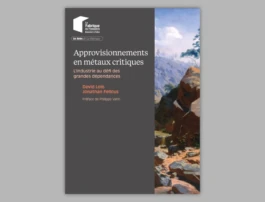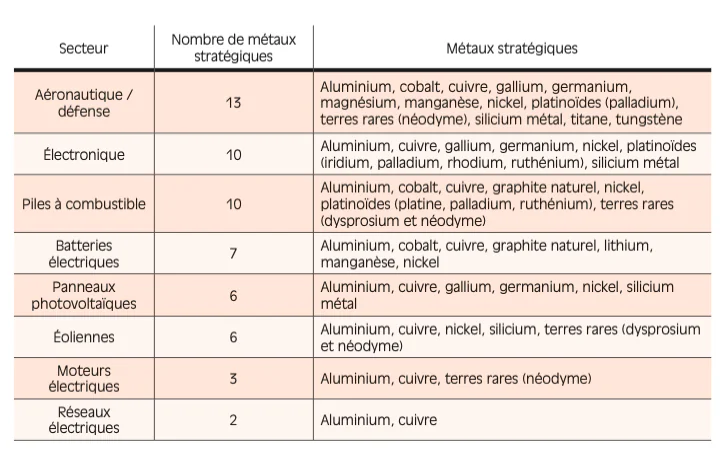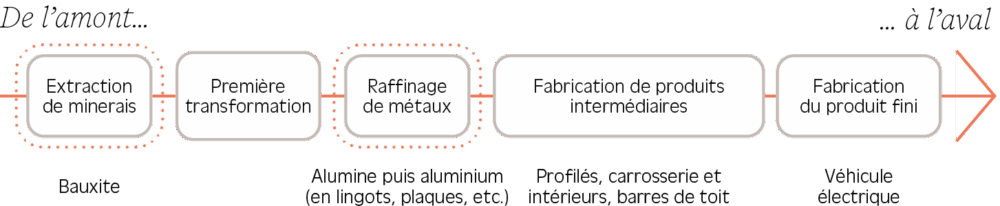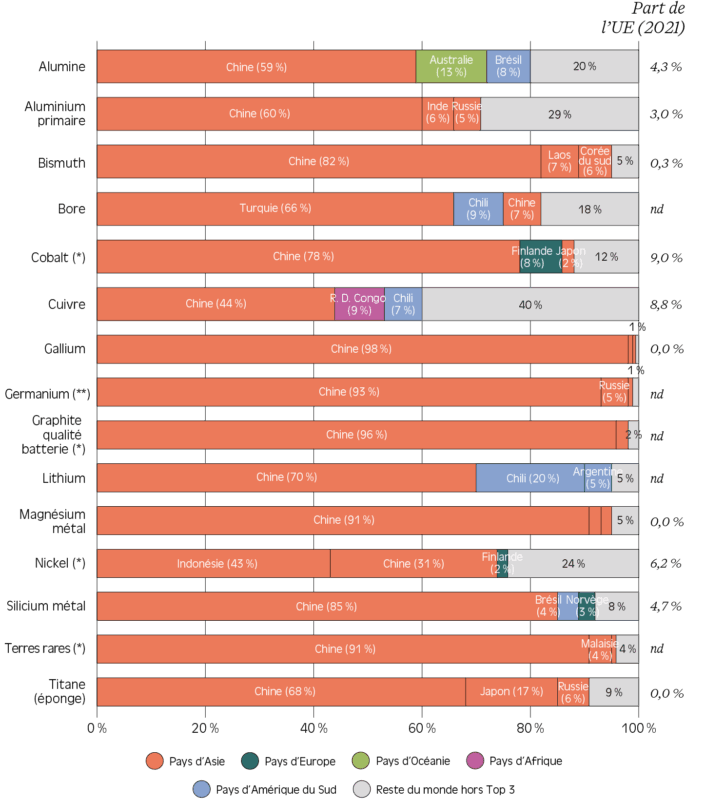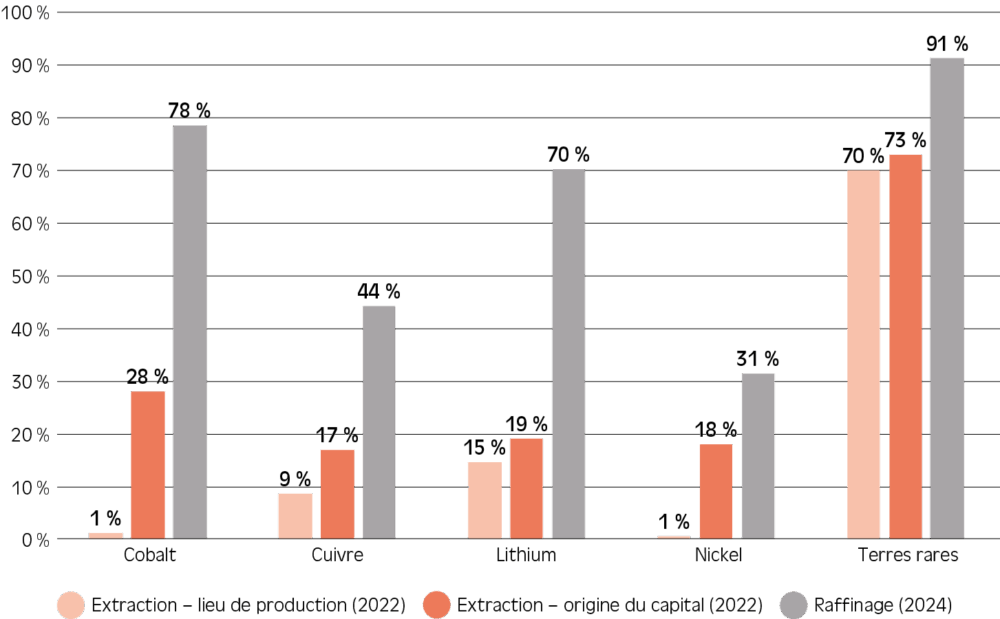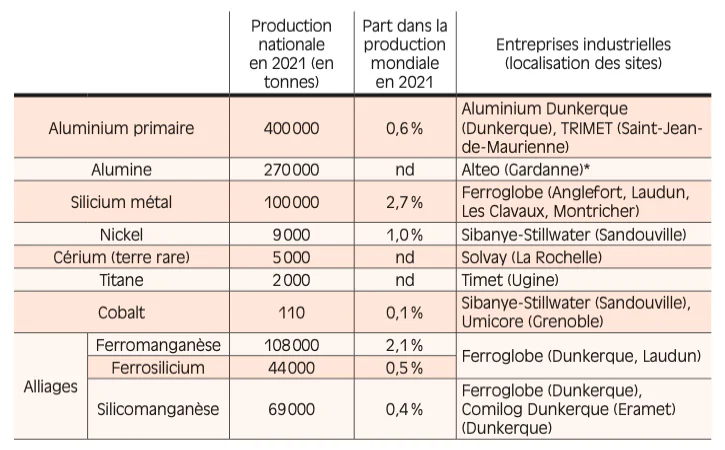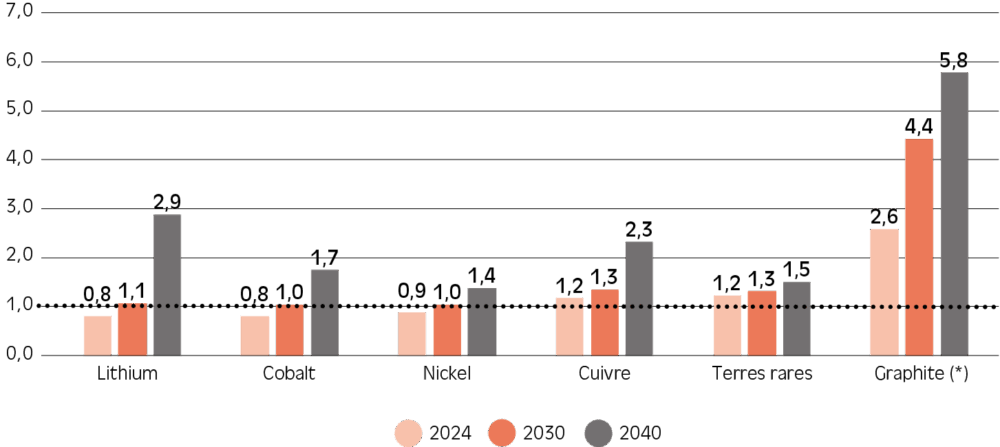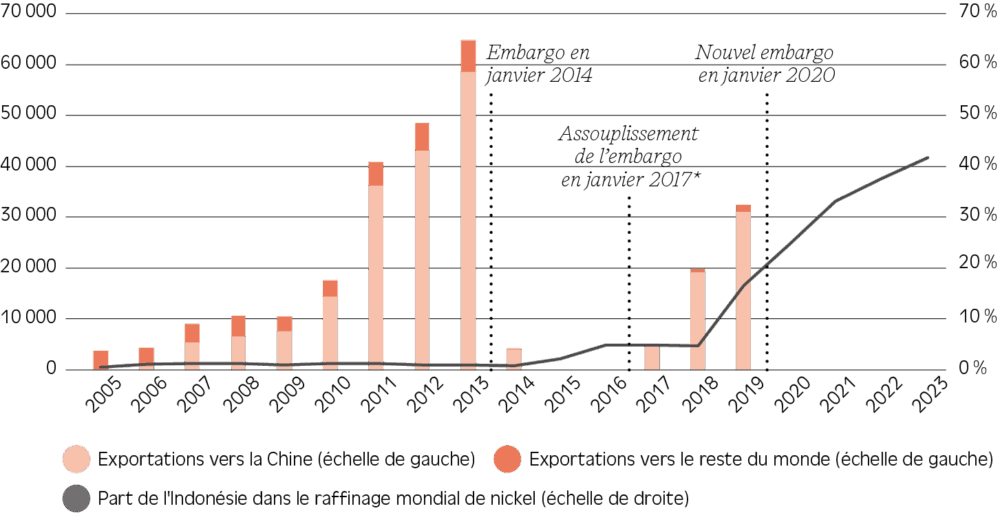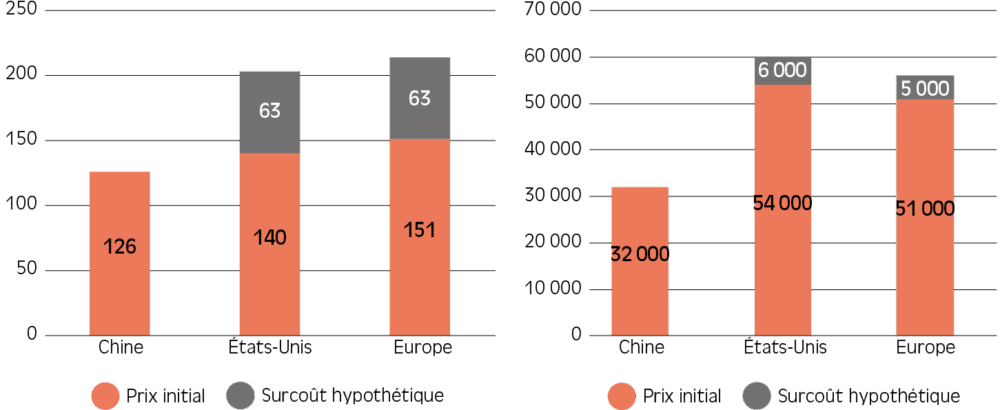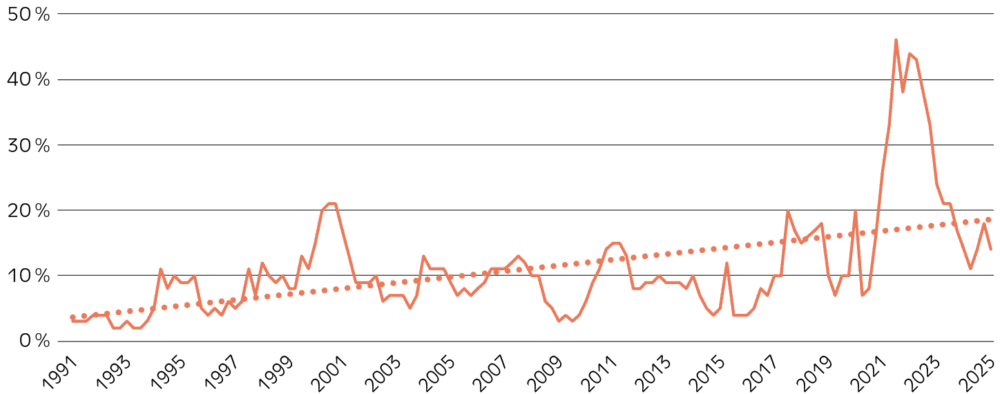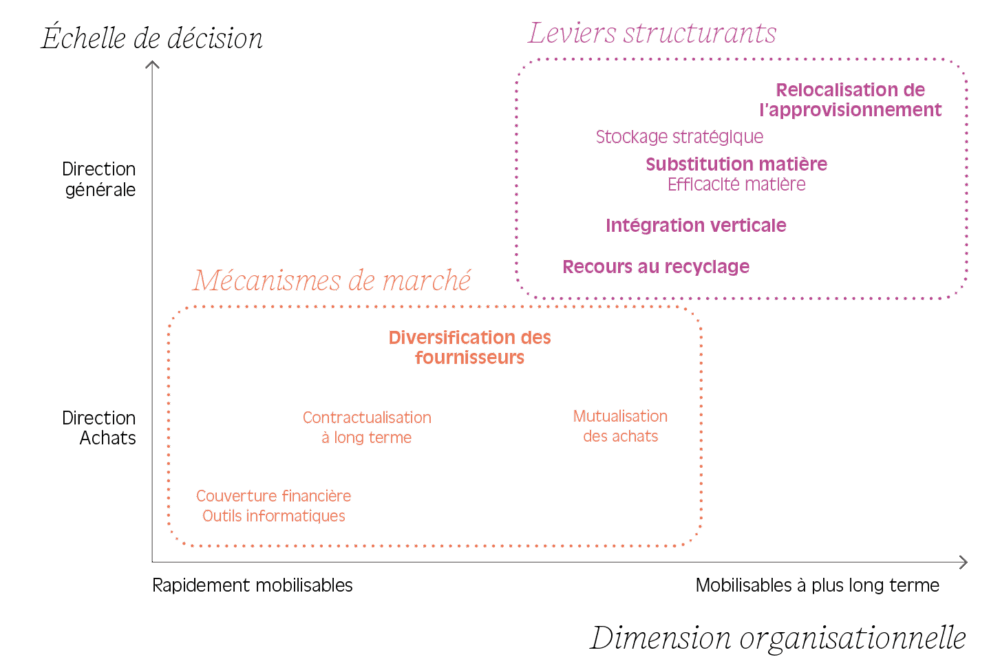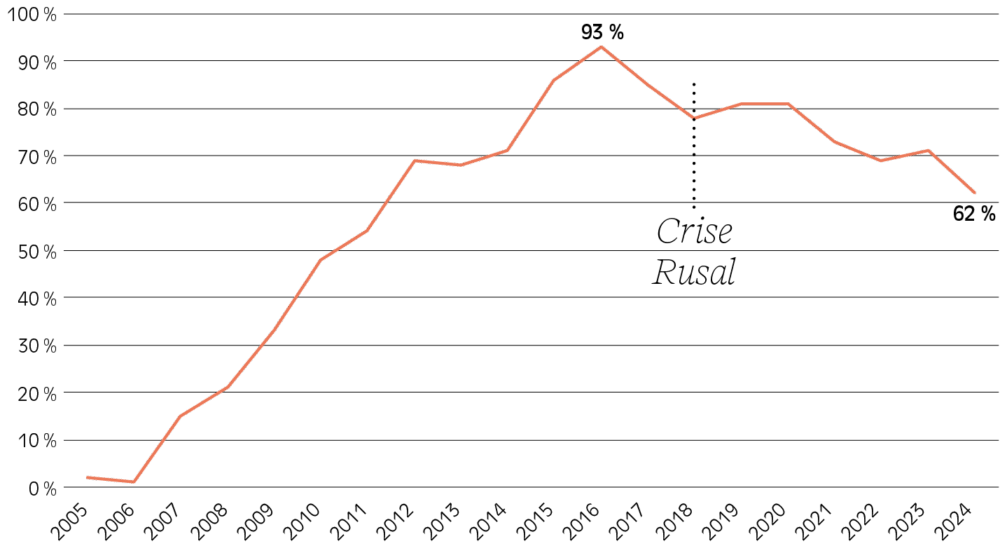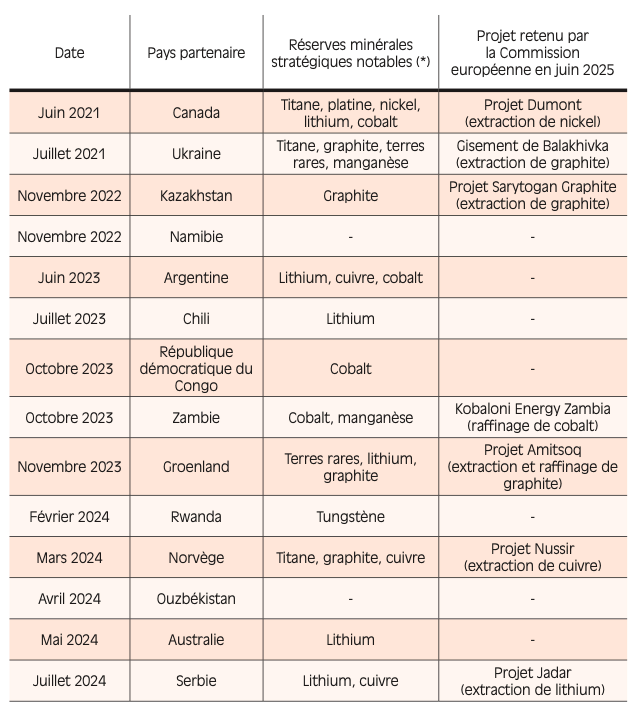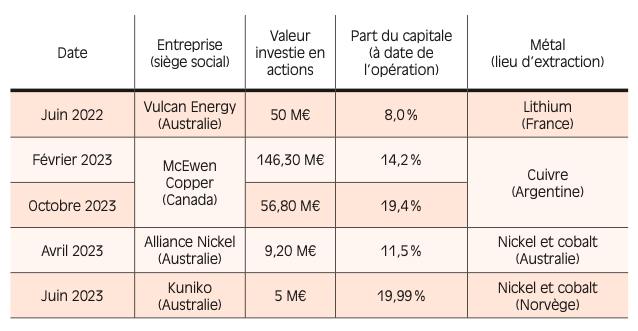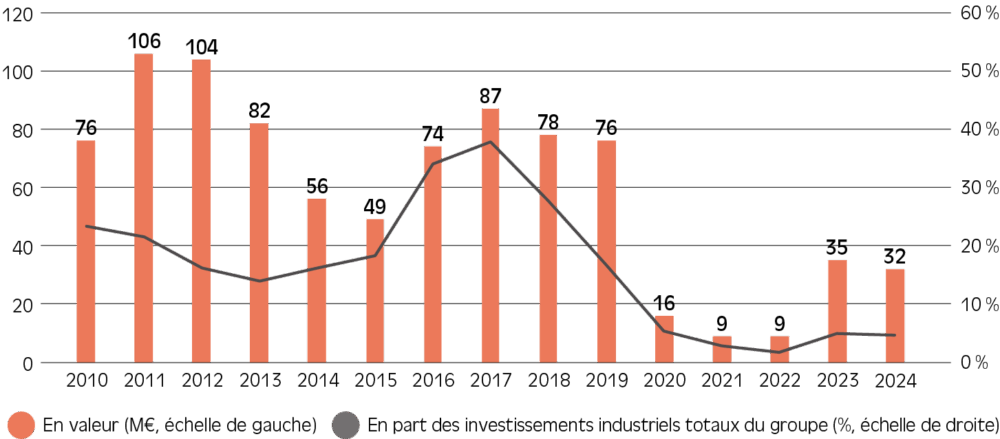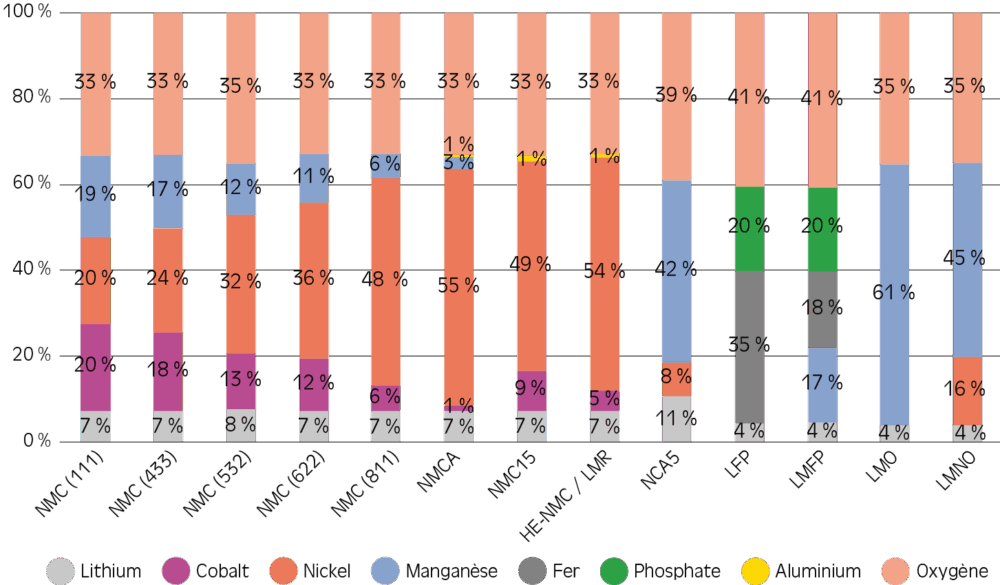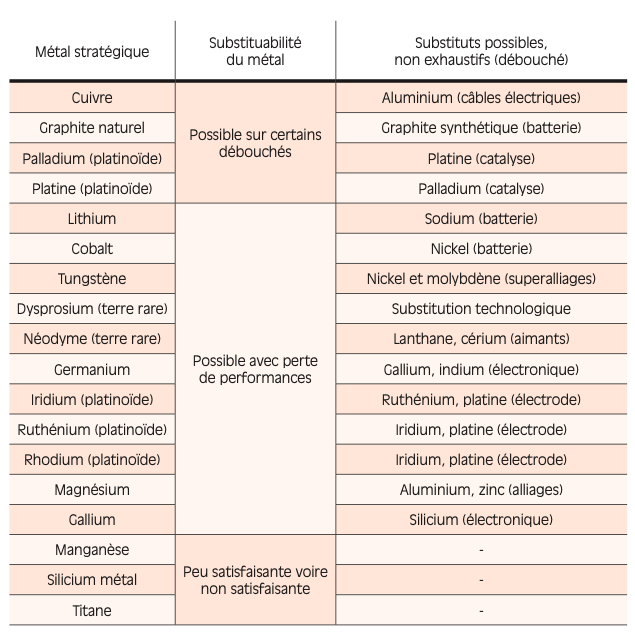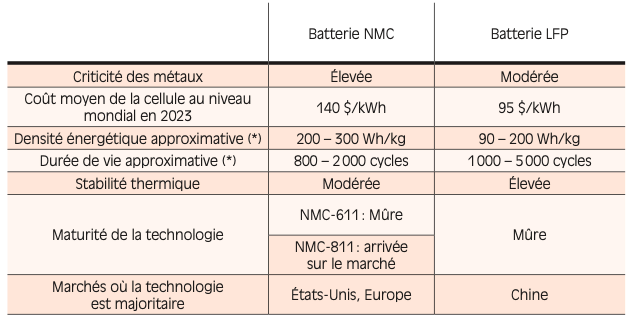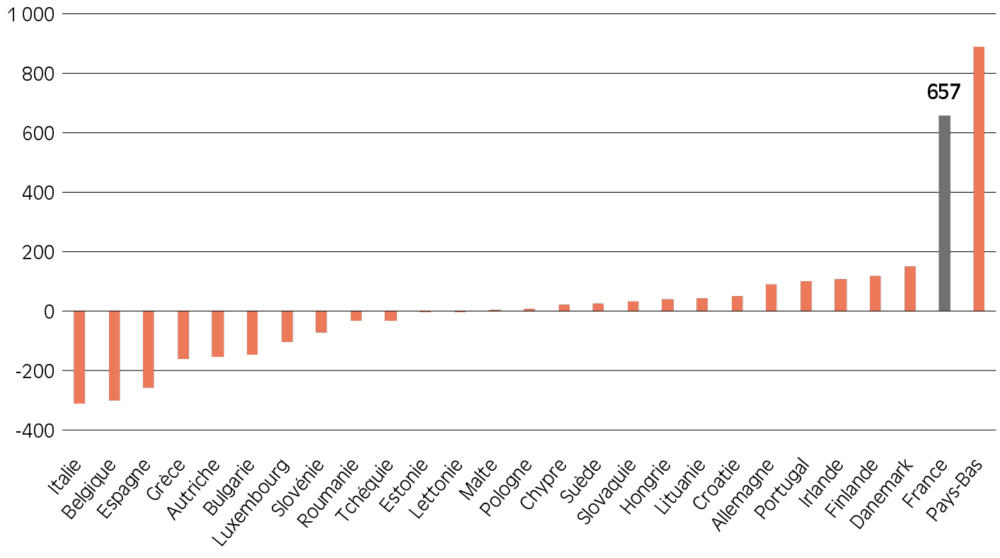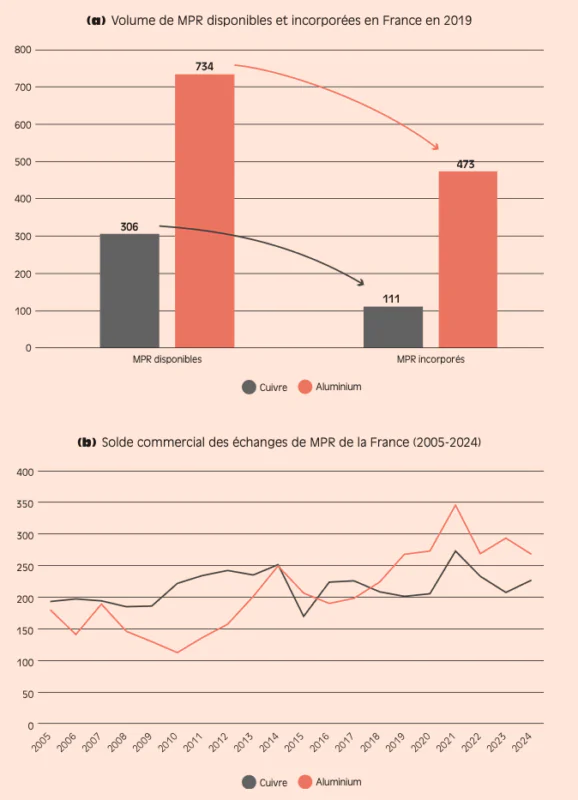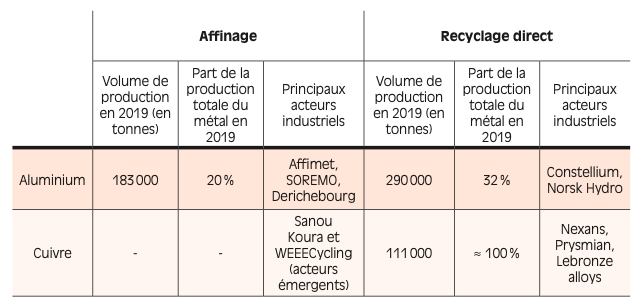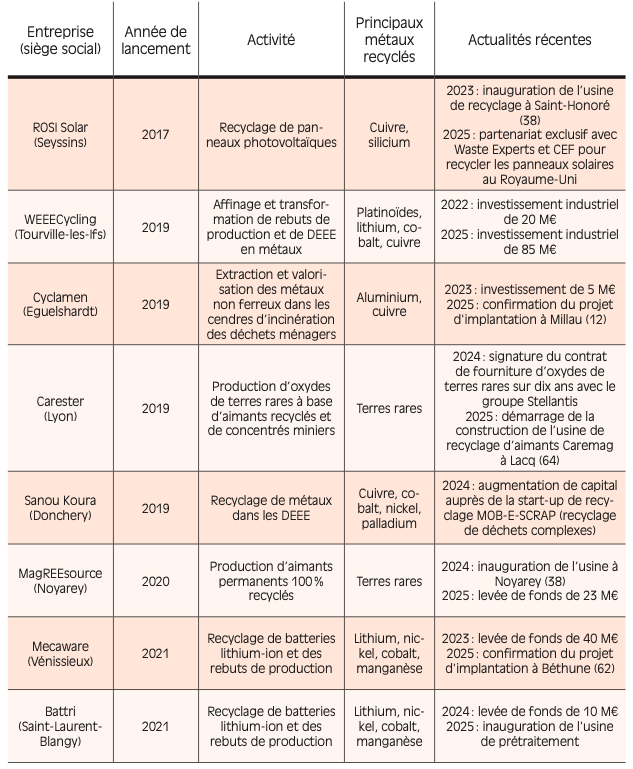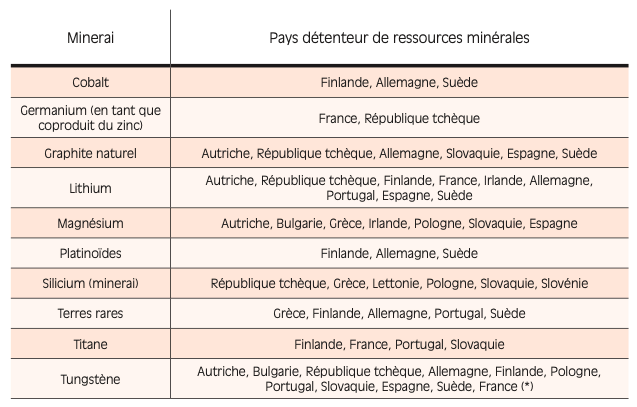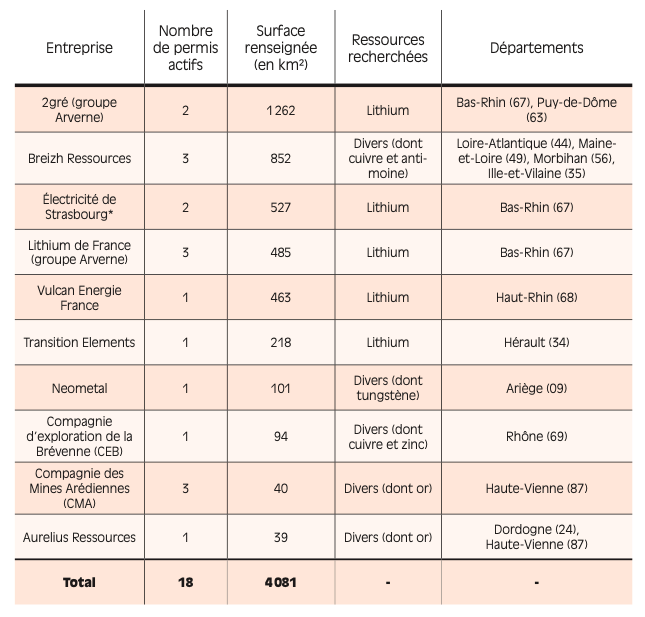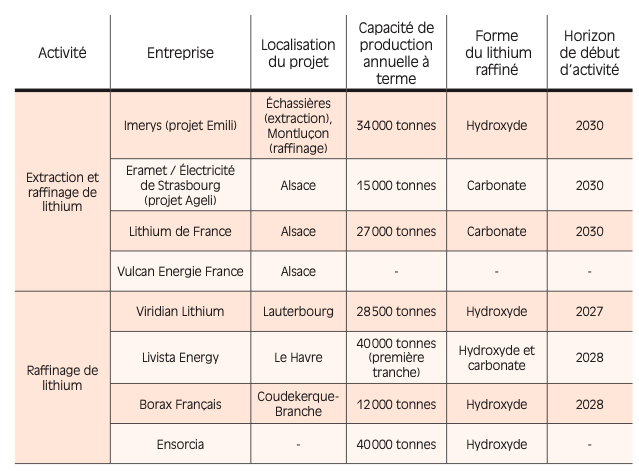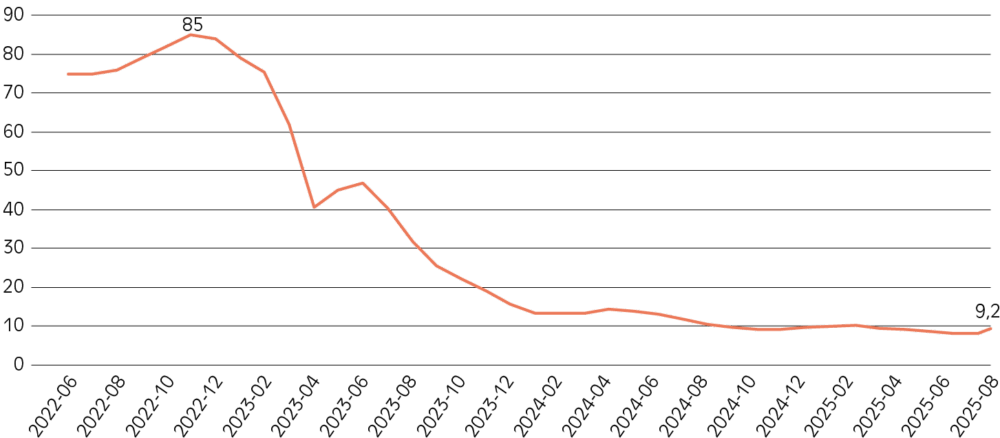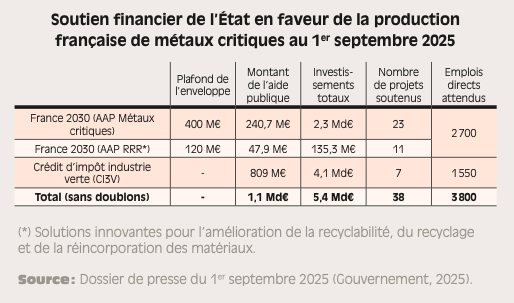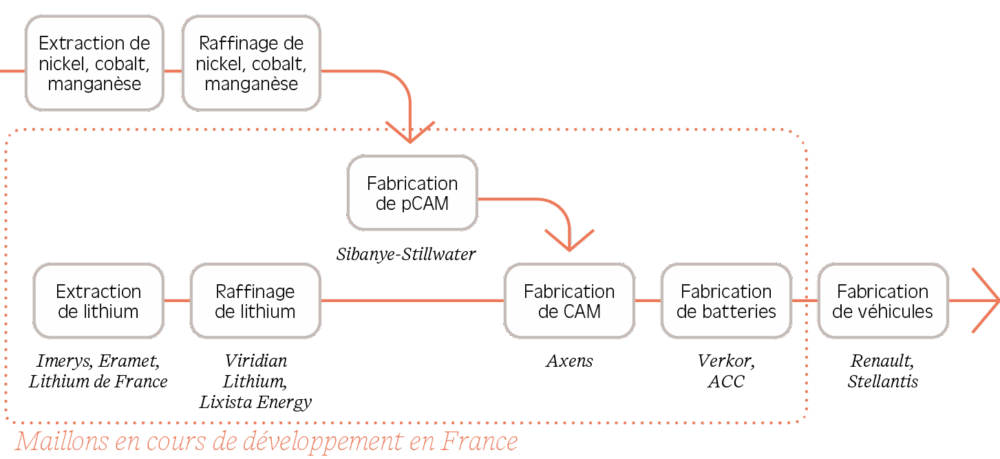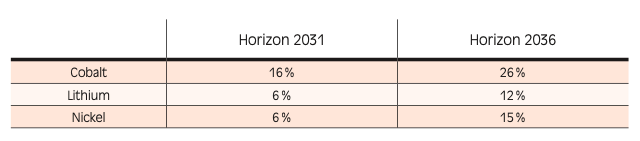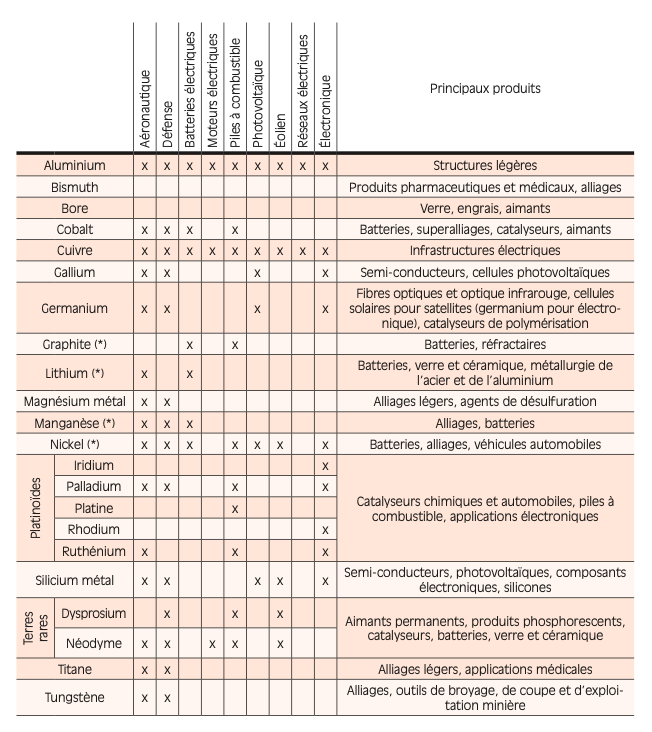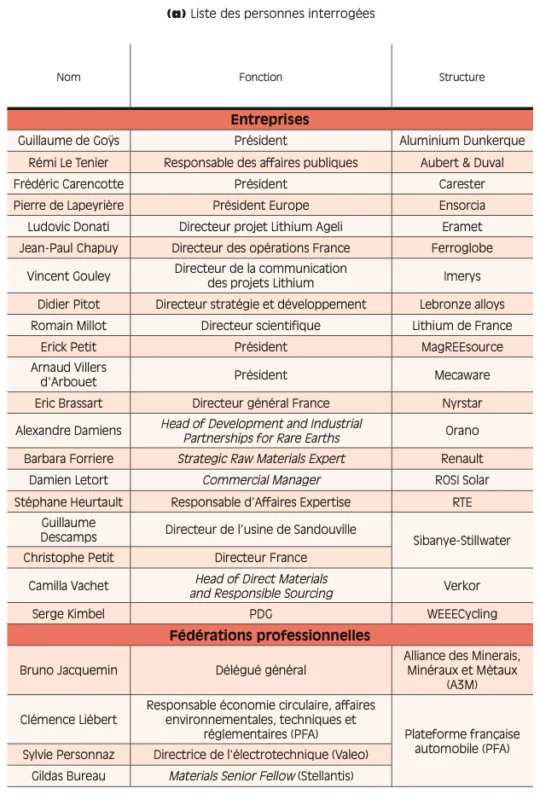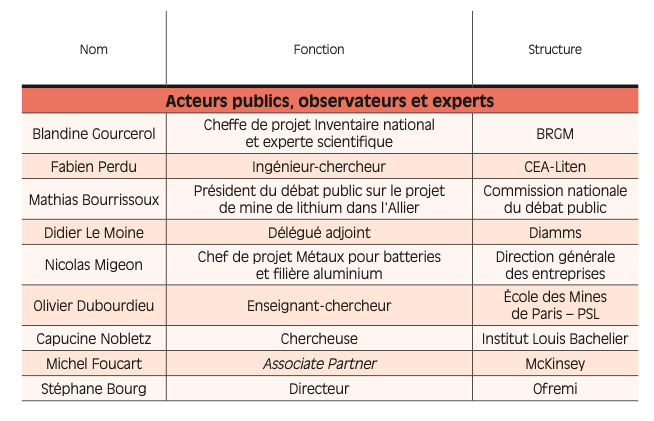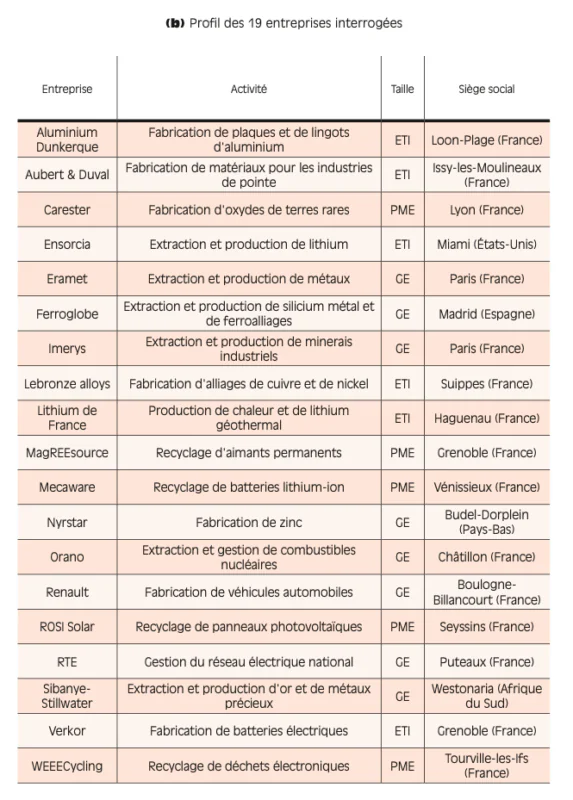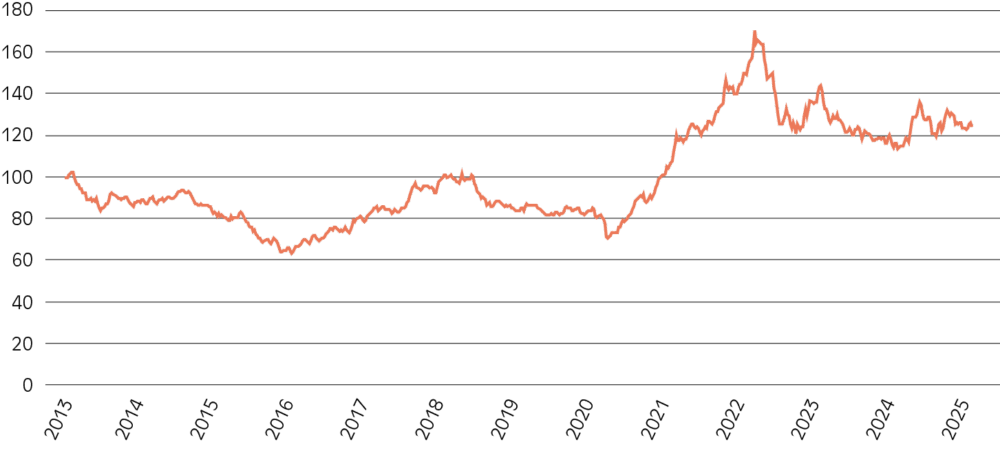Approvisionnements en métaux critiques. L’industrie au défi des grandes dépendances.

Préface
Des automobiles aux smartphones en passant par les infrastructures de transport électrique, les besoins mondiaux en métaux ne cessent de croître. Le lecteur de ces pages se rend-il compte que, au moment où nous entrons dans « l’ère des matériaux » pour développer les énergies renouvelables et électrifier les usages, nous devrions extraire de la planète au cours des 30 prochaines années autant de matériaux que depuis le début de l’humanité ?
Les approvisionnements de nos industriels sont-ils garantis ? Rien n’est moins sûr, comme alerte à raison cette étude de La Fabrique de l’industrie. Les crises d’approvisionnement qui ont affecté les chaînes de valeur européennes ces dernières années – crise sanitaire, pénurie de semi-conducteurs, guerre en Ukraine – nous invitent au contraire à une grande prudence. Sans compter qu’en matière d’approvisionnement en minerais et métaux, certains pays producteurs n’hésitent pas à en faire un levier géopolitique. Quinze ans après avoir provoqué une crise mondiale des terres rares, la Chine a introduit cette année des restrictionsd’exportations sur ces métaux, au grand dam desindustries américaines et européennes.
L’heure est donc à la sécurisation des approvisionnements en matières premières minérales. Je l’ai d’ailleurs appelée de mes vœux dans le cadre de la mission que le gouvernement m’a confiée entre septembre 2021 et janvier 2022. Il faut dire que la situation est préoccupante. L’industrie européenne souffre d’une impréparation de vingt ans par comparaison avec la Chine et s’avère dépendante du reste du monde à hauteur de 70 % de ses besoins en métaux stratégiques. La France, elle, est actuellement dépendante à 100 %, faute d’activité minière.
Dans ce contexte, comment les entreprises industrielles sécurisent-elles leurs approvisionnements en minerais et métaux ? C’est sur cette question stratégique que s’attarde cet ouvrage de La Fabrique de l’industrie.
S’appuyant sur une campagne d’entretiens, les auteurs offrent une immersion riche et documentée dans les multiples stratégies d’entreprises. Car, comme ils le rappellent, les approvisionnements sont, dans une économie de marché, à la discrétion des dirigeants. De la diversification des fournisseurs à la relocalisation minière, l’ouvrage livre un état des lieux nuancé des grands leviers de sécurisation. Une lecture nécessaire qui illustre les efforts en cours des industriels mais également les nombreux freins techniques et économiques auxquels ils se heurtent dans leurs démarches.
Parce qu’il en va de notre souveraineté, la puissance publique a un rôle à jouer pour les accompagner. Soutien des investissements miniers et industriels dans le cadre de France 2030, création de l’Observatoire Français des Ressources Minérales pour les filières industrielles (Ofremi), pour développer l’intelligence minérale, création de la délégation interministérielle aux approvisionnements en minerais et métaux stratégiques (Diamms) pour insuffler une diplomatie des matières premières, création d’un fonds public-privé pour investir dans la chaîne de valeur des métaux… : je me réjouis de voir ainsi posées les bases d’une politique française de sécurisation des approvisionnements, qu’il reste maintenant à consolider et prolonger à l’échelle européenne.
Je remercie La Fabrique de l’industrie de s’être saisie de ce sujet complexe mais majeur dans le contexte d’incertitude économique et géopolitique que nous traversons.
Philippe Varin
président de la Chambre de Commerce Internationale, auteur du rapport au Gouvernement sur la sécurisation des approvisionnements en matières premières minérales
Merci
Les auteurs remercient grandement grandement les 33 personnes rencontrées dans le cadre de cette étude. Les retours de terrain ont été particulièrement précieux pour étayer notre réflexion sur les arbitrages de sécurisation des approvisionnements à l’échelle microéconomique. Nous les remercions pour l’intérêt porté à notre travail, pour le temps qu’ils ont accordé ainsi que pour leur validation des verbatims.
Les auteurs remercient également l’ensemble de l’équipe et des prestataires de La Fabrique de l’industrie pour leur précieuse relecture de l’étude et pour leur appui continu lors de l’édition de cet ouvrage.
Pour résumer
Depuis le début des années 2010, les épisodes de tensions sur les approvisionnements en minerais et en métaux mettent en lumière tout à la fois les fortes dépendances de l’Union européenne aux pays tiers et la criticité de ces matières premières dans les activités industrielles. La crise des terres rares en 2010-2011 a rappelé la domination de la Chine dans la fourniture de ces métaux nécessaires à la production d’aimants et de moteurs électriques, eux-mêmes indispensables à la composition des éoliennes ou encore des véhicules électriques. La crise Rusal en 2018 a quant à elle révélé la forte dépendance de l’industrie française de l’aluminium à l’aluminerie irlandaise détenue par le groupe russe du même nom. Plus récemment, le déclenchement de la guerre en Ukraine en 2022 a souligné la dépendance de l’industrie aéronautique et de défense au titane produit en Russie.
Cette dépendance européenne s’inscrit dans un contexte de forte concentration géographique de la production de métaux non ferreux, de l’extraction de minerais au raffinage de métaux. À l’échelle mondiale, l’activité minière apparaît ainsi plus concentrée encore que l’extraction de charbon et de gaz naturel. Elle est notamment répartie en Asie de l’Est, en Océanie, en Afrique et en Amérique du Sud. Les activités industrielles de raffinage sont, elles, concentrées en Chine, qui en exerce à quelques exceptions près, un quasi-monopole. Sur la base de ressources minières intérieures ou importées, la Chine représente par exemple 70 % du raffinage mondial de lithium, 91 % du raffinage de terres rares et jusqu’à 98 % du raffinage de gallium. Dans ce panorama, la France et l’Union européenne sont des puissances secondaires, à la fois en matière d’extraction minière et de raffinage.
L’omniprésence chinoise est le fruit d’un dirigisme économique fort de l’État chinois, qui a anticipé de longue date – dès les années 1980 s’agissant des terres rares – la criticité des métaux non ferreux dans la transition énergétique. La Chine a mis en place une véritable stratégie d’intégration verticale, par le biais de partenariats stratégiques avec les puissances minières et de soutien à l’internationalisation des groupes chinois (publics et privés), pour s’assurer de son approvisionnement en minerais. En témoigne la forte pénétration des capitaux chinois en République démocratique du Congo pour y capter les minerais de cobalt.
Les tensions d’approvisionnement en métaux ont plusieurs causes. D’une part, elles découlent du déséquilibre structurel et croissant entre l’offre et la demande, celle-ci étant notamment tirée par les besoins de la transition énergétique. D’autre part, elles sont renforcées par la fragilité du libre-échange des minerais et des métaux, matérialisée par la mise en place de barrières commerciales (taxes et restrictions à l’exportation, jusqu’à l’embargo pur et simple) de la part de certains pays producteurs non européens. Sur le premier semestre 2025, le Gabon a annoncé la mise en place d’un embargo sur les minerais de manganèse à partir de 2029 ; la Chine, quant à elle, a mis en place des restrictions à l’exportation de terres rares et d’aimants permanents, sur fond de guerre commerciale avec les États-Unis.
Dans ce contexte, notre campagne d’entretiens qualitatifs met en lumière une prise de conscience des risques d’approvisionnement de la part des donneurs d’ordre industriels. Au lendemain du déclenchement de la guerre en Ukraine, les groupes Airbus et Safran, acteurs majeurs de l’industrie française aéronautique et de défense, ont réduit leur exposition au titane russe en diversifiant leurs sources d’approvisionnement et en rachetant leur fournisseur Aubert & Duval. Face aux tensions croissantes sur les métaux des batteries électriques (lithium, cobalt, nickel, etc.), les constructeurs automobiles Stellantis et Renault s’impliquent sur l’amont de leur chaîne de valeur, en contractualisant directement auprès d’entreprises minières voire en rentrant à leur capital. Ils exploitent également des opportunités de substitution matière, en témoigne leur diversification en cours vers les batteries LFP en parallèle des batteries NMC.
Sur l’ensemble des mesures possibles pour réduire les risques d’approvisionnement, nous constatons après enquête de terrain que trois leviers sont considérés avec la plus vive attention par les industriels : la diversification du sourcing, l’intégration verticale et la substitution matière. Pour autant, notre étude révèle aussi que ces leviers ne sont pas gratuits, et que leur promesse de sécurisation peut être, en pratique, fragile. Ainsi, la diversification du sourcing peut générer des coûts logistiques supplémentaires et cacher une dépendance plus en amont sur la chaîne d’approvisionnement. L’intégration verticale, de son côté, se heurte aux lourdes barrières à l’entrée qui caractérisent chaque maillon de la chaîne de valeur (de l’extraction du minerai jusqu’à l’assemblage du produit) et n’immunise pas les entreprises contre des chocs exogènes tels que les mesures protectionnistes. La substitution matière, enfin, est tributaire des avancées lentes et incertaines de la recherche technologique et peut se cantonner à déplacer la dépendance sur le tableau de Mendeleïev.
En parallèle, l’Union européenne, dans le cadre du Critical Raw Materials Act adopté en mars 2024, a également pour ambition de développer une offre européenne et décarbonée de métaux stratégiques. Cette offre alternative s’appuie d’un côté sur le recyclage des métaux à partir de déchets existants (filière secondaire) et de l’autre sur le développement de nouvelles activités minières et de raffinage (filière primaire). La France est une véritable vitrine de cette nouvelle ambition. Notre pays est notamment en passe d’héberger une filière de recyclage d’aimants permanents qui devrait permettre de couvrir la totalité des besoins nationaux de terres rares d’ici 2030, d’après les estimations du gouvernement. En parallèle, la France a entamé la mise à jour de son inventaire minier, en avance par rapport à ses voisins, et peut d’ores et déjà compter sur ses gisements connus de lithium, en Alsace et dans l’Allier. De nombreux projets miniers se positionnent à l’horizon 2030, signant un espoir de relance de l’activité minière en France métropolitaine, jusqu’à aujourd’hui cantonnée à de la bauxite non métallurgique. À l’horizon 2030, le gouvernement estime que 40 % de la demande nationale de lithium pour les batteries électriques pourra être couverte par la production française.
Pourtant, des défis industriels et économiques subsistent. La relocalisation d’une filière primaire des métaux emporte d’abord des lourdeurs administratives, auxquelles s’ajoutent des défis d’acceptabilité locale. À ce jour, entre dix à quinze ans séparent le recensement d’un gisement minier du début de son exploitation à grande échelle. Ensuite, la compétitivité d’une offre française et européenne n’est pas acquise face à la concurrence étrangère. Faute d’une filière compétitive de recyclage, la France est aujourd’hui le deuxième exportateur net de déchets de métaux non ferreux de l’Union européenne. Par ailleurs, les modèles d’affaires des porteurs de projets peuvent être fragilisés par une baisse des prix des métaux primaires, dont les cours s’avèrent particulièrement volatiles. Enfin, les promesses de sécurisation ne se confirment que si la chaîne d’approvisionnement est relocalisée de l’amont à l’aval pour éviter la fuite des matières. Charge donc au marché européen dans son ensemble de privilégier un approvisionnement européen face à l’offre étrangère, et notamment chinoise.
Introduction
Allant de pair avec la croissance économique et le développement industriel et technologique, la demande mondiale en métaux a été multipliée par 4 entre 1970 et 2019, soit une augmentation 2,5 fois plus forte encore que celle de la population mondiale (Baffes et Nagle, 2022). À ces déterminants structurels s’ajoutent aujourd’hui des besoins croissants en métaux du fait de la transition énergétique. Prenant le relais des énergies fossiles (charbon, pétrole, gaz naturel), l’électrification des usages entraîne en effet une forte progression des besoins en équipements électriques et, en amont, en minerais et en métaux à partir desquels ces équipements sont produits. Parmi eux figurent par exemple le cuivre et l’aluminium, métaux de base entrant dans la composition des câbles de transport d’électricité, des batteries et des panneaux photovoltaïques, les terres rares pour les aimants permanents de certains moteurs électriques et de générateurs d’éoliennes, le nickel et le lithium pour les batteries électriques ou encore le silicium métal pour les panneaux photovoltaïques. D’après les projections de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), la demande mondiale, pour être compatible avec l’atteinte de la neutralité carbone en 2050, devrait par exemple être multipliée par 1,8 entre 2024 et 2050 s’agissant du silicium métal, par 2,5 pour le cuivre, par 8,0 pour le nickel et par 13,1 pour le lithium. La dépendance énergétique mondiale se déplace donc des énergies fossiles vers les ressources minières et les métaux (Hache et Louvet, 2023).
L’approvisionnement en minerais et en métaux des entreprises industrielles n’est pourtant pas acquis. D’une part, les projections mondiales de l’AIE indiquent que l’offre de métaux augmentera moins que la demande, ce qui augure, toutes choses égales par ailleurs, de fortes tensions sur les ressources et sur leur prix (Aubert et al. , 2024). À titre d’exemple, au niveau mondial, la production de lithium en 2040 ne devrait couvrir que 30 % des besoins permettant d’atteindre la neutralité carbone d’après l’AIE. D’autre part, les entreprises françaises et européennes pâtissent d’une situation de dépendance structurelle aux puissances extra-européennes, et notamment à la Chine. Celles-ci dominent tantôt les activités d’extraction de minerais, tantôt de raffinage de métaux, et peuvent, en pratique, conditionner voire interdire le libre-échange de ces matières au gré de leurs intérêts économiques et géopolitiques. En avril 2025, la Chine a par exemple instauré des licences sur les exportations de terres rares dans le cadre de sa guerre commerciale avec les États-Unis, entraînant dans son sillage des hausses de prix et des tensions d’approvisionnements en Europe, notamment dans l’industrie automobile.
Le sujet de la sécurisation des approvisionnements en minerais et en métaux a intégré l’agenda institutionnel européen à la fin des années 2000 avec l’initiative Matières premières publiée en 2008. C’est dans le cadre de cette initiative que la Commission tient à jour, depuis 2011, une liste de matières premières qu’elle juge « critiques »1. En France, un comité des métaux stratégiques, lieu de concertation entre acteurs publics et acteurs économiques, a été créé en 2011 à la suite d’une crise mondiale des terres rares provoquée par la Chine (Hache, 2023). La problématique de la sécurisation des approvisionnements a fortement ressurgi dans le débat public depuis la crise sanitaire de 2020, dans un contexte plus large de prise de conscience des dépendances européennes (Boudinet et Khater, 2021). La communication de la Commission européenne, intitulée Résilience des matières premières critiques et publiée en septembre 2020, suivie à l’échelle nationale du rapport Varin, remis au gouvernement en janvier 2022, ont achevé de confirmer la forte dépendance européenne en matière d’approvisionnement en métaux. Ce diagnostic, mis en lumière par ailleurs par de nouvelles tensions d’approvisionnement (pénurie des semi-conducteurs en 2021 et guerre en Ukraine en 2022), a ainsi jeté les bases d’une nouvelle législation européenne, le Critical Raw Materials Act . Adopté en avril 2024 dans le cadre du plan industriel du Green Deal , ce règlement a vocation à garantir un approvisionnement sûr et durable en matières premières critiques. Parmi celles-ci, 17 matières premières jugées « stratégiques »2 font l’objet d’ambitions chiffrées d’approvisionnement européen pour 2030 : à cet horizon, les capacités européennes d’extraction, de transformation et de recyclage devront couvrir respectivement 10 %, 40 % et 25 % des besoins annuels de l’Union. Le règlement prévoit également qu’un pays fournisseur ne devra pas représenter à lui seul plus de 65 % de la consommation annuelle de métaux stratégiques de l’Union à ce même horizon.
Dans ce contexte de prise de conscience des pouvoirs publics, cette Note de La Fabrique de l’industrie cherche à explorer les leviers de sécurisation des approvisionnements à la portée des entreprises industrielles elles-mêmes. L’enjeu de la sécurisation des approvisionnements fait l’objet d’une littérature récente, notamment de la part des institutions publiques (Assemblée nationale, Sénat, ministère de la Transition écologique, ministère de l’Économie, Cour des comptes) et des centres de recherche et think tanks (Ifri, IRIS, CEPII, Institut Jacques Delors, Institut Montaigne). Toutefois, à notre connaissance, peu de travaux étudient le sujet à l’échelle microéconomique, alors même que les choix d’approvisionnement sont, dans une économie de marché, à la discrétion des entreprises. Cet angle mort apparent de la littérature s’explique probablement par le caractère sensible voire confidentiel du sujet. Entre 2018 et 2019, une enquête de terrain conduite par le Conseil général de l’économie et la fédération professionnelle A3M avait par exemple rencontré un succès relatif auprès du tissu industriel national (CGE, 2019).
Cette Note a donc vocation à enrichir la littérature existante en apportant des enseignements opérationnels sur les leviers et les freins de la sécurisation des approvisionnements à l’échelle des entreprises. Ces retours du terrain sont tirés d’une campagne de 30 entretiens conduits entre janvier et juillet 2025, dont 19 auprès d’entreprises ayant une activité ou un projet en France et 11 auprès d’acteurs et d’observateurs de l’écosystème (voir liste et méthodologie d’entretien en Annexe II). L’étude a une portée qualitative3 et se concentre, par souci de lisibilité et en lien avec l’échantillon d’entreprises interrogées, sur les matières premières jugées « stratégiques » par la Commission européenne4.
Cette étude se décompose en trois chapitres. Le premier donne la mesure de la concentration de l’offre mondiale de minerais et de métaux stratégiques et illustre les risques que cette situation fait peser sur les entreprises européennes. Le deuxième chapitre aborde trois leviers majeurs de sécurisation à la portée des entreprises – la diversification des fournisseurs, l’intégration verticale et la substitution matière – et met en lumière les contraintes techniques et économiques pouvant en freiner le recours par ces dernières. Le troisième chapitre s’attarde enfin sur les leviers d’approvisionnement à l’échelle européenne – le recyclage des métaux d’une part, la relocalisation d’activités minières et de raffinage d’autre part –, dont le développement à grande échelle se heurte encore à des défis industriels et économiques.
- 1 — Ce travail d’identification des matières critiques repose sur la compilation de plusieurs indicateurs chiffrés, comme l’importance économique du métal dans l’industrie européenne, la concentration géographique de la production et le degré de substituabilité. La première liste recensait 14 matières critiques, un volume qui a, depuis, plus que doublé pour s’élever à 34 matières critiques en 2023.
- 2 — Le CRM Act indique que « le caractère stratégique d’une matière première est déterminé sur la base de son importance au regard des transitions écologique et numérique et des applications dans les secteurs de la défense et de l’aérospatiale ». La liste et les débouchés des métaux stratégiques sont présentés en Annexe I.
- 3 — Pour un chiffrage des besoins nationaux en métaux critiques induits par la transition énergétique, le lecteur peut se référer aux estimations de l’Ademe réalisées dans le cadre de l’exercice prospectif « Transition(s) 2050 » (Ademe, 2022).
- 4 — Les approvisionnements français en uranium pour la filière nucléaire ne rentrent pas dans le périmètre de cette étude. Sur le sujet, le lecteur peut se référer aux travaux de l’IRIS (Meyer et Jeannin, 2025).
Des minerais aux métaux, La science irrigue une dépendance industrielle toujours la technologie préoccupante
L’approvisionnement des entreprises industrielles françaises et européennes en métaux stratégiques s’inscrit dans un contexte de forte dépendance à l’offre mondiale. Ce premier chapitre souligne d’abord la concentration de l’offre par les puissances extra-européennes, puis identifie et illustre les risques que cette situation fait peser sur l’approvisionnement des entreprises européennes, des métallurgistes jusqu’aux donneurs d’ordre.
Une mainmise étrangère, et surtout chinoise, sur l’offre mondiale
Les métaux, à la base des chaînes de valeur industrielles
Sur la base de leurs propriétés physiques (conductivité, résistance, légèreté, etc.), les métaux entrent dans la composition de nombreux produits industriels. L’industrie aéronautique et de défense, incarnée en France par des groupes comme Airbus et Safran, a par exemple une consommation très diversifiée de métaux, notamment sous forme d’alliages. Parmi eux figurent les alliages de titane, métal reconnu pour sa résistance à la corrosion, ou encore les alliages de manganèse et d’aluminium, reconnus pour leur légèreté (voir figure 1.1). L’industrie automobile, incarnée à l’échelle nationale par les groupes Renault et Stellantis, apparaît elle aussi gourmande en métaux, notamment dans sa mue vers la mobilité électrique. D’une part, les batteries électriques consomment, entre autres matières stratégiques, du lithium et du graphite naturel5 ; d’autre part, les moteurs électriques intègrent des terres rares. Comme le résume Barbara Forriere (Expert for Strategic Raw Materials chez Renault Group) « dans une voiture, il y a quasiment tout le tableau de Mendeleïev ». Moins présente en France et en Europe, l’industrie des énergies renouvelables requiert, de son côté, de nombreux métaux, comme le gallium, le germanium et le silicium métal, rentrant dans la composition des panneaux photovoltaïques ainsi que les terres rares (matière première des aimants permanents) rentrant dans la composition des générateurs des éoliennes. Enfin, le cuivre et l’aluminium, du fait de leur bonne conductivité électrique, sont au cœur des infrastructures de transport d’électricité, gérées en France par le groupe RTE.
Figure 1.1 – Consommation de métaux dans les secteurs stratégiques
Réalisation : La Fabrique de l’industrie d’après Mineralinfo.
Note : Le classement ici présenté n’est pas pondéré, il repose sur le recensement du nombre de métaux stratégiques consommés dans chaque secteur, indépendamment des volumes nécessaires pour chacun de ces métaux.
Or, l’offre mondiale en métaux stratégiques s’avère particulièrement concentrée hors de l’Union européenne. La production des métaux se décompose en plusieurs grandes étapes (Commissariat général au développement durable, 2023). La première étape est l’extraction des minerais. Cette activité s’opère dans des mines (souterraines ou à ciel ouvert), et plus rarement en carrières6. Elle peut être assurée à grande échelle par des entreprises dans des mines dites « industrielles » ou par des artisans mineurs dans des mines dites « artisanales ». L’étape d’extraction est suivie de la première transformation des minerais, comportant des opérations mécaniques de concassage et de broyage, puis des opérations physiques ou chimiques de séparation et de concentration des minerais. Cette transformation peut être assurée soit in situ, sur le site d’extraction, soit sur des plateformes logistiques par des intermédiaires, comme des négociants de matières premières, qui se chargent de compiler et de trier des minerais de diverses sources (Trafigura, 2017). La dernière étape de production, réalisée sur un site industriel, est la purification et la transformation des minerais en métaux à l’aide de procédés métallurgiques énergivores (pyrométallurgie, hydrométallurgie, électrométallurgie). La littérature résume cette deuxième étape par le terme de « raffinage ».
La suite de ce chapitre étudie la concentration géographique de l’extraction de minerais d’une part, et du raffinage de métaux d’autre part (encadrés en pointillés sur la figure 1.2).
Figure 1.2 – Chaîne de valeur industrielle simplifiée : exemple de l’aluminium contenu dans un véhicule électrique
Réalisation : La Fabrique de l’industrie.
Une forte concentration de l’activité minière
La concentration géographique de l’offre de métaux stratégiques s’observe d’abord sur les activités d’extraction de minerais. Cette activité est localisée notamment en Asie, en Afrique du Sud, en Océanie et en Amérique du Sud (figure 1.3). En Asie par exemple, la Chine représente à elle seule 69 % de l’extraction mondiale de minerais de terres rares, 78 % de l’extraction de graphite naturel et jusqu’à 82 % de l’extraction de tungstène d’après les données de l’United States Geologic Survey pour l’année 20247. En Afrique, la République démocratique du Congo héberge 76 % de l’extraction mondiale de cobalt, et l’Afrique du Sud assure 71 % de l’extraction mondiale de platine. À la croisée de l’Europe et de l’Asie, la Russie est également une puissance minière notable, en particulier sur le palladium dont elle assure 40 % de l’extraction mondiale. Pour tous les minerais stratégiques à l’exception du cuivre, les trois premiers pays producteurs cumulent au moins 75 % de la production mondiale. En comparaison, la part des trois premiers pays producteurs s’élevait, en 2019, à 42 % pour l’extraction de charbon et à 47 % pour l’extraction de gaz naturel (AIE, 2021).
Dans ce paysage minier, l’Union européenne apparaît secondaire voire marginale sur le périmètre des minerais stratégiques. Aucun pays européen ne figure au podium mondial en matière d’extraction. Le Vieux Continent présente toutefois des activités notables d’extraction de minerais de magnésium (10,8 % de la production mondiale en 2021, répartie notamment en Autriche, en Espagne, en Slovaquie et en Grèce) et de cuivre (4,5 % de l’offre, répartie notamment en Pologne, en Espagne et en Suède).
Figure 1.3 – Répartition du volume d’activité mondial d’extraction de minerais stratégiques en 2024 (en % du tonnage mondial)
Source : USGS, données 2024. Les trois premiers pays extracteurs sont représentés.
nd : non disponible.
Note de lecture : En 2024, la Guinée, l’Australie et la Chine représentaient 72 % de l’extraction mondiale de bauxite. Le reste du monde représentait 28 %.
Une domination chinoise sur le raffinage
La localisation des activités hors d’Europe est plus frappante encore au niveau du maillon suivant de la chaîne de valeur, le raffinage des métaux à partir des minerais. À cette étape industrielle, la concentration se renforce systématiquement au profit de la Chine (figure 1.4). Présente au podium mondial du raffinage pour tous les métaux stratégiques, la Chine assure à elle seule 70 % de la production mondiale de lithium, 78 % de la production mondiale de cobalt et jusqu’à 91 % pour les terres rares et 98 % pour le gallium. En calculant l’indice Herfindahl-Hirschman8 pour le raffinage de l’alumine, du cobalt, du cuivre et du nickel, Bucciarelli et al. (2024) soulignent que la concentration mondiale s’est même accentuée depuis 1995 pour ces quatre matières au profit de la Chine. Seules la Turquie et l’Indonésie la devancent à la première place du podium mondial, respectivement sur le raffinage de bore et le raffinage de nickel.
Figure 1.4 – Répartition du volume d’activité mondial de raffinage de métaux stratégiques en 2024 (en % du tonnage mondial)
Sources : USGS, données 2024. Les trois premiers pays extracteurs sont représentés.
(*) AIE, données 2024. (**) World Mining Data, données 2023.
nd : non disponible.
Note de lecture : En 2024, la Chine, l’Australie et le Brésil représentaient 80 % du raffinage mondial d’alumine. Le reste du monde représentait 20 %.
L’Union européenne héberge quant à elle des activités de raffinage de plusieurs métaux stratégiques, y compris en France (voir plus bas), mais dans des proportions minimes par comparaison avec le reste du monde. Elle ne produit pas de magnésium métal, alors qu’elle en extrait la matière première minérale, la magnésite, ce qui suggère que celle-ci s’adresse à des débouchés non métallurgiques (chimie, matériaux réfractaires, etc.). Seule la Finlande se distingue à l’échelle mondiale ; elle est le deuxième pays producteur de cobalt (8 % de la production mondiale en 2024) et le troisième pays producteur de nickel (2 % de la production mondiale).
De la mine au raffinage, la maîtrise verticale de la Chine
L’omniprésence chinoise découle d’une stratégie de l’État, inscrite dans les plans quinquennaux, de maîtriser de bout en bout la chaîne de production des métaux dont il a anticipé de longue date la criticité dans les technologies énergétiques et numériques d’avenir (Bonnet et al., 2022). Dans le cadre des cinquième, sixième et septième plans quinquennaux, l’État chinois a par exemple investi à partir des années 1980 dans des capacités de production de terres rares, production qui était alors dominée par les États-Unis. La Chine en détient aujourd’hui un quasi-monopole mondial, par l’intermédiaire d’entreprises publiques. Avec le treizième plan quinquennal (2016-2020) et le plan décennal Made in China 2025, la Chine s’est engagée dans « une bataille décisive pour l’industrie des métaux non ferreux » avec l’ambition de devenir la première puissance mondiale dans les technologies des transitions énergétique et numérique (Bonnet et al., 2022).
Comme l’indique Stéphane Bourg (directeur de l’Ofremi) : « Il y a quarante ans, les Chinois étaient sur la mine ; il y a trente ans, sur la mine et le raffinage ; et aujourd’hui, sur la mine, le raffinage, les aimants 9, les moteurs des voitures et les éoliennes. » Bruno Jacquemin (délégué général d’A3M) le résume ainsi : « Les Chinois ont descendu les chaînes de valeur. »
La part plus importante de la Chine sur l’étape de raffinage que sur l’étape d’extraction témoigne de la capacité des groupes industriels chinois à capter une partie des ressources minières mondiales pour les raffiner en Chine. Les données commerciales en donnent la mesure : en 2024, la Chine captait 59 % des importations mondiales de minerais de titane en volume, 73 % de minerais de nickel et 88 % de bauxite d’après les statistiques de l’ITC. Cette maîtrise des flux commerciaux de minerais est adossée à une stratégie nationale d’investissements au sein des pays producteurs et pouvant prendre la forme de prises de participation dans des concessions minières, d’internationalisation des groupes chinois, de création de coentreprises ou encore d’investissements dans des projets d’infrastructures en échange de minerais extraits (Christmann et Jégourel, 2020 ; Bonnet et al., 2022).
Ainsi, alors que la Chine n’extrait sur son sol que 1 % du nickel et du cobalt mondiaux, Faubert et al. (2024) estiment, dans un document de travail de la Banque de France, que les capitaux chinois en maîtrisaient respectivement 18 % et 28 % en 2022 (figure 1.5). S’agissant du cobalt, la pénétration des intérêts chinois est très visible en République démocratique du Congo, où la Chine « a réussi à négocier des prises de participation en échange d’investissements dans les infrastructures », indique Capucine Nobletz (chercheuse à l’Institut Louis Bachelier). Cette prégnance chinoise se matérialise notamment par le contrat de partenariat économique sino-congolais signé en 2007, entre l’État congolais et un consortium de groupes chinois, et par l’exploitation de plusieurs mines majeures de cobalt par ces derniers (direction générale du Trésor, 2019). Les banques d’État chinoises ont consenti des prêts à la République démocratique du Congo en échange d’un accès aux mines de cobalt et de cuivre (Gulley et al., 2019).
Figure 1.5 – Part de la Chine dans la production mondiale de 5 métaux stratégiques
Sources : USGS (extraction au lieu de production et raffinage du cuivre), Faubert et al. (2024) (extraction selon l’origine du capital), AIE (raffinage, hors cuivre).
La France : une puissance minière et industrielle aujourd’hui secondaire
La France métropolitaine était historiquement une puissance minière. Comme le rappelle Bruno Jacquemin (A3M), « la France a une activité minière depuis l’âge du cuivre, c’est-à-dire depuis le néolithique. Il y a 4 000 communes minières en France, un peu partout sur le territoire, essentiellement exploitées aux xvie, xviie et xviiie siècles ». La France métropolitaine a notamment exploité des mines de fer, de zinc, de plomb, de cuivre, d’argent et d’or. Au début du xxe siècle, elle était également le premier pays producteur mondial de minerais de bauxite et d’antimoine10. Cette activité minière diverse permettait de produire par ailleurs d’autres métaux, aujourd’hui jugés stratégiques, en tant que coproduits. « La mine de zinc de Saint-Salvy, lorsqu’elle était exploitée [de 1973 à 1992], récupérait du germanium », illustre ainsi Blandine Gourcerol (cheffe de projet et experte scientifique au BRGM).
Toutefois, cette activité minière nationale a fortement décliné depuis les années 1980 dans un contexte de mondialisation et d’exposition à la concurrence internationale. « En France, le coût de la main-d’œuvre était relativement élevé ; à l’international, certaines exploitations coûtaient relativement moins cher. Ensuite, la France dispose globalement de gisements de petite taille : pour les mettre en production, cela nécessite des coûts conséquents pour un tonnage qui n’est pas nécessairement élevé », explique Blandine Gourcerol. La surface des concessions minières en France métropolitaine a ainsi chuté sur les soixante dernières années (voir figure 1.6).
Figure 1.6 – Évolution de la surface des concessions minières autorisées en France métropolitaine (en km²)
Source : Cadastre minier (Camino), périmètre minerais et métaux, hors sels. Traitements La Fabrique de l’industrie.
À ce jour, la France est une puissance minière marginale. L’activité d’extraction de métaux sur le territoire métropolitain se résume à deux exploitations de bauxite dans l’Hérault, mais qui n’ont plus d’applications métallurgiques11. « Aujourd’hui, ce n’est plus rentable, explique Guillaume de Goÿs (président d’Aluminium Dunkerque). La bauxite française est donc utilisée pour faire d’autres choses, comme des produits réfractaires, de la céramique… » La France compte un groupe minier présent à l’international, le groupe Eramet (détenu à 37 % par la famille Duval et à 27 % par l’État français), mais celui-ci ne dispose pas à ce jour de site minier actif sur le territoire métropolitain12.
En matière de raffinage de métaux stratégiques, la France métropolitaine dispose d’un tissu industriel résiduel, composé d’une poignée d’entreprises dans la production d’alumine (mais pour des débouchés non métallurgiques, dits de spécialité), d’aluminium primaire, de silicium métal, de titane, de nickel, de cobalt ainsi que de ferroalliages (figure 1.7). La France compte également un site historique de production d’oxydes de terres rares à La Rochelle (fondé en 1948), dont l’activité porte à ce jour sur la production d’oxydes de cérium. Ces entreprises métallurgiques, dans la mesure où elles s’approvisionnent en minerais (en alumine issue de la bauxite s’agissant des industriels de l’aluminium), sont les premières concernées par la sécurisation des approvisionnements.
Figure 1.7 – Production de métaux stratégiques primaires en France métropolitaine
(*) L’entreprise produit de l’alumine non métallurgique pour les débouchés dits « de spécialité » , comme les céramiques, les produits abrasifs et les réfractaires. Sources : USGS, Elementarium et presse. Traitements La Fabrique de l’industrie.
Des chaînes de valeur exposées aux tensions d’approvisionnement
Des approvisionnements dépendants des puissances étrangères
La concentration mondiale de l’activité minière et de raffinage place les industriels français et européens dans une situation de dépendance et de vulnérabilité face à des tensions voire à des ruptures d’approvisionnement. Trois facteurs y contribuent. Le premier, structurel, tient au creusement continu de l’écart entre l’offre et la demande mondiale de métaux à l’horizon 2040, qui ne peut qu’accentuer les risques de pénurie (voir figure 1.8).
Figure 1.8 – Coefficient multiplicateur entre les volumes d’offre et de demande mondiales en métaux stratégiques
(*) Graphite naturel et synthétique
Source : AIE (2025), scénario intermédiaire (« Announced Pledges Scenario »), sur la base des ambitions climatiques énoncées par les États. Traitements La Fabrique de l’industrie.
Note : Un coefficient supérieur à 1 signifie que la demande est supérieure à l’offre, c’est-à-dire à ce que les producteurs seront en mesure de fournir sur l’année donnée.
Note de lecture : en 2040, la demande mondiale de lithium en volume sera 2,9 fois supérieure à l’offre selon le scénario intermédiaire de l’AIE.
Deuxièmement, de nombreux aléas plus conjoncturels ou localisés peuvent accentuer les tensions d’approvisionnement. En amont des chaînes de valeur européennes, les activités minières ainsi que les infrastructures et activités logistiques associées sont d’abord fortement exposées à des chocs exogènes, tels que des catastrophes naturelles, accidents et épisodes de grèves sur les exploitations minières. D’après le recensement de Hatayama et Tahara (2018), ces trois causes sont à elles seules à l’origine de 60 % des ruptures d’approvisionnement mondiales de minerais de cuivre13 et de 48 % pour les minerais de nickel sur la période 1967-2016. Les risques environnementaux liés au réchauffement climatique pèsent également sur les activités extractives. Les données de Skarn Associates relayées par l’AIE (2025) indiquent par exemple que 7 % de l’offre mondiale de minerais de cuivre est aujourd’hui exposée à un risque de rupture de production en raison d’inondations et de sécheresses, une part qui devrait monter à 30 % en 2030.
Troisièmement, l’instrumentalisation politique et géopolitique dont font l’objet les ressources minières de la part des États, dans un contexte de croissance des besoins mondiaux, achève d’alimenter des tensions voire des ruptures d’approvisionnement (Karkare, 2024). Les puissances minières, dans leur quête de développement économique, peuvent ainsi mettre en place des barrières douanières à l’exportation de minerais, pour mettre un terme à la fuite des activités de raffinage14. Comme l’indique Capucine Nobletz (Institut Louis Bachelier) : « Certains pays en voie de développement ne bénéficient pas des retombées économiques liées à l’exploitation de leurs ressources. Ils ne veulent plus vendre les minerais bruts, mais au contraire pouvoir les raffiner sur leur territoire afin de capter davantage de valeur ajoutée. »
Les minerais de nickel font par exemple l’objet de fortes velléités protectionnistes en Indonésie. Face à la stratégie d’intégration verticale chinoise qui se matérialise par une importante fuite de la production minière de nickel vers la Chine (figure 1.9), l’Indonésie a instauré un premier embargo en 2014 puis un second en 2020, afin de pousser les entreprises chinoises à investir également dans des capacités locales de raffinage du nickel15. En Nouvelle-Calédonie, un consensus politique historique plaide également pour la préservation sur le territoire de l’activité de première transformation du minerai de nickel (IGF et CGE, 2023). « Pendant longtemps, la politique locale de la Nouvelle-Calédonie a freiné les exportations du minerai brut de nickel », rappelle Nicolas Migeon (chef de projet à la Direction générale des entreprises).
Les pays producteurs de bauxite affichent des ambitions économiques similaires : « Les pays qui détiennent la bauxite essayent d’utiliser des mesures de rétorsion pour exiger une relocalisation de la chaîne de valeur dans leur pays. C’est le cas de la Guinée ; elle demande aux industriels de venir y construire des raffineries d’alumine », indique Guillaume de Goÿs (Aluminium Dunkerque). En juin 2023, l’Indonésie a, de son côté, couplé son embargo sur les minerais de nickel d’un embargo sur les minerais de bauxite.
Un tel interventionnisme économique des États n’est pas neutre sur le plan macroéconomique, comme l’analyse Michel Foucart (Associate Partner chez McKinsey) : « Les barrières douanières sont susceptibles de reconfigurer les chaînes de valeur mondiales des métaux critiques. Certaines régions pourraient apparaître davantage compétitives du fait de la mise en place de protections douanières. Si ces barrières continuent à exister sur le long terme, de nouveaux actifs [en l’occurrence ici, des sites métallurgiques] apparaîtront presque mécaniquement dans des régions où l’on ne s’y attendait pas dans un scénario sans barrières. » À la suite de l’embargo indonésien sur les minerais de nickel en 2014, de nombreux investissements industriels ont été réalisés de la part de groupes miniers (Vale, Weda Bay, PT ANTAM, etc.) pour produire sur le sol indonésien des produits raffinés à base de minerais de nickel (mattes, ferronickel, fonte brute) (USGS, 2016). Résultat, la part de l’Indonésie dans le raffinage mondial de nickel est passée de 1 % en 2013 à 42 % en 2023 (figure 1.9).
Figure 1.9 – Exportations indonésiennes de minerais de nickel (en milliers de tonnes) et part de l’Indonésie dans le raffinage mondial de nickel (en % de volume de production)
(*) Entre janvier 2017 et décembre 2019, les minerais ayant une concentration en nickel inférieure à 1,7 % pouvaient être exportés.
Sources : International Trade Center (ITC) et USGS. Traitements La Fabrique de l’industrie.
Les tensions et les ruptures d’approvisionnement peuvent également être causées par des conflits de nature géopolitique. Ainsi, la Chine met à profit sa domination dans le raffinage de métaux stratégiques lorsqu’elle cherche à peser dans la géopolitique mondiale. Dans le cadre de sa guerre commerciale avec l’administration américaine, la Chine a ainsi instauré, en avril 2025, un contrôle sur les exportations de sept terres rares et de leurs dérivés (aimants permanents)16. Cette restriction consiste à conditionner l’exportation de ces métaux à l’obtention d’une licence, que les industriels étrangers doivent demander auprès du ministère chinois du Commerce. Plus tôt, la Chine avait également interdit, en décembre 2024, les exportations de gallium, de germanium et d’antimoine vers les États-Unis, puis introduit, en février 2025, des restrictions à l’exportation de cinq métaux (tungstène, bismuth, molybdène, indium, tellure). Des arbitrages qui ne sont pas anodins d’après Michel Foucart (McKinsey) : « La Chine sélectionne de petits métaux qui ne sont pas immédiatement sur les radars (certaines terres rares, antimoine, etc.), mais qui peuvent s’avérer être des goulets d’étranglement critiques. »17 Bruno Jacquemin (A3M) ajoute que la Chine y trouve également un puissant levier d’intelligence économique : « Dans les exportations de terres rares, la Chine exige de ses exportateurs qu’ils rendent compte d’où iront leurs terres rares. En faisant cela, la Chine est en train de se constituer, gratuitement, une cartographie de la chaîne de valeur mondiale des terres rares. »
En conséquence directe de cette barrière commerciale sur les terres rares, les entreprises européennes ont essuyé un rallongement de leurs délais d’approvisionnement. Barbara Forriere en témoigne par exemple pour Renault Group : « Les fournisseurs chinois qui utilisent des terres rares pour faire notamment des aimants sont beaucoup plus longs à livrer nos propres fournisseurs, du fait des restrictions à l’exportation, qui passent par l’obtention, longue, de licences. »
Dans un scénario d’embargo chinois sur les terres rares, que la Chine avait par exemple mis à exécution vis-à-vis du Japon en 2010, les impacts économiques et opérationnels sur l’industrie automobile seraient plus lourds encore. Barbara Forriere en témoigne : « En cas de rupture sur l’approvisionnement d’une des matières, le risque serait que nous ne puissions pas approvisionner les pièces qui composent nos véhicules, et donc que nous devions mettre à l’arrêt certaines usines, tout simplement. Si nous sommes contraints d’arrêter une chaîne, cela représente également des coûts énormes. »
Du reste, les conflits entre États, de nature géopolitique ou militaire, peuvent affecter dans leur sillage l’approvisionnement européen en minerais et en métaux. En avril 2018, les sanctions économiques des États-Unis contre la Russie, sur fond de nouvelles tensions géopolitiques entre les deux puissances, ont ainsi conduit indirectement à une crise majeure d’approvisionnement pour l’industrie européenne de l’aluminium. Parmi les oligarques russes sanctionnés par l’administration américaine, figurait en effet Oleg Deripaska, principal actionnaire du groupe Rusal, lui-même premier fournisseur d’alumine pour l’industrie française de l’aluminium. « Du jour au lendemain, nous fûmes à risque très direct sur une très grande part de notre approvisionnement en alumine », se rappelle Guillaume de Goÿs (Aluminium Dunkerque, qui était alors intégré au groupe Rio Tinto). Cette exposition immédiate de l’industrie européenne tient à l’extraterritorialité du droit américain, les entreprises ayant des intérêts économiques aux États-Unis s’exposant à des sanctions de la part de l’administration américaine si elles maintiennent des « transactions significatives » avec les entités visées par cette dernière. En décembre 2018, les sanctions vis-à-vis de Rusal ont été levées suite au retrait partiel d’Oleg Deripaska du capital de la holding détenant le fournisseur d’alumine.
Plus récemment, le déclenchement de la guerre en Ukraine en février 2022 a suscité de fortes craintes sur l’approvisionnement européen de plusieurs métaux importés de Russie. « Sur le marché de l’aluminium, nous avons eu des commandes [de câbles électriques] retardées avec la guerre en Ukraine », illustre par exemple Stéphane Heurtault (responsable d’affaires expertise chez RTE). En outre, la guerre en Ukraine a révélé une forte dépendance européenne au titane russe. En avril 2022, le projet d’inscription du fournisseur russe de titane VSMPO-AVISMA à la liste des entreprises sanctionnées par l’Union européenne a suscité de fortes inquiétudes de l’industrie aéronautique française et européenne, qui en a obtenu le retrait.
En parallèle, une volatilité des prix des métaux
Ce risque pour les entreprises industrielles européennes de subir des tensions voire des ruptures d’approvisionnement est couplé à une exposition aux fluctuations des prix des métaux. Au-delà des évolutions conjoncturelles de l’offre et de la demande mondiales (Hasse et Nobletz, 2024 ; voir annexe III), la volatilité des cours provient également des caractéristiques intrinsèques des marchés sur lesquels les métaux s’achètent et se vendent, les marchés boursiers d’une part, les marchés de gré à gré d’autre part (voir encadré).
Sur les marchés boursiers, la volatilité des prix découle des incertitudes, des craintes et des comportements spéculatifs des agents, autant d’éléments qui peuvent ponctuellement prévaloir sur les déterminants économiques, et que les tensions géopolitiques susmentionnées alimentent. Comme l’indique Stéphane Bourg (Ofremi), « il y a des marchés où l’offre est supérieure à la demande, et pourtant les prix flambent ; d’autres où l’offre est inférieure à la demande, et les prix baissent. Regardez l’exemple du lithium : les mécanismes qui ont gouverné la courbe gaussienne du prix ces dernières années n’ont rien à voir avec des problématiques d’offre et de demande. Il y a de la volatilité, de la spéculation, de la peur ». Dans une certaine mesure, les fortes variations ces dernières années des cours des métaux au London Metal Exchange (LME), principal marché mondial pour les métaux non ferreux, comme le nickel et le cuivre, témoignent bien de la sensibilité des agents économiques (figure 1.10).
Figure 1.10 – Évolution des cours de 4 métaux cotés au London Metal Exchange (en $/tonne)
Source : Insee d’après London Metal Exchange.
En guise d’illustration, le cours du nickel, aussi appelé « métal du diable » en raison de sa forte volatilité, avait fait l’objet d’une stratégie spéculative de la part de Xiang Guangda (président de Tsingshan, premier producteur mondial de nickel et d’acier inoxydable) entre février et mars 2022. Pariant sur une baisse du cours du nickel, le magnat chinois a vendu l’équivalent de 150 000 tonnes de nickel par des contrats à terme18 dans la perspective de racheter ces contrats plus tard à un prix plus faible pour générer des marges financières. Or, l’avènement de la guerre en Ukraine a suscité une hausse inattendue du cours au LME, motivant alors le magnat chinois à racheter aussitôt ces contrats aux prix de marché (plus élevés que ceux qu’il avait anticipés). Ce rachat a alimenté un emballement du cours au LME (dont la cotation, après avoir atteint un pic journalier à 100 000$ $/t, a d’ailleurs été suspendue pendant plusieurs jours) et causé au groupe des pertes estimées à 8 milliards de dollars. Comme le résume Didier Pitot (directeur stratégie et développement de Lebronze alloys) : « La crise du nickel n’était absolument pas liée à un manque physique, c’est lié au fait qu’un acteur chinois s’est cru plus malin que le marché. »
OÙ S’ÉCHANGENT LES MÉTAUX NON FERREUX ?
LES MÉTAUX NON FERREUX s’échangent soit sur des marchés dits « organisés » soit sur des marchés dits « de gré à gré ».
Sur les marchés organisés, la transaction a lieu sur une place boursière, qui centralise les ordres d’achat et de vente et publie quotidiennement une cotation unique pour chaque métal d’une qualité donnée. Les métaux de base (aluminium, cuivre, étain, nickel, plomb, zinc), les métaux précieux (or, argent, platine, palladium) ainsi que le cobalt et le molybdène, depuis 2010, font ainsi l’objet d’une cotation sur une ou plusieurs places boursières. Tous les métaux susmentionnés, à l’exception de l’or et de l’argent, sont cotés au London Metal Exchange (LME).
Sur les marchés de gré à gré, la transaction se fait directement entre acheteurs et vendeurs. Ces marchés concernent les « petits métaux », dont les faibles volumes échangés à l’échelle mondiale ne justifient pas à ce jour une mise en bourse. « Le manganèse est un marché beaucoup plus petit, de niche, et là on est sur des échanges de gré à gré », illustre par exemple Ludovic Donati (directeur du projet Lithium Ageli chez Eramet). Ce mode de transaction couvre également les métaux cotés en bourse lorsque la pureté recherchée diffère de celle faisant l’objet de la cotation. Si les marchés de gré à gré permettent une personnalisation des contrats selon les besoins de l’acheteur, ils sont moins structurés que les marchés boursiers et souffrent d’une forte opacité. « Il n’y a pas de chambre de compensa- tion* ; en d’autres termes, il n’y a pas d’assurance si un des deux acteurs ne respecte pas ses engagements. Il y a moins d’informations, ce n’est pas très transparent », confirme Capucine Nobletz (Institut Louis Bachelier).
(*) Chaque marché organisé dispose d’une chambre de compensation dont la principale fonction est d’assurer le bon dénouement des transactions finan- cières. Pour cela, elle peut notamment se substituer aux acheteurs défaillants en payant les vendeurs ou aux vendeurs défaillants en assurant la livraison des marchandises. Elle peut aussi suspendre les transactions lorsque les prix varient fortement sans lien avec le marché réel.
Sur les marchés de gré à gré, la volatilité des cours tient, cette fois, à la nature bilatérale et discrétionnaire de fixation des prix. Comme le rappelle Capucine Nobletz (Institut Louis Bachelier), « il y a des situations d’oligopole où les entreprises disposent d’un gros contrôle sur les prix ». Comme l’explique Bruno Jacquemin (A3M), c’est le cas des entreprises chinoises qui dominent le raffinage de métaux : « Les Chinois fixent les prix, jouent avec les prix. Leur intérêt est de vendre le plus cher possible, et quand ils veulent. » « Avec ce que fait la Chine actuellement sur les contrôles à l’exportation, les prix des matières soumises à ce contrôle ont augmenté », constate par exemple Barbara Forriere (Renault Group).
Un risque pour la compétitivité européenne
Les variations de prix des minerais et des métaux sont préoccupantes dans la mesure où elles sont essuyées par les acheteurs, en l’occurrence, ici, par les entreprises industrielles françaises et européennes. En début de chaîne, les entreprises métallurgiques peuvent par exemple être prises en étau entre l’évolution du prix des minerais et celui du métal qu’ils vendent. Guillaume de Goÿs (Aluminium Dunkerque) confie : « Si le prix de l’alumine monte, on s’attend à ce que le prix de l’aluminium au LME monte. Mais on ne peut que le souhaiter. Rien ne peut garantir cela », tout en rajoutant : « Quand vous ne fixez pas le prix de vente, c’est difficile de répercuter les surcoûts sur les clients. » Jean-Paul Chapuy (Ferroglobe) livre un témoignage similaire : « Quand vous n’avez pas également une activité minière, vous dépendez du cours du minerai. Des fois, les courbes se croisent : le prix du minerai de manganèse monte, et le prix de l’alliage de manganèse à la vente baisse. Les prix n’arrêtent pas de fluctuer, il faut savoir jongler et faire avec. »19
Lorsqu’elles font l’objet d’une répercussion sur toute la chaîne de valeur, ces variations de prix peuvent atteindre les donneurs d’ordre, tels que les fabricants de câbles électriques ou de véhicules électriques. Comme le souligne Didier Pitot (Lebronze alloys), l’indexation des contrats d’approvisionnements sur les prix des métaux est « une pratique industrielle installée sur les métaux non ferreux. C’est moins le cas sur les aciers. Nous utilisons, comme tous les acteurs de la profession, le LME comme base de coûts des métaux. Tous nos contrats d’approvisionnement et de fourniture sont indexés sur le cours du LME. Les entreprises qui n’ont pas réussi à faire le pass through [l’indexation] à leurs clients ne sont plus là ».
La nouvelle industrie des batteries électriques ne semble pas déroger à cette pratique industrielle. Le propos de Camilla Vachet (Head of Direct Materials and Responsible Sourcing chez Verkor) l’illustre pour le fabricant français Verkor : « Notre modèle réside sur une indexation des prix des métaux en amont et en aval. Les fabricants de véhicules électriques payent le lithium à un prix indexé. Par conséquent, si notre prix d’achat fluctue, le prix de vente de nos batteries fluctue aussi. » En bout de chaîne, ce sont les constructeurs automobiles qui héritent donc de la volatilité des cours. « La batterie dépend de métaux dont les prix font le yoyo. L’industrie automobile n’était pas du tout habituée à cela », observe Ludovic Donati (Eramet).
Par le jeu de ce pass through, on comprend que les fluctuations de prix des métaux peuvent affecter in fine la compétitivité des industries européennes. En guise d’illustration, un travail prospectif de l’AIE (Dhir et al., 2025) estime qu’une multiplication par 10 du prix du graphite (naturel ou synthétique) entraînerait en Europe une augmentation de 42 % du prix d’une batterie électrique et de 10 % du prix d’un véhicule électrique (figure 1.11). Cette situation creuserait alors l’écart de compétitivité avec les fabricants chinois, allant jusqu’à mettre en péril la pérennité des fabricants européens. Comme l’indique Michel Foucart (McKinsey), « si vous êtes un constructeur automobile européen en concurrence avec un constructeur chinois, et que le coût de votre batterie est trois fois supérieur et celui de votre moteur électrique cinq fois plus élevé, vous avez de fortes probabilités de cesser de vendre des voitures ».
Figure 1.11 – Impact d’une multiplication par 10 du prix du graphite sur l’aval de la chaîne de valeur automobile
Source : Dhir et al. (2025).
En somme, il existe bien des risques tangibles sur l’approvisionnement des entreprises françaises et européennes en métaux, sur la continuité de l’approvisionnement d’une part, sur les prix d’achat des matières d’autre part. Ces risques découlent à la fois de la concentration géographique de la production (à l’étape de l’extraction et plus encore à l’étape du raffinage), de la précarité du libre-échange de ces matières du fait de l’interventionnisme de certains États producteurs (y compris la Chine), et de la volatilité des cours que les deux causes précédentes alimentent.
Au fil des crises, une prise de conscience des entreprises industrielles
L’enquête du Conseil général de l’économie et de l’A3M partait du constat que la sécurisation des approvisionnements était, à l’automne 2018, un sujet peu débattu au sein des entreprises industrielles (CGE, 2019). Seuls 18 % des répondants indiquaient, à cette date, connaître l’intégralité de leur chaîne d’approvisionnement et 47 % indiquaient être en situation de dépendance élevée voire exclusive à un unique fournisseur (dépendance à hauteur de 50 % à 100 %).
Figure 1.12 – La sécurisation des approvisionnements est-elle un sujet de préoccupation plus important que l’année précédente pour votre direction achats ?
Source : Baromètre annuel Conseil national des achats – AgileBuyer.
Note : La première occurrence de la question figure sur l’édition 2018. Les réponses à cette question sont manquantes dans les éditions 2020 et 2021 du baromètre.
Depuis quelques années, certains signaux convergent pour témoigner d’une meilleure prise en compte du sujet. Tous secteurs confondus (industrie, services, transports, etc.), l’enquête annuelle du Conseil national des achats (CNA) et d’AgileBuyer montre d’abord que la part des directions achats ayant prévu des actions de sécurisation est passée de 64 % en 2019 à 82 % en 2022 (voir figure 1.12). Les directions achats se disent également sensibles à l’évolution de l’environnement géopolitique. Fin 2024, 74 % d’entre elles s’attendaient à ce que les crises géopolitiques impactent leur stratégie d’achats, une part qui s’élève à 88 % dans l’industrie aéronautique et défense et à 81 % dans l’industrie automobile. Les enquêtes successives imputent cette inflexion à l’incertitude économique à partir de 2018 (en lien avec la guerre commerciale sino-américaine initiée lors du premier mandat de Donald Trump), à la survenue de pénuries (médicaments lors de la crise sanitaire en 2020 puis semi-conducteurs dans le contexte de reprise post-Covid), puis à l’avènement de la crise en Ukraine en 2022. Ces épisodes successifs ont entraîné des difficultés d’approvisionnement au sein du tissu industriel, comme en témoignent les données de l’Insee qui attestent d’un pic historique atteint en 2021 (voir figure 1.13).
Figure 1.13 – Part des entreprises déclarant subir des difficultés d’approvisionnement dans l’industrie manufacturière
Source : Insee.
Note : Le tracé en pointillé désigne la courbe de tendance.
Dans ce panorama global, des nuances sont toutefois perceptibles entre entreprises. Certains industriels ont anticipé de longue date le sujet de l’approvisionnement en métaux, comme le groupe Renault. Comme l’indique Olivier Dubourdieu (enseignant-chercheur à Mines Paris – PSL), « Renault a une équipe Raw Materials depuis le début des années 2000. Ce sont des équipes qui se sont étoffées avec le temps ». Barbara Forriere (Renault Group) confirme : « Les problématiques de sécurité d’approvisionnement nous intéressent depuis au moins quinze ans. J’avais mis en place une matrice de criticité au moment de la crise des terres rares de 2011. C’était assez novateur et cela continue de nous servir dans l’évaluation des risques. » En parallèle, Bruno Jacquemin (A3M) constate que la maturité du sujet est encore inégale parmi les entreprises. « Chez certains industriels, petite quantité de métaux égale petit problème », constate-t-il. Alexandre Damiens (responsable des partenariats industriels et du développement chez Orano) l’illustre pour le cas des terres rares et des aimants : « Le coût et le poids des aimants ne reflètent pas leur valeur stratégique. Par exemple, comparés à l’acier ou au cuivre nécessaires aux projets éoliens, les aimants ne représentent qu’une petite fraction du poids et du coût ; pourtant, ils sont indispensables, car sans eux il n’y a pas d’électricité générée. »
Sur la base de ces constats, les chapitres suivants examinent les leviers d’action à la portée des entreprises industrielles et questionnent leur efficacité à l’aune de l’objectif de sécurisation des approvisionnements.
- 5 — Le graphite n’est pas un métal, mais un minéral non métallique ; le seul, avec le bore, dans la liste européenne des matières premières stratégiques.
- 6 — La différence entre une mine et une carrière dépend de la substance qui en est extraite. L’article 2 du Code minier énumère les substances dont l’extraction est régie ; elles comprennent les combustibles fossiles, les sels, les métaux, les éléments radioactifs ainsi que le gaz carbonique. Tous les autres gisements constituent des carrières et sont juridiquement dépendants du Code de l’environnement. Il y a également une différence de propriété : les substances issues de carrières sont détenues par le propriétaire du terrain, alors que les substances extraites de mines sont la propriété de la Nation ; c’est l’État qui concède aux exploitants miniers un droit exclusif d’exploitation.
- 7 — Afin de mesurer la répartition géographique de l’activité minière, puis de raffinage, nous mobilisons ici les données de l’United States Geological Survey (USGS), l’Institut d’études géologiques des États-Unis. Cette base en libre accès apparaît exhaustive à la fois sur le plan géographique et minéral. Elle est également régulièrement utilisée dans la littérature économique. Nous mobilisons ponctuellement la base de données de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) lorsque certaines données de production de raffinage sont manquantes sur la base USGS ; le changement de source est notifié le cas échéant.
- 8 — L’indice Herfindahl-Hirschman (IHH) est un indice de concentration de l’activité à partir des parts de marché des entreprises, ou des pays.
- 9 — La Chine assure à elle seule 94 % de la production mondiale d’aimants permanents (Rizos et al., 2022).
- 10 — D’après les informations disponibles sur le site L’Élémentarium.
- 11 — La France maintient toutefois des activités d’exploitation de carrières de minerais non métalliques qui adressent les débouchés non métallurgiques (matériaux de construction, chimie, verre, etc.) et, de façon marginale, certains débouchés métallurgiques (quartz pour la production de silicium métal par exemple).
- 12 — Le groupe porte toutefois un projet d’extraction de lithium géothermal en Alsace, le projet Ageli, en partenariat avec Électricité de Strasbourg pour un début de la production à l’horizon 2030 (voir chapitre 3).
- 13 — Située au Chili, la plus grande mine de cuivre du monde, la mine d’Escondida, a par exemple fait l’objet de grèves de plusieurs semaines en 2017 et en 2024.
- 14 — Cet arbitrage s’inscrit dans une stratégie croissante de « nationalisme des ressources » qui consiste à réaffirmer un contrôle d’État sur les ressources naturelles pour des motifs économiques et stratégiques (Karkare, 2024).
- 15 — La réglementation indonésienne va plus loin encore puisqu’elle impose que les actifs miniers et métallurgiques soient détenus, après quinze à vingt ans d’activité, par un acteur basé en Indonésie (IGF et CGE, 2023).
- 16 — Sur les 17 métaux qui composent le groupe des terres rares, le contrôle à l’export de la Chine porte sur les exportations de 6 terres rares lourdes (gadolinium, terbium, dysprosium, lutécium, scandium et l’yttrium) et d’une terre rare légère (le samarium). Parmi elles, 4 terres rares sont jugées stratégiques par la Commission européenne, car rentrant dans la composition des aimants permanents (terbium, dysprosium, gadolinium, samarium).
- 17 — L’USGS estime que la dépendance américaine aux importations s’élevait à plus de 50 % pour le germanium, à 80 % pour les terres rares, à 85 % pour l’antimoine et jusqu’à 100 % pour le gallium pour l’année 2024 (USGS, 2025).
- 18 — « Dans un contrat à terme, deux parties s’engagent à acheter ou vendre une quantité déterminée d’un actif, ici un métal, à une date d’échéance et à un prix convenus à l’avance. Il permet d’anticiper les variations futures du prix d’un métal et peut donc servir à couvrir un portefeuille contre les fluctuations à venir du marché. Il permet aussi de dynamiser les performances de son portefeuille. » (source : Minéralinfo).
- 19 — En France, le groupe Ferroglobe s’approvisionne en manganèse pour produire du ferromanganèse et du silicomanganèse à Dunkerque (voir figure 1.7).
De la réaction à la La science irrigue prévention : un ensemble toujours la technologie de leviers à la portée des entreprises
Les tensions récurrentes sur les chaînes de valeur invitent les entreprises industrielles à mettre en place des stratégies de sécurisation de leurs approvisionnements. Ce chapitre rappelle les différents leviers d’action à leur portée et s’attarde sur trois d’entre eux, plus fréquemment considérés d’après notre campagne d’entretiens : la diversification des fournisseurs, l’intégration verticale et la substitution des matières.
Face aux tensions d’approvisionnement, une diversité de leviers possibles
Il existe en théorie plusieurs leviers que peuvent mobiliser les entreprises dans leur démarche de sécurisation des approvisionnements (Dera20, 2022) : la contractualisation à long terme, la diversification des fournisseurs, les mécanismes de couverture financière, les outils informatiques d’aide aux achats, le recours au recyclage, la mutualisation des achats, le stockage, l’amélioration de l’efficacité matière, la substitution matière et l’intégration verticale. À ces leviers identifiés par la Dera, nous rajoutons celui de la relocalisation de l’approvisionnement en métaux primaires à l’échelle européenne, levier qui s’inscrit dans une démarche de diversification des sources géographiques d’approvisionnement.
Pour une meilleure compréhension, nous proposons ici d’ordonner ces différents leviers selon leur degré de complexité organisationnelle d’une part, et selon l’échelle nécessaire de prise de décision d’autre part (figure 2.1). Certains leviers sont à la portée directe des directions achats et constituent des mécanismes de marché mobilisables sur la base de l’offre existante : c’est le cas de la contractualisation à long terme, de la diversification des fournisseurs, des mécanismes de couverture financière et des outils informatiques d’aide aux achats. Les autres nécessitent un arbitrage à plus grande échelle, car ils concernent étroitement d’autres directions de l’entreprise (financière, stratégique ou R&D) voire impliquent une modification du modèle d’affaires. Pour ces raisons, ils sont qualifiés de « leviers structurants » dans la figure ci-dessous.
Or, au cours de notre campagne d’entretiens, plusieurs de ces leviers sont apparus comme secondaires au sein des entreprises industrielles. C’est le cas de la mutualisation des achats et du stockage. Les industriels rencontrés ont notamment indiqué que la mise en place de stocks stratégiques s’apparentait en termes comptables à une immobilisation de capital, ce qui alourdit de fait le besoin en fonds de roulement (BFR)21. « Le nickel coûte cher et pèse sur notre BFR au moment de faire des stocks », illustre par exemple Didier Pitot (Lebronze alloys), un propos également tenu par d’autres personnes rencontrées. Comme le résume Gildas Bureau (Materials Senior Fellow chez Stellantis et Coordinateur Filière Automobile et Mobilité sur les matériaux critiques au sein de la Plateforme française automobile), « sur le principe, nous ne sommes pas opposés au stockage, mais pas chez les industriels, plutôt par les pouvoirs publics. Il y a un consensus là-dessus au niveau des fédérations ». Des arbitrages plus nuancés peuvent toutefois exister à l’échelle microéconomique.
Figure 2.1 – Matrice de positionnement des leviers de sécurisation des entreprises industrielles
Réalisation : La Fabrique de l’industrie.
Note : Les leviers en gras sont ceux étudiés en détail dans cette étude.
À l’inverse, plusieurs leviers ressortent de cette campagne d’entretiens comme des axes mobilisés dans le cadre de stratégies de sécurisation : la diversification des fournisseurs (en association avec la contractualisation à long terme), l’intégration verticale, la substitution matière, le recyclage et la relocalisation de l’approvisionnement22. Cette étude s’attarde sur ceux-là et cherche, pour chacun, à en illustrer les usage, à identifier les contraintes associées puis à évaluer à quel point ils contribuent à la sécurisation des approvisionnements.
La diversification des fournisseurs ou la sécurisation par le marché
Un levier connu et mobilisé par les entreprises
La diversification des fournisseurs constitue un premier levier de sécurisation des approvisionnements à la portée des entreprises. Elle se manifeste par la signature de contrats d’approvisionnement avec de nouveaux fournisseurs identifiés sur le marché, offrant une plus grande flexibilité en cas de rupture d’approvisionnement (Dera, 2022). En 2019, l’enquête de terrain du Conseil général de l’économie et de l’A3M indiquait qu’il s’agissait du premier levier de sécurisation des entreprises, mobilisé par 62 % des répondants (CGE, 2019).
C’est notamment ce levier d’action que l’industrie française de l’aluminium a mobilisé en réponse à la crise Rusal en 2018. La part de l’Irlande, où est située la raffinerie du groupe Rusal, dans les importations françaises d’alumine est passée de 85 % en 2017, à l’aube de la crise, à 62 % en 2024 (voir figure 2.2). Comme en témoigne Guillaume de Goÿs (Aluminium Dunkerque), « nous avions deux sources d’alumine qui étaient qualifiées chez nous ; nous en avons maintenant huit, de différentes régions du monde ». Pour réduire sa dépendance au titane russe depuis la guerre en Ukraine, la filière aéronautique française a, elle aussi, diversifié ses sources d’approvisionnement, notamment au profit des États-Unis et de la Chine (tel qu’indiqué par le groupe Safran en novembre 2024) et de l’Arabie saoudite (tel qu’indiqué par le groupe Airbus dans le cadre d’un contrat aéronautique signé en avril 2025). L’industrie automobile a également recours à ce levier : « Nous tâchons de ne pas dépendre d’une seule source d’approvisionnement. C’est une façon de dérisquer », indique Barbara Forriere (Renault Group).
Figure 2.2 – Part de l’Irlande dans les importations françaises d’alumine non hydratée en volume
Source : ITC.
Note : L’usine Aughinish Alumina de Rusal est la seule usine de production d’alumine en Irlande.
La diversification des approvisionnements peut aller plus loin et conduire à la substitution totale du fournisseur initial. Didier Pitot (Lebronze alloys) en témoigne : « Au moment de la crise du nickel [en 2022], nous avons demandé à nos négociants l’origine du nickel contenu dans les produits que nous achetions. En réalité, nos clients nous posaient la même question. Il s’est avéré que le nickel de nos produits venait de Russie. On a donc demandé aux négociants de trouver une nouvelle source avec des certificats d’origine. Aujourd’hui, nous garantissons une source non russe pour notre nickel. »
Une démarche soutenue par l’Union européenne
La diversification des fournisseurs est un axe majeur de la stratégie européenne de sécurisation des approvisionnements. Dans le cadre du CRM Act, l’Union européenne a pour ambition de réduire, pour toutes les matières premières stratégiques et d’ici 2030, sa dépendance mono fournisseur de sorte qu’aucun pays tiers ne représente plus de 65 % de sa consommation annuelle23.
Dans cette perspective, l’Union européenne, en plus de pouvoir compter sur sa politique historique d’ouverture commerciale24, a récemment noué des partenariats stratégiques non commerciaux avec des pays détenteurs de réserves minérales dans le cadre de sa stratégie « Global Gateway » initiée en 2021 (Blot, 2024). Cette stratégie de friendshoring s’est matérialisée par la signature de quatorze mémorandums entre juin 2021 et juillet 2024, répartis sur les cinq continents (voir figure 2.3). Parmi eux figurent par exemple le Canada, l’Australie et l’Argentine, qui représentent à eux seuls 68 % des réserves mondiales de lithium d’après les données USGS. À la lecture du CRM Act, ces partenariats stratégiques doivent permettre (i) d’améliorer la sécurisation de l’approvisionnement de l’Union européenne, (ii) d’améliorer la coopération tout au long de la chaîne de valeur et (iii) de contribuer au développement économique et social des pays partenaires. Les fonds européens (fonds Global Gateway doté de 300 milliards d’euros (Md€) entre 2021 et 2027, Banque européenne d’investissement, Fonds européen pour le développement durable) seront également mobilisés pour investir dans le développement d’infrastructures dans les pays partenaires, à l’instar du corridor de Lobito, qui relie la République démocratique du Congo (où il dessert des mines de cobalt), l’Angola et la Zambie. Pour les entreprises européennes, ces partenariats intègrent notamment des actions de mise en réseau et de facilitation des projets de coopération. Dans cette continuité, la Commission européenne a présenté, en juin 2025, une première liste de treize projets miniers et industriels qu’elle soutiendra à l’étranger en contrepartie d’une sécurité d’approvisionnement que ces projets conféreront aux entreprises européennes. Parmi eux, sept projets sont situés dans des pays signataires d’un partenariat stratégique (voir figure 2.3).
Figure 2.3 – Liste des partenariats stratégiques sur les matières premières signés par l’Union européenne
(*) Liste non exhaustive à partir de sources diverses (données USGS, sites gouvernementaux, presse), hors combustibles énergétiques et minerais non stratégiques.
Source : Commission européenne, informations connues au 1er septembre 2025.
Si la politique commerciale est une compétence européenne exclusive, les États européens peuvent également participer, à leur échelle, à la coopération internationale avec les puissances minières. En France, la Délégation interministérielle aux approvisionnements en minerais et métaux stratégiques (Diamms), créée en décembre 2022 selon une recommandation du rapport Varin, a ainsi signé quinze accords bilatéraux pour soutenir l’intégration des chaînes de valeur françaises avec celles de pays partenaires et renforcer la coopération en matière d’innovation et de connaissance du sous-sol. En juin 2025, la France a par exemple signé un mémorandum d’entente avec l’Argentine pour collaborer sur la recherche et l’exploitation minière.
Des défis techniques, logistiques et économiques
La diversification des sources d’approvisionnement n’est toutefois pas évidente pour les entreprises concernées. Elle se heurte à des défis techniques, logistiques et économiques qui peuvent en freiner la mise en place voire en questionner l’opportunité.
La diversification des fournisseurs comporte d’abord des défis d’ordre technique. Les exigences de qualité des intrants peuvent limiter le panel de fournisseurs alternatifs. Jean-Paul Chapuy (directeur des opérations France de Ferroglobe) l’illustre pour les minerais permettant de produire du silicium métal : « La silice est une roche très abondante ; c’est néanmoins plus difficile de trouver de la silice pure à plus de 98 %. » Il en va de même pour les éponges de titane « de qualité aéronautique », dont la production mondiale n’est assurée que par trois pays : le Japon, les États-Unis et la Russie, rappelle un article de L’Usine Nouvelle (Davesne et James, 2023).
Le cas échéant, les entretiens ont rappelé que l’intégration d’un nouveau fournisseur requiert un lourd processus de qualification qui consiste à s’assurer de la conformité technico-économique du nouvel intrant au cahier des charges initial. « Si nous voulons faire rentrer un nouveau fournisseur dans notre panel, cela s’accompagne d’investissements importants et de temps important », témoigne Camilla Vachet (Verkor). « Vous ne changez pas en cinq minutes une chaîne d’approvisionnement qui marche », abonde Didier Pitot (Lebronze alloys), qui explicite : « Chaque fois qu’on a un nouveau fournisseur, on demande un échantillon de matière pour voir si cela peut fonctionner dans nos produits, ensuite, on fait un lot d’essais, un plan de contrôle dans la durée pour s’assurer de l’absence de dérives. Cela a pris un certain temps, environ un an, pour valider la qualité du nickel. » D’après l’enquête du Conseil général de l’économie et de l’A3M, la durée de qualification d’un nouveau fournisseur s’élève à plus d’un an pour 21 % des répondants (CGE, 2019). En juin 2024, le directeur général du groupe Safran, Olivier Andriès, indiquait même, dans une interview à La Tribune, que le processus de qualification peut durer jusqu’à trois ans pour certaines pièces forgées (Barnier et Cabirol, 2024). Ce processus de qualification est rendu nécessaire lorsque les cahiers des charges des industriels répondent eux-mêmes aux exigences de leurs clients, jusqu’à celles des donneurs d’ordre. Stéphane Heurtault (RTE) le rappelle : « Pour chaque câble aérien, nous précisions les spécificités techniques que nous souhaitons. Nos exigences techniques descendent jusqu’à la fonderie. »
L’intégration d’un nouveau fournisseur peut également introduire de fortes contraintes industrielles. En 2017, le site de production de nickel pur de Sandouville, alors rattaché au groupe Eramet, a dû faire l’objet d’un plan d’investissement de 34,5 millions d’euros pour adapter l’outil de production au changement de fournisseur25. Comme l’explique Guillaume Descamps (directeur de l’usine de Sandouville de Sibanye-Stillwater) : « En changeant de fournisseur de matte de nickel 26, le site a perdu en qualité de produit à raffiner (nickel contenu). Cette perte était compensée par d’autres éléments chimiques ; nous avons donc saturé les unités chimiques de purification. »
La diversification des fournisseurs se heurte, en outre, à des défis logistiques de taille. Cette stratégie emporte, selon la localisation des fournisseurs alternatifs, de nouveaux coûts de transport, de nouveaux délais d’approvisionnement ainsi que des émissions de CO2 supplémentaires. « S’il faut faire venir le quartz de loin, c’est la logistique qui va faire doubler le prix. La roche en elle-même a un prix modéré », affirme Jean-Paul Chapuy (Ferroglobe). « Lorsqu’on s’approvisionne en Grèce, l’alumine doit faire tout le tour de l’Espagne pour ramener l’alumine à Dunkerque ; cela représente huit à dix jours de mer, ajoute Guillaume de Goÿs (Aluminium Dunkerque) ; en comparaison, nous sommes à deux jours et demi de mer de l’Irlande concernant l’alumine venant d’Aughinish. »
Dans une certaine mesure, ces contraintes logistiques permettent d’expliquer la part encore significative de l’usine irlandaise de Rusal dans les importations françaises d’alumine (voir figure 2.2), comme le confirme encore Guillaume de Goÿs : « Nous ne prenons pas le parti de renchérir le coût de nos sources d’alumine et nos émissions de CO2 en ayant des flux très réguliers avec les fournisseurs géographiquement éloignés. Nous avons fait les trois quarts du chemin. Nous ne sommes pas allés jusqu’à la décision de commander tous les ans, un tiers en Océanie, un tiers en Amérique, un tiers en Europe. Cela s’apparenterait à une diversification complète, mais entraînerait un surcoût financier et écologique très significatif. »
LES GROUPES DE NÉGOCE AU SERVICE DE LA DIVERSIFICATION DES APPROVISIONNEMENTS
L ’APPROVISIONNEMENT DE MINERAIS est une activité logis-(directeur général France de Nyrstar, producteur mondial de zinc ayant une usine à Auby) témoigne de cette complexité : « À la question de savoir si les minerais voyagent facilement, la réponse est oui et non. Techniquement oui, mais non si vous êtes mal organisés. Nyrstar produit à peu près 570 000 tonnes de zinc en Europe. Approximativement, il y a donc plus d’un million de tonnes de concentrés et d’oxydes qui alimentent les trois usines européennes de Nyrstar. Ces matières n’arrivent pas directement dans les usines et se trouvent déchargées au port d’Anvers par une société dont c’est le métier. Nos concentrés vont être orientés vers les usines pour ensuite être spécifiquement mélangés suivant les contraintes techniques. »
Dans ce contexte, les sociétés de négoce, comme le groupe suisse Glen-core et le groupe hélvético-singapourien Trafigura s’agissant des géants mondiaux, occupent une place prépondérante dans la gestion des flux de matières premières (Christmann et Jégourel, 2020). Elles représenteraient entre 20 % et 40 % du commerce mondial de minerais de cuivre et de nickel (IISD, 2019). Leur connaissance des sources d’approvisionnement ainsi que leur offre de services logistiques en font des partenaires prometteurs de la diversification des approvisionnements. Comme en témoigne Guillaume de Goÿs (Aluminium Dunkerque) : « Les sociétés de négoce nous ont aidés à qualifier de nouvelles sources. Les grands groupes ont souvent leurs propres flux internes. Ils achètent eux-mêmes donc ils ont souvent une société de négoce interne. Les entreprises industrielles indépendantes, à l’image d’Aluminium Dunkerque, font appel à des sociétés de trading justement de façon à diversifier les approvisionnements. » En mars 2022, dans un contexte de volatilité des prix, Aluminium Dunkerque a ainsi signé un contrat d’approvisionnement d’alumine auprès du groupe mondial de négoce Glencore.
La collaboration entre industriels et négociants peut aller jusqu’au rapprochement stratégique, comme en témoigne celui de Nyrstar avec Trafigura en 2019. « Trafigura, après avoir été actionnaire de Nyrstar, en est devenu le propriétaire, indique Éric Brassart. Nyrstar produit plus d’un million de tonnes de zinc dans le monde et bénéficie du support intégral de Trafigura quant à l’approvisionnement de ses matières premières et la vente de ses produits et sous-produits. »
Les conséquences économiques de la diversification des fournisseurs apparaissent, eux, plus ambivalentes. D’une part, ce levier a vocation à renforcer le pouvoir de négociation des clients face à leurs fournisseurs (Dera, 2022). Didier Pitot (Lebronze alloys) confie ainsi : « On essaye d’avoir à chaque fois deux ou trois fournisseurs, un peu pour la sécurisation mais beaucoup pour bénéficier d’un service. Quand vous avez plusieurs fournisseurs, il y a une possibilité de nous dépanner et il y a une mise en concurrence. » En tant que fournisseur de silicium métal, Jean-Paul Chapuy (Ferroglobe) indique, en miroir, être effectivement exposé à cette menace de substitution : « Notre marché principal se trouve en Europe, c’est celui des alliages d’aluminium. Le silicium est ici une simple matière d’addition, donc une commodité. Qu’il soit fabriqué en France ou en Chine, c’est le même et il n’apporte pas plus. C’est donc le prix qui fait la différence. Il n’y a aucune fidélité des clients. »
Pourtant, le fait de multiplier les sources d’approvisionnement réduit, d’autre part, les perspectives d’économies d’échelle auxquelles peut être adossée la compétitivité prix d’une entreprise (Dera, 2022). C’est à cette aune que s’inscrit ce témoignage de Camilla Vachet (Verkor) : « En fonction des projets et des spécificités de chaque composant, nous étudions les doubles sources lorsque cela est intéressant, mais cela n’est pas automatique. Nous avons choisi d’établir des partenariats avec des fournisseurs établis du marché. Ils ont fait leurs preuves dans leur domaine et sont principalement localisés en Asie aujourd’hui puisque la chaîne de valeur est plus mûre là-bas. »
Une sécurisation parfois en trompe-l’œil
Il convient enfin de souligner que la diversification des fournisseurs ne garantit pas automatiquement à l’entreprise une pleine sécurisation de ses approvisionnements. D’une part, la multiplication des fournisseurs sans diversification géographique expose toujours l’entreprise à des risques politiques comme la mise en place de barrières commerciales.
D’autre part, une diversification des fournisseurs directs peut cacher une dépendance plus en amont à l’égard de fournisseurs indirects (dits de rang 2, de rang 3, etc.). Il s’agit d’un écueil stratégique qu’a pu observer Stéphane Bourg (Ofremi) sur le terrain : « Pour les services achats, il suffit souvent d’avoir trois fournisseurs dans trois pays différents pour avoir des contrats en béton. Mais ceci n’empêchera pas des ruptures si les matières premières ont elles-mêmes la même source. Si le premier robinet se ferme, les trois fournisseurs, bien que dans trois pays différents, n’auront aucune marchandise. » À titre d’exemple, la diversification des fournisseurs de moteurs électriques n’immunise pas les constructeurs automobiles d’une dépendance aux terres rares produites en Chine (qui concentre 91 % du raffinage mondial de terres rares).
En amont, il s’agit donc pour les entreprises et les donneurs d’ordre d’améliorer leur visibilité sur leur chaîne de valeur à l’échelle microéconomique. « Nous rencontrons toute la chaîne, nous avons fait des études pour décortiquer toute la chaîne en partant du minerai. Nous essayons de trouver des goulets d’étranglement », témoigne par exemple Stéphane Heurtault (RTE). Cette démarche d’intelligence économique peut toutefois se heurter à une faible transparence des fournisseurs, comme l’indique Olivier Dubourdieu (Mines Paris – PSL) : « C’est en général très compliqué de faire de la traçabilité, et encore plus quand il y a une ou plusieurs étapes localisées en Chine : on ne sait pas ce qui se passe en amont des fournisseurs chinois ; il y a peu de visibilité, de confiance en la donnée partagée. C’est une black box pour beaucoup d’entreprises. Si vous êtes un acteur en aval, savoir si vous consommez du lithium australien ou chinois, et en savoir les conditions d’extraction, c’est compliqué. »
Le choix coûteux de l’intégration de la chaîne de valeur
Des approvisionnements indépendants des fluctuations de marché
L’intégration verticale, qui consiste à internaliser tout ou partie de sa chaîne de valeur, représente un autre levier possible de sécurisation des approvisionnements. Cette stratégie recouvre des réalités différentes selon les moyens engagés (croissance organique ou croissance externe), l’envergure financière de l’intégration (coentreprises, prises de participation) et sa portée sur la chaîne de valeur (sur l’amont ou sur l’aval) (Dera, 2022). En l’occurrence ici, c’est en internalisant l’amont de sa chaîne de valeur – en pratique, ses fournisseurs – que l’entreprise a vocation à sécuriser ses approvisionnements. À titre d’exemple, Jean-Paul Chapuy (Ferroglobe) indique que l’activité française de production de silicium métal fait l’objet d’un approvisionnement en partie intégré au sein du groupe : « Une partie importante du quartz provient de nos propres sites d’extraction en Espagne. Deux grandes carrières approvisionnent les usines espagnoles et françaises. » Le fabricant français de câbles électriques Nexans affirme également être un des seuls câbliers à être intégré verticalement ; il possède en effet une usine métallurgique à Lens, dans les Hauts-de-France (la seule de France), acquise en 1971. L’usine fabrique du fil machine en cuivre (à partir de cathodes de cuivre importées) pour les usines européennes de fabrication de câbles du groupe.
Cette intégration verticale présente pour les entreprises l’intérêt de ne plus être tributaires de fournisseurs tiers pour convenir des volumes d’approvisionnement ainsi que des prix de vente (Dera, 2022). Les processus d’achats sortent du marché pour s’opérer d’une filiale à l’autre d’un même groupe (Christmann et Jégourel, 2020).
Les industries automobile et aéronautique franchissent le pas
Ces dernières années, l’intégration verticale a été mobilisée en France comme outil de sécurisation des approvisionnements en métaux par les industries automobile et aéronautique. Après avoir créé une coentreprise de fabrication de batteries en août 2020, Automotive Cells Company (ACC), aux côtés de TotalEnergies puis rejoint par Mercedez-Benz, le groupe Stellantis est rentré au capital de quatre entreprises minières en tant qu’actionnaire minoritaire entre la mi-2022 et la mi-2023 (figure 2.4).
Figure 2.4 – Prises de participation du groupe Stellantis au sein d’entreprises minières
Sources : Presse et communiqués de Stellantis.
« La menace de nouvelles pénuries a poussé les constructeurs à réfléchir très sérieusement à leurs sources d’approvisionnement. Et, dans une certaine mesure, à prendre un contrôle direct sur certaines étapes amont de la chaîne de valeur », contextualise Michel Foucart (McKinsey). Si cette amorce d’intégration verticale apparaît « inédite » en Europe d’après ce dernier, elle est en réalité déjà visible ailleurs dans le monde. « À l’échelle mondiale, l’intégration verticale dans l’industrie automobile n’a rien de nouveau. Les Asiatiques le font depuis une dizaine d’années », rappelle ainsi Gildas Bureau (Stellantis, Plateforme française automobile). Outre-Atlantique, le constructeur américain Tesla avait également racheté, en 2020, une mine d’argile dans le Nevada dans le but d’y extraire du lithium.
Les objectifs poursuivis par ces prises de participation sont doubles. D’une part, elles ont vocation à flécher une partie de la production minière vers la chaîne de valeur du constructeur automobile, comme l’indique Olivier Dubourdieu (Mines Paris – PSL) : « Il s’agit de porter une partie du risque avec [les groupes miniers], mais derrière, il y a une garantie de volume. » D’autre part, elles permettent à l’industriel actionnaire de bénéficier d’une visibilité sur l’évolution de l’activité minière voire de prix inférieurs aux prix de marché. Gildas Bureau, de chez Stellantis, le confirme en soulignant qu’il s’agit d’un moyen de maîtriser les prix sur le long terme.
La filière aéronautique et de défense française a également fait usage de l’intégration verticale pour réduire sa dépendance au titane russe. En avril 2023, les groupes Airbus et Safran ont ainsi racheté, aux côtés du fonds Tikehau Capital, la société métallurgique française Aubert & Duval. Jusqu’alors filiale du groupe Eramet, la société industrielle élabore et produit des matériaux métalliques complexes (aciers spéciaux, superalliages, titane, aluminium) pour les secteurs critiques, dont l’aéronautique et la défense. Elle compte six sites industriels en France, dont un site dédié à l’élaboration d’alliages de titane de qualité aéronautique à Saint-Georges-de-Mons. En novembre 2024, le groupe Safran indiquait ainsi être « quasiment désensibilisé » au titane russe, une désensibilisation à laquelle le rachat d’Aubert & Duval a participé, en parallèle des efforts de diversification mentionnés plus haut dans le chapitre. Pour l’industrie française de défense, ce rachat s’inscrit en outre dans une quête d’autonomie stratégique animée par la Direction générale de l’armement (Desjeux, 2025). En août 2022, quelques mois après l’annonce de la vente d’Aubert & Duval par le groupe Eramet, l’État a ainsi introduit une « action spécifique » au capital de la société, lui permettant de s’opposer à l’éventuelle cession des actifs stratégiques de cette dernière et à certaines prises de participation à son capital au-delà de certains seuils.
Une stratégie engageante et coûteuse sur la durée
Les promesses de l’intégration verticale ne doivent pas pour autant occulter la lourdeur organisationnelle et financière qu’une telle stratégie représente, à la lumière des expériences du terrain.
À court et à moyen terme d’abord, les barrières à l’entrée – de nature technique et capitalistique – qui caractérisent chaque maillon de la chaîne de valeur (extraction, raffinage, etc.) peuvent en limiter la portée (Dera, 2022). Les difficultés rencontrées par le fabricant suédois de batteries électriques Northvolt, déclaré en faillite en mars 2025, pointent ainsi les limites d’une intégration verticale trop rapide et ambitieuse : « Les fabricants de batteries les plus performants en Asie sont ceux qui ont su créer une chaîne de valeur intégrée. La start-up européenne Northvolt avait pour ambition de recréer ce modèle, rappelle Camilla Vachet (Verkor), en travaillant en parallèle le recyclage, la fabrication de précurseurs et l’approvisionnement direct en métaux. C’était un projet d’envergure avec beaucoup de complexité associée à chacune de ces briques. Or, produire des cellules et des modules est une activité déjà très complexe. »
Dans une certaine mesure, la lourdeur organisationnelle et financière de l’intégration verticale explique le choix de Stellantis d’intégrer le capital d’entreprises minières de façon seulement minoritaire. « Un constructeur automobile, il assemble. Son travail n’est pas de faire de la mine. Les constructeurs automobiles ne s’intégreront probablement jamais dans cette activité », estime Olivier Dubourdieu (Mines Paris – PSL). Sophie Personnaz (Directrice de l’électrotechnique chez Valeo et membre de la Plateforme française automobile) le confirme : « Notre cœur de métier n’est pas d’être opérateur minier », soulignant par ailleurs le coût de cette stratégie : « Nous n’avons évidemment pas les moyens d’acheter toute la chaîne de valeur, même en nous regroupant. » Stéphane Bourg (Ofremi) ajoute à cela un manque de visibilité sur l’offre et la demande de métaux qui rend incertaine une remontée de la chaîne de valeur jusqu’à la mine : « On est dans un problème de temporalité : comment voulez-vous qu’un industriel aval comme un constructeur automobile se dise aujourd’hui, “si je veux éviter une disruption dans quinze ans, je vais me positionner sur de l’extraction minière” ? En réalité, il n’aura pas de réponse avant quinze ans. »
Figure 2.5 – Investissements industriels annuels du groupe Eramet en France
Sources : Documents de référence d’Eramet.
À moyen et à long terme ensuite, l’intégration verticale requiert de l’entreprise qu’elle investisse de façon durable dans ses filiales intégrées. Ces dernières années, les cessions successives de plusieurs sites métallurgiques du groupe Eramet en France, dans un contexte de difficultés économiques liées à la crise sanitaire et de recentrage stratégique du groupe sur l’activité minière27, illustre cette lourdeur financière. « Eramet s’est trouvé dans l’incapacité de réinvestir dans le site de Sandouville, explique ainsi Guillaume Descamps (Sibanye-Stillwater) ; nous n’avions donc pas pu obtenir tous les investissements nécessaires à l’amélioration de l’outil de production. L’actionnaire s’est alors mis en quête d’un nouveau propriétaire pour le site et l’a vendu [à Sibanye-Stillwater] en février 2022. » Il en va de même pour la vente d’Aubert & Duval en 2023, qui pâtissait d’une situation de sous-investissement au moment de son rachat d’après un article de L’Usine Nouvelle28 (Davesne et James, 2023). En moyenne, les investissements industriels annuels moyens consentis par le groupe Eramet en France sont tombés à 11 millions d’euros entre 2020 et 2022, contre 80 millions d’euros les trois années précédentes (voir figure 2.5).
Une autarcie relative
Par ailleurs, les expériences et retours du terrain laissent percevoir les limites de l’intégration verticale comme levier de sécurisation des approvisionnements.
D’abord, plus une chaîne d’approvisionnement est longue, plus on peut s’interroger sur l’efficacité d’une intégration verticale qui n’en joindrait que deux maillons. Comme l’indique Stéphane Bourg (Ofremi), « entre la mine et un constructeur automobile, il y a parfois douze intervenants. Il faudrait intégrer la chaîne de valeur de bout en bout. La Chine le fait. Si vous ne prenez que des parts dans la mine et que vous perdez la main sur les matières lors du raffinage, cela ne suffit pas. Tant qu’il n’y a pas d’intégration verticale, la sécurisation est difficile ». Camilla Vachet (Verkor) insiste également sur cette complexité de la chaîne de valeur : « Entre le fabricant de cellules et une mine, il peut y avoir jusqu’à sept ou huit entreprises : des miniers, des raffineurs, des traders et plusieurs transformations des produits jusqu’à la production de cellules. »
Ensuite, les arbitrages d’intégration verticale propres aux entreprises ne les immunisent pas contre des chocs exogènes, y compris de nature politique, pouvant compromettre ponctuellement ou durablement les flux entre filiales. En mai 2025, le Gabon a par exemple annoncé son intention d’interdire les exportations de minerais de manganèse à partir de 2029. Or, le groupe Eramet y exploite, via sa filiale gabonaise Comilog, la plus grande mine de manganèse du monde, la mine de Moanda, laquelle approvisionne en minerais son site français de fabrication de silicomanganèse à Dunkerque. Cette barrière douanière à venir vient mettre un doute sur l’intérêt du modèle d’approvisionnement intégré de l’usine française29. Plus généralement, une entreprise peut tendre vers un approvisionnement exclusivement internalisé, elle reste autant exposée à certaines ruptures que si elle s’en remettait à un fournisseur extérieur. En 2016, le choix du groupe Eramet d’arrêter la production de mattes de nickel dans sa filiale néo-calédonienne avait par exemple contraint la filiale de Sandouville, qui s’en approvisionnait de façon exclusive, à trouver un nouveau fournisseur sur le marché. Comme le rappelle Guillaume Descamps (Sibanye-Stillwater), « en 2013, les Chinois ont fait s’écrouler les cours du nickel à cause de leur production à partir de minerais indonésiens et philippins, à un tel point que 80 % des acteurs du nickel dans le monde perdaient de l’argent, dont la SLN, la filiale d’Eramet à Nouméa. ». Cette expérience rappelle que la viabilité économique du fournisseur reste un préalable à la sécurisation des approvisionnements, que ces derniers soient externalisés ou internalisés.
PECHINEY, LA DÉSINTÉGRATION VERTICALE DE L’INDUSTRIE FRANÇAISE DE L’ALUMINIUM
JUSQU’EN 2003, LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT intégrée au sein du groupe Pechiney. Le groupe, fondé en 1921 sur la base d’actifs miniers et industriels encore antérieurs et détenu par l’État entre 1982 et 1995, était positionné à la fois sur l’extraction de bauxite (historiquement dans le Var, mais également en Guinée et en Grèce), la production d’alumine (notamment à Gardanne, où est située la première usine mondiale ayant recouru au procédé Bayer de production d’alumine à partir de bauxite), la production d’aluminium primaire et les activités de transformation en aval (fonderie, laminage et fabrication de produits intermédiaires en aluminium).
En 2003, le groupe Pechiney, en difficulté financière et dans un contexte de consolidation de l’industrie mondiale de l’aluminium, a fait l’objet d’une offre publique d’achat hostile de la part du groupe canadien Alcan, qui en a repris la quarantaine de sites industriels alors actifs en France (Esposito, 2012). Parmi eux, figuraient notamment l’usine de production d’alumine de Gardanne ainsi que les usines de fabrication d’aluminium de Dunkerque et de Saint-Jean-de-Maurienne, des sites toujours en activité, mais qui ont depuis fait chacun l’objet de nouveaux mouvements capitalistiques.
Le retour d’expérience d’Ensorcia, qui porte en France un projet de raffinerie de lithium à partir de minerais extraits en propre en Amérique du Sud, résume bien cette ambivalence de l’intégration verticale, atout stratégique pour certains et risque pour d’autres : « On est sur un marché du lithium où tout est en tension et en dépendances, en termes de flux, de volume, de qualité, etc. On a donc nous-mêmes intérêt à réduire ces tensions et dépendances, en intégrant verticalement la chaîne de valeur de la ressource, jusqu’à l’extraction et le raffinage des produits finis, indique Pierre de Lapeyrière (président Europe d’Ensorcia). Pourtant, quand on va voir les banquiers pour financer notre usine française d’hydroxyde de lithium, ils disent “il faut que vous acceptiez de raffiner le lithium d’autres sources, pas uniquement le vôtre.” Eux disent qu’il y a plus de risques à faire du mono-sourcing, nous, on dit l’inverse. »
UN FONDS PUBLIC-PRIVÉ POUR PRENDRE DES PARTICIPATIONS DANS LA CHAÎNE DE VALEUR DES MÉTAUX CRITIQUES
EN MAI 2023, À LA SUITE DE LA RECOMMANDATION dont la gestion est confiée à la société d’investissement Infravia Capital Partners.
Ce fonds investira en minoritaire dans des projets de production de métaux critiques (extraction, transformation, recyclage) en France, en Europe et à l’international, à partir de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) élevés. Les prises de participation couvriront notamment les métaux des filières de la mobilité électrique et de la production d’énergie décarbonée (lithium, cobalt, nickel et terres rares) et garantiront aux investisseurs du fonds un approvisionnement prioritaire. La levée de fonds est en cours auprès de partenaires financiers et industriels (notamment des secteurs automobile, aéronautique et de défense) pour atteindre entre 1,5 et 2 milliards d’euros, dont 500 millions d’euros injectés par l’État dans le cadre de France 2030.
À long terme, les promesses de la substitution matière
De la substitution matière à la substitution technologique
Si la diversification des approvisionnements et l’intégration verticale ont vocation à les émanciper de leur dépendance aux fournisseurs, la substitution promet, quant à elle, d’affranchir les entreprises industrielles de leur dépendance aux matières elles-mêmes.
La recherche de substituts peut d’abord porter sur les métaux sur la base des propriétés physiques et chimiques recherchées. Par exemple, l’aluminium est utilisé de longue date comme un substitut du cuivre dans les infrastructures de transport d’électricité du fait de sa bonne conductivité électrique et de sa légèreté. Comme le rappelle Stéphane Heurtault (RTE), « la bascule vers l’aluminium, sur la partie aérienne, a été réalisée dans les années 1920-1930. Elle a permis d’économiser la construction de nombreux pylônes électriques ».
À ce jour, la recherche de substituts de matière est très visible dans l’industrie des batteries électriques lithium-ion, où elle se matérialise à la fois sur la cathode et sur l’anode. S’agissant de la cathode d’abord, les nouvelles générations de batteries Nickel-Manganèse-Cobalt (NMC), batteries qui dominent le marché européen, intègrent de moins en moins de cobalt au profit du nickel30. « Il y a une volonté de réduire le contenu en cobalt qui est le métal le plus cher ; de plus, en mettant plus de nickel, on gagne en densité d’énergie », souligne Fabien Perdu (ingénieur-chercheur au CEA-Liten)31. D’autres chimies de cathode vont plus loin dans la recherche de substituts. C’est notamment le cas des batteries Lithium-Fer-Phosphate (LFP). « Du point de vue de la criticité des métaux, le LFP est plus intéressant, car il n’y a pas de nickel ni de cobalt », poursuit Fabien Perdu. Cette chimie, dominante sur le marché chinois, se déploie progressivement sur le marché européen ; d’après les données de l’AIE, la part de la chimie LFP dans les ventes de batteries de véhicules électriques en Europe est passée de 3 % en 2022 à 10 % en 2024 (contre 75 % des ventes de batteries en Chine). La figure 2.6 illustre, de façon non exhaustive, la diversité des compositions chimiques dans les cathodes de batteries électriques.
Figure 2.6 – Composition des batteries lithium-ion selon leur chimie de cathode (en % à partir de compositions chimiques exprimées en kg/kWh)
Sources : Maisel et al. (2023).
À l’anode des batteries ensuite, le graphite naturel, dont la Chine domine la production mondiale, fait l’objet d’une substitution par du graphite artificiel, fabriqué à partir de coke de pétrole. Actuellement, « la majorité du graphite dans les voitures électriques est du graphite artificiel », constate Fabien Perdu. Une nouvelle substitution est à l’étude avec les anodes en silicium, qui promettent d’accélérer les temps de recharge des batteries. Enfin, des projets de recherche de substituts aux batteries lithium-ion, comme les batteries « tout solide » et les batteries sodium-ion, ambitionnent d’émanciper l’industrie automobile de sa dépendance résiduelle au lithium (voir encadré).
FRANCE 2030 À LA RECHERCHE DE BATTERIES SANS LITHIUM
DANS LE CADRE DE LA STRATÉGIE D’ACCÉLÉRATION plan d’investissement France 2030 comporte plus précisément un programme prioritaire de recherche baptisé PEPR Batteries, doté d’une enveloppe de 50,5 M€ sur sept ans et piloté par le CNRS et le CEA.
Ce programme finance dix-neuf projets de recherche sur trois axes : le développement de chimies innovantes comme les batteries « tout solide » et les batteries potassium-ion et sodium-ion (54 % du budget total), les systèmes innovants de gestion et de contrôle des batteries et les outils de caractérisation et de simulation pour mener ces recherches.
La substitution peut ensuite dépasser les arbitrages entre matières pour s’opérer à l’échelle des produits et des technologies (Mertens et al., 2024). À titre d’exemple, plusieurs technologies s’émancipent déjà de la dépendance aux terres rares. Dans l’industrie des éoliennes terrestres, les générateurs asynchrones ou à induction se sont substitués aux machines synchrones à aimants permanents (Pavel et al., 2017 ; Mertens et al., 2024). En France, les générateurs fonctionnant aux aimants permanents ne représentaient que 6,2 % de la capacité installée du parc éolien terrestre national en 2018 d’après une étude de l’Ademe (2020), qui souligne que les constructeurs ont fortement adapté leur offre dans la foulée de la crise des terres rares de 2010, qui avait provoqué une flambée des prix du dysprosium.
De la même façon, les constructeurs automobiles intègrent de façon croissante des moteurs sans terres rares dans leurs véhicules électriques. « Chez Renault, les moteurs électriques sont à rotor bobiné, donc nous sommes moins impactés par une rupture d’approvisionnement en terres rares », souligne par exemple Barbara Forriere (Renault Group). Mise sur le marché en 2012, la Renault Zoé est un des premiers véhicules électriques du groupe à avoir été doté de ces moteurs, que le constructeur développe avec l’équipementier Valeo.
Des compromis technico-économiques à consentir
La substitution des métaux et des technologies n’est toutefois pas automatique au sein des entreprises dans la mesure où elle peut altérer l’équilibre performance-coût par rapport à la composition initiale éprouvée par le marché. La figure 2.7, réalisée à partir des fiches de criticité produites par le BRGM et disponibles sur le site Minéralinfo, indique que la grande majorité des métaux stratégiques ne sont, en réalité, pas substituables à isoperformance à ce jour. La substitution du magnésium dans les alliages induit par exemple un alourdissement de ces derniers. S’agissant du titane, le BRGM signale qu’il n’existe que peu de matériaux ayant à la fois le même rapport résistance-poids et la même résistance à la corrosion, si bien que sa substituabilité est faible. « Les aimants en terres rares permettent de faire les moteurs les plus efficients du marché », souligne de son côté Frédéric Carencotte (président de Carester). Ainsi, les générateurs à aimants permanents restent majoritaires dans le segment des éoliennes en mer. Comme le souligne l’Ademe (2020), ils permettent de réduire les coûts des opérations de maintenance et le poids des nacelles, et donc celui du mât et des fondations.
Figure 2.7 – Substituabilité des métaux stratégiques
Réalisation : La Fabrique de l’industrie d’après Mineralinfo,
hors aluminium, bismuth et bore, dont les fiches de criticité sont manquantes.
L’industrie des batteries électriques illustre bien les répercussions de la substitution des métaux sur les performances techniques. Par comparaison avec les batteries NMC, la présence plus faible de métaux stratégiques dans les batteries LFP a pour contrepartie une densité énergétique plus faible qui influe négativement sur l’autonomie du véhicule. À l’inverse, la présence importante de nickel dans les batteries NMC permet d’en améliorer la densité énergétique au prix toutefois d’une moindre stabilité thermique, se manifestant par des risques de surchauffe, et une durée de vie plus limitée. La figure 2.8 synthétise dans un tableau ces différences techniques.
Figure 2.8 – Caractéristiques techniques d’une batterie NMC et d’une batterie LFP
(*) Il existe des modèles de batteries NMC et LFP allant au-delà ou en deçà des fourchettes indiquées mais ils ne sont pas représentatifs du marché.
Réalisation : La Fabrique de l’industrie à partir de Jasper et al. (2022), BloombergNEF (2023) et échanges avec Fabien Perdu (CEA-Liten).
Les fragiles conditions d’émergence de substituts
Les entretiens soulignent que l’émergence même des substituts dépend d’abord des avancées, lentes et incertaines, de la recherche, dont les résultats s’apprécient sur le long terme. Fabien Perdu (CEA-Liten) l’illustre avec les chimies des batteries : « Nous ne sommes jamais sûrs que la technologie aboutira. Par exemple, cela fait cinq ans que tout le monde prédit que les batteries tout solide révolutionneront la densité d’énergie et la sécurité ; en pratique, il y a d’importantes difficultés qui font que ces batteries ne sont pas encore commercialisables. Avant cela, il y a eu un grand engouement pour le lithium-air. Aucun développement que nous faisons en batterie n’est garanti. » Il ajoute : « Il y a facilement dix années entre le moment où on commence à faire marcher une chimie en laboratoire et le moment où elle est déployée à grande échelle dans des véhicules. » L’expérience de l’entreprise TIAMAT l’illustre ; la start-up industrielle projette de démarrer la production de batteries sodium-ion à grande échelle en France à l’horizon 2027, soit dix ans après sa création en essaimage du CNRS.
Le recours effectif aux substituts découle ensuite des conditions de marché et plus précisément des prix relatifs des matières. Guillaume de Goÿs (Aluminium Dunkerque) l’illustre par l’échec de la substitution de la bauxite par du kaolin pour produire de l’alumine métallurgique : « Une start-up canadienne dénommée Orbite Technologies s’était félicitée d’avoir trouvé un processus de conversion spectaculaire du kaolin en alumine très pure. Aujourd’hui, il n’y a aucune utilisation à l’échelle de l’alumine à partir de kaolin pour l’industrie de l’aluminium. La problématique est plus économique que technique. » De la même façon, la compétitivité des batteries sodium-ion par rapport aux batteries lithium-ion est très dépendante d’une augmentation attendue des prix du lithium qui pousserait en effet la filière à trouver des substituts moins chers (Capliez et al., 2024).
D’une dépendance matière à une autre
La substitution offre également des promesses contrastées de réduction des dépendances d’approvisionnement. À l’échelle macroéconomique, les fortes tensions qui pèsent sur l’offre de métaux sont de nature à stimuler le recours à des alternatives (matières ou technologiques), lesquelles deviendraient plus compétitives à long terme. « Je n’anticipe pas de pénurie généralisée de cuivre parce que des substituts se mettront en place, affirme ainsi Didier Pitot (Lebronze alloys). Si le cuivre devient trop cher, certains usages vont disparaître ; il y aura une substitution par autre chose. » Frédéric Carencotte (Carester) livre un avis similaire s’agissant des terres rares : « Si le dysprosium ou le terbium deviennent trop chers, on en mettra de moins en moins. »
Toujours à l’échelle macroéconomique, la coexistence de différentes chimies de batteries augure une diversification des besoins en métaux dans l’industrie automobile européenne, par-delà les seuls métaux des batteries NMC. Le propos de Camilla Vachet (Verkor) illustre cette complémentarité des chimies de batteries : « Le choix de la chimie doit être fait à l’aune du besoin client. Chaque chimie a ses avantages et ses inconvénients. » Dans cette continuité, Gildas Bureau (Stellantis, Plateforme française automobile) indique que « les nouvelles technologies de batteries viendront en complément des précédentes dans les nouveaux modèles de véhicules. Une technologie ne va pas du jour au lendemain remplacer toutes les autres ».
Toutefois, à l’échelle microéconomique, la substitution a des effets plus nuancés dans la mesure où, en pratique, elle est de nature à déplacer les dépendances plutôt qu’à les supprimer. La figure 2.7 illustre que les substituts des matières stratégiques sont généralement d’autres matières également jugées stratégiques. C’est le cas du palladium, substitut du platine dans la catalyse automobile ou du gallium, substitut du germanium dans les semi-conducteurs. Il en va de même lorsque la substitution s’opère à l’échelle des technologies. « Renault fait des moteurs électriques sans terres rares, sauf que le moteur est plus lourd et contient plus de cuivre », souligne Frédéric Carencotte (Carester), qui rajoute : « On voit des permutations entre dysprosium et terbium, mais personne n’anticipe une baisse de la consommation de ces deux éléments. » Fabien Perdu (CEA-Liten) poursuit : « Aujourd’hui, certaines batteries sodium-ion utilisent du vanadium. En matière de criticité, ce n’est pas extraordinaire non plus. »
Enfin, la substitution peut introduire de nouvelles dépendances économiques et technologiques. Ainsi, la diversification récente des constructeurs automobiles européens vers les batteries LFP s’est faite notablement au prix d’un rapprochement avec les fournisseurs asiatiques, et notamment chinois, qui en maîtrisent la technologie32. En 2024, les constructeurs Renault et Stellantis ont tous les deux annoncé des partenariats industriels avec le leader chinois CATL pour s’approvisionner en batteries LFP fabriquées en Europe, en Hongrie depuis l’usine de CATL pour le premier et en Espagne dans le cadre d’une coentreprise pour le second.
Au-delà de la substitution, l’amélioration des procédés pour alléger les dépendances
En parallèle de la substitution, plusieurs leviers d’innovation complémentaires permettent, de l’amont à l’aval des chaînes de valeur, d’alléger les tensions sur l’offre mondiale
En amont, le développement de nouveaux procédés d’extraction
Dans l’industrie minière, le développement de nouveaux procédés d’extraction permet d’accroître l’offre mondiale de minerais en élevant les « ressources » connues au rang de « réserves », par définition à la fois techniquement et économiquement exploitables. À titre d’exemple, l’arrivée à maturité de la technologie dite « d’extraction directe » de lithium, ou DLE (Direct Lithium Extraction), permet d’accélérer l’extraction du lithium en milieu aqueux (dans les salars, très concentrés en sels de lithium).
Mentionnés en partie précédente, les projets d’extraction de lithium des groupes Eramet et Ensorcia en Amérique du Sud* sont précisément adossés à cette nouvelle technologie. En juillet 2024, le groupe Eramet a inauguré une usine de production de lithium à Centenario, en Argentine, reposant sur une technologie DLE, propriété protégée par douze brevets. De façon notable, c’est également sur cette innovation que le groupe s’appuie pour envisager l’extraction du lithium en milieu géothermal en France, comme l’indique Ludovic Donati (Eramet) : « On maîtrise une technologie qui permet d’extraire le lithium directement de l’eau salée (saumures) et de le raffiner en carbonate de lithium de qualité batterie. Le rationnel derrière était le suivant : peut-on l’appliquer à d’autres gisements de lithium “liquides” ? C’est ce que nous avons regardé à la fin des années 2010 en France via un projet européen financé par l’Europe, Eugeli, European Geothermal Lithium, dans lequel nous étions en consortium avec Électricité de Strasbourg, le BRGM et d’autres organismes de recherche. »
En aval, la conception des produits au service de l’efficacité matière
À la portée des entreprises industrielles, l’efficacité matière consiste à atteindre la même performance avec moins de volume d’intrants. Frédéric Carencotte (Carester) l’illustre avec le cas des terres rares qui entrent dans la composition des aimants permanents pour les éoliennes : « Le dysprosium et le terbium permettent au moteur de tenir des températures plus élevées**. En revanche, avec les progrès en la matière, le dysprosium et le terbium sont mis de façon plus intelligente sur les aimants ; ces derniers en utilisent moins, voire beaucoup moins. » En 2020, l’équipementier germano-espagnol Siemens Gamesa a par exemple inauguré un modèle d’éolienne en mer dans lequel les aimants ont été placés à l’extérieur du générateur, lui-même situé à l’extérieur de la nacelle ; ce design permet aux aimants de se refroidir au contact de l’air ambiant et donc de nécessiter moins de dysprosium. Les nouveaux modèles de générateurs fonctionnent ainsi avec des aimants permanents contenant 1 % de dysprosium, contre 3 % à 6 % sur les modèles existants (Pavel et al., 2017).
(*) D’après les données USGS, l’Argentine et le Chili représentent 28 % de l’extraction mondiale de lithium en 2024, mais 44 % des réserves mondiales. Avec la Bolivie, ils forment le « triangle de lithium » et se partagent des plateaux riches en lithium dans les Andes centrales.
(**) Plus précisément, le dysprosium et le terbium sont intégrés dans les aimants permanents des générateurs d’éoliennes pour améliorer la résistance à la démagnétisation qui peut survenir à haute température.
Trois conclusions transverses émergent au terme de ce deuxième chapitre. Il ressort d’abord de notre enquête de terrain que les entreprises industrielles ne sont pas inactives face aux tensions d’approvisionnement ; au contraire, elles font preuve d’une capacité de réaction voire de prévention. Pour cause, il en va de la continuité de leur activité. Pour réduire sa dépendance à la raffinerie irlandaise d’alumine du groupe Rusal, la filière française de l’aluminium (Aluminium Dunkerque, TRIMET) a diversifié ses sources d’approvisionnement. Pour réduire son exposition au titane russe, la filière aéronautique française et de défense (Airbus et Safran) a mobilisé à la fois la diversification des approvisionnements et l’intégration verticale, par le rachat de leur fournisseur de matériaux critiques français Aubert & Duval. Face aux tensions structurelles qui pèsent sur les métaux des batteries électriques, les constructeurs automobiles (Stellantis, Renault) ont recours à la fois à l’intégration verticale et à la substitution matière, en lien avec la diversité des chimies de batteries.
Il ressort ensuite de ces échanges qu’aucun levier de sécurisation n’est instantané ; chacun des leviers emporte des contraintes techniques, industrielles et économiques qui peuvent ralentir voire compromettre leur usage par les entreprises. Ainsi, la substitution matière, parce qu’elle repose sur les avancées de la recherche technologique, s’apparente plutôt à un levier d’action préventif à long terme. La diversification des sources d’approvisionnement, sur la base des fournisseurs existants sur le marché, peut être envisagée à plus court terme par les directions achats comme levier de gestion ou d’anticipation de crise, moyennant toutefois un processus de qualification pouvant prendre plusieurs mois. Quant à l’intégration verticale, elle est soumise à un arbitrage stratégique de la part du dirigeant, d’une part parce que cette décision signe un élargissement du modèle d’affaires de l’entreprise par-delà son cœur de métier, d’autre part parce que cette décision s’avère particulièrement coûteuse.
Il en résulte enfin que la sécurisation envisageable pour chacun de ces leviers n’est jamais garantie à l’échelle microéconomique : la diversification des fournisseurs peut cacher une dépendance plus en amont sur la chaîne de valeur ; l’intégration verticale internalise la dépendance et n’immunise pas contre des chocs exogènes ; la substitution matière déplace la dépendance vers de nouvelles matières.
Le troisième chapitre se focalise sur les leviers de sécurisation des approvisionnements à l’échelle européenne, permettant de réduire les incertitudes commerciales et géopolitiques qui pèsent sur les entreprises lorsqu’elles s’approvisionnent dans le monde.
- 20 — La Dera, ou German Mineral Resources Agency, est la structure nationale en charge de l’information et de l’intelligence minérale en Allemagne. Créée en 2010, elle est rattachée à l’Institut fédéral de géosciences et de ressources naturelles, équivalent allemand du BRGM.
- 21 — Le BFR se définit comme la différence entre l’actif circulant (dont font partie les stocks) et le passif circulant. À trésorerie nette inchangée, un accroissement du BFR se traduit par un besoin de recapitalisation – ou par une pression à la baisse sur les actifs immobilisés.
- 22 — Le recyclage et la relocalisation de l’approvisionnement au sein de l’Union européenne sont étudiés dans le chapitre suivant portant sur l’émergence de chaînes d’approvisionnement régionalisées.
- 23 — D’après les calculs antérieurs de la Commission européenne (2020), ce plafond est par exemple dépassé pour les terres rares lourdes et légères (respectivement 99 % et 98 % de la consommation européenne étant assurée par la Chine), les minerais de borate (98 % par la Turquie), le magnésium et le bismuth (93 % par la Chine pour ces deux métaux), les minerais de lithium (78 % par le Chili) et les minerais de cobalt (68 % par la République démocratique du Congo).
- 24 — En vertu du principe de non-discrimination de l’OMC (clause de la « nation la plus favorisée ») et des accords de libre-échange signés par l’Union européenne, 92 % des importations européennes de matières premières critiques en valeur sont exonérées de droits de douane (Commission européenne, 2023).
- 25 — En 2017, l’usine de Sandouville a arrêté de s’approvisionner auprès de son fournisseur historique basé en Nouvelle-Calédonie, la Société Le Nickel (SLN), en difficulté, au profit du groupe finlandais Boliden.
- 26 — La matte de nickel est le produit issu de la première transformation du minerai de nickel par traitement pyrométallurgique. L’usine de Sandouville en tire du nickel pur par un procédé hydrométallurgique.
- 27 — Dans les années 1990, le groupe minier Eramet a diversifié ses activités vers l’aval en absorbant deux acteurs métallurgiques français, Erasteel en 1992 (production d’aciers rapides) et Aubert & Duval en 1999 (fabrication de pièces forgées et matricées). Entre 2022 et 2023, le groupe Eramet a conduit un recentrage stratégique sur son cœur de métier, l’activité minière et la première métallurgie, en cédant ces deux filiales. Ludovic Donati (Eramet) revient sur les sous-jacents de cette intégration horizontale en cours : « Depuis plusieurs décennies, Eramet est un acteur mondial du manganèse et du nickel, dont l’un des coproduits est le cobalt ; nous étions quasiment positionnés sur tous les métaux nécessaires à la fabrication des batteries électriques. Au début des années 2010, avec l’essor annoncé des véhicules électriques, le lithium est apparu comme un métal dont l’approvisionnement serait important pour les batteries. Nous avons donc commencé les recherches en Argentine. »
- 28 — À la faveur de son nouvel actionnariat, Aubert & Duval bénéficie actuellement d’un plan d’investissement de 350 M€ sur quatre ans, soit le double du montant moyen consenti avant son rachat (Pinaud, 2025).
- 29 — Sur son site institutionnel, le groupe Eramet indique toutefois que l’usine de Dunkerque s’approvisionne également en minerais de manganèse d’Afrique du Sud.
- 30 — Une batterie NMC-811 comporte quatre fois moins de cobalt et deux fois plus de nickel qu’une batterie NMC-111. Par déduction à partir des compositions chimiques reportées en figure 2.6, le volume de cobalt s’élève, dans une batterie de 50 kWh de puissance, à 4,1 kg dans une batterie NMC-811 (contre 16,7 kg dans une batterie NMC-111), et le volume de nickel s’élève à 32,5 kg dans une batterie NMC-811 (contre 16,7 kg dans une batterie NMC-111).
- 31 — La réduction du contenu en cobalt comporte également des motivations éthiques, les mines de cobalt en République démocratique du Congo faisant l’objet de soupçons croissants portant sur la précarité des conditions de travail et le recours au travail des enfants (Hebert & McCalla, 2021).
- 32 — L’AIE (2025) constate à ce titre que la chaîne de production des batteries LFP (raffinage des métaux, fabrication des composants et fabrication des cellules) est encore plus dominée par la Chine que la chaîne de valeur des batteries à base de nickel.
L’émergence de chaînes d’approvisionnement régionalisées
Ce troisième et dernier chapitre étudie l’opportunité pour les entreprises de s’approvisionner en métaux stratégiques à l’échelle européenne. Cet axe de sécurisation couvre le recours aux métaux produits à partir de déchets existants (recyclage) ou de nouvelles ressources minières (relocalisation d’activités minières et de raffinage). L’enjeu est donc de développer des filières secondaires et primaires sur le territoire français et européen. Si cette dynamique est bien en cours, son accélération reste un défi industriel et économique et appelle, à l’unanimité des entreprises rencontrées, à un soutien renforcé de la part de l’Union européenne.
Des filières de recyclage de métaux en structuration
Une substitution possible à la filière primaire
Le recours à des métaux recyclés constitue un levier que peuvent mobiliser les entreprises industrielles pour sécuriser leurs approvisionnements. Dans le cadre du Critical Raw Materials Act, la Commission ambitionne d’ailleurs de couvrir 25 % des besoins européens en métaux stratégiques par des matières recyclées à l’horizon 2030.
Les entretiens ont permis d’attribuer plusieurs intérêts au recyclage. Ce levier a d’abord vocation à émanciper les entreprises de leur dépendance à la chaîne de valeur primaire, atténuant de fait la pression sur les ressources minières. Comme l’indique Erick Petit (MagREEsource), « le modèle circulaire sert à remplacer le modèle linéaire, de façon à éviter les dépendances aux mines pour retrouver la matière ». « La tension sur les approvisionnements en métaux se fait sentir. Le recyclage permet, en partie, de répondre à cette tension », souligne de son côté Serge Kimbel (WEEECycling). D’après les estimations de la Diamms, le recyclage du cuivre, du lithium, du nickel et du cobalt pourrait par exemple réduire les besoins en approvisionnements primaires de 10 % à 30 % (Assemblée nationale, 2024). Ensuite, le recyclage a vocation à rapprocher la chaîne d’approvisionnement, notamment parce qu’il s’appuie surtout sur les gisements de déchets disponibles à l’échelle locale, nationale ou européenne. « Le recyclage est intéressant, car il permet de gagner petit à petit en autonomie stratégique sur des matériaux critiques tout en développant une chaîne de valeur locale », affirme Camilla Vachet (Verkor). Enfin, ce levier permet de réduire les consommations d’énergie et les émissions de CO₂ liées à l’extraction et au raffinage des métaux primaires. Une tonne d’aluminium recyclé affiche ainsi, en scope 1 (hors émissions de l’extraction de minerais), une intensité carbone quatre fois inférieure à une tonne d’aluminium primaire d’après les données d’Aluminium France.
Le recyclage repose, plus précisément, sur la valorisation des matières issues de rebuts de production (« new scrap ») et de produits en fin de vie (« old scrap » ou « mines urbaines »). La littérature et les entretiens s’accordent sur la sous-exploitation de ces gisements en France, pour des raisons qui seront explicitées dans les pages suivantes. Le Service des données et études statistiques33 (SDES, 2022) rappelle que la France est le premier pays exportateur net de matières premières de recyclage (MPR) en Europe. Sur le périmètre des déchets de métaux non ferreux, la France est le deuxième pays exportateur net de l’Union européenne d’après les données d’Eurostat, derrière les Pays-Bas (figure 3.1).
Erick Petit (MagREEsource) et Frédéric Carencotte (Carester) illustrent pourtant les promesses offertes par le recyclage dans les cas des terres rares et des aimants permanents : « Un déchet d’aimant ressemble beaucoup à de la ferraille. La plupart des acteurs industriels l’assimilent à de la ferraille et ne le valorisent donc pas », affirme le premier. « J’ai rapidement compris que nous avions des chutes de production, des aimants à recycler, des mines urbaines. Par exemple, toutes les trottinettes électriques ont des aimants permanents avec des terres rares, les voitures également », souligne le second. Damien Letort (ROSI Solar) en témoigne de son côté pour les panneaux photovoltaïques : « Aujourd’hui, il y a plutôt trop de panneaux solaires devant être recyclés que pas assez. En 2024, l’éco-organisme Soren a collecté 10 000 tonnes de panneaux solaires en France. » Didier Pitot (Lebronze alloys) poursuit s’agissant des alliages de cuivre : « La majorité de notre sourcing vient du recyclage. Nous n’avons pas de problème d’approvisionnement, car nous disposons en France et en Europe de plus de chutes que de besoins. Nous sommes sur un marché excédentaire. »
Figure 3.1 – Solde commercial des pays de l’Union européenne en déchets recyclables de métaux non ferreux (en milliers de tonnes)
Source : Eurostat, données 2024.
Note : Un solde positif signifie que le pays exporte davantage de déchets recyclables de métaux non ferreux qu’il n’en importe.
Les réseaux d’infrastructures s’apprêtent à accroître encore ce potentiel de recyclage en France. S’agissant des réseaux de télécommunications, le débranchement progressif du réseau cuivre (soit un million de kilomètres de câbles), sur lequel reposent les technologies historiques de téléphonie fixe RTC puis d’Internet par ADSL, permettra au groupe Orange de récupérer des quantités significatives de cuivre entre 2025 et 2032 ; les tonnages précis de cuivre collectés sur cette période ne sont pas communiqués par le groupe Orange mais ils sont estimés à « des centaines de milliers de tonnes » dans un article de L’Usine Nouvelle 34 (Duteuil, 2025). S’agissant des infrastructures de transport d’électricité, le développement du réseau de haute et très haute tensions, dans un contexte d’électrification des usages, sera adossé de façon croissante au recyclage de câbles électriques usagés. Dans le cadre de son schéma stratégique présenté en février 2025, le groupe RTE a pour ambition d’augmenter le taux d’aluminium recyclé dans ses câbles à 30 % à l’horizon 2040.
Un défi industriel : l’exemple du cuivre et de l’aluminium
La mobilisation de ce potentiel national requiert toutefois le développement de filières industrielles à même d’absorber les volumes de matières premières de recyclage (MPR). Or, les capacités de production à partir de ces MPR ne sont pas, à ce jour, toujours suffisantes au regard des volumes en question. C’est notamment le cas pour le cuivre et l’aluminium. Pour ces deux métaux stratégiques, l’Ademe (2023a) diagnostique une sous-capacité de recyclage en France. À partir des données de collecte et d’échanges commerciaux, elle estime que seules 64 % des MPR d’aluminium disponibles ont été effectivement recyclées dans des sites industriels en France en 2019, une part qui tombe à 36 % pour les MPR de cuivre (voir figure 3.2). Faute de capacités industrielles, les volumes restants trouvent des débouchés à l’export, notamment dans le reste de l’Union européenne (82 % des exportations françaises de MPR d’aluminium et 90 % pour le cuivre en 2024). Didier Pitot (Lebronze alloys) l’illustre s’agissant du cuivre, « dès que nous ne sommes pas sûrs de pouvoir valoriser un déchet uniquement par des méthodes de tri et de reconditionnement, nous allons devoir l’exporter, car il n’existe pas d’unités d’affinage de cuivre en France. C’est la pièce manquante du puzzle ». Guillaume de Goÿs (Aluminium Dunkerque) abonde s’agissant de l’aluminium : « Les capacités de recyclage ne sont pas le seul problème à régler pour remédier au problème d’export de MPR hors de France (et hors d’Europe). Deux autres problèmes limitent la capacité de recyclage en France. Le premier, c’est un sujet économique : par le jeu de droits de douane qui s’appliquent aux produits en aluminium, mais pas aux rebuts d’aluminium, les États-Unis attirent de plus en plus de MPR venant d’Europe. D’autre part, le manque de tri à la source des rebuts d’aluminium augmente les coûts de tri, et certains pays hors France offrent des coûts de tri (souvent manuels) beaucoup plus bas. Ceci permet à ces pays d’offrir une surprime aux déchets français ou européens qui de ce fait quittent le territoire. »
Derrière le recyclage, deux filières distinctes
L ’ industrie du recyclage cache deux procédés industriels : le recyclage direct d’une part, l’affinage d’autre
La première filière, dite du recyclage direct, consiste à fondre des MPR de composition homogène (canettes usagées, chutes internes, etc.) pour produire des métaux de composition similaire. Ici, la pureté du métal secondaire est donc dépendante de la pureté des intrants métalliques. Comme le souligne Didier Pitot (Lebronze alloys), « l’enjeu est de trouver les bonnes chutes. Plus elles sont impures, sales et mélangées, plus elles sont décotées. Il y a des seuils de pureté en dessous desquels on ne peut pas utiliser les chutes. Il y a un équilibre à trouver ». Cette contrainte technique invite donc au préalable à améliorer le tri des matières voire à privilégier des boucles fermées de recyclage pour se prémunir du « downcycling », c’est-à-dire de la perte de qualité du métal après son recyclage. Comme l’indique Alexandre Damiens (Orano), « le downcycling fait perdre le caractère stratégique aux actions de recyclage et engendre une perte de performance des produits recyclés ». Stéphane Heurtault (RTE) le souligne à la lumière du projet d’expérimentation de recyclage des câbles électriques mené par le groupe RTE en 2023 : « On se rend compte, avec nos partenaires industriels, que faire des câbles aériens avec de l’aluminium recyclé qui ne provient pas de nos câbles existants est presque impossible, car nous ne retrouvons pas la bonne pureté de l’aluminium. Mais nous avons été rassurés sur le fait qu’ils peuvent réutiliser l’aluminium de nos anciens câbles pour en produire de nouveaux. À petite échelle, cela n’impacte pas la qualité. C’est un beau succès technique. » C’est d’ailleurs à la suite de cette expérimentation réussie en boucle fermée que les groupes RTE et Nexans ont annoncé, en juillet 2025, le lancement d’une filière nationale de recyclage de câbles électriques.
La deuxième filière, dite d’affinage, s’accommode davantage de l’hétérogénéité des MPR entrantes par le recours à des procédés énergivores de traitement et de purification, comme la pyrométallurgie, l’hydrométallurgie ou encore le raffinage électrolytique. Pour produire des métaux de haute pureté (> 99,9 %), cette filière fait donc appel à un savoir-faire métallurgique relativement proche de celui de la filière industrielle primaire.
Figure 3.2 – Flux de MPR du cuivre et de l’aluminium en France (en milliers de tonnes)
Sources : (a) Ademe (2023a) (scories, cendres et résidus compris). (b) ITC (hors scories, cendres et résidus).
La difficulté de recycler l’ensemble des déchets produits en France tient à la fois aux barrières à l’entrée des activités de recyclage (lourdeur des investissements, savoir-faire métallurgique) et aux fortes pressions concurrentielles, notamment sur les activités d’affinage qui constituent un procédé majeur de recyclage. La figure 3.3 présente succinctement les filières nationales de recyclage de l’aluminium et du cuivre. Il apparaît notamment que la France n’est, effectivement, pas dotée de capacité industrielle d’affinage de cuivre à ce jour. Cette filière a disparu au début des années 2000, du fait d’un déficit de compétitivité par rapport à la concurrence étrangère, y compris européenne (Menard, 2022). Elle était alors répartie sur deux fonderies historiques, une à Palais-sur-Vienne (la Société électrométallurgique du Palais, créée en 1920 à la demande de l’État pour transformer les minerais de cuivre et les déchets de cuivre par voie électrolytique) et une à Poissy (Fonderie du Picquenard, fondée en 1881 et active à partir de 1950 dans l’affinage de cuivre issu de résidus cuivreux). La première, rattachée au groupe Pechiney dans les années 1990, a cessé son activité dans les années 2000 avant de fermer en 2010. La deuxième, après plusieurs décennies de protestation contre la pollution locale générée par le site, a cessé son activité d’affinage de cuivre en 1999 avant de fermer en 2004.
Figure 3.3 – Capacités industrielles de recyclage d’aluminium et de cuivre en France
Réalisation : La Fabrique de l’industrie d’après Ademe (2023a).
Si la France affiche encore une activité d’affinage d’aluminium (répartie sur une dizaine de sites), cette filière a significativement reculé depuis 2000 (–47 % en volume de production entre 2000 et 2022 d’après les données mobilisées par le Citepa). Comme l’indique l’Ademe (2023b), l’équilibre économique des entreprises d’affinage d’aluminium est pris en étau entre les pressions à la hausse des prix des déchets et les pressions à la baisse des prix des alliages de fonderie exercées par les secteurs consommateurs (dont l’industrie automobile). Ce recul de l’outil industriel d’affinage participe à l’augmentation des exportations françaises de MPR d’aluminium et de l’excédent commercial visible en figure 3.2.
En France, des filières de recyclage en développement
S’il est difficile de suivre statistiquement l’industrie du recyclage35, plusieurs signaux témoignent, ces dernières années, d’une croissance des capacités de recyclage des métaux stratégiques en France. D’abord, les producteurs français de cuivre et d’aluminium ont accru leurs capacités de recyclage en anticipation des besoins industriels. En 2024, le groupe Nexans a annoncé un investissement de 90 millions d’euros pour implanter une unité de production de fil de cuivre 100 % recyclé sur sa fonderie de Lens (62) à l’horizon 2026. Cette nouvelle unité permettra de recycler jusqu’à 80 000 tonnes de cuivre usagé par an. La même année, le groupe Constellium a inauguré deux fours supplémentaires de seconde fusion d’aluminium à Neuf-Brisach (68), augmentant la capacité du site de 75 %. Plus récemment, Aluminium Dunkerque, premier fabricant d’aluminium primaire en France, a inauguré en mai 2025 son premier four de recyclage, capable de recycler 7 000 tonnes d’aluminium « fin de vie » par an.
Outre ces métaux de base, la France accueille, depuis 2017, la première usine de recyclage de titane d’Europe, EcoTitanium, rattachée à la société Aubert & Duval. Implantée sur le site de production primaire de lingots et billettes de titane de Saint-Georges-de-Mons (63)36, l’usine EcoTitanium élabore des alliages et lingots de titane de qualité aéronautique à partir de chutes et copeaux de titane. Une partie significative de ces déchets, issus de chutes internes ou collectés auprès d’industriels comme Airbus et Safran (actionnaires d’Aubert & Duval depuis 2023), étaient jusqu’alors exportés, notamment vers les États-Unis.
De nouvelles filières se structurent enfin par le jeu de nouveaux acteurs industriels (voir figure 3.4). Certains sont positionnés sur le recyclage d’aimants permanents (Carester, MagREEsource), d’autres sur les déchets d’équipements électriques et électroniques (Sanou Koura, WEEECycling), d’autres encore sur le recyclage des batteries électriques (Mecaware, Battri). À eux seuls, les projets industriels de Carester et de MagREEsource devraient à couvrir 100 % de la demande nationale en terres rares lourdes à l’horizon 2030 (Gouvernement, 2025). L’ensemble de ces nouveaux entrants, issus de la recherche et soutenus par l’État (voir encadré), mettent en avant des procédés innovants, notamment des technologies d’affinage, afin de mieux valoriser les gisements de déchets et de produire des métaux de haute pureté37. Erick Petit (MagREEsource) témoigne par exemple : « Nous avons réussi à mettre au point une technologie qui permet de ne pas contaminer l’alliage à base de terres rares pendant son process. Cela nous permet de garantir les propriétés d’origine. Nous sommes capables de faire des aimants 100 % à partir de matière recyclée. » Serge Kimbel (WEEECycling) indique, de son côté : « Sur des métaux tels que les platinoïdes, le cuivre et l’argent avec des concentrations de 99,99 %, nous sommes les seuls aujourd’hui en France. Nous travaillons aussi sur le gallium ou germanium. [Pour ces deux métaux], nous ne sommes pas encore au niveau de l’affinage, mais nous arrivons à les préconcentrer. »
Ces nouveaux entrants insistent également sur le faible impact environnemental de leurs procédés. Damien Letort (ROSI Solar) souligne : « Contrairement au raffinage conventionnel qui utilise des acides, notre procédé a recours à de la chimie douce pour séparer les métaux entre eux. Au total, notre technologie de recyclage permet une réduction de 55 % des émissions de CO₂ par rapport à une production primaire de chacun des métaux contenus dans les panneaux solaires. » Arnaud Villers d’Arbouet (Mecaware) indique pour sa part : « Notre procédé affiche une empreinte carbone à peu près divisée par deux par rapport à l’hydrométallurgie du recyclage. Nous ne travaillons pas par voie hydrométallurgique conventionnelle ; notre procédé ne produit pas de sulfate, mais du carbonate. »
Une dépendance intrinsèque au marché primaire
Nos observations invitent toutefois à nuancer la promesse de sécurisation des approvisionnements offerte par le recyclage. D’une part, elle dépend directement de la capacité qu’ont à leur tour les industriels du recyclage à sécuriser leur approvisionnement en déchets. Or, la libre circulation des déchets, dont l’excédent commercial français est le reflet, expose les recycleurs français au risque de fuite vers leurs homologues étrangers (chinois, turcs, etc.). L’Ademe (2023a) souligne, à ce titre, que les déchets métalliques les plus purs font généralement l’objet d’un consentement à payer plus important des clients étrangers, notamment asiatiques, un constat confirmé par plusieurs recycleurs rencontrés.
Dans ce contexte, les entreprises de recyclage misent notamment sur la contractualisation et la diversification des sources d’approvisionnement. « Nous sommes autant en contact avec des éco-organismes, avec lesquels nous avons des partenariats de long terme, qu’avec des industriels pour nous assurer de la livraison de leurs déchets et de leurs rebuts de production », garantit ainsi Serge Kimbel (WEEECycling). De son côté, Didier Pitot (Lebronze alloys) indique : « On achète nos matières soit à des recycleurs, qui s’occupent de trier les chutes de production, soit à des négociants en contact avec les fonderies. »
Ensuite, si le recyclage des métaux promet d’émanciper les entreprises industrielles de leur chaîne d’approvisionnement primaire, l’industrie du recyclage reste, en amont, tributaire de la maturité du marché primaire. Le cas des batteries électriques, dont le marché n’est pas encore parvenu à maturité, illustre concrètement cette limite intrinsèque du recyclage. « Aujourd’hui les batteries en fin de vie datent d’il y a dix ans. Or, il y a dix ans, on ne vendait pas beaucoup de véhicules électriques, souligne Olivier Dubourdieu (Mines Paris – PSL). De plus, à mesure que vous améliorez vos technologies de batteries, vous rallongez également leur durée de vie. Cela repousse d’autant plus leur recyclage. » Décidée en octobre 2024, la suspension du projet de recyclage de batteries, ReLieVe, du groupe Eramet s’inscrit dans ce contexte. « D’après nos estimations, on aurait construit l’usine à plusieurs centaines de millions d’euros, pour qu’elle ne fonctionne qu’à moins de 20 % de ses capacités, explique Ludovic Donati (Eramet). Les seuls intrants auraient été globalement les batteries des Zoé du début des années 2010. Ce n’est pas encore assez. » Faute de volumes suffisants, Arnaud Villers d’Arbouet (Mecaware) admet ainsi que le recyclage ne saurait couvrir la totalité des besoins de la filière à court et à moyen terme : « Dans un premier temps, on ne pourra pas répondre à 100 % aux besoins de métaux. S’il y a 10 % de rebuts de production dans une production de gigafactory, nous ne pourrons fournir que 10 % au maximum. Le fabricant de matières actives ne pourra pas s’affranchir de matières premières vierges. Dans dix ou quinze ans, peut-être que nous fournirons entre 30 % et 50 % du besoin matière, lorsqu’on aura des batteries en fin de vie en quantité suffisante. » Une étude de Transport & Environnement (2024) indique qu’en 2035, le recyclage des batteries en Europe devrait permettre de fournir assez de lithium pour fabriquer 2,4 millions de véhicules électriques, soit 15 % seulement de la demande européenne. Comme le souligne Stéphane Bourg (Ofremi), « sur les métaux de batterie, [on assiste à] une hausse de la demande de 15 % par an, soit un doublement du marché tous les cinq ans. Vous pouvez recycler tout ce que vous pouvez, et vous devez le faire, mais cette croissance ne repose que sur l’activité minière ».
Figure 3.4 – Nouveaux entrants français du recyclage des métaux stratégiques
Réalisation : La Fabrique d’après Trendeo, presse et lauréats France 2030.
Le projet de production de terres rares de Carester souligne également cette complémentarité entre matières primaires et secondaires. Pour produire des terres rares lourdes sur son usine Caremag, l’entreprise s’approvisionnera à la fois en matières secondaires (2 000 tonnes d’aimants à recycler et de résidus de production à l’horizon 2030) et en matières primaires (5 000 tonnes de concentrés lourds). Frédéric Carencotte (Carester) indique ainsi : « Je n’oppose pas le recyclage au minier : les deux sont nécessaires. » S’agissant de son approvisionnement en concentrés, il promet un sourcing indépendant de la Chine : « Nous suivons onze projets miniers dans le monde avec lesquels nous avons soit des lettres d’intention soit déjà des contrats. Géographiquement, ils sont situés en Asie, en Amérique du Sud et du Nord, et on doit en avoir deux en Europe. Mais je n’ai aucun approvisionnement qui dépend de la Chine. »
L’État en soutien à l’industrialisation du recyclage : retours du terrain
Les lauréats de France 2030 démarrage industriel Bpifrance était le seul soutien externe que j’ai pu avoir au démarrage de mes activités, pour le financement de l’innovation, Par la prise de position de Bpifrance, les banques de territoires ont pu également nous apporter leur soutien et nous permettre d’investir. Mon projet contient deux soutiens forts : l’un de l’État français, l’autre de l’État japonais. Le second s’est matérialisé en 2025 ; celui de l’État français a démarré en 2020. J’ai réussi à monter le projet grâce aux subventions dès 2020. Le financement est un point délicat pour les start-up industrielles. Pour les investisseurs et les financeurs, il faut accepter qu’il y ait besoin de beaucoup d’argent, que le projet sera mis en place sur du temps long avec des aléas conséquents. Mecaware est une start-up industrielle deeptech. Nous avons besoin de nous financer par des augmentations de capitaux auprès d’investisseurs de qualité adaptée.
Les acteurs du recyclage ont également souligné l’importance du soutien public pour accélérer la montée à l’échelle industrielle. Serge Kimbel (WEEECycling) souligne ainsi : « On investit un peu plus de 80 millions d’euros dans l’extension de nos capacités de production. C’est un projet qui s’inscrit dans une démarche nationale avec le plan France 2030 dont nous sommes lauréats. Ce plan nous a permis d’être plus ambitieux et d’anticiper de nouvelles productions. » Damien Letort (ROSI Solar) abonde : « Nous sommes soutenus par les acteurs publics (Commission européenne, État, collectivités locales), mais nous aimerions l’être davantage pour aller plus vite dans l’industrialisation de notre procédé. »
Enfin, au-delà de la disponibilité des intrants, le marché primaire influe étroitement sur le modèle d’affaires et l’équilibre économique du recyclage. Ainsi, le coût d’opportunité du recyclage des batteries dépend du prix des métaux primaires qui les composent. Comme le souligne Camilla Vachet (Verkor), « le processus de recyclage implique beaucoup de coûts de transformation pour retransformer les métaux en grade batterie38. Ces frais de transformation associés au processus de recyclage ne valent le coût que si les métaux en question sont assez valorisés. C’est pourquoi le recyclage du LFP est peu compétitif aujourd’hui ». Olivier Dubourdieu (Mines Paris – PSL) précise ce propos : « Si vous faites entrer du LFP, vous revendez une blackmass dont la valeur n’est pas très élevée ; si vous mettez du NMC, votre blackmass aura beaucoup plus de valeur. Le recycleur va préférer travailler avec du NMC, car il récupère à la fin beaucoup plus sur du NMC que sur du LFP pour une différence minime en termes d’extraction physique et chimique. » Le témoignage d’Arnaud Villers d’Arbouet (Mecaware) achève d’illustrer cette dépendance du recyclage au marché primaire : « La facilité de financement fluctue. Lorsque l’industrie de la batterie est florissante, comme il y a deux ou trois ans, vous trouvez des financements relativement facilement. Quelques années plus tard, le cours des métaux chute, Northvolt ferme, et cela devient plus difficile. »
Avant le recyclage, la structuration de filières de collecte et de traitement des déchets
Le développement des activités industrielles de recyclage de métaux nécessite, en amont, la structuration de réseaux de collecte et de traitement des matières. À l’échelle nationale, ces réseaux reposent notamment sur les filières « à responsabilité élargie du producteur » (REP).
En développement depuis les années 1990, les filières REP ont vocation à impliquer les entreprises industrielles et de la construction dans la gestion de leurs déchets et la réintégration de ces derniers dans l’économie circulaire (Granier et al., 2025). Dans le cadre des filières REP, les entreprises versent une écocontribution aux éco-organismes de chaque filière, structures intermédiaires qui se chargent du développement opérationnel de la collecte de déchets et de la sensibilisation des acteurs.
Le recyclage des métaux stratégiques (cuivre, aluminium, terres rares, platinoïdes, etc.) repose notamment sur la filière des équipements électriques et électroniques (EEE), filière REP depuis 2005 et composée de trois éco-organismes agréés par l’État, Ecologic, Ecosystem et Soren. Comme l’indique Erick Petit (MagREEsource, positionné sur le recyclage des terres rares) : « La France est le premier exportateur de déchets en Europe. Pourtant, nous avons une chance : l’écosystème existe et fonctionne relativement bien, avec des filières de collecte existantes. Nous devons communiquer vers les autres membres de la filière pour leur faire comprendre l’importance des déchets et trouver des modèles permettant de massifier les flux. » Depuis août 2025, les batteries des véhicules électriques font également l’objet d’une filière REP en France dans le cadre du règlement européen sur les batteries qui est rentré en application en février 2024. Le règlement prévoit que le taux de rendement du recyclage des batteries au lithium atteigne 70 % du poids moyen à fin 2030.
De la mine au raffinage, la lente relocalisation de la chaîne primaire
En France, un inventaire minier en cours de consolidation
Pour sécuriser les approvisionnements des entreprises industrielles en métaux stratégiques, l’Union européenne ambitionne enfin de développer, en son sein, une offre primaire alternative à l’offre extra- européenne. Comme le recyclage, ce levier a vocation à émanciper les entreprises européennes des incertitudes qui pèsent sur les chaînes de valeur mondiales, comme des risques géopolitiques et la mise en place de barrières commerciales. À l’horizon 2030, les capacités européennes d’extraction et de transformation de métaux devront couvrir respectivement 10 % et 40 % de la demande européenne en métaux stratégiques d’après le CRM Act.
Les inventaires des États membres attestent d’ores et déjà de la présence de nombreux minerais stratégiques sur le sous-sol européen, comme le cobalt, le lithium, le graphite naturel et le tungstène (figure 3.5). En France métropolitaine, plusieurs ressources minières, aujourd’hui jugées stratégiques, avaient été identifiées dans le sous-sol lors de l’inventaire minier non exhaustif réalisé entre 1975 et 1992 : le lithium, le cuivre, le titane, le tungstène et le germanium (Gourcerol et al., 2021). À l’inverse, le cobalt et le gallium seraient présents sous forme d’indices seulement39. Comme l’indique Blandine Gourcerol (BRGM), « le premier inventaire minier a mis en évidence un certain nombre de zones cibles. Nous ne partons pas de rien ».
Figure 3.5 – Gisements connus de ressources minérales stratégiques en Union européenne
(*) La mention de la France a été rajoutée manuellement en croisant les informations de l’article
avec une étude réalisée par le BRGM sur la base de l’inventaire de Gourcerol et al. (2021).
Sources : Lewicka et al. (2021). Les gisements ne sont pas mentionnés pour les autres
matières stratégiques.
La France métropolitaine compte notamment des ressources importantes de lithium (Gloaguen et al., 2018). Le potentiel est connu de longue date sur le site de Beauvoir, premier gisement national de lithium situé dans l’Allier. Comme le rappelle Vincent Gouley (directeur de la communication des projets Lithium d’Imerys40), « le site de Beauvoir a par le passé appartenu au BRGM, qui avait identifié la présence de lithium après un sondage profond de 800-900 mètres dans les années 1960. Le granite de Beauvoir contient 1 % de lithium en moyenne, ce qui en fait un gisement de classe mondiale. Cela peut paraître peu, mais en réalité c’est beaucoup pour des gisements de roches dures, dont la concentration habituelle se situe plutôt entre 0,5 % et 0,7 %, voire moins parfois ». À ces gisements rocheux s’ajoutent des gisements géothermiques riches en lithium, situés en Alsace. « On peut trouver du lithium dans différents milieux : on en trouve en Argentine dans des salars, en Australie dans des roches, en France dans de l’eau géothermale », indique Fabien Perdu (CEA-Liten). L’ensemble de ce potentiel national fait actuellement l’objet d’études d’exploration minière. Après une décennie 2000 sans octroi de permis exclusif de recherche (PER), la prospection minière sur le territoire métropolitain a repris au début des années 2010 (Le Berre et Chailleux, 2021). À ce jour, la recherche de lithium représente à elle seule 72 % de la surface couverte par les permis de recherche actifs sur le territoire métropolitain (voir figure 3.6). En juillet 2025, le groupe Imerys a indiqué, à la suite de campagnes de forage et d’études géologiques, que les ressources du gisement de lithium de Beauvoir seraient trois fois plus importantes qu’initialement estimées.
Figure 3.6 – Entreprises détentrices ou demandeuses de permis exclusifs de recherche actifs en France métropolitaine
(*) Électricité de Strasbourg est le partenaire du groupe Eramet dans le projet Ageli.
Source : Cadastre minier (Camino), périmètre minerais et métaux hors sels. Liste exhaustive au 1er septembre 2025. Traitements La Fabrique de l’industrie.
Note : Le permis exclusif de recherche plurimétaux (lithium, tungstène, étain, etc.) d’Imerys dans l’Allier a pris fin en mars 2025 ; le groupe a déposé une demande de concession d’exploitation minière en février 2025, dont l’instruction est en cours.
Dans ce contexte de reconquête minière, la Commission européenne, par le biais du CRM Act adopté en 2024, enjoint les États membres à consolider leur inventaire minier sur le périmètre des métaux critiques. En France, le chantier a été initié plus tôt encore, en octobre 2023, comme recommandé par le rapport Varin. Financé à hauteur de 53 M€ dans le cadre de France 2030, ce programme est piloté par le BRGM, pour cinq ans. « La France est en avance de phase, avec un budget assez important dédié à son inventaire, comparé à d’autres pays en Europe, indique Blandine Gourcerol (BRGM). Le projet d’inventaire minier a démarré au second semestre 2024, avec la mise en place d’une filière au sein du BRGM pour permettre le déploiement de géologues. L’État a remis au goût du jour l’exploration stratégique. Nous travaillons avec des groupes privés sur l’identification de zones favorables. » En juillet 2024, le BRGM et l’entreprise minière Lithium de France ont par exemple formalisé un partenariat scientifique et industriel pour améliorer ensemble la connaissance du sous-sol alsacien.
Vers une filière nationale de production de lithium
Sur la base de ce potentiel minier, la France est en passe d’accueillir une filière de production de lithium pour satisfaire les besoins croissants de la filière des batteries électriques (figure 3.7). Trois sites intégrés d’extraction et de raffinage de lithium sont actuellement en projet, avec un démarrage d’activité prévu à l’horizon 2030 : un dans l’Allier à partir du gisement de granite de Beauvoir, porté par le groupe Imerys, et deux en Alsace reposant sur l’extraction de lithium géothermal, portés respectivement par Eramet (en partenariat avec Électricité de France) et Lithium de France. D’ici là, la France accueillera également ses premiers sites de raffinage de lithium à Lauterbourg (67), au Havre (76) et à Coudekerque-Branche (59). D’autres projets sont à l’étude, aussi bien concernant l’extraction de lithium (projet du groupe australien Vulcan, détenteur d’un permis exclusif de recherche depuis juillet 2024) que le raffinage de lithium de qualité batterie (porté par le groupe américain Ensorcia, qui a indiqué en 2023 que la France était pressentie pour accueillir son investissement industriel prévu en Europe). Ainsi, 40 % du lithium nécessaire pour les usines françaises de fabrication de batteries électriques pourra être produit en France à l’horizon 2030 d’après les estimations de l’État (Gouvernement, 2025).
Figure 3.7 – Entreprises porteuses de projets d’extraction et de raffinage de lithium en France
Réalisation : La Fabrique de l’industrie à partir de sources diverses (Trendeo, presse, sites des
groupes).
Comme les acteurs du recyclage, les porteurs de projets miniers installés en France mettent en avant la souveraineté et la décarbonation de notre économie dans leur promesse de valeur. « En matière d’indépendance, il est important d’avoir ce type de gisements en Europe », souligne Ludovic Donati (Eramet) au sujet des gisements de lithium géothermal. Romain Millot (directeur scientifique de Lithium de France) abonde en indiquant que la production de chaleur et de lithium géothermal permet à la fois de fournir une énergie décarbonée consommée localement et de produire du lithium de qualité batterie en France, métal critique pour la transition énergétique. « Sur le bilan carbone, on peut avoir une différence significative entre du lithium produit par géothermie en Europe et du lithium extrait de mines traditionnelles en Australie, transformé en Chine et expédié en Europe ; sans prendre en compte la production d’une énergie renouvelable », souligne-t-il.
Cette filière en structuration suscite d’ores et déjà l’intérêt de l’industrie automobile. « Nous sommes très intéressés par toutes les initiatives des industriels pour proposer une alternative européenne », affirme Gildas Bureau (Stellantis, Plateforme française automobile). Vincent Gouley (Imerys) perçoit cet intérêt : « On sent une réelle volonté d’aller de l’avant à travers les discussions menées par notre équipe commerciale. Nous n’avons pas eu de mal à initier des contacts avec toute la filière de l’automobile. » Dans une démarche d’intégration verticale, le groupe Stellantis est d’ailleurs rentré au capital de Vulcan en 2022 (voir figure 2.4), et le groupe Renault est rentré au capital d’Arverne Group, la maison-mère de Lithium de France, en 2023.
Outre la dynamique nationale sur le lithium, le groupe belge Solvay a pour ambition de relocaliser une activité de raffinage de terres rares sur son site historique de La Rochelle. En mai 2024, le groupe a annoncé un investissement de 100 M€ pour relancer une activité de production d’oxydes de terres rares (notamment le néodyme et le praséodyme) entrant dans la composition des aimants permanents pour le secteur automobile et la production d’éoliennes. Une ligne de production a été inaugurée en avril 2025. Le site a pour ambition de couvrir 20 % de la demande européenne en 2030.
Sur le terrain, une relocalisation lente et difficile
La relocalisation minière n’en reste pas moins un défi majeur sur le terrain. Dès l’étape de la prospection minière, les porteurs de projets doivent composer avec une grande complexité administrative ainsi que de forts enjeux d’acceptabilité locale (Le Berre et Chailleux, 2021). En France, l’octroi d’un permis exclusif de recherche (PER) peut ainsi prendre entre seize et dix-huit mois, voire jusqu’à plus de deux ans, contre six à sept mois en Allemagne (ministère de l’Économie, 2024). Cette lenteur administrative tient, d’une part, à la diversité des parties prenantes impliquées (ministères, services déconcentrés de l’État comme les préfectures et les Dreal, collectivités territoriales et grand public), d’autre part, à la nécessité pour le porteur de projet de fournir en amont de solides garanties financières et environnementales. Entre 2018 et 2019, les fortes contestations locales ont conduit la société Variscan Mines à abandonner ses permis de recherche de métaux divers (or, argent et cuivre notamment) en Bretagne (trois permis) et en Pays de la Loire (trois permis). Son septième et dernier permis de recherche en Occitanie a également été annulé dans la foulée par l’État, faute d’évaluation des incidences du projet. « Le Code minier et le Code de l’environnement sont protecteurs d’un point de vue environnemental, confirme Blandine Gourcerol (BRGM). Lors de la pose d’un permis exclusif de recherche, l’État demande aux opérateurs d’avoir un plan très développé sur plusieurs années en vue de la remise en état du site sur lequel ils travailleraient et d’engager une somme garantie pour couvrir ce qui serait fait ou réalisé au cours de ces PER. » Cette exigence de prévention des risques miniers a été récemment réaffirmée dans le cadre de la réforme du Code minier. Initiée par la loi Climat et résilience d’août 2021, cette réforme systématise désormais la réalisation d’une analyse environnementale, économique et sociale dès la demande d’un PER : « Si l’on veut remettre en place une industrie minière en France, il faut montrer patte blanche et étant plus proactif sur les sujets liés à l’environnement et aux relations sociales », poursuit Blandine Gourcerol.
En plein développement, la filière française du lithium éprouve actuellement ces mêmes défis. Comme en témoigne Romain Millot (Lithium de France), « en France, l’État octroie des permis exclusifs de recherche permettant aux opérateurs détenteurs de faire des campagnes d’exploration du sous-sol. Cinq ans après avoir déposé notre demande aux ministères, nous débutons nos premiers travaux de forages exploratoires à Schwabwiller, commune de Betschdorf en Alsace du Nord. Les autorisations ont été obtenues à la suite de plus d’un an et demi d’instruction du dossier de demande d’autorisation environnementale. Tout au long de ce chemin, un aspect majeur de ce type de projet est le dialogue avec le territoire, dès la conception ».
En outre, l’ensemble des projets susmentionnés de recherche et d’exploitation de lithium dans l’Allier et en Alsace font l’objet de craintes de la part d’associations environnementales et de riverains. « Beaucoup de gens comprennent l’intérêt d’ouvrir des mines en Europe, mais personne ne les veut à côté de chez soi », constate Ludovic Donati (Eramet). La population locale a une certaine appréhension des activités liées au forage et à la géothermie et une peur de la sismicité. » C’est bien dans ce contexte que Lithium de France a abandonné, en août 2025, un projet de recherche de gisement par forage géothermique à Soufflenheim. Pierre de Lapeyrière (Ensorcia) abonde, s’agissant de l’activité de raffinage : « Parfois, des usines ou stockages de batteries au lithium explosent. Les populations associent le lithium à ce danger et se disent “le raffinage est dangereux”. Mais les produits impliqués dans le raffinage n’explosent pas, notamment les produits finis au lithium. Il y a toute une éducation à faire pour renverser les idées reçues. »
La France et l’Union européenne, dans le cadre de la loi Industrie verte parue en 2023 et du CRM Act paru en 2024, cherchent à accélérer les procédures d’instruction des projets miniers et de raffinage. À cet effet, le CRM Act prévoit une catégorie de projets « stratégiques » qui promet aux porteurs de projets labélisés une simplification et une accélération des procédures d’octroi des autorisations administratives (moins de vingt-sept mois pour les projets d’extraction, quinze mois pour les projets de transformation et de recyclage). Les projets des groupes Imerys (Emili) et Eramet (Ageli) bénéficient de cette labélisation. Ludovic Donati (Eramet) témoigne : « Le CRM Act garantit un point de contact unique au niveau de l’administration pour faire en sorte que les permis, les autorisations, tout ce qui peut aider le projet minier, soient bien réalisés, et que les délais de traitement soient accélérés. Mais il se trouve qu’en même temps, la France, avec la loi Industrie verte, est allée quasiment plus loin que le CRM Act, qui n’était pas encore à l’époque adopté. » Vincent Gouley (Imerys) offre un témoignage plus nuancé : « La simplification administrative n’est pas encore une réalité. Sur un projet comme Emili, nous allons probablement passer par une dizaine d’enquêtes publiques. Or, chaque étape représente un risque supplémentaire sur le calendrier global du projet. Certes, il y a une véritable intention politique, tant au niveau européen que français 41, mais elle ne se traduit pas complètement dans les actes et n’est pas toujours perceptible sur le terrain. » Cette longueur des procédures administratives suggère que l’émergence de nouvelles filières minières autres que le lithium est peu réalisable à court terme en France métropolitaine.
Un défi économique et financier
Outre les difficultés administratives et d’acceptabilité, il faut encore préciser que la compétitivité des projets miniers et de raffinage n’est pas acquise. Les entretiens ont rappelé que le modèle d’affaires de ces projets peut être régulièrement fragilisé par la baisse des prix des métaux et, en amont, l’évolution du marché (accroissement de l’offre, chute de la demande). Comme le souligne Blandine Gourcerol (BRGM) : « Il faut dix à quinze ans entre le moment où on trouve des traces d’un métal et le moment où la mine pourra être exploitée, sans compter que, chaque année, le projet peut être remis en cause pour diverses raisons (prix d’exploitation, réorientation de la stratégie du groupe minier, etc.). » Stéphane Bourg (Ofremi) abonde : « Démarrer une activité minière est risqué. Cela peut être économiquement viable au moment de l’ouverture, mais on ne sait jamais. Il suffit qu’un concurrent trouve de grands gisements à l’étranger ou qu’une nouvelle technologie reposant sur une autre ressource émerge, et l’activité ne sera plus rentable. »
Le débat public autour de la mine de lithium dans l’Allier État en soutien
La Commission nationale du débat public (CNDP) a été saisie par le groupe Imerys et le groupe RTE*, dans le cadre du projet d’exploitation d’une mine de lithium sur le site de Beauvoir dans l’Allier. La saisine de la CNDP constitue une obligation légale pour les projets de grande ampleur, représentant une valeur d’investissement supérieure à 600 M€. Le débat public a duré quatre mois, de mars à juillet 2024, et a réuni plus de 3 600 participants.
Vincent Gouley (Imerys), indique que « le débat public s’est bien passé. Le projet n’a pas été remis en question. En revanche, des sujets importants ont été abordés, en particulier la gestion de l’eau, la gestion des résidus, la gouvernance du projet ». Mathias Bourrissoux (garant à la CNDP), qui a présidé ce débat public, détaille les enjeux qui ont été soulevés : « Le projet d’Imerys comporte trois activités réparties sur des zones géographiques différentes. Forcément, les parties prenantes et la nature du débat public ne sont pas les mêmes. Pour le projet d’extraction de lithium à Échassières, le débat a porté sur les impacts environnementaux et la préservation des écosystèmes locaux. Pour l’activité de chargement des minerais prévue à Saint-Bonnet, le débat a porté sur les impacts visuels, sonores et de pollution, du fait de la proximité de riverains. Pour le projet de raffinage à Montluçon, le débat a porté sur la ressource en eau. La question de la ressource en eau s’est avérée être la problématique la plus prégnante. Le débat a porté sur la disponibilité à venir de la ressource, dans un contexte de réchauffement climatique, et sur les impacts de l’activité de raffinage sur la qualité de l’eau. »
À la suite du débat public, le groupe Imerys a publié, en janvier 2025, une liste d’engagements pour limiter les prélèvements en eau, faire bénéficier le territoire des retombées économiques du projet et réduire la consommation de produits chimiques. Comme l’illustre Vincent Gouley (Imerys), « nous avons été amenés à prendre un certain nombre d’engagements, notamment la non-commercialisation du feldspath, un composant du granite utilisé dans la céramique, dont le traitement aurait requis un usage de produits chimiques plus important sur le site de Beauvoir ». Après le débat public en 2024, l’étape pilote du projet d’Imerys (activités extractives et de transformation à petite échelle) a fait l’objet d’une enquête publique entre février et mars 2025. L’enquête publique des usines de taille industrielle est quant à elle prévue en 2027.
(*) Le groupe RTE est impliqué dans le débat public en tant que maître d’ouvrage des raccordements électriques haute tension des usines de traitement.
En France, la rentabilité des projets d’extraction et de raffinage de lithium doit ainsi s’apprécier dans un contexte de prix bas du lithium. Au London Metal Exchange, le prix à terme de l’hydroxyde de lithium a chuté depuis fin 2022 et stagne autour de 10$ $/kg depuis début 2024, du fait du ralentissement de la demande mondiale (figure 3.8). « Nous sommes convaincus qu’un prix de lithium à 10€ € le kilo n’est pas tenable à long terme, répond Vincent Gouley (Imerys). Quand on regarde la liste des projets miniers, on se rend compte que l’offre mondiale ne sera plus suffisante pour répondre à la demande croissante de lithium à horizon 2030-2035. Nous ne croyons pas vraiment au scénario d’un gisement magique de lithium qui couvrirait toute la demande mondiale, qui plus est à des coûts très bas. » Romain Millot (Lithium de France) partage ce point de vue : « Les projections indiquent qu’entre 2032 et 2035, il y aura une inversion de la courbe entre demande et production mondiale de lithium si de nouveaux projets tel que celui de Lithium de France ne se développent pas. »
L’enjeu de la compétitivité se pose tout particulièrement au regard de la lourdeur des dépenses d’investissement (Capex). Dans l’Allier, le projet du groupe Imerys a été récemment réévalué à 1,8 Md€ (contre 1 Md€ initialement), en lien avec l’inflation et l’intégration de critères environnementaux plus stricts. « Les porteurs de projets d’extraction, une fois qu’ils produisent, peuvent s’assurer d’un certain niveau de rentabilité. Mais ce sont les investissements initiaux qui sont extrêmement importants », indique Ludovic Donati (Eramet). Nous avons besoin que l’État et l’Europe subventionnent une partie des investissements pour combler le déficit de compétitivité : c’est le coût de la souveraineté. C’est là où doivent se croiser les visions industrielles d’investisseurs privés, qui demandent de la rentabilité, et la vision de l’État qui a besoin de sécuriser les approvisionnements en métaux critiques sur le sol français. » Les projets industriels de Viridian Lithium et d’Imerys sont par exemple tous les deux lauréats de l’appel à projets Métaux critiques de France 2030 et bénéficiaires de crédits d’impôt Industrie verte (respectivement de 120 M€ et de 200 M€).
Figure 3.8 – Prix à terme (à quinze mois) de l’hydroxyde de lithium au London Metal Exchange (en $/kg)
Source : TradingView.
La lourdeur des investissements initiaux se couple à d’importantes dépenses d’exploitation (Opex) pour les porteurs de projet, notamment aux étapes de raffinage. Du fait de procédés énergivores (pyrométallurgie, électrométallurgie, etc.), la compétitivité des sites de raffinage de métaux est en effet fortement liée aux coûts de l’énergie, en particulier de l’électricité. Comme l’indique Michel Foucart (McKinsey), « dans l’activité minière, la part de l’énergie est moins importante que la qualité des actifs dans le modèle d’affaires. Si vous disposez d’un gisement avec une teneur suffisamment élevée, vous serez probablement compétitif à l’échelle mondiale. Dans l’activité de raffinage, à l’inverse, le premier facteur est l’énergie ».
Les métallurgistes rencontrés confirment ce propos. « Pour notre usine, l’approvisionnement en électricité est au moins aussi important que l’approvisionnement en alumine », rappelle Guillaume de Goÿs (Aluminium Dunkerque). « La consommation d’électricité du site Nyrstar à Auby est équivalente à celle de Lyon et de sa banlieue », indique Éric Brassart (Nyrstar). « L’électricité est pour nous une ressource primordiale, encore plus que les matières premières », poursuit Jean-Paul Chapuy (Ferroglobe), qui alerte : « Sans électricité compétitive, on ne pourra pas lutter contre nos concurrents. » Au pic de la crise énergétique à la mi-2022, plusieurs sites métallurgiques ont d’ailleurs été contraints de suspendre leur activité (Lolo et al., 2023). Fin 2024, l’AIE indiquait que le prix de l’électricité en Europe était trois fois plus élevé qu’en Chine.
LE SOUTIEN FINANCIER DE L’ÉTAT AUX FILIÈRES DES MÉTAUX CRITIQUES
AU 1ER SEPTEMBRE 2025, l’État soutient financièrement une quarantaine de projets liés aux filières des métaux
critiques (extraction minière, raffinage, recyclage). Cette aide publique s’élève à 1,1 milliard d’euros, soit 20 % de la valeur cumulée des investissements industriels pour ces projets (5,4 milliards d’euros à ce jour). Comme l’indique Nicolas Migeon (Direction générale des entreprises), « on voit, de manière générale, que sans intervention de l’État, il n’y a pas ou peu d’entreprises capables d’investir sur des dépenses risquées, sur les métaux, surtout compte tenu de la concurrence internationale et du poids des subventions reçues par certaines industries dans d’autres pays ». Cette aide publique est répartie en subventions dans le cadre de France 2030 et en crédits d’impôt.
Le plan d’investissement France 2030 est doté de deux appels à projets (AAP) soutenant les filières des métaux critiques. Le premier, intitulé Métaux critiques, est piloté par Bpifrance ; le deuxième, portant sur le recyclage et la réincorporation des matériaux, est piloté par l’Ademe. Ils représentent un budget cumulé de 520 M€ d’aides publiques, dont 55 % ont été distribués jusqu’à présent.
En parallèle, l’État a mis en place, dans le cadre de la loi Industrie verte votée en 2023, un crédit d’impôt au titre des investissements en faveur de l’industrie verte (C3IV) qui soutient quatre filières de la transition écologique : batteries, éoliennes, panneaux photovoltaïques, pompes à chaleur.
Le rôle des prix de l’énergie dans la crise du nickel en Nouvelle-Calédonie
En 2023, la Nouvelle-Calédonie représentait 6 % de l’extraction mondiale de minerais de nickel et 2 % du raffinage de nickel (source : USGS).
Le raffinage de nickel est assuré par trois groupes intégrés, la SLN (filiale du groupe Eramet), KNS et PRNC. Ces groupes employaient 5 035 salariés en 2023, soit 7,5 % des salariés du secteur privé de la Nouvelle-Calédonie (IGF et CGE, 2023).
Les coûts de l’électricité et de la main-d’œuvre pèsent fortement sur la compétitivité de ces industriels (IGF et CGE, 2023). Entre 2023 et 2024, ils ont rendu ces acteurs financièrement vulnérables face à la baisse du prix du nickel (–36 % entre 2022 et 2024 au LME) et à la concurrence immédiate de l’Indonésie, où les dépenses d’énergie sont deux fois plus faibles (ibid.). « Ce qui plombe le coût de production d’alliage de nickel en Nouvelle-Calédonie, c’est le prix de l’énergie, confirme Ludovic Donati (Eramet). À partir des années 2000, on a beaucoup vanté le fait que la majorité de la valeur venait du raffinage, de la transformation. Or, avec les coûts de l’énergie et donc les coûts de production actuels, ce n’est malheureusement plus vraiment le cas. Le modèle calédonien est déficitaire aujourd’hui. » Dans ce contexte, le volume de production métallurgique de nickel a chuté de 49 % en 2024 en Nouvelle-Calédonie d’après les données de l’Isee (équivalent néo-calédonien de l’Insee).
Après la mine et le raffinage, le défi de relocaliser toute la chaîne de valeur
Enfin, la sécurisation des approvisionnements n’est véritablement assurée que si toute la chaîne de valeur, en aval des mines et du raffinage, est également présente en Europe. Comme l’indique Alexandre Damiens (Orano), « ce n’est pas parce que vous avez les gisements miniers chez vous que la résilience est assurée, il faut aussi savoir transformer les minerais en métaux puis en composants ou produits finaux ».
De nouveau, l’industrie des batteries électriques en fournit une illustration parlante. La fabrication de cellules de batteries nécessite deux étapes intermédiaires de transformation des métaux ; d’abord, la synthétisation de précurseurs de cathode (dits pCAM, qui incluent du nickel, du cobalt et du manganèse pour les batteries NMC), puis la fabrication de matériaux actifs de cathode (CAM, qui sont composés de pCAM et de lithium). Or, ces étapes industrielles sont à ce jour absentes en France et peu présentes au sein de l’Union européenne. « Les fabricants de pCAM en Europe se comptent sur les doigts d’une main. Sur le lithium, il y en a quelques-uns, mais sur le nickel, le manganèse et le cobalt, ils ne sont pas au stade industriel en Europe, constate Arnaud Villers d’Arbouet (Mecaware) ; si, dans cette filière, un maillon manque, qu’il s’agisse du recycleur ou du fabricant de précurseurs, votre matériau prendra inévitablement le chemin de l’Asie, et vous garderez un niveau de dépendance stratégique. Nous militons pour que la boucle puisse se fermer en Europe. Une fois que tous les acteurs seront installés en Europe, la matière pourra rester et être travaillée en Europe. » En aval, les fabricants de batteries et de véhicules électriques sont donc actuellement contraints dans leur volonté d’approvisionnement à l’échelle européenne. « Si nous voulons trouver des options d’approvisionnement différentes, ou européennes, celles-ci n’existent pas toujours aujourd’hui, indique Camilla Vachet (Verkor) ; certains de nos composants ne sont pas produits en Europe à ce jour. Certains fournisseurs ont des ambitions de se localiser, mais les projets n’ont pas toujours atteint la maturité nécessaire pour constituer un approvisionnement qualifié et au niveau requis pour répondre aux exigences de qualité et de sécurité des batteries. Nous travaillons donc pour développer cette chaîne de valeur alternative en accompagnant les fournisseurs émergents. » Barbara Forriere (Renault Group) confirme : « On s’approvisionne – ou on va le faire – en partie des batteries européennes, mais elles ne sont pas 100 % européennes puisque tous les composants et matériaux ne viennent pas d’Europe. »
En France, plusieurs entreprises portent actuellement des projets sur les maillons intermédiaires de la chaîne de valeur des batteries électriques à l’horizon 2027 : Sibanye-Stillwater à Sandouville (projet Gallicam de fabrication de pCAM), Axens à Saint-Saulve (fabrication de CAM) et Orano à Dunkerque (fabrication de pCAM et de CAM). La figure 3.9 place ces acteurs sur la chaîne de valeur des batteries électriques. Christophe Petit (Sibanye-Stillwater) revient sur l’arbitrage stratégique réalisé dans l’usine de Sandouville après son rachat auprès d’Eramet en 2022 : « Notre métier historique est de partir du nickel issu de la mine pour enlever toutes les impuretés et le transformer en produit utilisable. C’est le métier d’une raffinerie. Quand on veut faire des précurseurs de cathode (pCAM), c’est un peu le même principe. Le procédé que nous mettons actuellement en place est très proche de celui que nous avions. Nous allons plus en aval de la chaîne de valeur. »
Ces porteurs de projet s’appuient sur des partenaires technologiques pour relocaliser le savoir-faire industriel, mettant en lumière de fortes barrières à l’entrée. Le projet d’Axens est adossé à un partenariat exclusif avec le spécialiste chinois de ce segment, Hunan Changyuan Lico ; celui du groupe Orano est, de la même façon, incarné par la constitution de joint-ventures avec le groupe chinois XTC New Energy42. Comme l’indique Nicolas Migeon (Direction générale des entreprises), « lorsqu’il s’agit d’accueillir des investisseurs asiatiques, nous essayons de favoriser la coopération avec des acteurs européens locaux plutôt que d’être spectateurs d’investissements sans partenaire local et sans transfert technologique ». Le groupe Sibanye-Stillwater est également à la recherche de partenaires : « Pour rentrer dans le monde de la batterie, il faut être un acteur crédible, indique Christophe Petit (Sibanye-Stillwater). Pour cela, il faut montrer que nous savons déjà fabriquer des pCAM. On maîtrise parfaitement la première étape de raffinage, qui consiste à enlever tous les éléments qu’on ne veut pas. Mais il y a encore du travail à faire sur la deuxième étape, la précipitation en pCAM. »
Gildas Bureau (Stellantis, Plateforme française automobile) résume l’état de la chaîne de valeur en ces termes : « La volonté de s’approvisionner en Europe est bien là, mais elle ne donne pas encore ses fruits, car il faut du temps pour que toute la filière parvienne à se relocaliser en Europe. Certains maillons de la chaîne d’approvisionnement (étape de raffinage et recyclage) ne produisent pas encore aujourd’hui ou ne sont pas encore à l’échelle. Or, c’est maintenant que nous avons besoin de métaux critiques. Il y a un retard de disponibilité des matières européennes par rapport aux besoins. »
Toutefois, une telle relocalisation se heurte, là encore, au défi de la compétitivité-prix, notamment face à la concurrence chinoise qui témoigne d’une avance industrielle significative. « En effet, s’approvisionner en batteries européennes est plus cher », ajoute Gildas Bureau. « En Chine, le marché de la batterie se développe depuis dix à vingt ans et ils ont investi énormément tout au long de la chaine de valeur. Ceci se construit sur du long terme. La compétitivité passera par un soutien de la filière et par de la protection », affirme Camilla Vachet (Verkor). Or, ce décalage structurel de compétitivité peut contrarier les arbitrages en faveur de l’approvisionnement européen. « Est-ce que l’industrie est prête à payer plus cher pour ses approvisionnements ? Elle peut faire des efforts de manière volontaire, mais cela reste à l’initiative de quelques industriels ; ce n’est encore pas la norme », constate Nicolas Migeon de la Direction générale des entreprises. « L’Europe ne peut pas obliger l’une de ses industries à acheter en Europe, cher, plutôt qu’ailleurs, pas cher. Nous n’arrivons pas à faire passer la notion de premium, le fait qu’il existerait un premium sur les matières dont la traçabilité est garantie par des standards ESG », poursuit Stéphane Bourg (Ofremi). « Lorsque je demande aux industriels sur quoi sont motivés leurs acheteurs, sur la durabilité du contrat ou sur le prix, quand on creuse un peu, cela reste le prix, constate de son côté Bruno Jacquemin (A3M) ; les directions achats doivent tendre vers une gestion de risque multicritères qui se substitue à une simple gestion de la marge. »
Figure 3.9 – Chaîne de valeur simplifiée des batteries électriques NMC et porteurs de projets situés en France
Réalisation : La Fabrique de l’industrie. Liste non exhaustive d’entreprises d’après presse.
Les entreprises soulignent également la faible propension du marché à valoriser les critères de souveraineté et de décarbonation dans les arbitrages d’achat. « Aujourd’hui, les achats sont souvent principalement déterminés selon une logique de compétitivité (coût, localisation, etc.) », indique Camilla Vachet (Verkor). « Pour les clients finaux, la souveraineté vient en conflit avec la compétitivité à court terme, constate Christophe Petit (Sibanye-Stillwater) ; or, si vous veillez à préserver la souveraineté, il faut être d’accord pour payer plus cher. » « Nos clients voudraient qu’on ait un silicium le plus vert possible sans pour autant payer le prix additionnel, du moins aujourd’hui », indique Jean-Paul Chapuy (Ferroglobe). « On devrait avoir un premium, car on produit un lithium moins carboné que les autres. Mais les utilisateurs finaux ne sont pas prêts à payer plus cher », abonde Pierre de Lapeyrière (Ensorcia). Aux yeux des entreprises rencontrées, ce défi structurel de la compétitivité-prix doit conduire l’Union européenne à coupler le CRM Act à des mesures complémentaires de soutien à l’industrie.
Le CRM Act, et après ?
Le Critical Raw Materials Act a été salué par l’ensemble des entreprises industrielles rencontrées, notamment pour sa rapidité d’adoption et le supplément de visibilité qu’il leur confère. Toutefois, les entreprises jugent également ce règlement insuffisant pour relocaliser les chaînes d’approvisionnement et estiment qu’il doit être complété par d’autres mesures de soutien à l’échelle européenne.
Certaines entreprises rappellent d’abord le besoin d’aide financière pour gagner en compétitivité-prix face à la concurrence extra-européenne. « Le CRM Act va dans le bon sens. Il reste maintenant à financer tout cela. Côté compétitivité, le CRM Act ne garantit rien. Ce qu’il faudrait, c’est un complément financier tel que l’IRA », indique Sophie Personnaz (Valeo, Plateforme française automobile). Camilla Vachet (Verkor) poursuit : « Nous sommes favorables à ce que l’Europe soutienne l’industrie naissante de la batterie pendant les premières années de développement, afin de permettre aux acteurs d’atteindre rapidement une masse critique. » Erick Petit (MagREEsource) constate de son côté : « Les nouvelles filières des métaux critiques comme les aimants sont très soutenues par l’État et la Commission européenne, mais les Chinois et les Américains font encore plus. »
D’autres entreprises jugent nécessaire la mise en place de barrières commerciales sur certaines matières pour se protéger de la concurrence asiatique. En septembre 2025, le groupe Ferroglobe a annoncé la mise à l’arrêt pour trois mois de ses usines de fabrication de silicium en Europe, dont ses usines françaises face à la baisse de la demande et à la surcapacité chinoise. « La sécurisation de la chaîne passe par la préservation des éléments de cette chaîne. Nous exigeons, comme l’acier l’avait obtenu, des mesures de sauvegarde pour le silicium, ferrosilicium et ferromanganèse », indique Jean-Paul Chapuy (Ferroglobe), qui rappelle que le dumping chinois a causé la disparition de l’industrie européenne des panneaux photovoltaïques dans les années 2010 : « Aujourd’hui, il n’y a presque plus de fabrication du polysilicium en Europe : 95 % du polysilicium pour les panneaux photovoltaïques est fabriqué par la Chine, qui a complètement inondé le marché en cassant les prix et tué les industriels occidentaux. » Erick Petit (MagREEsource) indique pour sa part : « Je suis intimement convaincu qu’il faut réguler pour interdire l’export de déchets depuis l’Europe, afin de garder ces ressources secondaires et développer l’économie circulaire, plus rémunératrice pour tous les acteurs. » Christophe Petit (Sibanye-Stillwater) poursuit : « Ce qu’il manque le plus à l’échelle européenne, c’est la gestion des frontières ; la mise en place d’un ban sur l’export de blackmass, la mise en place d’un tarif douanier sur l’entrée de pCAM ou de CAM, mais également sur les véhicules assemblés. À défaut, ce sont des voitures chinoises qui arriveront. »
Enfin, certaines entreprises s’interrogent sur l’opportunité d’instaurer des mesures incitatives ou contraignantes pour favoriser les matières fabriquées dans l’Union européenne (« contenu local »). « Le CRM Act est un vœu pieux, une déclaration d’intention. Que se passe-t-il, en l’absence de mesures concrètes, si on ne respecte pas les exigences ? Ce n’est pas explicité », rappelle Christophe Petit (Sibanye-Stillwater). « Orano appelle à un taux réglementaire européen de matière recyclée incorporée dans les aimants », poursuit Alexandre Damiens (Orano). Adopté en juillet 2023, le règlement européen relatif aux batteries prévoit ainsi d’instaurer des seuils progressifs de contenu recyclé dans les batteries électriques commercialisées sur le marché européen à l’horizon 2031 (voir figure 3.10). Il prévoit également, à partir de 2027, la mise en place d’un passeport numérique fournissant, pour chaque batterie vendue sur le marché européen, une fiche d’identité exhaustive (chiffrage de l’empreinte carbone, origine géographique des composants, etc.). « Le règlement batteries prévoit la mise en œuvre de classes de performance qui permettront de distinguer les empreintes carbone des différentes batteries commercialisées en Europe et, en 2028, d’interdire la mise sur le marché de batteries dont l’empreinte carbone sera au-dessus d’un certain seuil », explique Clémence Liébert (Plateforme française automobile). « C’est clé. On ne peut pas se battre sur les prix. Si on veut développer l’industrie chez nous, il faut avoir d’autres critères comme la décarbonation », souligne Arnaud Villers d’Arbouet (Mecaware).
Figure 3.10 – Taux minimum de contenu recyclé par matière active dans les batteries électriques
Source : Règlement européen du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries.
- 33 — Le SDES est le service statistique rattaché aux ministères chargés de l’environnement, de l’énergie, de la construction, du logement et des transports.
- 34 — Pour comparaison, la demande européenne de cuivre devrait s’élever à 5 millions de tonnes en 2030 (Ademe, 2023a).
- 35 — Le recyclage ne fait pas l’objet d’un code dédié dans la nomenclature d’activités françaises (NAF).
- 36 — Le site de production de lingots et billettes de titane de Saint-Georges-de-Mons (63), baptisé UKAD, a été inauguré en 2011 dans le cadre d’une joint-venture entre Aubert & Duval et le groupe minier et métallurgique kazakh UKTP, qui a apporté son savoir-faire en forgeage du titane. Depuis 2022, le site est rattaché à 100 % à Aubert & Duval, qui a racheté les parts de son partenaire. L’unité de production EcoTitanium compte également le Crédit Agricole et l’Ademe en tant qu’actionnaires.
- 37 — Sur la période 2010-2019, le recyclage de métaux stratégiques a fait l’objet de 183 brevets déposés en France d’après les données de Patstat (Bellit et Charlet, 2023). Ce volume place la France au sixième rang mondial devant le Japon (938 brevets), les États-Unis (661), la Chine (625), l’Allemagne (431) et la Corée du Sud (271).
- 38 — L’innovation des procédés et le recyclage en boucle fermée peuvent toutefois participer à réduire ces coûts de transformation, comme en témoigne Arnaud Villers d’Arbouet (Mecaware) : « Tous les métaux que nous produi- sons sont de qualité “battery grade”. Nous n’avons donc pas besoin de faire un raffinage supplémentaire derrière. Ce n’est pas le cas de tous les recycleurs présents, dont les produits ne peuvent pas directement réintégrer la filière batterie. »
- 39 — Le BRGM définit un indice comme « une minéralisation dont l’existence est connue grâce à des observations de terrain mais dont l’intérêt économique n’est pas encore démontré ».
- 40 — Le projet d’Imerys en France est explicité plus loin dans le texte.
- 41 — Dans le cadre du projet de loi de simplification de la vie économique, le gouvernement a également proposé des mesures promettant de diviser par deux les délais d’instruction des projets exclusifs de recherche et d’exempter les « projets d’intérêt national majeur » de l’obligation de saisine de la CNDP. À la date de la finalisation de cet ouvrage, le projet de loi est encore débattu en commission mixte paritaire.
- 42 — Le groupe chinois détiendra une participation minoritaire sur l’unité de fabrication de pCAM, mais une participation majoritaire sur l’unité de fabrication de CAM.
Conclusion – La succession des tensions commerciales
Cette étude montre que chacun des leviers emporte des contraintes opérationnelles ainsi que des coûts substantiels. La diversification des fournisseurs nécessite d’engager un lourd processus de qualification et peut générer des surcoûts logistiques. L’intégration verticale, aux marges voire nettement au-delà de l’activité cœur de métier, nécessite de surmonter de fortes barrières à l’entrée qui caractérisent tout à la fois les activités d’extraction de minerais et de raffinage des métaux (savoir-faire minier et métallurgique, lourdeur des investissements et des coûts d’exploitation). Enfin, la substitution matière appelle à des compromis sur la performance et sur les coûts, rares étant les métaux substituables à isoperformance.
En ligne avec les ambitions du Critical Raw Materials Act européen, de nombreux projets miniers et industriels émergent à l’échelle européenne pour proposer à terme une alternative partielle à l’offre étrangère. La France en constitue d’ailleurs une véritable vitrine. De nombreux investissements, totalisant 5,4 Md€ sur le périmètre des projets soutenus par l’État au 1er septembre 2025, sont en cours pour développer des capacités de recyclage de métaux stratégiques (terres rares, cuivre, titane, aluminium, etc.) et relocaliser des activités minières et métallurgiques. Répartie notamment entre l’Allier et l’Alsace, une filière française d’extraction et de raffinage de lithium devrait ainsi voir le jour à l’horizon 2030, augurant la relance de l’activité minière en France métropolitaine aujourd’hui cantonnée à de la bauxite non métallurgique.
Pour s’affranchir totalement de dépendances étrangères, il faudrait cependant relocaliser la chaîne de valeur de bout en bout, du raffinage des métaux stratégiques jusqu’à leur assemblage dans les technologies (batteries électriques, éoliennes, etc.). Or, le développement d’une telle offre intégrée, en dépit de ses promesses de souveraineté et de décarbonation, bute sur les freins déjà connus de la réindustrialisation : lourdeur des investissements initiaux, compétitivité fragile face à l’avance industrielle chinoise et contrariée davantage encore par les prix élevés des énergies (gaz et électricité), faible acceptabilité des projets à l’échelle locale… Sans politiques publiques complémentaires, les entreprises industrielles rencontrées restent donc sceptiques sur les chances d’atteindre les ambitions chiffrées du CRM Act. À défaut, le recours à une offre primaire européenne restera réservé aux entreprises les plus sensibles aux promesses de la relocalisation (sécurisation des approvisionnements et réduction de l’empreinte carbone), et dont la latitude financière et le pouvoir de marché permettent d’en assumer les éventuels surcoûts.
Bibliographie
Ademe (2020). Terres rares, énergies renouvelables et stockage d’énergies. Avis technique. 7 octobre 2020.
Ademe (2022). Les matériaux pour la transition énergétique, un sujet critique. Feuilleton. 24 février 2022.
Ademe (2023a). Étude du potentiel d’amélioration du recyclage des métaux en France .
Ademe (2023b). Plan de transition sectoriel de l’industrie de l’aluminium en France .
Agence internationale de l’énergie (2021). The role of critical minerals in clean energy transitions. World Energy Outlook Special Report .
Agence internationale de l’énergie (2025). Global Critical Minerals Outlook 2025 .
Assemblée nationale (2024). Investir dans la France de 2030: Investissements d’avenir. Avis présenté au nom de la Commission des affaires économiques. 16 octobre 2024.
Aubert, A., Zoghely, S. et Le Guennec, X. (2024). « Les minerais dans la transition énergétique ». Direction générale du Trésor, Trésor-Éco n o 351, octobre 2024.
Baffes, J. et Nagle, P. (2022). Commodity Markets : Evolution, Challenges and Policies . Banque mondiale.
Barnier, L. et Cabirol, M. (2024). « Il faut se préparer à des chocs futurs » (Olivier Andriès, directeur général de Safran). La Tribune . Article du 3 juin 2024.
Bellit, S. et Charlet, V. (2023). L’innovation de rupture, terrain de jeu exclusif des start-up ? L’industrie française face aux technologies-clés. Les Notes de La Fabrique. Presses des Mines.
BloombergNEF (2023). Lithium-Ion Battery Pack Prices Hit Record Low of $139/kWh . 26 novembre 2023.
Blot, E. (2024). Sourcing critical raw materials through trade and cooperation frameworks . Institute for European Environmental Policy (IEEP). 4 mars 2024.
Bonnet, T., Grekou, C., Hache. E. et Mignon. V. (2022). Métaux stratégiques : La clairvoyance chinoise. CEPII. La lettre du CEPII n o 428.
Boudinet, L. et Khater, N. (2021). Comment sécuriser nos approvisionnements stratégiques ? Les Docs de La Fabrique. Presses des Mines.
Bucciarelli, P., Hache, E. et Mignon, V. (2024). Evaluating criticality of strategic metals : Are the Herfindahl-Hirschman Index and usual concentration thresholds still relevant ? Document de travail. Energy Economics .
Capliez, R., Grekou, C., Hache, E. et Mignon, V. (2024). Batteries lithium-ion : Cartographie dynamique de la chaîne de valeur et perspectives. CEPII. Policy Brief n o 48.
Christmann, P. et Jégourel, Y. (2020). De la structuration des chaînes de valeur aux mécanismes de formation des prix : Une analyse englobante des marchés des métaux de base. Les Annales des mines . Responsabilité & Environnement, volume 99, n o 3, pp. 6-18.
Commissariat général au développement durable (2023). Les ressources minérales critiques pour les énergies bas-carbone. Chaînes de valeur, risques et politiques publiques.
Conseil général de l’économie (2019). Analyse de la vulnérabilité d’approvisionnement en matières premières des entreprises françaises . Rapport, mars 2019.
Davesne, S. et James, O. (2023). Aubert & Duval en pleine refonte. L’Usine Nouvelle . Article du 30 septembre 2023.
Commission européenne (2020). Résilience des matières premières critiques : la voie à suivre pour un renforcement de la sécurité et de la durabilité. Communication du 3 septembre 2020.
Commission européenne (2023). Un approvisionnement sûr et durable en matières premières critiques à l’appui de la double transition. Communication du 16 mars 2023.
Dera (2022). Securing raw material supply : Benchmarking of measures of foreign manufacturing companies and recommendations for action. German Mineral Resources Agency. DERA Rohstoffinformationen , volume 52.
Desjeux, M. (2025). Approvisionnements en métaux critiques. De la maîtrise à la supériorité. Les Notes de La Fabrique. Presses des Mines.
Dhir, S., Buisson, E. et Kim, T.-Y. (2025). Growing geopolitical tensions underscore the need for stronger action on critical minerals security. Article du 9 février 2025.
Direction générale du Trésor (2019). La Chine en RD Congo : Présence économique, financements et les créances. Article du 20 mars 2019.
Duteuil, E. (2025). Orange coupe le cuivre : un gisement de plusieurs milliards d’euros à portée de main. L’Usine Nouvelle . Article du 28 janvier 2025.
Esposito, O. (2012). Que sont devenues les 40 usines de Pechiney ? La Tribune . Article du 2 juillet 2012.
Faubert, V., Guessé, N. et Le Roux, J. (2024). Capital in the Twenty-First Century : Who Owns the Capital of Firms Producing Critical Raw Materials ? Banque de France. Document de travail n o 952, juillet 2024.
Gloaguen, E., Melleton, J., Lefebvre, G., Tourlière, B., Yart, S. Avec la collaboration de Gourcerol, B. (2018). Ressources métropolitaines en lithium et analyse du potentiel par méthodes de prédictivité . BRGM, décembre 2018.
Gourcerol, B., Gutierrez, T., Pochon, A., Picault, M., Gloaguen, E., Fournier, E. (2021). Évolution Base de données « Gisements France » : Atlas des substances critiques et stratégiques . BRGM, décembre 2021.
Gouvernement (2025). Sécuriser nos approvisionnements en métaux critiques. Dossier de presse, 1 er septembre 2025.
Granier, C., Cathelat, S. Richa, G. et Tessier, J. (2025). Industries circulaires. Esquisse d’une transformation . Les Notes de La Fabrique. Presses des Mines.
Gulley, A., McCullough, E., et Shedd, K. (2019). China’s domestic and foreign influence in the global cobalt supply chain. Resources Policy , volume 62, pp. 317–323.
Hache, E. et Louvet, B. (2023). Métaux, le nouvel or noir. Demain la pénurie ? Éditions du Rocher.
Hasse, J.-B., et Nobletz, C. (2024). Critical Raw Materials Index – CRMI. École d’économie d’Aix-Marseille. Document de travail n o 27.
Hatayama, H. et Tahara, K. (2018) Adopting an objective approach to criticality assessment : Learning from the past. Resources Policy , volume 55, pp. 96-102.
Hebert, A. et McCalla, E. (2021). The role of metal substitutions in the development of Li batteries, part I : Cathodes. Materials Advances . Volume 2, pp. 3474-3518.
IISD (2019). Commerce des matières premières : comprendre les défis fiscaux pour les pays d’origine et d’accueil. Institut international du développement durable , mai 2019.
Inspection générale des Finances (IGF) et Conseil général de l’économie (CGE) (2023). Avenir de la filière du nickel en Nouvelle-Calédonie . Rapport.
Jasper, F. , Späthe, J., Baumann, M., Peters, J., Ruhland, J., Weil, M. (2022). Life cycle assessment (LCA) of a battery home storage system based on primary data. Journal of Cleaner Production . Volume 366, 15 Septembre 2022.
Karkare, P. (2024). Resource nationalism in the age of green industrialisation. European Centre for Development Policy Management. Discussion Paper n o 365.
Le Berre, S. et Chailleux, S. (2021). La relance minière en France et en Europe à l’épreuve des critiques. Revue Gouvernance . Volume 18, n o 2.
Lewicka, E., Guzik, K. et Galos, K. (2021). On the possibilities of critical raw materials production from the EU’s primary sources. Resources, 2021, 10 (50).
Lolo, D., Charlet, V. et Diop, A. (2023). Crise énergétique en Europe et protectionnisme américain. La réindustrialisation compromise ? Les Notes de La Fabrique. Presse des Mines
Maisel, F., Neef, C., Marscheider-Weidemann, F. et Nissen. N. (2023). A forecast on future raw material demand and recycling potential of lithium-ion batteries in electric vehicles. Resources, Conservation and Recycling . Volume 192, May 2023.
Menard, Y. (2022). Le recyclage des métaux en France : Que fait-on aujourd’hui ? BRGM, Géosciences n o 26, juin 2022.
Mertens, J., Dewulf, J., Breyer, C., Belmans, R., Gendron, C., Geoffron, P., Goossens, L., Fischer, C., Du Fornel, E., Hayhoe, K., Hirose, K., Le Cadre-Loret, E., Lester, R., Maigné, F., Maitournam, H., Valadão de Miranda, P., Verwee, P., Sala, O., Webber, M., Debackere, K. (2024). From emissions to resources : Mitigating the critical raw material supply chain vulnerability of renewable energy technologies. Mineral Economics . Volume 37, pp. 669-676.
Meyer, J. et Jeannin, F. (2025). L’approvisionnement en uranium naturel : enjeu de la relance nucléaire. Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS). Rapport, janvier 2025.
Ministère de l’économie (2024). Simplification des procédures minières pour accélérer la transition énergétique et renforcer la sécurité d’approvisionnement française. Communiqué de presse du 12 avril 2024.
Pavel, C., Lacal-Arántegui, R., Marmier, A., Schüler, D., Tzimas, E., Buchert, M., Jenseit, W., Blagoeva, D. (2017). Substitution strategies for reducing the use of rare earths in wind turbines. Resources Policy . Volume 52, Juin 2017, pp. 349-357.
Pinaud, O. (2025). En Auvergne, la renaissance du métallurgiste Aubert & Duval, porté par la souveraineté industrielle. Le Monde . Article du 20 mai 2025.
Rizos, V., Righetti, E., et Kassab, A. (2022). Developing a supply chain for recycled rare earth permanent magnets in the EU : Challenges and opportunities. Centre for European Policy Studies (CEPS), décembre 2022.
SDES (2022). Les échanges commerciaux français de matières premières de recyclage, de 1999 à 2021. Datalab Essentiel. 22 juin 2022.
Trafigura (2017). Démystifier le commerce des matières premières : le négoce et la chaîne d’approvisionnement mondiale expliqués .
United States Geological Survey (2016). Resource Nationalism in Indonesia. Effects of the 2014 Mineral Export Ban . Fiche d’information. 2016-3072.
Annexe 1 – Liste et débouchés métallurgiques des matières premières stratégiques du Critical Raw Materials Act
Annexe 2 – Méthodologie d’entretien et structures interrogées
Cette étude se base sur une campagne de 30 entretiens réalisés entre janvier et juillet 2025. Nous avons échangé avec 19 entreprises et 11 acteurs et observateurs de l’écosystème des métaux critiques. Au total, 33 personnes ont été rencontrées dans le cadre de cette étude. Pour constituer le panel d’entreprises prospectées, nous nous sommes appuyés sur les listes respectives des adhérents de l’A3M et de France Industrie ainsi que sur notre revue de presse.
La campagne a permis d’échanger avec un panel diversifié d’entreprises, à la fois en termes de profils (PME, ETI et grands groupes) et d’activités (extraction, raffinage, recyclage). Le panel couvre également une pluralité de métaux stratégiques (aluminium, cuivre, nickel, lithium, terres rares, silicium métal) et de secteurs de débouchés (automobile, aéronautique et défense, réseaux électriques).
Les informations ont été collectées lors d’entretiens semi-directifs tenus en visioconférence. Compte tenu de la diversité des structures du panel, nous avons fait le choix d’adopter un guide d’entretien spécifique à chaque contact. Pour les entreprises métallurgiques et les donneurs d’ordre en aval des chaînes de valeur, le questionnaire a porté sur les tensions d’approvisionnement et sur les leviers mobilisés de sécurisation des approvisionnements. Pour les porteurs de projets (miniers, industriels ou de recyclage), les entretiens se sont concentrés sur l’état d’avancement du projet et les freins rencontrés. Enfin, pour les acteurs et observateurs de l’écosystème, nous avons formulé des questions plus transverses sur la prise de conscience du sujet à l’échelle nationale et sur les politiques publiques mises en œuvre. L’ensemble des verbatims mobilisés dans cette étude ont été validés par les personnes rencontrées.
Annexe 3 – Évolution du Critical Raw Materials Index
Les chercheurs Jean-Baptiste Hasse (Aix-Marseille Université, Université Catholique de Louvain) et Capucine Nobletz (Banque de France, Institut Louis Bachelier) ont développé un indicateur pondéré de l’évolution hebdomadaire des prix des matières premières critiques. Cet indicateur, construit à partir de données de marché (London Metal Exchange, Shanghai Metals Market, etc.), couvre 29 matières premières nécessaires pour la transition énergétique (véhicules électriques, réseaux électriques, stockage d’énergie, etc).
Parmi elles figurent 14 matières premières jugées stratégiques par la Commission européenne : l’aluminium, le cobalt, le cuivre, le gallium, le germanium, le graphite, le lithium, le manganèse, le nickel, le platine, le silicium métal et 3 terres rares (le dysprosium, le néodyme et le praséodyme).
David Lolo, Jonathan Fellous,
Approvisionnements en métaux critiques.
L’industrie au défi des grandes dépendances ,
La Fabrique de l’industrie, Paris,
Presses des Mines, 2025.
ISBN : 978-2-38542-739-9
ISSN : 2495-1706
© La Fabrique de l’industrie
81, boulevard Saint-Michel 75005 Paris
info@la-fabrique.fr
www.la-fabrique.fr