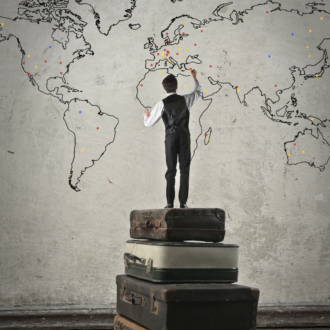Le dialogue social dans l'industrie
Dans toutes les entreprises, un dialogue social constructif favorise à la fois l’existence d’un bon climat social et de hauts niveaux de productivité. Ce n’est pas toujours le cas. D’une part, parce que l’acquisition ou la préservation des droits des salariés passe parfois davantage par le conflit que par le dialogue et la concertation. D’autre part, parce que la recherche de productivité se fait parfois au détriment des conditions de travail des salariés. Le dialogue social représente pourtant un vrai levier de croissance, notamment dans les entreprises industrielles.
Qu’est-ce que le dialogue social ?
Pour l’organisation internationale du travail (OIT) : « le dialogue social inclut tous types de négociation, de consultation ou simplement d’échange d’informations entre les représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs selon des modalités diverses, sur des questions relatives à la politique économique et sociale présentant un intérêt commun. »
Ses objectifs : consolider les pratiques démocratiques et de bonne gouvernance en milieu professionnel, encourager le consensus entre les différents acteurs du monde du travail pour aboutir à un climat social sain, propice à la prospérité économique. Bien qu’il recouvre la négociation des conditions de travail, le dialogue social ne s’y limite pas et permet, en outre, de débattre des politiques économico-sociales au niveau de l’entreprise ou au niveau régional, voire national. Par ailleurs, qu’il se tienne de manière informelle ou institutionnalisée, le dialogue social peut être objet bipartite, entre salariés et employeurs, ou tripartite si l’État intervient dans le processus.
Les acteurs du dialogue social
Le dialogue social, dans l’industrie ou ailleurs, se déroule dans le cadre d’échanges, principalement entre les chefs d’entreprise et les salariés, en vue d’améliorer les conditions de travail et de performance. Ils sont représentés par leurs organisations respectives, organisations d’employeurs et syndicats des travailleurs. En France, on dénombre cinq organisations syndicales (CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, CGT-FO) et trois organisations patronales (MEDEF, CPME, U2P) représentatives au niveau interprofessionnel.
Notre pays accuse néanmoins un retard sur ses voisins européens en ce qui concerne le niveau d’implication des salariés dans les relations sociales. En effet, une étude Dares réalisée en 2018 révèle que 67 % des entreprises sont couvertes par une instance représentative du personnel (IRP) et 37 % par un délégué syndical. Pour autant, un tiers des TPE n’est couvert par aucune IRP et, en 2017, le taux de participation aux élections des représentants du personnel n’a pas dépassé les 63 %.
Par ailleurs, l’État joue un rôle clé dans le bon fonctionnement du dialogue social. Il est en effet le garant de la stabilité politico-sociale qui permet aux travailleurs et aux employeurs d’agir librement, dans le cadre de la loi. En outre, même dans le cas d’un processus bipartite, l’État soutient le dialogue social à travers un cadre juridique et institutionnel adéquat.
Histoire du dialogue social dans l’industrie
La genèse du concept de dialogue social remonte aux accords de Matignon, en 1936. Le 21 juin de cette année, une première loi institue la semaine de 40 heures dans les établissements industriels et commerciaux. Quelques jours après, le 24 juin, une loi modifiant la loi du 25 mars 1919 relative aux conventions collectives est promulguée. Toujours en 1936, le 26 juin précisément, apparaît la loi instituant un congé annuel payé dans l’industrie, le commerce, les professions libérales, les services domestiques et l’agriculture. Enfin, le 31 décembre 1936, une loi relative aux procédures de conciliation et d’arbitrage dans les conflits du travail signe l’apparition d’un cadre légal au dialogue social.
Le dialogue social s’est donc généralisé en France et en Europe. Toutefois, jusque dans les années 1980, il demeurait marginal dans le champ des relations collectives du travail. C’est notamment l’Union européenne qui a mis en avant le dialogue social comme un pilier des réflexions contemporaines sur le devenir de l’industrie.
Les enjeux spécifiques du dialogue social dans l’industrie sont nombreux, surtout dans le contexte de mutation technologique, sociale et économique que nous connaissons et qui modifie en profondeur le rapport au travail. La numérisation et l’évolution rapide des modèles de production impliquent un changement de la nature même du travail. C’est dans ce cadre que la Fabrique de l’industrie, laboratoire d’idées dédié à l’industrie, propose des réflexions autour du dialogue social et de l’industrie 4.0.
Crise du travail : et si l’organisation responsabilisante était la solution ?
Articuler dialogue social et participation directe des salariés pour une meilleure qualité du travail
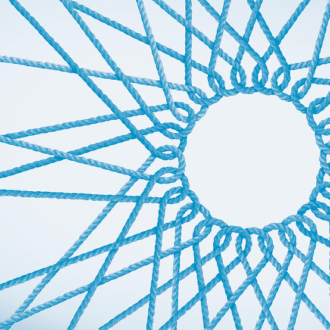
Dialogues social et professionnel : comment les articuler ?

Articuler participation directe et dialogue social en entreprise

GT solutions : la transformation collective d’une ETI

Tirer le meilleur d’une entreprise patrimoniale : le projet Radiall 2025

Travail, emploi et dynamiques territoriales

Travailler à l’heure du numérique : nouveaux métiers, nouvelles compétences, nouvelles régulations

Accords d’entreprise transnationaux : un changement de paradigme