Mondialisation
Les publications “Mondialisation”

Ukraine : un nouveau choc pour l’industrie française
Un bref état des lieux des relations économiques qui unissent la France et la Russie permet d’évaluer les premières conséquences de ce conflit. Du point de vue français, la dépendance à...
Pas de sécurisation des approvisionnements stratégiques sans une meilleure coopération entre l’État et les entreprises
Les pénuries dues à la crise du Covid-19 ont mis en lumière la dépendance de certaines filières industrielles aux intrants étrangers. Ces vulnérabilités sont anciennes mais elles...
Les faux-semblants de la libéralisation chinoise
La Chine cherche aujourd’hui à normaliser son économie et à intégrer pleinement le multilatéralisme mondial. Un cadre compétitif, propice aux...
Territoires et mondialisation : je t’aime, moi non plus
On débat souvent de la mondialisation comme si elle avait ses architectes d’un côté et ses victimes de l’autre. Or sur le terrain, on ne voit que des gens œuvrer, travailler, s’adapter....
Si 8 % des entreprises industrielles pensent relocaliser dans les trois ans, 60 % envisagent créer des emplois en France
La Fabrique révèle aujourd’hui les résultats d’un sondage exclusif réalisé en partenariat avec l’Ifop auprès de dirigeant·e·s d’entreprises sur leurs perceptions et intentions au...
Relocaliser ne suffira pas à réindustrialiser
La réponse gouvernementale à la crise fait la part belle à une reconquête de notre « souveraineté industrielle » via les relocalisations. Aurait-on trouvé là...

Coronavirus : demain sera-t-il différent d’hier ?
Y aura-t-il un avant et après coronavirus comme il devait y avoir un avant et un après Lehman Brothers ? Simple régulation ou aménagement à la marge ou vrai changement ? A chaque crise, la...

Le dérèglement climatique : quelle durée d’incubation ?
La pandémie nous permet de mesurer les coûts d’une action trop tardive. Quelles leçons tirer pour le dérèglement climatique, dont la période d’incubation se compte, non en semaines mais...
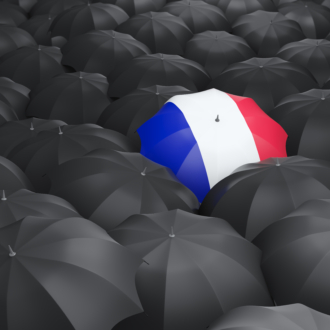
Nos entreprises sont-elles exposées au risque protectionniste ?
La Fabrique de l’industrie publie aujourd’hui sa Note n°29 intitulée

Productivité agrégée : prix des facteurs de production et décision des entreprises
La thèse de Charlotte nous explique comment l’intensification des échanges commerciaux a permis des gains de productivité en France et en Europe.
