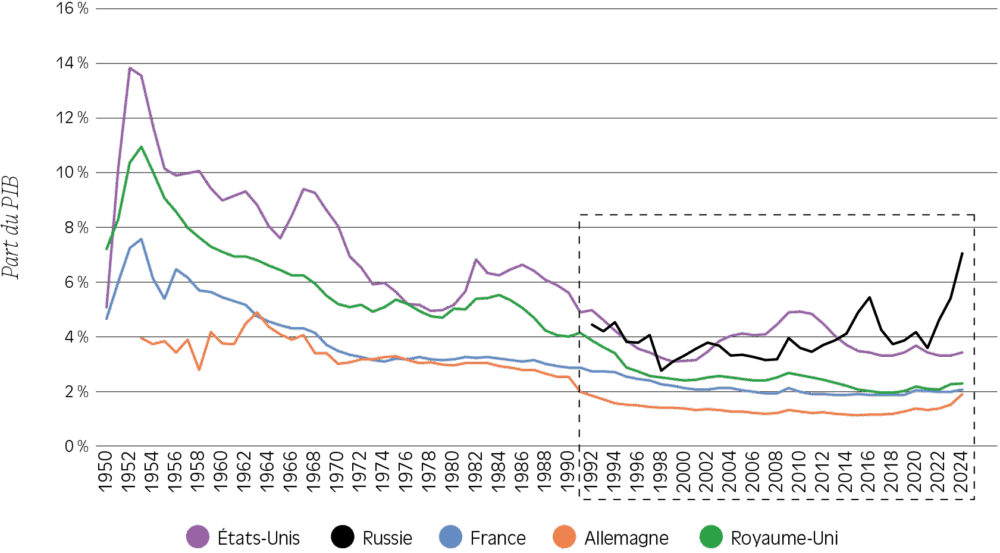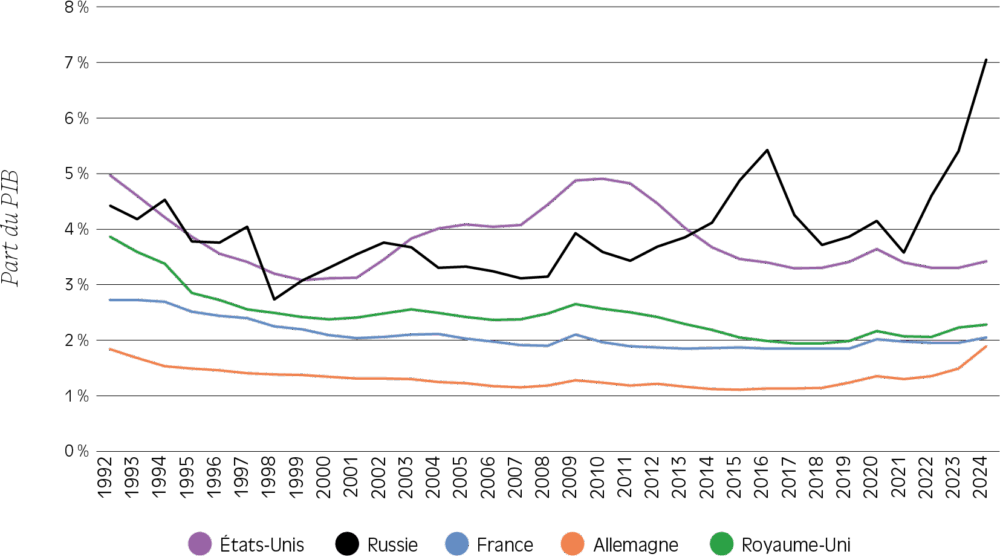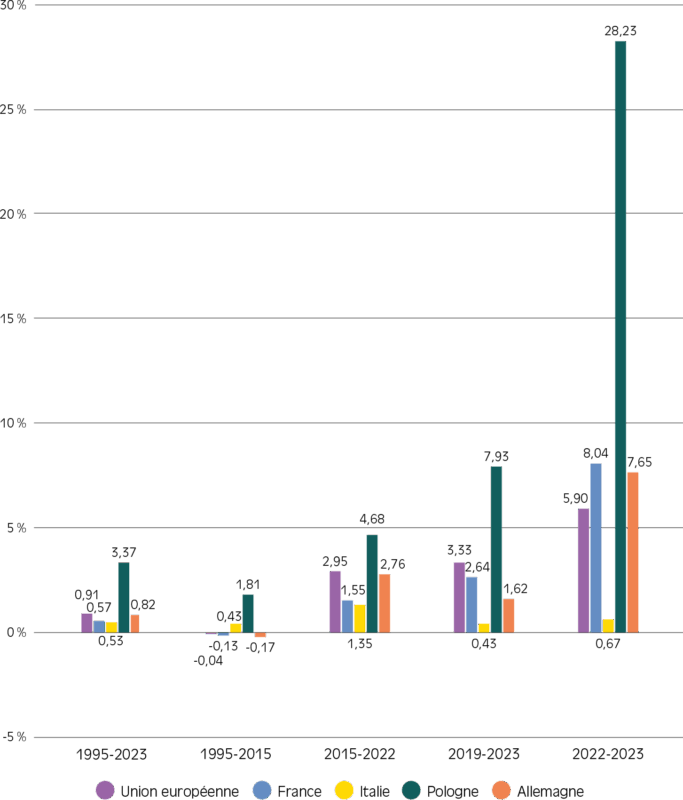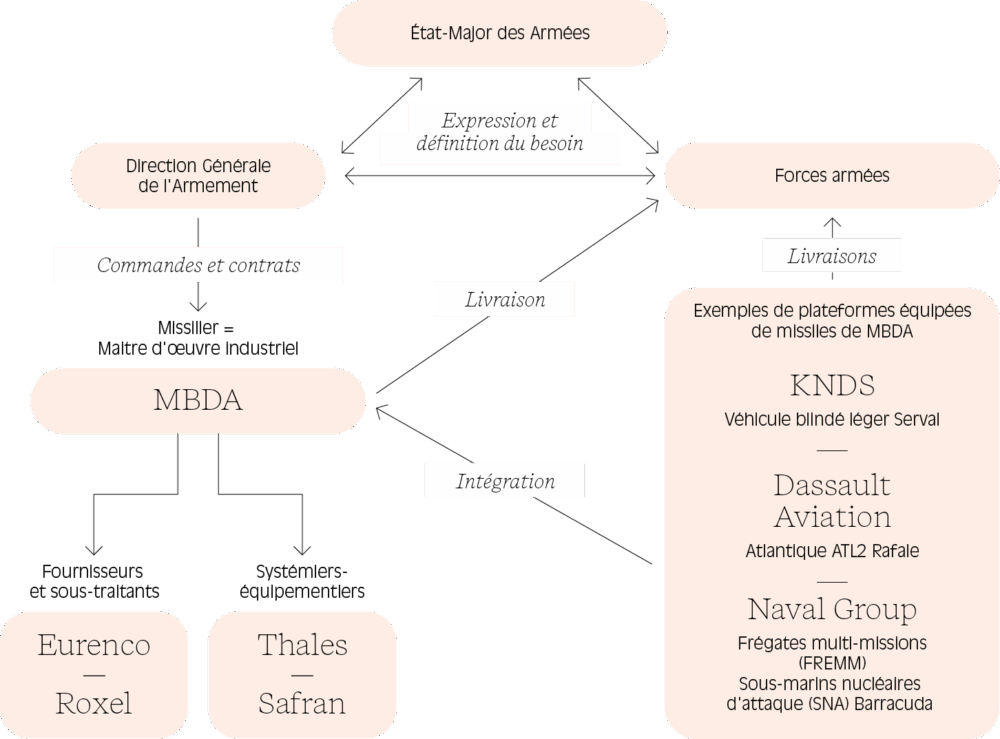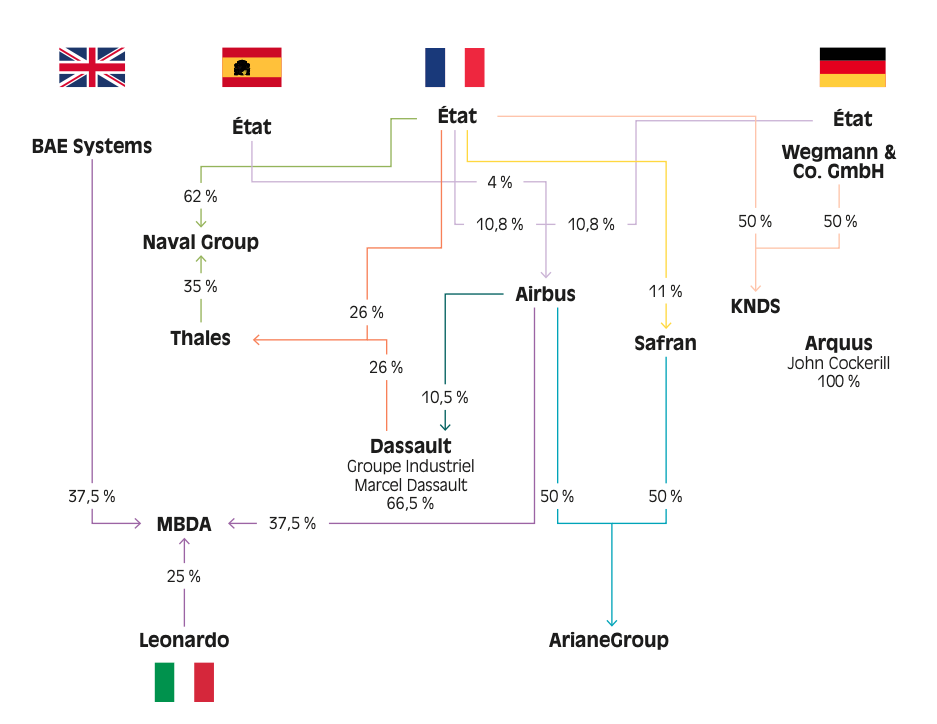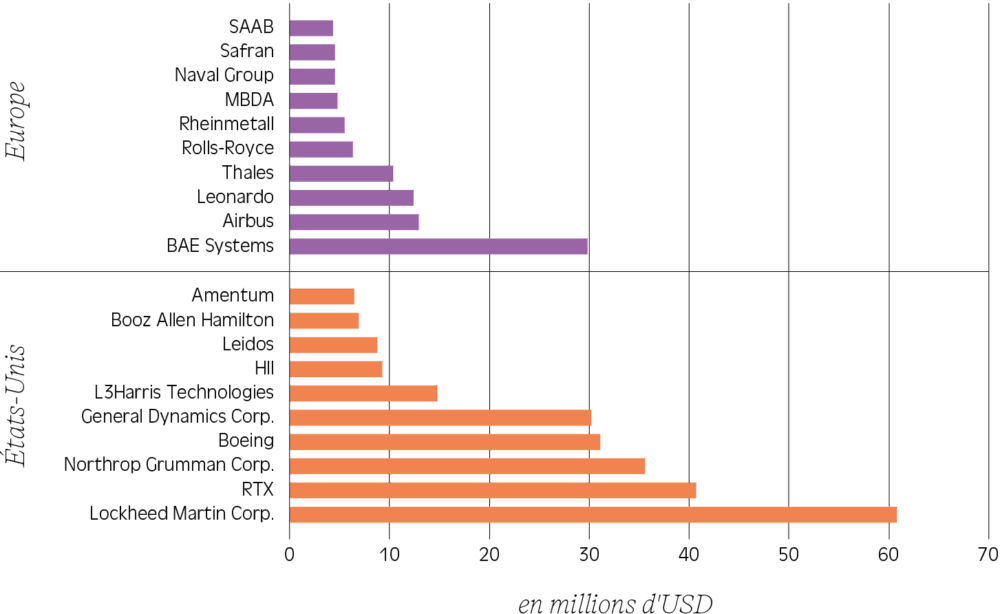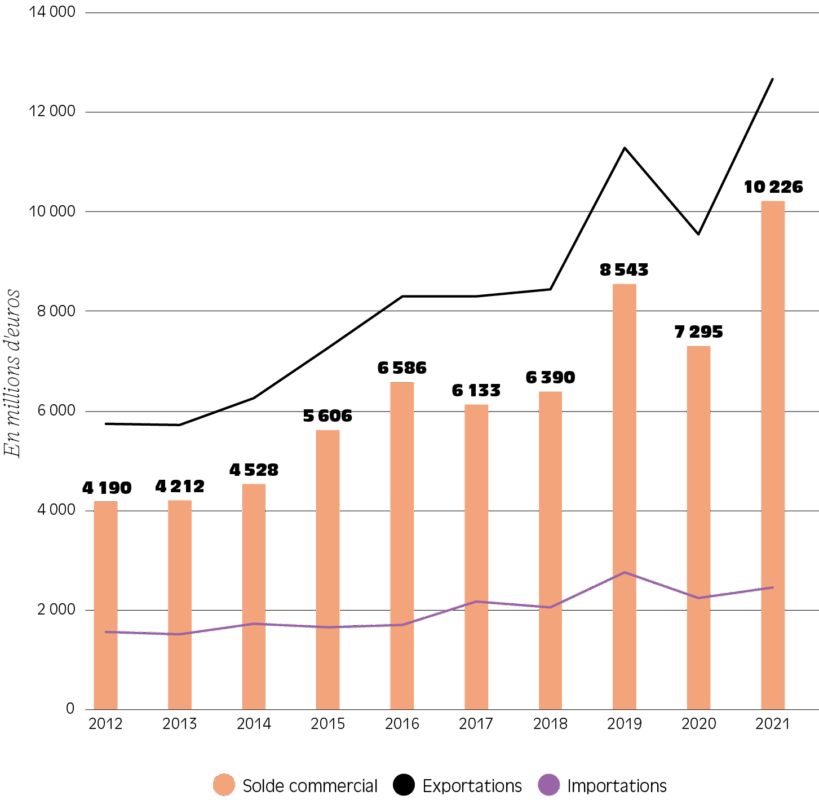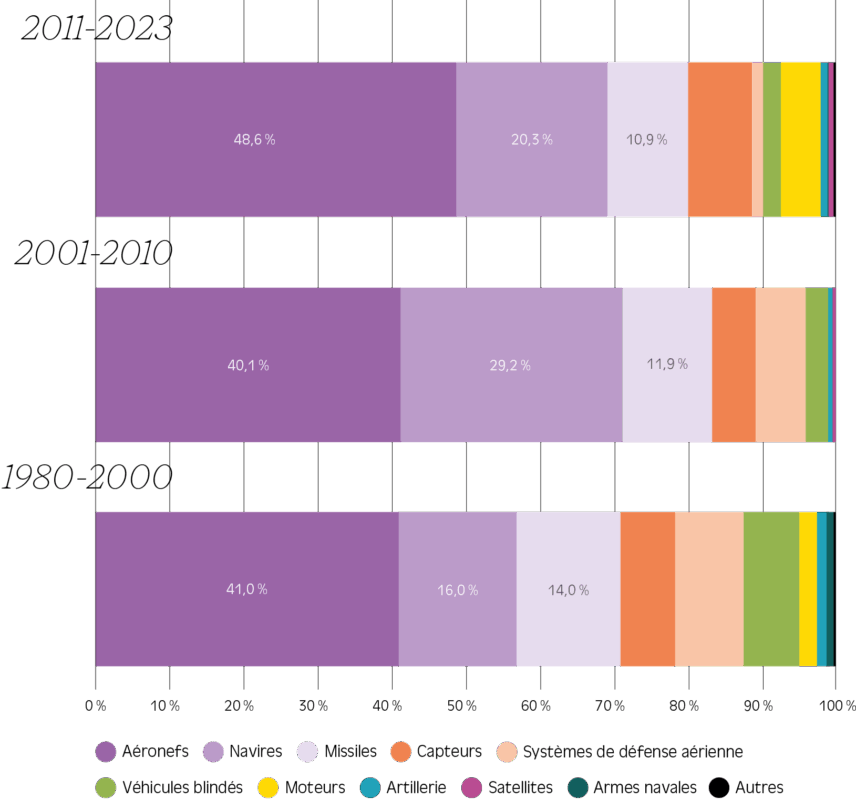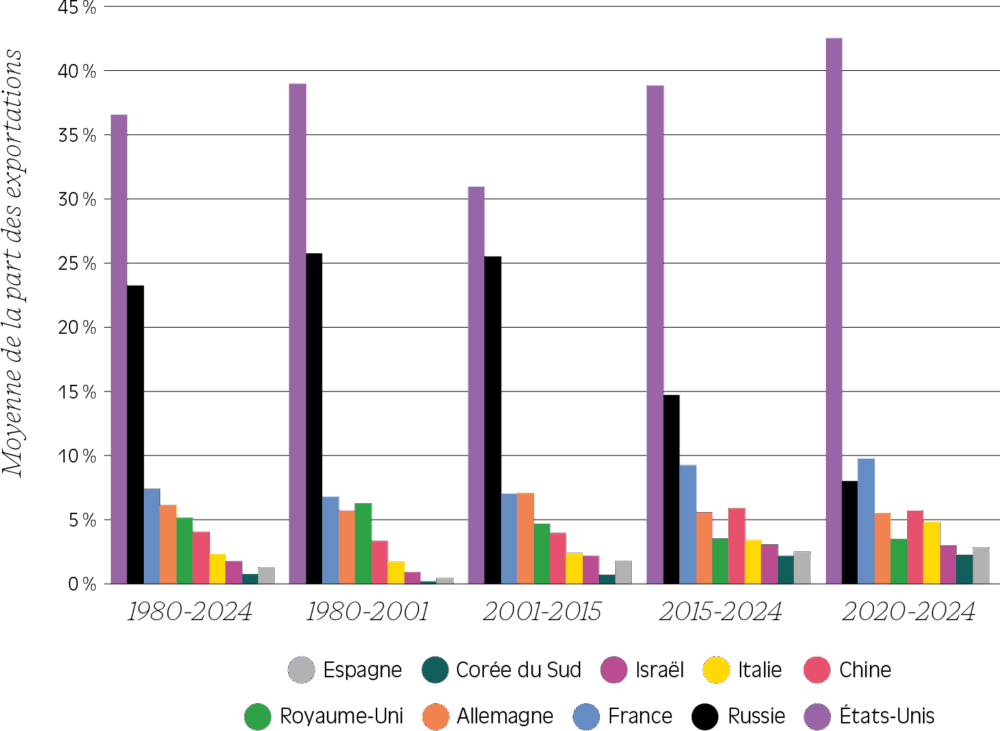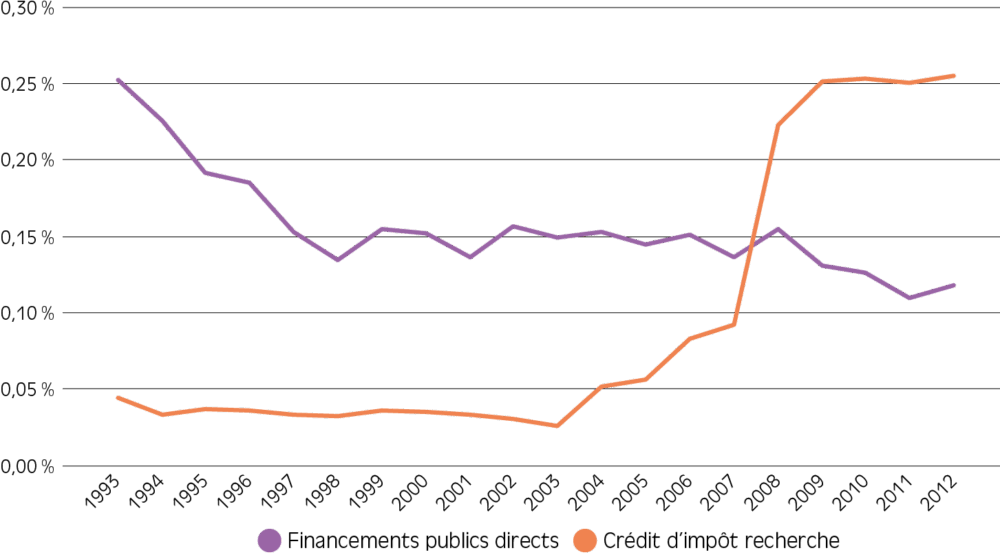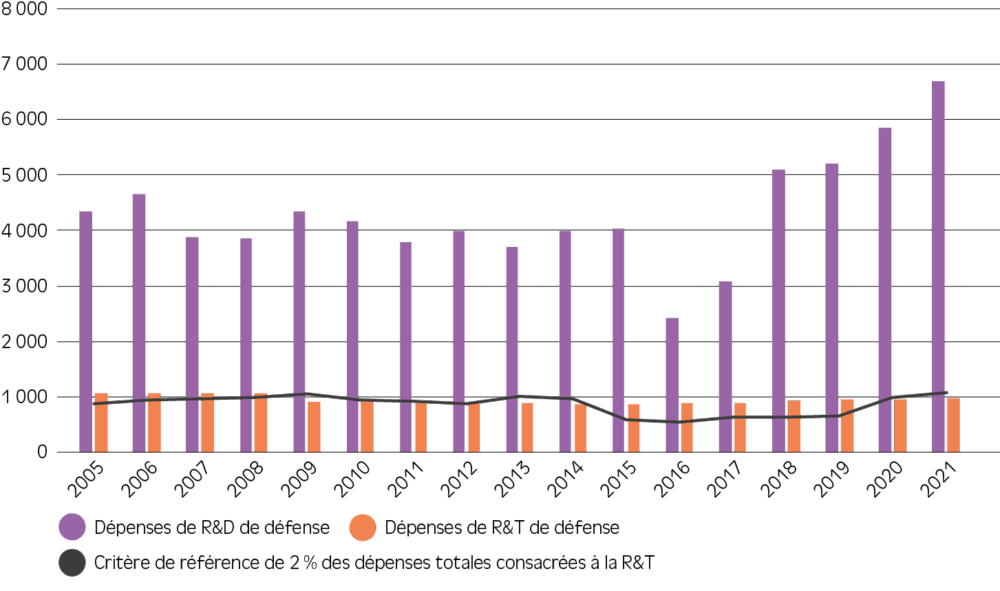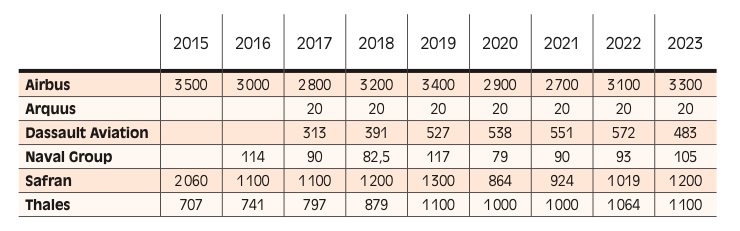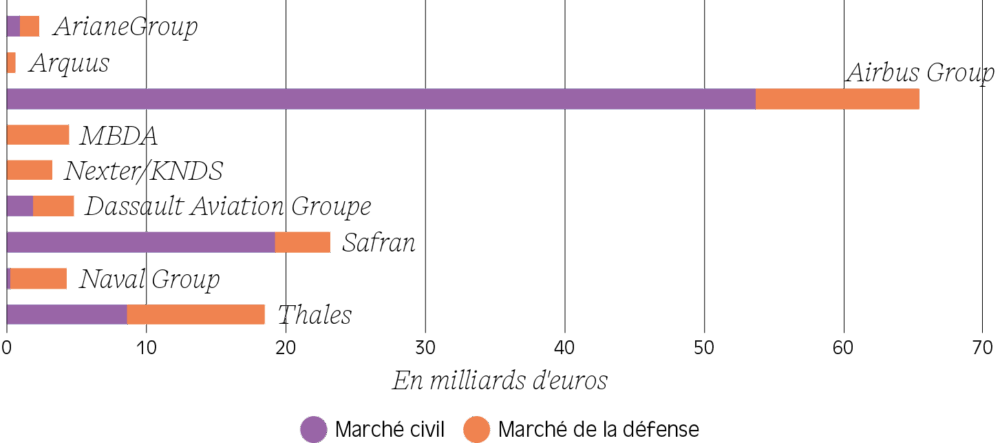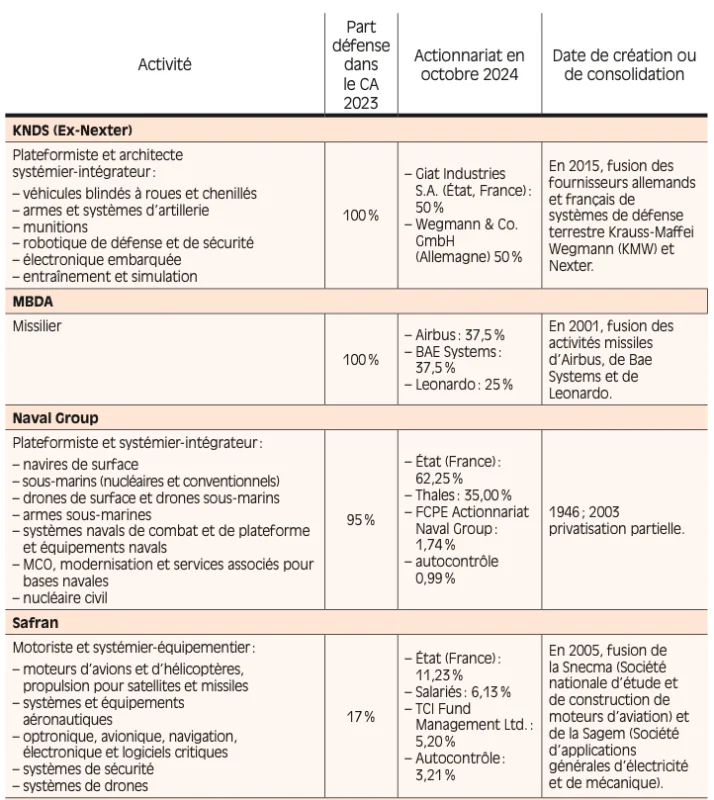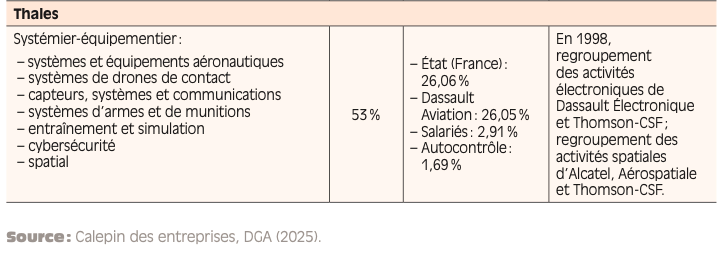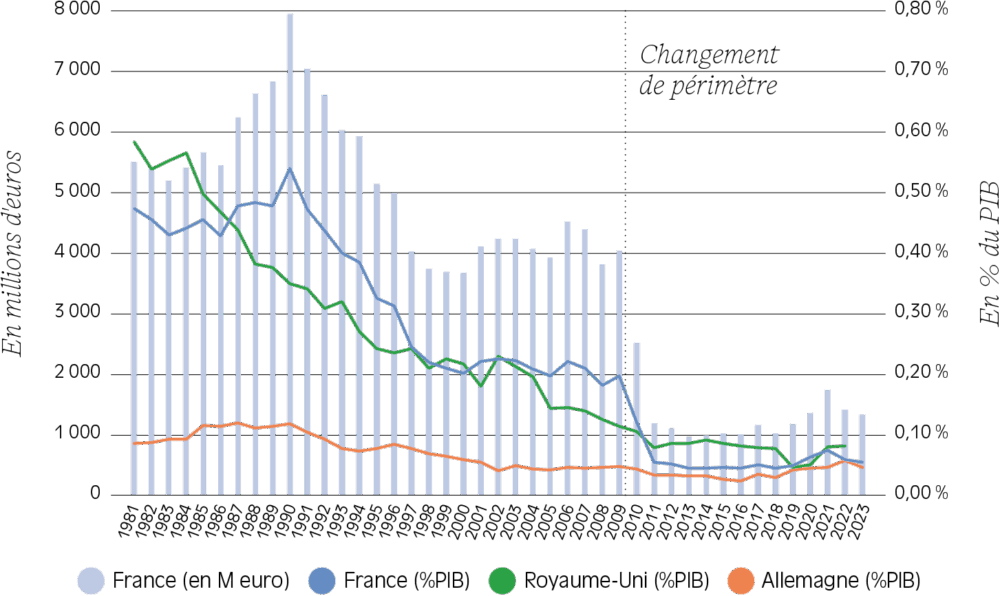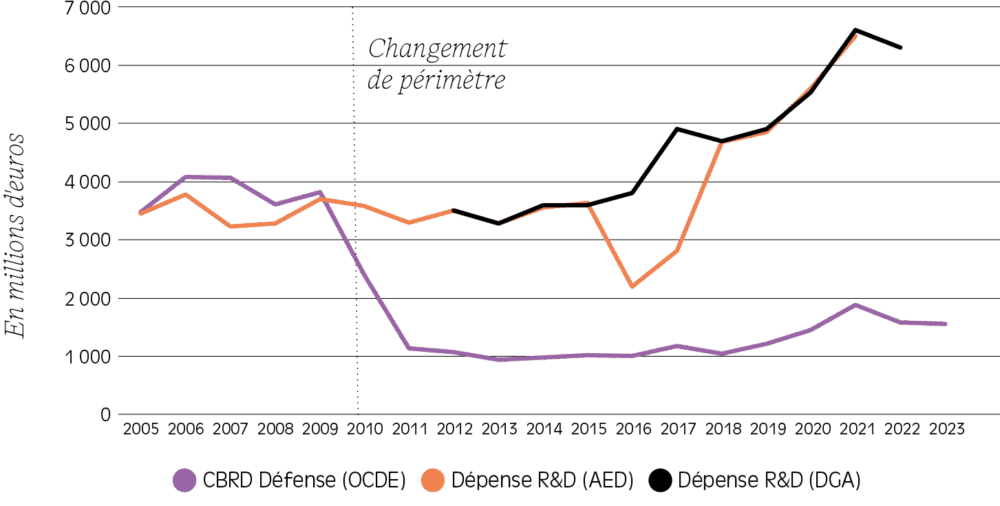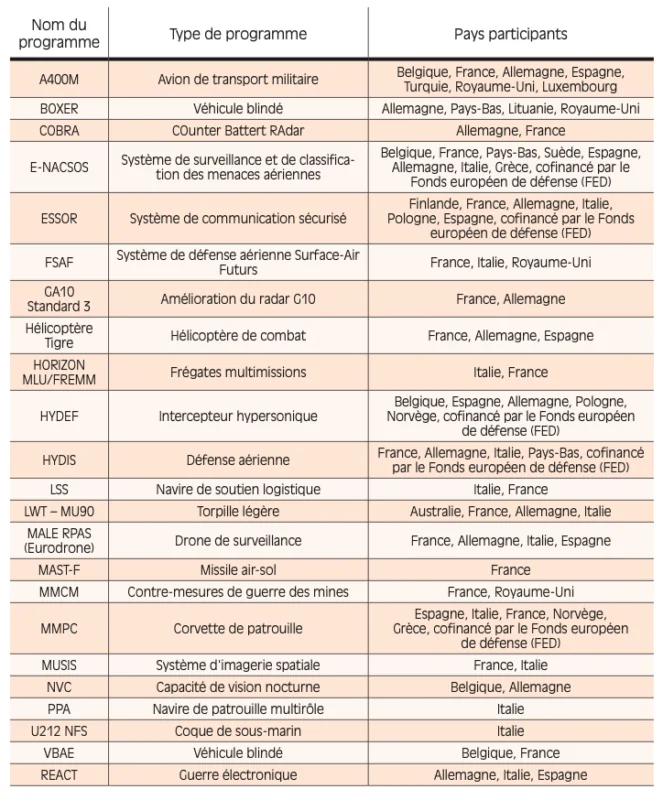L’industrie de défense au service des ambition française. De la maîtrise à la supériorité.

Rythme nº3, décoration pour le Salon des Tuileries Delaunay Robert (1885-1941)
Préface
L’industrie de défense française ne saurait être réduite à un simple secteur économique. Son histoire est profondément liée à la souveraineté de la France, à sa capacité d’influence sur la scène internationale et la défense de ses intérêts vitaux. C’est pourquoi l’État demeure l’architecte central de cette filière, orchestrant l’équilibre délicat entre exigences opérationnelles, contraintes budgétaires et dynamiques d’innovation.
Pour autant, la commande publique est loin de constituer le seul moteur de croissance du secteur. L’intégration croissante de la dimension européenne, le développement des exportations et la diversification vers les marchés civils imposent à nos entreprises de repenser leurs modèles organisationnels et industriels afin de rester compétitives dans un environnement très concurrentiel.
Depuis 2022, l’invasion russe en Ukraine a bouleversé notre environnement sécuritaire. Cette onde de choc rappelle aux Européens la valeur de la paix, mais surtout le prix à payer pour l’assurer. Elle a redéfini les priorités stratégiques de tous les pays du continent : le réarmement est redevenu une nécessité urgente, et avec lui l’obligation, pour l’industrie de défense, de démontrer sa capacité à intensifier ses cadences de production.
Pour l’industrie de défense française, cet impératif capacitaire – produire plus, plus vite – ne concerne pas seulement les équipements à forte intensité technologique, qui exigent des investissements lourds. Il s’étend désormais à des besoins de masse avec des produits plus simples, comme les munitions ou les drones à faible coût. C’est une évolution majeure.
Notre capacité à répondre aux attentes des forces armées, dans les délais et coûts impartis, repose sur quelques fondamentaux alors que le champ de bataille se transforme sous l’effet de l’intelligence artificielle, de la dronisation et de la guerre hybride.
Le premier de ces fondamentaux est la visibilité. Lancer de nouveaux investissements industriels, qu’il s’agisse d’optimiser des lignes de production existantes ou d’en créer de nouvelles, nécessite une prise de risque significative de la part des industriels. Celle-ci n’est possible que si l’État assure pleinement son rôle d’acheteur souverain en s’engageant sur des commandes fermes et pluriannuelles qui favorisent la souveraineté. Par la préférence accordée aux équipements dont l’autorité de conception est européenne et qui sont produits en Europe, l’Union européenne à un rôle important à jouer dans la montée en puissance de la défense européenne appuyée sur une industrie de défense européenne assurant une souveraineté de conception, d’emploi et d’exportation qui sont au cœur de l’autonomie stratégique. Faute de quoi, l’Europe restera prisonnière des modèles d’acquisitions militaires qui se font essentiellement au bénéfice des Etats-Unis.
Le deuxième élément de réussite réside dans la robustesse de la chaîne d’approvisionnement. Répondre à l’augmentation de la demande ne relève pas uniquement des grands donneurs d’ordre : c’est tout un tissu de PME et de fournisseurs qui, sortant d’une période de faible activité, doivent désormais investir, recruter, soutenir financièrement leur croissance, tout en intégrant des standards élevés de qualité et de traçabilité. L’urgence n’est pas seulement de produire plus, mais de le faire vite et bien, avec chaîne industrielle résiliente et performante et donc compétitive à l’export.
Le troisième pilier, enfin, est le maintien d’une supériorité technologique qui repose sur l’innovation, aussi bien dans les produits que dans les procédés industriels. Fabrication additive, production et contrôle assistés par l’intelligence artificielle, numérisation : ces leviers permettent d’accélérer les cadences et d’intégrer rapidement les innovations dans les produits utilisés sur le champ de bataille.
Ce triptyque – visibilité, résilience, innovation – doit désormais s’inscrire dans une dimension européenne. La préférence européenne, qu’elle s’exprime dans le contenu technologique, la conception ou les chaînes d’approvisionnement, est essentielle pour retrouver un effet de volume, renforcer nos capacités collectives et sortir de la dépendance à des fournisseurs extra-européens. Il en va de notre autonomie stratégique commune, sur le long terme.
La montée en puissance industrielle à laquelle nous faisons face ne se limite pas à une augmentation des volumes. Elle engage une transformation profonde de nos méthodes, de nos partenariats et de notre rapport à l’innovation.
Olivier Andriès
Directeur général de Safran et président du Cidef
Merci
L’autrice remercie l’ensemble des industriels, représentants de filières, institutionnels et chercheurs qui ont accepté de prendre part aux entretiens. Également, elle remercie les experts présents lors de l’atelier de travail du 7 juillet 2024, dont les éclairages pertinents ont marqué le début de l’étude. Les enseignements de cet ouvrage résultent en grande partie de la disponibilité des acteurs interrogés, ainsi que de leurs connaissances et compétences tant techniques qu’industrielles et militaires. En particulier, l’autrice adresse ses sincères remerciements à MM. Renaud Bellais, Hervé Guillou, Guillaume Muesser et Axel Nicolas, dont la participation a été déterminante dans l’accomplissement de cette étude.
Celle-ci a bénéficié du concours de la direction de l’industrie de défense de la DGA. L’autrice remercie tout particulièrement MM. Nicolas Grangier et Camille Lanet, qui ont largement contribué à la compréhension du fonctionnement de cette institution.
Cette Note est le fruit, comme à son habitude, du travail collectif de l’équipe de la Fabrique de l’industrie. Merci à Vincent Charlet et Caroline Granier pour leurs conseils et relectures tout au long de l’étude, à Émilie Binois et Sharif Abdat pour le suivi éditorial, à Gabriel Meunier et Julie Celeste Meunier pour la valorisation médias.
Pour résumer
Au socle de la puissance politique de la France, l’industrie de défense lui permet de préserver ses intérêts nationaux. Plus précisément, elle concourt à la maîtrise « des capacités essentielles à sa défense et sa sécurité » , selon les termes officiellement choisis pour définir la notion d’ « autonomie stratégique » , concept clé de la doctrine française de défense depuis 1958. C’est l’objectif cardinal que l’État s’est assigné à lui-même, ainsi qu’à l’ensemble des parties prenantes qui l’aident à l’atteindre.
Pour y parvenir, l’industrie de défense doit notamment respecter deux règles impératives : d’une part, maintenir la supériorité technologique des équipements et systèmes des forces armées françaises à la hauteur des ambitions de puissance nucléaire du pays et, d’autre part, accéder à un haut niveau de compétitivité pour trouver sur les marchés extérieurs et civils un complément d’affaires indispensable aux ressources limitées de l’État français. Et elle y parvient ! En 2024, la France se hisse au deuxième rang mondial des exportations d’armement et au premier rang européen. Notre pays a même réussi à accroître sa part de marché dans un contexte de vive concurrence.
Tenir cette double ambition, technologique et industrielle, ne va pas de soi et c’est tout le propos de cet ouvrage que de comprendre à quoi tient cette performance, à la fois conséquence et condition d’une volonté politique orchestrée par l’État. À plusieurs titres, on y reconnaît l’importance d’une organisation industrielle maîtrisée et agencée autant par les entreprises que par l’administration pour faire de ce secteur un fleuron technologique et économique. Cet enseignement découle d’un ensemble d’observations, énumérées ci-dessous, qui pourront simultanément faire office de guide et servir de rappel des bonnes pratiques pour renforcer la compétitivité des secteurs industriels.
Premièrement, la maîtrise des savoir-faire et leur conservation sur le territoire national constituent un axe structurant de cette démarche, assurant la vitalité d’un tissu industriel innovant. En second lieu, les industriels et l’État veillent conjointement à la robustesse de leur chaîne d’approvisionnement, et savent adopter des réponses rapides et efficaces en temps de crise. Troisièmement, cette maîtrise de bout en bout est assurée par un ensemble d’acteurs formant un écosystème dense, où l’on retrouve des organismes nationaux, des syndicats de filière et des clusters territoriaux, ancrant des habitudes coopératives à tous les stades de la chaîne de valeur, elles-mêmes sources de confiance et de résilience. Cette dynamique de coopération s’étend aujourd’hui au cadre européen, quand la convergence d’intérêts entre les acteurs français et leurs partenaires le permet. Alors que les tensions géopolitiques se multiplient et que de nouveaux concurrents industriels émergent, les nations européennes mutualisent, non sans difficulté, certaines activités en vue de renforcer leur puissance.
Enfin, les entreprises du secteur cherchent à adapter leur stratégie d’innovation aux nouvelles menaces, ainsi qu’aux avancées technologiques civiles. Tout comme leurs principaux interlocuteurs régaliens, elles s’efforcent d’ouvrir leur fonctionnement pour capter de nouveaux modèles d’organisation et maintenir la supériorité technologique et opérationnelle de leurs solutions.
Loin d’être monolithique, l’industrie française de défense se présente sous la forme d’un ensemble d’acteurs, de plus en plus variés et duaux, qui interagissent et forment un écosystème bien coordonné autour d’un impératif commun. La relation organique permanente qu’ils entretiennent avec le ministère des Armées et sa Direction générale de l’armement se présente comme un cas particulier de politique industrielle performante, adaptée aux enjeux du temps présent.
Introduction
Lors des vœux du 7 janvier 2025, Sébastien Lecornu, ministre des Armées, a exposé la réussite commerciale du secteur français de l’armement : « L’année 2024 a été la deuxième meilleure année de notre histoire, avec plus de 18 milliards d’euros de prise de commandes. » Parmi ces acquisitions figurent les accords conclus avec la Serbie pour l’achat de douze Rafale et avec les Pays-Bas pour l’achat de quatre sous-marins. Tandis que le déficit commercial de la France a atteint 81 milliards d’euros la même année, ces contrats à l’export mettent sur le devant de la scène les excellentes performances de l’industrie française de défense, première exportatrice européenne et deuxième mondiale. Entre 2015 et 2021, l’excédent commercial des matériels de guerre et produits liés a presque doublé, passant de 5,6 milliards d’euros à plus de 10,2 milliards d’euros, tandis que la part moyenne de la France dans les échanges commerciaux est passée de 7 % entre 2001 et 2015 à 9 % entre 2015 et 2024.
La France, donc, excelle dans ce domaine. Elle détient des savoir-faire clés, tant dans le naval que dans l’aérospatial et le terrestre. Le rapport Draghi publié en septembre 2024, qui exprime globalement une vive inquiétude quant au risque de décrochage de la compétitivité européenne, souligne également que « certains équipements et technologies [de défense] sont supérieurs ou au moins équivalents à ceux produits aux États-Unis dans de multiples domaines, comme les chars de combat et tous les sous-systèmes, les sous-marins, les technologies navales et aéronautiques ».
Ces divers éléments mettent en lumière la performance de l’industrie française de défense, qui se distingue doublement par son excellence technologique et sa compétitivité à l’international. Sa contribution positive à la balance commerciale intervient en outre dans une actualité marquée par les tensions géopolitiques et l’intensification des conflits, qui se sont traduites par une présence militaire très perceptible lors de l’édition 2025 du Salon du Bourget et par de nouvelles annonces, en mars de la même année, d’un supplément d’effort budgétaire en faveur de la défense.
Cette étude vise à comprendre les raisons du succès industriel des produits français, en remontant le plus souvent à la fin de la guerre froide, qui s’est traduite par un net ralentissement de la dépense militaire en France. L’effondrement du bloc de l’Est et la dissolution de l’URSS ont notamment mis un coup d’arrêt à la course à l’armement, entraînant une chute de la demande mondiale en équipements militaires (Coulomb, 2017). Or, en dépit de cette contraction de la demande, le secteur français de la défense1 a su conserver les savoir-faire et les capacités industrielles nécessaires à la satisfaction des ambitions étatiques d’« autonomie stratégique ». Ce concept popularisé par le Général de Gaulle réapparaît dans le Livre blanc de la défense de 1994, concernant la nécessité pour la France de maintenir une indépendance vis-à-vis de l’Otan et des États-Unis. Une décennie plus tard, dans le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale de 2013, l’autonomie stratégique est définie en ces termes : « maîtrise nationale des capacités essentielles à sa défense et sa sécurité ». D’un point de vue industriel, le ministère des Armées entend par conséquent garder un « accès aux capacités industrielles et technologiques qui conditionnent la satisfaction à long terme des besoins des forces armées » (Oudot et Bellais, 2008). Cette stratégie s’incarne notamment par la volonté de l’État de « placer sous son contrôle » les unités productives des systèmes de défense (Vernhes, 2024).
Il s’agit donc, pour l’État français et ses interlocuteurs industriels, de garantir au meilleur niveau la réponse à une ambition nationale en s’appuyant sur des entreprises qui s’en remettent pour leur part aux principes de l’économie de marché. Cela n’a rien d’évident. Comment et dans quelle mesure l’objectif français d’autonomie stratégique a-t-il pu structurer l’industrie de défense et en faire un pilier de son économie ? Faut-il voir, dans les termes mêmes de cette question, la définition caractéristique d’une politique industrielle réussie, dont on pourrait s’inspirer sur d’autres terrains ?
C’est à ces questions que cet ouvrage se propose de répondre. Le premier chapitre analyse le rôle central de l’État dans la construction de l’offre et de la demande sur le marché de la défense, notamment avec la Direction générale de l’armement (DGA), organisant l’industrie en fonction des intérêts et ambitions que la nation souhaite défendre. Dans le deuxième chapitre, nous présentons les transformations de la base industrielle, survenues à partir de 1990, qui lui ont permis d’accroître son efficacité économique : restructurations – encouragées par les acteurs étatiques et industriels – et investissement dans de nouveaux leviers de croissance comme l’exportation. Dans le troisième chapitre, nous montrons comment les acteurs français de la défense parviennent à garantir la supériorité technologique de leurs systèmes, ce qui concourt à leur compétitivité tout en offrant à la France un outil militaire qui lui donne la possibilité d’agir au service des intérêts nationaux. Le quatrième chapitre met en évidence la manière dont la chaîne d’approvisionnement a été structurée afin de sécuriser les savoir-faire et les capacités nécessaires au fonctionnement industriel. Le cinquième chapitre esquisse les différentes dynamiques de coopération entre les acteurs de l’écosystème, que ce soit à l’échelle locale, nationale ou européenne, qui le rendent résilient et compétitif. Enfin, le sixième et dernier chapitre se concentre sur l’hybridation du modèle économique des industriels, qui doivent maximiser les synergies entre les sphères civile et militaire et diversifier leurs segments de croissance.
Cette étude se fonde sur une analyse approfondie de la littérature, ainsi que sur des entretiens et ateliers de travail avec des chercheurs, des représentants industriels et des institutionnels – maîtres d’œuvre et PME-ETI, responsables de filières et de clusters, et représentants d’intérêts.
- 1 — À proprement parler, l’industrie de défense ne correspond ni à un secteur (au sens statistique de la nomenclature d’activités française) ni à une filière (puisqu’elle en regroupe plusieurs). Faute d’un terme plus précis, et conformément au langage courant, nous emploierons indifféremment dans la suite de ce texte les expressions « secteur », « industrie » ou encore « segment » de la défense pour désigner cet ensemble d’activités, hétérogène mais cohérent.
Une filière industrielle gouvernée pour répondre à des ambitions étatiques
L’État structure autant la demande d’équipements de défense que le nombre d’offreurs industriels présents. Ce rôle est intrinsèquement lié aux caractéristiques particulières de ce secteur.
L’État, premier interlocuteur de l’industrie de défense
Une industrie forte de 4 000 entreprises et de plus de 220 000 emplois
La base industrielle et technologique de défense (BITD) désigne l’ensemble des entreprises qui contribuent à concevoir, produire et maintenir en condition les équipements des forces françaises (Bellais et al., 2014). Elle se décline selon les quatre grands milieux d’opération (aérospatial, naval, terrestre et cyberespace), où un ensemble d’acteurs participe, à différentes étapes des chaînes de valeur, à la construction du système militaire. Jean-Marie Dumon, délégué général adjoint du Gican2, décrit une industrie composée de filières hétérogènes, ce qui entraîne « des caractéristiques et contraintes spécifiques, qu’il faut prendre en compte pour comprendre le fonctionnement de la BITD. Ce n’est pas un corps monolithique mais plutôt un ensemble de segments différents, qui doivent répondre à un double enjeu : les exigences de la défense et les contraintes économiques. » Il prend le cas de la filière navale, qu’il définit comme moins « verticale » que les autres, en raison de la diversité des entreprises qui la composent, d’un niveau d’intégration modéré (plus faible que l’industrie aérospatiale) et de la forte dualité des technologies employées.
Selon la DGA, la BITD regroupe neuf grandes entreprises appelées « maîtres d’œuvre industriels » (MOI, voir Annexe 3)3 et plus de 4 000 PME et ETI exerçant des activités de recherche et de production. Leur activité stimule le développement économique de nombreuses régions : l’industrie de la défense crée ainsi près de 220 000 emplois directs et indirects répartis sur tout le territoire français (EcoDef nº 260, 2025). Selon Lerousseau (2021), une unité de revenu dépensée par le secteur de la défense sur le territoire français permettrait un accroissement compris entre 1,1 et 2,5 de la production locale. Ces résultats concordent avec les estimations du ministère des Armées (2025) en partenariat avec l’Institut de l’économie industrielle : « Chaque euro investi dans la défense génère entre 1,27 euro et 1,68 euro de richesse dans l’économie nationale, en fonction de l’horizon temporel considéré. »
Cet effet d’entraînement de l’investissement militaire est notamment la conséquence d’une production industrielle à haute valeur ajoutée, impliquant de nombreux acteurs tout au long du processus, depuis la conception jusqu’au maintien en condition opérationnelle. Par exemple, le Rafale, avion de combat produit par Dassault, engendre plus de 7 000 emplois directs et indirects en France et implique 400 entreprises, principalement des PME et des ETI (LPM 2024-2030).
Un monopsone régi par la commande publique
La particularité de la défense est qu’elle appartient à la catégorie des biens collectifs. En d’autres termes, il est impossible d’exclure un citoyen de la protection assurée par la défense nationale : elle est uniforme et s’applique à tous (non exclusive et non rivale). Or, selon la théorie des biens publics, un risque de défaillance de marché survient pour ces biens collectifs : certains acteurs (appelés « passagers clandestins ») sont désincités à en assumer le coût. Pour pallier cette défaillance, l’État intervient en créant un budget spécifiquement destiné au financement de la défense de son territoire4. La défense nationale appartient donc au portefeuille des compétences régaliennes ; en France, cela remonte à la mise en place de la taille en 1439, impôt dévolu exclusivement à la constitution d’un budget spécifique pour la défense (Aben, 2020).
Une autre particularité importante est que le marché de la défense constitue un monopsone : il n’y a qu’un seul acheteur, l’État, qui fait d’ailleurs face à un oligopole de producteurs (Bellais et al., 2014), voire à un monopole bilatéral pour certains segments. Cette structure assez rare dans les activités marchandes résulte du cadre réglementaire de la défense. En France, et dans une large partie du monde, la fabrication et le commerce de matériel à usage militaire sont en effet soumis à une autorisation étatique. Puisque l’armée relève de l’État et que le commerce d’armes est interdit sauf en cas d’obtention de licence, les producteurs ont l’État pour unique client légal, dont la demande correspond à la commande publique. Hérault (2018) définit la demande sur le marché de l’armement comme « la somme de marchés domestiques sur lesquels les clients (majoritairement étatiques) s’approvisionnent en ouvrant plus ou moins la compétition à des acteurs étrangers ». Depuis les travaux de Ron Smith (1989), la dépense militaire5 est un proxy largement utilisé dans la littérature économique pour comptabiliser la demande sur le marché des produits d’armement.
Cette commande publique dépend elle-même du budget que l’État accorde à l’équipement et au fonctionnement des forces armées. Ce budget est planifié dans la loi pluriannuelle de programmation militaire (LPM), qui précise les achats et investissements prévisionnels affectés aux programmes d’armement, à leur maintenance et à l’innovation sur une période de six ans. Le budget officiel reste cependant la loi de finances annuelle, dont le ministère des Armées a la charge d’allouer les crédits afin d’assurer « la protection du territoire, de la population et des intérêts français ». L’utilisation et la répartition des crédits pour l’équipement des forces armées sont plus spécifiquement supervisées par la Direction générale de l’armement (DGA), responsable de toutes les opérations liées aux acquisitions d’armement pour les trois armées, que leur développement soit sous-traité à l’industrie ou que l’équipement soit acheté « sur étagère » en France ou à l’étranger. Cette Direction a donc la charge de superviser et d’orienter la stratégie industrielle, afin d’assurer l’autonomie stratégique de la défense française.
La LPM 2024-2030 prévoit ainsi un effort de 413 milliards d’euros sur sept années. En 2024, 16,6 milliards d’euros de crédits budgétaires ont été alloués à l’équipement des forces armées, soit 34 % du total de la mission « Défense » qui représente 49,2 milliards d’euros, hors pensions (ministère des Armées, 2024)6. Dans cette loi budgétaire, Charles Maisonneuve, directeur des affaires publiques d’Arquus, distingue trois grandes catégories de dépense : l’équipement des forces, la préparation et l’emploi des forces, et enfin les dépenses d’environnement et de prospective consacrées notamment à la recherche et à l’innovation7. « Ces dépenses apparaissent complémentaires afin de préparer l’avenir des équipements et de garder une force armée efficace dans le futur. » La pluriannualité de la LPM offre une vision de moyen terme aux entreprises, d’autant plus nécessaire que les programmes d’armement et cycles d’acquisitions s’étendent sur plusieurs décennies : « Il faut du temps pour faire mûrir le développement et la réalisation des engins », ajoute Charles Maisonneuve. Par exemple, la mise en service du Rafale a mis vingt ans, entre le lancement du programme en 1982 et sa première entrée en service à la Marine nationale en 2002.
En revanche, Hinde Doux, présidente de TNS-Mars8, précise que la LPM9 « n’est qu’une programmation et non une loi de finances ou un budget de l’État sanctuarisé ». C’est un indicateur pour évaluer la commande, qui « reste important pour les entreprises de défense, souvent en situation d’incertitude, afin d’orienter leurs investissements. Étant donné la volatilité et la difficulté de ce marché, la LPM est le minimum nécessaire pour continuer à produire des systèmes d’armes pour le marché français », ajoute-t-elle.
Les ambitions et engagements internationaux de la France
L’effort de défense de l’État français s’explique en partie par son ambition de constituer une « armée de premier rang », capable de garantir son statut de puissance sur la scène internationale. Remontant à l’époque de Colbert, quand la production de poudres et d’armes était maintenue sous contrôle pour répondre aux exigences de l’État, cette priorité politique s’est exercée continûment. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement s’est efforcé de reconstruire et de moderniser les manufactures et arsenaux du pays. Puis, à partir des années 1960, sous l’impulsion du général de Gaulle qui souhaitait s’affranchir de la tutelle des États-Unis et de l’Otan, la base industrielle telle qu’on la connaît aujourd’hui s’est structurée autour de la mission de dissuasion (Fontanel et Hébert, 1992 ; Fromion, 2006).
La dissuasion est une stratégie militaire dont le principe est de faire renoncer l’adversaire à attaquer. La menace nucléaire y occupe une place centrale (Masson, 2016), cette arme de destruction massive pouvant frapper tout État qui aurait l’intention de mettre en péril les intérêts vitaux de la Nation, peu importent les méthodes employées. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le développement des armes nucléaires est devenu un élément clé des relations internationales ; cette stratégie a donc été « prolongée par les successeurs du général de Gaulle afin de rester une puissance sur la scène internationale. [Elle] a organisé en grande partie le système de défense nationale français », relate Guillaume Muesser, directeur défense et affaires économiques du Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales (Gifas).
Dépenses militaires de la France et des principaux producteurs d’armes
(a) En % du PIB entre 1950 et 2024
(b) En % du PIB entre entre 1992 et 2024
Source : SIPRI Military Expenditure Database.
Pour Renaud Bellais 10, chercheur associé au Cesice, université Grenoble Alpes, et codirecteur de l’Observatoire de la défense, Fondation Jean-Jaurès, « la politique étrangère de la France, et donc l’accompagnement de la BITD, ont en effet été façonnés par la dissuasion nucléaire. Dans cette optique, la France a investi dans la conception et la production d’un dispositif aérien et naval capable de l’incarner 11, de la crédibiliser et de la protéger (sous-marins nucléaires d’attaque, sous-marins nucléaires lanceurs d’engins, porte-avions, chasseurs, frégates, dispositifs de surveillance et de communication avancés…). Tous ces éléments forment un système orienté autour d’un objectif, qui détermine le niveau d’ambition et de fiabilité à atteindre. »
Outre les ambitions géopolitiques propres à la France, ses dépenses militaires sont également déterminées par ses engagements internationaux dans le cadre de l’Otan. Depuis 2006, elle devait ainsi atteindre un niveau de dépense équivalant à 2 % de son PIB, effort collectif considéré comme minimal pour affermir la crédibilité de l’alliance. Désormais, selon les termes du sommet des 24 et 25 juin 2025 à La Haye, la cible a été portée à 3,5 % du PIB d’ici à 2035 – à quoi il faut encore ajouter 1,5 % afin de renforcer la protection des frontières et la cybersécurité. En 2023, les dépenses militaires du Canada et des pays européens appartenant à l’Otan atteignaient seulement 1,78 % de leur PIB12.
Enfin et surtout, ces efforts budgétaires et commandes d’armement s’inscrivent dans un contexte international marqué par des tensions plus ou moins affirmées. C’est ce qui explique, d’abord, qu’ils aient considérablement diminué depuis le début des années 1990, tant en France et en Europe qu’aux États-Unis. Cette réduction s’explique avant tout par la fin de la guerre froide et la période des « dividendes de la paix » qui a suivi. En 1953, les dépenses militaires de la France représentaient en effet 7,5 % de son PIB, tandis que les États-Unis ont atteint en 1952 un niveau de 14 %. Ces proportions ont au contraire atteint un minimum historique de 1,85 % en 2013 et de 3 % en 1999, respectivement.
Les dépenses militaires mondiales ont toutefois connu un mouvement de reprise relative à partir des années 2000, sur fond d’émergence de nouvelles puissances industrielles comme la Corée du Sud. Ce pays a en effet développé une industrie à la fois efficace et autonome, face aux menaces émanant de la Corée du Nord, tout en s’efforçant d’adapter ses normes industrielles aux standards internationaux dans le but d’augmenter les échanges commerciaux, à l’instar du char K2 compatible avec les munitions de l’Otan (Martin, 2022).
Ce revirement a certes tardé à atteindre les États membres de l’UE. Hormis un timide sursaut après les attentats du 11 septembre 2001, la dépense militaire de la France est en effet restée orientée à la baisse (Béraud-Sudreau, 2020), marquée par des coupes budgétaires à la suite des crises financières, la reléguant au rang des variables d’ajustement parmi les priorités étatiques selon Droff et Malizard (2014). C’est à l’aune de la menace terroriste sur le sol français à partir de 201513 puis de la guerre en Ukraine que la France a recommencé à allouer davantage de crédits à son effort de défense (fig. 1.2), alors même que les comptes publics souffraient d’un fort endettement et d’un dérapage du déficit public. Ce changement s’est également observé chez nos plus proches partenaires. Ainsi, le taux de croissance annuel moyen des dépenses militaires de l’Union européenne en prix constants (2020) a été négatif entre 1995 et 2015, tandis qu’il s’est établi à + 2 % sur la période 2015-2022, principalement tiré par des pays de l’Europe de l’Est. La Pologne, par exemple, a accru ses dépenses de près de 28 % entre 2022 et 2023 (fig. 1.3). Depuis 2022, tout semble donc indiquer que s’amorce une nouvelle course mondiale à l’armement, dont la dernière avait pris fin avec la chute du mur de Berlin (Coulomb, 2017).
Évolution de l’effort public de défense entre 2005 et 2024, en France
Sources : budget.gouv.fr
Note : les dépenses sont exprimées en crédits de paiements, tels qu’inscrits dans les lois de finances chaque année. Les crédits de la mission « défense » incluent les pensions.
Taux de croissance annuel moyen des dépenses publiques de défense (en prix constants, base 2020) entre 1995 et 2023
Source : Eurostat. Traitement La Fabrique de l’industrie.
Une filière organisée autour de l’exigence d’autonomie stratégique
La DGA, pivot de l’organisation industrielle de la défense
La Délégation ministérielle pour l’armement (DMA) a été créée en 1961 par le général de Gaulle afin de mettre en œuvre les programmes des composantes14 de la dissuasion nucléaire (Collet-Billon, 2022). Elle est devenue la DGA en 1977.
La DGA agit en tant que maître d’ouvrage du système de défense français et principal client des fournisseurs de matériel militaire, conçu et produit pour répondre à un objectif de maîtrise technologique aligné avec l’ambition politique du pays (Joana, 2008). Elle est dotée d’une direction d’exécution de la R&D chargée d’anticiper les évolutions des équipements. Placée sous l’autorité du ministère des Armées, elle supervise les directions techniques des principaux milieux (terre, air, naval, espace), chargées de la conception – y compris de la R&D – et de la fourniture des équipements pour les forces armées. En droite ligne avec l’objectif prioritaire d’autonomie stratégique présenté plus haut, la DGA veille en particulier à réduire autant que possible ses dépendances vis-à-vis de pays tiers pour l’acquisition de matériel militaire (Oudot et Bellais, 2008).
La fin de la guerre froide a exposé la DGA à des critiques et contestations concernant son efficacité et sa légitimité. Ses ambitions technologiques ont été jugées coûteuses, alors même que le budget alloué à la défense diminuait considérablement. La concurrence entre industriels pour obtenir des commandes, dans un cadre budgétaire toujours plus resserré, a également pu contribuer à une forme de déconnexion décrite par Joana (2020) : les considérations technologiques semblaient ainsi l’emporter sur les besoins opérationnels, tout comme les développements sur le temps long s’accordaient difficilement aux besoins des forces armées souhaitant disposer des meilleures technologies le plus rapidement possible. En particulier, lors de la guerre en Afghanistan, les attaques asymétriques ont révélé l’inadaptation du matériel de l’armée de terre à ce nouveau type de conflit, requérant des achats en urgence, « sur étagère », de matériels non prévus par la loi de programmation militaire.
En 1996, Jean-Yves Helmer, ancien industriel du groupe PSA, est nommé à la tête de la DGA afin de mener une réforme des programmes d’armement. En particulier, les études techniques – équivalentes à la R&D de la DGA – sont transférées vers les centres de recherche15 et vers les industriels, en vue d’accroître l’efficacité de l’administration centrale et de réduire tant les coûts que les délais d’acquisition. C’est à la même époque que l’État opte pour la professionnalisation des forces armées et la fin du service militaire obligatoire (Perez, 2018, Hoeffler, 2013). De plus, une organisation transversale se substitue aux directions techniques par milieu, qui avaient tendance à cristalliser des conflits préexistants entre les états-majors. Quelques années plus tard, en 2004, une nouvelle réforme fixe à la DGA un objectif « d’autonomie compétitive », c’est-à-dire d’obtention des équipements les plus performants au meilleur prix.
Le recentrage des compétences de la DGA en 1997 renforce la responsabilité des MOI dans le développement des programmes d’armement (Lazaric et al., 2009) ; il s’accompagne d’ailleurs d’un retrait progressif de l’État de leur capital. L’inflexion de 2004 introduit quant à elle un certain niveau de concurrence entre les MOI. Dans l’ensemble, l’écosystème a donc évolué vers un partage des risques financiers et techniques, renforçant les responsabilités des deux parties contractantes tout en instaurant un processus d’évaluation des coûts (enquêtes de prix) et des spécificités techniques (Lazaric et al., 2009 ; Hoeffler, 2013 ; Bellais et al., 2014). Cette concurrence est certes restreinte au territoire français, parfois étendue au cadre européen de programmes coopératifs ; elle est surtout restée limitée en pratique du fait des stratégies de spécialisation des MOI et d’une préférence institutionnelle en faveur de producteurs français. Seule une minorité des contrats pour l’acquisition d’équipements suit aujourd’hui une procédure concurrentielle, la plupart étant souvent négociés de gré à gré ou avec un nombre restreint de concurrents choisis (Oudot et Bellais, 2008).
Quoi qu’il en soit, ces réformes ont fait évoluer le rôle de la DGA depuis celui de « maître d’ouvrage architecte », intervenant dans la conception et la réalisation, à celui de « maître d’ouvrage des interfaces », pilotant les processus entre les besoins opérationnels des forces armées et les capacités productives des industriels (Joana, 2020 ; Oudot et Bellais, 2008 ; Lazaric et al., 2009).
Organisation de la filière des missiles
Sources : Briant (2022) et sources publiques.
Une organisation productive modulaire pilotée par la DGA
En tant que maître d’ouvrage des interfaces, la DGA adopte une approche capacitaire, c’est-à-dire qu’elle se concentre sur les besoins des forces armées tout en s’appuyant sur son expertise technique pour gérer la contractualisation des programmes d’armement auprès des industriels. Les programmes d’armement sont en effet encadrés par des contrats d’approvisionnement, signés entre la DGA et les MOI, et dans une moindre mesure des ETI et PME, dans lesquels cette dernière spécifie les conditions budgétaires, techniques et calendaires de la conception, de la production et du maintien en condition opérationnelle (MCO) de l’équipement concerné. Dans ces contrats, les prix d’acquisition sont fixés ex ante, tout comme le sont les circonstances permettant de revoir les prix, en fonction notamment des paramètres économiques et du respect par les contractants des obligations de résultat en matière de performance et de délais.
Charles Maisonneuve décrit ainsi les grandes étapes de contractualisation dans l’industrie de défense. « Le processus de décision commence par une discussion entre l’état-major des armées et la DGA, qui définissent ensemble le budget nécessaire pour atteindre les objectifs des forces armées. Une fois celui-ci établi, la DGA échange avec l’armée de terre afin de retranscrire sous la forme de cahier des charges les besoins capacitaires. S’ensuit un lancement d’appels d’offres ou des accords de gré à gré avec les industriels. L’objectif de l’armée de terre est de faire en sorte que le matériel soit le plus opérationnel possible en établissant des objectifs à atteindre à partir de critères comme celui de la disponibilité technique opérationnelle des véhicules (DTO). Tout au long de ces interactions, les industriels guident et informent les parties prenantes sur les moyens possibles pour atteindre leurs objectifs. Au sein des grands programmes d’armement, la proximité et l’intensité des échanges deviennent primordiales, car les nouvelles avancées technologiques requises pour accroître la capacité technique de l’appareil nécessitent un soutien financier en matière de recherche et de développement, tant de la part de l’État que du secteur privé. Une fois le contrat signé, le maître d’œuvre se trouve confronté à un arbitrage dans le choix de ses fournisseurs et sous-traitants entre les enjeux de compétitivité et ceux de souveraineté. »
Dans les années 1990, l’essor des technologies de l’information et de la communication (TIC) fait évoluer les équipements des forces armées en plateformes connectées et modulaires, tout un ensemble de composants mécaniques et électroniques utilisés lors des opérations militaires pouvant rendre ces équipements plus performants (Depeyre et Dumez, 2007 ; Lazaric et al., 2009). Prenons l’exemple du Rafale : cet avion est équipé d’un ensemble de modules matériels qui en font un système d’armes complet pour mener différentes missions (surveillance, attaque, etc.). Il est équipé de missiles air-sol et air-air pour l’interception ou l’attaque, et peut même inclure des têtes nucléaires. Enfin, il est doté de technologies de communication pour assurer la liaison entre les différents contingents sur le terrain des opérations, ainsi que de divers capteurs pour les missions de renseignements.
Dans cette organisation productive modulaire des systèmes de défense, le MOI est à la fois l’architecte principal et l’intégrateur final : Dassault pour le Rafale, Naval Group pour les sous-marins, Airbus pour les hélicoptères et KNDS France pour les canons d’artillerie entre autres. Ce MOI intègre les différents composants de la plateforme fournis par les fabricants de sous-systèmes. Par exemple, Thales apporte les technologies de communication pour le Rafale, tandis que Safran est responsable des moteurs. Ces maîtres d’œuvre de sous-systèmes gèrent leur propre chaîne d’approvisionnement, qui inclut à son tour des sous-traitants et des fournisseurs. Hinde Doux précise que « dans la plupart des cas, le maître d’œuvre contractant est notifié du marché et la DGA n’assure pas un flux précis de ruissellement des compétences tout au long de la chaîne de valeur ; à part dans quelques cas particuliers où la DGA impose un fournisseur dans le contrat, en spécifiant par exemple qu’un sous-système provienne de Safran ou de Thales ». D’autres fournisseurs de systèmes, ETI et PME, livrent également à l’État, directement ou via des programmes d’ensemble, des équipements militaires, notamment dans les domaines des drones, du numérique, des forces spéciales et pour certains domaines de lutte ciblés.
C’est ainsi que la DGA anime la configuration industrielle et pilote la dynamique tantôt concurrentielle, tantôt coopérative, entre les principaux acteurs de la défense.
Une proximité relationnelle qui fluidifie la circulation de l’information
L’équipement des forces repose donc sur une structure en triptyque, incluant les armées, la DGA et l’industrie. Cela suppose une grande fluidité des interactions, et notamment une bonne circulation de l’information entre ces trois acteurs pour favoriser l’ajustement entre offre et demande (Hoeffler, 2008 ; Dupuy, 2013). Cette fluidité est d’autant plus nécessaire que l’externalisation des activités de R&D, couplée au recentrage de la DGA sur des fonctions de coordination et de supervision des contrats, a entraîné une asymétrie d’information concernant la conception des systèmes d’armement. En outre, les connaissances sont plus réparties entre de multiples acteurs, du fait de la production modulaire de systèmes complexes.
Or, en examinant les liaisons (activités commerciales) entre entreprises16 pour l’année 2014, Dolignon (2018) constate une forte concentration de l’écosystème autour du ministère des Armées et des MOI. Non seulement le ministère a des liens avec chaque MOI, mais chaque MOI détient en outre des liens avec au moins quatre autres MOI. Ces interdépendances économiques peuvent être vues comme le reflet de la complémentarité des compétences mobilisées17. En fait, cette complémentarité va jusqu’à instaurer des schémas de coopétition. Une firme ne pouvant à elle seule assurer la conception et la production complètes des programmes d’armement (Depeyre et Dumez, 2007), les MOI sont amenés à interagir régulièrement en tant que partenaires. Par exemple, Safran est le motoriste des avions militaires pour Airbus et Dassault et travaille également sur la propulsion des fusées d’ArianeGroup. Pour le programme de frappe longue portée terrestre (FLP-T), Safran s’est associé à MBDA et Thales à ArianeGroup, alors que MBDA et Thales sont coproducteurs dans le cadre du système intégré d’autoprotection pour l’avion de combat Rafale SPECTRA. Représentante du ministère des Armées auprès de ces industriels, la DGA constitue au sein de cet écosystème un acteur pivot.
Pour Hervé Guillou, président d’Exail18 et ancien PDG de Naval Group « le rôle de la DGA en tant qu’interlocuteur exclusif pendant l’ensemble du cycle de vie du matériel, de la conception à la mise en service opérationnelle et jusqu’au démantèlement, participe à améliorer la prise en compte de la politique industrielle et des exigences de souveraineté dans le processus d’achat public, élément clé pour améliorer les performances du processus d’acquisition. »
La fluidité des interactions s’enracine notamment dans la proximité culturelle et relationnelle des individus. Ils sont en effet nombreux à partager le même cursus, celui des ingénieurs de l’armement formés dans des écoles militaires prestigieuses telles que l’École polytechnique ou l’École nationale supérieure de techniques avancées (ENSTA), (Moura, 2020). Les réseaux des ingénieurs de l’armement sont ainsi constitués dès l’école, sous le pilotage et la supervision de la DGA qui s’assure de la cohésion des groupes et de la cohérence des compétences. La DGA exerce d’ailleurs la tutelle de plusieurs établissements d’enseignement supérieur et de recherche (École polytechnique, ISAE, ENSTA ParisTech et ENSTA Bretagne), ce qui renforce ce lien étroit, au fur et à mesure des promotions, entre les sphères publique et privée et contribue à créer un esprit de corps au sein de la défense (Moura, 2020). Le conseil général de l’armement gère en outre l’ensemble de la population des ingénieurs de l’armement exerçant en dehors des structures ministérielles. Dès lors, les ingénieurs de la DGA ont la capacité de mobiliser un réseau étendu dans l’ensemble du secteur industriel. Surtout, Patrice Daste, ancien PDG de la PME stratégique Alsymex, évoque « un état d’esprit axé sur la défense de l’intérêt général, en cohérence avec une mission de service public et de souveraineté française, tout en veillant à la qualité de la chaîne de valeur ». Il reconnaît à cet égard l’utilité du travail des partenaires institutionnels, comme l’Institut de hautes études de défense nationale (IHEDN), qui s’efforcent d’entretenir cet état d’esprit.
- 2 — Le Groupement des industries de construction et activités navales (Gican) est un syndicat professionnel qui fédère plus de 320 industriels et organisations du secteur maritime français. Issu de la Chambre syndicale des constructeurs de navires et de machines marines de 1899, il a été officiellement créé en 1992 afin de regrouper les acteurs français présents à l’Exposition française des matériels pour les forces navales et aéronavales (exposition créée en 1968 à l’initiative de la Marine nationale) et de favoriser la promotion des matériels et services navals et aéronavals de ses membres.
- 3 — Cet ensemble comprend : Airbus Defence & Space, Thales, Safran, MBDA, Naval Group, Dassault Aviation, ArianeGroup, Nexter, Arquus. On peut également inclure le CEA, un établissement public de recherche à caractère industriel et commercial.
- 4 — En parallèle, des penseurs comme Hobbes ou Weber apportent des justifications philosophiques à l’intervention de l’État en matière de défense, par l’exercice exclusif « de la violence légitime ». L’État peut en effet assurer sa défense et protéger ses intérêts par la création et la supervision de forces armées qui exercent la violence à sa place. Toutefois, ces réflexions n’expliquent pas l’intervention économique de l’État dans cette activité.
- 5 — Les dépenses militaires représentent les coûts engagés par un État pour assurer sa défense et sa sécurité nationale. Elles incluent les salaires du personnel, l’achat d’équipements, les opérations et la maintenance, la construction d’infrastructures militaires, ainsi que la R&D. Fontanel (2021) rappelle les limites de cette définition, qui varie d’un pays à l’autre en raison de la divergence des législations, de la nature et de la quantité de renseignements rendus publics, du secret militaire, des méthodes de fixation des prix. Les comparaisons internationales sont donc à considérer avec précaution.
- 6 — Les missions budgétaires relevant du ministère des Armées sont la mission « Défense », la mission « Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation », ainsi que le programme « Recherche duale (civile et militaire) » de la mission interministérielle « Recherche et enseignement supérieur ». Outre l’acquisition d’équipements, cette mission « Défense » intègre les dépenses pour les activités opérationnelles des militaires, la prospective, le renseignement, etc.
- 7 — Le programme 178 (« Préparation et emploi des forces ») assure la conduite des opérations et la préparation des forces dans un cadre organique cohérent sous la supervision du CEMA. Le programme 144 regroupe les actions « Recherche et exploitation du renseignement intéressant la sécurité de la défense », « Prospective de défense » et « Relations internationales et diplomatie de défense », piloté par la Direction générale des relations internationales et de la stratégie.
- 8 — PME issue d’une joint-venture détenue par Thales, Nexter et Safran afin de développer les outils des programmes relatifs au combat collaboratif aéroterrestre.
- 9 — Les LPM sont conditionnées aux lois de finances. Buffotot (2016) constate des écarts entre les prévisions de la LPM et le budget adopté, notamment entre 1984 et 2014.
- 10 — Renaud Bellais est également chief economist de MBDA, mais ses propos n’engagent pas l’entreprise.
- 11 — Jusqu’en 1996, la dissuasion était aussi portée par la composante terrestre.
- 12 — Données issues de l’Otan et exprimées en prix constant de 2015.
- 13 — Le renforcement du renseignement ainsi que l’opération militaire Sentinelle menée sur le sol français sont intégrés à la mission « Défense ».
- 14 — Il s’agit des composantes terrestre (démantelée sous la présidence de Jacques Chirac), océanique (les sous-marins nucléaires lanceurs d’engins) et aéroportée (le Rafale et les ravitailleurs stratégiques).
- 15 — Il s’agit notamment du Commissariat à l’énergie atomique (CEA), du Centre national d’études spatiales (Cnes), de l’Office national d’études et de recherches aérospatiales (Onera) ou encore l’Institut franco-allemand de recherches de Saint-Louis, spécialisé dans les domaines de la défense et de la sécurité civile.
- 16 — Ces données sont issues de la base Sandie (Statistiques annuelles sur la défense, son industrie et ses entreprises) et collectées par l’Observatoire économique de la défense (OED).
- 17 — Elles confirment naturellement la centralité du ministère des Armées dans cette configuration, en tant qu’unique client des systèmes d’armement.
- 18 — ETI spécialisée dans la robotique maritime et les systèmes de navigation.
Point de vue – Quels sont les effets économiques des dépenses militaires ?
Par Julien Malizard
Pour répondre à cette question, il convient d’étudier les particularités des dépenses de défense et du multiplicateur associé (quel est l’effet sur l’activité économique d’une augmentation des dépenses publiques de défense). En France, la politique de défense menée depuis 1958 vise à réduire le plus possible les dépendances extérieures. Les moyens budgétaires sont élevés (environ 2 % du PIB pour 2025) et, pour préserver les avantages technologiques des armées, la part de la recherche et développement dans le budget de défense est importante (supérieure à 10 %). Grâce à un budget d’équipement substantiel, l’acquisition d’armement est essentiellement concentrée autour de groupes industriels français.
Dans ce contexte, plusieurs études récentes ont confirmé l’existence d’un multiplicateur supérieur à un, bien qu’il soit faible à court terme (Malizard, 2011). On peut donc y voir l’existence d’effets « d’offre », par opposition à des effets « de demande » qui seraient ici non-existants : l’impact économique se matérialisant avec le temps, cela suggère une transformation de la structure économique plutôt qu’une consommation immédiate. Par ailleurs, sur le long terme, le multiplicateur de la dépense militaire serait supérieur à celui des autres dépenses publiques (Malizard, 2013). D’autres études portant sur le cas américain aboutissent à une estimation similaire du multiplicateur (Antolin-Diaz et Surico, 2025).
Plusieurs raisons permettent d’expliquer ces résultats. Tout d’abord, le ministère des Armées est le premier investisseur public, notamment via le programme 146 « équipements des forces ». Ainsi en 2024, il représentait près de 80 % des investissements publics des administrations publiques centrales (APUC). Le comportement du multiplicateur mentionné plus haut est donc cohérent avec celui des investissements publics, avec des effets faibles voire inexistants à court terme mais favorables sur le long terme. Par ailleurs, il existe une complémentarité entre les dépenses d’équipement de défense et l’investissement privé (Malizard, 2015) : il y a donc un effet d’entraînement sur la structure économique privée parce que le secteur des équipements de défense est hautement capitalistique. Ensuite, les entreprises qui fournissent le ministère des Armées sont essentiellement françaises (en 2021, à hauteur de 84 % des achats, selon Place et Ng, 2025). Ainsi les dépenses militaires irriguent essentiellement le tissu productif national et en particulier les grands groupes de défense, leaders européens et mondiaux sur leurs segments respectifs. Enfin, le secteur de la défense est central dans la R&D française : environ 25 % des dépenses de R&D du secteur privé en France sont liés à la défense (Belin et al., 2019). Le financement public vient soutenir une part majeure de cet effort. De nombreux travaux portant sur le cas américain valident d’ailleurs l’idée de « débordements technologiques » du secteur de la défense vers le secteur civil (Ruttan, 2006).
En conclusion, il apparait que la qualité des dépenses militaires est primordiale pour expliquer ses effets positifs sur l’économie française : les investissements consentis irriguent un secteur industriel productif avec peu de fuites vers l’extérieur. Les dépenses militaires futures, justifiées par l’instabilité internationale et les nouvelles formes de conflictualité, sont orientées à la hausse dans le cadre de la loi de programmation militaire 2024-2030. Leur composition étant relativement inchangée, leurs effets économiques seront probablement identiques.
Une base industrielle restructurée et active à l’export
L’affaiblissement de la commande publique et le recul des impératifs militaires après la fin de la guerre froide ont rendu nécessaire une restructuration de l’industrie française de défense. Les entreprises ont alors entamé une consolidation de leurs activités et se sont tournées vers l’export, devenu leur principale source de croissance.
La consolidation de la base industrielle au profit de la compétitivité
Des restructurations pour atteindre une taille critique
La privatisation du Groupement industriel des armements terrestres (GIAT)19 en 1990, devenu Giat industrie puis aujourd’hui KNDS, marque le début d’une vague de privatisations et de concentrations au sein de l’industrie française de défense. Ce double mouvement découle à la fois de la contraction de la commande publique, évoquée au chapitre précédent, et de la complexification des systèmes de défense du fait de l’intensification des innovations technologiques (Lazaric et al., 2009), qui accroît les coûts de production (Bellais, 2011 ; Devaux et al., 2019).
D’un côté, l’État a encouragé ces dynamiques afin de préserver les capacités industrielles du pays dans un contexte d’affaiblissement de la dépense militaire. C’est ainsi qu’il s’est entouré de MOI, grands groupes ayant la responsabilité de concevoir et d’assurer le suivi des systèmes sur l’ensemble de leur cycle de vie. De l’autre côté, les industriels soumis à des contraintes économiques ont cherché à renforcer leurs positions. Ils ont donc intégré des activités complémentaires pour atteindre une taille critique afin d’amortir leurs coûts fixes et de gagner en compétitivité à l’international (Devaux et al., 2019). Les programmes d’armement se distinguent en effet par le poids de leurs investissements initiaux : R&D permettant l’utilisation de technologies de pointe, installations pour fabriquer des sous-marins ou des missiles ou encore, dans le cas d’Aubert et Duval, presse de 65 000 tonnes pour pouvoir travailler des matériaux métalliques complexes…
Le budget d’équipement des forces armées s’amenuisait déjà dans les années 1980, en termes réels, face à l’inflation des coûts de production des systèmes de défense – estimée à 5 %, voire 8 % dans cette décennie, en unités monétaires constantes, par Cornu et Dussauge (1998). Cette hausse des prix a été exacerbée par l’inflation des matières premières et le coût du travail tandis que les spécifications et exigences ont continué de s’accroître. Par exemple, Lefeez (2013) estime qu’un avion Mirage 2000 monoplace mis en service dans les années 1980 avait un coût unitaire de 9,4 millions d’euros, exprimé en euros constant de 2010, à comparer à 50 millions d’euros (toujours de 2010) pour un Rafale monoplace. Pour sa part, le coût de développement d’un nouveau modèle d’avion est passé de 7 à 12 milliards de dollars par génération (ibid.). Cette hausse significative des coûts de production avait déjà été examinée aux États-Unis dans les années 70 par Norman Augustine, ancien directeur de Lockheed Martin et ancien secrétaire de l’US Army. La seizième « loi d’Augustine » fait référence à l’estimation de ce dernier qui prédit qu’en 2054, le budget américain ne permettra plus que l’acquisition d’un seul avion tactique si l’évolution des coûts unitaires et l’augmentation du budget continuent sur leurs tendances respectives.
Le cas du char Leclerc, conçu pour anticiper un affrontement potentiel entre l’Ouest et l’Est, illustre par ailleurs comment la réduction des volumes commandés peut exercer une vive pression sur les coûts unitaires. Au terme de la guerre froide, le nombre de chars Leclerc commandés est en effet passé de 1 200 à 406. Cette baisse drastique des volumes a mis en péril le respect du budget du programme. Dans un rapport de 2001, la Cour des comptes estime le coût d’acquisition de chacun des 406 chars Leclerc à 104,3 millions de francs (prix constant 2000), soit 15,91 millions d’euros, ce qui est presque sept fois supérieur au prix unitaire initial de 15 millions de francs (prix constant 1982), soit 2,29 millions d’euros, prévu pour 1 200 chars20.
La diminution des volumes produits augmente donc les coûts unitaires, contraignant la commande publique et réduisant le nombre d’entreprises capables de répondre à ces exigences (Lefeez, 2013).
Le mouvement de restructuration des industries de défense a atteint son apogée à la fin des années 1990 et au début des années 2000 : remembrement en 1998 des activités d’Aerospatiale, Alcatel, Dassault et Thomson-CSF, respectivement dans l’électronique et le spatial, dont Thomson-CSF (bientôt rebaptisé Thales) ressort à la fois privatisé et conforté dans le domaine de l’électronique de défense ; fusion Aerospatiale Matra la même année ; privatisation partielle de Naval Group en 2003 ; fusion de la Snecma et de la Sagem pour donner naissance à Safran en 2005…
À partir des années 2000, ces consolidations d’entreprises s’étendent au niveau européen. Ainsi, même si le consortium européen Airbus existe depuis 1970, on voit émerger en 2000 le nouveau groupe européen EADS (futur Airbus Group), acteur majeur de l’aéronautique, à la suite du regroupement d’Aerospatiale Matra, Daimler-Chrysler Aerospace et Construcciones Aeronáuticas. De même, la création de MBDA donne naissance à un missilier européen capable de rivaliser avec Raytheon et Lockheed Martin. Le groupe KNDS, dans les activités terrestres, naît quant à lui en 2015 du rapprochement de Nexter et KMW. Ces restructurations élèvent les barrières à l’entrée du marché, protégeant les groupes historiques ainsi renforcés de nouveaux concurrents (Devaux et al., 2019).
Elles n’entraînent pas pour autant un retrait total de l’État français, qui exerce encore un contrôle majoritaire et direct sur plusieurs groupes clés de défense. Parmi ceux-ci, on trouve KNDS et Naval Group, deux entreprises issues des arsenaux de l’État (Masson et Paulin, 2007). Les participations publiques atteignent des niveaux significatifs sans être majoritaires dans plusieurs entreprises stratégiques. Par exemple, l’État français détient 26 % du capital de Thales, 11 % du capital de Safran et 10 % du capital d’Airbus Defence & Space.
Une industrie européenne toujours plus fragmentée que son homologue américaine
À l’échelle européenne, ces restructurations restent toutefois partielles, au sens où l’on est encore loin d’un regroupement continental des activités par segment de marché. Rien que chez les avionneurs, on trouve cinq grands plate-formistes intégrateurs (EADS, British Aerospace, Finmeccanica, Dassault et SAAB). Du côté des systémiers équipementiers, on dénombre au moins huit acteurs : Thales, Safran, Smiths Aerospace, Cobham, Ultra Electronics, Indra Sistemas, Leonardo et Hensoldt. Cet état de fait résulte du cloisonnement des marchés nationaux, les réglementations spécifiques au commerce de biens à usage miliaire s’ajoutant aux préférences nationales dans les choix d’acquisition (Devaux et al., 2019) et à la répartition encore très hétérogène des dépenses militaires entre États membres. Si la France et le Royaume-Uni investissent davantage, les efforts de défense de l’Allemagne et de l’Italie sont nettement plus faibles depuis 1992 (cf. Chap. 1).
Liens capitalistiques des 9 MOI
Source : Calepin des entreprises, DGA (2025).
Aux États-Unis, par comparaison, cinq grands groupes ont émergé des efforts de consolidation du secteur21. Or l’effort budgétaire américain est largement supérieur à celui de l’UE : ces cinq donneurs d’ordre bénéficient en effet d’un marché domestique de 875 milliards de dollars en 2023 (d’après les données de l’Otan), quand la dépense militaire de l’UE s’élève à 227 milliards d’euros la même année selon Eurostat. Dans le seul cas du spatial, les investissements européens de l’ESA (European Space Agency) et des principaux pays actifs dans ce domaine (Espagne, France, Allemagne, Italie et Royaume-Uni) représentent en moyenne 2,8 milliards d’euros par an entre 2020 et 2023, contre 7,3 milliards d’euros aux États-Unis (Draghi, 2024).
Les dix premiers groupes européens et américains (CA militaire, 2023)
Source :SIPRI Top 100.
Note de lecture : Les acteurs européens comprennent les entreprises européennes hors UE (ex : Royaume-Uni).
Les groupes européens de défense ont donc encore aujourd’hui une taille inférieure à celle de leurs concurrents américains, leur capacité d’investissement en R&D s’en trouvant d’autant plus morcelée, alors que ces investissements doivent dépasser un certain seuil pour faire naître de nouvelles technologies. De même, faute d’un effet de série suffisant, l’absorption des coûts fixes maintient des coûts unitaires relativement plus élevés que dans la BITD américaine (Dupuy, 2013 ; Draghi, 2024). Cette fragmentation tend à affaiblir le pouvoir de marché des entreprises européennes tout en réduisant l’efficacité de leur effort d’innovation. Selon Briani (2013), pour un grand projet en cours aux États-Unis, l’Europe en conduit trois ; il estime le gaspillage des ressources qui en résulte à plus de 120 milliards d’euros par an. Tout à la fois symptôme et cause de ce déséquilibre, le marché américain demeure fermé aux produits européens, tandis qu’on observe chez certains partenaires européens de la France une préférence pour l’acquisition d’équipements américains, comme le souligne le rapport Draghi : 78 % des matériels militaires achetés par les États membres de l’UE proviennent de fournisseurs extérieurs à l’Union européenne, dont 63 % d’entreprises américaines.
Au final, le chiffre d’affaires des dix premières entreprises de défense européennes équivaut au quart de celui des dix premières entreprises américaines (fig. 2.2), ce qui peut fragiliser leur position face à des concurrents provenant de Chine, de Russie ou de Corée du Sud.
Le succès à l’export, reflet de la compétitivité et
des ambitions nationales
À l’export, un succès impératif pour pallier la baisse de la demande nationale
La défense est un des rares secteurs industriels à contribuer positivement à la balance commerciale de la France : s’il n’est pas possible de suivre cette statistique année après année dans les données générales de l’Insee22, l’Observatoire économique de la défense (OED) (EcoDef nº 240, 2024) a établi que l’excédent commercial des matériels de guerre et produits liés avait atteint 10,2 milliards d’euros en 2021 (fig. 2.3). Cette même année, le commerce extérieur de la BITD représentait près de 10 % des exportations françaises contre 4 % seulement des importations. Les entreprises de la BITD sont même plus compétitives que leurs homologues comparables : les premières et les secondes exportent respectivement 14,6 % et 10,4 % de leur chiffre d’affaires sur la période 2010-2012, selon Belin (2015)23.
Pour être plus précis, l’intensité des exportations est plus élevée lorsque la part militaire du chiffre d’affaires de l’entreprise dépasse 20 % (Ramet, 2020)24.
Ces exportations sont principalement imputables aux plus grandes entreprises, très ouvertes à l’international (Ramet, 2020) : 90 % des ventes sont réalisées par moins de 2 % des sociétés exportatrices. Les PME ne sont pas absentes, puisqu’elles constituent 40 % des entreprises exportatrices de la BITD, mais leur part du chiffre d’affaires est donc nettement inférieure (ibid.). L’existence de liens financiers avec les marchés étrangers apparaît comme un facteur facilitant ces ventes, qu’il s’agisse de filiales créées localement ou de transferts de technologie conclus dans les contrats à l’export (Hérault, 2018). Dans les deux cas, cela procure un avantage supplémentaire aux plus grandes entreprises pour exporter.
Si l’on raisonne par produit, les exportations françaises sont principalement tirées par les aéronefs (fig. 2.4). Selon l’OED (EcoDef nº 240, 2024), les aéronefs, les systèmes de propulsion et les appareils de détection contribuent à hauteur de 70 % à l’excédent commercial français sur les matériels de guerre et les produits liés en 2022. Les commandes de ces aéronefs proviennent principalement du Moyen-Orient et du reste du continent asiatique.
Le solde commercial des matériels de guerre et produits liés
Sources : Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI). Traitement OED.
Note de lecture : En 2021, l’excédent commercial des matériels de guerre et produits liés est de 10 226 millions d’euros.
Champ : Échanges CAF/FAB de matériels de guerre et produits liés.
Part des catégories d’armes dans les exportations françaises (en valeur)
Source : SIPRI Arms Industry Database. Traitement La Fabrique de l’industrie.
Note : La mesure en valeur du SIPRI (nommée trend-indicator value ) est estimée à partir des coûts de production unitaire connus d’un ensemble d’armes de base, afin d’évaluer le montant du commerce d’armes plutôt que la valeur financière de l’exportation ou de l’importation et en prenant en compte les spécificités techniques. De cette façon, il est possible de comparer les transferts d’armes entre pays sur le long terme.
Cette performance des entreprises françaises à l’export est certes liée, pour partie, à la conjoncture géopolitique. D’un côté, l’instabilité mondiale accroît la demande en biens militaires25 quand, de l’autre, la guerre en Ukraine concentre l’effort d’armement russe sur ses propres capacités, la Russie se déclassant en troisième position des pays exportateurs d’armes (fig. 2.5). Toutefois, ce succès s’explique également par une compétitivité intrinsèque des entreprises françaises de défense. Une bonne manière de l’illustrer est de souligner qu’en moyenne, sur la période 2015-2024, la France consacre 2 % de son PIB à la dépense militaire, ce qui est très proche du Royaume-Uni par exemple, mais représente plus de 9 % des exportations mondiales de matériel, ce qui est plus du double de notre proche voisin.
On peut voir également cette ouverture française aux exportations comme le fruit d’une politique industrielle délibérée, et menée en l’occurrence avec succès. En effet, dès lors que la commande publique n’était plus suffisante pour assurer la rentabilité des programmes nationaux d’armement, l’exportation est apparue comme un relais de croissance nécessaire au maintien des entreprises sur le marché – et donc à l’entretien à long terme de l’autonomie stratégique des armées françaises (Bellais et al., 2014).
Part mondiale des exportations, par pays et par période, entre 1980 et 2024
Source : SIPRI Arms Industry Database.
Si l’on considère le cas du Rafale, les 26 livraisons prévues par la LPM 2014-2019 (soit 5,2 par an) ou encore les 42 appareils mentionnés dans la LPM 2024-2030 (soit 7 par an) sont bien inférieurs aux 11 unités annuelles contractuellement garanties pour le maintien de l’activité de la chaîne de production par Dassault (Hérault, 2015). Pour Jean-Marie Dumon, « ce n’est qu’à ce prix [pour répondre aux marchés internationaux] que l’on peut envisager d’investir dans le maintien et l’expansion des infrastructures, lourdes et coûteuses mais indispensables à la construction [de systèmes de défense] comme les gros navires ». Ce relais de croissance est d’autant plus important que, « en l’absence d’activité productive, les compétences se perdent et compromettent ainsi l’autonomie des forces armées ». Arnaud Génin, directeur intelligence stratégique de Naval Group, prend l’exemple des chantiers de Cherbourg (sous-marins) et de Lorient (frégates) : les contrats à l’export permettent de maintenir l’activité des bureaux d’études, les compétences et les plans de charge industriels entre les programmes nationaux.
POLITIQUES D’EXPORTATION D’ARMEMENT DES ÉTATS ET DÉPENDANCE DE LA BITD
Les divergences entre États s’expliquent par l’interaction entre des facteurs externes (le positionnement dans la hiérarchie internationale des producteurs d’armement et le degré de sensibilité aux pertes de puissance relative qui en découle) et internes (le degré de dépendance à l’exportation de la base industrielle de défense). Plus un État se situe haut dans la hiérarchie internationale des producteurs d’armement, plus il sera sensible aux gains relatifs qu’un État client pourra réaliser en termes de puissance relative, et donc plus il sera restrictif dans sa politique de ventes d’armes. À l’inverse, un État se situant dans une position plus basse dans la hiérarchie des producteurs d’armement sera moins sensible aux gains relatifs, et sera donc plus permissif dans sa politique d’exportation. Sur le plan interne, plus l’industrie de défense d’un État est dépendante des exportations, moins sa politique d’exportation est restrictive, et inversement.
Ces deux facteurs [permettent] d’établir une typologie qui dégage quatre types d’États exportateurs (hégémon, gardien, marchand et importateur) et explique les arbitrages différenciés entre considérations stratégiques et économiques dans les politiques d’exportation d’armes. [Ces hypothèses sont] testées sur deux catégories (hégémon et gardien) à partir des cas américain et français, et en particulier leurs réformes du contrôle des exportations de matériel de guerre et l’embargo vers la Chine. Ces cas d’études [confirment] les hypothèses émises. L’“État hégémon” (États-Unis) est peu contraint par les enjeux économiques et donc en mesure d’accorder la priorité aux considérations stratégiques, renforcées par sa forte sensibilité aux pertes relatives issues des exportations d’armement. En revanche, l’“État gardien” (France), tout en ayant une sensibilité aux pertes relatives, ne peut pas de la même manière donner la priorité aux considérations stratégiques en raison de la forte dépendance à l’exportation de son industrie de défense. »
In Béraud-Sudreau et Meijer (op. cit.).
Envisagées sous cet angle, les exportations sont donc autant la marque de la compétitivité de la BITD que celle de sa dépendance aux marchés étrangers. Béraud-Sudreau et Meijer (2016) proposent une analyse comparée sur ce point. Ils appellent « dépendance aux exportations » d’une industrie de défense nationale le ratio entre les ventes à l’étranger et les ventes totales (équivalentes aux acquisitions étatiques auxquelles on ajoute les exportations et soustrait les importations). Ils obtiennent un niveau de dépendance à l’export de 30 % pour la BITD française, de 38 % pour l’industrie allemande, de 25 % pour l’industrie britannique, et de 18 % pour l’industrie américaine (voir encadré). Ce résultat confirme l’importance des débouchés à l’export dans le modèle économique actuel de l’industrie française de défense.
Quoi qu’il en soit, ce succès à l’exportation se traduit par un classement mondial très honorable : selon les données du SIPRI, la France se classe au troisième rang en prenant la moyenne de parts d’exportations de 1980 à 2024, mais se hisse à la deuxième place en moyenne sur la période 2020-2024, du fait du retrait des exportations russes. Sur la période 2015-2024 (fig. 2.5), sa part de marché dépasse légèrement 9 %, contre 5,6 % pour l’Allemagne et 3,5 % pour le Royaume-Uni. En revanche, les industriels américains dominent nettement le marché : ils concentrent en effet 47 % des exportations et 50 % du chiffre d’affaires des 100 plus grandes entreprises en 2023, tandis que leur marché intérieur représente 40 % des dépenses militaires mondiales.
Un succès qui traduit et incarne les ambitions politiques de la France
Naturellement, le matériel militaire ne s’exporte pas comme une commodité ; les contraintes politiques et juridiques encadrant cette activité sont au contraire très fortes. Comme le rappelle Nicolas Grangier, chef du service de la sécurité économique de la direction de l’industrie de défense (DID), « la règle de base est le régime de la prohibition, et les autorisations ne sont que l’exception ». Toute exportation de technologie ou de produit à usage militaire est en effet soumise à autorisation gouvernementale, moyennant l’octroi d’une licence.
Dans le cadre d’un appel d’offres étranger pour l’acquisition d’un système d’armes, l’exportateur signe donc un contrat avec le pays importateur sous réserve de l’aval des autorités nationales. En France, avant d’accorder toute autorisation, les services du Premier ministre recueillent les avis des ministères concernés, Bercy ou le Quai d’Orsay. Charles Maisonneuve tient à souligner « le suivi rapproché qui est imposé par le SGDSN, Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale, par lequel tout exportateur doit faire une demande d’autorisation pour vendre à l’étranger ses systèmes d’armements ».
Les contrats peuvent notamment inclure des clauses de transfert technologique, qui deviennent autant d’outils diplomatiques facilitant la formation d’alliances entre les nations : notre pays exporte alors du matériel militaire en contrepartie d’une part de contenu local. Par exemple, dans le cadre du contrat à l’export de six sous-marins de classe Scorpène entre Naval Group et l’Inde, celle-ci souhaitant développer ses propres capacités industrielles de défense a obtenu un transfert technologique couvrant la majeure partie de la plateforme, réalisée par le chantier naval indien MDL (Hérault, 2018). Pour Nicolas Grangier, « tout l’enjeu [des contrats à l’export] est de sécuriser la chaîne de valeur et d’éviter les effets négatifs engendrés par les offsets (les transferts de technologie prévus par contrat) ». Les transferts technologiques peuvent en effet réduire l’intérêt du contrat en tant que relais de croissance si la fabrication a lieu hors de France et qu’elle présente le risque de nourrir la concurrence future (ibid.).
Pour toutes ces raisons, les contrats d’exportation s’inscrivent dans la politique étrangère de la France et dans l’entretien d’alliances stratégiques (Cour des comptes, 2023). Il s’agit donc d’un marché « éminemment géopolitique », comme rappelle Martine Poirmeur, déléguée générale adjointe à la défense du Gicat26. Pour Charles Maisonneuve, « l’exportation d’armement français ne se réduit pas à un objectif commercial mais s’inscrit dans une ambition étatique volontariste d’élargissement du soft power français, par la signature de contrats d’exportation bilatéraux. En effet, les compétences industrielles de la BITD s’apparentent à un outil de la politique étrangère française pour créer ou soutenir des alliances stratégiques, par l’équipement et la formation des forces armées étrangères. »
Pour preuve, les présidents successifs depuis Nicolas Sarkozy ont été très actifs dans la promotion du matériel militaire français à l’étranger, que ce soit lors de déplacements officiels ou en accueillant des délégations étrangères au salon de l’aéronautique du Bourget. Hoeffler et al. (2021) affirment par exemple que leur action a contribué au succès à l’export du Rafale, dont le premier contrat date de 2014 (vente de 24 appareils à l’Égypte). Outre la présidence de la République, le ministère des Armées et les ambassades françaises ont également pris toute leur part dans ces succès à l’export.
En revanche, ces pourparlers peuvent être longs : Arnaud Génin rappelle que « les contrats conclus avec la Grèce en 2022, comprenant trois frégates FDI et six Rafale équipés, ont été acquis après de très longues années de négociations ». Ils peuvent également tourner court : le contrat d’acquisition des navires Mistral par la Russie a ainsi été annulé sous François Hollande en 2014, en raison de divergences politiques (Hoeffler et al., 2021).
En outre, ces démarches diplomatiques se heurtent, elles aussi, à une concurrence exacerbée, du fait du faible accès au marché intérieur des États-Unis et de l’émergence de nouveaux acteurs (Chine, Brésil, Turquie, Corée du Sud…). Tout particulièrement, la diplomatie américaine n’hésite pas, tant s’en faut, à utiliser elle aussi les exportations d’armement comme des éléments d’alliance stratégique venant répondre aux besoins sécuritaires de ses partenaires (Droff et Malizard, 2023). Par exemple, les pays acquérant le F-35 deviennent des relais de la stratégie de dissuasion des États-Unis, certains comme les Pays-Bas ou la Belgique étant les hôtes de missiles nucléaires.
- 19 — Le GIAT est issu de la Direction technique des armements terrestres (DTAT), une des trois divisions techniques rattachées à la DGA.
- 20 — Cette différence de coût unitaire est si importante que le coût total d’achat de 406 chars serait près du double de ce qui était prévu pour en acquérir 1 200. Une fois l’inflation prise en compte, 15 MF de 1982 donnent 25,8 MF en 2000. Par ailleurs, le rapport d’information de la commission de la défense nationale et des forces armées (Bernard et Carré, 2004) fait état d’une augmentation des coûts variables unitaires de production de 7,68 à 8,41 millions d’euros, hors coûts fixes. L’essentiel de la dérive du coût unitaire du char Leclerc relève donc d’autres explications. L’amortissement de coûts fixes sur des volumes plus réduits ne peut en représenter qu’une partie.
- 21 — Les consolidations entre 1990 et 1998 de la base industrielle états-unienne ont créé cinq principaux contractants : Lockheed Martin (aérospatial, missilier, système électronique), RTX (aérospatial, aéronaval et électronique), Northrop Grumman (aérospatial, cybersécurité et électronique), Boeing (aérospatial), General Dynamics (terrestre, naval et aérospatial) (Depeyre et Dumez, 2009).
- 22 — Pour rappel, l’industrie de la défense ne correspond pas à une classification comptable, mais à un ensemble de filières dont certains biens sont à usage militaire. Par ailleurs, le secret-défense et le secret statistique font que les données Insee sur les produits d’armement ne sont pas accessibles.
- 23 — Belin (2015) identifie le groupe « défense » à partir des paiements effectués par la DGA, et le groupe de contrôle est constitué d’entreprises aux caractéristiques similaires et sélectionnées aléatoirement.
- 24 — Données issues de la Direction générale des douanes et droits indirects et de l’enquête sur les entreprises des industries de défense (EID), menée par l’Observatoire économique de la défense (OED) pour les années 2016 et 2017.
- 25 — Si 60 % des unités légales de la BITD déclaraient souffrir d’une demande insuffisante début 2021, elles n’étaient plus que 20 % en 2024 (EcoDef nº 260, 2025).
- 26 — Le Groupement des industries françaises de défense et de sécurité terrestres et aéroterrestres, créé en 1978, regroupe 480 adhérents, dont 2 % de grandes entreprises, 19 % d’ETI et 79 % de PME/TPE.
Point de vue – Qu’est-ce qu’une économie de guerre ?
Par Alain Quinet – Économiste, auteur d’Économie de la guerre (éd. Economica, 2023).
Alors qu’Emmanuel Macron a déclaré depuis juin 2022 le passage à une « économie de guerre », puis à un « effort de guerre » le 14 juillet 2025, l’économiste Alain Quinet apporte dans ce commentaire un éclairage sur ce concept et ses implications économiques.
C’est à l’ombre des guerres du xxe siècle que s’est forgé le concept d’économie de guerre, pour désigner le système économique d’exception mis en place par les belligérants. Les deux « pères fondateurs » de l’économie de guerre sont deux économistes d’obédiences très différentes : d’un côté le socialiste autrichien Otto Neurath, membre du cercle de Vienne, de l’autre le libéral anglais John Maynard Keynes.
Otto Neurath souligne l’enjeu économique de la mobilisation et le changement radical de perspective que celle-ci implique : « En temps de paix, toutes les énergies ne sont pas pleinement utilisées, la guerre le permet parfois. La raison est qu’en temps de guerre la production prime sur la rentabilité. » Keynes, pour sa part, signale les exigences macroéconomiques de cette mobilisation, pour éviter que l’envolée des dépenses militaires ne dégénère en inflation galopante : « L’économie de guerre, c’est le passage de l’abondance à la pénurie. »
Les dépenses militaires de temps de paix sont généralement inférieures ou égales à 3 % du PIB. Elles franchissent ce seuil en phase de réarmement pour atteindre un tiers, voire la moitié du PIB en cas d’affrontement majeur. Pour autant, l’entrée en économie de guerre ne se résume pas à une augmentation de budget de défense et de la production d’armement. C’est un changement plus radical de système économique.
La mise entre parenthèses des règles économiques de temps de paix
Une économie de guerre doit assumer deux ruptures. La première est celle de la mobilisation massive et rapide des ressources humaines et industrielles. Les objectifs de production de biens essentiels à la défense prennent le pas sur les objectifs individuels de bien-être et de rentabilité. La seconde réside dans la mise entre parenthèses du cadre macroéconomique traditionnel : la politique budgétaire libère les crédits nécessaires pour la défense, l’État s’endette, la Banque centrale assure la liquidité de la dette, maintient des taux d’intérêt bas et fournit si nécessaire un financement monétaire.
Les politiques économiques ne peuvent toutefois ignorer les effets inflationnistes induits par la chute de la production civile et l’envolée du prix des matières premières énergétiques et alimentaires. Dans ce cadre, la politique budgétaire a vocation à contenir la demande spontanément supérieure à l’offre réduite de biens civils. Dans cette perspective, l’économie de guerre se traduit par la mise en place d’une fiscalité fortement progressive : même aux États-Unis, le taux marginal d’imposition sur le revenu est monté à 90 % lors de la Seconde Guerre mondiale. Elle se traduit aussi par des incitations à l’épargne fléchée sur la défense à travers des emprunts de guerre. Keynes recommandait d’aller plus loin et de recourir à l’épargne obligatoire pour financer la dette publique et contenir la demande, en sus de l’épargne volontaire.
L’économie de guerre aujourd’hui
Le terme d’économie de guerre est aujourd’hui employé de manière générique dans un sens très large, chaque fois que les priorités de la politique publique se déplacent de la recherche du plus haut niveau de prospérité vers des objectifs d’autonomie stratégique, de réarmement et de résilience.
Clausewitz disait que « la guerre est un caméléon ». Elle prend aujourd’hui de fait deux formes distinctes : l’affrontement majeur, tel qu’on le voit en Ukraine, et les menaces hybrides qui se matérialisent sur notre sol (cyberattaques, sabotage d’infrastructures, mesures de coercition économique réduisant nos accès à certains matériaux critiques, désinformation amplifiée par l’intelligence artificielle). Face à ces menaces, l’enjeu clé aujourd’hui est de réarmer à des coûts maîtrisés en tirant profit de l’échelle européenne et des nouvelles technologies digitales.
La supériorité technologique, point de rencontre des exigences étatiques et économiques
La supériorité technologique du matériel d’armement constitue un objectif cardinal pour les acteurs de la filière. D’une part, elle est devenue décisive pour assurer aux armées un rapport de force favorable et maintenir l’influence internationale de la France. D’autre part, elle est déterminante pour conquérir des marchés à l’export et concourt donc à la compétitivité des entreprises de la BITD. Cela requiert d’importants investissements en R&D, qui ont sensiblement décru depuis 1990 bien qu’on observe une nette reprise depuis 2017-2018.
Une exigence de l’État-client
La crédibilité des armées et de l’État dépend de la supériorité technologique
La guerre en Irak menée par les États-Unis en 2003 a marqué un tournant dans les stratégies militaires, qui considéraient jusqu’alors que la puissance d’une armée était déterminée à parité par sa technologie et ses effectifs. Grâce à l’emploi massif d’armes de précision, 250 000 soldats américains, deux fois moins nombreux que les 500 000 soldats irakiens et près de trois fois moins nombreux que les 700 000 unités engagées lors du premier conflit en 1991 pour libérer le Koweït, ont fait tomber Saddam Hussein en trois semaines (Lefebvre, 2018).
Plus que jamais, l’innovation appliquée au contexte militaire bouleverse les rapports de force, parfois au point de dissuader l’adversaire d’attaquer (Vernhes, 2024). Comme le souligne Renaud Bellais, « la technologie n’est pas une fin en soi, mais se justifie au regard de la puissance de l’adversaire ». Or il se trouve que la LPM de 2024-2030 rappelle l’ambition française de « faire face aux nouvelles menaces et de maintenir son rang parmi les premières puissances mondiales ». C’est pourquoi l’ensemble de l’écosystème de défense, composé des centres de recherche, des industriels et de la DGA, cherche à développer des systèmes de défense performants et innovants, afin de maintenir un avantage stratégique face à d’éventuels adversaires (Serfati, 2008).
Cette recherche de supériorité technologique s’incarne tout particulièrement dans la stratégie de dissuasion. La crédibilité de l’arme nucléaire exige en effet un arsenal d’équipements de très haute performance (Fromion, 2006 ; Hoeffler et al., 2021), dont il faut continuellement anticiper et renouveler les briques technologiques pour faire face à l’évolution des systèmes équipant les armées étrangères. À titre d’exemple, la troisième version des missiles balistiques M51 est en cours de développement depuis 2014 ; un premier lancement a eu lieu le 18 novembre 2023. Équipant les sous-marins nucléaires lanceurs d’engins, ces missiles seront plus furtifs pour pénétrer des dômes antibalistiques pourtant conçus comme « hermétiques ». Pour Fabien Kuzniak, conseiller militaire de Safran, « la stratégie de dissuasion élève l’efficacité et l’innovation technologique de toute la production, car l’erreur n’est pas envisageable lorsqu’il s’agit de contribuer à la tenue de la posture nucléaire ».
L’excellence technique développée dans le cadre de la dissuasion ruisselle ensuite sur l’ensemble des systèmes de défense, ce qui améliore de facto la performance de l’ensemble des équipements de l’armée française. Arnaud Génin confirme que « chaque sous-domaine bénéficie d’une technicité avancée, alliant fiabilité et performance, dont les critères ont été élevés au niveau requis par l’environnement nucléaire des sous-marins nucléaires lanceurs d’engins (système d’armes et propulsion) ». Guillaume Muesser souligne que « de nombreux missiles conventionnels [qui ne portent pas de charge nucléaire] bénéficient des technologies développées pour les missiles nucléaires ».
La reprise des dépenses militaires qui s’observe ces temps-ci en Europe et ailleurs s’accompagne donc d’un nombre croissant d’exigences normatives et techniques : les armements doivent résister à des conditions extrêmes et répondre à des critères précis, constamment relevés, afin d’être plus efficaces que ceux de l’adversaire (Oudot et Bellais, 2008 ; Malizard, 2015 ; Mérindol, 2016). Plus généralement, les systèmes d’armes appartiennent par nature à la catégorie des systèmes et produits complexes (Hobday et al., 2000). Fabien Kuzniak rappelle ainsi le défi que suppose la production d’un système tel que le moteur d’un avion de chasse : « Un savoir-faire détenu par moins de cinq pays au monde qui nécessite de maîtriser une chaîne complète de technologies et de gestes techniques allant des sciences des matériaux pour l’usinage à l’assemblage final des milliers de pièces spécifiques qui constituent un moteur comme celui du Rafale. » Les systèmes militaires comme les porte-avions ou les avions de combat intègrent de nombreux sous-systèmes et composants à forte intensité technologique, de la mécanique au logiciel, dont les connaissances sont détenues par un ensemble d’acteurs complémentaires, ce qui en complique encore la fabrication (Fauconnet, 2019 ; Versailles, 2005).
L’État, qui ne pourrait pas se limiter à édicter des spécifications exigeantes, intervient largement dans le soutien à l’innovation industrielle de défense, comme principale source de financement et comme premier destinataire des technologies développées à usage militaire. Il y a plusieurs raisons à cela. Une première est que son intervention est un des modes d’expression de son propre impératif d’autonomie stratégique : l’État place délibérément sous son contrôle les principaux acteurs de l’innovation de défense dans le but de conserver la maîtrise des technologies employées par les forces militaires (Malizard, 2015 ; Vernhes, 2024).
Une seconde raison résulte de la structure particulière – et désincitative – de ce marché, rappelée au chapitre 1. L’optimum économique exige en effet que la puissance publique pallie les défaillances de l’investissement privé (Oudot et Bellais, 2008), contrarié par un besoin élevé lié à la complexité technologique et des rendements futurs très incertains. Cette incertitude résulte elle-même, et tout à la fois, de la durée des négociations puis du développement des systèmes, de l’influence du contexte géopolitique qui ne manque pas d’évoluer, et des volumes de commandes de la DGA affectés par les contraintes budgétaires. À titre d’exemple, il a fallu attendre 2015 pour que le Rafale emporte ses premiers succès commerciaux, alors que sa mise en service date de 2002. Dès lors, l’État prend en charge les investissements en R&D nécessaires au développement des technologies de défense, soit sous forme de contrats exécutés par les entreprises, soit dans le cadre des programmes d’armement. Toute la question est de savoir s’il y alloue un effort suffisant.
L’affaiblissement continu de l’effort public direct de R&D dans le domaine de la défense
Il est difficile d’établir avec précision le poids du soutien public dans l’effort de R&D de défense conduit par les entreprises de la BITD française, mais plusieurs indices convergent pour indiquer qu’il est critique. Ainsi, en 2022, le ministère des Armées a versé 2,1 milliards d’euros de soutien aux entreprises (hors CIR) au titre de la R&D27, ce qui représente 53,6 % des fonds publics versés aux entreprises au titre de la R&D la même année, toutes finalités confondues (soit 3,8 milliards d’euros, voir EESRI nº 18). Cette part du ministère des Armées monte même à 77 % pour les entreprises du secteur aérospatial et jusqu’à 95 % pour les producteurs d’équipements de communication.
Bien sûr, en moyenne, les entreprises assument l’essentiel de leur effort d’innovation. Activités civiles et militaires confondues, elles autofinancent en effet à hauteur de 82 % les 39,0 milliards d’euros que représente la DIRDE (dépense intérieure de recherche et développement des entreprises) en 2022. A contrario, la part des subventions publiques, toutes administrations confondues et hors mesures fiscales, ne dépasse pas 10 % de ce total (le solde provenant de l’étranger). Toutefois, il est couramment admis que la part autofinancée de R&D privée est plus faible pour les activités militaires. Pour donner un ordre de grandeur, les principaux MOI (Airbus, Safran, Naval Group, Arquus, Dassault et Thales) ont cumulé en 2022 un effort autofinancé de R&D de 5,8 milliards d’euros en R&D (activités civiles et militaires confondues, voir fig. 3.4).
Abi-Saab et al. (2002) constatent que la R&D militaire est passée de 16,8 % à 8,1 % de la DIRD (dépense intérieure de recherche et développement) entre 1992 et 2000. Ils estiment que cette baisse de l’investissement dans la R&D dédiés à la défense, qui représentaient encore 1,5 milliard d’euros soit 66 % des financements publics aux entreprises au titre de la R&D en 2000, a largement contribué à la baisse totale du soutien public à la R&D privée qui a chuté de 35 % entre 1992 et 2000.
La France n’est pas la seule à avoir suivi cette évolution : le Royaume-Uni et les États-Unis ont également vu leur effort de R&D militaire s’amenuiser durant cette période. En 1992, la part des dépenses intérieures de R&D allouées à la défense au Royaume-Uni s’élevait à 16,3 % contre 14,5 % en 2000. Pour les États-Unis, cette proportion est passée de 21,9 % en 1992 à 13,7 % en 2000.
Ce décrochage historique est bien sûr une matérialisation statistique du « dividende de la paix », dans un contexte de ralentissement économique et d’augmentation des prestations sociales en Europe, ayant conduit globalement à une réduction de la part du budget consacrée à la défense (Bellais, 2005). Rappelons toutefois que, selon les données du SIPRI, la dépense militaire mondiale se maintient entre 2,1 et 2,6 % du PIB planétaire depuis 1996, ce qui signifie qu’elle augmente continûment en dollars constants depuis cette date. L’évolution des crédits publics alloués à la R&D de défense peut donc sembler paradoxale. Comme le rappelle le témoignage d’Hervé Guillou, la nuance est parfois mince entre les dividendes de la paix et l’impréparation collective face à de nouveaux conflits possibles (voir encadré).
Les drones aériens : un exemple de retard technologique selon Hervé Guillou
Dans les années 1990, la France se positionnait parmi les leaders mondiaux dans le domaine des drones aériens, alors que le marché civil était inexistant. Le programme d’appareil inhabité Brevel développé en coopération avec l’Allemagne fut abandonné sous la présidence de Jacques Chirac, dans le contexte des « dividendes de la paix ». En effet, un arbitrage en faveur de la professionnalisation de l’armée a conduit à réduire une partie des crédits des programmes industriels, notamment en matière de R&D dans lesquels figuraient les drones, au bénéfice du capacitaire.
Pendant cette période de désengagement, les États-Unis, la Grande-Bretagne et Israël, eux, poursuivirent leurs investissements en développement. Ce n’est qu’en 2004-2005, lors du conflit en Afghanistan, que la France a pris conscience de son retard technologique. Quand les forces armées ont exprimé le besoin urgent d’obtenir ce matériel pour leurs opérations, le ministère a dû faire le choix d’achats sur étagère ou de locations de drones auprès des Américains et des Israéliens, plutôt que d’investir dans la R&D, ce qui n’a fait que retarder les investissements dans une solution européenne souveraine. Cette stratégie de compensation s’avéra coûteuse à long terme et conduit la France à avoir un déficit capacitaire de 40 ans minimum.
Ainsi, la France a non seulement perdu des capacités de défense souveraines, mais elle a également supporté un coût bien plus élevé, cumulant les dépenses d’achat immédiates et les investissements nécessaires pour compenser son retard.
Évolution des financements publics de la R&D des entreprises et de la dépense intérieure de R&D des entreprises (en % du PIB)
Source : L’état de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en France (ESSRI) n°8 – juin 2015.
En France du moins, ce repli statistique porte également la marque d’un changement de modalité du financement de la R&D. Le transfert des compétences de la Direction générale de l’armement (DGA) aux industriels et aux centres de recherche en a constitué une première étape. Ensuite, l’État a également mis l’accent sur de nouveaux mécanismes de financement, et notamment sur le crédit d’impôt recherche (CIR). Comme le résument Belin et al. (2019), « le financement [direct] de la défense, qui était au cœur du financement public de la R&D, est devenu un instrument parmi d’autres dans un policy mix privilégiant le financement indirect de la R&D par le biais de crédits d’impôt ». Un rapport du ministère de la Recherche (2014) montre en effet que les aides directes aux entreprises au titre de la R&D représentaient 0,25 % du PIB en 1993 pour tomber sous la barre des 0,15 % à la fin des années 2000, tandis que le CIR est de son côté passé de 0,05 % à 0,25 % du PIB (fig. 3.1). Cela a naturellement eu des conséquences sur les stratégies de financement de la BITD : en 2012, les entreprises de la BITD ont déclaré au titre du crédit impôt recherche un effort total de R&D proche de quatre milliards d’euros – activités civiles et militaires confondues – et ont bénéficié d’un CIR d’un montant de 1,1 milliard (Quemener et Oudot, 2015).
Financements publics reçus par les entreprises en France (prix constant 2015)
Source : L’état de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en France (ESSRI) n°9 – 18.
(*) Ministère de la Défense (DGA) et CEA militaire.
Plus près de nous, soit à partir de 2018, l’effort public en faveur de la R&D de défense a repris une tendance ascendante, qui se confirme sur deux périmètres statistiques différents (voir Annexe 4). D’une part, la « recherche et développement » telle qu’on la nomme à la DGA ou au DoD (Department of Defense) américain constitue un ensemble d’opérations et de dépenses nettement plus vaste que ce qu’on entend habituellement, le terme de « développement » ayant une acception très extensive qui comprend jusqu’aux dernières étapes pré-opérationnelles des équipements. Ce sur-ensemble de la « R&D au sens militaire du terme » représentait récemment de l’ordre de quatre milliards par an avant de progresser jusqu’à près de sept en 2021. D’autre part, le sous-ensemble de cet effort budgétaire appelé « recherche technologique » ou « R&T », et qui se rapproche davantage de ce que l’on nomme R&D dans les statistiques civiles est passé selon les données de l’Agence européenne de défense28 de moins de 600 M€ en 2015 à plus d’un milliard en 2021 (fig. 3.3).
Les dépenses publiques de la France en R&D et R&T de défense, en millions d’euros constants de 2022 (2005-2021)
Source : Agence européenne de défense.
Une production de pointe, facteur de compétitivité de la BITD
Comme le rappelle Hinde Doux, la production d’équipements innovants et performants n’est pas seulement une exigence stratégique fixée par l’État-client. C’est aussi un impératif économique des entreprises qui évoluent sur un marché concurrentiel : « Les industriels de la défense sont avant tout des entreprises privées qui répondent à des incitations et à des mécanismes de marché, et non uniquement à des intérêts patriotiques. La performance économique reste le premier moteur pour ces entreprises. Bien qu’animées par un élan patriotique en termes d’activité, pour exister, ces entreprises doivent être rentables. »
Pour y parvenir, elles disposent de plusieurs leviers, dont la réduction des coûts de production et l’amélioration de la qualité. C’est à ce double titre que l’innovation joue un rôle important, sans qu’il faille pour autant perdre de vue, ainsi que le souligne Jean-Marie Dumon, que le principal objectif n’est pas d’innover mais de produire : « L’innovation n’est qu’un moyen pour y parvenir. C’est ce levier qui permet de capter de nouvelles parts de marché, en particulier à l’export, et même idéalement de faire la course en tête. »
L’efficacité et la pertinence de ces innovations sont éprouvées pendant les opérations militaires, qui concourent ainsi à démontrer aux observateurs internationaux l’excellence technologique et la fiabilité des systèmes d’armement français. Arnaud Génin confirme que « les terrains d’opération constituent une vitrine de premier plan de l’offre française, prenant les armées étrangères à témoin de la performance du matériel français dans des situations réelles, comme en mer Rouge où les frégates françaises ont dû faire face à des attaques de drones et missiles balistiques ennemis, là où d’autres marines alliées ont préféré ne pas s’aventurer ».
L’innovation est ainsi au cœur de la stratégie des entreprises de défense. Entre 2015 et 2022, les grands donneurs d’ordre ont alloué entre 2 % et 11 % de leur chiffre d’affaires à la recherche et développement (R&D) civile et militaire (fig. 3.4). C’est par exemple le cas de Safran, qui y consacre entre 5 % et 6 %, selon les données du calepin des entreprises de la DGA (2024). Pour sa part, Thales a autofinancé sa R&D à hauteur d’un milliard d’euros, soit 6 % de son chiffre d’affaires de 2023. La part des effectifs affectés à la R&D est également élevée au sein des grands donneurs d’ordre. Elle est ainsi de 4,4 % chez Thales, ce qui représente 3 500 chercheurs. Cet effort de R&D se matérialise enfin par le nombre de dépôts de brevets. D’après l’Institut national de la propriété industrielle, parmi les dix premiers déposants de brevets en 2024, on retrouve les maîtres d’œuvre tels que Safran, Airbus et Thales, ainsi que le CEA.
Dépenses de R&D autofinancées par les MOI, en millions d’euros, entre 2015-2023
Source : Rapports 2016-2024, calepin des entreprises (DGA).
Une manière parlante de qualifier cet effort d’innovation est de le comparer à celui des autres entreprises innovantes, hors BITD. Ainsi, parmi les entreprises françaises qui exerçaient une activité de R&D en 2014, Moura (2020) relève que celles qui étaient présentes sur le marché de la défense employaient significativement davantage de chercheurs que les autres. En outre, entre les entreprises générant plus de 20 % de leur chiffre d’affaires dans le secteur de la défense et un groupe de contrôle constitué d’entreprises civiles, les parts respectives déclarant innover en matière de produits présentent une différence de 18 points de pourcentage29 (Moura, 2018, 2020). Moura (2018) indique encore que les entreprises d’armement sont cinq fois plus nombreuses que les entreprises hors armement à déclarer des collaborations scientifiques avec le secteur public. Enfin, au titre du crédit impôt recherche, une entreprise de défense obtient en moyenne un crédit d’impôt cinq fois supérieur à celui d’une entreprise hors défense. Dans l’ensemble, les entreprises de la BITD représentaient 5 % des entreprises déclarantes, mais 21 % des dépenses de R&D déclarées au CIR en 2012, soit un peu moins de 4 milliards d’euros (Quemener et Oudot, 2015).
Pour spécifique qu’il soit, le marché mondial de l’armement est lui aussi partagé entre des entreprises qui misent sur une concurrence par les prix en proposant des produits relativement simples et d’autres qui cultivent leur avantage comparatif en perfectionnant des produits complexes. Pour autant, il semble que la seconde approche soit la plus représentative, sans doute parce qu’elle est la plus à même de répondre aux exigences des différents acheteurs publics. Fauconnet (2021) observe en tout cas que la dépendance économique des entreprises au marché militaire, au niveau mondial, favorise des innovations de haute qualité, que ce soit par la diffusion de ces innovations dans « une diversité d’inventions futures » ou par la mobilisation d’une « diversité d’inventions technologiques passées ».
Fauconnet (ibid.) note également que les industriels optent généralement pour une innovation incrémentale, qui offre des cycles de développement plus rapides et des opportunités économiques plus étendues. Par exemple, Safran procède régulièrement à des optimisations techniques dans une perspective d’amélioration continue d’une même plateforme. Fabien Kuzniak prend l’exemple du Rafale dont « la performance est restée comparable à celle de l’offre américaine qui a pourtant produit plusieurs versions d’avions de chasse (F-16, F-22, F-35 pour Lockheed Martin ; F/A-18, EA-18G, F-15 pour Boeing), alors que la France a une plateforme multimissions unique qu’elle adapte constamment. Cette obligation lui impose d’innover dans tous les domaines, à l’instar du futur moteur du Rafale dénommé T-REX dont la poussée sera augmentée de 20 % par rapport à la version existante. »
Le canon Caesar, une innovation d’initiative privée selon Hinde Doux
Le développement du canon Caesar a été lancé à Bourges dans une usine de Giat Industries par un ingénieur de l’armement, nommé dans un contexte de plan social. Plutôt que de se contenter de supprimer des postes, il a cherché à préserver certaines compétences stratégiques en lançant un nouveau projet. Afin d’intégrer de nouveaux marchés, le canon Caesar a eu pour ambition de développer un système d’artillerie monté sur camion moins coûteux à produire et avec une meilleure mobilité, capable de se démarquer de la concurrence. À l’origine, ni la DGA ni aucune autre autorité institutionnelle ne soutenaient ce programme, ce qui en fait un cas très particulier d’innovation industrielle. Rapidement, le Caesar a été adopté par les artilleurs français et a été exporté. Toutefois les volumes restent limités et ne compensent pas les contrats d’équipements lourds en termes de rentabilité, comme ceux dans le cadre du programme du char Leclerc. L’excellent rapport qualité/prix du canon mis en avant est trompeur : cette simplicité résulte d’un travail d’ingénierie de haute précision, conçu pour être à la fois performant, fiable, simple à fabriquer et à maintenir. Son efficacité, même dans des environnements complexes, est reconnue à l’international où les Américains ont demandé à bénéficier de la protection et de la puissance de feu des artilleurs
- 27 — En 2014, les principaux maîtres d’œuvre ont perçu 96 % des financements publics de R&D de défense destinés aux entreprises du secteur.
- 28 — Les données de l’AED ne prennent en compte que les 27 pays membres de l’UE.
- 29 — Moura (2020) utilise les données issues de plusieurs enquêtes, dont la base Sandie de 2014 qui permet d’identifier la BITD et l’enquête communautaire sur l’innovation, CIS (2012-2014). À partir des tests d’égalité de proportion effectués entre les entreprises de la BITD et un panel d’entreprises extérieures à la BITD mais comparables, Moura évalue la différence entre le nombre d’entreprises de la BITD qui affirment innover en matière de produits et le groupe de contrôle.
Focus – La guerre de haute intensité : une rupture du dogme de la supériorité technologique ?
L’utilisation massive de drones civils, à coût modéré, dans les opérations militaires ukrainiennes a montré les limites du principe de supériorité technologique dans un conflit de haute intensité, essentiellement terrestre. Face à des moyens d’attaque de faible qualité mais en nombre élevé (selon la stratégie appelée « guerre d’usure » ou « guerre d’attrition »), certains ont pu mettre en doute ce consensus de la stratégie militaire qui privilégie toujours l’excellence technologique des équipements. Un double enjeu s’esquisse alors dans cet arbitrage coût bénéfice : le respect de la contrainte budgétaire, d’une part, et la recherche de compétitivité d’autre part.
Charles Maisonneuve constate qu’« un point noir de cette industrie est son incapacité à revoir à la baisse ses exigences pour être plus rentable en matière de coûts de production et répondre ainsi à une plus large demande : “Dans l’armement, la solution peut être la plus efficace mais pas forcément la plus compétitive.” » Par exemple, les concurrents turcs répondent à 70 % du besoin en étant moins chers que les produits français. Renaud Bellais confirme qu’une des difficultés de l’industrie de défense française est son incapacité à « réduire la performance de ses produits au point de retrouver une compétitivité prix. Cela s’est vu avec Ariane : Arianespace propose un lanceur technologiquement parfait, dont le très haut niveau de fiabilité correspond aux standards militaires, mais dont les coûts de production sont bien trop élevés pour faire face à la concurrence de SpaceX, moins fiable mais plus abordable : c’est toute la différence entre une fiabilité à 90 % et une fiabilité à 99,9 %. »
En contrepoint, l’usage d’armes de haute technologie se justifie non seulement par le besoin de crédibilité de la dissuasion française, mais également par la valeur des infrastructures sous protection. Fuller (2024) prend l’exemple des « attaques houthies des frégates en mer Rouge avec des drones Shahed iraniens de quelques dizaines de milliers d’euros qui provoquent la défense de nos bâtiments de la Marine par des missiles Aster d’un montant avoisinant le million d’euros ». L’usage de ces missiles est cohérent et rationnel étant donné la valeur humaine et économique des bâtiments de la Marine.
De ces arbitrages entre haute technologie et masse apparaît la notion de robustesse des équipements militaires. On entend par robustesse la capacité d’un système à fonctionner correctement dans des conditions dégradées (Livet, 2025). Selon l’autrice, obtenir un équipement robuste revient à trouver un certain niveau de simplification technique qui demande d’adopter une nouvelle approche de la conception du système de défense française afin de prendre en compte à la fois les contraintes budgétaires, les aléas des théâtres de guerre (rupture d’approvisionnement énergétique, capacité à réparer facilement) et enfin les attentes technologiques en fonction de l’usage (ibid.).
C’est un enjeu complexe que de parvenir à un ensemble d’équipements cohérents selon les différentes catégories de conflits et de menaces. D’autant que ces arbitrages se font en fonction des missions des armées et des équipements nécessaires pour y parvenir.
La chaîne d’approvisionnement, point névralgique
L’accès maîtrisé aux capacités et compétences industrielles implique de privilégier la production sur le territoire national. Or les chaînes de valeur sont mondialisées et interdépendantes. C’est pourquoi la DGA et les donneurs d’ordres interviennent le long des chaînes d’approvisionnement qu’ils supervisent afin de garantir la livraison des équipements des forces armées.
Une stratégie de préférence nationale
Comme l’explique le directeur technique d’une ETI de défense, l’objectif national d’autonomie stratégique, « dans une logique de maîtrise industrielle de l’équipement des forces françaises, implique un contrôle de la chaîne de valeur ». La stratégie de son entreprise s’inscrit dans ce cadre, « soit par l’internalisation des activités, soit par l’externalisation auprès de fournisseurs sous-traitants présents sur le territoire français. La règle générale dans le domaine militaire est celle d’une préférence pour les produits fabriqués en France. » À titre d’exemple, Arquus compte 85 % de ses 1 300 fournisseurs sur le territoire.
Cette préférence pour la production nationale devient même un impératif pour les systèmes de défense liés à la dissuasion : Hugo Richard, directeur de cabinet du président exécutif et des affaires publiques d’ArianeGroup, confirme que toutes les unités de production du missile balistique M51 se situent en France, contrairement à celles des autres segments qui se répartissent entre l’Allemagne et la France.
Nicolas Grangier souligne l’intérêt pour l’État de conserver un accès aux technologies et aux systèmes de défense, en s’assurant du maintien des savoir-faire sur le territoire. Il s’agit de « ne pas laisser le marché faire et défaire des industries stratégiques selon l’évolution de leur compétitivité relative. L’État se détache donc d’une logique de compétitivité au profit de la sécurisation des approvisionnements stratégiques. » Il considère que son véritable enjeu est de sécuriser la chaîne de valeur : « Conserver une technologie sur le territoire national peut s’avérer essentiel pour répondre aux besoins des armées françaises tout en réduisant notre dépendance aux exportations. »
Privilégier la production locale constitue également un moyen de s’affranchir des politiques des autres pays ainsi que des contraintes réglementaires liées au commerce d’armes, comme le rappelle Hinde Doux. « La réglementation à l’exportation nécessitait souvent de vérifier qu’un accord commercial n’était pas en contradiction avec les conditions d’usage des éléments achetés. D’autant que les règles d’exportation de matériel de guerre diffèrent significativement d’un pays à l’autre. Par conséquent, l’ensemble de ces réglementations ont conduit les entreprises à acheter à l’intérieur de leurs frontières nationales, dans un souci de simplicité opérationnelle. Dès les années 1980-1990, acheter en France était une injonction indirecte des entreprises pour éviter toute complication réglementaire. Dans les années 2000-2010, les entreprises ont commencé à subir un contrôle à l’export plus strict ; l’Allemagne a notamment renforcé sa réglementation sur l’exportation de systèmes d’armes incorporant des composants issus de son territoire. À partir des années 2010, ces politiques restrictives se sont étendues à tous les pays européens. Quelques années plus tard, la Chine et une large partie des pays producteurs ont édicté leurs propres règles de contrôle à l’export. La BITD a été relativement préservée : elle n’a pas connu le même tournant de sourcing international que l’industrie automobile qui, pour sa part, a adopté des stratégies de “cost killing” en s’en remettant aux acquisitions étrangères. »
Naturellement, certaines entreprises localisées en France sont détenues par des capitaux étrangers. La politique d’approvisionnement prioritairement national reflète donc un parti pris dans l’interprétation de l’objectif d’autonomie stratégique. En particulier, les PME innovantes relevant du secteur de français de la défense sont plus souvent détenues par des actionnaires étrangers que les PME œuvrant sur des marchés civils (Belin et al., 2008)30.
Une interdépendance des chaînes de valeur qui pousse à la vigilance
Cette logique de préférence nationale ne signifie pas que les systèmes de défense soient pour autant entièrement produits sur le territoire national. Les industriels français dépendent notamment de fournisseurs européens et américains pour s’approvisionner en biens intermédiaires (Moura, 2021). Cette situation reflète certes l’internationalisation et la fragmentation des chaînes de valeur, mais elle peut découler plus spécifiquement des compensations stipulées dans les contrats d’exportation, des projets européens de coopération ou encore des fusions transnationales des MOI. L’extension à l’échelle européenne de certains programmes d’armement a en effet déplacé au-delà des frontières non seulement certaines unités de production mais aussi les savoir-faire associés (Hérault, 2018). Certains intrants essentiels à la fabrication des systèmes de défense sont également importés pour la simple raison qu’il s’agit de matériaux ou métaux dont l’extraction ou le raffinage sont situés hors du territoire national. Par exemple, l’aéronautique consomme du titane, un métal dont les gisements se trouvent principalement en dehors de la France et notamment en Russie.
C’est en pareille situation que les réglementations nationales relatives aux produits à usage militaire, notamment celles ayant cours en Allemagne et aux États-Unis, peuvent poser des problèmes critiques aux entreprises françaises. L’exemple le plus connu est sans doute l’International Traffic in Arms Regulations (ITAR) : aux termes de cette réglementation américaine, les États-Unis peuvent interdire la vente à un pays tiers d’un système d’armes si celui-ci contient un composant américain. C’est d’ailleurs ce qu’ils ont fait en 2018, dans le cadre de la vente de Rafales à l’Égypte : l’administration Trump a en effet bloqué la livraison de missiles de croisière Scalp, inclus au contrat, car ces derniers contenaient un microprocesseur produit aux États-Unis.
Les acteurs de la BITD sont donc très concrètement incités à surveiller leurs dépendances à l’égard des approvisionnements étrangers. Sous la direction du ministère de Florence Parly, entre 2017 et 2022, les entreprises ont notamment cherché à réduire leurs approvisionnements en composants états-uniens. Elles y sont parvenues en développant certaines activités critiques en interne, en procédant à des rachats d’entreprise ou des prises de participation, ou bien en achetant « sur étagère » des quantités suffisantes de composants pour l’ensemble de la vie du programme concerné. Dans le cas de MBDA, producteur du missile Scalp, c’est une prise de participation en 2018 au capital de la PME Dolphin Integration, spécialisée en composants électroniques sensibles, qui a permis de s’affranchir du joug américain (Cabirol, 2019).
Les vulnérabilités de la chaîne d’approvisionnement
La vulnérabilité des approvisionnements français en armement ne se résume pas, loin de là, aux blocages politiques pouvant survenir de la part de partenaires commerciaux. Ce problème, partagé par l’ensemble des experts interrogés, apparaît même au centre des préoccupations de la DGA et des MOI. Il provient tout à la fois de la santé jugée fragile des PME et ETI, des contraintes de certification par l’État de ses fournisseurs et d’une forte concentration des approvisionnements en matériaux critiques utilisés dans la production. Dans un contexte riche en chocs conjoncturels, cette vulnérabilité peut entraîner des ruptures des chaînes d’approvisionnement.
Sur la période 2016-2021, les ETI et PME de la BITD ont en effet affiché une rentabilité plus faible que les entreprises comparables des autres secteurs (EcoDef nº 260, 2025) – hormis le cas particulier des entreprises spécialisées en R&D, « souvent plus rentables en moyenne que leurs équivalents dans le comparatif ». Cette moindre rentabilité réduit leur trésorerie et leur capacité d’investissement, alors même qu’elles ont une plus forte intensité capitalistique31. Cette situation s’explique en partie par le pouvoir de marché des donneurs d’ordres, qui s’est encore accentué après la vague de concentrations et de spécialisation des MOI (Bellais et al., 2014 et Lazaric et al., 2009). D’un autre côté, les prix des systèmes d’armes sont bornés ex ante par les contrats et financés par la commande publique, ce qui réduit les marges de manœuvre (Bellais et Oudot, 2008). Face aux difficultés d’autofinancement des PME de la BITD, la DGA a mis en place le fonds d’investissement Definvest, dotée de 100 millions d’euros et géré par Bpifrance, afin de « soutenir le développement des PME stratégiques pour la défense par des prises de participations du capital », explique Camille Lanet, sous-directeur de l’intelligence économique de la direction de l’industrie de défense (DID), DGA. Garder ce tissu industriel en bonne santé est d’autant plus essentiel selon Laurent Legendre, directeur régional Île-de-France chez Airbus Développement, que les PME-ETI participent « au bon fonctionnement des donneurs d’ordre, et donc à la maîtrise des sous-systèmes qui garantissent la souveraineté française ». Jean-Marie Dumon souligne ainsi « le rôle des équipementiers dans la sécurisation de la chaîne de valeur, et plus largement dans la préservation de la souveraineté industrielle : sans équipementiers, les donneurs d’ordre n’ont plus rien à intégrer. »
La concentration des fournisseurs certifiés par la DGA, ainsi que les contraintes réglementaires associées qui limitent les sources d’approvisionnement alternatives, constitue un autre facteur de vulnérabilité de la chaîne d’approvisionnement (Dolignon, 2018). Pour Renaud Bellais, « l’État est très prudent dans le choix de ses fournisseurs, peut-être même trop prudent, parce qu’il cherche avant tout à s’assurer de leur pérennité sur toute la durée d’un programme d’armement, afin de maintenir sa souveraineté à tout prix ». Les contraintes administratives, certes garanties du niveau de qualité final, rigidifient encore la chaîne d’approvisionnement en cas de rupture d’approvisionnement. Guillaume Muesser fait état de délais d’accréditation particulièrement longs : « pour un nouvel entrant, complètement inconnu de la filière, il faut environ quatre ans avant d’obtenir la qualification. »
Enfin, la sécurisation des approvisionnements en matériaux stratégiques est devenue un enjeu majeur : six matériaux sur dix utilisés par la BITD sont considérés comme critiques selon Calzada (2020). Par exemple, la société Mecaprec, PME établie au sud de Toulouse, dans l’Ariège, et fournisseur pour l’aéronautique et le secteur naval, a dû faire face à une rupture d’approvisionnement en titane au moment de la guerre en Ukraine. En conséquence, elle a été amenée à reconsidérer ses choix d’approvisionnement pour sécuriser ce matériau essentiel à son fonctionnement.
L’action de l’État et des industriels pour sécuriser les approvisionnements
Les facteurs de fragilité mentionnés plus haut aboutissent périodiquement à l’apparition de goulets d’étranglement, voire à de crises d’approvisionnement. Par exemple, Arquus s’est trouvé en manque de câbles lors de la crise sanitaire parce que ses sous-traitants français étaient eux-mêmes dépendants de fournisseurs chinois.
La DGA a donc employé certains moyens pour minimiser ces risques à l’avenir. D’une part, elle spécifie les producteurs et fournisseurs qu’elle souhaite voir apparaître dans les contrats d’acquisition, notamment pour prévenir tout risque de perte des savoir-faire. D’autre part, la participation de l’État au capital des entreprises lui confère un moyen de contrôle sur leurs décisions stratégiques. Quand l’État est actionnaire majoritaire (comme dans le cas de Naval Group, détenu à hauteur de 62,25 %), il peut orienter directement la stratégie. Sinon, il détient parfois des actions d’un type particulier, appelées « actions spécifiques », qui lui confèrent un droit de veto sur des décisions qui iraient à l’encontre de ses intérêts (Bellais et al., 2014 ; Videlin, 2025). Par exemple, le rachat de l’entreprise métallurgique Aubert et Duval s’est accompagné d’une action spécifique au motif de « protéger les actifs et activités sensibles de cette entreprise au titre de la défense nationale » (Videlin, 2025).
Plus récemment, cette surveillance de la chaîne de valeur s’est trouvée renforcée par la mise en place, en avril 2024, de la direction de l’industrie de défense (DID) au sein de la DGA. Celle-ci « porte comme mission la définition de la politique industrielle, les activités d’assurance qualité, la connaissance du tissu économique dans toutes ses dimensions (entreprises, banques, assurances, investisseurs), la protection des entreprises et de leur patrimoine (résilience cybersécurité, protection de la propriété intellectuelle, suivi des investissements étrangers en France, aides à l’accès au financement) et enfin le pilotage de l’intelligence économique pour les questions d’armement », rapporte Camille Lanet. L’apparition de la DID fait suite à des critiques concernant l’isolement de la DGA, que sa réforme de la fin des années 1990, moyennant un recentrage sur les MOI, aurait éloignée des PME-ETI au point d’en concevoir « une méconnaissance de l’organisation de la chaîne d’approvisionnement », relate Guillaume Muesser. Un des buts de la réforme de la DGA était de déléguer aux MOI la gestion de la supply chain, s’éloignant ainsi des PME et des ETI. Quoi qu’il en soit, dans le contexte actuel de montée en cadence, la nouvelle DID a aujourd’hui pour mission d’établir des liens plus directs avec les PME et les ETI.
La DID a ainsi mis en place un réseau d’attachés d’industrie de défense en région (AIDER), lesquels conseillent les préfectures et les conseils régionaux concernant le développement des entreprises de défense. Ils constituent ainsi des interlocuteurs de confiance entre dirigeants d’entreprises et administrations régionales. Camille Lanet estime que « les AIDER constituent un point de contact privilégié vis-à-vis des sous-traitants de la BITD, qu’ils sont amenés à visiter ». Axel Nicolas, codirecteur de l’Observatoire de la défense de la Fondation Jean-Jaurès, abonde en ce sens : « L’appui des territoires est un moyen efficace pour soutenir le développement de la filière, car l’action des collectivités facilite le dialogue entre l’État et les industriels. » En particulier, il soutient que « la création d’attachés de défense en région a permis de rendre la DGA plus visible et plus accessible pour les acteurs industriels ».
Un autre exemple d’intervention publique concerne l’entreprise de métallurgie Aubert et Duval, accompagnée entre 2018 et 2022 puis finalement rachetée par Safran, Airbus et le fonds d’investissement Tikehau Capital en 2023. Deux facteurs ont fait culminer les difficultés financières de l’entreprise : la crise de qualité rencontrée en 2018 et la forte baisse des commandes aéronautiques lors de la crise sanitaire. Cette situation a mené à un plan de départ des effectifs à l’initiative de son propriétaire, Eramet (publiée dans le JO Sénat du 01/04/2021 – page 2191). En parallèle, « les donneurs d’ordres de l’aéronautique ont pris conscience de la vulnérabilité de la chaîne d’approvisionnement et des enjeux autour de sa sécurisation tandis que les commandes à l’international augmentent autant que les tensions régionales », commente Fabien Kuzniak. Safran, Airbus et l’État, au moyen du fonds Ace Capital géré par le fonds d’investissement Tikehau Capital, ont pris la décision de former un consortium en vue d’acquérir A&D. Tikehau avait été choisi par l’État, au moment de la crise sanitaire, pour créer un fond ad hoc, Ace Aéro Partenaires, abondé par les fonds propres de Tikehau Capital mais également par l’État et les grands donneurs d’ordres de la filière : l’objectif de cet outil est d’investir dans des entreprises stratégiques de la filière afin de les remettre sur pied, que ce soit par la modernisation de l’arsenal productif ou par la R&D, puis de sortir du capital à moyen terme. D’autres entreprises ont bénéficié de ces financements, par exemple Figeac Aero (Bezzon, 2024).
En outre, la DGA porte une attention particulière aux investissements étrangers dans les entreprises, qui constituent la principale menace de captation de savoir-faire (Louise, 2022). Ces investissements passent d’ailleurs parfois inaperçus en raison de montages complexes. Enfin, les leçons tirées de certains cas de rupture d’approvisionnement ont conduit la DGA à exiger des entreprises la constitution de stocks stratégiques pour les matériaux et produits semi-finis les plus critiques, aux termes de l’article 49 de la loi de programmation militaire (LPM) 2024-2030.
Les donneurs d’ordres veillent eux aussi à anticiper et à réduire les goulets d’étranglement, à plus forte raison depuis les récents cas de rupture d’approvisionnement en 2020 et 2022. Fabien Kuzniak explique que le donneur d’ordre « intervient aussi quand la PME éprouve des difficultés à s’approvisionner en matières. Lorsque les prix des matières premières augmentent considérablement, alors que les contrats restent inchangés, les fournisseurs peuvent se retrouver en difficulté. Dans ce cas, Safran aide parfois sa supply chain en achetant en grandes quantités les matières premières concernées (comme le titane), en regroupant les demandes de ses sous-traitants et en garantissant les transferts financiers. » Enfin, les MOI sont parfois incités à prendre des participations au capital d’un fournisseur stratégique dont l’état de santé se dégrade ou qui se trouve à la merci d’un rachat par des acteurs étrangers. L’acquisition par MBDA et Soitec, entreprise de composants électroniques, de Dolphin Integration, qui se trouvait alors en difficultés financières, est également intervenue en réponse à un risque de prise de contrôle par un acteur étranger (EGE, 2018).
Toutefois, ce soutien des donneurs d’ordres aux PME et ETI ne peut être systématique. Patrice Daste, ancien président de la PME Alsymex, rappelle que, pendant la crise des subprimes, « au sein de la chaîne de valeur de l’aéronautique, certains donneurs d’ordres se sont concentrés sur leurs activités en interne au détriment de la sous-traitance, abîmant la relation de confiance entre ces partenaires, pourtant vecteur de résilience pour l’industrie ».
- 30 — Ce résultat est issu d’analyses comparatives de groupes entre PME de défense innovantes et non innovantes par rapport à des PME civiles innovantes et non innovantes, ainsi que des grandes entreprises de défense dont les données proviennent de plusieurs sources qui datent de la période 2002-2004. L’échantillon total de 5 647 entreprises, issu d’une enquête Sandie conduite par l’OED en partenariat avec l’Insee, permet d’identifier les PME innovantes par le développement d’innovations en produit ou procédé, ou bien l’engagement de dépenses de R&D.
- 31 — Les besoins de financement de l’activité de défense sont en effet supérieurs à ceux de l’activité civile en raison d’investissements en R&D plus élevés et des charges de personnel plus importantes, majoritairement des emplois qualifiés (Belin, 2015).
Un écosystème résilient, capable de travailler en réseau
La cohésion de la filière de défense, facteur décisif de sa résilience, se mesure au nombre de liens existant entre les acteurs industriels, institutionnels et scientifiques. Leurs coopérations sont d’abord le résultat de la complémentarité de leurs compétences, toutes nécessaires au développement des systèmes d’armement. Elles ont progressivement forgé une culture partagée, la logique de filière se trouvant complétée par celle d’un écosystème dense où le travail en réseau se trouve favorisé. Cette logique de coopération s’étend aujourd’hui à l’échelon européen, sous l’effet de l’alignement des intérêts économiques et politiques des États membres, mais également de leurs programmes de renouvellement de matériels, ce qui tend à renforcer la compétitivité des industriels.
Un jeu collectif, vecteur de résilience
De longue date, les industriels de la BITD se sont organisés en syndicats nationaux et en clusters territoriaux, afin de partager une même vision collective de leur activité.
En premier lieu, le Conseil des industries de défense françaises (Cidef) incarne « l’expression collective des organisations professionnelles adhérentes dans le domaine de la défense ». Fondé en 1990, il rassemble les trois syndicats organisés par filière : le Gicat pour l’armement terrestre, le Gican pour l’armement naval et le Gifas pour l’aérospatial. L’exemple du Gifas permet d’illustrer comment ces syndicats peuvent ancrer une culture de travail collectif au sein d’une filière. Un des atouts du Gifas tient à son ancienneté : créée en 1908, cette fédération professionnelle préexistait donc à la quasi-totalité de ses entreprises adhérentes actuelles. Guillaume Muesser confirme que « cette ancienneté lui a permis de s’inscrire dans les habitudes de la filière avant même le tournant industriel des aéronefs. L’institution est devenue “la maison”, qui regroupe en un même lieu tous les acteurs de cette filière et implique logiquement l’adhésion des nouveaux entrants. En outre, cette structure promeut un travail collectif en organisant des réunions mensuelles dans lesquelles les grands patrons de l’aéronautique (Airbus, Dassault Aviation, Safran, Thales, MBDA) et des représentants des ETI et des PME, se rencontrent et échangent sur les enjeux communs, se mettant d’accord sur les problématiques partagées et les actions que la filière peut entreprendre au bénéfice de tous. Ces principes, transformés en habitude de travail collectif, érigent le Gifas en structure qui fédère et défend les intérêts communs. C’est au sein du Gifas que sont élaborées les positions de la filière dans le cadre des discussions conduites avec la DGA sur les coûts retenus dans les marchés de gré à gré. Dans un cas comme celui-là, le Gifas s’impose en interlocuteur de premier plan, regroupant les avis émis par les industriels. » Le Gifas joue également un rôle structurant auprès des PME et des ETI. Par exemple, il a soutenu la mise en place de la plateforme collaborative BoostAeroSpace qui assure la fluidité des informations entre donneurs d’ordre et fournisseurs.
Outre les syndicats nationaux, les industries de défense se rassemblent également au sein de clusters territoriaux. En particulier, Moura (2015) observe une surreprésentation des entreprises de la BITD au sein des pôles de compétitivité. En 2012, sur les 1 955 entreprises repérées pour leur activité de défense32, 612 adhéraient à au moins un pôle ; chaque entreprise adhérait « en moyenne à 2,4 pôles, contre 1,2 pour les autres entreprises ».
Ces regroupements locaux favorisent le dynamisme coopératif et la compétitivité des entreprises (Granier et Ellie, 2021). Par exemple, le cluster EDEN33 a été créé en 2008 à la suite d’une étude commandée par la DGA à la Chambre de commerce et d’industrie de Lyon. Celle-ci visait à identifier les entreprises isolées et peu visibles par les donneurs d’ordres dans ce territoire, détenues souvent par des dirigeants en fin de carrière, avec un risque d’absence de transmission ou une grande vulnérabilité à un rachat d’étranger. La DGA a donc encouragé la création d’une structure fédérant les entreprises concernées dans la région, afin de rompre leur isolement et de diffuser des bonnes pratiques, notamment en matière de coopération. L’objectif est de favoriser l’obtention de nouveaux contrats, par exemple en constituant des groupements momentanés d’entreprises (GME) pour répondre collectivement à des appels d’offres. Thierry Regond, son président, précise que « le soutien de la DGA est toujours d’actualité par un financement entre 30 % et 40 % du budget de l’organisation ». Il ajoute qu’« en raison de l’accompagnement à l’international et à l’échelle nationale, l’initiative a rapidement connu un fort succès. Ce regroupement renforce la visibilité des PME et des ETI, ce qui améliore leur attractivité et leur compétitivité à l’international. Cette dynamique se traduit notamment par une part significative de leur chiffre d’affaires réalisée à l’export, atteignant 50 % pour les entreprises du cluster. La présence de clusters dans les territoires permet de compléter les compétences des autres structures, en intégrant les spécificités régionales dans les actions de mise en réseau. »
Dans un rapport non public remis au ministre, le Conseil général de l’armement juge que l’industrie de défense a fait preuve de résilience durant la crise sanitaire. Les auteurs l’imputent en partie à la réactivité dont ont fait preuve la DGA et les industriels durant la pandémie. Leur capacité à travailler ensemble a permis aux acteurs de la défense d’adopter des solutions rapides, notamment dans le domaine aéronautique dont l’activité commerciale s’est alors totalement arrêtée. La DGA a su mettre promptement en place un plan de soutien, sous la forme de commandes anticipées d’avions, d’hélicoptères et de drones, afin d’alimenter le plan de charge et de préserver l’emploi. Une cellule d’appui a également été créée par la DGA, afin de rester en étroite coopération avec les fournisseurs et sous-traitants et de se maintenir informée de leurs difficultés. Enfin, des cas de coopération ont même eu lieu entre MOI de différentes activités. En particulier, Naval Group a proposé à Airbus de procéder à un prêt de main-d’œuvre d’ingénieurs, de techniciens et d’usineurs pour la construction de navires (rapport de responsabilité sociétale d’entreprise, Naval Group, 2020).
Cette capacité de l’industrie de défense à absorber les chocs économiques s’explique en grande partie par une forme d’ouverture d’esprit qui lui permet d’envisager aisément des solutions collectives, qui sont ensuite rapidement mises en œuvre. Hervé Guillou confirme que la proximité entre ces acteurs privés et leur faculté à collaborer a été source de résilience pendant la pandémie de Covid-19 : « les présidents du Gifas, du Gicat et du Gican tenaient des réunions de crise hebdomadaires avec la DGA et ses adjoints pour accélérer les circuits de trésorerie en faveur des entreprises en difficulté et prioriser les programmes stratégiques. Ce fonctionnement n’a malheureusement pas été répliqué dans d’autres domaines. » Cette qualité de l’organisation de la défense illustre à ses yeux ce que l’on peut espérer d’une politique industrielle en capacité d’atteindre ses objectifs. « Lorsque l’industrie est correctement organisée (Gican, Gicat, Gifas, eux-mêmes coordonnés au sein du Cidef) et que les acteurs, mobilisés par un sentiment d’appartenance à une communauté unique, se connaissent bien, les grands programmes industriels sont assurés de succès. » Il prend comme contre-exemple l’industrie automobile, où il constate « que l’absence d’organisation de l’écosystème intensifie les déchirements actuels, gangrenés par les intérêts divergents des constructeurs et des équipementiers, sans qu’un service étatique stable ne s’occupe du temps long ». Laurent Legendre conclut que l’organisation du tissu industriel de défense, autour d’un double modèle de filière et de clusters locaux, est un élément de sa compétitivité.
Une de ses fragilités tient toutefois au petit nombre d’ETI, qui exercent un rôle important d’interface avec les donneurs d’ordre et d’équilibrage des relations interentreprises. La consolidation des PME est également un enjeu partagé par Thierry Regond, vice-président par ailleurs de la PME de défense Sunaero : « Les perspectives de regroupement des PME, en vue d’atteindre une taille critique par le biais de fusions et d’acquisitions, représentent un des principaux défis pour leur éviter d’être vassalisées par les grands donneurs d’ordres… ou doublés par les concurrents européens. »
Le développement des coopérations à l’échelle européenne
L’implication de la France dans les partenariats européens
Selon un rapport de la Cour des comptes sur la coopération européenne (2018), la France et les pays européens coopèrent pour « se doter de capacités modernes et de haut niveau technologique, dont le développement aurait été difficilement financé par un seul d’entre eux ». Ces coopérations ont principalement été mises en œuvre à partir des années 199034 ; elles ont été institutionnalisées au niveau européen par la création de l’Organisation conjointe de coopération en matière d’armement (OCCAr)35 en 2001, puis de l’Agence européenne de défense36 en 2004. En parallèle, et sur un plan bilatéral cette fois, des traités comme ceux de Lancaster House, signés en 2010 entre la France et le Royaume-Uni, scellent des partenariats en matière de défense et de sécurité.
On dénombre un total de 23 programmes conjoints à l’initiative de l’OCCAr. La France participe à 17 d’entre eux, contre 13 pour l’Allemagne, 12 pour l’Italie et 4 pour le Royaume-Uni. Ces programmes permettent des économies d’échelle à la fois sur le plan industriel, en assemblant des compétences techniques complémentaires, et sur le plan commercial, favorisant les achats groupés d’équipements de la part des États participants.
Depuis le début du conflit en Ukraine, l’UE s’est dotée d’un nouvel outil incitatif de court terme, pour encourager ses États membres à mutualiser leurs achats d’armement, notamment dans le domaine des munitions et missiles dont les besoins sont en croissance rapide. Pourvu d’un budget de 310 millions d’euros, l’EDIRPA (European Defence Industry Reinforcement through Procurement Act) est ainsi entré en vigueur le 27 octobre 2023. Son programme ASAP (Action de soutien à la production de munitions) a été lancé la même année.
La nécessaire convergence des intérêts et des besoins
Le succès d’une coopération, qu’elle soit interétatique ou industrielle, demande une convergence des intérêts (économiques, politiques ou militaires) et des besoins (industriels, calendaires ou financiers), dans un cadre de confiance et de valeurs partagées.
Pour Axel Nicolas, le partenariat franco-belge CaMo constitue un bel exemple d’une telle convergence. Ce programme CaMo (Capacité motorisée) s’inscrit dans un objectif d’interopérabilité des équipements entre les forces armées. L’accord intergouvernemental prévoit que la Belgique confie à la France le contrat d’acquisition et de livraison par KNDS France (ex-Nexter) de 382 véhicules blindés multirôles Griffon et de 60 engins blindés de reconnaissance et de combat Jaguar à l’armée belge. Ce partenariat, scellé en 2019, fait suite au constat par les forces armées belges d’un besoin de modernisation de leurs équipements, tandis que la France avait déjà entrepris le développement des véhicules Griffon et Jaguar dans le cadre du programme Scorpion37 (Dumoulin, 2025).
Ce qui est vrai pour les programmes de développement et d’acquisition l’est tout autant dans le cas des consolidations d’entreprises. L’histoire de la création de MBDA, première entreprise entièrement intégrée au niveau européen38, illustre bien cette nécessaire convergence des intérêts et des besoins pour parvenir à des synergies efficaces (Devaux et Ford, 2018). En 1994, le gouvernement britannique a lancé un appel d’offres en vue de l’achat sur étagère d’un missile de croisière, à la suite de l’usage de ce type d’arme par les États-Unis lors de la première guerre du Golfe, véritable démonstration de force aux yeux des Européens. Dès le départ, la compétition a été ouverte à l’international, faute d’une offre nationale suffisante. Matra Défense, filiale française de Lagardère spécialisée dans les missiles et les activités spatiales, avait déjà remporté l’appel d’offres français pour la conception du missile de croisière APTGD (arme de précision tirée à grande distance). L’entreprise française choisit donc de constituer un partenariat avec BAE Systems, afin de s’adapter aux exigences de retour industriel de la part du Royaume-Uni. En outre, la solution proposée par le consortium a permis de répondre aux exigences de furtivité du produit exprimées par les Britanniques, spécification réintégrée ensuite dans le contrat signé entre la DGA et la filiale française afin de mutualiser les volumes de production. Ce partenariat a donné naissance au missile de croisière SCALP en version française, et Storm Shadow en version britannique (ibid.).
Rapidement après la consolidation des activités aérospatiales françaises, avec la fusion Matra-Aérospatiale en 1998, le passage à l’échelle européenne de l’activité « missiles » est acté en 2001 par le rapprochement des entités britanniques, françaises et italiennes. Selon la Cour des comptes (2018), cette consolidation a généré un gain de l’ordre de 10 % sur le coût de production des missiles en série, par rapport à une production nationale sur un volume plus réduit. La consolidation aussi rapidement efficace des capacités industrielles a été rendue possible par le partage préalable d’une vision commune et d’habitudes de coopérations depuis les années 1990, qui ont instauré un climat de confiance réciproque entre les instances étatiques et les industriels (Devaux et Ford, 2018 ; Cour des comptes, 2018). En 2015, la création de centres d’excellence de MBDA a constitué une étape déterminante de l’intégration de l’entreprise. Fruits d’un accord entre les gouvernements britannique et français, ces centres mutualisent désormais les efforts de recherche technologique sur les missiles, entraînant un partage des savoirs entre les deux pays et, par conséquent, une interdépendance en matière de compétences stratégiques. Ce succès industriel illustre donc non seulement un cas réussi de constitution d’un « champion européen », mais également une incarnation possible de « l’autonomie stratégique ouverte » pensée à l’échelle européenne.
Les limites de la coopération européenne
Bien que le rapport de la Cour des comptes (op. cit.) souligne les succès technologiques des coopérations européennes auxquels participent les industriels français, ces derniers programmes représentent au contraire une perte d’efficacité lorsque les divergences de besoins ou d’intérêts sont trop importantes.
D’une part, les coopérations peuvent être substantiellement freinées par l’activation du principe du retour géographique, quand chaque pays exige un retour industriel sur son investissement, ce qui engendre une augmentation du nombre de sites de production. Pour Hugo Richard, le retour géographique est paradoxalement le ciment de la coopération européenne, parce qu’il a incité les États à participer à des programmes ambitieux, mais ses conditions de mise en œuvre grèvent en partie la compétitivité des programmes en raison d’une allocation des contrats industriels en fonction de la nationalité plutôt que du principe du best athlete, à savoir l’offre présentant le meilleur rapport qualité/coût.
D’autre part, il arrive que les États expriment des attentes très différentes autour d’un même système : à quel point l’hélicoptère doit-il faire face au feu ennemi, l’avion doit-il pouvoir se poser sur un porte-avions… ? Cela entraîne alors la fabrication de plusieurs versions d’un même système, ce qui en limite la standardisation et l’interopérabilité et en augmente les coûts (Droff et Malizard, 2023). L’hélicoptère Tigre, par exemple, est fabriqué sur quatre chaînes d’assemblage et en cinq versions, pour un nombre total d’unités produites de 185, à destination de seulement quatre États clients (Cour des comptes, 2018). Ainsi, la commande française des hélicoptères Tigre est passée de 215 appareils lors du lancement du programme à 71 en 2018, face à l’augmentation des coûts unitaires qui a conduit à réviser le volume demandé. Enfin, il convient de noter que les coopérations ne s’alignent pas systématiquement sur les intérêts politiques nationaux, lesquels varient en fonction du milieu. Par exemple, les chantiers navals en Europe répondent avant tout à un intérêt national, en particulier en France avec les exigences de la dissuasion.
- 32 — Cet échantillon est construit à partir de l’enquête Sandie.
- 33 — EDEN, cluster composé uniquement de PME et d’ETI et créé par 6 entrepreneurs rhônalpins, réunit aujourd’hui 270 adhérents liés à la défense, à la sécurité et à la sûreté dans différentes régions de France.
- 34 — En 1994, le Livre blanc sur la défense fait référence à la coopération européenne dans la continuité du traité de Maastricht et s’oriente vers une préparation active des capacités de défense européennes.
- 35 — L’OCCAr rassemble la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Italie, la Belgique et l’Espagne et supervise la conduite des programmes d’armement entre ces États. Il s’agit par exemple de l’hélicoptère de combat Tigre, des missiles sol-air ou mer-air FSAF, de l’avion de transport militaire polyvalent A400M, ou encore du véhicule blindé d’aide à l’engagement (VBAE).
- 36 — L’AED a été créée pour développer et consolider les capacités militaires de l’Union européennes. Néanmoins, son budget reste limité : en 2023, son budget général avoisine 47 millions d’euros et celui des projets ad hoc de coopération environ 285 millions supplémentaires. Par comparaison, le budget de la mission défense en France (hors pensions) s’élève à 43,9 milliards d’euros en 2023.
- 37 — Le programme Scorpion (Synergie du COntact Renforcé par la Polyvalence et l’Info valorisatiON) est un programme de modernisation de la composante terrestre (blindés, médians), autour du concept de combat collaboratif, qui transforme la chaîne de commandement sur les terrains d’opérations.
- 38 — Aujourd’hui filiale commune d’Airbus Group (37,5 %), BAE Systems (37,5 %) et Leonardo (25 %), MBDA est née de la fusion en 2001 des activités missiles de Matra Défense, Aérospatiale, BAe Dynamics et Finmeccanica (Leonardo aujourd’hui), rejoints par le groupe allemand LFK en 2006.
Focus – Coopération, intégration : le moment de vérité pour le marché européen de l’armement
par Renaud Bellais
L’industrie européenne d’armement est à un moment charnière. Pendant longtemps, elle a pu se développer et répondre aux besoins militaires sur une base nationale. L’évolution technologique et industrielle ne le permet plus pour les capacités militaires les plus ambitieuses : une européanisation s’avère nécessaire pour rester dans la course depuis le début du xxie siècle. L’accroissement récent et durable des dépenses militaires peut être un accélérateur en faveur d’une plus grande intégration du marché européen ou, au contraire, favoriser les forces centrifuges.
Les pays européens font face à un paradoxe. La période des « dividendes de la paix » aurait dû favoriser les programmes en coopération. Cependant, la faiblesse des budgets a conduit la plupart des pays à réduire les projets en commun afin de préserver leurs capacités industrielles nationales. Symétriquement, l’accroissement récent des dépenses a réduit l’appétence de ces mêmes pays pour partager les efforts. Dans les deux configurations, les forces centrifuges prédominent sur les facteurs propices à l’intégration du côté tant de la demande que de l’offre.
Il est donc prévisible que, quelle que soit l’évolution à moyen-long terme des dépenses militaires en Europe, l’émergence d’une base industrielle et technologique de défense réellement européenne soit peu probable si les dynamiques à l’œuvre reposent sur les seules préférences des gouvernements nationaux et des entreprises locales. Au-delà des intérêts particuliers, la logique de sécurité d’approvisionnement l’emporte sur la rationalité économique, ce qui est cohérent puisque les États ont créé leur industrie locale pour garantir un certain degré d’autonomie stratégique.
La coopération intergouvernementale peut aboutir à des réussites, à l’instar de l’hélicoptère Tigre ou des avions de missions A400M ou MRTT, voire plus récemment des véhicules blindés (Boxer, Scorpion/CaMo). Cependant, elle reste ponctuelle et incertaine. Nous restons toujours sur des « îlots de coopération » (Tomáš Valášek). Qui plus est, ces îlots peuvent disparaître si de nouveaux projets ne viennent pas entretenir la coopération étatique et industrielle.
C’est pourquoi la Commission européenne a le rôle important d’enclencher une réelle dynamique d’intégration, c’est-à-dire de construire une base industrielle sans barrières à l’échelle européenne, là où les coopérations intergouvernementales ont montré leurs limites depuis les années 1980 (Samuel Faure). Il faut en effet dépasser les limites des coopérations ad hoc entre États qui, contrairement à ce que nous avions pu espérer au tournant du siècle, n’ont pas un pouvoir intégrateur suffisant. La dynamique vertueuse du « programme en coopération et consolidation industrielle » s’est heurtée in fine à un plafond de verre.
Nous sommes à un moment charnière. La crise provoquée par l’invasion russe en Ukraine a créé les conditions pour faire avancer la construction d’une défense européenne. Les gouvernements ont confié à la Commission en mars 2022 la mission de mettre en place de nouveaux outils pour coopérer plus et mieux. La Commission souhaite maintenant pérenniser ces solutions d’urgence (EDIRPA, ASAP) à travers sa Stratégie pour l’industrie européenne de la défense (EDIS).
La Commission ne doit pas se substituer aux États, ce qui se heurterait automatiquement d’ailleurs à un veto des gouvernements. Mais elle doit devenir un catalyseur pour favoriser un marché de l’armement bien plus intégré en Europe. Elle peut le faire en faisant évoluer la régulation du côté de l’offre et de la demande à l’échelle de l’Union européenne, dans la continuité du « paquet défense » de 2009, mais aussi en incitant les États à coopérer en apportant des aides financières aux projets communs. Ces deux dimensions vont de pair pour passer au stade de l’intégration.
Renaud Bellais
Chercheur associé au Cesice, université Grenoble Alpes, et codirecteur de l’Observatoire de la défense de la Fondation Jean-Jaurès.
Une industrie hybride en quête d’agilité
Depuis la fin de la guerre froide et l’affaiblissement des dépenses militaires, les industriels ont été contraints de mettre en œuvre de nouvelles stratégies pour assurer leur rentabilité, leur compétitivité et conserver les compétences nécessaires à la supériorité de leurs équipements. L’essentiel des acteurs de la BITD a ainsi adopté un modèle dual, captant à la fois les opportunités des marchés civils et militaires, qui ne répondent pourtant pas aux mêmes spécifications et ne suivent pas le même rythme. Elle est, de ce fait, mise au défi de devenir plus agile pour continuer à renforcer la performance des systèmes de défense tandis que la concurrence s’intensifie et que les menaces deviennent « hybrides » 39.
Les marchés civils, impératifs pour la pérennité de la BITD
La dualité, c’est-à-dire l’interdépendance entre le développement des technologies civiles et militaires et l’évolution des marchés correspondants, est devenue intrinsèque au fonctionnement de la BITD. Une parfaite illustration en est donnée par Dassault, qui produit à la fois des Falcon, avion d’affaires pour le marché civil, et le Rafale. Pour Guillaume Muesser, « cette organisation a poussé les synergies à leur maximum, alors que les objectifs et contraintes du Rafale et des avions commerciaux demeurent bien différents ».
Au-delà de ce cas d’école, le portrait-robot de l’entreprise type travaillant pour la défense française est celui d’une PME dont 20 % du chiffre d’affaires provient d’activités militaires (EcoDef 260, 2025). Même les entreprises classifiées « stratégiques » par la DGA, c’est-à-dire dont les activités sont sensibles au regard des intérêts de la Nation, ont diversifié leur portefeuille, à l’image d’Alsymex. Cette entreprise spécialisée dans la mécanique de précision tire désormais 40 % de son chiffre d’affaires des activités de défense, contre 80 % historiquement. Cette augmentation de la part civile de ses activités provient de la relance du programme nucléaire civil, considéré comme « une véritable aubaine » pour la diversification des activités de l’entreprise, ayant notamment apporté de nouvelles ouvertures de projets scientifiques avec des centres de recherche.
Chiffres d’affaires des principaux donneurs d’ordres en 2023
Source : Calepin des entreprises internationales de défense, DGA.
D’un point de vue technique, cette stratégie de diversification consiste à exploiter au maximum les synergies entre les deux sphères d’activité (Mérindol et Versailles, 2015). Reprenons l’exemple d’Alsymex : en matière de numérisation et de fabrication additive, l’entreprise cherche à tirer le meilleur parti des avancées obtenues dans le civil pour le militaire et vice versa. Cela n’est évidemment possible que dans la mesure où le segment d’activité de l’entreprise se prête effectivement à des usages duaux : c’est typiquement le cas des satellites de communication, qui peuvent servir à la fois au ministère des Armées et aux opérateurs de téléphonie. Il faut également que les structures des coûts soient similaires : il doit s’agir de production à haute valeur ajoutée et en petites ou moyennes séries (Mérindol et Versailles, 2015). Guillaume Muesser cite ainsi l’exemple des freins carbone pour les avions civils, développés par Safran à partir de technologies issues des programmes de dissuasion. Safran a pu ainsi devenir l’un des leaders mondiaux de ce secteur : « La rentabilité du civil par rapport au marché de l’armement constitue une voie additionnelle au financement des innovations technologiques. »
Sur le plan économique, l’alternance des projets civils et militaires favorise la santé financière des entreprises et la résilience de la BITD : une baisse de commandes dans l’une des deux sphères peut ainsi être compensée par un regain d’activité dans l’autre. C’est exactement ce qui est arrivé à Dassault Aviation : sa diversification vers les avions d’affaires à partir des années 1980 a minimisé les conséquences de la réduction de la commande publique, tandis que la commande publique militaire a compensé les pertes essuyées sur le marché civil lors de la crise économique de 2007-2008 (Bellais, 2011).
En outre, la plus grande taille du marché civil implique généralement des séries plus longues, et donc la possibilité d’atteindre des économies d’échelle. De manière caractéristique, le segment civil contribue donc à réduire les coûts moyens de production, tandis que le marché de défense, où les volumes à produire et les prix de vente sont déterminés par contrat, limite de facto les perspectives de marge sur le marché domestique. Pour les mêmes raisons, l’innovation est elle aussi économiquement plus risquée quand elle est cantonnée à la sphère militaire (Oudot et Bellais, 2008 ; Mérindol et Versailles, 2015).
Enfin, l’étalement des commandes puis du déploiement opérationnel des gros systèmes d’armement, pouvant aisément représenter une décennie voire un demi-siècle pour un porte-avions, engendre un risque de perte de compétences au sein des entreprises, sur les postes de production et de R&D (Bellais, 2010 ; Bellais et Droff, 2016). En entretenant la dualité de leurs activités, les entreprises de la BITD maintiennent une charge de travail à peu près constante pour l’ensemble de leurs équipes. Safran, par exemple, a transféré les équipes chargées du développement des missiles balistiques vers le projet de motorisation de la fusée Ariane porté par l’Agence spatiale européenne.
Cette gestion des savoir-faire devient particulièrement critique lorsque surviennent des départs en retraite massifs d’ingénieurs et de techniciens : chaque changement générationnel des effectifs ralentit la transmission des savoir-faire techniques, pourtant déterminante pour assurer la continuité entre deux programmes. En cas de perturbation extérieure, cela peut mettre tout le système sous tension. Par exemple, le passage d’Ariane 5 à 6, dont le tuilage a été contrarié par la crise sanitaire et la guerre russo-ukrainienne, a entraîné un retard dans la stratégie spatiale de l’armée française, explique Hugo Richard : « Le satellite CSO-3 (composante spatiale optique) attendait depuis 2022 de compléter la miniconstellation de surveillance terrestre dont le vol a finalement été effectué en 2025. La transition entre la version 5 et 6 de la fusée s’est heurtée à une conjoncture défavorable. De la crise sanitaire, par l’arrêt des activités aérospatiales, à la guerre russo-ukrainienne, ces chocs ont fortement perturbé le planning du programme. La fin soudaine de l’exploitation de Soyouz depuis Kourou par Arianespace à quelques semaines du lancement prévu de CSO-3 a conduit les armées à patienter et à choisir de conserver leur satellite au sol le temps qu’Ariane 6 soit prête à le lancer, ce qui a été fait le 6 mars 2025. Ces opérations avaient pour objectif de faire tampon entre les deux versions et de compléter les missions d’Ariane 5 pour déployer les constellations en orbite terrestre basse qui sont au cœur de la demande actuelle. »
La dualité des activités s’exprime différemment en fonction du positionnement des entreprises dans la chaîne de valeur et des milieux d’opérations (terre, air, mer, cyber). Des MOI du naval et du terrestre tels que Naval Group et KNDS, par ailleurs issus d’arsenaux nationaux, restent davantage tournés vers le militaire parce que leurs activités offrent peu de possibilités de diversification40. À l’inverse, les secteurs de l’aéronautique et des TIC sont fortement orientés vers le civil, bénéficiant de plus larges possibilités de transférer des technologies. « Les sphères peuvent aussi être mutuellement dépendantes, comme pour ArianeGroup pour qui ni le civil ni le militaire n’ont la taille critique pour pouvoir subsister sans le soutien de l’autre : il faut des commandes publiques pour survivre dans le secteur spatial. Plus précisément, une inversion semble se produire entre les niveaux supérieurs et inférieurs de la chaîne de valeur : les MOI, en haut de la chaîne, ont des activités distinctes sur chacun des deux marchés, tandis que leurs fournisseurs industriels de rangs élevés ont souvent une seule activité dont les usages concernent de multiples filières. À toute généralité, des exceptions existent. Il y a des technologies dites “orphelines” que l’on ne peut développer ni à l’export ni dans le civil : pour un fabricant de catapultes pour porte-avions ou de chaufferies nucléaires, l’activité est entièrement dédiée au militaire », (Hervé Guillou).
Le marché civil, nouveau driver technologique
L’apport du civil dans les effets d’entraînement de la R&D militaire
La fin de la guerre froide et l’application croissante d’innovations issues de la sphère civile au champ militaire ont remis en question le paradigme selon lequel la R&D militaire était un moteur privilégié de l’innovation technologique et, par conséquent, de la croissance économique. Charles Maisonneuve avance l’idée d’une rupture dans la diffusion des innovations : « Auparavant, la sphère militaire était un moteur dans le développement d’innovations. Avec la fin de la guerre froide, le marché militaire s’est contracté alors que celui du civil s’est développé, et l’innovation a été plus florissante de ce côté. » Notamment, les analyses de causalité montrent depuis les années 1990 un affaiblissement des externalités de la R&D à usage militaire sur l’économie civile (Guichard, 2003), bien qu’il n’y ait pas de consensus sur les effets des dépenses militaires, ces derniers variant selon la temporalité et la zone géographique étudiée. Chu et Lai (2012) modélisent quant à eux les externalités positives de la R&D militaire sur la croissance économique sous la forme d’une courbe en U inversé : tant que les investissements ne franchissent pas un seuil déterminé, les retombées de la R&D militaire sont supérieures aux coûts engagés.
Dans cette réflexion, le rôle du marché civil a été mis en avant à la fois parce qu’il permet une vaste diffusion des fruits de la R&D militaire grâce à la consommation de masse et parce qu’il ouvre l’accès à de nouvelles sources de financement. Prenons l’exemple d’Internet, souvent cité comme l’archétype de l’innovation de rupture résultant de la R&D militaire. Instruit par le ministère de la Défense américain et géré par la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA, anciennement ARPA), le projet Arpanet a connu un développement et des progrès très significatifs du fait de son transfert vers le marché civil. Cela a favorisé l’obtention de financements, un dynamisme entrepreneurial et l’accès à de nouvelles briques technologiques. Plus profondément, cela a transformé ce qui était un réseau de communication des données en une interface de mise en réseau (Serfati, 2008 ; Mowery et Simcoe, 2002). Cette transformation radicale conduit Hinde Doux à avancer que « les innovations de rupture sont issues du secteur civil, même lorsque leur amorce ou leur premier financement proviennent du militaire. L’exemple emblématique d’Internet en témoigne : s’il a été conçu dans un cadre militaire, sa généralisation et son développement à grande échelle n’auraient jamais été possibles sans le soutien massif du monde civil. » Le GPS a également connu un développement massif par l’ouverture au marché civil, qui a tout à la fois baissé les coûts de production et optimisé le système (Kumar et Moore, 2002).
Parfois, le marché civil n’est pas seulement déterminant pour le développement et la rentabilité des innovations issues de financements militaires (spin-off) ; c’est lui qui accouche certaines fois de technologies qui seront plus tard appliquées à des usages militaires (spin-in), comme l’établit Vernhes (2024). Initialement orientée vers le marché civil des produits multimédia, la TPE toulousaine Vodéa a reçu des subventions du programme Rapid41 (Régime d’appui à l’innovation duale) et s’est ainsi spécialisée dans les activités militaires en tant que fournisseur de l’enregistreur vidéo pour le Rafale (IRIS, 2015).
Une intensification des flux d’innovations civiles vers la sphère militaire
Les TIC constituent les technologies qui bénéficient le plus fortement de synergies entre le civil et le militaire. Issues pour partie de financements militaires, elles ont connu un rapide déploiement dans le civil, tandis que leur développement massif dans les combats a changé les stratégies militaires. Par exemple, dans le cadre du programme Scorpion, l’hélicoptère Tigre, conçu pour des missions de combat, est équipé de dispositifs de communication permettant la mise en réseau des différents systèmes de défense de l’armée de terre, afin de développer le combat collaboratif.
Plus récemment, la guerre en Ukraine a confirmé l’accélération des innovations provenant de la sphère civile (intelligence artificielle, technologies cloud, drones autonomes…), qui viennent enrichir les technologies à usage militaire. En particulier, la constellation de satellites Starlink déployée par SpaceX est devenue indispensable aux communications de l’armée ukrainienne, bien que celles-ci ne se soient pas aussi sécurisées qu’avec des satellites entièrement militaires, rappelle Alexandre Houlé, directeur de la stratégie de Thales. Hinde Doux prend quant à elle l’exemple des drones pour illustrer la capacité de la BITD à intégrer des technologies venues du monde civil : « Le civil a étendu et structuré le segment du drone. Les armées se sont ensuite approprié ces outils en achetant des composants “sur étagère” pour les rendre conformes à leurs attentes, en renforçant par exemple leur conception pour les rendre résistants à des environnements climatiques extrêmes ».
Charles Maisonneuve décrit ainsi ce qu’il perçoit comme une évolution forte des flux de transfert d’innovations : « Aujourd’hui, peu de technologies sont développées par l’armée et transférées dans le monde civil. Par exemple, le blindage conçu à des fins militaires possède quelques applications civiles mais qui restent limitées. Au contraire, le secteur de la défense se distingue par sa capacité à capter des technologies, souvent dérivées du secteur civil et adaptées aux besoins militaires. »
Vers plus d’agilité pour conserver la supériorité technologique
Les efforts d’ouverture des acteurs de la défense
L’intégration des innovations civiles dans la défense (spin-in) suppose que les acteurs de ce domaine adoptent de nouvelles pratiques organisationnelles, notamment au profit d’une plus grande agilité (Guichard, 2003 ; Mérindol et Versailles, 2024). Il ne s’agit pas seulement de savoir intégrer de nouvelles connaissances provenant du civil ou de l’étranger, mais surtout de pouvoir le faire rapidement, même lorsqu’elles concernent une haute technologie très consommatrice en connaissances.
Un schéma « bicéphale » s’observe donc aux États-Unis, où un processus d’innovation dirigé au sein du complexe militaro-industriel cohabite avec un dispositif d’intégration des avancées technologiques mondiales circulant librement. Cela est d’autant plus important que la circulation libre et abondante des connaissances entre auteurs de publications et déposants de brevets concourt à favoriser les innovations de rupture et à élever la compétitivité des entreprises (Charlet, 2025). L’ouverture vers le civil du management de l’innovation de défense n’est pas seulement une option, mais une condition pour maintenir la supériorité technologique des forces armées.
Selon Kévin Martin, chargé de recherche au pôle Défense et Industries de la Fondation pour la recherche stratégique, « les chocs suscités par la pandémie de Covid puis par la guerre russo-ukrainienne ont fait prendre conscience à la DGA de la nécessité d’accélérer et de renforcer sa transformation en vue de faire face aux problématiques actuelles (dépendances aux matières premières, sécurité des chaînes d’approvisionnement, enjeux liés à l’industrie 4.0, accélération des cadences de production, etc.). En matière d’innovation, il s’agit aussi de s’ouvrir aux innovations d’usages liées notamment aux produits ou solutions détournés du marché civil et adaptés à la défense, à l’instar de l’irruption de petits drones, bon marché, sur les théâtres d’opérations. » Alexandre Figuière, consultant chez Dassault Systèmes ajoute que, pour affronter ces chocs, « l’industrie de la défense doit être aussi solide et stable que le chêne, puisque ses principaux programmes sont à très long terme et donc immanquablement monolithiques et rigides, mais doit également préserver son avenir en se montrant souple et agile comme le roseau, afin de pouvoir tirer profit des évolutions sans cesse renouvelées du marché ».
Qui plus est, la variété des menaces contemporaines (cyber, économiques, militaires) brouille davantage encore les frontières traditionnelles entre ces deux sphères, et contraint la DGA à s’ouvrir davantage (Louise, 2022). Cette dernière essaye donc de s’inscrire dans un schéma d’innovation ouverte, et notamment de fluidifier la circulation des connaissances scientifiques entre ses réseaux d’innovation pour nourrir les programmes d’armement. L’Agence de l’innovation de défense (AID), créée en 2018, a précisément pour mission de favoriser le transfert d’innovations issues du civil. La création de l’AID est également un moyen pour se connecter à des écosystèmes d’innovation transverses, intéressant un large ensemble d’applications militaires (Mérindol et Versailles, 2024). En plus d’intégrer de nouvelles briques technologiques, l’AID sert également de catalyseur de nouvelles pratiques. Pour Valérie Mérindol, professeure à Paris School of Business, « la porosité qu’entretient la BITD avec les autres écosystèmes n’a jamais été aussi prononcée qu’aujourd’hui et permet d’envisager une innovation plus dynamique. Beaucoup reste à faire pour développer de nouvelles innovations, mais l’AID agit comme une sorte d’orchestrateur de réseau pour favoriser les synergies civiles-militaires. »
Quant aux industriels de la BITD, selon Arnaud Génin, ils ont « diversifié leurs sources d’innovation en investissant dans la création d’open labs [laboratoire d’innovation ouverte] ou dans des partenariats avec des acteurs du civil, comme l’a fait le chantier naval boulonnais Socarenam avec Michelin [pour équiper un futur patrouilleur de la Direction des affaires maritimes 42 d’une voile qui réduit la consommation d’énergie des navires]. C’est tout l’écosystème défense qui cherche à faire de l’innovation un véritable levier amplificateur de l’efficacité opérationnelle future. » Un autre exemple est donné par Thales, qui travaille avec le CEA-Leti, sur des composants avancés à base de silicium, et Sorbonne Université sur l’intelligence artificielle. L’entreprise a également créé un fonds d’investissement consacré aux start-up critiques pour les activités de l’entreprise. En revanche, « l’acquisition pure et simple de start-up est plutôt rare : l’entreprise souhaite préserver leur agilité et leur mode de fonctionnement particulier, car ces intégrations peuvent parfois étouffer son modèle. Aussi, l’entreprise privilégie avec les start-up des partenariats et l’intégration de leurs innovations au sein de leurs solutions », selon Alexandre Houlé.
Les freins aux synergies entre l’innovation civile et militaire
Bien que les contraintes budgétaires et l’essor de la R&D civile aient poussé les entreprises de défense à s’ouvrir vers les marchés civils et les partenaires académiques, ces synergies se heurtent encore à des obstacles structurels et culturels. En particulier, les différences de structure de coûts et de temporalité freinent l’intégration des connaissances et des compétences civiles sur le marché de la défense. Les systèmes de défense sont en effet développés par des contrats qui fixent les volumes et les prix, avec des prévisions de croissance limitées aux exportations qui restent incertaines. Les flux de trésorerie dépendent des calendriers fixés par la commande publique, souvent dans le cadre de séries courtes. Les enveloppes budgétaires sont calculées au plus serré par rapport aux spécifications et atteignent le juste prix pour compenser les coûts de l’entreprise, sans perspective d’accroissement de gains dans le futur (Oudot et Bellais, 2008). À l’inverse, le secteur civil suit une courbe en S, où les produits doivent d’abord convaincre des early adopters avant de bénéficier de financements supplémentaires pour une production à plus grande échelle et une réduction des coûts (Mérindol et Versailles, 2015).
Sur un autre plan, l’organisation rigide et verticale du secteur de la défense apparaît parfois à contresens du mode d’innovation privilégié dans le civil, qui s’appuie sur la libre circulation des connaissances. Les restrictions volontaires ou non concernant les transferts technologiques sur les marchés de défense en sont une illustration importante (Mérindol, 2004). Par exemple, le faible nombre de citations scientifiques figurant dans les brevets déposés par les grandes entreprises innovantes de défense, relativement aux grandes entreprises innovantes de tous secteurs, freine d’autant la circulation des connaissances43.
Pour Cédric Lowenbach, référent défense chez Bpifrance, l’innovation au centre de la compétitivité de la BITD est par définition duale et doit être soutenue comme telle, par la collaboration des grands groupes avec les start-up et les PME (ou leur acquisition). Il constate « le haut niveau technologique des start-up, que ce soit dans l’intelligence artificielle, le quantique ou dans le spatial, et estime que cet axe de développement sera critique pour l’industrie de demain. Le principal challenge de ces dernières années est plutôt de trouver des financements pendant les phases de développement, tandis que le fonctionnement structurel des grands groupes historiques les pousse à agir sur le temps long. » Damien Bajard, responsable commercial grands comptes de la PME Elistair, plaide à ce sujet pour un assouplissement des pratiques des donneurs d’ordre afin d’éviter l’entrechoc entre le « temps long » et le « temps court », qui évince les start-up de cette industrie.
À ces contraintes s’ajoutent encore d’autres barrières, notamment de nature réglementaire, qui freinent l’arrivée d’acteurs issus du civil sur le marché de la défense. Damien Bajard confirme que « la principale difficulté, que ce soit pour les start-up, les PME ou les grandes entreprises, concerne la transformation de ces innovations en équipements en série. En effet, l’industrialisation est très souvent ralentie par des contraintes administratives (évaluation opérationnelle, spécifications, rédaction du marché, attribution des lignes budgétaires). Ces contraintes frappent plus durement les start-up ou les PME, car elles ne possèdent pas de trésorerie assez importante pour amortir leurs investissements. »
Sur le plan théorique, il n’y a aucun doute que l’ouverture à la concurrence stimule l’innovation (Aghion et al., 2005). Jérôme Faul, président du fonds d’investissement Innovacom, a beau déplorer des réflexes « de lobbying ou de contrôle de l’accès aux contrats », il admet également que l’impératif d’innovation reste subordonné aux « préoccupations de sécurité nationale et [à] la nécessité d’une fiabilité à long terme ». Damien Bajar regrette quant à lui que « la communication, bienvenue et favorable, qui est élaborée en faveur de l’innovation ne s’accompagne pas d’actions concrètes pour soutenir les efforts ».
- 39 — Ces menaces « hybrides » sont définies par le Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN) comme la quête de gains politiques, territoriaux, économiques, combinant des modes d’action militaires et non militaires, directs et indirects, légaux ou illégaux, tels que l’utilisation de groupes armés, le cyber, le spatial, la manipulation de l’information ou l’instrumentalisation du droit (Louise, 2022).
- 40 — À noter que ces mêmes entreprises dédiées à la défense conduisent, toutefois, des projets avec des sous-traitants ou partenaires qui sont le plus souvent des entreprises duales : 75 % des entreprises du Gican sont duales et les marchés civils pèsent pour 30 % du chiffre d’affaires global de la filière.
- 41 — Rapid a été émis en place en 2009 en partenariat avec la Direction générale des entreprises (DGE) du ministère de l’Économie et des Finances. Ce dispositif de subvention vise à soutenir des projets d’innovation d’intérêt dual portés par des PME ou des ETI de moins de 2 000 personnes. La dotation annuelle du programme Rapid est de 50 M€. En 2021, 57 projets ont été sélectionnés pour un montant total de 43 M€.
- 42 — Il s’agit d’un navire patrouilleur effectuant des missions de police ou de l’Action de l’État en mer (AEM) en métropole.
- 43 — Fauconnet (2021) observe en effet qu’une augmentation d’un point de pourcentage du taux de dépendance au marché de la défense entraîne une réduction moyenne de 0,977 du nombre de citations scientifiques.
Point de vue – L’incompatibilité de la DARPA dans le modèle d’innovation européen
par Valérie Mérindol
La darpa est très souvent citée comme l’exemple à suivre pour promouvoir des innovations disruptives et faire émerger de nouveaux écosystèmes à même de soutenir leur développement. Cette agence du Pentagone couvre autant des innovations à usage militaire que civil et son action concerne les domaines porteurs de technologies de rupture pour la sécurité et la compétitivité nationales.
La création d’une DARPA européenne fait l’objet d’un débat ancien, qui revient en force. Cette agence apparaît comme un instrument de politique publique particulièrement adapté pour soutenir l’émergence rapide d’innovations technologiques diffusantes (c’est-à-dire dont les usages sont intersectoriels, comme l’intelligence artificielle) ou encore pour des sauts technologiques majeurs qui requièrent de favoriser des synergies croissantes entre écosystèmes civils et militaires.
Mais force est de constater que les Européens ne sont jamais arrivés à créer une telle agence tant au niveau national qu’européen. Cette situation ne s’explique pas seulement par les efforts financiers d’ampleur différente entre les deux continents. Elle s’explique surtout par le fait que la transposition du modèle de la DARPA américaine vers l’Europe nécessite l’acceptation d’un cadre institutionnel et culturel, ainsi que l’adoption de pratiques et de processus antinomiques avec les modèles d’innovation actuellement en vigueur en Europe. Donnons ici quelques exemples majeurs.
La DARPA s’appuie sur un cadre institutionnel et culturel qui promeut le risque par des financements publics qui n’aboutissent pas tous à des résultats. Ainsi, ce fonctionnement concourt au développement de communautés d’exploration qui transcendent les silos organisationnels et institutionnels, lesquels entravent l’innovation en Europe. Son action s’inscrit principalement dans le temps long et à contre-courant de la logique des prérogatives institutionnelles, notamment vis-à-vis des forces armées américaines qui privilégient le court terme en cohérence avec leurs impératifs opérationnels.
En outre, les recrutements au sein de la DARPA reposent à la fois sur des critères d’excellence et de mobilité. Les chefs de projets doivent disposer de compétences autant scientifiques qu’entrepreneuriales de très haut niveau. Les personnes recrutées sont les mieux qualifiées pour piloter des projets technologiques risqués, animer de nouveaux écosystèmes d’innovation et encourager le recours à l’expérimentation rapide. Les modes d’action et de financement agiles de cette agence leur laissent une grande liberté d’action. La DARPA peut intervenir sur tout. Rien n’est interdit.
Pour conclure, une DARPA européenne n’a jamais pu émerger sur notre continent parce que l’Europe s’est plus attachée à la forme (une agence) qu’au fond (les principes institutionnels et organisationnels qui la sous-tendent). Transposer le modèle de la DARPA en Europe, c’est avant tout adopter des pratiques, des processus et un cadre institutionnel différents et moins contraignants que ceux que l’on connaît actuellement, qui privilégient le contrôle sur l’autonomie d’action et le risque, le respect des prérogatives et l’organisation en silos ou encore les contraintes de juste retour entre pays européens. L’Europe se doit d’être plus « inventive » sur les instruments de politique publique qu’elle souhaite mettre en œuvre plutôt qu’essayer de dupliquer des modèles sans en comprendre ce qui fait leur succès.
Valérie Mérindol
Professeure à Paris School of Business.
Conclusion
L’industrie de la défense doit répondre à la fois à des lois économiques, qui exigent qu’elle soit toujours plus compétitive, et à des impératifs géopolitiques qui consistent à préserver l’autonomie stratégique de la France. Dès lors, on ne peut comprendre la performance de cette industrie sans tenir compte d’emblée de l’action de l’État en la matière. L’ambition géopolitique et militaire de la France s’incarne notamment au moyen d’une industrie capable de produire des systèmes de défense hautement performants pour ses forces et de convaincre, comme clients à l’export, les États avec lesquels notre pays souhaite entretenir des liens diplomatiques.
Or les chiffres soulignent de manière probante que l’industrie française de défense est parvenue à se démarquer sur les marchés internationaux par la qualité et la fiabilité de son matériel innovant, éprouvé sur le terrain et soutenu au plus haut niveau de l’État.
Toutefois, la commande publique s’est sensiblement contractée depuis le début des années 1990, tandis que les coûts de production des systèmes de plus en plus complexes continuent d’augmenter et que le seuil des investissements pour parvenir aux innovations critiques ne cesse de s’accroître. Pour les industriels, l’autofinancement sur ce marché est particulièrement désincitatif, en raison des risques industriels élevés et des perspectives de rendement restreintes par de faibles volumes et une incertitude importante sur les commandes envisageables à l’export. Pour consolider leur croissance, certains industriels ont donc entamé, depuis plus de vingt ans et avec l’aval de la DGA, une stratégie de diversification en se tournant vers le marché civil. En parallèle, les coopérations, voire les rapprochements d’entreprises s’étendent progressivement à l’échelle européenne.
À observer les stratégies déployées par les acteurs de la défense, on peut tirer de précieux enseignements valables pour l’ensemble des filières. Le premier réside dans l’organisation de la BITD autour d’un objectif commun, d’ordre supérieur, et dans la capacité des acteurs à s’insérer dans une dynamique collective. Les interactions fréquentes entre acteurs publics et privés, à divers niveaux de la chaîne, constituent le ciment d’une confiance durable, et se présentent comme un levier de compétitivité et de résilience.
Un deuxième enseignement tient à la maîtrise de la chaîne de valeur, qui répond elle-même à un impératif d’autonomie stratégique. Toute la filière fait l’objet d’une politique de sécurisation des approvisionnements, partagée par les interlocuteurs publics et privés. Que ce soit pour la DGA comme pour les MOI, la présence de vulnérabilités au sein de la chaîne de valeur est susceptible de compromettre non seulement la performance des systèmes et des acteurs, mais également les savoir-faire critiques au regard des ambitions économiques et politiques du pays. Bien que controversé, le rôle particulier de la DGA dans l’organisation de cette industrie est à souligner. Depuis la fin de la guerre froide, celle-ci s’est adaptée aux nouvelles conditions économiques, en gardant un contrôle attentif sur le système productif tout en externalisant la compétence de maître d’œuvre à des MOI privés. Cette agence d’État, dotée de moyens techniques, humains et financiers de prospective et de programmation, a su ainsi concilier innovation, contraintes budgétaires et préservation des équilibres au sein du secteur.
L’augmentation de la demande amorcée depuis le conflit russo-ukrainien pourrait offrir de nouvelles perspectives de croissance aux entreprises françaises, tout comme les nouveaux objectifs assignés aux États membres de l’Otan depuis ce mois de juin 2025. Certaines fragilités industrielles demeurent toutefois, au premier rang desquelles la santé financière d’un tissu productif composé de PME et ETI, mise à rude épreuve. En effet, la réduction des commandes publiques a interrompu les effets de série et contribué à un sous-investissement dans le capital fixe de ces entreprises. En conséquence, les PME éprouvent des difficultés à amorcer la montée en cadence attendue dans un contexte de réarmement mondial. Certains observateurs ont envisagé qu’une ouverture de la BITD à l’échelle européenne, pour renforcer sa compétitivité, pourrait avoir des répercussions à double tranchant. Augmentant la concurrence tant au niveau de l’offre que de la demande, elle pourrait déstabiliser le jeu établi des États et des industriels à l’heure où l’augmentation des cadences de production se révèle déjà problématique.
Enfin, le parti-pris de la compétitivité hors prix et de la performance technique des entreprises de la BITD, encouragé par les ambitions nationales, est régulièrement réinterrogé, notamment face à la perspective de conflits de haute intensité. Le double besoin d’équipement des forces, en masse et de haute technologie, semble se traduire par une scission du marché mondial de la défense. D’une part, le segment historique, encadré par les grands programmes d’armement, continue de répondre en premier lieu aux exigences de supériorité technologique. D’autre part, un segment en pleine croissance, rythmé par la concurrence étrangère et l’urgence des besoins de court terme, vient répondre à une demande en munitions « d’usure ». Dans ce contexte, l’offre industrielle se redéfinit autant par l’entrée de nouveaux acteurs que par le décloisonnement des sphères entre civil et militaire.
Bibliographie
Abi-Saab, P., Bonneau, J., Bonneau, M., David, C., Francoz, D., Favre, F., & Weisburger, E. (2002). Recherche & Développement en France : Résultats 2000, estimations 2001, objectifs socio-économiques du BCRD 2002. [rapport]. Ministère de la Jeunesse, de l’Éducation nationale et de la Recherche, Direction de l’évaluation et de la prospective.
Aghion, P., Bloom, N., Blundell, R., Griffith, R., & Howitt, P. (2005). Competition and innovation : an inverted-U relationship. The Quarterly Journal of Economics, 120(2), 701-728.
Antolin-Diaz, J., & Surico, P. (2025). The long-run effects of government spending. American Economic Review, 115(7), 2376–2413.
Belin, J. (2015). Les entreprises françaises de défense : caractéristiques économiques et financières. Revue Défense Nationale, 780(5), 28-33.
Belin, J., Cavaco, S., & Guille, M. (2008). Analyse économique et financière des PME défense très innovantes. EcoDef, 50.
Belin, J., Guille, M., Lazaric, N., & Mérindol, V. (2019). Defense firms adapting to major changes in the French R&D funding system. Defence and Peace Economics, 30(2), 142-158.
Bellais, R. (2010). Une industrie de défense en transition. Implications pour la sécurité internationale. In Fontanel, J. (éd.), Économie politique de la sécurité internationale. L’Harmattan.
Bellais, R. (2011). Restructuration et coopération, l’avenir des industries de défense française ? Géoéconomie, 57, 109-119.
Bellais, R., & Droff, J. (2016). Innovation, technology and defense procurement : Reform or paradigmatic shift ? In K. Burgess et P. Antill (éds), Emerging Strategies in Defense Acquisitions and Military Procurement. IGI Global.
Bellais, R., Foucault, M., & Oudot, J.-M. (2014). Évolution et régulation de l’industrie de défense. Économie de la défense (p. 21-38). La Découverte.
Béraud-Sudreau, L. (2020). Dépenses militaires en Europe dans les années 2010 et leçons pour l’ère post-Covid 19. Revue Défense nationale, 832(7), 19-26
Béraud-Sudreau, L. et Meijer, H. (2016). Enjeux stratégiques et économiques des politiques d’exportation d’armement. Une comparaison franco-américaine. Revue internationale de politique comparée, 23(1), 57-84.
Bernard, J.-L., & Carré, A. (2004). Rapport d’information sur les conditions d’exécution des grands programmes de défense (N° 1922). Assemblée nationale.
Bezzon, B. (2024). Allier industrie et ruralité : Aurillac-Figeac-Rodez. Les Docs, La Fabrique de l’industrie.
Briani, V. (2013). The costs of non-Europe in the defence field. Centre for Studies on Federalism, Moncalieri, and Istituto Affari Internazionali, Rome.
Buffotot, P. (2016). Les Lois de programmation militaire en France : un demi-siècle de programmation. Paix et sécurité européenne et internationale, 4.
Cabirol, M. (2019). Exportations : comment MBDA desserre le nœud coulant des États-Unis (ITAR). La Tribune, 27 mars.
Calzada, C. (2020). Dépendance stratégique aux matériaux critiques de la BITD française.
Charlet, V. (2025). Aux sources de l’innovation de rupture. Les Notes de la Fabrique, Presses des Mines.
Chu, A.C. & Lai, C.-C. (2012), On the growth and welfare effects of defense R&D. Journal of Public Economic Theory, 14(3), 473-492.
Collet-Billon, L. (2022). La délégation générale à l’armement, l’enjeu des liens entre public et privé. L’ENA hors les murs, 513(3), 44-46.
Cornu, C., & Dussauge, P. (1990). L’Industrie française de l’armement. Economica.
Coulomb, F. (2017). Industries de la défense dans le monde. Presses universitaires de Grenoble.
Cour des comptes (2001). Les industries d’armement de l’État [rapport]. Les éditions des Journaux officiels.
Cour des comptes (2018). La coopération européenne en matière d’armement. Un renforcement nécessaire soumis à des conditions exigeantes [rapport]. Documentation française.
Dagnino, G. B., Le Roy, F., & Yami, S. (2007). La dynamique des stratégies de coopétition. Revue française de gestion, 176(7), 87-98.
De Durand, É. (2007). Quel format d’armée pour la France ? Politique étrangère, 2007(4), 729-742.
Depeyre, C., & Dumez, H. (2007). Le rôle du client dans les stratégies de coopétition. Revue française de gestion, 176(7), 99-110.
Devaux, J.-P., & Ford, R. (2018). Scalp EG / Storm shadow : les leçons d’une coopération à succès. Recherches & Documents, 2018(9).
Devaux, J.-P., Freland, J.-J., Matelly, S., Maulny, J.-P., Colomina, P., & Decis, H. (2019). Fusion et acquisition dans le domaine de la défense. Étude prospective et stratégique 2018(24).
Dolignon, C. (2018). Les entreprises de la BITD à l’aune d’une analyse de réseaux. EcoDef, 102.
Droff, J., & Malizard, J. (2014). Cohérence entre politique budgétaire et budget de défense en France. Revue Défense nationale, 769, 116-121.
Droff, J., & Malizard, J. (2023). Le prix de la souveraineté aéronautique en Europe : une approche économique. Revue Défense nationale, hors-série (11), 121-126.
Dumoulin, A. (2025). Belgique et défense européenne : comment ne plus être le « passager clandestin » ? Revue Défense nationale, 881(6), 130-139.
Dupuy, R. (2013). L’industrie européenne de défense : changements institutionnels et stratégies de coopétition des firmes. Innovations, 42(3), 85-107.
EcoDef L’excédent commercial lié aux matériels de guerre se contracte en 2022 EcoDef Statistiques
EcoDef Quelle était la situation financière des entreprises de la BITD avant la guerre en Ukraine ? EcoDef Études
EGE. (2018). Les enjeux de la réglementation ITAR dans le blocage de la vente des missiles SCALP à l’Égypte. École de guerre économique.
Fauconnet, C., (2019). La structuration des bases de connaissances des entreprises de défense [thèse]. Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Fauconnet, C. (2021). Spécificités des entreprises de défense et processus d’innovation : une approche empirique par les références scientifiques contenues dans les brevets. Revue d’économie industrielle, 175(3), 63-97.
Fontanel, J., & Hébert, J.-P. (1992). L’importance économique de l’industrie française d’armement. ARES, 13(4), 85–121.
Fontanel, J. (2001). L’avenir de la défense européenne. In G. Casale (éd.), Europe: What Kind of Integration ?
Fontanel, J. Les dépenses militaires dans le monde en 2021 selon le SIPRI. Hypothèses, intérêt, limites. Paix et sécurité européenne et internationale, 2023, 19, 10.61953/psei.3439. halshs-03987439.
Fromion, Y. (2006). Rapport sur les exportations de défense et de sécurité de la France. Mission confiée par Dominique de Villepin, Premier ministre.
Fuller, W. (2024). La recherche de l’équilibre entre complexité et efficacité face au mythe de la simplification. Revue Défense nationale, hors-série (HS15), 95-106.
Granier, C., & Ellie, P. (2021). Ces territoires qui cherchent à se réindustrialiser Les Notes de la Fabrique, Presses des Mines.
Guichard, R. (2003). Éléments pour un repositionnement de l’innovation de défense au sein du système d’innovation français.
Hérault, P. (2015). La Base industrielle et technologique de défense à l’âge de la globalisation. Revue Défense nationale, 784(9), 95-100.
Hérault, P. (2018). L’internationalisation des chaînes de valeur dans l’industrie de défense : le cas du naval [thèse]. Université Paris sciences et lettres.
Hobday, M., Rush, H., & Tidd, J. (2000). Innovation in complex products and systems. Research Policy, 29, 793-804.
Hoeffler, C. (2008). Les réformes des systèmes d’acquisition d’armement en France et en Allemagne : un retour paradoxal des militaires ? Revue internationale de politique comparée, 15(1), 133-150.
Hoeffler, C. (2013). L’émergence d’une politique industrielle de défense libérale en Europe : appréhender le changement de la politique d’armement par ses instruments. Gouvernement et action publique, 2(4), 641-665.
Insee (2024). Note de conjoncture – Depuis l’invasion de l’Ukraine, l’industrie de défense française bénéficie d’une hausse des commandes et a augmenté sa production, mais bute sur des contraintes d’offre.
IRIS (2015). Origines des technologies critiques dans l’industrie de défense en France : spin-ins ou spin-offs entre la défense et le civil ? Traitement qualitatif et quantitatif : synthèse de l’étude. Étude prospective et stratégique, N° CHORUS : 214.1050146747 – EJ n° 1506019487.
Joana, J. (2008). Armée et industrie de défense : cousinage nécessaire et liaisons incestueuses. Pouvoirs, 125(2), 43-54.
Joana, J. (2020). Guerre et changement dans la politique d’armement. Les achats en urgence opérationnelle des armées françaises en Afghanistan. Gouvernement et action publique, 9(3), 9-30.
Kumar, S., & Moore, K. B. (2002). The evolution of global positioning system (GPS) technology. Journal of Science Education and Technology, 11, 59-80.
Lazaric, N., Mérindol, V., & Rochhia, S. (2009). La nouvelle architecture de l’industrie de la Défense en France. Économie et Institutions, 12–13, 31–60.
Lefeez, S. (2013). Toujours plus chers ? Complexité des armements et inflation des coûts militaires. Focus stratégique, 42.
Lefebvre, M. (2018). La politique étrangère américaine. (3e éd.). Presses universitaires de France.
Lerousseau, J. (2021). L’évaluation des retombées économiques locales de la dépense de défense. EcoDef Références, 185. IISN 1293-4348. halshs-04310373.
Livet, A. (2025). Sobriété énergétique et forces armées : les low-tech sont-ils une solution ? Fondation pour la recherche stratégique. Recherches & Documents, 7.
Louise, D. (2022). La Direction générale de l’armement à l’ère des menaces hybrides. Revue Défense nationale, hors-série (HS3), 308-319.
Malizard, J. (2011), Dépenses militaires et croissance économique, Thèse de doctorat, Université Montpellier 1.
Malizard, J. (2015). L’innovation comme facteur de croissance, l’exemple de grands groupes industriels de défense français. Revue Défense nationale, 780(5), 34-39.
Martin, K. (2022). La Corée du Sud sur le marché international de l’armement terrestre : l’exemple européen. Fondation pour la recherche stratégique. Défense & Industries, 16.
Masson, H. et Paulin, C. (2007). L’industrie de défense française à la croisée des chemins. Dans . Fondation pour la Recherche Stratégique Annuaire stratégique et militaire 2006-2007 (p. 103-145). Odile Jacob.
Masson, H. (2016). Impact économique de la filière industrielle « composante océanique de la dissuasion » – Volet 1. SNLE. Fondation pour la recherche stratégique. Défense & Industries, 8.
Mérindol, V. (2004). R&D de défense et coordination civile-militaire. In D. Uzunidis, L’Innovation et l’économie contemporaine : espaces cognitifs et territoriaux (p. 85-113). De Boeck Supérieur.
Mérindol, V., & Versailles, D. W. (2015). La dualité comme moyen de repenser la position stratégique des firmes. Revue Défense nationale, 780(5), 46-51.
Mérindol, V., & Versailles, D. W. (2020). Comment sortir du paradigme techno-push ? Les apports des nouveaux modes d’innovation. Revue Défense nationale, 832(7), 97-102.
Ministère des Armées (2025). La défense : un levier stratégique pour l’économie française.
Moura, S. (2015). Le poids de la BITD dans les pôles de compétitivité. Observatoire économique de la défense. EcoDef Études, 72.
Moura, S. (2018). La R&D militaire : le lien industrie-État. Observatoire économique de la défense. EcoDef Études, 117.
Moura, S. (2020). La R&D de défense en France : quels changements depuis la guerre froide ? Revue de la régulation. Capitalisme, institutions, pouvoirs, 28.
Moura, S. (2021). La fragmentation mondiale des chaînes de production en biens militaires de la France. EcoDef Études, 175.
Mowery, D. C., & Simcoe, T. (2002). Is the Internet a US invention ? An economic and technological history of computer networking. Research Policy, 31(1), 1369-1387.
Oudot, J.-M., & Bellais, R. (2008). Choix contractuels et innovation : le cas de l’approvisionnement de Défense. Innovations, 28(2), 85-103.
Perez, M. (2018). L’externalisation dans le secteur de la Défense [mémoire].
Place, D., & Ng, V. (2025). 40 milliards d’euros de chiffres d’affaires militaires pour les entreprises de défense dans l’industrie et les services en 2021. Ecodef Statistiques, 265.
Quemener, J., & Oudot, J.-M. (2015). Les dépenses de R&D de la base industrielle et technologique de défense : une évaluation par le crédit impôt recherche. EcoDef Statistiques, 74.
Ramet, C. (2020). Les déterminants économiques des exportations de matériels militaires des entreprises industrielles de la BITD française. EcoDef Études, 147. Post-Print halshs-04291784, HAL.
Ruttan, V. (2006). Is war necessary for economic growth ? Oxford University Press.
Serfati, C. (2008). Le rôle de l’innovation de Défense dans le système national d’innovation de la France. Innovations, 28(2), 61-83.
Vernhes, G. (2024). Les relations entre sciences, technologies et territoires au cœur de la souveraineté nationale : une approche structurale sur longue période (Doctoral dissertation, Institut Polytechnique de Paris).
Videlin, J.-C. (2025). L’entreprise publique, instrument contesté de la souveraineté industrielle. In C. Druelle-Korn, P. Fridenson, P. Griset, et L.Warlouzet (éds), Industrie, développement et souveraineté xvii e ‑xxi e siècle (p. 159-173). Institut de la gestion publique et du développement économique.
Annexe 1 – Méthodologie
Notre étude s’appuie sur seize entretiens et la tenue d’un groupe de travail, menés entre juillet 2024 et novembre 2024 auprès d’entreprises ou d’acteurs liés à l’industrie de défense. Ils ont été sélectionnés de manière à représenter une diversité de secteurs et de tailles d’entreprise, à partir de recherche ou de recommandations. Les données ont été collectées au cours d’entretiens individuels semi-directifs, en visioconférence. Une première partie des experts a été interrogée sur la compétitivité et l’innovation de l’industrie de défense française, les enjeux de la formation et de la transmission des compétences et, enfin, sur l’organisation et l’état des relations entre donneurs d’ordres et sous-traitants. La seconde partie a été interrogée sur l’organisation de la chaîne de valeur, le management de l’innovation et les synergies avec la sphère civile, les relations au sein de cet écosystème et la coopération européenne. L’objectif de ces entretiens était de comprendre comment l’organisation et les interactions au sein de l’écosystème industriel de la défense française ont permis à cette industrie de produire des systèmes d’armement répondant aux exigences nationales et à la demande internationale, alors que la concurrence est vive et les ambitions géopolitiques diverses.
Notre étude repose également sur l’analyse d’un grand nombre de données disponibles et d’articles de recherche académique.
Annexe 2 – Liste d’entretiens
Entretiens :
Alexandre Houlé, directeur de la stratégie Thales
Arnaud Génin, directeur de l’intelligence stratégique Naval Group
Camille Lanet, sous-directeur de l’intelligence économique de la DID, DGA
Charles Maisonneuve, directeur des affaires publiques et des médias Arquus
Deux ingénieurs-chercheurs liés à un centre de recherche de la défense
Fabien Kuzniak, conseiller militaire Safran
Guillaume Muesser, directeur défense et affaires économiques Gifas
Hervé Guillou, président d’Exail et ancien directeur général de Naval Group
Hinde Doux, présidente TNS-Mars et présidente de la commission PME du Gicat
Hugo Richard, directeur de cabinet du président exécutif et des affaires publiques ArianeGroup
Jérôme Faul, président de la société capital risque Innovacom
Patrice Daste, ancien président de la PME stratégique Alsymex
Renaud Bellais, chercheur associé au Cesice, université Grenoble Alpes, et codirecteur de l’Observatoire de la défense, Fondation Jean-Jaurès
Thierry Regond, président d’EDEN et de la PME Sunaero
Un directeur technique d’une ETI de la BITD
Un représentant d’une ETI, fournisseur de la BITD
Groupe de travail :
Alexandre Figuière, consultant, Dassault Systèmes
Axel Nicolas, codirecteur de l’Observatoire défense de la Fondation Jean-Jaurès
Cédric Lowenbach, référent défense pour le groupe Bpifrance
Damien Bajard, responsable commercial grands comptes, Elistair (PME)
Jean-Marie Dumon, délégué général adjoint Gican
Kévin Martin, chargé de recherche, pôle Défense et Industries de la Fondation pour la recherche stratégique
Laurent Legendre, directeur régional Airbus Développement
Martine Poirmeur, déléguée générale adjointe à la défense Gicat
Nicolas Grangier, chef du service de la sécurité économique de la DID, DGA
Valérie Mérindol, professeure à Paris School of Business
Annexe 3 – Présentation des neuf maîtres d’œuvre industriels de la BITD française
Annexe 4 – Évolution des crédits budgétaires alloués à la R&D et R&T de défense
L’évolution des dépenses publiques de R&D de défense n’est pas évidente à suivre à partir des années 2010. En effet, d’après les chiffres de l’OCDE, les CBRD de défense enregistrent une chute brutale en France, passant de 4 à 1 milliard d’euros, sans justification apparente dans les sources officielles (fig. 3.4). Cette discontinuité suggère un artefact statistique, probablement lié à une modification du périmètre comptable utilisé par l’OCDE. En tout état de cause, les montants recensés jusqu’en 2010 correspondent au périmètre de la « R&D », au sens que lui donnent la DGA et le ministère des Armées, quand les montants disponibles après cette date sont nettement plus proches du volume de la R&T (fig. a, b et c).
(a) Évolution des crédits budgétaires alloués à la R&D de défense (en millions d’euros constants de 2015 et en part du PIB)
Source : OCDE – Government Budget Allocations for R&D (GBARD).
Traitement La Fabrique de l’industrie.
(b) Les dépenses de la France en R&D en prix courant (2005-2023)
Sources : OCDE – Government Budget Allocations for R&D (GBARD), Agence européenne de défense, chiffres clés (DGA – ministère des Armées).
(c) Les dépenses de la France en R&T en prix courants (2005-2023)
Sources : OCDE – Government Budget Allocations for R&D (GBARD), Agence européenne de défense, chiffres clés (DGA – ministère des
Armées), L’état de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
en France. Traitement La Fabrique de l’industrie.
Annexe 5 – présentation des programmes de coopération menés par l’OCCAr
Marie Desjeux, L’industrie de défense au service des ambitions françaises. De la maîtrise à la supériorité , La Fabrique de l’industrie, Paris, Presses des Mines, 2025.
ISBN : 978-2-38542-745-0
ISSN : 2495-1706
© La Fabrique de l’industrie
81, boulevard Saint-Michel 75005 Paris
info@la-fabrique.fr
www.la-fabrique.fr