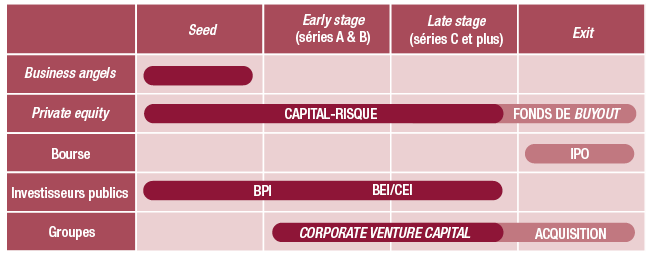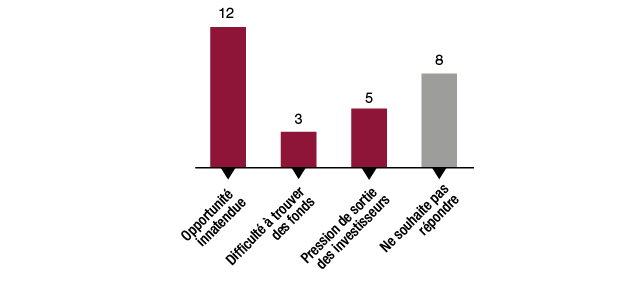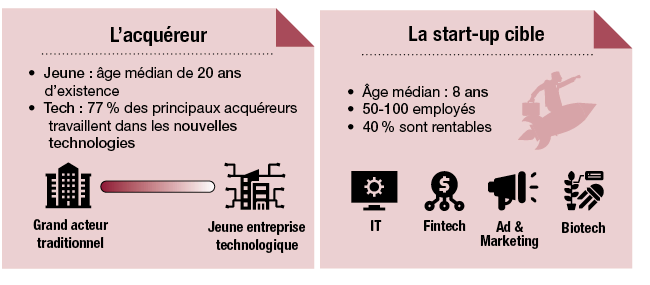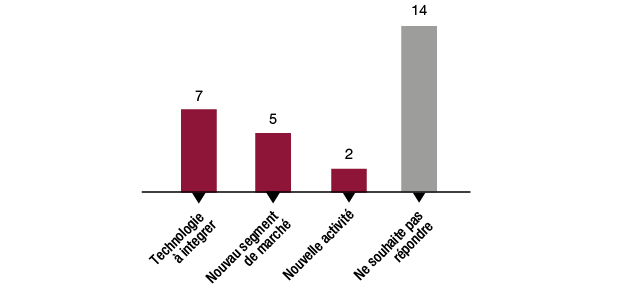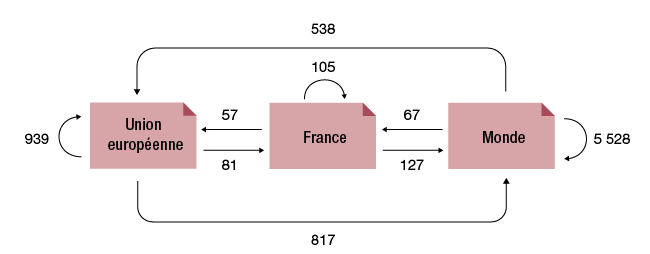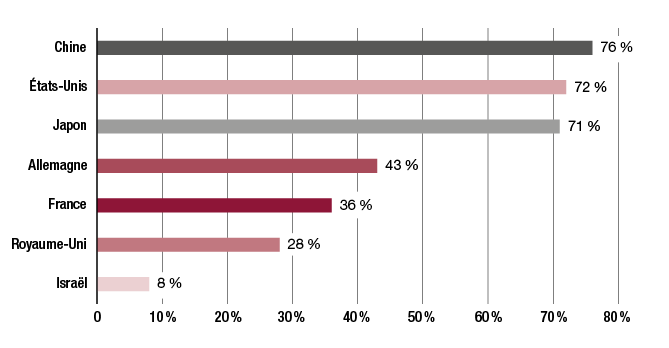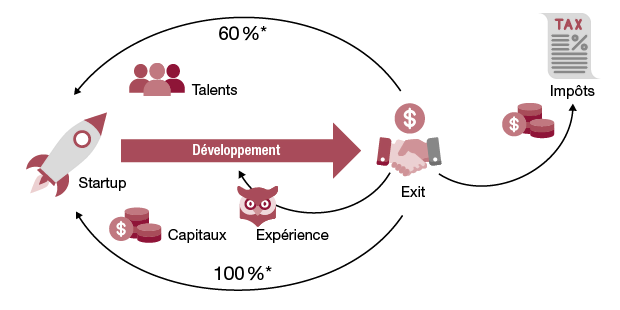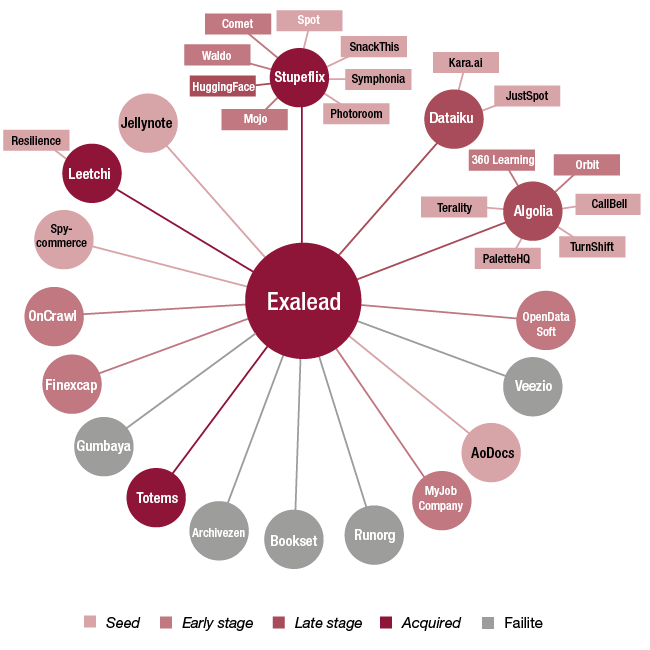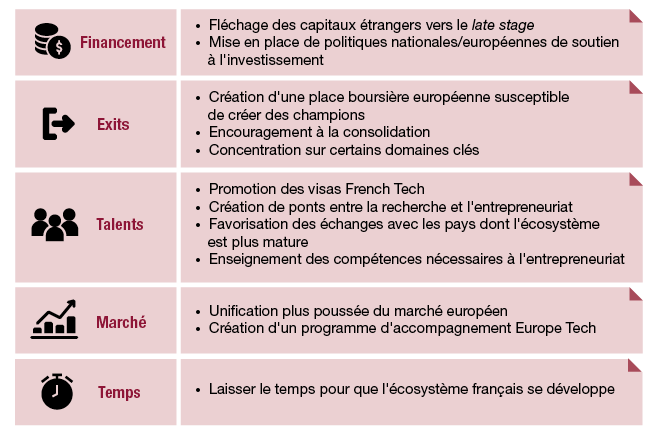Rachat des start-up : des racines françaises, des ailes étrangères
Avant-propos
La France sait de mieux en mieux accompagner les start-up à leur naissance, quand leur idée fondatrice émerge. Mais elle leur offre moins d’opportunités à mesure que ces jeunes pousses en forte croissance ont besoin de nouveaux fonds pour consolider leur activité. Faute d’une offre française attractive, beaucoup de ces pépites passent alors entre les mains d’acquéreurs étrangers.
On a longtemps déploré ces rachats étrangers de « nos » start-up comme autant de pertes sèches pour la France. Il n’en est rien observent les auteurs de cet ouvrage, dont le travail bienvenu vient répondre à une controverse vieille d’au moins trente ans. Bien au contraire, ces rachats assurent la survie et le développement de la plupart des start-up rachetées, génèrent des emplois en France comme à l’étranger et constituent accessoirement des revenus pour l’État français. La nécessité de développer l’écosystème français demeure entière bien sûr. Mais c’est précisément en laissant jouer le cercle vertueux du rachat et du réinvestissement que cela a les meilleures chances d’advenir.
À partir d’entretiens de différents acteurs (start-up, administrations, grandes entreprises, investisseurs), les auteurs proposent une analyse documentée qu’ils concluent par des recommandations pour favoriser les rachats domestiques et faire émerger des consolidateurs technologiques.
La collection des « Docs de La Fabrique » rassemble des textes qui n’ont pas été élaborés à la demande ni sous le contrôle de son conseil d’orientation, mais qui apportent des éléments de réflexion stimulants pour le débat et la prospective sur les enjeux de l’industrie.
Nous espérons que ce document offrira aux industriels et aux décideurs publics des pistes de réflexion sur les moyens de renforcer ce nouvel écosystème. Les étudiants et futurs entrepreneurs pourront aussi y trouver des éclairages utiles pour monter un futur projet professionnel.
L’équipe de La Fabrique
Résumé
Il semble bien que l’intention présidentielle de faire de la France une « start-up nation » soit en train de se réaliser sous nos yeux. À tout le moins, le marché français des start-up est incontestablement en train de se structurer, de gagner en ampleur et en profondeur. Les montants investis tout comme le nombre de licornes et d’autres jeunes pousses se sont sensiblement accrus depuis 10 ans, et cette progression se poursuit malgré la crise.
Pour autant, les start-up ne sont pas seulement des entreprises jeunes et innovantes : ce sont surtout des entreprises qui visent à croître rapidement et qui se caractérisent donc par un très fort besoin de financement. C’est par leur capacité à attirer des investisseurs qu’elles démontrent la pertinence de leurs idées et de leur business model. Or, on le sait, l’aval du marché est toujours comparativement peu structuré et peu dynamique en France. En conséquence de quoi, une proportion importante d’exits (rachats ou IPO) se déroulent en terre étrangère, et notamment aux États-Unis.
Ces rachats de start-up françaises par des entreprises étrangères sont souvent perçus par le public comme une prédation pure et simple, privant l’économie française de ses meilleurs talents, de ses actifs technologiques et, bien sûr, du fruit de son investissement patient et risqué dans de jeunes pousses prometteuses. Il n’en est rien : ce travail d’entretien mené auprès de dirigeants de start-up rachetées prouve que la France n’y est pas perdante, bien au contraire. Les flux de rachats entrants et sortants sont très équilibrés, comme aux États-Unis d’ailleurs. Surtout, l’analyse de terrain permet d’établir que ces rachats sont, dans leur immense majorité, favorables au développement des start-up rachetées, et de ce fait créateurs d’emplois en France comme à l’étranger. Naturellement, ils constituent aussi une source de liquidités pour l’écosystème et de revenus pour l’État.
Le seul point encore problématique tient à l’écart de volume et donc de dynamisme entre ces marchés. Les montants investis par les acquéreurs américains sont en moyenne trois fois supérieurs à ceux que proposent leurs homologues européens (100 millions d’euros contre 30 millions d’euros respectivement par exit), ce qui les place en position de force pour acquérir les pépites les plus prometteuses. Cet écart s’explique bien sûr par le poids hégémonique du secteur américain du capital-investissement, mais il se trouve encore renforcé par le manque de consolidateurs technologiques en Europe – principalement de jeunes entreprises très intensives en technologie – qui, à leur tour, ne constituent pas encore une menace suffisante auprès des grandes entreprises « traditionnelles » pour que ces dernières aient industrialisé ni même valorisé l’activité d’intégration de start-up, éminemment risquée.
Tant que cet écart de maturité perdure entre l’écosystème américain et ses équivalents européens, les plus belles licornes ont tout intérêt à convoiter les détenteurs de capitaux américains, qui leur ouvrent des portes à des marchés plus vastes, à des talents plus affûtés, à une expertise plus développée.
Mais, précisément, le cercle vertueux des rachats de start-up et des réinvestissements dans de nouveaux projets constitue le meilleur moyen de corriger ce déséquilibre à moyen terme. Les exemples le prouvent : chaque génération de start-up est plus robuste que la précédente et chaque génération d’entrepreneurs plus aguerrie et plus solide, notamment grâce aux conseils et au soutien des pionniers.
Ce serait donc un bien mauvais réflexe que de vouloir hérisser des barrières dissuasives dans l’idée de protéger « nos » start-up de prédateurs étrangers. Au contraire, ces rachats sont aujourd’hui ceux qui offrent les perspectives les plus prometteuses à nos entreprises et ils renforcent l’écosystème français d’investisseurs. Bien sûr, il existe des cas, très spécifiques et peu nombreux, dans lesquels une perspective de rachat peut être jugée contraire aux intérêts stratégiques du pays. Tous les acteurs concernés conviennent que, en pareil cas, une intervention publique est pleinement justifiée. Mais elle ne doit pas se confondre avec un protectionnisme économique pur et simple, souvent synonyme de mort pour une start-up ayant des besoins urgents en capitaux.
Face aux rachats étrangers de jeunes pousses, il convient donc de faire usage avec discernement de l’arsenal défensif dont l’État est déjà nanti et de privilégier des registres d’action plus offensifs, afin notamment de développer le marché de l’investissement late stage et la maturité des places boursières européennes. C’est en poursuivant dans cette voie que la France et l’Europe pourront réserver le meilleur accueil aux start-up les plus prometteuses.
Introduction
Dès la campagne présidentielle, Emmanuel Macron a annoncé son souhait de faire de la France « une start-up nation » en l’espace de cinq ans, engagement qu’il a depuis réitéré. Pourquoi cet engouement ?
D’abord parce qu’une start-up est un moyen efficace de conduire des innovations radicales. Il peut s’agir d’innovations technologiques, comme c’est souvent le cas des biotechnologies en faveur du développement de nouvelles molécules, mais ce sont le plus souvent des innovations de marché ou de modèle ; ce sont par exemple les cas d’Airbnb, dans le secteur du tourisme, d’Ynsect dans le domaine de l’alimentation ou de Back Market sur le marché du reconditionnement. Petite, jeune, rapide et dotée d’une grande capacité d’adaptation, la start-up est perçue comme le véhicule idéal pour innover efficacement en s’appuyant sur les dernières technologies, notamment numériques, afin de moderniser la plupart des marchés traditionnels.
Ensuite, parce que l’État français voit dans les jeunes pousses d’aujourd’hui les grandes entreprises de demain qui créeront des emplois et de l’activité économique tout en assurant à la nation une souveraineté et une légitimité technologique. Selon la formule de Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, cette maîtrise technologique est une des conditions pour que la France continue à « faire partie des nations qui écrivent le XXIe siècle et qui ne se contentent pas de le lire ou de le traduire »1.
En dépit d’un contexte sanitaire peu propice à l’investissement, la French Tech continue ainsi de connaître une ascension fulgurante. Les start-up ont levé 5,4 milliards d’euros en capital-risque en 20202, contre 1,8 milliard d’euros en 2015, et la France peut se targuer de compter dans ses rangs 18 licornes3.
L’objectif visé par le gouvernement est la création en France de futurs champions technologiques, à l’instar de Spotify, le géant suédois du streaming musical. Beaucoup d’efforts et d’argent publics ont été investis dans cet objectif, notamment à travers l’action de la Banque publique d’investissement (BPI). Qonto, Contentsquare ainsi que de nombreuses start-up françaises en forte croissance semblent maintenant sur une bonne lancée et la France peut se féliciter d’un essor aussi rapide. Néanmoins, un obstacle de taille semble se dresser sur leur chemin : la difficulté à trouver des fonds ou un racheteur sur le marché français. Lorsque l’on observe les générations précédentes de start-up prometteuses, la plupart ont en effet fini par se vendre à des entreprises étrangères. C’est le cas de Zenly, le réseau social basé sur la géolocalisation qui enregistrait en 2016 près de 10 % de croissance par semaine. Alors que la France commençait à rêver de posséder son propre Facebook, la pépite a été rachetée par l’américain Snapchat après seulement 6 ans d’existence pour environ 300 millions de dollars. De même, Sentryo, jeune entreprise très prometteuse de cybersécurité, accompagnée et financée par la BPI et lauréate de nombreux prix, a été récupérée par l’américain Cisco en 2019.
Faut-il pourtant s’offusquer du fait que nos jeunes pousses arrosées et cultivées avec soin4 partent finalement consolider les rangs des plus gros acteurs étrangers ? À qui bénéficient réellement ces rachats, quelles sont leurs retombées pour la jeune pousse et pour l’économie française ? Ces rachats étrangers aident-ils la start-up à prospérer ou déguisent-ils une volonté d’annihilation de la concurrence ? Génèrent-ils des emplois ou sont-ils davantage source de délocalisation ? Que deviennent les ressources de la start-up et comment est utilisé l’argent de la transaction ? Enfin quelles sont les alternatives de développement pour ces jeunes pousses ?
Ce sont à ces questions que cette étude cherche à répondre. Celle-ci est structurée autour de deux volets d’analyse. Le premier, statistique et descriptif, dépeint objectivement la situation. L’autre, plus subjectif, se fonde sur une enquête de terrain menée auprès des acteurs économiques.
La première partie (chapitres 1 et 2), s’appuyant sur des analyses statistiques économiques provenant de bases de données et de rapports, dresse un état des lieux objectif sur les tendances de rachats de start-up en France et dans le monde.
La deuxième partie (chapitres 3 et 4) se concentre sur le rachat des start-up par des acteurs étrangers et met à mal plusieurs idées reçues. Notre résultat principal est que ces rachats étrangers, qui peuvent paraître alarmants à première vue, sont en réalité nécessaires à la prospérité d’un écosystème encore en construction. En plus d’être nécessaires, ces rachats étrangers possèdent certaines vertus comme la création d’emplois et de valeur sur le territoire français ou encore la dynamisation de l’écosystème à travers le recyclage de capitaux et de talents ayant gagné en expérience.
Ce résultat débouche d’un travail de triangulation, bâti sur plus d’une centaine d’entretiens auprès d’acteurs directement concernés (start-up, grandes entreprises, administration, investisseurs, personnes politiques…) et tout particulièrement une trentaine d’entretiens avec les fondateurs de start-up rachetées. Ces entrepreneurs ont raconté l’histoire de leur entreprise et ont livré leur représentation du sujet, permettant de mieux saisir ces enjeux tels qu’ils sont vécus sur le terrain.
Enfin, la troisième partie (chapitre 5), interroge les leviers dont dispose la puissance publique pour favoriser un meilleur développement des start-up sur le territoire français. Les idées développées sont issues de la même méthodologie que la partie précédente, avec un accent plus marqué sur les entretiens menés avec des administrations. En complément, différents rapports récents proposant des leviers d’actions offensifs pour promouvoir le développement des start-up en France sont décrits succinctement et quelques modestes propositions sont avancées. L’ensemble de ces données permet de comprendre que, si le souhait de protéger les meilleures pépites françaises des féroces compétiteurs étrangers peut paraître tentant, cette approche présente de nombreux risques. Elle semble en effet moins adaptée qu’une démarche d’aide à la consolidation d’un écosystème robuste, basée sur l’approvisionnement de fonds capables de financer les start-up les plus mûres ainsi que l’émergence de nouveaux consolidateurs technologiques.
- 1 – Déclaration de M. Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, sur le financement des entreprises technologiques, à Paris le 7 juin 2021.
- 2 – Selon le baromètre 2020 du capital-risque réalisé par EY.
- 3 – Selon les données publiées en juillet 2021 par la DG Trésor.
- 4 – Selon le rapport KPMG Venture Pulse du premier trimestre 2020, l’investissement en capital-risque croît deux fois plus vite en France que dans le reste du monde.
De quoi parle-t-on ?
Les start-up sont désormais des acteurs clés de l’économie, qu’il est nécessaire de distinguer des PME et des entreprises technologiques, ayant fait naître autour d’elles tout un écosystème essentiellement financier.
Qu’est-ce qu’une start-up ?
Le terme « start-up » relève d’un concept encore un peu flou qu’il est nécessaire d’éclaircir pour mieux comprendre les conditions de leur développement.
Une entreprise conçue pour croître rapidement
Au sein de l’administration et dans le monde de l’entreprise, beaucoup de confusions sont faites, notamment entre start-up et entreprise technologique, ou parfois entre start-up et PME traditionnelle. Contrairement à la plupart des PME qui ont tendance à se structurer autour d’une logique d’exploitation voire d’optimisation d’une technologie ou d’un procédé existant, la start-up se caractérise par sa logique d’exploration et son utilisation des technologies récentes5.
En outre, les PME ou les entreprises technologiques fonctionnent souvent selon un schéma d’affaires prédéfini et relativement fixe. À l’inverse, comme la définit Steve Blank, un entrepreneur réputé de la Silicon Valley, une start-up est une « organisation temporaire conçue pour rechercher un business model reproductible et évolutif ». On entend également souvent dire que les start-up sont des entreprises jeunes, financées par du capital-risque, évoluant dans des secteurs technologiques et bénéficiant du statut de jeune entreprise innovante (JEI).
Bien que ces indicateurs semblent déterminer rapidement si une entreprise est une start-up ou non, ces caractéristiques ne suffisent pas à en comprendre l’essence. Une start-up est avant tout un pari sur une innovation. Un pari risqué, qui nécessite un fort investissement, mais qui peut rapporter beaucoup. Selon Paul Graham, fondateur du célèbre incubateur Y-Combinator, « une start-up est une entreprise conçue pour croître rapidement »6. Tout le reste découle de cette caractéristique fondamentale. Les start-up ne sont souvent pas rentables, car elles préfèrent investir pour maximiser leur croissance future. Même lorsqu’elles sont rentables, leur valorisation excède largement leurs revenus. Leur croissance est si importante que ces entités sont nécessairement jeunes et transitoires, car les dispositifs de financement en capital pour les accompagner ne peuvent pas suivre indéfiniment. Une entreprise née avant 1980 ne peut donc vraisemblablement pas être encore une start-up en 2021. Elles se doivent d’être innovantes, s’appuyant souvent sur des technologies de pointe, pour se distinguer radicalement de la concurrence et générer une croissance très rapide.
Un cycle de développement spécifique
Dans les entreprises classiques, les créanciers et actionnaires se rémunèrent grâce aux bénéfices générés par l’entreprise via des dividendes. Mais en raison de leur risque intrinsèque, de leur absence de rentabilité et de garanties, les start-up n’intéressent pas les banques. Un acteur financier spécifique, le capital-risque, aussi appelé venture capital (VC) s’est alors créé pour répondre aux besoins spécifiques des jeunes pousses. Le modèle du VC n’est pas de se rémunérer sur les bénéfices de l’entreprise – trop faibles compte tenu du capital immobilisé – mais sur la plus-value de son capital investi. En effet, la valeur du capital d’une start-up qui réussit croît fortement avec le temps ; acquérir des parts de l’entreprise coûte donc de plus en plus d’argent. Les investisseurs en capital-risque vont alors acheter des parts de l’entreprise tôt dans le but de les revendre lorsqu’elles valent plus cher. Pour limiter la prise de risque, ils ont besoin d’entrer au capital de plusieurs start-up et ils exigent d’elles une croissance très rapide pour décupler la valeur de leur investissement. Ce risque important peut être récompensé par le fait qu’il n’y a pas de plafond à la plus-value que peut faire un investisseur, la valorisation du capital de la start-up n’étant pas limitée. Ainsi, Peter Thiel, un des premiers investisseurs de Facebook, a multiplié sa mise par plus de 2 000, transformant une mise initiale de 500 000 dollars en plus d’un milliard.7
Dans ce mode d’investissement, le financement est structuré en plusieurs sessions, appelées series en anglais, au cours desquelles les investisseurs entrent au capital avec des montants de plus en plus importants, avant de revendre leurs parts en tentant de maximiser leur plus-value lors du rachat ou de l’entrée en Bourse de la start-up, événement que l’on appelle exit. Ainsi, la forte croissance de la start-up est nécessaire pour qu’elle puisse attirer les VC et compenser le risque de l’investissement.
Le cycle de vie d’une start-up (voir figure 1.1) commence par un processus d’idéation suivi de la phase de création, au cours de laquelle les fondateurs créent des prototypes de leurs idées. S’ensuit l’amorçage, qui coïncide généralement avec la première session de financement, puis le développement (scaling). Durant le développement, s’enchaînent des sessions de financement de plus en plus importantes, les premières étant de l’early stage (series A et B), les suivantes du late stage (series C et suivantes), avec des tickets dépassant souvent 50 millions d’euros. Enfin, la start-up commence son expansion, au cours de laquelle elle cherche à se diversifier, atteindre la rentabilité et songe souvent à la sortie (exit).
Les premières étapes d’idéation et de création sont relativement peu risquées pour une start-up car sans financement, les enjeux ne sont pas très importants. Grâce à un effort conséquent de la puissance publique, l’amorçage, encore difficile à réaliser il y a vingt ans bien que mobilisant des montants relativement faibles, est désormais assez aisé à passer également. Ceci est particulièrement vrai en France où les fonds disponibles pour aider les jeunes entrepreneurs sont abondants et très facilement accessibles (BPI, incubateurs, allocations-chômage…).
Cependant, dès la première session de financement commence une course contre la montre : il faut réussir, avec les fonds levés, à développer et à faire croître la start-up suffisamment rapidement pour réussir la prochaine session. Et cela se répète pour chaque session jusqu’à l’exit. Sans nouvelle session, les fonds disponibles finissent par s’épuiser et la start-up qui ne génère pas de bénéfices fait inévitablement faillite. C’est ce phénomène, appelé « vallée de la mort », qui explique que peu de start-up survivent et atteignent les dernières phases de développement. Selon le site d’informations spécialisé dans le digital, Wydden, 60 à 90 % des start-up ne parviennent pas à passer cette phase critique (chiffres de 2019).
Lorsqu’une start-up survit à ces étapes, elle prouve que son business model permet effectivement une belle croissance sur un marché porteur, ce qui intéresse les acquéreurs. Cependant, passé un certain stade, sa croissance commence à ralentir et sa valorisation devient trop importante, limitant les acquéreurs potentiels aux grands groupes. Cela explique que les rachats soient les plus fréquents dans la phase de scaling, lorsque la valorisation se situe entre 5 et 50 millions d’euros. Passée cette phase, la start-up cherche généralement à rentabiliser son activité avant de se faire acquérir par un fonds ou de s’introduire en Bourse.
Enfin, il est important pour une start-up qui veut croître de pouvoir agrandir son marché, et donc de s’ouvrir à l’international : trouver des capitaux à l’étranger, notamment aux États-Unis, permet d’aider à s’y implanter. La grande majorité des start-up françaises qui réussissent à se développer s’internationalisent et ne font plus qu’une modeste partie de leur chiffre d’affaires en France (voire en Europe)8.
Figure 1.1 – Cycle de développement d’une start-up
*La phase de développement est plus souvent appelée scaling.
La start-up passe par 5 phases de vie : l’idéation, la création, l’amorçage, le développement (ou scaling) et l’expansion.
L’écosystème des start-up
La start-up obéit donc à un schéma de développement très spécifique caractérisé par une forte croissance associée à un fort risque. Pour lui permettre de croître selon ce modèle particulier, de nombreux acteurs existent et accompagnent l’entreprise tout au long de son développement. Ces acteurs de soutien, indispensables, forment ce que l’on appelle « l’écosystème start-up ».
Des acteurs financiers
L’écosystème a beau comporter une multitude d’acteurs, le nerf de la guerre reste l’argent nécessaire pour financer l’aventure. La possibilité de faire grandir des jeunes pousses en France repose donc sur un réseau d’acteurs financiers spécifiquement dédiés.
Figure 1.2 – Présentation des acteurs financiers
Les business angels sont des individus fortunés qui investissent dans des jeunes pousses au début de leur histoire, lors du seed, la première session de financement. Ils entrent au capital avec des tickets allant généralement jusqu’à un million d’euros, pour donner un premier souffle à la start-up. Ils investissent dans beaucoup de projets simultanément, car si le risque est fort, les retours lorsque la start-up parvient jusqu’à l’exit sont très intéressants. Les business angels – souvent eux-mêmes d’anciens fondateurs de start-up – ont une bonne connaissance du fonctionnement d’une start-up et peuvent aider les fondateurs à traverser la vallée de la mort, jusqu’à ce que des fonds de capital-risque investissent.
Le private equity désigne tous les fonds qui investissent directement au capital d’entreprises non cotées. Deux sous-catégories de private equity s’intéressent particulièrement aux start-up : les fonds de capital-risque et les fonds de capital-transmission (ou fonds buyout).
Le capital-risque, appelé venture capital (VC) en anglais, rassemble les partenaires principaux des start-up. Ils peuvent investir dès la création de la jeune pousse et jusqu’aux dernières sessions de financement. Généralement, ils se spécialisent dans une étape, soit en early stage (premières levées de fonds, le plus souvent sous les 50 millions d’euros), soit en late stage (dernières levées de fonds, plus coûteuses, mais sur des start-up plus mûres). Leur but est de se rémunérer en vendant leurs parts à d’autres investisseurs lors de futures sessions de financement ou lors de la revente de la start-up. Leur horizon temporel est généralement de sept à dix ans. Ils doivent nécessairement revendre leurs parts au terme de cette période pour rémunérer les détenteurs de leurs capitaux. Plus l’investissement est tardif dans le développement de la start-up, plus le fonds prend des responsabilités au sein de celle-ci. Il n’est ainsi pas rare pour des fonds de capital-risque de prendre le contrôle de la start-up. Leurs intérêts étant alignés avec la réussite financière de la start-up, les bons fonds de capital-risque font bénéficier à la jeune entreprise de leur expérience ainsi que de leur réseau d’entrepreneurs, de talents et de financiers afin de prodiguer des conseils utiles au développement de la jeune pousse.
Les fonds de buyout, plus spécialisés, interviennent au moment du rachat et s’intéressent à des start-up plus développées. À la différence du capital-risque, ils ne se rémunèrent pas sur la croissance de la pépite. Ces fonds la restructurent pour la rendre plus efficace et rentable financièrement, avant de la revendre sur d’autres marchés. Souvent, ces fonds achètent plusieurs start-up concurrentes pour les fusionner et créer des champions d’un secteur. Du fait de l’importance des montants requis, il y a peu de fonds de buyout s’intéressant aux start-up en France9, et il n’est pas rare pour ces fonds de faire des LBO (leveraged buyout), une technique qui consiste à acquérir une entreprise avec un crédit remboursé avec les bénéfices de l’entreprise achetée. Ce levier, bien qu’efficace, est à manier avec précaution. Cette technique peut s’avérer dangereuse pour l’avenir de la start-up en ce qu’elle détourne ses bénéfices vers le remboursement d’un prêt, au lieu de contribuer à l’investissement dans son développement.
Les marchés cotés constituent une autre possibilité pour les start-up en fin de développement, via une introduction en Bourse, appelée IPO (Initial Public Offering) en anglais. Cependant, il est rare pour des start-up de réaliser des IPO en France car le marché est trop petit et n’est pas assez structuré pour atteindre des valorisations suffisantes – certaines start-up, tel Criteo, préfèrent donc se rendre sur le NASDAQ, marché public américain.
Les start-up peuvent aussi s’appuyer sur des investisseurs publics. La France, comme beaucoup de pays, a mis en place une banque publique d’investissement, Bpifrance, qui agit sur les mêmes sessions de financement que le capital-risque. La rentabilité du capital reste un objectif mais ces investisseurs publics sont avant tout intéressés par le développement économique du pays, quitte à investir dans des projets plus risqués afin de rassurer les investisseurs privés. Bpifrance cible majoritairement les phases de seed et early stage en proposant du financement et de l’investissement mais possède également un fonds pour les start-up plus développées appelé large venture (Granier, 2021).
Au niveau européen, la Banque européenne d’investissement (BEI) émet des obligations et le Conseil européen de l’innovation (CEI) investit au capital de start-up en late stage à travers un fonds doté de 3,5 milliards d’euros.
Enfin, les groupes interagissent financièrement avec les start-up par deux mécanismes : le capital-risque d’entreprise (Corporate Venture Capital ou CVC) et les acquisitions. Le CVC est très proche du capital-risque classique à la différence près que c’est un groupe qui utilise ses fonds propres pour investir directement dans des start-up. Le CVC utilise les start-up pour externaliser l’innovation. Si une start-up dans son portefeuille se porte bien, le groupe peut plus facilement garder un œil dessus voire l’acquérir. Pour une start-up, avoir un groupe au capital comporte des avantages et des risques. L’avantage principal est de pouvoir profiter du réseau et des connaissances du groupe pour se développer, le risque principal est de ne plus pouvoir travailler avec les concurrents du groupe. Le second levier des groupes est d’acquérir des start-up en fin de développement. Les motivations poussant à faire ces acquisitions sont nombreuses et seront reprises plus en détail dans la suite de l’étude. On peut néanmoins noter parmi ces motivations : intégrer une technologie complémentaire dans un produit, se renforcer sur un marché ou développer un nouveau segment de marché, ou encore priver la concurrence d’un atout potentiel.
À l’exception des groupes et des business angels, qui disposent de leurs propres fonds, les autres acteurs mentionnés ci-dessus n’ont pas de capitaux propres10 : ce sont des gestionnaires pour des investisseurs indirects. Ces derniers, constitués principalement de banques, d’assurances et de fonds souverains ont à leur charge l’argent des détenteurs de capitaux, et peuvent flécher cet argent vers un large ensemble d’actifs.
Des entrepreneurs et des talents
Outre les acteurs financiers, un autre maillon essentiel à la création de pépites est la présence de femmes et d’hommes prêts à s’embarquer dans l’aventure start-up. En France, cette volonté est maintenant relativement forte parmi les jeunes générations puisque 45 % des étudiants français souhaiteraient avoir une expérience entrepreneuriale11.
En plus de cette appétence, lancer des start-up qui réussissent nécessite la mobilisation de nombreuses compétences spécifiques. Ainsi, des développeurs informatiques sont nécessaires pour la majorité des projets, et la plupart des applications développées nécessitent l’éclairage de designers spécialisés en expérience utilisateur (UX). Il est encore difficile de trouver des profils expérimentés sur ces fonctions clés très spécifiques.
Des mentors
Afin d’être guidés dans la recherche de leur modèle économique et dans leurs choix, les entrepreneurs ont besoin d’être guidés et formés aux bonnes pratiques entrepreneuriales, qui sont parfois contre-intuitives12. Celles-ci sont inculquées par des mentors expérimentés qui ont accompagné de nombreuses start-up du même secteur. L’autre fonction fondamentale des mentors consiste à mettre en connexion des start-up de leur réseau avec d’autres start-up, talents ou investisseurs avec qui elles pourraient collaborer. Un bon mentor bénéficiera donc d’un réseau important. Ce mentorat est en partie fait par les investisseurs qui possèdent un portefeuille de start-up et qui partagent avec les entrepreneurs un objectif de réussite du projet. Deux autres types de structures très répandus et spécialisés dans le mentorat sont les accélérateurs et les incubateurs qui hébergent souvent les start-up et leur fournissent tout ce dont elles ont besoin pendant leurs premières années d’existence.
Un État polyvalent
L’État joue également un rôle majeur, souvent sous-estimé, dans la réussite de l’écosystème start-up. Cette idée est particulièrement bien défendue par Mariana Mazzucato13. L’économiste, qui s’élève contre les discours répandus aux États-Unis en 2008 réclamant une baisse des dépenses publiques pour relancer l’économie, rappelle que l’État est le véritable moteur de l’innovation et le seul à pouvoir impulser une stratégie nationale de long terme. À travers ses dépenses publiques, notamment dans les secteurs de la recherche et l’éducation, il permet l’émergence de technologies issues de laboratoires publics qui sont ensuite reprises par des entrepreneurs ayant été formés dans les meilleures universités. Mazzucato développe notamment l’idée qu’aucune innovation de rupture comme l’iPhone ou même Internet n’aurait pu naître sans un État susceptible d’investir dans des projets risqués et avant-gardistes et ce, bien avant que le secteur privé ne puisse suivre. C’est donc à l’État d’être le moteur principal d’une croissance tirée par l’investissement et dirigée vers les grands défis à venir.
À première vue, l’État apporte principalement son soutien aux start-up en créant un cadre réglementaire spécifique, plus simple que celui destiné aux entreprises. Celui-ci est régulièrement revu à travers un dialogue régulier avec des entrepreneurs et investisseurs. Néanmoins, il joue également un rôle majeur d’accompagnement financier à travers la BPI, un rôle de mentorat à travers la French Tech et la BPI, ainsi qu’un rôle – qui gagnerait à être musclé – sur l’attraction de talents à travers l’attribution de visas spéciaux, la formation dans les écoles aux nouvelles compétences nécessaires à l’entrepreneuriat ou le financement de la recherche publique.
- 5 – Voir de Chevigny, I. Capital, 10 août 2015.
- 6 – Traduit de l’anglais par les auteurs depuis Paul Graham, « Start-up = Growth », 2012.
- 7 – BFM, « l’investisseur Peter Thiel décroche le jackpot grâce à facebook », 2012.
- 8 – Le chiffre d’affaires réalisé hors de France représente désormais plus de 61 % du chiffre d’affaires total selon le Baromètre 2019 de la performance économique et sociale des start- up numériques en France réalisé par EY. Ce résultat semble s’accentuer avec la maturité de la start-up. Il est conforté par les entretiens menés dans lesquels les tendances étaient encore plus extrêmes.
- 9 – Les fonds de buyout en France sont peu nombreux mais figurent parmi les leaders européens en matière de montants investis et représentent une opportunité pour les pépites françaises. Ceux-ci se tournent peu à peu vers l’investissement dans les start-up. Ainsi LBO France, un des leaders français, possède maintenant près de 20 % de son portefeuille en start-up, exclusivement autour de la santé digitale. Le premier investissement dans ce secteur n’a pourtant eu lieu qu’en 2014.
- 10 – BPI fait aussi du financement en fonds propres venant de l’État mais ils sont à la fois porteurs et détenteurs de fonds.
- 11 – Selon le baromètre Les étudiants et l’entrepreneuriat 2019, réalisé par Moovje, Opinion Way et le CIC.
- 12 – Voir par exemple Thomas Houy, Le demi-tour numérique, 2018.
- 13 – Dans son ouvrage L’État entrepreneur. Pour en finir avec l’opposition public privé, 2020.
Les rachats de start-up en France et ailleurs
La proportion de start-up rachetées après 10 ans d’existence est significativement plus élevée que pour d’autres entreprises classiques14 ; en 2019, sur la totalité des start-up françaises, 1 % ont été rachetées. Pour les PME, ce ratio était de 0,1 %. En France, la French Tech recense ainsi près de 750 start-up rachetées entre 2017 et 202015. Ce résultat qui peut paraître surprenant est en fait une conséquence de leur schéma de développement. Contrairement à certaines idées reçues, le rachat d’une start-up qui réussit n’est pas une anomalie qu’il faudrait chercher à prévenir, c’est son destin naturel.
Pourquoi les start-up doivent-elles se vendre ?
La start-up est une entité transitoire ayant vocation à explorer de nouvelles technologies ou de nouveaux modèles d’affaires dans une optique de croissance très rapide. Comme expliqué plus tôt, cette perspective rend le projet particulièrement risqué, ce qui désintéresse les banques mais attire les investisseurs en capital-risque. Il est important de garder en tête que les fonds en capital-risque investissent sur des durées de l’ordre de 10 ans puis doivent impérativement se désengager pour rembourser leurs propres investisseurs financiers (appelés Limited Partners ou LP). Avant la clôture du fonds dont la date est fixe, ils vendent donc les parts qu’ils possèdent dans les différentes entreprises en espérant une importante plus-value.
Ce modèle de développement a plusieurs conséquences. Tout d’abord, une start-up est une entité fragile basée sur des promesses futures, qui n’est pas souvent économiquement rentable et dont la valeur est à risque. Quand un fonds de capital-risque investit dans une start-up, son objectif est d’augmenter la valorisation de ses parts. La start-up est alors poussée à proposer une croissance exponentielle de son modèle d’affaires plutôt qu’à chercher à pérenniser et consolider son niveau de revenus actuel. Ce qui intéresse les investisseurs, c’est un potentiel futur leader et non pas une simple entreprise. Une entreprise à perte pendant 7 ans avec une promesse crédible de futur monopole est préférée à une entreprise proposant un modèle d’affaires rentable. Ainsi les emplois et la propriété intellectuelle créés par une start-up ne sont pas pérennes et dépendent des capitaux apportés par les investisseurs.
Figure 2.1 – Pourquoi se vendre ?
Note : Résultat d’un sondage mené par les auteurs auprès de 28 start-up rachetées.
Figure 2.2 – Le destin d’une start-up
Note : 60 à 90 % des start-up meurent sans aller jusqu’à l’exit. Celles qui ont survécu à la vallée de la mort sont majoritairement rachetées par une entreprise. Les sorties en buyout et surtout les introductions en Bourse sont réservées à des start-up particulièrement structurées et rentables et offrent des multiples de valorisation considérablement plus élevés.
De plus, la faible durée de vie des fonds implique que les investisseurs doivent impérativement trouver un repreneur pour leurs parts quelques années seulement après la création de l’entreprise. Ces derniers étant souvent majoritaires au capital de la start-up à ce stade de développement, ils peuvent exercer une forte pression sur les fondateurs et les pousser à vendre leur entreprise. La pression des investisseurs était d’ailleurs directement à l’origine d’un quart des rachats des start-up interrogées dans notre étude. Dans certains cas, sur des marchés mûrs, d’autres fonds de late stage peuvent reprendre les parts des premiers investisseurs dans l’objectif de faire à leur tour grossir l’entreprise en quête d’une plus-value. Sinon, ils doivent trouver un acteur capable d’acheter l’entreprise à hauteur de la valeur qu’elle est susceptible de créer. L’âge médian de rachat de start-up est d’ailleurs d’une dizaine d’années ce qui coïncide avec la durée de vie moyenne d’un fonds de capital-risque.
Ainsi la vente d’une start-up en pleine réussite n’est pas une anomalie mais une issue parfaitement normale. Cette étape est délicate mais cruciale en ce qu’elle permet de pérenniser la valeur créée par l’entreprise.
La sortie reste toutefois une issue royale réservée à une faible fraction des start-up qui ne font pas faillite (pour rappel 60 à 90 % des start-up ne parviennent pas jusqu’à l’exit). Elle n’est cependant pas toujours rentable. Selon une étude de Mind the Bridge et Crunchbase de 2018, 60 % des exits depuis 2010 n’ont pas permis aux investisseurs de récupérer leur mise, 35 % ont engendré des gains modérés, et seuls 5 % génèrent d’excellents retours pouvant aller jusqu’à plus de 100 fois la mise initiale.
Pourquoi les entreprises veulent-elles acheter des start-up ?
Pour qu’une start-up puisse se vendre, il faut également qu’elle trouve un acquéreur prêt à la racheter à hauteur de la valeur estimée par les investisseurs. L’existence d’acquéreurs ayant une forte appétence pour les start-up est donc cruciale pour assurer la liquidité de ce modèle de croissance. Mais pourquoi une entreprise établie, ayant parfois des moyens d’innovation colossaux, acquerrait-elle une jeune start-up ayant un projet encore immature et dont la rentabilité est, au mieux, incertaine ?
Au cours des dernières décennies, on a observé le passage d’un modèle d’innovation fermée, où les entreprises ouvraient des centres de R&D pour innover secrètement en interne, à un modèle d’innovation ouverte où elles préfèrent collaborer avec leur écosystème afin d’intégrer plus efficacement les briques technologiques développées par d’autres entreprises. Le professeur Henry Chesbrough (2003) explique cette évolution par une mobilité accrue des talents, l’enseignement ouvert des technologies de pointe dans les universités, l’essor d’investisseurs en capital-risque permettant de se financer ainsi que la réduction du délai de mise sur le marché des innovations.
Dans ce nouveau schéma économique, la grande entreprise, ralentie par ses procédures internes, sa lourdeur et sa culture, n’est pas toujours en mesure d’innover aussi rapidement et efficacement qu’une petite structure agile comme une start-up. Elle n’a pas non plus les ressources pour explorer les milliers de nouvelles pistes ouvertes par l’essor de certaines technologies. Elle va ainsi préférer laisser de jeunes pousses explorer de nouvelles technologies prometteuses, sélectionner celle qui se sera démarquée, l’acquérir puis utiliser ses moyens financiers colossaux pour l’intégrer, déployer et commercialiser la solution à grande échelle.
Ce schéma dans lequel la start-up explore une piste d’innovation tandis que le grand groupe exploite les plus prometteuses est devenu une norme dans certaines industries comme le secteur pharmaceutique. Les grandes entreprises pharmaceutiques laissent des start-up en biotech chercher et développer de nouvelles molécules ou de nouveaux procédés puis utilisent leurs ressources pour assurer la fin des tests et essais cliniques avant de permettre une production à grande échelle obéissant à des standards stricts de qualité et de sécurité. À titre d’exemple, Sanofi a racheté plus d’une dizaine de start-up dont dernièrement la biotech britannique Kymab spécialisée dans le développement d’un anticorps monoclonal humain.
La présence d’un grand nombre d’acquisitions dans ce secteur peut s’expliquer par deux facteurs. Tout d’abord, l’avènement de technologies de rupture comme le séquençage de l’ADN ouvre le champ à un abîme d’innovations que les grands acteurs n’ont pas le temps d’explorer en totalité. Ensuite, en raison des standards élevés de qualité, les temps de développement sont longs et les coûts des essais cliniques et d’industrialisation sont extrêmement élevés. Pour ces raisons, passé un certain stade, le développement de l’innovation devient très difficile pour un jeune acteur s’il ne s’adosse pas à un gros acteur industriel possédant les moyens et le savoir-faire. De façon générale, dans les industries lourdes, les cycles de développement sont trop longs et coûteux pour qu’une start-up puisse réussir seule.
Dans le domaine du numérique, de nombreuses acquisitions sont faites par des start-up ou anciennes start-up pour consolider leurs produits existants ou se diversifier. Ces entreprises ayant un ADN proche de celui des jeunes start-up, il apparaît naturel qu’elles se consolident en rachetant ce type d’entités. De plus, on observe sur ces technologies des cycles de développement très courts, une très grande rapidité de mise sur le marché (mais aussi d’obsolescence) ainsi qu’une grande modularité qui permet une bonne intégration. Ces éléments peuvent justifier la haute fréquence de ce type d’acquisition. Ainsi Spotify, créée en 2006, a déjà acquis plus d’une vingtaine de jeunes pousses.
Les acquéreurs de start-up françaises
Qui sont-ils ?
Le portrait-robot de l’acquéreur de start-up françaises tient principalement en deux caractéristiques : il est souvent jeune et travaille dans des domaines liés aux nouvelles technologies.
Une étude menée en 2019 par le cabinet de conseil Avolta Partner indique que 50 % des acquéreurs de pépites technologiques françaises ont moins de 20 ans d’existence et la plupart travaillent dans le numérique.
À l’échelle mondiale, selon une étude de Mind the Bridge et Crunchbase (2018), on retrouve le même profil parmi les 30 acquéreurs les plus actifs de la dernière décennie. Leur âge médian est de 30 ans et 77 % d’entre eux travaillent dans des secteurs liés aux nouvelles technologies.
Que cherchent-ils ?
Les start-up recherchées, en France et dans le monde, ont généralement entre 5 et 15 ans d’existence ; seule une petite moitié (~40 %) d’entre elles est rentable et elles comptent en moyenne 50 à 100 employés. L’âge moyen des start-up françaises au moment du rachat, dans l’échantillon considéré dans notre étude auprès de 28 start-up, était de 8 ans.
À l’échelle mondiale, Mind the Bridge et Crunchbase observent que les start-up rachetées évoluent principalement dans les secteurs de l’informatique (31 %), de la banque et finance (12 %), des biotechs (10 %), et du marketing et publicité (10 %). Dans ces domaines, l’apport de ces start-up est principalement technologique.
Le montant moyen de la transaction varie quant à lui largement d’une région du monde à l’autre. En effet, le montant moyen de rachat lors de l’acquisition d’une start-up européenne est de 30 millions de dollars, soit un montant plus de trois fois inférieur à celui d’une start-up américaine.
Figure 2.3 – Portaits robots
Source : Inspiré de Avolta Partners, Tech Exit Transactions Multiple, 2019 Edition / Mind the Bridge & Crunchbase, TechStartup M&As 2018 / Étude des auteurs
Quelles sont leurs motivations ?
Comme vu précédemment, les objectifs poursuivis lors de l’acquisition de start-up sont variables. Les grandes entreprises souhaitent mettre la main sur de nouvelles technologies et des modèles de rupture afin de rester compétitives et d’éviter de se faire « disrupter » (Christensen, 1997) sur leur cœur de métier tandis que les jeunes acteurs cherchent à atteindre une taille critique en se consolidant sur leur marché.
Pour parvenir à ces objectifs, il existe plusieurs façons d’incorporer la valeur de la start-up dans l’entreprise. Dans le domaine des technologies, Avolta Partners (2018) a identifié trois catégories d’intégration : la tech acquisition, la tech integration et le corporate development16.
La tech acquisition consiste à acquérir une start-up dans le but d’exploiter sa technologie dans un département à part, sans chercher à l’intégrer dans les produits existants de la grande entreprise. Ainsi, après son rachat par l’acteur allemand Daimler, la start-up de VTC Chauffeur privé a conservé son indépendance et son modèle de fonctionnement. Il en va de même de l’entreprise de financement KissKissBankBank rachetée par la Banque Postale afin de toucher un segment plus jeune et élargir sa gamme de modes de financement. Dans le cadre d’une tech acquisition, une grande autonomie est généralement laissée à la start-up et à son équipe dirigeante ce qui rend l’intégration relativement facile.
La tech integration consiste au contraire à acheter une start-up dans le but d’intégrer sa technologie et de la diffuser dans la feuille de route existante des produits de l’acquéreur. Les synergies entre les produits des deux entreprises rendent le montant de ce type de rachat particulièrement élevé. Ce sont les synergies envisagées avec Outlook qui ont poussé Microsoft à valoriser et à racheter 100 millions de dollars l’application de calendrier Sunrise qui n’en était pourtant encore qu’à un stade de développement très peu avancé. De même le logiciel de recommandation musicale mis en place par la start-up française Niland s’intègre parfaitement dans le cœur de l’offre de Spotify. L’intégration peut être plus ou moins difficile. Lorsqu’il s’agit d’une brique technologique indépendante, comme la propriété intellectuelle sur le procédé de développement d’une molécule, le transfert est immédiat et ne nécessite pas toujours la présence de l’équipe fondatrice. À l’inverse, lorsque la technologie est étroitement imbriquée à un produit et qu’elle peut bénéficier à plusieurs gros produits complexes, l’intégration peut durer plusieurs années et mobiliser des dizaines d’employés de la start-up et de l’entreprise acquéreuse à temps plein.
Le corporate development ne se base pas nécessairement sur une logique d’acquisition technologique mais s’inscrit davantage dans une optique financière afin de renforcer des indicateurs de l’entreprise acquéreuse comme ses marges ou ses parts de marché. Ces entreprises s’intéressent par exemple aux plateformes d’e-commerce qui ont besoin d’une taille critique afin d’améliorer leurs marges. Dans ce type d’acquisition, l’enjeu réside dans l’intégration organisationnelle, financière et managériale de la start-up. C’est notamment le cas de l’entreprise japonaise Rakuten qui a acquis Priceminister pour consolider son emprise sur l’e-commerce européen.
L’étude d’Avolta indique que l’âge est la variable expliquant le mieux le comportement des acquéreurs. Les jeunes acquéreurs pratiquent de façon égale ces trois types d’intégration tandis que les acquéreurs plus anciens ont généralement tendance à faire davantage de corporate development.
Parmi les entreprises interrogées, les motivations de l’entreprise acquéreuse étaient équitablement réparties entre une volonté d’inclure la technologie de la start-up dans des produits existants et une volonté de laisser à la start-up acquise une certaine indépendance sur un nouveau segment de marché. Parfois même, l’entreprise acquiert une start-up servant de noyau de compétence pour se lancer dans une nouvelle activité. Ce fut le cas dans le domaine de la robotique avec le rachat d’Aldebaran par l’acteur japonais SoftBank, aujourd’hui en difficulté17.
Figure 2.4 – Pourquoi racheter une start-up ?
Note : Résultat d’un sondage mené par les auteurs auprès de 28 start-up rachetées.
La France face aux autres puissances mondiales
La France n’est pas seule à rêver de start-up. Le sujet est en plein essor dans le monde entier et la plupart des pays technologiquement avancés ont pour ambition de construire un solide écosystème entrepreneurial. Deux variables distinguent les différents pays : chaque acteur poursuit des objectifs stratégiques qui lui sont propres et les écosystèmes n’ont pas tous le même degré de maturité. En particulier, on distingue trois courants stratégiques principaux, portés respectivement par les États-Unis, Israël et la Chine.
Le modèle hégémonique des États-Unis. Le concept de start-up est né aux États-Unis, il n’est donc pas étonnant que ce soit le pays avec l’écosystème entrepreneurial le plus développé. La stratégie américaine est basée sur une logique d’hégémonie technologique. Les États-Unis ont les compétences pour développer des jeunes pousses, les fonds pour les supporter et les acteurs financiers pour les acquérir. Leur maturité leur permet d’être plus compétents sur les sujets technologiques. Ces différentes ressources leur permettent à la fois de créer de très belles start-up technologiques et de repérer à travers le monde les pépites les plus prometteuses afin de les acquérir. Ainsi, les États-Unis ont réussi à faire émerger de nombreux champions, dont les GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft), qui en se nourrissant de start-up ont pu maximiser leur emprise sur leurs marchés. Bien que surveillant leurs pépites stratégiques dans les domaines sensibles, ils laissent les acteurs étrangers acheter la plupart de leurs start-up et n’hésitent pas en retour à « faire leur marché » dans les écosystèmes étrangers.
Israël, l’usine exportatrice de start-up. Israël a une stratégie très différente basée sur la production intensive et l’exportation de start-up. Si le pays possède les talents nécessaires pour monter de belles start-up, il reconnaît ne pas avoir un marché intérieur suffisant pour les transformer en grandes entreprises. Ces start-up sont en écrasante majorité financées par de l’argent étranger (90 % des montants levés sont d’origine étrangère). Au lieu de chercher à tout prix à conserver leurs pépites, les Israéliens les vendent majoritairement aux acteurs américains (80 %) ou les cotent au NASDAQ afin d’apporter des recettes financières à l’État israélien et ainsi amorcer de nouvelles entreprises (DG Trésor, 2021). Israël parvient de plus à conserver la R&D sur place afin de garder la maîtrise du savoir technologique acquis. Ce positionnement lui a permis de devenir aujourd’hui un réacteur à innovation, qui exporte son savoir dans le monde entier. Le cœur de cette stratégie israélienne trouve son origine dans le programme Yozma (Carpentier et Suret, 2006) lancé dans les années 1990 qui a favorisé l’essor du capital-risque en Israël ainsi que le développement de la formation et de la recherche axé vers les technologies de pointe comme la cybersécurité ou l’intelligence artificielle.
Le modèle protectionniste chinois. Un dernier modèle intéressant est le modèle protectionniste à tendance importatrice de la Chine. À l’inverse des Israéliens, les Chinois cherchent à conserver au maximum leurs jeunes pousses (qui sont de toute façon souvent adaptées au marché chinois et pas aux marchés occidentaux) tout en important quelques belles start- up étrangères afin de capter un savoir-faire qu’ils pourront déployer localement. Les ressources considérables de leur économie planifiée permettent à leurs entreprises d’acquérir des pépites à travers le monde, peu importe le prix. Ce modèle leur permet de délocaliser une partie de l’innovation, pour se concentrer sur l’industrialisation des technologies. Même s’il existe un riche écosystème entrepreneurial interne, le nombre d’exportations de start-up reste peu élevé et les données concernant les start-up chinoises assez rares. De plus, les acteurs chinois préfèrent soit investir minoritairement dans les start-up lorsqu’elles sont encore jeunes et peu visibles, bien avant qu’elles soient assez mûres pour être acquises, soit à l’inverse racheter des entreprises technologiques qui ne sont pas des start-up (comme l’entreprise allemande de robotique Kuka). Leur stratégie d’importation de technologies ne se reflète donc pas nécessairement dans les données concernant les acquisitions.
Dans ce panorama simplifié, où se situent la France et l’Europe ? Les prétentions françaises et européennes ressemblent à celles des États-Unis : la France rêve de créer ses propres licornes qui pourraient devenir les grandes entreprises technologiques de demain et de les conserver, pour faire de l’Hexagone un acteur mondial dans le domaine des nouvelles technologies. Le gouvernement s’est d’ailleurs donné pour objectif la création de 25 licornes françaises d’ici à 2025. La France participe en outre activement au projet Scale-up Europe qui vise à faire émerger 10 entreprises technologiques européennes dépassant les 100 milliards d’euros de valorisation d’ici 2030. Toutefois, comme cela sera détaillé au chapitre suivant, si les ambitions françaises sont clairement définies, le degré de développement de son écosystème, lui, est encore faible par rapport à d’autres puissances mondiales.
On peut comparer les pays selon trois dimensions : leur capacité à produire des start-up (autrement dit la maturité de leur écosystème), leur taux de rachat domestique (soit leur capacité d’absorption et de rétention de leurs propres start-up) et enfin leur balance commerciale (le rapport entre les start-up importées et exportées). Ces indicateurs peuvent être calculés de deux manières : à partir du nombre de rachats de start-up ou du montant des transactions. Si les indicateurs de montants peuvent sembler a priori plus pertinents, ces chiffres sont impossibles à obtenir car près de 80 % des montants de transactions de rachat ne sont pas divulgués. Il est plus judicieux de se reposer sur le nombre de rachats, bien que cette métrique comporte des biais, notamment en raison de l’imprécision statistique de la définition d’une start-up (cf. chapitre 1). L’étude ici présentée s’appuie sur l’analyse d’une des principales bases de données recensant les levées de fonds et acquisitions sur les start-up, Dealroom. Pour renforcer les résultats, nous les avons ensuite croisés avec ceux de deux études menées par des cabinets de M&A et d’innovation, Avolta Partners et Mind the Bridge. Si les chiffres ne doivent pas être considérés comme exacts à l’unité près, les grandes tendances de fond qui se dégagent sont fiables et globalement cohérentes entre les différentes sources.
Un écosystème français en progression
Au moment d’évaluer le dynamisme et la liquidité sur le marché des start-up, deux métriques sont intéressantes : le nombre d’exits ainsi que les montants levés en capital-risque sur cette période. Les exits sont plus parlants que le nombre de créations de start-up en ce qu’ils représentent les start-up à succès qu’un écosystème a effectivement réussi à produire. Les montants levés en capital-risque, qui sont le carburant de la start-up, donnent quant à eux une indication sur l’effort fourni par un pays pour faire prospérer son écosystème. Il est par ailleurs plus pertinent de rapporter ces indicateurs au PIB de chaque pays, afin de normaliser les données. La figure 2.5 présente ces deux indicateurs pour la France, les États-Unis, la Chine, le Japon, l’Allemagne, la Grande-Bretagne et Israël.
Figure 2.5 – Capacité de production de l’écosystème entrepreneurial français
Israël, usine exportatrice de start-up, a des ratios plus de deux fois supérieur à ceux des États-Unis, qui vendent également beaucoup de start-up comparativement aux autres pays. On constate également que la hiérarchie entre pays est très stable quel que soit l’indicateur retenu (nombre d’exits ou investissement en capital-risque), sauf dans le cas de la Chine qui, pourtant très active dans le financement de start-up, fait état d’un petit nombre de ventes. Les ratios du Japon semblent traduire une assez faible maturité de son écosystème. La France et l’Allemagne, en milieu de tableau, affichent une activité sensiblement supérieure à celle des deux puissances asiatiques. La Grande-Bretagne est encore plus avancée, ce qui peut s’expliquer par un intérêt plus ancien pour les start-up, la présence d’un système universitaire plus orienté vers l’essaimage – notamment dans les sciences du vivant – et par la facilité de la collaboration avec les États-Unis. Néanmoins, ces trois grands acteurs du continent européen ont encore du retard sur les deux pays leaders.
Si la Silicon Valley a 70 ans d’existence, l’écosystème français est plus récent. Et son développement s’est réellement accéléré ces quinze dernières années avec deux étapes clés : la création du statut Jeune entreprise innovante en 2005 qui accorde aux start-up des exonérations fiscales pendant 8 ans, et la naissance du label French Tech en 2013. D’autres mesures ont depuis permis de soutenir le développement de cet écosystème, comme la « Loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques » dite « loi Macron » de 2015, qui a facilité les démarches juridiques. Le crédit impôt recherche (CIR), qui permet des réductions d’impôts sur la base des dépenses de R&D de l’entreprise, offre lui aussi des avantages aux jeunes entreprises. Sur le terrain, plusieurs initiatives ont été lancées, et notamment la création par Xavier Niel de Station F, plus grand incubateur de start-up au monde, ou encore de l’École 42, une formation gratuite dont la pédagogie axée sur la créativité et l’autonomie forme des développeurs en informatique, ressource la plus précieuse pour une start-up. Depuis 2014, les grandes entreprises ont commencé elles aussi à lancer massivement leurs incubateurs et leurs fonds de CVC tandis que les universités se mettent à dispenser des formations d’entrepreneuriat. La progression de l’écosystème français est d’ailleurs très rapide : entre 2014 et 2019, l’investissement en France dans des start-up a été multiplié par six, quand il a été multiplié par trois dans le reste du monde18.
La France importe autant de start-up qu’elle en exporte
La France souhaite être une nation productrice de jeunes pousses sans toutes les exporter. Là encore, les mesures peuvent varier selon les études et les méthodologies choisies mais la conclusion principale demeure : la France se fait acheter des start-up et ses entreprises achètent dans le même temps des start-up étrangères dans des proportions globalement similaires. Il n’existe donc pas de « fuite » de start-up, dans la mesure où les départs sont compensés par des acquisitions.
Valeo, l’Oréal, Thales et d’autres entreprises interrogées font principalement leurs acquisitions à l’international. Ce marché mondial des start-up présente deux avantages : un ensemble bien plus vaste et diversifié de start-up et la présence de jeunes pousses plus mûres, évoluant dans des écosystèmes plus développés que le nôtre.
Selon les données de Dealroom sur la période 2015-2021, la France a un ratio « start-up vendues sur start-up achetées » de 1,14, proche de l’équilibre. L’étude de Mind the Bridge et Crunchbase, centrée sur les jeunes entreprises technologiques, note quant à elle un léger déséquilibre, avec un taux de 0,8.
Figure 2.6 – Flux mondiaux d’acquisitions de start-up, en nombre, 2015-2021
Source : Données Dealroom, acquisitions entre janvier 2015 et juin 2021 d’entreprises soutenues par des fonds de capital-risque.
Note : Les flèches partent du pays d’origine de la start-up pour aller vers l’acquéreur. Par exemple, entre 2015 et 2021, 81 start-up européennes ont été rachetées par des entreprises françaises.
Une difficulté à retenir les plus belles pépites
Si la France n’est pas en « déficit » de start-up, elle peine à conserver ses plus belles pépites, mettant à mal son ambition de former des champions nationaux. Il faut en effet prendre en compte la capacité du pays à retenir ses pépites pour en faire des meneurs technologiques. Il est alors pertinent de regarder le taux de rachat domestique, défini comme le pourcentage de start-up acquises par une entreprise de leur pays d’origine par rapport au nombre total de start-up vendues de ce pays (figure 2.7).
Ce taux varie significativement en fonction de la définition que l’on retient pour une start-up. Le résultat général qui se dégage tout de même est le suivant : si la France possède des entreprises pouvant racheter de nombreuses pépites, elles ne sont pas en mesure de les capter aussi efficacement que leurs concurrentes américaines et nos plus belles pépites partent à l’étranger.
Centrée sur les entreprises financées par le capital-risque (soit environ 80 % des start-up19), la figure 2.7 montre qu’Israël, grand exportateur de start-up, ne conserve que 8 % de ses pépites dans des entreprises nationales. De l’autre côté du spectre, la Chine protectionniste conserve ses start-up à hauteur de 76 %. Le Japon et les États-Unis affichent des taux similaires, sur des cohortes aux tailles très différentes cependant.
Les trois principaux pays européens apparaissent, là encore, en milieu de tableau. En particulier, le Royaume-Uni exporte la majorité de ses start-up en dépit de la maturité de son écosystème. On ne sait dire si cette ouverture à l’export relève d’un choix stratégique assumé ou bien si « la machine à produire » des start-up britanniques est en avance, proposant une offre abondante qui ne trouve pas suffisamment d’acquéreurs locaux.
De manière comparable, un tiers des start-up françaises acquises le sont par des entreprises françaises. Ce ratio témoigne à la fois de l’existence d’acteurs français en mesure de racheter des start-up domestiques, d’un retard relatif du système financier français et en particulier un manque d’acquéreurs et, de façon plus positive, de l’intérêt que des écosystèmes plus mûrs portent aux pépites françaises.
Figure 2.7 – Pourcentage de rachats domestiques, par pays
Le pourcentage de rachats domestiques est défini comme le nombre de start-up acquises par une entreprise de leur pays d’origine sur le nombre total de start-up vendues par pays entre 2015 et juin 2021.
Source : Données Dealroom, acquisitions entre janvier 2015 et juin 2021 d’entreprises soutenues par des fonds de capital-risque. Traitement des données réalisé par les auteurs.
Complétant ce résultat, un rapport d’Avolta Partner recense les sorties d’entreprises technologiques ayant eu lieu entre 2017 et 2019. L’échantillon considéré n’inclut pas exclusivement des start-up, ce qui induit des différences dans les résultats sans en infléchir la conclusion générale. Dans deux cas sur trois, l’acquéreur d’une entreprise technologique française est une entreprise française ; la valeur créée par la pépite reste donc sur le sol français20. Parmi le tiers restant, la moitié concerne des acquéreurs américains et l’autre des acquéreurs européens non français. En revanche, cette étude apporte une information supplémentaire : si les transactions sont majoritairement françaises en nombre, les rachats par des acquéreurs français représentent environ le quart des montants dépensés par les acteurs américains.
- 14 – Environ 10 % des PME cédées ont moins de 10 ans d’existence contre 100 % des start-up de l’échantillon considéré. De plus, les cessions de PME ne représentent pas toutes des rachats stratégiques par d’autres entreprises indépendantes, ce qui est le cas pour les start-up. Enfin, les start-up sont incluses dans les données PME et tirent les chiffres vers le haut. Sources : In Extenso, Régions & Transmission, panorama des cessions et acquisitions de PME, 4e édition, 2020 ; Observatoire CRA de la transmission des TPE/ PME, Edition 2017.
- 15 – Base de données de la French Tech tirée de Dealroom.
- 16 – Avolta Partners, Tech exit transaction Multiples Europe 2018 Edition et vidéo Youtube : Masterclass : Enjeux et tendances du M&A Tech en Europe | Café Connect | Le Hub Bpifrance
- 17 – Émission Net plus ultra France Inter du 2 juillet 2021.
- 18 – Selon le baromètre EY du capital-risque en France de 2019 et le rapport de KPMG Venture Pulse du premier quadrimestre 2020.
- 19 – 80 % des start-up interrogées par EY (parmi un large panel) pour son baromètre annuel sur la performance économique et sociale des startups numériques en France, étaient financées par capital-risque. À l’inverse toute entreprise financée par du capital- risque peut être considérée comme une start-up en raison de la pression de croissance exercée et des multiples de transaction recherchés par ce type d’investisseur.
- 20 – Avolta Partners, Tech exit transaction Multiples, France édition 2019.
Le manque d’acquéreurs français
Une grande partie des start-up françaises les plus prometteuses quittent le territoire français et participent au mouvement de consolidation des acteurs étrangers. Ce constat peut légitimement soulever plusieurs interrogations concernant l’efficacité de l’effort important de la BPI et d’autres institutions publiques en faveur du développement des jeunes pousses. Plus globalement, il interroge sur le niveau de développement de l’écosystème français des start-up.
Les risques des rachats étrangers
Le rachat des start-up françaises par des entreprises étrangères présente des risques à la fois économiques, politiques et industriels.
D’un point de vue principalement économique, le premier danger en cas de rachat par un acteur étranger est la délocalisation. Si la start-up est absorbée et ferme son siège ou le déplace à l’étranger, les emplois générés par l’activité ne seront plus créés en France et il existe un risque de « fuite des cerveaux », c’est-à-dire des talents vers l’étranger. De plus, l’entreprise ne paiera plus d’impôts en France. Face à ce risque avéré de délocalisation économique, on pourrait penser que l’argent public serait mieux investi à financer des entreprises plus traditionnelles, pour lesquelles on observe peut-être moins de délocalisations et une création d’emplois moins rapide mais plus pérenne.
D’un point de vue plus politique, le risque est celui de la perte de puissance technologique. En effet, la plus grande valeur des start-up réside dans leur savoir-faire technologique ainsi que dans leur capital humain. Cette maîtrise technologique détermine en partie la capacité d’un État à peser dans les grandes décisions du siècle qui vient. Les technologies liées au numérique et à la donnée représentent par exemple aujourd’hui des outils de soft power que les États cherchent à protéger. Le projet GAIA-X d’un cloud souverain européen illustre aussi très bien cette tendance de fond.
Or, lors d’un rachat, il est très difficile d’éviter un transfert technologique vers l’entreprise acquéreuse. Bien que certaines clauses permettent de protéger des données sensibles ou de conserver des relations avec certains partenaires, la majorité de la propriété intellectuelle – les brevets mais également le savoir-faire et les outils développés par les équipes – deviennent la propriété de l’acquéreur. Cette fuite de la propriété intellectuelle est d’autant plus frustrante qu’elle est souvent issue de longues et coûteuses années de recherche au sein des laboratoires publics. Les start-up permettent certes à la technologie d’essaimer mais elles demeurent des véhicules fragiles, facilement absorbés. Lorsqu’elles transfèrent leur propriété intellectuelle, c’est tout leur réseau de partenaires français qui en perdent l’usage, au profit de nouveaux acteurs industriels situés dans la zone géographique de l’acquéreur. Du point de vue de la puissance publique, une alternative possible au financement des start-up serait donc de flécher cet argent vers les laboratoires, universités et grandes entreprises, plus à même de protéger les technologies qu’ils développent.
Enfin, d’un point de vue industriel (et politique), le problème réside dans le fait que le rachat des start-up françaises empêche le développement de consolidateurs nationaux de technologie. A fortiori, la France ne pourra jamais compter de grands champions technologiques mondiaux si aucune pépite ne se maintient sur le territoire pour son développement. Les secteurs liés au numérique, dans lesquels les start-up excellent, représentent aux États-Unis près de 30 % de la capitalisation boursière de l’indice américain S&P 50021, tandis que la valorisation d’Apple excède à elle seule celle de l’intégralité du CAC 40. La puissance de ces acteurs transparaît à travers l’hégémonie des GAFAM : en plus de posséder des trésoreries de plus de 100 milliards de dollars, ces entreprises sont régulièrement aux prises avec la justice de différents États pour leur mainmise sur les données personnelles des citoyens du monde entier, leurs tentatives présumées d’exercer une influence sur l’opinion publique ou encore leurs comportements d’acquisition jugés anticoncurrentiels. À coup sûr, cet accaparement des meilleures pépites françaises par une poignée de leaders du numérique aux moyens illimités porte également préjudice à nos entreprises françaises, qui pourraient en bénéficier pour innover et rester compétitives. Faut-il alors envisager des mesures protectionnistes pour protéger nos start-up de l’appétit insatiable de certains acteurs étrangers ?
Ces craintes, très répandues dans la presse comme au sein de l’administration, sont fondées sur quelques cas avérés. Le rachat par Spotify de la jeune pousse de recommandation musicale Niland, elle-même issue de l’IRCAM (Institut de recherche et coordination acoustique/musique), a entraîné la disparition de la pépite, immédiatement absorbée, et le départ des équipes à New York. Néanmoins, bien qu’en forte progression, l’écosystème des start-up en France n’est pas encore assez solide et mûr pour se structurer seul. Les jeunes pousses tricolores sont encore largement dépendantes du marché, des fonds, des acquéreurs et des places boursières étrangères.
Une dépendance aux capitaux étrangers
Une start-up ayant un besoin vital de connaître une très forte croissance ne peut souvent pas s’en tenir au marché français, trop petit, tant en matière de clients que de capitaux. Le marché européen étant encore trop fragmenté par des différences linguistiques, réglementaires et culturelles, les marchés cibles pour les start-up sont souvent les États-Unis ou parfois l’Asie.
Progressivement, la start-up s’internationalise et cherche à développer une part croissante de son activité, sur le marché américain notamment. Pour s’introduire correctement sur ce marché, la présence d’un investisseur ou d’un acquéreur local est un réel atout, ce qui incite les start-up françaises à ouvrir leur capital à des acteurs étrangers. Par exemple, si la start-up Stupeflix était presque entièrement basée en France, elle réalisait tout de même l’essentiel de son chiffre d’affaires à l’étranger, notamment aux Philippines ou aux États-Unis où les clients ont plus d’appétence pour ces nouvelles technologies.
Les start-up pourraient pénétrer le marché américain sans ouvrir leur capital à un acteur étranger mais elles auront nécessairement besoin de fonds pour financer leur stratégie de croissance. Or, malgré des progrès importants, les fonds français ne sont pas encore assez importants pour assumer ce déploiement international des start-up. Parmi les 15 plus grosses levées de fonds de start-up françaises en 2020, seulement 2 ont été menées par des investisseurs français. De plus, ces investisseurs français étaient le Cnes et la BPI, deux établissements publics. Force est de constater que, au-delà d’un certain stade de développement, la France est dépendante de fonds étrangers pour la survie et l’essor de ses pépites. Bruno Maisonnier, fondateur de la start-up de robotique Aldebaran, raconte qu’il avait besoin de 15 millions d’euros en 2011 pour financer son entreprise. Après avoir rencontré des dizaines d’investisseurs privés européens non intéressés ou n’ayant pas les moyens d’investir une telle somme, il s’est tourné vers les pouvoirs publics, par le biais de ce qui était alors le prédécesseur de la BPI, Oséo. Ses interlocuteurs ont manifesté un vif intérêt mais les mois ont passé sans qu’aucune proposition concrète n’émerge. Après six mois, autant dire une éternité pour une start-up en quête de fonds et qui joue sa survie, Bruno Maisonnier a décidé d’élargir ses horizons de recherche à l’international. Au cours d’un événement, il croise un représentant de SoftBank, immédiatement intéressé par la jeune pépite. Une rencontre est organisée entre Bruno Maisonnier et Masayoshi, président fondateur de la banque. S’ensuit rapidement une offre de rachat pour 100 millions d’euros. Juste avant d’accepter, l’entrepreneur reçoit, après un an d’attente, une réponse des pouvoirs publics français qui souhaitent investir. Il est trop tard. Pendant cette période difficile, il ne s’est pas senti soutenu par la France, tandis que des investisseurs japonais ont manifesté un réel intérêt pour son produit, lui proposant une très belle offre ainsi qu’un plan d’intégration prometteur. Aldebaran s’est donc vendue à Softbank et a été renommée Softbank Robotics Europe en 2016.
Le constat est similaire pour les entrées en Bourse : elles se font majoritairement sur le NASDAQ américain, faute de marché suffisamment structuré dédié aux valeurs technologiques en Europe. C’est par exemple le choix qu’a fait la start-up de reciblage publicitaire Criteo, entrée en Bourse en 2013. Parmi les faiblesses importantes de l’Europe l’empêchant d’imposer sa propre place boursière, on compte le manque d’expertise fiable pour attribuer une valeur aux entreprises technologiques, le manque de gros fonds capables de financer des start-up mûres (late stage) ainsi que le manque de fonds capables de restructurer les start-up pour les rendre prêtes à entrer en Bourse.
Un manque de jeunes consolidateurs technologiques
De rares entreprises technologiques au profil de gros acquéreurs
La majorité des acquéreurs de start-up sont eux-mêmes des start-up ou d’anciennes start-up cherchant à se consolider. Google a par exemple réalisé 150 acquisitions sur la période 2010-2018 tandis que d’autres très jeunes acteurs, ayant alors tout juste une dizaine d’années d’existence comme Twitter, ont effectué 46 opérations sur cette période.
Or, le CAC40 ne comprend pas d’entreprises satisfaisant ces critères d’âge et de secteur d’activité. La plus proche serait Dassault Systèmes, qui est d’ailleurs l’un des acteurs français les plus actifs en matière d’acquisition de start-up avec 13 acquisitions menées entre 2010 et 2018 et qui était jusqu’à très récemment la seule entreprise technologique à être cotée sur le marché principal d’Euronext. Les autres start-up françaises suffisamment établies pour se consolider sont très actives mais ne sont pas encore très nombreuses. Ainsi Blablacar, la start-up de covoiturage fondée en 2006, a déjà effectué 13 acquisitions.
La France manque donc d’acteurs susceptibles de racheter une part significative de ses start-up et cela se traduit par un manque de propositions françaises pour acquérir les meilleures pépites : parmi l’ensemble des start-up rachetées par des acteurs étrangers interrogées dans le cadre de cette étude, seules 18 % avaient reçu une proposition venant d’une entreprise française.
De nouveaux secteurs sans acteurs français susceptibles de consolider
En plus de cette incapacité des entreprises françaises à absorber un volume suffisant de start-up, se pose aussi le problème du manque d’acteurs sur certaines verticales technologiques.
Les exemples récents dans le domaine de la cybersécurité en sont une illustration. En 2019, Cisco a racheté la pépite Sentryo. En entretien, Laurent Hausermann, cofondateur de Sentryo, a expliqué qu’il ne voyait pas d’acteur français pour qui un rachat de Sentryo aurait pu faire sens. En 2021, en l’espace d’une semaine à peine, ce sont deux des start-up de cybersécurité les plus prometteuses, Sqreen et Alsid, qui ont été rachetées par des entreprises américaines. En matière de cybersécurité, la France manque notamment d’acteurs mûrs dans des domaines tels que la sécurité logicielle ou des réseaux. Ces sujets sont peu développés chez les leaders nationaux comme Thales, qui travaillent surtout sur des domaines adjacents.
Cette pénurie d’acteurs dans certains secteurs participe au manque de dynamisme et de profondeur du marché des technologies. Le domaine du SaaS (Software as a Service) en est un autre exemple. Il est ressorti des entretiens qu’il était très difficile de monter une société d’édition de logiciel SaaS sans avoir un très fort ancrage aux États-Unis, où se trouve la majorité du marché et où l’appétence des grandes entreprises pour ce type de solution est bien plus prononcée. Il existe là encore très peu de grands acteurs tricolores pouvant racheter de jeunes start-up d’origine française. Nombreuses d’ailleurs sont celles qui, comme Algolia ou Dataiku, ont très tôt délocalisé leur siège aux États-Unis pour être au plus près du marché et des acteurs américains.
Des grands groupes encore peu friands des start-up
Si la France possède encore peu de jeunes entreprises technologiques performantes, elle peut néanmoins se targuer de compter dans ses rangs de nombreuses grandes entreprises d’envergure mondiale. Ces entreprises qui ont d’importants moyens financiers, un réseau et une image internationale pourraient en théorie participer activement à l’accélération du développement des start-up en les acquérant. À l’heure actuelle pourtant, les relations entre start-up et grandes entreprises françaises sont encore timides et vont rarement jusqu’au rachat, même si certaines entreprises ont entamé de réels efforts en ce sens.
Des modes de fonctionnement trop différents
Le principal obstacle aux interactions entre start-up et grands groupes provient de leurs profondes différences d’intérêts, d’organisation et de culture : d’un côté, un David jeune, agile et innovant mais disposant de peu de moyens, et de l’autre, un Goliath robuste, possédant de nombreuses ressources et une véritable puissance d’industrialisation mais tenu par des processus rigides et une certaine inertie. La start-up est une entité fragile, qui ne peut survivre aux contraintes étouffantes de la grande entreprise, que ce soit la sécurisation de l’IT (pour Information Technology) ou encore les délais interminables avant décision ou paiement. En sens contraire, la notion de qualité dans une start-up se limite généralement à une dizaine de retours de clients satisfaits ou encore à un taux de panne inférieur à 10 %, ce qui sidère la grande entreprise en quête d’une fiabilité et d’une sécurité maximales.
Certaines histoires à succès, comme le rachat de Compte Nickel par la BNP pour 200 millions d’euros, montrent néanmoins que ce type de rachat peut fonctionner et apporter beaucoup de valeur aux deux acteurs. Pour Hugues Le Bret, fondateur de Compte Nickel, le succès de cette union tient d’une part à la mise en place très tôt d’une vision commune du schéma et des modalités d’intégration de la start-up et d’autre part à une connaissance par les employés de Compte Nickel du milieu des grandes banques, à la faveur d’une restructuration de l’entreprise quelques années plus tôt (Hugues Le Bret a lui-même travaillé dix ans à la Société Générale et a dirigé Boursorama avant de créer Compte Nickel).
Les deux entités ont des fonctionnements qui ne peuvent être réconciliés sans ajustement. Sauf exception comme dans le cas de Compte Nickel, la start-up n’a pas les moyens de s’adapter aux pratiques de la grande entreprise : c’est donc à cette dernière de faire le plus d’efforts pour s’accommoder au mode de fonctionnement de la jeune pousse.
Il ne s’agit pas d’une tâche facile : une start-up privilégie toujours la croissance à la rentabilité, en raison de la nature de son financement, et ne cherche pas nécessairement à se conformer aux exigences d’une entreprise classique. Un grand groupe doit donc préparer ses collaborations avec des start-up. Cela nécessite de repenser une organisation interne où les départements financiers et opérationnels s’accommodent d’un certain niveau d’incertitude financière et technique. De même, une bonne intégration nécessite de nombreuses ressources, de bon niveau et provenant de chaque département, dédiées à temps plein sur l’activité, ainsi que des processus internes simplifiés. Cisco, qui a fait du rachat de start-up l’un de ses principaux moteurs de croissance, possède des employés spécialisés dans les ressources humaines, la finance, le juridique, ainsi que des ingénieurs dédiés à temps plein sur l’intégration des nouvelles entreprises acquises.
Un cas symptomatique de rachat raté faute d’adaptation de l’entreprise acquéreuse est celui de la start-up Withings qui produit des objets connectés dans le domaine médical. Suite à l’impatience des investisseurs et à la difficulté de trouver des fonds, Éric Carreel s’est vu contraint de céder son entreprise au géant finlandais Nokia qui souhaitait se développer dans la santé. Néanmoins, Nokia n’avait pas suffisamment planifié l’arrivée de Withings ; en particulier, elle n’avait pas prévu dans quel département la jeune start-up devait atterrir. Certains employés un peu désœuvrés y ont vu une belle opportunité pour retrouver de l’activité et ont cherché à asseoir leurs pratiques internes propres à Nokia sans s’interroger sur les besoins de la pépite et les dangers de ces pratiques. Les résultats ont été désastreux et la jeune pousse, qui était rentable jusqu’à son rachat, s’est mise à accumuler les pertes. Ne voyant pas comment redresser la situation, Nokia a choisi de remettre en vente Withings deux ans après son achat ; la jeune entreprise a finalement été reprise pour une fraction du prix initial de vente par son ancien dirigeant et fondateur Éric Carreel.
L’aversion au risque, un problème culturel français ?
Le paragraphe précédent évoque des difficultés que l’on est susceptible de retrouver dans tous les pays, dans toute opération de rachat d’une start-up par une grande entreprise. Or, plusieurs entrepreneurs interrogés se montrent spécifiquement critiques envers les grandes entreprises françaises avec lesquelles ils ont tenté de collaborer. Toute considération organisationnelle mise à part, ils estiment que la culture française freine la prise de risque de la part des grands groupes. On a ainsi rappelé au chapitre précédent l’écart entre le montant moyen du rachat d’une start-up aux États-Unis (100 millions d’euros) et en Europe (30 millions d’euros). Si la disponibilité de liquidités en est incontestablement une explication première, s’agit-il également d’une affaire de perception ? Et, dans l’affirmative, en quoi est-elle spécifiquement française ?
Le fondateur de Price Minister par exemple, initialement plutôt favorable à un rachat français, a finalement vendu son entreprise au géant du e-commerce japonais Rakuten pour 200 millions de dollars. Il explique que, si des acteurs français ont manifesté leur intérêt, ils proposaient des montants 4 à 5 fois inférieurs à ce que proposait Rakuten. Certaines entreprises françaises, conscientes de cet écart, estiment que les montants mis sur la table par certains acteurs étrangers ne sont pas justifiés et relèvent de la pure spéculation. À l’inverse, des entreprises américaines interrogées considèrent que les grandes entreprises françaises sous-valorisent le gain potentiel représenté par les solutions des start-up et ne sont simplement pas prêtes à prendre de tels risques.
On l’a dit : l’intégration est un exercice complexe sur lequel il convient de mobiliser des moyens importants. La demi-mesure, consistant à suivre de loin quelques pépites en espérant qu’elles apportent d’elles-mêmes de la valeur à l’entreprise, ne peut pas fonctionner. Ce qui est donc reproché aux grands acteurs français, c’est un attachement excessif à une démarche gestionnaire poursuivant une croissance stable, au détriment d’un esprit entrepreneurial visant la transformation.
Dans le cas des partenariats, certaines start-up reprochent en outre aux grandes entreprises françaises de ne pas leur faire confiance assez rapidement, enchaînant les prises de participations ultra-minoritaires, les proof of concept (prototype rapide permettant de démontrer la faisabilité d’une solution) et les mini-contrats qui tardent à monter en cadence. Ces collaborations à faible échelle n’offrent pas aux start-up l’accès aux montants dont elles ont besoin pour développer leur technologie. Des engagements sur des contrats significatifs contribueraient plus nettement à leur croissance et des avances – plutôt que des retards de paiement – les aideraient à honorer ces gros contrats. Tout, dans le business d’une start-up, est une affaire de pari : ses financements bien entendu mais également ses partenariats. Ses clients doivent prendre le risque d’une commande incertaine dans des volumes importants tandis que ses partenaires et fournisseurs doivent faire des efforts sur leurs prix et leurs conditions, dans l’espoir de devenir par la suite un partenaire privilégié de la start-up si elle parvient à grandir.
Pour finir, un autre reproche adressé à certaines grandes entreprises françaises est le manque de clarté quant à leurs motivations dans l’hypothèse d’une acquisition : achètent-ils la start-up pour sa technologie, pour son marché ou pour son équipe ? Dans quel produit souhaitent-ils l’intégrer ? Cette incertitude conduit à des difficultés pour valoriser l’apport de la start-up et pour justifier les ressources importantes à investir dans le succès de cette acquisition. Apple et Microsoft sont des exemples d’entreprises ayant des logiques d’intégration particulièrement claires : ils recherchent uniquement des briques technologiques à intégrer dans la feuille de route de l’un de leurs produits, pour leur faire gagner du temps.
Après plusieurs discussions avec des acteurs internationaux, il semble que les grandes entreprises, toutes nationalités confondues, s’enhardissent d’autant plus qu’elles ressentent directement la concurrence des nouveaux acteurs technologiques sur leurs marchés traditionnels. Cette compétition faisant ressortir leurs vulnérabilités, ces géants historiques cessent de se considérer comme intouchables et voient soudain la nécessité d’investir dans l’innovation de rupture plutôt que de consolider indéfiniment leurs points de marge. En atteste par exemple l’adaptation rapide de certaines entreprises du numérique ou de la biopharmacie, aujourd’hui très actives en matière de rachat de start-up. Ces signaux encourageants montrent que la transformation est possible : si l’intégration de start-up devient une priorité pour le groupe et qu’il restructure une partie de son activité autour de cette pratique, la plupart des barrières structurelles et culturelles peuvent être levées.
Si l’on privilégie cette explication, le « retard culturel » de la France et de l’Europe ne serait autre que la conséquence du faible nombre de grands acteurs technologiques. La vague de nouvelles start-up françaises en train d’émerger pourrait changer la donne et déclencher davantage d’acquisitions par les grandes entreprises dans les prochaines années.
L’innovation « ouverte » dans les grandes entreprises
Les modes de collaboration avec les start-up ne se limitent pas au rachat ni au corporate venture capital. En interne, de nombreuses entreprises proposent des incubateurs pour accompagner tôt la start-up dans l’élaboration d’un cas d’usage. Les entreprises nouent également des partenariats externes avec des fonds ou des structures d’accélération.
Les schémas de collaboration privilégiés varient d’une entreprise à l’autre. Valeo par exemple prend des participations minoritaires pour maintenir une relation privilégiée avec certaines pépites tout en leur laissant une forte autonomie. En fonction de l’évolution de la relation, l’équipementier monte plus ou moins significativement au capital jusqu’à en prendre parfois le contrôle comme dans le cas de la start-up allemande Gestigon, spécialisée dans les logiciels de traitement d’images en 3D de l’habitacle. A contrario, elle laisse ses parts à d’autres acteurs si les intérêts stratégiques commencent à diverger, comme dans le cas de la start-up française Aledia, spécialisée dans les LED, qui a trouvé un marché plus rentable dans le domaine des écrans. D’autres acteurs comme Thales préfèrent construire des relations de partenariats plutôt que d’entrer au capital des start-up. À l’opposé, des acteurs comme Dassault Systèmes préfèrent procéder directement par acquisition et par intégration des technologies. La plupart des entreprises qui expérimentent ces pratiques de collaboration avec des start-up possèdent néanmoins de nombreuses, trop nombreuses, structures. Dans certaines entreprises du CAC40, on peut recenser plus de 60 entités revendiquant faire des collaborations d’open innovation avec les start-up.
Les organisations se transforment également pour accueillir au mieux les jeunes start-up acquises. Ainsi L’Oréal, très actif dans le rachat de jeunes marques, a nommé en 2019 un Chief Integration Officer qui s’occupe d’intégrer non seulement les nouvelles marques mais aussi de jeunes start-up technologiques. Engie a également créé cette fonction tandis que Dassault Systèmes l’a intégrée depuis plus de 10 ans dans un département corporate development.
Accor 2.0 : se transformer pour survivre
L’exemple d’Accor nous enseigne que le bouleversement des marchés traditionnels par de jeunes acteurs du numérique peut accélérer la transformation des grandes entreprises. Pendant une cinquantaine d’années et jusqu’au début des années 2000, Accor génère du profit en louant des chambres d’hôtel et en gérant un parc foncier ; l’arrivée de start-up sur ses métiers va l’obliger à se transformer.
Étape 1 : Booking renverse le pouvoir de force
Vers 2002, Booking commence à démarcher les acteurs de l’hôtellerie, dont Accor, pour leur proposer de référencer leurs offres de chambres non louées. Cette proposition est un deal « gagnant-gagnant » : les clients traditionnels continuent de réserver tandis que Booking peut espérer toucher une commission sur les invendus, rapportant par la même occasion des gains additionnels à Accor. Cependant, la nouvelle plateforme qui permet aux clients de visualiser et de comparer l’intégralité des offres d’hôtel en ligne sans frais additionnel devient rapidement incontournable. Le pouvoir de négociation change de camp et oblige Accor et les autres hôteliers à se plier aux règles de Booking pour rester visibles sur la plateforme, abandonnant ainsi une partie de leurs marges.
Étape 2 : Airbnb fragilise le marché de l’ hôtellerie
Quelques années plus tard, un nouvel acteur, Airbnb, propose aux particuliers de louer leur domicile en s’intercalant comme intermédiaire de confiance. Pendant plusieurs années, les grands groupes hôteliers ne voient pas le danger venir et ne répertorient même pas Airbnb comme concurrent. Cependant, en 2015, face au développement de la jeune pousse qui offre désormais une alternative d’hébergement crédible à des tarifs plus attractifs, le marché de l’hôtellerie chute. Accor perd alors des parts de marché sur son cœur de métier. En parallèle, l’entreprise doit également faire face à la montée d’un autre acteur, Wework, qui vient le concurrencer sur le foncier et sur le segment des voyages d’affaires en proposant des espaces de réunions flexibles.
Étape 3 : faire de ces nouveaux concurrents des alliés
Le CEO d’Accor, Sébastien Bazin, décide de modifier radicalement l’approche de son groupe concernant l’innovation. En 2016, il nomme à son comité exécutif l’entrepreneur Thibault Viort, dont il vient d’acquérir la start-up, en tant que Chief disruption and growth officer et le charge de trouver de nouveaux business complémentaires pour Accor. Thibault Viort commence à nouer des partenariats et à acquérir de nombreuses start-up dans un portefeuille centré autour de trois grandes thématiques : la distribution, la tech et les services premiums.
Dans la partie tech, il s’intéresse notamment à la digitalisation du groupe et opère des acquisitions dans le but de consolider l’acteur technologique D-Edge et d’en faire l’acteur de référence dans le domaine du logiciel pour l’hôtellerie. Les résultats de cette initiative sont positifs avec une activité qui génère du profit, permet de rationaliser les coûts et modernise la structure Accor. On voit ainsi apparaître l’un des rôles que peuvent jouer les grands groupes dans la création de champions technologiques : la consolidation de jeunes start-up en faisant office de plateforme.
Quatre ans après, le bilan de cette expérience est encourageant, bien que la crise sanitaire ait freiné ces nouvelles logiques d’exploration. Tout comme pour les fonds d’investissements, les hauts niveaux de risque de cette activité impliquent de suivre une logique de portefeuille. Il faut acquérir un volume suffisant pour se diversifier et apprendre. Certaines activités se sont arrêtées ou ont été revendues tandis que d’autres commencent à rapporter de l’EBITDA ; en valeur portefeuille, c’est-à-dire en cumulant les coûts et gains cumulés de toutes ces collaborations, l’activité est dans le vert. En outre, elle a permis de moderniser le groupe et de le rendre attractif pour les jeunes talents, qui cherchent à travailler dans ce type d’environnement dynamique.
- 21 – Données reprises du rapport de Philippe Tibi, Financer la quatrième révolution industrielle, 2019, citant lui- même : S&P Dow Jones Indices, au 31 janvier 2019. Le chiffre inclut la part des secteurs GICS « Information Technology » et « Communication Services ».
Les rachats étrangers alimentent l’écosystème
La présence d’acquéreurs étrangers est aujourd’hui une nécessité pour les start-up qui ne trouvent pas de voies de sorties en France. La bonne nouvelle, c’est que ces rachats représentent aussi une opportunité de développement pour l’écosystème dans son ensemble.
L’accélération du développement de la start-up
Il peut certes arriver que le rachat d’une start-up soit motivé par la volonté de tuer dans l’œuf un jeune concurrent. Ce comportement prédateur a notamment été observé par Cunningham et al. (2019) dans le secteur pharmaceutique aux États-Unis, où certaines entreprises achètent des biotechs développant des molécules concurrentes afin de les détruire, ce qui leur revient moins cher que de les exploiter. Ils estiment le taux de rachats « prédateurs » à 6,4 %.
Néanmoins, la tendance inverse est de loin la plus fréquente : l’entreprise acquéreuse est habituellement soucieuse d’investir dans la jeune pousse et d’accélérer son développement. Parmi les start-up interrogées dans le cadre de la préparation de cet ouvrage, les deux tiers considèrent qu’elles n’auraient pas pu arriver à un tel niveau de croissance sans acquisition. Le tiers restant se partage à parité entre celles qui considèrent que leur taux de croissance est conforme à ce qu’elles auraient pu atteindre seules et celles qui estiment que l’acquisition a diminué la croissance de leur activité, cela étant dû davantage à la maladresse de l’acquéreur qu’à une volonté de laisser mourir l’activité. Aucune ne fait part d’un comportement délibérément prédateur.
Un exemple marquant récent est celui de la start-up en cybersécurité Sentryo, acquise par le géant américain des réseaux Cisco, qui a pu conserver son autonomie de marque. En un an seulement, le rachat a permis de doubler les effectifs d’ingénieurs de la start-up en France, de recruter des forces commerciales, d’améliorer la qualité de la solution et de la déployer dans le monde entier en profitant des technologies et des réseaux de distribution de l’acquéreur.
Ces résultats sont en accord avec la littérature concernant le rachat des PME, synthétisée par Gazaniol (2014). Les rachats de PME, même par des entreprises étrangères, seraient bons pour la productivité de la petite entreprise (Bertrand et Zitouna (2008), Fontagné et Toubal (2010)). Le rachat étranger serait également bénéfique pour sa capacité à innover (Bertrand (2009), Bandick, Görck et Karpaty (2014) sur un cas suédois).
Concernant les start-up proprement dites, une étude de la DG Trésor de 202122 compare leurs performances après rachat avec celles de jeunes pousses ayant continué à se développer seules. Si le rachat d’une start-up n’a pas d’impact sur son niveau d’effort en R&D (ratio des dépenses sur les effectifs), il augmente significativement ses performances économiques (chiffre d’affaires et exportations) ainsi que ses effectifs. Le risque de prédation est estimé entre 1 % et 5 %.
Ce développement commercial de la start-up suite à son rachat provient du fait que celle-ci n’a plus besoin de se concentrer à tout prix sur sa croissance, du fait du désengagement de ses investisseurs en capital-risque. Ainsi libérée, elle peut désormais s’appuyer sur les ressources financières et humaines de la grande entreprise acquéreuse, ainsi que sur sa notoriété et son savoir-faire, afin de rendre sa solution robuste pour générer de la rentabilité.
Felix Malfait, fondateur de Luckey Homes, explique que le passage à l’échelle (scaling) de son entreprise n’aurait pas été possible sans son rachat par Airbnb. La plateforme lui a mis à disposition des compétences clés – qui lui manquaient sur le marché français – comme des ingénieurs talentueux ayant de l’expérience avec les start-up ainsi que des designers. L’entrepreneur insiste sur ce savoir-faire précieux qu’ont les grands acteurs technologiques américains, et qui fait défaut en Europe, à faire passer à l’échelle des projets numériques. Il affirme que ses équipes apprennent énormément au contact d’entrepreneurs et de développeurs bien plus expérimentés. En plus de permettre à Luckey de passer la crise sans encombres dans un secteur particulièrement touché, le rachat par Airbnb a permis à la pépite de monter de deux crans en matière d’ambitions et de perspective de croissance. Félix Malfait soutient qu’aucun des acteurs français avec lesquels Luckey collaborait n’aurait pu lui apporter un tel soutien.
De façon générale, les entrepreneurs interrogés demeurent très attachés à leur projet et estiment qu’ils n’auraient pas accepté la proposition d’un acquéreur si celle-ci n’avait pas été bonne pour le développement de la jeune pousse. Certains fondateurs ont d’ailleurs privilégié des offres moins attractives financièrement mais plus convaincantes et respectueuses du projet initial de la start-up.
Paradoxalement, si l’acquisition est généralement bénéfique pour la croissance de la start-up à court terme, le constat est plus difficile à dresser du point de vue de l’acquéreur. La plupart des acquéreurs, même très expérimentés, reconnaissent qu’une acquisition sur deux présente le risque de ne pas leur apporter de réels profits. Mieux vaut donc opter pour un portefeuille équilibré d’acquisitions plutôt que de tout miser sur une ou deux pépites.
Le maintien et la création d’emplois
Le rachat par une entreprise étrangère est donc favorable au développement économique de la start-up. En revanche, il n’est réellement bénéfique à l’économie française que si l’activité et les emplois ne sont pas délocalisés. Or, contrairement à ce que l’on peut parfois entendre, les cas de délocalisation de start-up sont peu nombreux. La R&D qui représente souvent le cœur de la valeur de la jeune pousse reste presque systématiquement en France. Parmi les start-up étudiées pour la préparation de cet ouvrage, seules deux ont été délocalisées : une dans le secteur des biotechs, l’autre dans le secteur du numérique en raison de la très petite taille de l’entreprise.
D’une part, à partir d’une certaine taille critique, il devient trop coûteux et trop risqué de délocaliser une start-up : le capital humain et son savoir-faire sont les biens les plus précieux d’une jeune pousse et l’acquéreur ne peut risquer de les perdre dans l’opération. Il y a dix ans encore, les start-up françaises peinaient à trouver les financements leur permettant d’atteindre cette taille critique, mais ce n’est maintenant plus le cas. D’autre part, conserver l’activité en France permet également d’attirer de nouveaux talents dans une région où les ingénieurs sont très qualifiés et peu chers grâce au crédit impôt recherche (CIR). Toujours parmi les start-up interrogées en vue de cet ouvrage, les trois quarts ont vu augmenter leurs effectifs en France, tandis qu’ils sont restés stables pour la majorité du quart restant.
Par exemple, la start-up Logmatic qui employait 10 personnes lors de son rachat en 2017 par Datadog compte, quatre ans plus tard, 400 employés dans un bureau qui est resté à Paris. Son fondateur estime que, grâce au rachat, la valorisation de la pépite est maintenant comparable voire supérieure à celle des meilleures pépites françaises qui ont continué à se développer seules.
Enfin rappelons que même lorsque peu d’emplois sont créés, le rachat a également pour vertu de pérenniser les emplois existants, la start-up indépendante ayant un avenir bien plus incertain en raison de ses contraintes financières
Ce n’est donc pas sur l’emploi à court terme que le rachat des start-up peut constituer une menace, bien au contraire. Toutefois, il faut avoir conscience que cela amorce un transfert technologique au moins partiel vers l’acquéreur, qui semble difficile à protéger. La croissance est alors partiellement répercutée sur l’entreprise acquéreuse, conformément à son objectif. Ces acquisitions avec transfert sont celles qui offrent les plus-values à la vente les plus intéressantes. C’est le cas par exemple de Zenly, dont la fonctionnalité de géolocalisation offrait de bonnes synergies avec la carte de Snapchat, ou du calendrier Sunrise qui s’est vendu très jeune à Microsoft pour 100 millions de dollars avant d’être absorbé et de voir sa technologie diffusée dans le calendrier Outlook. En cas d’absorption complète de la pépite, les talents sont redéployés dans les équipes de l’acquéreur sur des projets connexes, généralement dans les bureaux locaux.
Figure 4.1 – Le cercle vertueux de l’exit
* Pourcentage de start-up interrogées après rachat pour lesquelles ce type de recyclage a eu lieu
Au moment d’un rachat, les anciens employés contribuent souvent au développement de nouvelles start-up.
En conclusion, loin des images d’Épinal d’une fuite des meilleurs talents et des retraites dorées des fondateurs, il s’avère après examen qu’une partie essentielle des ressources engagées dans les rachats de start-up bénéficient directement à l’écosystème local.
Le recyclage des talents
Il est fondamental de comprendre ce que deviennent les fondateurs une fois leur start-up acquise. Différents entretiens menés ainsi que plusieurs recherches annexes montrent que la grande majorité d’entre eux quittent leur entreprise 2 à 4 ans après le rachat. Cette période correspond à la durée d’une clause dite de earn out, pendant laquelle les fondateurs doivent rester dans leur start-up pour en accompagner l’intégration, sous peine de se voir privés d’une partie des gains de la vente.
Ces démissions sont principalement motivées par la différence culturelle entre la start-up et l’entreprise acquéreuse, entre l’esprit d’entrepreneuriat et le salariat ou par le refus d’avoir de nouveau un patron. Parmi les entrepreneurs interrogés, les deux tiers ont quitté l’entreprise dès qu’ils ont pu. Si l’on écarte également ceux qui, encore sous clause, ont manifesté le désir de partir dès que possible, il ne reste qu’un quart des fondateurs à être effectivement restés travailler au sein de la nouvelle entreprise. On pourrait penser que les grandes entreprises technologiques comme les GAFAM sont plus attractives mais, parmi les fondateurs des start-up françaises vendues à Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft et Twitter, on retrouve un résultat similaire : seulement 26 % de fondateurs sont restés travailler dans l’entreprise23.
Puisque la start-up reste généralement en France après le rachat, l’entrepreneur qui a lui-même souvent des attaches françaises va le plus souvent chercher à démarrer une nouvelle activité sur place, qu’il pourra financer en partie grâce à ses gains. De nombreux fondateurs de start-up ont exprimé un devoir d’aider et de soutenir un écosystème en croissance, à qui ils doivent d’avoir gagné beaucoup d’argent. Un sentiment de communauté semble peu à peu se consolider parmi ces entrepreneurs aguerris, dont l’argent et l’expérience sont très précieux aux nouvelles start-up françaises.
Un coup de pouce fiscal à l’émergence de nouveaux business angels
La plus-value réalisée lors de la revente est imposée autour de 34 %. Pour les fondateurs et les premiers acquéreurs, cette plus-value est proche du prix de cession puisque l’acquisition initiale des titres s’est faite à un prix quasi-nul. Cela étant, l’article 150-0 B Ter du Code général des impôts permet de réduire cette taxation à condition d’investir plus de 60 % des gains dans des entreprises françaises similaires. Les anciens propriétaires de start-up sont ainsi encouragés à se convertir en business angels et à soutenir à leur tour de jeunes start-up peu développées. Parmi les vingt-huit entrepreneurs interrogés pour préparer cet ouvrage, tous se sont activement engagés dans le financement de jeunes start-up françaises, allant parfois jusqu’à la création de structures d’investissement complexes qui mobilisent plusieurs dizaines d’employés.
La moitié des fondateurs interrogés ont décidé de se relancer dans une aventure entrepreneuriale en France. Certains sont devenus des serial entrepreneurs à l’instar de Bruno Maisonnier qui a participé à la création de 17 start-up en France, dont AnotherBrain, une start-up d’intelligence artificielle figurant au prestigieux classement français FT120 de la French Tech en 2019. D’autres choisissent l’investissement ou le conseil, tels Hugues Le Bret qui s’est focalisé sur l’accompagnement de fintechs françaises après la vente de Compte Nickel, ou Sébastien Lefebvre qui a rejoint le fonds français Elaia spécialisé en deeptech.
De manière similaire, 64 % des fondateurs des entreprises rachetées par les GAFAM se sont reconvertis dans une activité favorisant le développement de l’écosystème français. La plupart des entrepreneurs et investisseurs interrogés considèrent ce mécanisme de « recyclage » des capitaux et des talents comme le principal moteur qui permet à l’écosystème de se structurer.
L’« Exalead Mafia », exemple français de recyclage des talents et des capitaux
L’épanouissement de l’écosystème entrepreneurial de la Silicon Valley est en partie le fruit de la « PayPal mafia »24. Ce terme désigne les anciens employés de PayPal qui ont essaimé des centaines de start-up, en tant que fondateurs ou financiers. Facebook, LinkedIn ou Palantir sont nés de ce réseau, dont Elon Musk est un acteur notable, ou ont pu grandir grâce à lui.
En France, les anciens d’Exalead jouent un rôle similaire. À eux seuls, ils ont amorcé plus de 30 start-up dont la valorisation combinée est de plusieurs milliards d’euros.
L’histoire commence avec François Bourdoncle, chercheur en informatique aux mines de Paris. Après un post-doc dans la Silicon Valley, il collabore avec Altavista sur des technologies de moteur de recherche, puis développe une technologie de moteur de recherche sémantique qu’il rachète pour fonder Exalead en 2000 avec Patrice Bertin. En utilisant les meilleures pratiques de code apprises et développées à Palo Alto, Exalead se hisse au rang des start-up françaises les plus prometteuses. Elle est vendue à Dassault Systèmes en 2010 pour 135 millions d’euros. François Bourdoncle y reste quatre ans avant de monter son cabinet de conseil tout en devenant business angel pour de nombreuses start-up.
Au même moment, d’anciens employés d’Exalead créent leurs propres start-up. Clément Stenac et Florian Douetteau lancent au début de l’année 2013 Dataiku, une plateforme de machine learning à destination des entreprises, aujourd’hui évaluée à plus d’un milliard d’euros. Julien Lemoine et Nicolas Dessaigne quittent Exalead en 2012 pour lancer Algolia, qui développe des technologies de moteur de recherche. Etienne Albert, François Lagunas et Nicolas Steegmann créent Stupeflix en 2009, une start-up de création automatique de vidéos, rachetée en 2016 par GoPro pour 105 millions de dollars, etc. Au total, nous avons recensé 17 start-up « filles » d’Exalead qui ne comptait pourtant que 150 employés au moment de son rachat par Dassault Systèmes. Elles affichent qui plus est un excellent taux de réussite – à mi-2021, seules cinq d’entre elles ont fait faillite. Les plus belles réussites, comme Algolia, Dataiku, Stupeflix ou encore Leetchi, ont même continué cet essaimage et ont engendré à leur tour de nombreuses start-up (17 au total). Stupeflix en particulier, depuis son rachat par GoPro, a engendré pas moins de 8 start-up. La plus prometteuse, HuggingFace, un leader mondial de la reconnaissance de langages naturels (NLP), est déjà évaluée à plus de 100 millions de dollars. Nous avons identifié trois raisons à la quantité et la qualité des start-up issues de Exalead : la culture Exalead, le choc chez Dassault Systèmes et la force du réseau.
L’école Exalead
Si les anciens d’Exalead ont eu tant de succès dans leurs aventures entrepreneuriales, c’est en partie grâce à leur expérience chez Exalead. Faisant le constat du manque d’ingénieurs très compétents en programmation, François Bourdoncle recrutait majoritairement des profils jeunes, sortis d’école, afin de les former en interne. Les premiers employés étaient souvent des doctorants qui effectuaient leur thèse au sein de la start-up. Cette stratégie a permis d’avoir une équipe qui codait de manière radicalement différente du reste de l’industrie, en utilisant les standards développés lors de son post-doc à Palo Alto. Cette formation a offert un avantage compétitif aux ingénieurs d’Exalead pour leurs futurs postes ou start-up.
Les anciens ont aussi pu observer les erreurs commises par Exalead, pour ne pas les reproduire. Notamment, François Bourdoncle expliquait qu’Exalead n’avait pas réussi à pénétrer le marché américain parce qu’il s’y était attaqué trop tard. Pour éviter de tomber dans cet écueil et pouvoir profiter du marché et des investisseurs américains, certaines des start-up issues de Exalead (Algolia, Dataiku…) ont installé leur siège social aux États-Unis mais conservé leur centre de R&D en France, pour attirer les investisseurs américains, tout en gardant la majorité de leur activité en France.
Le choc Dassault Systèmes
Si l’expérience Exalead explique la réussite de sa progéniture, le volume de création de start-up, notamment après 2010, s’explique par le rachat par Dassault Systèmes. Souvent, l’intégration d’une start-up dans une plus grande structure, plus établie et pérenne, est un choc pour ses employés. Le rachat est souvent synonyme de perte d’indépendance, avec l’intégration à une business unit établie. Chez Dassault Systèmes, Exalead est passé d’une logique d’exploration à une logique d’exploitation, incompatible avec des esprits libres entrepreneurs. Ceci a mené beaucoup des premiers employés d’Exalead à quitter l’entreprise pour tenter l’expérience entrepreneuriale.
Une partie de la rémunération des employés de start-up prend souvent la forme de parts au capital. Lors d’une opération de rachat réussie, les salariés, surtout les plus anciens, font une plus-value importante. Cet argent a permis aux ex-employés de financer le début de leur aventure, à l’instar de Dataiku qui n’a pas eu besoin de lever d’argent durant ses deux premières années d’existence.
Le réseau d’anciens
Enfin, la troisième force des anciens d’Exalead, c’est de faire partie du même réseau. Plus de dix ans après le rachat par Dassault Systèmes, ils restent soudés et proches. Beaucoup se sont associés, par deux ou trois, pour monter leurs projets. Si aujourd’hui chaque start-up s’est épanouie dans un domaine différent, les briques technologiques de base proviennent de leur travail chez Exalead.
Le premier avantage de cette proximité est la circulation des talents. Il n’est pas rare pour des employés d’une start-up d’aller travailler dans une autre, ce qui permet le partage de compétences entre start-up d’une même génération, mais aussi entre celles d’une génération à la suivante. Ainsi, Patrice Bertin, fondateur d’Exalead, est maintenant vice-président architecture chez Dataiku. François Lagunas, l’un des premiers employés Exalead, fondateur de Stupeflix, est lui ingénieur en machine learning chez HuggingFace.
Le second avantage de cette proximité est le financement croisé. En plus de la possibilité d’autofinancement, il est fréquent dans les familles d’entrepreneurs, comme pour les anciens de PayPal, d’utiliser leur plus-value liée à la revente pour financer les start-up de leurs amis (on parle de Love Money). Ainsi, les premiers tours de tables de financement se font sans besoin d’investisseurs externes, donnant plus d’autonomie aux fondateurs.
Si certaines de ces raisons sont propres à Exalead, le phénomène de « mafia » dans les start-up est fréquent. L’expérience d’une start-up réussie met en confiance ses anciens employés, qui une fois confrontés au salariat dans une entreprise classique, préfèrent utiliser leur réseau et leur plus-value pour monter leur propre jeune pousse.
Figure 4.2 – La famille Exalead
Les anciens employés d’Exalead et de ses descendants ont fondé plus de 30 start-up.
La formation des entrepreneurs à « l’école américaine »
La plupart des entrepreneurs connaissant bien les écosystèmes français et américain sont stupéfaits par les progrès accomplis en France ces dernières années. Ils constatent cependant toujours un écart de maturité : certaines fonctions clés comme Product Manager, Sales Manager, CEO ou encore Designer UI/UX ne sont pas encore assez répandues ni même comprises en France. La création de start-up commence certes à se standardiser mais il manque encore les savoir-faire pour les faire grossir.
Pour ce faire, une solution consiste à aller s’inspirer des méthodes américaines pour « gagner du temps ». Cette pratique est toutefois encore mal considérée en France, alors qu’elle est très répandue et acceptée en Chine ou en Israël, avec des résultats concluants. Ici, nous entendons plus fréquemment un discours critique envers les entrepreneurs qui décident de quitter la France : manque de patriotisme, perte d’un brillant cerveau formé aux frais de la France… Si ces risques sont pour partie réels, on peut aussi les considérer comme un prix nécessaire à payer pour former rapidement de nouveaux talents en matière d’entrepreneuriat et de nouvelles technologies. Car les talents qui reviennent et ceux qui restent contribuent significativement au développement de l’écosystème français, apportant des savoir-faire nouveaux et nécessaires. En cherchant à trop contraindre les départs, on risquerait au contraire de ne garder que des talents frustrés et inefficaces.
D’un côté, certains Français partis se former ou travailler aux États-Unis finissent par revenir. Ces flux de retour, encore très rares il y a quelques années, concernent notamment des jeunes très diplômés qui n’ont pas construit de famille sur place et qui ont gardé de nombreuses attaches en France25. De l’autre, ceux qui s’installent à l’étranger deviennent des « ancres », permettant de transférer le savoir-faire local aux générations suivantes, qui viennent quelques années en stage ou travailler sous visa temporaire. De sorte qu’il existe aujourd’hui en Silicon Valley une véritable communauté de Français, extrêmement soudée et solidaire, qui participe à la formation des entrepreneurs et à la dynamisation de l’écosystème français.
Flux d’expérience chez Farmwise, une start-up de Français en Silicon Valley
Dédiée au développement de robots autonomes pour l’agriculture, la start-up Farmwise a été créée en 2016 par Sébastien Boyer et Thomas Palomares, deux jeunes polytechniciens ayant complété leur formation aux États-Unis. Soucieux de comprendre les rouages de l’entrepreneuriat dans un écosystème mûr, ils choisissent de lancer leur start-up à San Francisco dès leur sortie d’école. Leurs deux premiers employés sont un ancien camarade d’école français, Arthur, qui s’occupe de la partie logicielle, et un Américain, Eric, avec qui ils avaient sympathisé dans leur incubateur en raison de ses fortes attaches françaises. Ils ont ensuite été rejoints par un Français expatrié, Michael (arrivé aux États-Unis après la revente de sa propre start-up à un acteur américain, Michael a fini à la tête de la partie hardware et architecture de ce dernier avant de rejoindre Farmwise). Le reste de l’équipe recrutée par la suite est principalement composée d’Américains ainsi que de deux autres Français. La jeune pousse américaine a en outre recruté trois stagiaires français, qui ont passé plusieurs mois à San Francisco et y ont beaucoup appris. L’un d’eux est rentré en France pour créer son entreprise avant de rejoindre une autre start-up française, tandis qu’un autre met à profit son expérience afin d’aider l’État à mieux cerner les enjeux liés aux start-up.
Fin 2020, deux des employés clés français, Arthur et Marie, ont décidé de rentrer en France. Arthur a rejoint la start-up française InstaDeep qui l’a recruté pour ses compétences en intelligence artificielle. Le départ de Marie fut quant à lui le déclencheur d’un projet que les deux cofondateurs mûrissaient depuis quelque temps, celui de lancer un bureau de R&D en France. Marie travaille donc maintenant pour Farmwise depuis la France dans le nouveau centre de R&D de la pépite, dirigeant une équipe grandissante qui comptait trois employés début 2021. Sébastien est quant à lui très investi pour transmettre son expérience aux jeunes entrepreneurs français et exerce une activité de mentorat dans plusieurs jeunes pépites françaises.
L’exemple de Farmwise (voir encadré) illustre cette dynamique bénéfique qui opère entre différents écosystèmes. Certains entrepreneurs français souhaiteraient d’ailleurs créer des schémas vertueux similaires entre la France et le marché chinois par exemple. C’est avec cet objectif en tête que l’un des fondateurs d’Ilog, Marc Fourrier, a financé quelques jeunes entrepreneurs afin qu’ils montent leur entreprise en Chine et qu’ils reviennent après s’être développés sur ce marché clé ou qu’ils favorisent la venue d’autres acteurs français26.
Bien sûr, l’intensification de ces flux vaut dans les deux sens. Comme mentionné précédemment, deux jeunes pépites françaises Alsid et Sqreen ont été rachetées en 2021, à une semaine d’intervalle, par deux acteurs américains : Tenable et Datadog. Or ces deux entreprises acquéreuses ont un point commun : elles comptent au moins un fondateur français. Renaud Deraison est co-fondateur et CTO de Tenable, une entreprise née d’un logiciel open source qu’il a commencé à développer alors qu’il était encore au lycée. Quant à Datadog, elle a été créée à New York par deux diplômés de l’école Centrale à la sortie de leurs études. Bien conscients de la qualité des ingénieurs français et de leur coût relativement faible, ressentant en outre une proximité culturelle évidente, ils ont réalisé en même temps ces deux importantes acquisitions, Logmatic et Sqreen.
Mais, en réalité, il est important de garder en tête que les start-up prometteuses ont très tôt une portée internationale très marquée27. Étroitement lié aux technologies numériques, leur marché est rapidement mondial et la plupart ne craignent pas d’ouvrir très tôt des antennes et bureaux dans différents pays. Le caractère national de la jeune pousse s’efface peu à peu au sein de l’entreprise, rendant assez floue la distinction entre la France et le reste du monde. Si certains entrepreneurs gardent un sentiment patriotique fort, d’autres se revendiquent citoyens du monde et considèrent que « la question de pays d’appartenance n’est pas vraiment pertinente », selon un entrepreneur souhaitant rester anonyme.
Un nouveau modèle hybride est d’ailleurs en train d’être adopté par quelques start-up françaises, consistant à implanter le siège de l’entreprise aux États-Unis afin de capter les fonds et le marché au plus tôt tout en conservant l’intégralité de la R&D en France (c’est le choix fait par Dataiku et Algolia). De même, Thibaud Elzière de Fotolia a mis en place la start-up studio EFounders, spécialisée dans la création en série de start-up Saas (Software as a Service), sur la base de ce modèle hybride. Les résultats des trente entreprises créées sont remarquables et ouvrent la voie vers un modèle dans lequel la start-up possède dès son fondement plusieurs nationalités et partage la valeur qu’elle crée entre ses différents pays.
- 22 – Prise de contrôle dans les start-up françaises : prédation ou développement, DG Trésor, février 2021.
- 23 – La liste des acquisitions se trouve sur les pages Wikipédia des entreprises citées. Les noms et nouveaux emplois des fondateurs des start-up rachetées ont été récupérés manuellement sur LinkedIn.
- 24 – L’expression vient du magazine Fortune, montrant une photo des anciens employés de PayPal habillés en gangsters.
- 25 – Discussion avec des Français de la Silicon Valley, des ambassadeurs de la French Tech.
- 26 – Compte-rendu de la conférence « Ilog, leçons d’un parcours » à L’École de Paris du Management, séance du 25 novembre 2009.
- 27 – Les start-up réalisent 61 % de leur chiffre d’affaires hors de France selon la 8e édition (2019) du baromètre de la performance économique et sociale des start-up numériques en France réalisé par EY.
Les leviers d’action de la puissance publique
Pour conserver nos plus belles jeunes pousses, il est essentiel de faire émerger un marché français des start-up. Si l’offre est maintenant présente, ce n’est pas le cas de la demande : une demande portée par des entreprises technologiques, indépendantes et rentables, qui pourront agir comme consolidateurs. Pour favoriser leur émergence, l’État dispose de nombreux leviers d’action dont l’utilisation actuelle n’est pas en adéquation avec les besoins des start-up. Plutôt que de concentrer son action sur une stratégie défensive, l’état aurait au contraire tout intérêt à activer des leviers d’action offensifs.
Les limites du blocage défensif
Un premier levier permettant de conserver nos start-up sur le territoire français consiste à empêcher les acteurs étrangers de les racheter, afin de les laisser prospérer. Néanmoins, cette approche peut s’avérer dévastatrice lorsqu’elle est utilisée à des fins protectionnistes, sans distinction entre les intérêts stratégiques et les intérêts économiques de la nation, qui n’obéissent pas du tout aux mêmes raisonnements. Depuis le décret signé par Arnaud Montebourg en 201428, toute prise de participation dans une entreprise française appartenant à un secteur jugé stratégique doit être autorisée par les autorités publiques. Le périmètre des technologies concernées a été étendu en 2018 pour aboutir à une liste, vaste et vague, de secteurs incluant notamment la cybersécurité, l’intelligence artificielle, la robotique et les biotechnologies. Beaucoup de start-up sont donc soumises à ce décret et peuvent se voir refuser un rachat par un acteur étranger.
Une protection efficace pour quelques actifs cibles
Dans certains cas touchant réellement aux intérêts stratégiques, comme dans le domaine de la Défense, la nécessité d’obtenir une approbation de l’État avant toute acquisition est admise par tous les acteurs. C’est d’ailleurs une pratique largement diffusée, y compris aux États-Unis. Ce dispositif de contrôle des investissements étrangers en France permet à l’État de négocier en amont les termes du contrat de vente, afin par exemple de préserver certaines activités en France ou encore de limiter l’accès à certaines données sensibles. Lors de son rachat par Cisco, Sentryo est passé par ce dispositif qui a imposé quelques conditions au groupe américain. Celui-ci les a jugés raisonnables et le processus a été conclu très rapidement.
Ces conditions ne sont d’ailleurs pas uniquement valables au moment de l’acquisition. Une veille active en amont a beaucoup de valeur puisque de nombreux enjeux se jouent lors de la prise de participation minoritaire de certains investisseurs dans les premières phases de croissance de la start-up. La présence d’un investisseur d’une certaine nationalité tend naturellement à infléchir le centre de gravité de la start-up vers le pays associé (son réseau partenarial, son marché, ses clients). Dans des phases où les start-up ne sont pas encore dépendantes des financements étrangers, il peut être intéressant d’essayer de trouver des investissements français ou européens alternatifs.
Néanmoins, il est important de comprendre que ces schémas légitimes de protection ne concernent en réalité qu’une infime part de l’ensemble des jeunes pousses. La France, dont l’écosystème start-up est encore relativement immature, est très loin de pouvoir se permettre de protéger ses pépites au nom d’intérêts économiques. C’est notamment ce que nous enseigne l’affaire Dailymotion (voir encadré ci-après).
À ce sujet, la confusion est souvent faite au sein de l’administration ou dans la presse entre start-up et entreprise technologique. Ces dernières étant davantage concernées par la question des rachats sensibles. Cette distinction est importante car leurs enjeux de croissance et leurs chances de survie ne sont pas les mêmes. Ainsi par exemple, le récent blocage du rachat de Photonis par l’américain Teledyne, dans le cadre du contrôle des IEF, a fait beaucoup de bruit. Cette entreprise, qui produit une technologie de vision nocturne équipant les forces armées françaises, a été jugée critique et devait rester française au nom de la souveraineté industrielle du pays. Or Photonis a beau avoir été qualifiée de start-up à cette occasion, elle est née en 1937… Leader mondial dans son domaine, détenue par un fonds de capital-développement robuste, elle employait plus de 500 personnes, avait des contrats stratégiques de longue date avec plusieurs gros acteurs nationaux et générait plusieurs millions d’euros de chiffres d’affaires. Il était donc peu probable que l’entreprise fasse faillite en cas de blocage de la part de l’État.
Par comparaison, une start-up vit au jour le jour grâce au cash apporté par les investisseurs lors des levées de fonds successives : elle ne peut donc se permettre d’attendre un an avant de trouver de nouveaux capitaux. De plus, dans le cas d’une entreprise considérée comme très internationale, un blocage souverain envoie de mauvais signaux aux investisseurs et aux clients étrangers. Ainsi, toute intervention étatique induit un risque très sérieux de faire disparaître la jeune entreprise. Ce contrôle doit donc être utilisé avec un grand discernement.
Qui plus est, en raison de leur jeune âge, les start-up n’ont généralement pas eu le temps de créer des liens étroits avec des grands acteurs et ne peuvent donc pas être considérées comme des actifs dont la France serait économiquement dépendante. Mieux vaut donc voir une pépite partir prospérer ailleurs, en cédant ainsi à l’étranger une partie de la valeur qu’elle crée, que de la laisser mourir sans raison.
Un cas d’école : le blocage du rachat de Dailymotion par Yahoo
L’exemple de Dailymotion est emblématique des dangers que peut présenter le contrôle du rachat de start-up. Plateforme française d’hébergement vidéo, créée un mois seulement après Youtube en 2005, l’entreprise connaît un succès instantané et devient rapidement l’un des principaux acteurs du secteur. En 2008, la crise financière rend compliquée l’obtention de financement en France, tandis que le compétiteur américain commence à prendre de l’avance grâce à son rachat par Google fin 2006. L’État français entre alors au capital de la pépite en 2009 par le biais du fonds stratégique d’investissement (FSI), participant à une levée totale de 17 millions d’euros. Ce montant, très important pour une start-up française, reste malheureusement trop faible pour faire face à la concurrence ; il devient impératif pour Dailymotion de s’adosser à un partenaire industriel. Un acteur américain, Qualcomm, s’intéresse à la pépite mais le gouvernement Fillon souhaite qu’elle demeure française et s’efforce de trouver un autre repreneur. Le FSI est favorable à un rapprochement avec Orange. Le groupe français de télécommunications récupère donc 49 % du capital de Dailymotion en 2011, avec l’objectif d’en prendre le contrôle à terme. Orange absorbe ses pertes et lui fait profiter de son réseau et de son image de marque, mais n’investit pas dans la pépite et ne lui offre pas de synergies. Dailymotion ne disparaît pas mais stagne alors qu’elle a cruellement besoin de prendre de la vitesse. Les deux entreprises se mettent en quête d’un nouvel actionnaire qui pourrait aider la jeune pousse à prendre son envol.
Au même moment, Yahoo, à travers son nouveau chief operation officer Henrique de Castro, ancien responsable de Youtube pour Google, recherche activement un moyen de développer la stratégie vidéo de l’entreprise. Le mariage entre la jeune start-up et le géant semble clair et enthousiasmant : doper Dailymotion grâce aux moyens financiers de Yahoo pour venir concurrencer Google sur le secteur. Orange est d’autant plus enthousiaste à cette idée que Yahoo propose de valoriser la start-up à 300 millions de dollars. La start-up se voit promettre un soutien financier sans précédent et des synergies industrielles qui lui permettraient de réduire ses coûts de streaming à zéro (ces mêmes synergies qu’Orange a refusé de lui accorder), la rendant infiniment plus compétitive. Toute la procédure est organisée et la plupart des documents dont la term sheet sont rapidement signés.
Coup de théâtre ! L’État, représenté par Arnaud Montebourg, s’élève publiquement et au dernier moment contre cette affaire, au nom des intérêts économiques français. Pour le ministre du Redressement productif de l’époque, le géant américain ne fera que tuer la jeune pousse. Après avoir tenté d’imposer des conditions jugées inacceptables par Yahoo, l’État, présent au capital d’Orange à hauteur de 26 % et disposant d’un droit de blocage, annule ce rachat. Yahoo tourne définitivement le dos à la pépite. Dailymotion est donc absorbée à 100 % par Orange, qui n’investit pas davantage dans la start-up. Après un nouveau blocage en 2015 d’une offre de rachat par le hongkongais PCCW, la pépite exsangue passe des mains d’Orange à celles de Vivendi sans plus d’investissements. Les résultats commencent à chuter et les talents à partir comme l’un des fondateurs Olivier Poitrey qui rejoint Netflix en 2016. Dailymotion n’est plus aujourd’hui que l’ombre de ce qu’il a été.
Les répercussions de ce blocage ont été désastreuses sur de nombreux plans. Tout d’abord, il a privé la jeune pousse de capitaux et d’un appui industriel vitaux, qu’elle ne trouvait pas en France. La jeune pousse aurait en outre impulsé une dynamique positive en signant le plus bel exit jamais enregistré par une start-up française, même à ce jour. Par ailleurs, ce blocage a entraîné une perte de motivation des employés clés, dont la plupart a décidé de s’expatrier en Amérique du Nord : on n’a pas connaissance d’un tel taux de fuite de salariés vers les États-Unis dans une autre entreprise étudiée. Quelle ironie pour une entreprise que l’État a prétendu protéger ! Enfin, cette affaire a eu un impact médiatique extrêmement fort outre-Atlantique, véhiculant l’image d’une France avec laquelle il est impossible de faire des affaires. Dix ans après, des investisseurs américains justifient encore leur refus d’investir en France par l’affaire Dailymotion.
Le danger de la réciprocité
Enfin, des blocages jugés non justifiés peuvent exposer la France à des représailles de nature à empêcher nos jeunes pousses et nos grandes entreprises de prospérer sur la scène internationale.
Or, les entreprises françaises font la plupart de leurs acquisitions à l’étranger. L’Oréal par exemple acquiert une majorité de ses marques en dehors de la France. Le géant de la cosmétique a notamment racheté en 2014 la start-up israélienne Coloright qui a développé une technique de lecture optique de la fibre capillaire. Cette acquisition a permis à L’Oréal de mettre un pied dans l’écosystème israélien puisque le fondateur de Coloright s’occupe maintenant de la stratégie d’open innovation du groupe en Israël. Plus récemment, le groupe a acquis la start-up canadienne Modiface qui permet à un utilisateur de constater virtuellement l’effet qu’aurait du maquillage sur sa peau.
Les start-up françaises ont également besoin de faire des acquisitions à l’étranger pour se consolider, à l’image de la start-up medtech Bioserenity qui a récemment absorbé la jeune pousse américaine SleepMed afin d’accélérer son implantation sur le sol américain.
Les outils offensifs
Figure 5.1 – Les leviers d’action offensifs
Levier 1 : améliorer l’accès aux capitaux en late stage
L’écosystème français des start-up s’est progressivement structuré pour parvenir aujourd’hui à un niveau de financement décrit par la plupart des acteurs interrogés comme très satisfaisant sur la phase dite early stage. Le montant total des fonds levés par les entreprises de la French Tech a plus que triplé entre 2015 et 2020. Dans le même temps, le montant moyen des tours de financement en série A a augmenté considérablement, démontrant à la fois une disponibilité plus importante de liquidité pour ces investissements et une meilleure valorisation des start-up de l’écosystème français.
Cependant, le constat n’est pas aussi satisfaisant sur le late stage, vers lequel les capitaux sont encore très peu fléchés. Les investissements français se raréfient lorsqu’on approche des phases plus avancées, à partir de 20 millions d’euros, avec un manque encore plus marqué dans les levées à plus de 100 millions d’euros. Selon les entretiens que nous avons réalisés, de nombreuses jeunes pousses se vendent encore trop tôt, font entrer du capital étranger ou se vendent à l’international faute de capitaux disponibles ou par anticipation des manques à venir.
Cet état de fait est lié d’une part à la culture d’investissement en France : d’après le rapport Tibi (2019)29, 62 % de l’épargne française est concentrée sur l’épargne réglementée (livret A, assurance-vie) et les entreprises à forte composante technologique représentent 6,9 % des portefeuilles d’actifs assurantiels contre 19 % du MSCI World Index, un indice représentatif des ETI et grands groupes mondiaux. D’autre part, le montant global des liquidités est encore limité par comparaison avec les États-Unis. Ceci n’est pas une spécificité française mais un problème européen : l’Union européenne représente un quart du PIB mondial mais 10 % des levées de fonds des start-up (53 % pour les États-Unis et 27 % pour la Chine).
Pour remédier à ce défaut de capitaux, le rapport Tibi encourage la mise en place d’une dizaine de fonds à 1 milliard d’euros, pour financer des start-up de late stage.
Des politiques nationales et européennes de soutien à l’investissement
Au niveau national, la BPI cherche à combler en partie ce manque de financement privé. Omniprésente dans le financement en early stage, elle est en train de prendre une place de plus en plus importante dans le late stage, notamment à travers son fonds Large Venture qui propose des tickets à partir de 10 millions d’euros. Ce dispositif précieux permet de faire levier sur l’investissement privé. Le fonds a notamment joué un rôle important dans les deux dernières levées de fonds de Contentsquare30, dont la dernière, s’élevant à un demi-milliard de dollars (408 millions d’euros), représente la plus importante levée de fonds jamais réalisée par une pépite de la French Tech.
Outre ces actions de soutien nationales, des initiatives européennes sont portées aujourd’hui par deux entités : la Banque européenne d’investissement (BEI) et le Conseil européen de l’innovation (CEI). Dans le cadre du plan d’investissements pour l’Europe, ou « Plan Juncker », la BEI a investi 315 milliards d’euros depuis 2014. Ces capitaux ont été placés dans des fonds d’investissements late stage, ainsi qu’en investissement direct dans les start-up, sous forme de dette, avec des tickets minimums à 10 millions d’euros. Une prise de position de la BEI sur une start-up permet de réduire le risque de l’investissement et d’attirer d’autres acteurs financiers, notamment sur les secteurs de la biotech, la medtech et la fintech. Cette diminution du risque est également liée aux compétences des ingénieurs travaillant à la BEI, dans l’évaluation des technologies développées par les start-up. S’ajoute à cela, depuis 2012, le CEI qui investit directement au capital de start-up late stage, sur des dossiers instruits par la BEI. On observe également d’autres mesures notables, comme la coopération BPI-KfW qui permet des investissements croisés entre France et Allemagne dans des start-up, permettant de lever des fonds plus importants.
Levier 2 : construire un vrai marché européen
Un autre défi consiste à se doter d’un marché des start-up unifié en Europe, capable de rivaliser avec les grandes puissances américaines et asiatiques. Pour l’heure, il demeure fragmenté par diverses langues, cultures, règles juridiques et fiscales. Un des secteurs qui résiste le mieux à cette fragmentation est celui de la fintech qui bénéficie de l’homogénéité d’une partie des réglementations autour de la monnaie unique.
Un programme d’accompagnement des start-up souhaitant s’exporter en Europe, Europe Tech (similaire au rôle de la French Tech), pourrait être créé. Porté par la Commission européenne, il aurait la charge d’organiser des évènements et d’accompagner les entreprises dans leur expansion. Ce serait une opportunité de représenter l’écosystème européen à l’international et, par des remontées de terrain efficaces, de réduire les frictions réglementaires entre pays. Il serait un complément utile au programme « scale-up Europe » lancé par le gouvernement français qui ambitionne de créer 10 géants technologiques européens d’ici 2030. Ce programme porte 21 propositions dont la création d’un statut « tech worker » permettant de standardiser les contrats de travail ainsi que les droits sociaux31.
Levier 3 : favoriser l’émergence et la mobilité des talents
La France manque de certaines compétences propres au secteur numérique : développeur informatique, UX designer ou encore ingénieur en machine learning. Ce déficit de compétences concerne également des fonctions plus horizontales, comme celle du CEO qui doit savoir porter une vision en l’absence de tout actif tangible et apprendre à lever des fonds. D’autres fonctions comme la vente, le marketing ou l’ingénierie doivent également s’adapter aux méthodes de travail et à la rapidité d’exécution de la start-up.
Cette pénurie de talents est importante et se fait d’ailleurs ressentir également dans les écosystèmes développés de la Silicon Valley et d’Israël. En plus de ces compétences techniques, il est également important de cultiver un esprit entrepreneurial, auquel sont rarement formés les jeunes élèves français – alors qu’il est inculqué très tôt chez les Israéliens par exemple : encourager la prise de risque, l’exploration, l’itération ainsi que l’apprentissage par la pratique, en donnant droit à l’erreur.
Enfin, cette pénurie s’observe également parmi les investisseurs : encore trop peu d’entre eux sont capables d’évaluer les start-up avec une expertise équivalente à celle des fonds traditionnels de la Silicon Valley. Le fait qu’ils soient peu nombreux, notamment sur des phases de financement avancées, tend également à uniformiser les start-up sélectionnées autour des schémas les plus traditionnels comme le SaaS (Software as a Service) tandis qu’il existe moins d’offres de financement pour des modèles plus originaux.
Deux remèdes : l’attractivité et la formation
Pour encourager la montée de ces compétences, il y a deux solutions : former les talents et les attirer.
Concernant la formation, des écoles de développement informatique ou de design de bon niveau, suivant des programmes similaires à ceux de l’École 42, pourraient être montées. Ces disciplines pourraient également intervenir plus tôt dans la scolarité des élèves. Les nouveaux programmes « Numérique et sciences informatiques » au lycée ainsi que l’option MP2I en classe préparatoire, mettant un accent sur l’informatique, vont dans ce sens. L’enseignement de ces compétences pourrait être combiné, dans l’enseignement supérieur, à des cours de mise en situation entrepreneuriale.
Néanmoins, les stages en start-up et les immersions dans des cultures où cet état d’esprit entrepreneurial est plus développé restent les meilleures façons d’apprendre. Même si on peut craindre une « rétention de nos talents » lorsqu’ils font des stages à l’étranger (notamment aux États-Unis), les échanges avec des pays comme les États-Unis ou Israël constituent une formidable opportunité de rattrapage. À titre d’exemple, les élèves du Master X-HEC Entrepreneuriat passent 6 mois à Berkeley pour s’immerger dans la culture très créative de la vallée.
Il est également nécessaire d’encourager le monde de la recherche à entreprendre pour valoriser ses travaux. Les sociétés d’accélération du transfert technologiques (SATT) participent de cette logique mais ne constituent qu’une réponse partielle à cet enjeu. En complément, les visas French Tech32 aident à capter des talents étrangers non-européens.
La diffusion des compétences
Cet esprit entrepreneurial et cette expertise technologique doivent également se diffuser au sein des acteurs tiers soutenant l’écosystème comme les grandes entreprises ou l’Administration publique, via les mobilités. Faute d’anciens entrepreneurs reconvertis, la collaboration avec ces entités demeure difficile alors qu’elles ont un rôle majeur à jouer dans le développement des start-up. Disposer de plus de ressources ayant vécu une aventure entrepreneuriale apporterait à ces acteurs tiers une meilleure compréhension de la psychologie sous-jacente ainsi qu’une plus grande aptitude à apprécier la valeur d’une technologie et d’un modèle d’affaires.
Ainsi chez Dassault Systèmes, la présence de plusieurs ex-entrepreneurs a eu pour effet de diffuser la culture entrepreneuriale en interne. Les employés ont davantage l’habitude d’être challengés par des idées externes et se montrent plus aptes à les accepter et à les intégrer dans leur propre feuille de route. De telles compétences seraient utiles aux organisations publiques françaises et européennes, que ce soit lors de l’évaluation de dossiers ou pour faciliter les échanges. Christophe Chatillon qui a revendu sa start-up Capptain à Microsoft, a fondé le bureau de la French Tech à Bruxelles. Gilles Babinet, fondateur de Musiwave également revendu à Microsoft, co-préside le Conseil national du numérique et étudie à ce titre les perspectives de la révolution numérique sur la société et l’action publique. En parallèle, il a été nommé Digital Champion pour la France à la Commission européenne, représentant les intérêts des entrepreneurs français dans le domaine du digital à Bruxelles.
Levier 4 : former une place boursière susceptible de créer des champions
Pour pouvoir créer des géants technologiques, il est impératif de développer une place boursière performante dédiée aux valeurs technologiques à l’échelle européenne. Si le destin naturel d’une start-up est de se vendre, elle a généralement été conçue et structurée pour s’introduire en Bourse. Il s’agit de la plus belle sortie, celle qui offre la plus belle plus-value financière tout en conférant aux fondateurs la liberté de poursuivre leur projet.
Or actuellement, la place boursière européenne n’est pas aussi attractive pour les entreprises technologiques que le NASDAQ américain. Pour cette raison, ce dernier est préféré par la plupart des pépites françaises pour s’introduire en Bourse, à l’instar de la start-up Talend spécialisée dans l’analyse de données.
Le rapport Tibi qui analyse les sources de cette défaillance a dressé un plan opérationnel très concret afin de rendre la place de Paris plus attractive pour les start-up européennes. Outre la création d’une dizaine de fonds late stage mentionnés plus haut, pour résoudre un problème d’offre, le rapport Tibi recommande l’ouverture de cinq à dix fonds « Global Tech » sur le marché coté investissant dans des valeurs technologiques.
A ainsi vu le jour en janvier 2020 « l’initiative Tibi » préconisant d’atteindre un objectif global de 20 milliards d’euros (provenant à la fois des mandats institutionnels des allocataires d’actifs et de l’épargne des particuliers) à orienter vers ces deux types de fonds (fonds Global Tech sur marché coté et fonds de venture sur le volet non-coté) d’ici la fin de l’année 2022. Cette initiative prévoit aussi le recrutement d’une cinquantaine de gérants de portefeuilles pour les fonds Global Tech qui pourront lancer des fonds ouverts destinés aux particuliers, à l’image de l’initiative BpiFrance Entreprises 1 qui permet depuis septembre 2020 aux particuliers d’investir dans des PME. Ces fonds iraient d’abord échanger des titres sur les places boursières étrangères afin de monter en compétence et de mieux connaître les acteurs du marché avant de revenir à Paris. Leur expérience internationale ainsi acquise leur permettrait alors d’être crédibles aux yeux des différents acteurs français.
Début juin 2021, la barre des 18 milliards d’euros étant déjà franchie, le ministre de l’économie, Bruno Le Maire, a relevé l’objectif initial à 30 milliards d’euros, toujours à l’horizon fin 2022.
Levier 5 : encourager à la consolidation
La France manque d’acquéreurs de start-up, qui sont en majorité de jeunes acteurs technologiques. On l’a répété, cette pénurie encourage le rachat de start-up par des entreprises étrangères, ce qui retarde d’autant plus l’émergence d’acquéreurs locaux, et ainsi de suite… Il faut donc aider nos pépites à grossir et à assurer progressivement ce rôle pour briser ce cercle vicieux.
Des consolidations peuvent notamment se faire via des fonds de buyout spécialisés, encore trop rares, qui cherchent à rendre les start-up profitables. Elles peuvent être saines et ne viendront pas nécessairement spontanément des start-up, qui n’ont pas toujours le réflexe ni la compétence pour effectuer des opérations de croissance externe. Un point de vigilance toutefois concerne le mécanisme de Leverage Buy Out (LBO), qui fait peser sur les start-up une obligation nouvelle de remboursement de leur dette, au détriment des investissements absolument indispensables en R&D.
Un nouveau type de véhicule financier nommé SPAC (special purpose acquisition company) peut également permettre la mise en place très rapide de nouveaux acteurs technologiques. Un SPAC est une entité sans activité opérationnelle qui lève directement de l’argent en Bourse dans le but de réaliser une ou plusieurs acquisitions et de structurer les entreprises acquises. Ce type d’opérations peut toutefois mener à des comportements spéculatifs sur des montants importants, ce qui représente une prise de risque très significative. Si l’État n’a pas les compétences pour mettre en place et orchestrer de telles opérations, il pourrait en revanche les encourager fiscalement dans certains domaines clés.
Enfin, un autre levier consiste à augmenter l’appétence des grandes entreprises pour l’acquisition de jeunes pousses. L’exemple d’Accor (voir Chapitre 3) montre qu’elles peuvent utiliser leur notoriété et leurs moyens financiers pour agir comme des plateformes de consolidation sur certaines activités adjacentes à leur cœur de métier. L’émergence de compétiteurs technologiques venant les concurrencer sur leur segment historique est sans doute la meilleure stimulation qu’elles puissent recevoir pour engager davantage de ressources sur le sujet. En ce qui concerne les compétences, on pourrait toutefois encourager la mobilité de profils entre l’univers des start-up et celui des grandes entreprises. Le partage de bonnes pratiques d’open innovation et de collaborations réussies, à l’image du Hub lancé par Bpifrance, peut également aider à rapprocher les acteurs de ces deux mondes.
Faire tout ou faire bien ?
L’action publique doit-elle apporter une aide indifférenciée, en laissant agir les forces du marché tout en offrant du levier, ou doit-elle cibler certaines technologies et secteurs critiques ? Un exemple d’actualité est offert par le plan quantique. Après la remise d’un rapport intitulé « Quantique : le virage technologique que la France ne ratera pas »33, le président de la République Emmanuel Macron a annoncé une enveloppe de 1,8 milliard d’euros sur 5 ans pour permettre à la France de devenir un leader du calcul quantique, technologie qui n’en est encore qu’à ses débuts34. Cette annonce de stratégie nationale propulse sur le devant de la scène de nombreuses pépites quantiques françaises comme Alice & Bob, Qandela ou Pasqal. Après cette annonce, un fonds quantique Quantonation a levé plus de 20 millions d’euros, qu’il a commencé à investir dans trois pépites européennes tandis que de nombreux acteurs publics ou privés comme Atos ou le CNRS se mobilisent également. Cette approche ciblée fait de la France le troisième pays en matière d’investissement dans le quantique, derrière la Chine et l’Allemagne. De manière similaire, à la suite d’un rapport de Cédric Villani, la France avait consacré une enveloppe de 1,5 milliard d’euros sur le thème de l’intelligence artificielle quelques années auparavant35. On peut s’interroger sur l’impact de ces montants, quand les États-Unis prévoient dans le même temps de débloquer plusieurs milliards de dollars pour accélérer la R&D sur ces sujets mais ces annonces ont tout de même le mérite de coordonner l’action française sur quelques technologies clés.
- 28 – Décret n° 2014-479 du 14 mai 2014 relatif aux investissements étrangers soumis à autorisation préalable.
- 29 – Rapport au ministre de l’Économie et des Finances de Philippe Tibi, Financer la quatrième révolution industrielle, 2019.
- 30 – Contentsquare est spécialiste de l’analyse des comportements des internautes sur les sites et applications.
- 31 – Sifted (2021), « Scale-up Europe : How to build global tech leaders in Europe ».
- 32 – Valide 4 ans et renouvelable, le visa French Tech est une procédure simplifiée pour les investisseurs, fondateurs et collaborateurs de start-up non-européens qui veulent s’installer en France. Le visa s’étend automatiquement aux conjoints et enfants mineurs à charge.
- 33 – Rapport de Paula Forteza de janvier 2020.
- 34 – Le Monde, « Emmanuel Macron veut mettre la France dans le trio de tête mondial des technologies quantiques », 2021.
- 35 – Le Figaro, « La France va investir 1,5 milliard d’euros pour l’intelligence artificielle d’ici 2022 », 2018.
Conclusion
L’écosystème start-up français connaît depuis une dizaine d’années une croissance fulgurante et est en bonne voie pour donner naissance à de très belles entreprises technologiques françaises. Néanmoins, il demeure fragile et n’occupe qu’une place modeste sur la scène internationale. Sa forte croissance n’est d’ailleurs pas due aux seules forces tricolores mais bénéficie en réalité de la récente attention d’acteurs étrangers. Ces acteurs apportent un soutien financier précieux ainsi que l’expérience d’investisseurs et d’entrepreneurs bien plus aguerris. En contrepartie, une part importante des pépites françaises se vendent dans ces pays étrangers, faute de trouver les ressources nécessaires au maintien de leur croissance sur le territoire français.
Ces rachats, souvent critiqués, sont en réalité nécessaires au maintien et à la dynamisation de l’écosystème, grâce aux liquidités qu’ils fournissent. Mieux qu’un « mal nécessaire », ils sont une formidable opportunité de rattrapage sur lesquels les pionniers de la Silicon Valley n’ont pas pu compter. Ces rachats sont globalement bénéfiques à la croissance des start-up ainsi qu’au développement de l’écosystème, en raison du recyclage des capitaux et des talents qu’ils engendrent.
Des risques de perte technologique existent, c’est un fait. Cependant, d’un point de vue économique, les start-up qui se font racheter par des acteurs américains sont sources d’investissements étrangers en France et croissent plus rapidement que celles qui ne se font pas racheter – ou que celles qui se font acheter par des acquéreurs français. De plus, elles ne subissent que très peu de délocalisations et maintiennent ou développent leurs compétences et leurs emplois en France. Ces rachats entraînent certes un départ des fondateurs mais ceux-ci réinvestissent leurs gains, leur temps et leur expérience dans de nouvelles générations de start-up françaises plus robustes et ambitieuses que la génération précédente.
Ce qui importe en réalité n’est pas tant la protection des start-up d’aujourd’hui que le développement de l’écosystème et sa consolidation. Il ne s’agit pas tant de protéger individuellement telle ou telle start-up que de mettre en place rapidement une « machine » à engendrer de jeunes entreprises innovantes et efficaces. Ainsi, si le rachat étranger fait perdre à la France une partie de sa production, il permet en contrepartie d’huiler la machine par les liquidités engendrées et la dote d’ingénieurs forts d’un savoir-faire nouveau, qui ont en tête les plans pour concevoir un système efficace. L’expérience étrangère permet de gagner du temps, d’éviter des erreurs et est rentable sur le long terme compte tenu de la production de start-up plus efficaces et de meilleure qualité qu’elle suscite.
De plus, cette « machine » à produire des start-up n’est pas dédiée au numérique ni aux autres secteurs couverts par les start-up actuelles. Il s’agit d’un outil permettant de produire rapidement de l’innovation, y compris au profit d’autres types d’innovation comme la sobriété énergétique ou la réduction des gaz à effet de serre. Un tel système aidera la France à produire de jeunes entités agiles et audacieuses pour explorer ces nouvelles problématiques.
Au moment où ces lignes sont écrites, la start-up Believe vient de s’introduire sur la place boursière européenne Euronext. Il s’agit de la première introduction d’une entreprise technologique française de cette taille depuis Dassault Systèmes en 1996. Cette start-up qui porte bien son nom est un symbole de ce vent nouveau qui souffle sur l’écosystème français.
Bibliographie
Avolta Partners (2018), Tech exit transaction Multiples Europe, disponible sur http://www.avoltapartners.com/tech-exit-transaction-multiples/
Avolta Partners (2019), Tech Exit Transactions Multiple, disponible sur http://www.avoltapartners.com/tech-exit-transaction-multiples-2019/
Bertrand O. (2009), « Effects of foreign acquisitions on R&D activity : Evidence from firm-level data for France », Research Policy, 2009, vol. 38, issue 6.
Bertrand O. et Zitouna H. (2005), « Domestic versus Cross-Border Acquisitions : Which Impact on the Target Frims’ Performance ? », Applied Economics, 2008, vol.40.
Blank S. (2010), What is a start-up, first principes, disponible sur https://steveblank.com/2010/01/25/whats-a-startup-first-principles
Carpentier, C. & Suret, J.-M. (2006). « Création et financement des entreprises technologiques : les leçons du modèle israélien ». L’Actualité économique, 82 (3), 419 – 438.
Chesbrough H. (2003). Open innovation, Boston, Massachusetts, Harvard Business School Press.
Christensen C. (1997), The innovator’s dilemma, when new technologies cause great firms to fail, Boston, Massachusetts, Harvard Business School Press.
CIC, Moovjee, Opinion Way (2019), Baromètre Les étudiants et l’entrepreneuriat disponible sur https://www.moovjee.fr/2019/04/04/barometre-les-etudiants-et-lentrepreneuriat
CRA (2017), Observatoire CRA de la transmission des TPE/PME, disponible sur https://www.cra.asso.fr/wp-content/uploads/2015/04/observatoire-2-04-2017.pdf
Cunningham C., Ederer F. and Ma S. (2020), « Killer Acquisitions ». Journal of Political Economy, Vol. 129, No. 3, March 2021, disponible sur SSRN : https://ssrn.com/abstract=3241707 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3241707
De Chevigny I. (2015) « Au fait, c’est quoi une start-up ? », Capital, disponible sur https://www.capital.fr/entreprises-marches/au-fait-c-est-quoi-une-start-up-1063221
Direction générale du Trésor (2021), Prise de contrôle dans les start-up françaises : prédation ou développement, disponible sur https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2021/02/11/prise-de-participation-dans-les-start-ups-francaises-predation-ou-developpement
Direction générale du Trésor (2021), La tech israélienne, disponible sur https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/IL/innovation-en-israel
Direction générale du Trésor (2021), Levées de fonds et licornes : où en est la France ? disponible sur https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2021/06/04/levees-de-fonds-et-licornes-ou-en-est-la-france
EY, France Digitale (2019), Baromètre de la performance économique et sociale des start-up numériques en France, 8e édition, 2019, disponible sur https://francedigitale.org/publication/barometre-annuel-la-performance-economique-et-sociale-des-startups-numeriques-en-france-ey-et-france-digitale-2019/
EY (2020), Baromètre EY du capital-risque en France – Bilan annuel 2019, disponible sur https://www.ey.com/fr_fr/news/2020/01/barometre-ey-du-capital-risque
EY (2021), Baromètre EY du capital-risque en France – Bilan annuel 2020, disponible sur https://www.ey.com/fr_fr/services-aux-entrepreneurs/frenchtech-bilan-des-investissements-en-2020
Fontagné L. et Toubal F. (2010), Investissement direct étranger et performances des entreprises, La documentation française.
Forteza P. (2020), Quantique : le virage technologique que la France ne ratera pas, rapport disponible sur https://www.entreprises.gouv.fr/fr/etudes-et-statistiques/autres-etudes/quantique-virage-technologique-que-la-france-ne-ratera-pas
Gaudiaut T. (2021), « 2021, une année prolifique pour la French Tech », Statista, disponible sur https://fr.statista.com/infographie/24667/liste-des-licornes-francaises-selon-la-date-emergence-2021.
Gazaniol A. (2014), « Quel impact des fusions/acquisitions sur les performances des entreprises rachetées ? », Document de travail de la DG Trésor.
Graham P. (2012), Start-up = Growth, disponible sur http://www.paulgraham.com/growth.html
Granier C. (2021), Start-up et industrie : des destins liés ?, Les Docs de La Fabrique, Presse des Mines.
Houy T. (2018), Le demi-tour numérique. Quand le digital oblige les entreprises à innover à l’envers, Première Edition.
KPMG (2021), Venture Pulse Q1 2020, disponible sur https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2020/04/venture-pulse-q1-2020-global.pdf
In Extenso, Régions & Transmission (2020), Panorama des cessions et acquisitions de PME, 4e édition.
Mazzucato M. (2020), L’État entrepreneur. Pour en finir avec l’opposition public privé. Fayard
Mind the Bridge et Crunchbase (2018), Tech Start-up M&As – 2018, rapport disponible sur https://mindthebridge.com/mtbcrunchbase-techstartup-mas-2018
Morel, A. (2012), « l’investisseur Peter Thiel décroche le jackpot grâce à facebook », BFM, disponible sur https://www.bfmtv.com/economie/patrimoine/placements-epargne/l-investisseur-peter-thiel-decroche-le-jackpot-grace-a-facebook_AN-201208210067.html
O’Brien J. (2007), « The PayPal Mafia », Fortune, disponible sur https://fortune.com/2007/11/13/paypal-mafia
Tibi P. (2019), Financer la quatrième révolution industrielle. Lever le verrou du financement des entreprises technologiques, rapport au ministère de l’Économie et des Finances, juillet, disponible sur https://theinnovationandstrategyblog.com/wp-content/uploads/2019/10/financer-la-quatrieme-revolution-industrielle-philippe-tibi.pdf
Bandick R., Görg H. et P. Karpaty (2014), « Foreign Acquisitions, Domestic Multinationals, and R &D », Scandinavian Journal of Economics, 116.
Sifted « Scale-up Europe : how to build global tech leaders in Europe », disponible sur https://content.sifted.eu/wp-content/ uploads/2021/06/15162949/Scale-Up-Europe-Report.pdf
Le Monde (2021), « Emmanuel Macron veut mettre la France dans le trio de tête mondial des technologies quantiques », disponible sur https://www.lemonde.fr/politique/article/2021/01/21/emmanuel- macron-presente-un-plan-quantique-de-1-8-milliard-d-euros-sur-cinq- ans_6067037_823448.html
Ronfaud L. (2018), « La France va investir 1,5 milliard d’euros pour l’intelligence artificielle d’ici 2022 », Le Figaro, disponible sur https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2018/03/29/32001-20180329ARTFIG00287-la-france-va-investir-15-milliard-d-euros-pour-l-intelligence-artificielle-d-ici-2022.php
Forbes (2021), « Biden’s $180 Billion R&D Plan Prioritizes Key Areas Such As Chips, Quantum Computing », disponible sur https://www. forbes.com/sites/martingiles/2021/04/01/bidens-180-billion-plan- prioritizes-key-technologies/
Wydden (2019), « Les chiffres clés des startups en France », disponible sur https://wydden. com/chiffres-cles-startups-france/#Taux_dechec_des_ startups
Annexe 1 – Méthodologie
Les entretiens
Les résultats de cette étude sont issus d’une centaine d’entretiens menés avec différents acteurs de l’écosystème : des start-up rachetées ou non, de grandes entreprises françaises et étrangères, des investisseurs, des incubateurs, des administrations publiques ainsi que des personnalités politiques.
En particulier, les principaux résultats concernant les conséquences du rachat proviennent d’entretiens menés auprès de 28 start-up rachetées par des entreprises étrangères à partir d’un questionnaire mêlant des questions quantitatives (ou fermées) et des questions plus libres afin de laisser l’interlocuteur exprimer ses idées. D’une part, des thèmes récurrents ont été extraits de ces entretiens et ont pu être approfondis par la suite. D’autre part, les réponses quantitatives et fermées aux mêmes questions prédéfinies ont permis de développer une « intuition statistique » des conséquences économiques de ces rachats.
Ces résultats ont été comparés avec des échantillons témoins de start-up non rachetées ou acquises par des entreprises françaises. Ils ont ensuite pu être confrontés avec la littérature existante sur le sujet ou par la discussion avec des spécialistes.
Il existe trois limites aux résultats de cette étude : la faible taille de l’échantillon, sa représentativité et sa temporalité.
Tout d’abord, vingt-huit réponses ne sont pas suffisantes pour permettre une bonne puissance statistique. Il s’agit d’un parti pris pour deux raisons : d’une part, l’objectif n’était pas d’obtenir des résultats économétriques fiables et robustes mais plutôt de développer une intuition statistique permettant de guider la réflexion, d’appuyer certaines hypothèses et de remettre en cause des idées reçues. D’autre part, en raison de la diversité des histoires entendues, il semblait important de récupérer ces informations au cours d’échanges longs qui laissaient la place à l’interlocuteur de s’exprimer et ne laissaient pas de doutes quant à l’interprétation des réponses. Ce choix permet de replacer les réponses dans leur contexte et d’éviter les contresens en plus d’ouvrir de nouvelles pistes de réflexion. En revanche, il ne permet pas de traiter le même volume d’information qu’un questionnaire homogène envoyé en masse par e-mail ou via les réseaux sociaux.
Au niveau de la représentativité, les start-up ont été sélectionnées de façon uniforme parmi les jeunes pousses répertoriées comme achetées par des acquéreurs stratégiques ces 15 dernières années. Certaines histoires de rachat lues dans la presse ainsi que des suggestions provenant des interlocuteurs interrogés ont permis de compléter de façon opportuniste ce panel. Bien entendu, certaines start-up n’ont pas répondu. Notamment, la plupart de celles rachetées par les GAFAM soumises à des conditions de non divulgation strictes. Ce procédé comporte un biais et a sélectionné des rachats relativement visibles et médiatiques qui ne représentent pas de façon tout à fait juste l’acquisition moyenne. Il s’agit également d’un parti pris, considérant que l’objectif est de s’intéresser à la perte des pépites les plus susceptibles d’apporter de la valeur à l’économie française. Afin de vérifier que nous ne passions pas à côté d’une grande partie de problème, plusieurs discussions ont été menées confirmant qu’il n’existait que peu de rachats dans les phases de vie très amont de la start-up, phases dans lesquelles ces rachats pourraient passer inaperçus.
Les rachats étudiés ici ont concerné en grande partie les États-Unis. Ceci est une conséquence du fait que la plupart des gros rachats étrangers instructifs ont été faits par des acteurs américains. L’échantillon comportait lui bien des rachats par des acteurs asiatiques et européens.
Enfin, le dernier biais est celui de la date de ces rachats. La plupart ont eu lieu entre 2015 et 2018, il y a moins de 6 ans. Le caractère récent de ces rachats ne permet pas nécessairement d’apprécier leur impact à long terme sur la start-up et l’économie française. Cette plage temporelle a néanmoins été choisie car l’environnement dans lequel évoluaient les start-up françaises avant cette période, un environnement sans fonds disponibles avec un écosystème inexistant, aurait pu mener à des conclusions erronées quant au devenir des jeunes pousses actuellement rachetées. Il semblerait par exemple que les pépites des années 2000 étaient davantage victimes de délocalisation en raison de l’absence d’opportunités de développement en France. Il serait intéressant de reconduire une étude similaire dans 5-10 ans, lorsque les rachats actuels auront laissé des empreintes plus nettes.
Données statistiques
Les données utilisées pour modéliser les flux de start-up sont issues de la plateforme Dealroom. Les rachats de start-up ont été filtrés sur les années 2015 à 2021, en ne gardant que les start-up soutenues par des fonds de capital-risque et acquises par des entreprises.
Ces résultats ont ensuite été confrontés avec deux rapports sur le M&A de start-up conduits respectivement par les cabinets de conseil en acquisition Avolta Partners d’une part, Mind the Bridge et Crunchbase d’autre part.
Le choix de ne sélectionner que des entreprises ayant été financées par capital-risque est l’hypothèse la plus forte qui ait été faite en ce qu’elle induit des résultats qui diffèrent quelque peu des études de référence. Les deux études font le choix de définir une start-up par appartenance à un secteur technologique (marketing, e-commerce…), en rajoutant pour l’une d’elles un critère d’âge.
S’il n’existe pas de bonne réponse en raison de l’absence de définition statistique d’une start-up, cette approche nous a semblé moins pertinente pour l’objet de notre étude parce qu’elle sélectionne de nombreuses entreprises qui ne sont pas des start-up.
En intégrant les mêmes critères de secteur que dans les études d’Avolta et Mind the Bridge, la base Dealroom sélectionne notamment des entreprises de conseils, des vendeurs de matériel informatique ou des agences de voyages qui ne nous intéressent pas. Le critère d’investissement en capital-risque, qui, à l’inverse, a pour inconvénient de ne pas inclure l’intégralité des start-up mais d’en sélectionner un sous-échantillon, a le mérite de filtrer la grande majorité des entreprises qui n’obéissent pas à l’objectif de croissance qui définit selon nous la start-up. De plus, l’étude Social and economic performance of French digital startups menée par EY et France Digitale (2020) indique que 80 % des start-up interrogées (parmi un large panel) étaient financées par capital-risque, ce qui nous a confortés dans ce critère de sélection.
Enfin, il est important de souligner que les données sont très souvent incomplètes. Notamment, il existe des discordances entre les plateformes (Dealroom, Crunchbase, Pitchbook…), certaines start-up sont absentes, d’autres mal répertoriées et certains rachats sont manquants. Aussi, les montants des rachats ne sont pas souvent divulgués : dans les données, seuls 15 % des rachats avaient un montant chiffré. Ainsi, il a été décidé de n’exploiter que les volumes des rachats, et non leurs montants, pour garder des résultats représentatifs. Les figures présentées ont été obtenues à l’aide des données Dealroom, mais des analyses similaires ont été menées sur des échantillons de données Pitchbook pour s’assurer que les conclusions étaient les mêmes, et les résultats présentés sont en accord avec les études quantitatives disponibles sur le sujet. Néanmoins, il est important de garder à l’esprit que les chiffres concernant les rachats sont approximatifs bien que l’ordre de grandeur reste suffisamment fiable pour dresser des tendances et des conclusions macroéconomiques.
Pour résumer les différentes méthodologies, notre étude se base sur les données publiques de la plateforme Dealroom, entre 2015 et 2021, en sélectionnant pour start-up les entreprises ayant été financées par capital-risque.
L’étude d’Avolta s’intéresse plus généralement aux entreprises technologiques françaises définies par leur secteur d’activité, sur la période 2017-2019, et utilise une base de données privée interne regroupant plusieurs plateformes dont Dealroom, Pitchbook et Crunchbase.
Enfin, l’étude Mind the Bridge définit comme start-up une jeune entreprise technologique, c’est-à-dire une entreprise ayant moins de 20 ans d’existence et exerçant une activité soit dans un secteur considéré comme technologique, soit dans un secteur traditionnel en y apportant une technologie de rupture (comme les drones dans l’agriculture). La période d’étude est 2010-2018, les données proviennent de la plateforme Crunchbase et le rapport se penche spécifiquement sur les interactions entre les écosystèmes européens et américains.
Annexe 2 – Liste des start-up interrogées et études de cas
Nous avons interrogé 28 start-up françaises ayant fait l’objet d’un rachat (l’âge moyen au moment du rachat est de 8 ans) :
• Acticor (biotech)
• Aldebaran (robotique)
• Bringr (analyse numérique)
• Ceradrop (semi-conducteurs)
• Cobol-IT (informatique)
• Compte Nickel (fintech)
• eFront (fintech)
• Exalead (informatique)
• Fotolia (graphisme, vidéo)
• Genticiel (biotech)
• Jeuxvideo.com (services numériques)
• La Fourchette (services numériques)
• Leka (robotique, biotech)
• Logmatic (informatique)
• Luckey Holmes (services numériques)
• Memometal technologies (biotech)
• Mesagraph (analyse numérique)
• Oasis Smart Sim (semi-conducteurs)
• OuiDo productions (vidéo)
• Preligens (intelligence artificielle)
• Qosmos (cybersécurité)
• Sculpteo (impression 3D)
• Sentryo (cybersécurité)
• Stupeflix (software)
• Vexim (biotech)
• Withings (biotech)
• Zenly (services numériques)
• Zensoon (cosmétique)
Résultats statistiques des entretien
Exemples d’entretiens avec six start-up françaises rachetées

Julien Piet et Marc Revol, Rachat des start-up. Des racines françaises, des ailes étrangères, Les Docs de La Fabrique, Paris, Presses des Mines, 2021.
ISBN : 978-2-35671-694-1
© Presses des MINES – TRANSVALOR, 2021
60, boulevard Saint-Michel – 75272 Paris Cedex 06 – France presses@mines-paristech.fr
www.pressesdesmines.com
© La Fabrique de l’industrie
81, boulevard Saint-Michel – 75005 Paris – France info@la-fabrique.fr
www.la-fabrique.fr