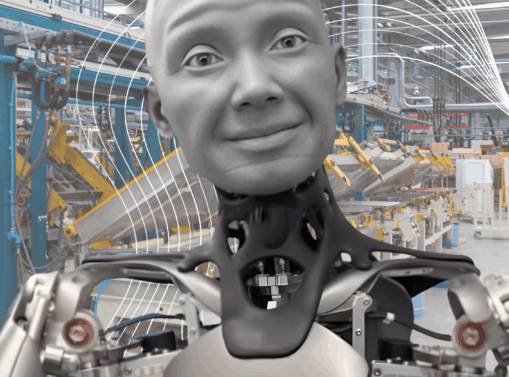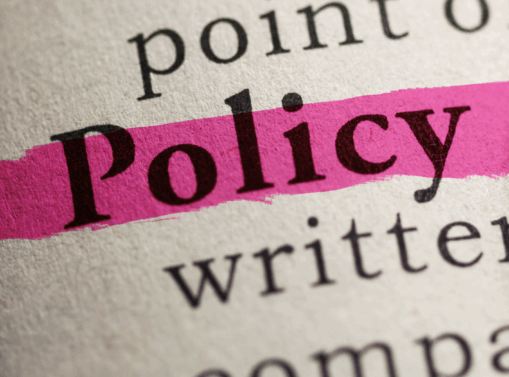Nos souverainetés industrielles et l’ombre de l’oncle Sam
Version française
Nos souverainetés industrielles et l’ombre de l’oncle Sam
La semaine dernière, j’ai eu le plaisir de participer une fois encore à la réunion du forum Babbage à Cambridge, au Royaume-Uni. Seize pays étaient représentés par une quarantaine de participants, chercheurs ou praticiens, venus des deux Amériques, d’Asie et d’Europe. Nous avons pu, en confiance, échanger nos connaissances et nos impressions sur les politiques industrielles et d’innovation telles qu’elles sont mises en œuvre un peu partout dans le monde.
Il faut d’abord saluer la qualité de cette assemblée, le respect mutuel dont témoignaient ces échanges, qui ont ainsi permis de croiser avec intelligence les perspectives d’observateurs variés, qu’ils soient américains, chinois ou d’ailleurs. Dans le contexte actuel, cette intelligence collective est précieuse. C’est aussi un tour de force des organisateurs – bravo à Mike, Gordon, Sarah et à tous leurs collègues de l’IMF !
Un deuxième point marquant ressort de ces discussions : l’instabilité internationale et le risque de conflit étaient dans toutes les têtes et sur toutes les lèvres. Il a été particulièrement frappant de constater combien l’attitude imprévisible de notre allié historique, les États-Unis, était redoutée voire vilipendée par ceux qui en subissent déjà les conséquences les plus lourdes. On a même entendu des représentants des pays « non alignés » affirmer qu’en comparaison, la Chine apparaissait aujourd’hui plus fiable, car elle joue selon des règles écrites et prévisibles.
Il y a deux ans, la France faisait partie des rares pays à avoir explicitement porté un objectif de « souveraineté industrielle » au premier chef de son action publique. Cette expression, toujours absente des dictionnaires et dénuée de signification précise, n’en est pas moins devenue courante et semble désormais partagée sur toute la planète. Toutefois, ce n’est pas le souvenir du Covid ou des pénuries de paracétamol qui guide l’action publique en la matière, mais bien le recentrage des États-Unis sur leurs intérêts nationaux exclusifs, la compétition structurante entre les deux superpuissances mondiales et la crainte généralisée d’un affrontement majeur.
Aux États-Unis, la politique industrielle est toujours aussi délibérée que sous le mandat précédent, quoique moins lisible et bien moins prévisible, et désormais totalement placée sous le parapluie des politiques de défense et de sécurité. Le grand changement est qu’il n’y a plus aucune rationalité économique évidente à la succession des décisions présidentielles. Transition énergétique, innovation, croissance, balance extérieure… : on chercherait en vain un plan d’analyse, un critère, qui les rende cohérentes. C’est en dehors de l’économie qu’il faut se placer pour en saisir la signification : la logique de l’exécutif est purement politique, celle de l’affirmation de puissance. Le marché n’est pour Trump qu’une arène comme une autre où faire jouer des rapports de force, avec pour objectif obsessionnel que l’Amérique gagne à tous les coups et à tout prix. Cette tactique, appelée par un intervenant européen « retrait belliqueux », consiste en particulier à délier progressivement les États-Unis de leurs engagements internationaux, tout en se montrant extrêmement agressifs à chaque pas en arrière.
La Chine, de son côté, poursuit méthodiquement son projet de leadership industriel et d’autosuffisance technologique à horizon 2049. Elle développe de nombreuses technologies d’avenir (IA, quantique, véhicules autonomes et intelligents…) et moissonne des succès insolents, tout en localisant autant que nécessaire ses activités manufacturières hors de ses frontières, notamment en Asie du Sud-Est et en Afrique de l’Est où elle investit très lourdement, comme elle le fait d’ailleurs pour ses approvisionnements miniers. Si l’industrie et la technologie sont au cœur du modèle de leadership chinois, l’acte manufacturier proprement dit peut tout aussi bien être localisé en Indonésie ou en RdC. Tous les pays de la zone, Vietnam excepté, sont d’ailleurs en phase de désindustrialisation eux aussi.
L’Europe, en comparaison, fait figure d’enfant candide, pour avoir cru jusque tardivement – et y croire peut-être encore – à la supériorité de son modèle, optimisé sur le papier car placé au service de la prospérité économique et guidé par les préceptes de l’efficacité libérale, oubliant ce faisant qu’elle était alors protégée des agressions extérieures par l’ombre dissuasive de l’oncle Sam. Aujourd’hui, elle se retrouve à découvert.
Certes, la densité du marché intérieur européen constitue toujours une protection économique, notamment quand l’arme favorite de ses adversaires consiste à moduler les droits de douane. Il suffit pour s’en convaincre d’écouter les ressortissants des pays dont le développement économique et la stabilité politique dépendent plus intensément encore du commerce international, de la Norvège à l’Indonésie en passant par l’Inde ou Singapour. Toutefois, l’intense maillage constitué par les liens commerciaux intra-européens ne saurait tisser une armure suffisante, surtout depuis que l’autorité morale de l’OMC est réduite à néant – plusieurs intervenants ont même déclaré que l’OMC était « morte, défenestrée ».
L’Europe, dans cet environnement international compétitif, présente un bulletin de notes peu flatteur : retard technologique, faiblesse de l’investissement en capital et en R&D… Plus que son diagnostic, c’est sa réaction qui fait peine à entendre : affirmant une fois de plus qu’elle a pris la mesure du problème et qu’elle va se ressaisir, elle met en avant… la publication de deux rapports de haut niveau (Letta et Draghi). On peut certes y reconnaître une prise de conscience documentée ; mais quel long chemin il reste à parcourir entre la publication d’un rapport et l’acte souverain !