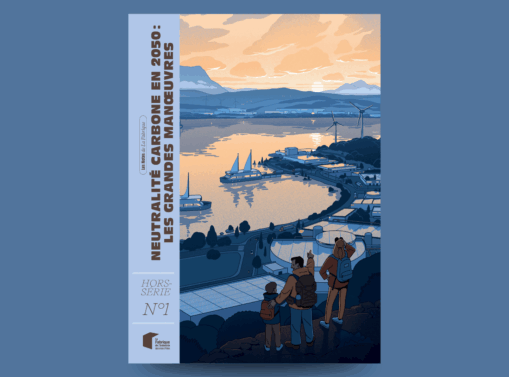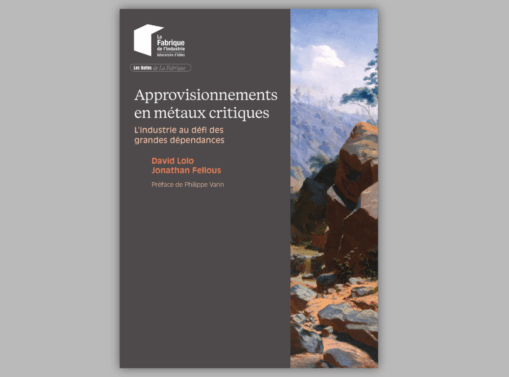Construire une ville industrielle et durable : les enseignements tirés de nos voisins européens
Conjuguer besoins des industriels en foncier et préservation des espaces naturels est un dilemme qui dépasse nos frontières, confirme la nouvelle étude de La Fabrique de l’industrie. L’examen de trois villes européennes montre néanmoins qu’il est possible de concilier ces deux ambitions sous certaines conditions.
L’accès au foncier constitue une des conditions essentielles au développement des activités industrielles dans les villes moyennes. Mais ces dernières doivent aussi faire des arbitrages en faveur d’une gestion durable du foncier, en raison d’un volontarisme affiché ou d’une réglementation comme c’est le cas en France avec l’objectif de zéro artificialisation des sols (ZAN), inscrit en 2021 dans la loi Climat et Résilience. Les auteurs de l’étude Gérer le foncier industriel dans les territoires – Un dilemme européen, ont analysé les stratégies de trois villes européennes conjuguant une forte présence d’activités industrielles et une stratégie d’urbanisation durable pour mettre en évidence des pratiques locales inspirantes en matière de gestion foncière : Bergame en Italie, Gand en Belgique et Vitoria-Gasteiz en Espagne.
Une territorialisation des objectifs
En Espagne, en Italie et en Belgique, les objectifs de sobriété foncière et les politiques d’aménagement du territoire sont décentralisés de façon à tenir compte des réalités locales. Ainsi, quand la ZAN s’applique de manière uniforme en France, à Bergame et à Gand, cette ambition est fixée à l’échelle régionale sous la forme d’objectif chiffré sans se traduire par une législation contraignante (à Gand par exemple il s’agit de limiter à 3 hectares la consommation de sols non bâtis journalière).
À Vitoria-Gasteiz, l’objectif est municipal et se traduit par la modification dans le plan d’urbanisme de terrains constructibles qui n’auraient pas encore été aménagés et pour lesquels il n’y aurait pas de projet déjà défini en zones non urbanisables.. C’est aussi à cet échelon qu’est défini le plan de développement industriel dans la ville espagnole tandis que la stratégie industrielle de Bergame et de ses environs s’inscrit dans le modèle plus informel des districts industriels.
L’intermédiation foncière dépendante du niveau de décentralisation
Toutefois, les compétences transférées aux collectivités diffèrent d’un pays à un autre, et expliquent en partie les différences de gestion du foncier dans les trois villes d’étude. Au Pays basque, chaque échelon – région, province, ville – dispose d’une agence d’aménagement qui joue le rôle d’intermédiaire entre les industriels et les propriétaires fonciers. La constitution de réserves foncières dédiées à l’industrie par la ville de Vitoria-Gasteiz est une autre preuve de la maîtrise foncière publique. En Italie, la décentralisation récente n’a pas effacé le fonctionnement centralisé du pays ni l’autonomie des communes. Ainsi, à Bergame, les relations informelles entre les industriels et les élus locaux structurent l’accès au foncier.
Adapter les outils aux conditions locales
Le cas de Gand est éloquent de ce point de vue. Pour répondre au « stop béton » flamand visant à limiter drastiquement l’urbanisation, la ville a développé des instruments juridiques et financiers, certes coûteux, mais qui favorisent la réhabilitation des friches industrielles. On retrouve sinon dans ces villes européennes des outils mis en oeuvre dans les territoires français, tels que des plans d’urbanisme pour définir les implantations futures, des zones industrielles pour maîtriser la consommation foncière ou la création de « ceintures vertes » autour des villes (comme à Vitoria Gasteiz).