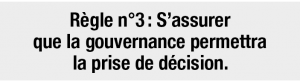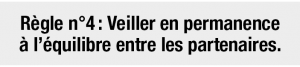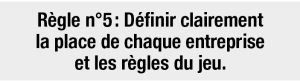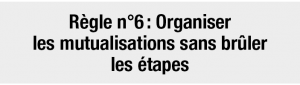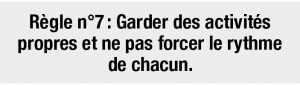Accélérateurs de croissance pour PME : build-up et alliances

Anthony Dowell et Wayne Eagling interprètent Prospero et Ariel Crickmay Anthony (né en 1937) © Droits réservés Royaume-Uni, Londres, Victoria and Albert Museum Photo © Victoria and Albert Museum, Londres, Dist. RMN-Grand Palais / image Victoria and Albert Museum
Préface
En 2017, la France a créé davantage d’usines qu’elle n’en a détruites. L’embellie est certes fragile mais manifeste, il faut s’en réjouir. Nous pouvons également nous féliciter d’un élan entrepreneurial perceptible dans notre pays, comme en atteste le dynamisme des créations d’entreprises.
Il est cependant probable qu’un grand nombre de ces nouvelles entreprises auront du mal à grandir jusqu’à devenir des entreprises de taille intermédiaire (ETI), capables d’innover, de développer de nouveaux produits et d’exporter. Le déficit d’ETI est, nous le savons bien, une carence majeure de l’industrie française. À l’inverse, ces entreprises constituent Outre-Rhin un atout maître du tissu industriel, le fameux Mittlestand qui joue un rôle décisif dans la création de richesses et d’emplois.
De nombreuses PME françaises ont pourtant le potentiel nécessaire pour croître, se développer et devenir de véritables ETI. Mais les obstacles sont nombreux sur le sentier de la croissance et il n’existe pas de solution unique pour y parvenir. Il faut pallier le manque de fonds propres, faire face aux contraintes juridiques et fiscales, s’assurer du soutien des donneurs d’ordre… Il y a aussi, parfois, une certaine frilosité des chefs d’entreprises, qui peuvent trouver plus confortable de ne pas grandir. Ce livre donne la parole à ceux qui ont tenté le pari de la croissance externe ou de l’alliance.
La croissance externe, appelée build-up quand elle se déploie à un rythme très soutenu, est souvent portée par des dirigeants à l’ambition assumée. Elle vise à assurer la pérennité de l’entreprise, même lorsqu’elle est pilotée par un fonds de capital-investissement. Les alliances constituent également un moyen efficace d’accéder au statut d’ETI. Ces deux stratégies suscitent évidemment des réticences, liées aux transformations qu’elles supposent. Nul doute que les témoignages précieux sur lesquels ce livre repose inspireront les chefs d’entreprise pour les inciter à sauter le pas.
Pierre-André de Chalendar et Louis Gallois
Coprésidents de La Fabrique de l’industrie
Introduction
Cette Note, réalisée en partenariat avec le Centre technique des industries mécaniques (Cetim), est la troisième que La Fabrique de l’industrie consacre à la croissance des PME et ETI industrielles. Le point de départ de la réflexion est toujours le même. La France souffre d’un déficit d’entreprises de taille intermédiaire1 et de grosses PME. Elle en compte moins que l’Allemagne et que le Royaume-Uni : Oliver Gottschalg (Observatoire du private equi ty , HEC) indique que, comparativement à son PIB au sein de l’Europe de l’Ouest, il manquerait à la France 4 000 entreprises réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 100 millions d’euros2. De manière générale, les PME françaises, comparativement aux PME allemandes, sont en moyenne plus petites et plus fragiles que leurs homologues, elles présentent un taux de survie moins élevé, elles croissent moins vite, sont moins exportatrices et préservent plus difficilement leur indépendance. Le secteur de la mécanique, premier secteur industriel de France en nombre d’emplois et nombre d’entreprises, ne compte par exemple que 12 000 entreprises de plus de 10 salariés sur les 30 000 du secteur ; il illustre les enjeux que représente la croissance pour des milliers de TPE situées dans le bas des filières.
Par quels mécanismes ces PME peuvent-elles accélérer leur croissance et jouer pleinement le rôle de ferment du tissu économique national qu’elles ont dans d’autres pays ?
Nous nous étions précédemment intéressés aux ressorts micro-économiques généraux de la croissance mis en œuvre par les ETI dans Paroles d’ETI3, puis à leurs facteurs de résilience dans Rebondir et se réinventer4. En investiguant à nouveau notre base des cas, nous avons décelé deux mécanismes d’accélération de croissance intéressants pour les PME : la croissance externe soutenue ou « build-up », et les alliances entre PME. C’est à ces deux accélérateurs de croissance que nous consacrons la présente note.
La méthode est la même que pour les opus précédents. Il s’agit d’écouter la parole des chefs d’entreprise5 pour comprendre comment ils abordent une problématique, quelles sont leurs motivations, les difficultés qu’ils rencontrent et comment ils les surmontent. Cette étude n’a donc aucunement la prétention d’étudier le build-up ou les alliances sous tous leurs angles, ni de fournir des méthodes de croissance « en kit », ni d’investiguer les conditions-cadres macro-économiques susceptibles de favoriser la croissance des PME industrielles. Tout au plus a-t-elle l’ambition de fournir par la méthode du « carottage » – prélever des échantillons en profondeur – des sources d’inspiration et des « meilleures pratiques que d’autres » à des entreprises qui seraient confrontées à des situations plus ou moins similaires, tout en conservant toujours à l’esprit qu’une bonne pratique est toujours relative aux circonstances particulières de l’entreprise qui l’a employée ou fait naître.
Build-up et alliances sont deux manières possibles de faire grossir des PME et de les transformer en ETI.
Le build-up est un terme assez récent. Il est surtout employé par les sociétés de capital-investissement (ou fonds de buy out ) qui visent à regrouper différentes entités autour d’une entreprise plateforme selon des critères stratégiques et opérationnels, afin de créer des structures de plus grande taille. En regroupant des PME et en développant leurs synergies, les build-up créent des groupes de taille moyenne et modifient ainsi la structure du tissu économique (chapitre 2). Les études économiques sur « l’effet taille » des entreprises ont, en effet, montré que les entreprises de plus grande taille ont une plus grande longévité, résistent mieux aux fluctuations économiques, sont plus productives, plus rentables, ont une R&D plus efficace et disposent de meilleurs atouts à l’export. Telle est la justification et la vertu macro-économique des opérations de build-up.
Bien évidemment, le build-up n’est en rien réservé aux sociétés de capital-investissement. Une entreprise chef de file peut parfaitement décider d’adopter une stratégie par croissance externe soutenue et viser d’emblée à devenir une ETI de son secteur par acquisitions successives. Nous donnons d’ailleurs quelques exemples remarquables de cette stratégie dans le chapitre 1. Que l’entreprise décide de financer une telle stratégie avec l’appui ou non d’un fonds de capital-investissement, ou en mixant différentes sources de financement, est seconde dans notre propos.
Il importe néanmoins de garder à l’esprit qu’il existe dans notre pays, comme dans d’autres, un débat sur le fait de savoir si de telles stratégies de croissance externe et de consolidation sectorielle ont une meilleure chance de réussite lorsqu’elles sont gouvernées par des fonds de capital-investissement que lorsqu’elles sont menées par des industriels détenant la majorité du capital. Nous ne prendrons pas parti dans cette controverse qui déborde très largement le cadre de notre sujet. Nous nous bornons à constater que, d’une part, la présence de ces fonds dans l’actionnariat d’une entreprise – par exemple lorsque celle-ci a été reprise en LBO – peut jouer un rôle déterminant dans le choix en faveur d’un développement rapide par croissance externe ; d’autre part, que les intérêts s’alignent sans doute moins « spontanément » que ne l’affirment les fonds et qu’il peut exister des conflits entre l’horizon temporel du fonds et celui d’un patron d’ETI soucieux d’indépendance et de pérennité. Quoi qu’il en soit, les fonds de capital-investissement demeurent des partenaires importants dans ce type de stratégies de croissance.
Mais le développement par croissance externe n’est pas une voie ouverte à toutes les PME. Pour toutes celles qui ne peuvent pas mobiliser des capitaux aussi importants, une solution alternative à la croissance externe est fournie par les alliances et les partenariats (chapitre 3). Cette voie nécessite de la part des chefs d’entreprise une ouverture suffisante et un esprit de collaboration qui ne s’acquièrent pas en un jour. C’est un chemin escarpé qui en dissuade plus d’un, mais lorsque l’alliance réussit, elle renforce autant l’entreprise que les compétences du dirigeant.
En définitive, et pour paraphraser Fanny Letier, anciennement directrice exécutive Fonds propres PME de Bpifrance, notre objectif, à travers la présentation de ces cas de build-up et d’alliances, est « d’inspirer les 1 000 à 2 000 PME qui ont le potentiel de se hisser demain au rang d’ETI et dont l’accélération est l’autre enjeu “caché” de notre économie »6
Liste des entreprises et experts
• Gilles Benhamou, PDG, Asteelflash Group | Séance AI7 du 17 mai 2016
• Antonio Molina , PDG, Mäder | Séance MI du 16 septembre 2015
• Tony da Motta Cerveira , Directeur de l’innovation, Matfer Bourgeat | Séance AI du 5 juillet 2016
• Nicolas Mouté , Associé, Ixens | Séance AI du 8 juillet 2015
• Patrick Orlans , Délégué régional, CETIM | Entretien avec l’auteur
• Gilles Pernoud , Président, AGP Développement et Groupe Georges Pernoud | Séance AI du 17 février 2016
• Sophie Pourquéry , Associée, Industries et Finances Partenaires | Séance AI du 14 octobre 2015
• Daniel Richet , Directeur du développement, CETIM | Séance MI du 20 septembre 2017 et entretien avec l’auteur
• Gérard Russo et Guy Kilhoffer , CEO, Ventana | Séance AI du 18 janvier 2018
• Marc Sevestre , PDG, Cap Group | Cetim Infos , n°238, juin 2017
• David Simonnet , PDG, Axyntis | Séance AI du 4 juillet 2017
• Alexandre Souvignet , PDG, Alphi | Séance AI du 15 mars 2018
- 1. Entreprises dont les effectifs sont compris entre 250 et 5000 salariés et dont le CA est compris entre 50 M€ et 1,5 Md€.
- 2. Industries&Finances avec HEC Buy Out Research Program, 10 janvier 2012.
- 3. Cahier Marie-Laure et Toubal Louisa, Paroles d’ETI : les entreprises de taille intermédiaires à la conquête de la croissance, La Fabrique de l’industrie, Presses des Mines, 2015.
- 4. Marie-Laure Cahier, Vincent Charlet, Rebondir et se réinventer : la résilience des ETI industrielles, Les Notes de La Fabrique, La Fabrique de l’industrie, Presses des Mines, 2017.
- 5. Auditions dans le cadre du séminaire « Aventures industrielles » organisé par l’École de Paris du management avec le soutien de l’UIMM et de La Fabrique de l’industrie. Les comptes-rendus complets de toutes les séances sont consultables sur le site www.la-fabrique.fr
- 6. Fanny Letier, Postface in Rebondir et se réinventer, op. cit., p. 39.
- 7. AI : séminaire Aventures industrielles, MI : séminaire Management de l’innovation.
Le build-up, un mode de croissance très volontariste
Un nouvel anglicisme se répand : le « build-up ». Ce terme a été popularisé depuis quelques années par les fonds de capital-investissement menant des opérations de consolidation sectorielle via des regroupements de PME. Pour les puristes, il faudrait donc différencier les build-up conduits par des fonds, d’autres opérations de croissance externe menées par des industriels et qualifiées de « fusions-acquisitions stratégiques ». Pour notre part, nous employons ici « build-up », d’une façon générique, pour désigner toute stratégie de croissance basée sur l’acquisition, à un rythme soutenu, d’autres sociétés, sur la base de logiques de regroupement horizontales, verticales ou technologiques, afin d’atteindre une taille critique et de créer des synergies industrielles. Un build-up est donc « un ensemble d’acquisitions mené par une holding ou une entreprise en vue de construire, dans un secteur d’activité choisi, un groupe plus important et plus rentable, développant une stratégie de leader de marché »8. En ce sens, le build-up n’est pas réservé aux financiers, c’est un mode de croissance – la croissance externe – ouvert aux chefs d’entreprise désireux de croître, peu importe la manière dont ils le financent.
Dans une PME ou une ETI, du fait de ses moyens limités, mais aussi de sa propension à l’indépendance et au contrôle issue de son caractère patrimonial, la croissance externe est souvent considérée avec une certaine méfiance : elle est difficile sur le plan du financement et nécessite souvent une ouverture du capital ; elle est jugée risquée sur le plan de l’intégration des organisations et des cultures, dans un contexte où les dirigeants manquent souvent de temps pour tout gérer. Dans un précédent ouvrage de notre série sur les ETI, Paroles d’ETI , nous avions identifié chez plusieurs patrons des réticences face à la croissance externe : « La croissance externe sert souvent à compenser une croissance interne insuffisante »9 ou encore « La croissance externe est plus rapide que l’organique, mais elle peut s’avérer un miroir aux alouettes »10. Ce type d’entreprises est donc généralement plus enclin à faire le choix de la croissance interne. Quand elles font des acquisitions, elles agissent le plus souvent par opportunité, au gré des rencontres et des partenariats qui se développent et s’approfondissent, lorsqu’un partenaire est en difficulté (le prix de l’acquisition devenant alors attractif) ou lorsqu’une ancienne joint-venture dysfonctionne.
Chez les entrepreneurs qui recourent au build-up, en revanche, ces craintes sont supplantées par la volonté de croître rapidement : « Compte tenu de mon âge lorsque j’ai racheté l’entreprise, j’ai opté pour la croissance externe de préférence à la croissance organique, car cela va plus vite » (Antonio Molina, Mäder).
Au vu de notre échantillon d’entreprises, c’est donc un mode de développement qui : a) résulte d’une volonté affirmée, b) correspond à une vision stratégique et c) se déploie à un rythme assez soutenu. Une telle orientation semble correspondre à une sociologie particulière de chefs d’entreprise.
1. Une sociologie spécifique
Au vu de notre échantillon limité, et avec toutes les précautions qui s’imposent de ce fait, on constate une toile de fond commune aux chefs d’entreprise qui optent pour une logique de build-up.
Ce sont des diplômés du supérieur, et souvent des diplômés de grandes écoles de commerce ou d’ingénieur.
Ils se trouvent souvent au 2 e ou 3 e tiers de leur vie professionnelle (entre 35 et 50 ans) et disposent d’une solide expérience professionnelle en tant que cadres supérieurs de grands groupes, ou parfois en tant que serial repreneurs.
Ils se situent initialement dans un cadre de reprise d’entreprise, et non de stricte création11, même si, à l’issue du processus, l’entreprise qu’ils dirigent n’aura plus grand-chose à voir avec celle qu’ils avaient rachetée : on pourrait dire qu’il s’agit d’une « re-création »12. Les reprises étant fréquemment financées par du capital-transmission (LBO), il est aussi fort probable que la présence de fonds au sein de la gouvernance de ces entreprises représente une incitation à la croissance externe, comme mode de croissance rapide et créateur de valeur. On pourrait même aller jusqu’à penser que l’orientation vers la performance résulte, dans certains cas, de l’alignement des intérêts de l’entrepreneur-manager sur l’intérêt du fonds à travers des mécanismes de « carotte » et « bâton ».
Autre caractéristique, ces entrepreneurs ne sont pas forcément issus du secteur d’activité dans lequel ils interviennent. Autrement dit, ils ne bénéficient pas toujours d’une connaissance sectorielle préalable approfondie, ce qui leur permet de porter un regard neuf ou prospectif sur le secteur, et d’élaborer ainsi des stratégies originales : « Lorsque j’expliquais à mes interlocuteurs que nous pouvions assurer l’intégration de leurs fonctions électroniques et plasturgiques, en les faisant bénéficier de la mutualisation des achats et en participant au design, ils me prenaient pour un hurluberlu » (Gilles Benhamou, Asteelflash). Quand il a racheté sa première entreprise de peinture en 1993, Antonio Molina, aujourd’hui PDG de Mäder, était docteur en physique, avait travaillé comme ingénieur de développement, puis comme consultant et analyste financier : « J’avais ma stratégie en tête, mais je ne connaissais pas encore le monde de la peinture. »13
S’ils comprennent la technologie, voire se passionnent pour elle, leur atout réside plutôt dans le portage d’une vision et dans leurs qualités managériales : « Mon registre d’expertise est plutôt dans la stratégie et l’organisation que dans les réactions chimiques elles-mêmes » (David Simonnet, Axyntis).
Enfin, ils manifestent un tempérament de bâtisseur. D’emblée, ils voient grand : « Nous avons décidé d’en faire une entreprise nationale, puis internationale » (Antonio Molina, Mäder) ; « J’ai décidé de constituer d’emblée une ETI » (David Simonnet, Axyntis) ; « Nous cherchons à ajouter en permanence de nouvelles cordes à notre arc » (Gérard Russo, Ventana).
Dans un article intitulé « La PME : une gestion spécifique »14, Michel Marchesnay distingue les patrons PIC (ceux qui donnent la priorité à la pérennité, puis à l’indépendance, puis à la croissance) et les patrons CAP (ceux qui privilégient la croissance, puis l’autonomie, puis la pérennité). Si le PIC recherche une indépendance patrimoniale et manifeste une préférence pour l’autofinancement, le CAP recherche l’autonomie de la décision, mais « ne répugne pas, loin s’en faut, à s’endetter, voire à faire participer des personnes extérieures à son capital »15. Bien que ce type de segmentation relève toujours de l’idéal-type et ne se retrouve que rarement dans la pratique sous cette forme extrême, il ressort cependant que le build-up correspond davantage aux chefs d’entreprise de type CAP.
De son poste d’observation privilégié comme associée dans une société de capital-investissement dédiée au build-up (Industries & Finances Partenaires), Sophie Pourquéry décrit ainsi le profil de ce chef d’entreprise : « Pour se lancer dans un programme de build-up, un manager doit être comme l’enfant qui apprend à marcher, c’est-à-dire dans une posture de léger déséquilibre et tourné vers l’avant. Il est attaché à la pérennité de l’entreprise mais il veut également la développer et il est prêt pour cela à prendre des risques en intégrant de nouveaux savoir-faire, des cultures et des organisations différentes, et aussi en ouvrant son capital. »16
2. Quand le build-up repose sur une vision stratégique de long terme
Pour les chefs d’entreprise de notre échantillon, viser une croissance rapide ne s’oppose pas à la recherche de pérennité. Ils ont une ambition fondée sur une vision à long terme de leur marché et de leur activité, qui préexistait aux opérations de build-up. Les acquisitions sont au service de cette stratégie, mais elles ne la commandent pas.
Dans le cas contraire, si les acquisitions ne sont pas soutenues par une vision préalable, le risque est de se laisser porter par celles-ci et de changer de logique et de priorité au gré du vent : « Trop d’entreprises changent constamment leur fusil d’épaule. Elles se lancent dans une première activité mais, quand vous vous adressez à elles au bout de quelque temps, vous vous rendez compte qu’elles sont déjà passées à autre chose. Deux ans plus tard, elles ont encore changé de sujet. On ne peut pas réussir en modifiant en permanence sa stratégie fondamentale. » (Gilles Benhamou, Asteelflash)
« [La stratégie] d’Asteelflash a été définie en 2000 et nous n’en avons jamais dévié, en dépit de nos acquisitions successives. Cette stratégie consistait à être un manufacturier et à nous positionner dans le service en proposant aux entreprises d’intégrer leurs fonctions électroniques. Ce qui a changé au fil du temps, c’est la dimension de notre marché et la façon dont nous avons complété notre offre de service. Nous sommes passés du niveau national au niveau mondial, et nous avons progressivement renforcé notre contribution au design et à l’industrialisation en recourant à des technologies de plus en plus pointues » explique ainsi Gilles Benhamou, son PDG.
Même son de cloche pour Antonio Molina chez Mäder : « Nous avons opté pour l’industrie et décidé de devenir leader dans notre domaine, [la peinture pour] le ferroviaire. Progressivement, nous nous sommes développés dans d’autres secteurs industriels, en nous efforçant chaque fois de prendre la première place. […] Il faut avoir une stratégie claire et la mettre à jour régulièrement. »
Pour David Simonnet, PDG d’Axyntis, il s’agissait de construire un leader indépendant de la chimie fine au sein d’un secteur qui demeure assez éclaté. En 2007, il rachète cinq usines, dont quatre dans la chimie fine pharmaceutique et une dans les colorants, créant ainsi le groupe Axyntis. Ensuite, « j’ai mis dix ans à racheter [l’activité de chimie fine de 3M] » témoigne-t-il, ce qui dénote pour le moins d’une grande constance dans le projet que l’on s’est fixé.
Dans l’industrie, le chef d’entreprise build-upper n’est pas un gambler : la croissance recherchée est au service de la construction d’un groupe pérenne.
3. Objectifs stratégiques des acquisitions
Les acquisitions peuvent correspondre à plusieurs objectifs stratégiques qui, parfois, se cumulent.
Atteindre une taille critique
Au démarrage, l’objectif fondamental est souvent d’atteindre une taille critique. « Atteindre la taille critique permet à l’entreprise d’être référencée et d’accéder au marché des grands donneurs d’ordres, de massifier ses achats, d’obtenir de meilleures conditions de la part des fournisseurs, d’investir dans la recherche et développement, dans la force commerciale, dans le marketing digital ou encore dans l’internationalisation, et aussi de recruter plus facilement » résume Sophie Pourquéry.
Un bon exemple en est donné par Ventana, un fabricant de pièces et de sous-ensembles métalliques de haute technologie pour l’aéronautique civil et de défense. L’entreprise emploie aujourd’hui cinq cents salariés à travers sept filiales et réalise un chiffre d’affaires de cinquante millions d’euros, dont un quart à l’export. Le groupe s’est construit à travers l’acquisition de sept PME en un peu plus de dix ans. En 2003, Ernst Lemberger, Gérard Russo et Guy Kilhoffer s’associent pour reprendre CIMB (chaudronnerie et mécano-soudure de précision). La machine est lancée : en 2005, ils acquièrent Micron Précision (usinage de pièces à haute valeur ajoutée de moyennes dimensions), en 2007, GTA (montage et réparation de turbines et de sous-ensembles mécaniques), en 2008, Fonderie Meissier (fonderie sable de précision aluminium et magnésium pour pièces de grandes dimensions), en 2011, ERI (usinage de prototypes et petites séries de pièces de grandes dimensions), en 2012, Fonderie Mercié (fonderie sable de précision aluminium pour pièces de petites dimensions), en 2016, O. St. Feinguss & HPG (fonderie cire perdue tous alliages légers et aciers spéciaux, et fonderie de précision). Pourquoi une telle boulimie ? « Cette dynamique de croissance […] répond à l’attente de nos clients, qui souhaitent disposer de partenaires pérennes et disposant d’une forte capacité d’innovation. […] Nos clients souhaitent aussi cette croissance pour une autre raison, qui nous plaît moins : la possibilité de faire participer leurs fournisseurs aux risques qu’ils prennent. Nous comptons parmi nos clients tous les grands noms de l’aéronautique : Safran, Airbus Group, Liebherr, Rolls-Royce, Thales, General Electric. »
Se développer géographiquement
La recherche d’une internationalisation rapide représente souvent l’un des objectifs visés par les opérations de croissance externe.
Pour Antonio Molina, le rachat du groupe suisse Mäder a représenté pour l’entreprise un tournant qui lui a permis de gagner plusieurs années de développement : « En 1999, l’hexagone commençait à être trop petit pour nous. Nous avons eu l’opportunité de racheter le groupe suisse Mäder, qui était un peu la “Rolls-Royce” de la peinture industrielle. Nous connaissions bien ce groupe avec lequel nous avions des contrats de licence. Le montage financier a été un peu complexe, car son chiffre d’affaires équivalait au nôtre, mais l’opération a finalement pu être menée à bien en un an et demi seulement. Cette acquisition nous a donné une couverture géographique beaucoup plus étendue, avec une usine en Suisse et des implantations commerciales en Allemagne. Nous avons décidé de transformer ces sites commerciaux en sites de production et nous avons poursuivi les rachats d’entreprises en Allemagne, puis en Chine, où Alstom nous a sollicités pour la peinture des soixante-quatre premiers TGV, et désormais également en Inde. Aujourd’hui, nous sommes présents dans 14 pays. Notre chiffre d’affaires est passé de 10 millions d’euros en 1993 à 200 millions en 2015, et de 80 salariés à 870, dont 360 en France, 200 en Suisse, 200 en Allemagne et 70 en Chine. »
De son côté, le groupe Asteelflash s’est constitué, à partir de 2000, par acquisitions successives dans le domaine des EMS (Electronic Manufacturing Services). Au bout de six ans, le chiffre d’affaires atteignait déjà 200 millions d’euros, avec plusieurs établissements en France et un centre de production à bas coût en Tunisie. Mais la concurrence était vive et le marché mondial, en train de se consolider : « Je n’avais pas le choix, raconte Gilles Benhamou, il fallait poursuivre cette démarche de build-up, cette fois à l’international. En 2008, nous avons racheté la société Flash Electronics, implantée sur la côte Ouest des États-Unis et en Chine, ainsi qu’une petite société anglaise. Notre chiffre d’affaires est instantanément passé de 200 millions d’euros à 450 millions de dollars. […] En 2011, nous avons racheté Catalyst Manufacturing Services Inc., une société implantée sur la côte Est des États-Unis et au Mexique, puis, en 2012, une entreprise allemande. En 2014, grâce à ces acquisitions et à notre croissance interne, nous sommes devenus le numéro deux en Europe. Asteelflash compte désormais cinq mille collaborateurs, dont neuf cents en France, et notre chiffre d’affaires devrait atteindre [en 2016] 800 millions de dollars. »
Se diversifier
Le troisième objectif stratégique des acquisitions est la diversification. Il s’agit de compléter l’offre de produits et de services, de capter de nouvelles cibles de clientèle ou de nouveaux marchés, de se doter d’une nouvelle branche d’activités.
Matfer Bourgeat est aujourd’hui un leader mondial des équipements destinés aux métiers de bouche. Le groupe opère dans quatre domaines stratégiques : les petits ustensiles de cuisine, les arts de la table, le mobilier de distribution de repas et le matériel hôtelier. Avec mille collaborateurs et six sites industriels spécialisés en métallurgie et en plasturgie, il réalise un chiffre d’affaires de 200 millions d’euros.
Au milieu des années 1980, la société Matfer s’est lancée dans une croissance externe en acquérant des sociétés spécialisées dans les arts de la table et la vaisselle. Cette diversification avait pour but de proposer des offres de salles en complément de ses gammes réservées à la cuisine professionnelle et ainsi de se rapprocher du consommateur final. Le nouveau groupe Matfer a ensuite poursuivi sa dynamique par l’achat d’ensembliers et de distributeurs dans une logique d’intégration verticale. En 2002, l’entreprise a racheté le numéro deux de son marché, la société Bourgeat. Cette expansion a doté Matfer Bourgeat d’une offre extrêmement étendue et a soutenu une stratégie « B-to-B-to-U-to-C » qui, au-delà du circuit de distribution, s’attache à toucher l’utilisateur du produit (le cuisinier) et le client final (l’hôte du restaurant).
La diversification des clients et des secteurs est également protectrice pour les entreprises, particulièrement pour celles intervenant en sous-traitance : en réduisant la dépendance à un ou plusieurs donneurs d’ordre dans le même secteur, elle permet de ne pas trop souffrir des « à-coups » d’activité.
Ventana, par exemple, s’efforce de développer une certaine diversité afin de ne pas être trop impactée lorsqu’un de ses secteurs connaît des difficultés : « Depuis quelques années, le marché des hélicoptères a été pratiquement divisé par deux. Notre chiffre d’affaires dans ce domaine est tombé de 16 millions d’euros à un peu plus de 7 millions. À ce mouvement général s’est ajouté, en avril 2016, l’accident d’un Super Puma H225 en Norvège, qui a provoqué la mort de treize personnes, ce qui a temporairement cloué la flotte au sol et réduit également la partie maintenance de notre activité. »
David Simonnet, PDG d’Axyntis, confirme : « Dans une industrie de sous-traitance comme la nôtre, il est risqué d’être trop dépendant d’un donneur d’ordres. L’un de nos concurrents, qui vient d’être mis en redressement judiciaire, avait un client dont les commandes représentaient 40 % de son chiffre d’affaires. C’est pourquoi nous privilégions une diversification de nos marchés, à la fois géographique et sectorielle, tout en valorisant sur ces nouveaux marchés les standards de qualité et de sécurité que nous appliquons dans la production pharmaceutique. » Mais pour parvenir à cette diversification des clients, il faut souvent ouvrir de nouveaux marchés et acquérir de nouvelles compétences : c’est là que les acquisitions entrent en jeu. « Notre deuxième grand champ d’activité, la chimie fine de spécialités, comprend l’électronique, la cosmétique, la photographie et de nombreuses autres activités de niche comme les arômes et parfums. En 2007 [au moment de la première reprise], nous n’étions présents dans aucun de ces domaines, à part l’électronique, précise David Simonnet. Grâce à cette diversification, notre premier client ne représente que 12 % de notre activité. »
Acquérir des technologies et des savoir-faire
Pour beaucoup d’ETI industrielles, le mobile des acquisitions consiste à intégrer des technologies nécessaires au développement des capacités d’innovation, qu’il serait trop coûteux ou trop lent de développer en interne. Mais il est intéressant d’observer que ce sont aussi ces mêmes entreprises qui investissent le plus en R&D. Les deux démarches sont liées.
« Chaque société rachetée devait pouvoir se “brancher” sur le Groupe et communiquer avec lui pour partager les connaissances et les accroître. Nous avons donc privilégié les entreprises possédant des technologies que nous ne connaissions pas, de façon à constituer peu à peu un système encyclopédique. » (Antonio Molina, Mäder) Mäder investit 10 % de son chiffre d’affaires dans la recherche, alors que ses concurrents ne vont pas au-delà de 5 à 6 %, et la recherche emploie environ cent vingt-cinq personnes.
« Nous avons souhaité nous positionner plus en amont dans le cycle de vie des projets de nos clients, notamment en développant nos capacités d’innovation. Ceci s’est traduit par l’acquisition d’un certain nombre de technologies et d’outils techniques. » (David Simonnet, Axyntis) L’acquisition de ces technologies a donc une fonction stratégique. Elle permet de se repositionner dans la chaîne de valeur pour « monter en gamme » et capter davantage de valeur ajoutée. À l’origine, Axyntis était ce qu’on appelle un CMO ( Contract Manufacturing Organization ), ce qui signifie que l’essentiel de son métier consistait à reproduire scrupuleusement les procédés industriels élaborés par ses clients, avec un handicap, celui de ne pas vendre autre chose qu’une production dont la structure de coûts est connue. En investissant dans des technologies permettant l’accompagnement des clients dans toute la phase précédant l’industrialisation– qui peut durer près de dix ans pour une nouvelle molécule médicamenteuse– Axyntis est devenu un CDMO ( Contract Development and Manufacturing Organization ), augmentant au passage considérablement sa création de valeur.
4. Les défis du build-up pour une PME
À côté de ces bénéfices, le build-up présente aussi un certain nombre de défis assez redoutables pour une PME.
Nicolas Mouté, ancien membre du fonds Oaktree Capital Management qui a fait plusieurs build-up, et aujourd’hui associé d’Ixens, résume ainsi les défis qui attendent l’entreprise :
• L’identification de l’entreprise cible, l’approche, l’ensemble des vérifications, les discussions et toutes les négociations représentent une charge très lourde pour une PME. Il lui est en général impossible de réaliser seule cette étape. Elle aura alors recours à des consultants, des banquiers d’affaires ou des fonds d’investissement pour s’assurer que l’acquisition a vraiment un intérêt pour elle en fonction de sa stratégie, et pour mener l’opération à bonne fin.
• La recherche du financement et le montage financier sont également complexes.
• Les opérations de build-up tirent souvent parti du rachat d’entreprises en difficulté. La contrepartie en est que ces entreprises doivent être redressées, ce qui représente un défi en soi.
• Une fois l’acquisition réalisée, l’acquéreur va être confronté à des différences culturelles, mais aussi à des « querelles de clocher ». Il doit être capable de prendre du recul, de dépasser les rivalités et d’opter pour des solutions qui sont intéressantes pour la nouvelle entité, et pas seulement pour ses intérêts propres.
• Enfin, il s’agit de mettre en place une nouvelle organisation adaptée à la taille de la nouvelle entité ainsi créée et génératrice de performance.
L’ampleur de la tâche paraît souvent dissuasive, ce qui explique les réserves exprimées par certains chefs d’entreprises à l’égard de la croissance externe. Une dimension que ne cachent d’ailleurs pas ceux qui y ont eu recours : « Je n’affirmerai pas que le choix de la croissance externe est forcément le meilleur. C’est le plus rapide […]. Mais cela représente plutôt une contrainte. » (Antonio Molina, Mäder)
« Les problèmes d’intégration culturelle résultent de l’histoire et de l’organisation de chaque entreprise rachetée […]. Les collaborateurs issus de 3M avaient l’habitude de fabriquer les quatre mêmes molécules depuis longtemps. Ils doivent désormais produire des molécules variées pour plusieurs clients simultanément. Par ailleurs, certains collaborateurs ont vécu des moments très difficiles dans leur ancienne entreprise, comme Calaire Chimie, avec des ateliers à l’arrêt pendant des mois et un climat déprimant. De façon surprenante, ce sont parfois ceux dont l’emploi risquait de disparaître qui se sont montré les plus réticents à adopter les nouveaux modes de fonctionnement. » (David Simonnet, Axyntis)
« Si passer de 100 millions à 2 milliards d’euros de chiffre d’affaires peut se faire en deux ans, obtenir que la totalité des collaborateurs appliquent les règles communes prend environ cinq à dix ans et exige d’énormes efforts. » (Gilles Benhamou, Asteelflash)
Il est donc nécessaire de s’assurer de la compatibilité de l’entreprise-cible avec la culture et le projet de l’acquéreur : « Nous avons surtout privilégié l’achat de PME. Lorsqu’il nous est arrivé de racheter une filiale d’un grand groupe, l’intégration des salariés s’est avérée très difficile. Ils avaient l’habitude de travailler pour un seul client avec un seul process, alors que nous devons être très flexibles pour répondre à la diversité des clients et de leurs demandes. »
En résumé, un processus de build-up est par nature complexe et délicat. Si l’impact peut être extrêmement rapide en termes de croissance et indéniablement facilitateur en termes d’internationalisation – « Racheter des sociétés nous a permis de gagner du temps en nous dotant dans chaque pays d’une base industrielle expérimentée et en nous permettant de disposer d’emblée d’équipes parlant la langue et connaissant les façons locales de faire du commerce, qui varient fortement d’un pays à l’autre » (Asteelflash) – les écueils sont nombreux. Le format des échanges ayant servi de base à notre travail n’a pas permis de creuser particulièrement ce point, mais nous soupçonnons que les difficultés, voire les échecs, sont supérieurs à ce qui a été ici brièvement évoqué.
Néanmoins, il faut aussi tenir compte du fait que beaucoup d’ETI indépendantes s’inscrivent dans un capitalisme « patient » : à la différence des opérations de fusions et acquisitions menées par de grands groupes, les acquisitions n’y sont pas gouvernées par la création de valeur immédiate, mais par le souci de leur contribution au développement et à la pérennité de l’entreprise. Dans cette perspective de temps long (une quinzaine d’années), le « succès » ou « l’échec » d’une intégration se mesure à une aune tout à fait différente de la seule « valeur actionnariale ». C’est pourquoi, la tendance actuelle à la « financiarisation » des build-up par des fonds de capital-investissement, comme nous le verrons au chapitre 2, peut entrer en contradiction avec le projet du chef d’entreprise.
Enfin, selon Antonio Molina, la pratique répétée des acquisitions tend à les rendre plus aisées : « Le fait de procéder constamment à de nouvelles acquisitions facilite l’intégration des filiales. Quand vous achetez une nouvelle entreprise, celle que vous avez reprise juste avant se considère comme une “ancienne” et s’identifie plus facilement au Groupe. »
5. Changer d’échelle et devenir une ETI
Une ETI construite par build-up doit être capable de devenir plus que la somme de ses parties, au risque de ne demeurer qu’une confédération de PME. « L’augmentation du chiffre d’affaires n’est pas le seul critère d’une transformation réussie et un groupe ne peut pas être seulement une accumulation de PME, même si chacune fait parfaitement son travail. Il faut que le client puisse retrouver, d’un établissement à l’autre, la même philosophie, la même stratégie, les mêmes outils industriels. Il est donc très important de réussir à faire appliquer les mêmes “business rules” partout, qu’elles concernent les achats et les ventes ou encore l’acceptation des commandes, les réponses aux appels d’offres, la coordination des appels d’offres, etc. » (Gilles Benhamou, Asteelflash)
Passer de PME à ETI implique donc de refondre (voire de configurer) l’organisation existante en matière de process , systèmes de pilotage, d’information et de communication. Une exigence qui sera encore renforcée si le financement du build-up a impliqué l’ouverture du capital à des fonds de capital-investissement. Ce passage d’un style de management direct, et d’une organisation assez informelle, à un système plus pyramidal sera souvent vécu comme une étape douloureuse par le dirigeant de PME.
Sur le plan de la gestion financière, une PME s’intéresse avant tout au compte d’exploitation et au résultat. Dans une ETI, l’indicateur devient l’EBITDA ( Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization ). Ce changement a des implications concrètes, comme le fait de réduire les actifs en limitant les stocks ou de négocier des délais plus avantageux pour le paiement des fournisseurs, car tous ces éléments ont une incidence sur la valeur de l’entreprise. La présence de fonds dans la gouvernance de l’entreprise va orienter l’attention du dirigeant vers deux caractéristiques essentielles de la réussite financière : la génération de cash et l’amélioration de la valeur. « Si l’on ne comprend pas la nécessité de ce changement de perspective, on ne peut pas adopter une stratégie de croissance » conclut Gilles Benhamou.
Un autre changement lié à la transformation en ETI concerne l’équilibre à trouver entre le local et le corporate , entre centralisation et autonomie des filiales. Pour ne pas perdre en agilité tout en gagnant en homogénéité, l’ETI doit savoir se réorganiser en permanence pour répondre au double objectif « penser globalement, agir localement ».
« Nous sommes passés d’une organisation pyramidale à une organisation matricielle, puis revenus à un système pyramidal, puis nous avons encore changé de système. À l’époque où nous avons racheté Mäder à Zurich, nous imposions à toutes les nouvelles filiales notre propre mode d’organisation, qui était alors matriciel. Au bout de deux ans, nous avons constaté que cela ne fonctionnait pas à Zurich. Un des cadres m’a expliqué “Ici, il n’y a que le Führerprinzip qui marche.” Nous avons rétabli un système pyramidal et les problèmes ont été réglés. » (Antonio Molina)
« Pour parvenir à harmoniser les règles au sein d’Asteelflash, j’ai décidé de renforcer le niveau corporate en recrutant des directeurs de très haut niveau chargés chacun d’un domaine d’expertise (le Lean, les technologies, la qualité, le commerce, l’informatique, la finance…) et en mettant en place un outil informatique unique. Nous avons effectivement réussi à harmoniser les business rules. En revanche, ce fonctionnement “en silos” nous a fait un peu perdre de vue l’objectif final […]. Les dirigeants d’établissement étaient largement déresponsabilisés : ils appliquaient les procédures qui leur étaient imposées, mais n’étaient plus proactifs dans la prise de décision. Tout ceci s’est traduit par une forte diminution de notre rentabilité et nous a conduits, après quelques années, à faire pencher le balancier dans le sens inverse. Nous avons réduit le niveau corporate à quelques personnes seulement et redonné le pouvoir à l’échelon local, celui-ci étant constitué à la fois par quatre grands patrons de régions (Allemagne, France et Tunisie, États-Unis et Mexique, Chine) et par les patrons d’établissements. Désormais, ces derniers gèrent eux-mêmes l’ensemble de leurs activités, y compris commerciales, ce qui leur confère de bien plus grandes réactivité et responsabilité. Le risque est maintenant celui du relâchement dans le respect des business rules du Groupe. C’est pourquoi j’imagine que, d’ici quelques années, il faudra à nouveau renverser le balancier et redonner du pouvoir au niveau corporate. En réalité, une ETI comme la nôtre doit en permanence se garder de deux écueils : croître trop vite sans avoir fixé des lignes directrices suffisamment claires, ou passer trop de temps sur les règles et négliger la rentabilité, fruit de la responsabilité locale. » (Gilles Benhamou)
Enfin, l’entreprise va devoir faire évoluer le profil de ses managers en fonction de la réalité de sa croissance et de son internationalisation. « On ne peut pas gérer un chiffre d’affaires d’un million, de cent millions ou d’un milliard d’euros avec les mêmes personnes. » Savoir choisir ses collaborateurs aux différentes étapes du développement est une compétence critique pour un dirigeant d’ETI.
6. Financer le build-up
La croissance externe mobilise des capitaux importants. Cependant, les liquidités n’ont jamais été aussi abondantes sur le marché et les solutions de financement sont quasiment infinies. Une PME ou une ETI en bonne santé, avec des projets de développement solides, a aujourd’hui peu de problèmes pour financer son développement. Emprunter, ouvrir son capital ou panacher selon de multiples montages : le choix dépend de la situation de l’entreprise, mais aussi de l’état d’esprit du dirigeant sur la question du partage de pouvoir. Globalement, discrétion oblige, nos témoins n’ont pas été très diserts sur ces questions de financement.
Selon Fanny Letier, directrice exécutive Fonds propres chez Bpifrance, les PME et les ETI patrimoniales sont en général très sourcilleuses quant à leur indépendance et réticentes à ouvrir leur capital. Elles se privent ainsi de moyens permettant des stratégies de développement offensives, indispensables dans la compétition mondiale.
Les entrepreneurs de notre échantillon qui ont fait le choix du build-up sont évidemment plus ouverts que la moyenne aux investisseurs extérieurs17. Ils ont souvent financé leur première reprise en LBO, ce qui a conditionné leur structure actionnariale et leur gouvernance.
Plus qu’à l’indépendance formelle, ces dirigeants sont attachés à l’autonomie de la décision. Selon Gilles Benhamou qui détient 25 % des actions d’Asteelflash– le reste appartenant à des sociétés de capital-investissement– le pouvoir ne repose pas sur le nombre d’actions détenues, mais sur la performance du management qui lui permet de s’imposer.
Antonio Molina, ancien analyste financier, se targue d’être particulièrement affûté sur les questions financières. « Pour le rachat de Mäder à Zürich, nos banquiers n’ont toujours pas compris comment nous avions fait, mais cela a très bien fonctionné, dans le strict respect de la loi. Cela dit, on peut se procurer cette compétence financière à l’extérieur de l’entreprise. » Chez Mäder, le financement de la croissance externe a fait appel à des banques et à des fonds d’investissement, avec deux grandes règles : ils devaient rester minoritaires dans le capital et il n’y avait pas de versement de dividendes, car cela aurait été incompatible avec le fait de consacrer 10 % du chiffre d’affaires à la R&D. Tous les financeurs ont accepté ce principe : ils réalisent leur plus-value au moment de la sortie du capital.
Le recours à un fonds de capital-investissement constitue souvent un bon catalyseur pour démarrer un build-up. Mais si ce choix présente de nombreux avantages, il impose aussi des contraintes, en particulier quant au temps alloué pour opérer les acquisitions. Au bout de 5 ans en moyenne, le fonds voudra sortir du build-up et réaliser sa plus-value. Or, nous avons pu voir que, dans la pratique, le cycle de build-up permettant la construction d’une ETI internationalisée était plutôt de 10 à 15 ans. Ceci étant, une fois la pompe amorcée, l’entreprise pourra chercher d’autres relais financiers, soit en s’endettant, soit en procédant à une augmentation de capital, soit en passant de fonds en fonds, voire en s’introduisant en Bourse.
***
Dans ce chapitre 1, nous avons considéré des stratégies de croissance externe pilotées par des chefs d’entreprise ambitieux et volontaristes. Mais il existe également une autre catégorie de build-up : ceux qui sont déclenchés et pilotés par des fonds de capital-investissement. Regarder le build-up via ce second prisme est particulièrement intéressant : cela permet de visualiser l’ensemble des conditions nécessaires à la réussite d’un build-up.
- 8. Emmanuel Harlé, « Marier stratégie et création de valeur : le build up », Vie et sciences de l’entreprise, 2011/1, n°187, p. 115-118.
- 9. Marie-Laure Cahier et Louisa Toubal, Paroles d’ETI : les entreprises de taille intermédiaires à la conquête de la croissance, La Fabrique de l’industrie, Presses des Mines, 2015, p. 26-27.
- 10. Ibid.
- 11. Notons qu’il existe aussi des stratégies de build-up chez les start-up. 20 % des start-ups accompagnées par le Hub Bpifrance ont déjà fait au moins une acquisition. Mais il n’y a rien ici d’étonnant, puisqu’il s’agit par nature d’entreprises qui misent sur une croissance rapide avec une logique de « winner-take-all ». http://www.bpifrance-lehub.fr/le-build-up-a-la-francaise/
- 12. Dans son rapport Industrie du futur: du système technique 4.0 au système social (décembre 2017), l’Académie des Technologies souligne l’importance du « repreneuriat » dans l’engagement des chefs d’entreprise en faveur de l’industrie du futur. «Dans certains cas, l’engagement d’une PME passera par un changement de génération à sa tête. La question du repreneuriat se pose dans un nombre considérable de PME industrielles, dirigées par des baby-boomers nés dans les années 40 et 50. Les écoles de management et les facultés de gestion devraient y attacher une importance comparable à celle qu’elles accordent à l’entrepreneuriat », p. 59.
- 13. Cité in Luc Hossepied, La course à l’innovation : la saga d’Antonio Molina, Ateliers Henry Dougier, 2017.
- 14. Michel Marchesnay, « La PME : une gestion spécifique », Économie rurale, 1991, p. 11-17.
- 15. Ibid.
- 16. Dans Rebondir et se réinventer: la résilience des ETI industrielles (La Fabrique de l’industrie, Presses de Mines, 2017), nous avions mis au jour que les ETI les plus résilientes sont justement celles qui sont «ambidextres», parvenant à concilier prudence patrimoniale et prise de risque entrepreneuriale.
- 17. Pour comparer les choix d’ETI en matière de financement de leur croissance, voir Paroles d’ETI, p. 79 à 87.
Le build-up, côté fonds
Sur les 282 fonds de capital-investissement membres de l’AFIC (Association française des investisseurs pour la croissance), 190 financent des transmissions majoritaires ou LBO (leverage buy-out). Parmi eux, 150 se consacrent aux petites et moyennes entreprises, avec des participations allant de 2 à 20 millions d’euros. Une cinquantaine de ces fonds sont actifs, c’est-à-dire réalisent au moins une opération par an. Très peu sont spécialisés dans le build-up, même si la rentabilité de ces opérations, lorsqu’elles réussissent, attire de plus en plus les convoitises.
En 2012, une étude menée par Oliver Gottschalg, professeur à HEC, sur un panel de 1 905 transactions18, dont 504 build-up, indiquait que procéder à des opérations de build-up représentait une stratégie gagnante pour les fonds LBO.
Le build-up nécessite de la part du fonds investisseur (entendu ici comme la somme des apporteurs de fonds et du gestionnaire du fonds) un savoir-faire et une implication spécifiques : il doit disposer d’une double expertise financière et industrielle, de l’expérience d’acquisitions et d’intégration d’entreprises au sein d’un groupe, d’une capacité de suivi opérationnel ainsi que d’une capacité à générer un flux d’affaires propre. C’est sans doute ce qui explique qu’en dépit de la rentabilité de ces opérations, les fonds spécialisés dans ce type d’opérations ne soient pas très nombreux.
Sans oublier qu’un build-up mal conduit peut aussi détruire de la valeur. Par exemple, explique Nicolas Bouté, associé chez Ixens, « un entrepreneur peut racheter des concurrents et créer des “guerres de chapelles” qui plombent l’entreprise. Un investisseur ayant une démarche purement financière peut produire une situation chaotique en procédant à des acquisitions sans queue ni tête. Le build-up est un concept très simple en lui-même, mais difficile à mettre en œuvre. »
Définition donnée par Sophie Pourquéry, associée chez Industries & Finances Partenaires (IFP)
1. La méthodologie des fonds de capital-investissement
Les fonds spécialisés ont développé une méthodologie pour les build-up. Nous donnons ici l’exemple de la méthodologie d’Industries & Finances Partenaires, un fonds intégralement dédié au build-up.
La première étape pour un fonds consiste à choisir l’entreprise plateforme. Il s’agit souvent de PME générant un chiffre d’affaires d’environ 10 à 15 millions d’euros et qui sont leaders sur leur marché. Leur avantage concurrentiel peut reposer sur leurs savoir-faire et compétences, sur la qualité de leurs produits et de leur démarche client, sur leur force commerciale, sur l’efficacité de leur organisation, sur l’industrialisation de leurs process, ou encore sur leurs bonnes pratiques. En général, leur rentabilité est également supérieure à celle de leurs concurrents, parfois de trois ou quatre points, ce qui est significatif pour des PME. Comme nous l’avons vu au chapitre 1, le profil du dirigeant de la future plateforme est également essentiel. À cette étape, l’objectif du fonds est de convaincre l’entrepreneur de céder la majorité de son capital.
Certains secteurs se prêtent plus que d’autres au build-up. Les plus intéressants sont ceux qui sont fragmentés ou, du moins, offrent de la place pour l’émergence d’un nouvel acteur stratégique. Les écosystèmes de fournisseurs sont particulièrement propices au build-up : par exemple, dans l’industrie, la chaudronnerie, la fonderie, ou encore les fournisseurs de rang 2 de l’aéronautique. La consolidation permet à ces fournisseurs de maintenir leurs savoir-faire et de mieux encaisser les à-coups des carnets de commande. Notons que c’est majoritairement dans ces secteurs que les acteurs industriels vus au chapitre 1 ont eu recours au build-up. Mais d’autres secteurs où l’effet de taille est important peuvent aussi être considérés, comme le numérique ou la distribution B-to-B ou B-to-B-to-C.
Une fois la plateforme sélectionnée, la deuxième étape consiste à formaliser une stratégie à 10 ou 15 ans pour la plateforme. Pour beaucoup de patrons de PME, c’est une découverte : même s’ils ont beaucoup d’idées sur l’avenir de leur entreprise, ils n’ont jamais pris le temps de les mettre en forme. L’objectif est ici de mettre en commun la réflexion sur la valeur que pourrait apporter à l’entreprise une taille plus importante, sur le potentiel de consolidation du secteur, les perspectives de développement sur des marchés adjacents, les produits, services ou savoir-faire manquants, etc.
La troisième étape consiste à recenser puis à sélectionner les cibles. C’est un travail très lourd : il y a parfois plusieurs dizaines de cibles potentielles. Pour chaque société complémentaire visée, le fonds doit identifier la valeur intrinsèque de l’acquisition et les synergies positives qu’elle offre, effectuer un premier tri, puis bâtir une démonstration qui visera à convaincre le dirigeant de la société cible qu’il a davantage intérêt à rejoindre la plateforme qu’à rester seul.
Quatrième étape : prendre contact avec les sociétés cibles. Il arrive que les patrons de la plateforme et de la société cible se connaissent depuis des années et aient déjà envisagé de « faire quelque chose ensemble » mais, comme ils sont concurrents, la discussion n’est pas allée très loin car ils ne veulent ni se communiquer leurs rentabilités respectives, ni échanger leurs secrets de fabrication. Le fonds d’investissement joue alors le rôle d’un tiers de confiance. Les deux sociétés acceptent de communiquer ce qu’elles auraient refusé de se dire entre elles. Le fonds utilise alors des grilles d’analyse pour évaluer les portefeuilles produits, services et clients de la cible et identifier plus précisément les synergies possibles. Il est très important d’associer les dirigeants à cette étape pour observer comment ils fonctionnent et si l’intégration a des chances de fonctionner. S’il y a trop d’incertitudes à cette étape, il est préférable de renoncer à l’opération.
S’ensuit la cinquième étape, celle des due diligences, permettant de vérifier si les éléments d’attractivité de la cible correspondent bien à la réalité. Elle sera suivie par la négociation sur le prix et sur les autres aspects du contrat : pacte d’actionnaires, gouvernance, règles de vie communes.
La dernière étape intervient après l’achat de l’entreprise : c’est celle du déploiement des synergies. Le fonds organise des sessions de travail pour faciliter la mise en œuvre des synergies et pour impliquer les équipes sur des sujets transverses tels que la création d’une marque commune, les systèmes d’information, l’harmonisation des process, etc.
En matière de gouvernance, une holding est créée, qui détient 100 % du groupe. Dans le cas d’un build-up intégralement piloté par un fonds, celui-ci en devient très souvent l’actionnaire majoritaire et les anciens dirigeants deviennent aussi actionnaires de la holding. Le fonds peut prendre la présidence, tandis que le patron de la plateforme en devient le directeur général. Le fonds passe également du temps sur la constitution du comité exécutif, afin de trouver le bon équilibre entre nouveaux et anciens, entre les personnalités en présence, leurs points forts et leurs points faibles.
Entre la première rencontre du fonds avec la « plateforme » et la première acquisition, il se passe environ un an. Si les fonds reconnaissent que le cycle complet d’un build-up pour construire un groupe est de l’ordre de dix ans, leur présence est en moyenne souvent limitée à cinq ans. Au-delà, le fonds souhaitera sortir et réaliser sa plus-value, en revendant par exemple à un autre fonds qui prendra le relais. Si la présence du fonds se prolonge, son taux de retour sur investissement devient plus faible, ce qui n’est pas dans son intérêt.
Le facteur multiplicateur entre le prix d’achat et le prix de vente des sociétés traduit la transformation d’une PME immature (management « en soleil » où tout passe par le dirigeant, offre produits incomplète, etc.) en un groupe structuré et désendetté, avec une stratégie claire, une gamme de produit complète, un développement international, etc.
2. Avantages et inconvénients du recours à des fonds de capital-investissement pour un build-up
Les projets de croissance externe nécessitent une mobilisation importante de capitaux, impliquant souvent le recours à des fonds de capital-investissement. Si le chef d’entreprise parvient à rester majoritaire, à recourir à plusieurs fonds ou autres sources de financement, ou à garder le contrôle via des pactes d’actionnaires particulièrement bien rédigés, il s’assure une autonomie de décision appréciable. Mais cela n’est pas toujours réalisable. Antonio Molina– chez qui les fonds sont pourtant minoritaires– note en outre que la pression mise sur la création de valeur à court terme, les exigences de reporting et de justification des décisions prises, s’accentuent. Impression confirmée en creux par David Simonnet qui déclare : « En 2015, souhaitant mettre un terme au LBO et obtenir l’indépendance stratégique et opérationnelle, j’ai fait appel à un partenaire japonais. »
Nicolas Mouté, associé chez Ixens, résume ainsi les avantages et inconvénients du recours à un fonds pour une entreprise.
Les fonds d’investissement apportent, tout d’abord, du financement en fonds propres qui a l’avantage d’être moins fragilisant que l’endettement. Ils apportent avec eux toutes les ressources et compétences qui peuvent manquer au PDG en termes de fusions-acquisitions.
Ils aident l’entreprise à se professionnaliser sur certains plans comme la stratégie, la finance ou l’organisation, et lui ouvrent tout un réseau de contacts et de projets, y compris à l’international.
Ils disposent du recul nécessaire pour aider le dirigeant à réduire le facteur « émotionnel », en montrant l’impact rationnel, dans une logique financière, de certaines décisions. Comme ils ne sont pas attachés aux intérêts particuliers de l’une ou l’autre société du groupe, ils peuvent jouer un rôle de facilitation et d’apaisement lors de conflits entre deux dirigeants.
Ils représentent aussi une force motrice et « accélérante », car ils sont pressés d’avancer, alors que deux dirigeants peuvent parfois se montrer hésitants. Souvent, deux PDG peuvent s’interroger pendant des années sur l’intérêt qu’il y aurait à se rapprocher, alors que le fonds exigera que l’opération soit bouclée en 12 mois.
Toutefois, le fonds agit en fonction de son propre horizon temporel qui, comme nous l’avons dit, est plus court que celui de la construction d’un groupe. Ce que le fonds appelle « long terme » (5 ans en moyenne), l’entrepreneur pourra le vivre comme un court terme.
Le fonds fixe des orientations, par exemple en matière d’investissement, qui correspondent à son propre agenda de maximisation de valeur entre son investissement initial et le prix de sortie. Il est mû par des considérations relevant de la valorisation financière à terme de l’entreprise pour les bailleurs de fonds. Il peut donc exister une divergence notable entre les intérêts du fonds et la vision de dirigeants « bâtisseurs » soucieux de croissance, mais aussi de pérennité et d’indépendance. Les enjeux court-termistes peuvent venir hypothéquer des stratégies qui miseraient, par exemple, sur une R&D à horizon de retour lointain pour assurer le développement à long terme de l’entreprise. La perte d’autonomie, voire la perte du contrôle de son entreprise, est le risque majeur pointé par les chefs d’entreprise.
Certains fonds d’investissement peuvent aussi avoir tendance à se représenter le monde à travers les grilles d’un tableur Excel, où les sociétés sont des briques de Lego que l’on peut assembler et désassembler sans difficulté. Tout opérationnel sait que le rachat de sociétés est un exercice qui peut s’avérer très compliqué, surtout lorsque l’on veut créer des synergies et faire du build-up transformant , c’est-à-dire aboutir à un résultat très différent de la simple addition des entreprises.
***
Selon l’étude menée par Oliver Gottschalg, les stratégies d’acquisition menées par des financiers affichent cependant des taux de réussite supérieurs à celles menées par des industriels. « De nombreuses recherches académiques soulignent qu’en moyenne, lors d’une opération de fusion-acquisition, le retour pour les acquéreurs est faible, voire négatif. Plus de 50 % de ces opérations se révèlent être des échecs, détruisant de la valeur pour les actionnaires de l’acheteur » , indique Oliver Gottschalg19. Soulignons que l’on parle toujours ici de valeur pour les actionnaires, et pas forcément de performance économique et sociale durable pour l’entreprise.
Plusieurs éléments peuvent expliquer que la performance financière soit meilleure lorsque les financiers sont à la manœuvre. À la différence des acteurs industriels, les fonds de LBO ont le choix des secteurs dans lesquels investir, certains se prêtant plus à des opérations de rapprochement du fait par exemple de leur atomisation. Par ailleurs, le fonds dispose des moyens pour aligner les intérêts des différents dirigeants impliqués dans le programme de build-up via leur intéressement capitalistique, et des capacités pour contrôler et conseiller le management de l’entreprise (« ingénierie organisationnelle »). Enfin, le fonds conduit son opération exclusivement en fonction du rendement attendu, alors qu’un patron industriel pourra avoir d’autres motivations.
- 18. HEC, Observatoire du Private Equity, Buyout Database – données confidentielles collectées auprès d’investisseurs sur longue période.
- 19. L’Agefi, 13 janvier 2012.
Alliances et partenariats, une alternative à la croissance externe
Lorsque les moyens sont limités, comme c’est le cas pour beaucoup de PME, alliances et partenariats peuvent représenter une alternative aux opérations de croissance externe.
Dans la majorité des cas, alliances et partenariats visent les mêmes objectifs stratégiques que les acquisitions : regrouper des compétences ou des briques technologiques pour proposer une offre complète ou une offre nouvelle, atteindre une taille critique pour pouvoir être candidats à des marchés de sous-traitance, changer de rang dans un panel fournisseurs, remonter dans la chaîne de valeur, aborder un nouveau marché à l’international, etc.
Nous distinguerons ici, de manière très simple, l’alliance du partenariat : le partenariat se traduit par l’établissement de liens contractuels dans une certaine durée ; l’alliance se traduit par la création d’une personne morale nouvelle.
1. Des alliances, pourquoi ?
L’importance de ces rapprochements pour les PME peut être saisie à travers la situation du secteur de la mécanique. Comme l’explique Daniel Richet, directeur du développement du Cetim20, la mécanique est le premier secteur industriel de France en nombre d’entreprises et en nombre d’emplois : il compte 30 000 entreprises, dont 12 000 seulement sont des structures de plus de 10 salariés. Il irrigue toutes les grandes filières. Il peut être appréhendé soit par le métier de chaque entreprise (fonderie, usinage, etc.), soit par les marchés qu’elles servent (aéronautique, automobile, énergie, agro-alimentaire, etc.). La crise de 2009 a impacté violemment le secteur qui, globalement, a perdu 25 % de son chiffre d’affaires. Et ce sont bien évidemment les plus petits des sous-traitants qui ont le plus souffert. Parallèlement, les grands donneurs d’ordre ont commencé à rationaliser leurs panels de fournisseurs, exigeant de ces derniers qu’ils soient capables de les accompagner à l’international. Ce phénomène a créé une incitation à des regroupements en cascades.
La crise a donc servi de révélateur : un grand nombre de ces entreprises sont trop petites, trop souvent centrées sur un seul métier ou un seul marché, trop locales, insuffisamment intégrées. Pour assurer leur développement et leur pérennité, les PME mécaniciennes ne peuvent plus se contenter de répondre aux commandes, elles doivent adopter des stratégies proactives pour innover, ajouter de nouvelles cordes à leur arc, se renforcer dans la filière ou s’exfiltrer parfois de leur filière d’origine, et croître en partant de leur métier de base et de leur savoir technologique. Pendant dix ans, le programme Acamas piloté par la FIM21 avec le soutien opérationnel du Cetim a accompagné 1 300 PME de la mécanique dans leur évolution stratégique au sein des 18 régions partenaires du programme. Des dizaines de consultants ont été mobilisés pour faire entrer la réflexion stratégique dans les petites structures, aider les patrons à définir leurs domaines d’activité stratégiques, à monter en gamme, à anticiper pour rester dans le mouvement et, plus généralement, à s’ouvrir à des réseaux.
Les alliances interentreprises faisaient partie des leviers stratégiques identifiés par le programme pour parvenir à des métissages de technologies et de savoir-faire. Aux dires des consultants impliqués, l’alliance n’est pas, et de loin, la méthode la plus facile à mettre en œuvre, mais lorsqu’elle réussit, elle représente un accélérateur de croissance significatif, et même lorsqu’elle s’arrête – car les alliances sont fragiles – elle représente pour le chef d’entreprise une excellente école qui l’aura fait grandir. Selon Patrick Orlans, délégué régional du Cetim, l’alliance doit aussi être vue comme une pédagogie pour le dirigeant.
2. Des alliances souvent difficiles
Les alliances sont difficiles pour les PME, car il s’agit avant tout d’une histoire d’hommes (et de femmes) aux prises avec une dimension patrimoniale et concurrentielle, des egos, des psychologies, des rivalités. Comme l’explique joliment Patrick Orlans, il s’agit de « passer du tripal au tribal » , ou encore de l’indépendance à l’interdépendance.
« Comme l’a montré Walter Powell22, le réseau constitue une forme de coordination différente car les acteurs ne sont ni indépendants, ni dépendants, mais interdépendants les uns des autres. Ils sont engagés dans des transactions répétées et le succès de chacun dépend de la qualité du travail de tous les autres. »
Gilles Pernoud, un mouliste d’Oyonnax, s’est associé à deux autres moulistes pour créer une société de services commune, AGP Développement ; il pointe ces difficultés : « La création d’AGP est d’abord une “histoire d’hommes” : nous étions six autour de la table, deux par société, et nous avons dû apprendre à travailler ensemble. Travailler en commun n’est jamais évident pour des “Gaulois” qui ont toujours un peu de mal à s’entendre avec leurs voisins… C’était difficile aussi bien pour nous, les dirigeants, qui avions toujours peur que les autres entreprises nous prennent nos clients ou nos salariés, que pour nos collaborateurs, à qui nous demandions de travailler avec ceux qui, auparavant, étaient leurs concurrents. »
Pour aborder une alliance, encore faut-il que le chef d’entreprise ait déjà changé de « logiciel », en s’ouvrant sur l’extérieur, par exemple en participant à des clubs de rencontres entre chefs d’entreprise, à une union patronale ou à un syndicat professionnel. Tout doit être fait pour que le dirigeant « sorte de son bocal »23. Inciter à ce passage à l’acte était d’ailleurs l’une des finalités du programme Acamas de la FIM, mais aussi, par exemple, celle des clubs APM (association Progrès du management). Cette nouvelle disposition d’esprit est un facteur préalable à toute idée d’alliance, sans compter qu’elle favorise les rencontres réelles entre patrons ; la majorité des alliances entre PME sont des alliances locales, avec des établissements à moins de 100 kilomètres les uns des autres.
Une autre difficulté des alliances est la construction de la confiance entre les partenaires. La confiance est ce qui permet d’alléger les coûts de transaction d’un réseau. Dans son cours de stratégie d’entreprise à Mines ParisTech, Thierry Weil indique que la dynamique progressive de la confiance mobilise trois catégories : la confiance calculée, construite et postulée. « Le calcul rationnel du niveau de confiance qu’on peut accorder en fonction d’éléments objectifs s’appuie sur les événements passés [confiance calculée], on construit au présent de nouvelles raisons de faire confiance [confiance construite], enfin on anticipe sur les bénéfices d’une relation confiante en accordant plus de confiance qu’il ne semble “raisonnable” [confiance postulée]. »24
On parle aussi d’escalade vertueuse de la confiance. En pratique, la confiance va se construire sur la base du capital-réputation des partenaires (un actif essentiel à la confiance), des expériences passées de collaboration sur des périmètres plus étroits, ainsi que sur des garanties réciproques. Bien souvent, la présence d’un « tiers de confiance » facilitera le processus. Il faut donc trouver ces intermédiaires dans l’environnement de la PME, ce qui n’est pas toujours simple. Entamer le dialogue, le poursuivre, ouvrir ses comptes ou sa base clients ne sont pas des attitudes « naturelles » chez un patron de PME, qui navigue entre narcissisme et héroïsme, indépendance et isolement. Sans facilitateur pour accompagner le processus et aider à construire le périmètre de l’alliance, les idées de rapprochement s’enlisent. Sans compter que l’envie de « grossir » est loin d’être unanimement partagée, comme l’indiquait une étude de 2009 intitulée « Le syndrome de Peter Pan »25 consacrée aux patrons de PME.
3. Logiques additives, logiques d’intégration
Il existe dans la littérature académique de très nombreuses grilles de segmentation des coopérations interentreprises, définies comme « l’interaction plus ou moins étendue entre les activités de deux ou plusieurs entreprises juridiquement distinctes »26. Pour caractériser ces coopérations, nous retenons ici la grille à visée unificatrice proposée par les chercheurs Douard et Heitz, qui distingue logiques additives et logiques d’intégration27. Ce modèle n’est pas spécifique aux PME, mais il s’y adapte très bien.
La logique additive est considérée au sens de la réunion de moyens émanant des partenaires. Le résultat de cette mise en commun est profitable à chacun d’eux. Un réseau de producteurs au sein d’un territoire présentant une certaine homogénéité et qui se regroupent pour commercialiser leurs produits appartient à cette catégorie.
La logique d’intégration (ou de complémentarité) combine des actifs complémentaires. Ce qu’une entreprise apporte, l’autre n’en dispose pas en interne. On associe différentes phases d’un processus de production de valeur ajoutée, phases qui concourent de façon spécifique à l’obtention d’un résultat donné. Il y a renforcement de la chaîne de valeur de l’entreprise par la coordination de processus qui restent individualisés.
Par exemple, les entreprises Pain, Beurre et Confiture peuvent créer un site de commercialisation commun pour le petit-déjeuner (logique additive) ou se lancer sur le nouveau marché de la Tartine (logique intégrative)28.
À ces deux paramètres, les deux chercheurs ajoutent une troisième dimension-clé : la notion de spécificité des actifs créés par le réseau « au sens où le réseau permet l’émergence d’un actif matériel ou immatériel nouveau, résultant de l’interaction entre ses membres »29. Cet actif propre au réseau, et distinct des actifs propres à chacun des membres, peut être plus ou moins mis en correspondance avec une structure formelle (une joint-venture, par exemple) et peut être fort ou faible. L’importance de cet actif propre au réseau conditionne l’évolution dans le temps des réseaux et influence le degré de réversibilité des coopérations. Plus la spécificité des actifs propres au réseau est importante, plus la « barrière à la sortie » sera forte, induisant l’irréversibilité de la coopération.
L’articulation de ces deux dimensions (logique additive ou intégrative, actif fort ou faible) permet de construire une grille de lecture en quatre familles de réseaux : réseaux d’adjonction, réseaux heuristiques, réseaux transactionnels, réseaux d’orchestration. Nous donnerons pour chacune des familles un exemple issu de notre échantillon d’entreprises.
Les réseaux d’adjonction
Les réseaux d’adjonction sont représentés dans le quadrant inférieur gauche, à l’intersection des dimensions de faible spécificité des actifs du réseau et des logiques additives. Le résultat de la collaboration consiste en une réalisation conjointe par mise en commun de moyens, à laquelle aucun des partenaires pris isolément ne serait parvenu. Mais le niveau d’engagement reste très contrôlé, avec un cloisonnement permettant de protéger les savoir-faire spécifiques individuels, et la réversibilité du processus est possible à tout moment pour chaque partenaire à quelques coûts irrécouvrables près.
C’est le cas, par exemple, de ces trois entreprises mécaniciennes qui se sont alliées pour accompagner un important donneur d’ordre de la sidérurgie sur un contrat en Afrique dans le secteur pétrolier et partager les investissements nécessaires. Il s’agissait d’une alliance résultant essentiellement de l’incitation du donneur d’ordre30 qui souhaitait un seul répondant pour une offre globale. Ce fut l’opportunité de construire une réponse entre fournisseurs concurrents déjà présents et de structurer une stratégie collaborative pendant trois ans sur d’autres affaires.
Dans le domaine des équipements de chantiers pour le BTP, les dirigeants des sociétés Alphi, Sateco, Mills et Batiroc Protect ont décidé de se réunir sous l’entité du Pôle France Coffrage (PFC), forts de leurs valeurs partagées que sont l’innovation, la sécurité, la fabrication française et l’internationalisation. Leurs produits ne sont pas directement concurrents, même s’ils peuvent se chevaucher légèrement. À eux quatre, ils représentent 500 collaborateurs, un chiffre d’affaires de 100 millions d’euros et quarante brevets. Ils se sont associés pour « chasser en meute », et plus particulièrement pour mutualiser les coûts des salons internationaux. Au lieu de recueillir isolément 350 contacts sur un salon, ils en récupèrent collectivement 1 200 et les partagent. Alexandre Souvignet, PDG de Alphi, indique cependant : « Certains de nos commerciaux ont toutefois un peu de mal à adhérer à cette démarche. La valeur d’un commercial réside avant tout dans son carnet d’adresses, et il peut être réticent à le partager… Dans quelques semaines, nous organisons une opération de team building pour que les commerciaux des quatre entreprises se connaissent mieux et se familiarisent avec les innovations des différentes sociétés afin de pouvoir les signaler aux clients. » Une étape permettant à l’avenir le montage d’affaires communes qui marquerait le passage d’une logique additive à une logique intégrative. En attendant, au sein de ce collectif souple, chacun pèse de la même façon, en dépit du fait que les chiffres d’affaires des quatre partenaires sont très différents : 55 millions d’euros pour Sateco, 28 pour Mills, 20 pour Alphi et 2 pour Batiroc Protect. Les décisions se prennent en bonne intelligence en veillant à ne léser personne.
Les réseaux heuristiques
À l’intersection entre logiques additives et spécificité forte des actifs du réseau, les réseaux heuristiques correspondent à des situations dans lesquelles le degré d’engagement et d’influence réciproque des partenaires est fort. Le réseau développe un apprentissage spécifique important, source d’une spécificité forte des actifs du réseau. Ce type de coopération a vocation à construire des avantages concurrentiels à moyen et long terme. Un stade d’évolution ultérieur peut être une fusion ou acquisition suivant la force financière de l’un des partenaires et suivant le maintien ou non de l’équilibre entre les partenaires. Le risque est plus grand ici, en effet, de voir une appropriation des savoir-faire par un membre du réseau, modifiant l’équilibre et facilitant des évolutions du type fusion ou acquisition.
En 2000, à l’occasion d’une formation en cours du soir, une dizaine de moulistes de la vallée d’Oyonnax se demandent comment faire face à la concurrence asiatique. Après Taïwan, c’est désormais la Chine qui commence à proposer des moules beaucoup moins chers. À l’issue d’une année de réflexion, trois de ces dix entreprises décident d’unir leurs forces en se regroupant au sein d’une structure de services mutualisés baptisée AGP Développement. Ils ont, en effet, des préoccupations communes. La première est la nécessité de travailler sur les métiers de demain pour pouvoir offrir toujours plus de services à leurs clients et assurer la qualité que ceux-ci attendent. La seconde est de renouveler et renforcer leur démarche commerciale : ils décident d’embaucher un directeur commercial, ce dont chacun n’aurait pas eu les moyens au niveau de son entreprise, et de participer à des salons. La troisième est de mutualiser d’autres fonctions comme la comptabilité, les achats ou l’informatique. Enfin, ils pensent que la nouvelle structure leur permettra de prendre du recul et d’avoir une vision plus stratégique, tout en préservant l’autonomie de chaque société. Après avoir envisagé un GIE, solution la plus répandue pour ce type de projet, ils décident d’aller d’emblée plus loin dans leur engagement, en créant une SAS, détenue à 33 % par chacune des trois sociétés.
Entre 2000 et aujourd’hui, 50 % des moulistes français ont disparu, alors que ces sociétés ont continué à se développer. Comme le raconte Gilles Pernoud, l’un des trois partenaires, « Quand nous avons créé AGP Développement, nos trois sociétés employaient au total 70 salariés pour un chiffre d’affaires de 7 millions d’euros. Aujourd’hui, l’effectif [cumulé] est de 200 salariés […]. Nous réalisons à nous trois un chiffre d’affaires de 24 millions d’euros, ce qui fait d’AGP le plus gros mouliste français. » Le fait d’être réunies au sein d’AGP permet aux trois entités d’obtenir des marchés auxquels elles n’auraient jamais pu prétendre séparément, les clients étant de plus en plus sensibles à la taille de leurs fournisseurs. Le budget d’AGP est de 350 000 euros, ce qui représente un gros investissement pour chacune des sociétés, mais le bénéfice qu’elles en retirent est largement supérieur à la dépense. La sortie de la SAS serait en revanche coûteuse pour chacun des partenaires. Il aura cependant fallu 15 ans pour arriver à ce résultat.
À la question « avez-vous jamais pensé à fusionner vos trois entreprises ? », Gilles Pernoud répond : « Nous l’avons envisagé mais nous y avons renoncé car nous aurions trop peur d’y perdre en souplesse. Aujourd’hui, si l’un d’entre nous a envie de se développer dans telle ou telle direction, il le fait. Si nous fusionnons, il faudra qu’il obtienne l’accord des deux autres, ce qui prendra forcément du temps et le freinera. […] Il faut que chacun reste libre de son propre développement. »
Les réseaux transactionnels
À l’intersection des logiques d’intégration et de faible spécificité des actifs propres au réseau, les réseaux transactionnels privilégient des relations d’échanges entre partenaires sur un marché, permettant de renforcer une part de la chaîne de valeur de la firme. De tels réseaux se présentent essentiellement comme une gamme de savoir-faire ou de ressources mobilisables suivant la nature du problème à résoudre ou de l’activité à produire. La spécificité des actifs propres au réseau dans sa dimension collective reste faible. Dans l’exemple qui suit, il s’agissait pour cette entreprise spécialisée dans le petit équipement et les accessoires pour le transport collectif et l’aéronautique de créer une capacité de « systémier », mobilisant les savoirs d’un réseau élargi, le réseau fonctionnant avec des joueurs récurrents et d’autres sollicités ponctuellement.
Lorsqu’il reprend cette entreprise en grande difficulté par LBO, le repreneur se fixe un objectif ambitieux et décide d’innover sur tous les fronts. Il procède à une véritable révolution du modèle d’affaire de l’entreprise, passant du statut de fournisseur de composants à celui de « systémier », c’est-à-dire de fournisseur de sous-ensembles.
Pour devenir un systémier, l’entreprise devait se montrer capable de fédérer des partenaires et de combiner des technologies internes et externes, car les moyens financiers qu’elle pouvait consacrer à l’innovation étaient limités. Encore aujourd’hui, face à des concurrents fournisseurs de rang 1 de l’aéronautique, elle doit contracter avec des partenaires capables de lui apporter les « briques » de savoir-faire qui lui manquent, et qu’elle ne pourrait développer qu’au prix de plusieurs années d’efforts. L’entreprise a donc fait le choix de conclure des partenariats, mais seulement avec des sociétés de taille similaire à la sienne, afin que le partage des risques et des bénéfices puisse reposer sur un rapport de force équilibré. Elle veille à ce que sa stratégie et celle de ses partenaires soient convergentes, par exemple pour aborder de nouveaux marchés. Comme l’explique le directeur en charge de la division aéronautique, « Une petite entreprise d’électronique ou un éditeur de logiciel de dix ou vingt salariés sait parfaitement que, seul, il n’a pas les moyens d’aller frapper à la porte de Boeing ou de Cessna. De notre côté, sans les briques technologiques complémentaires qu’ils nous fournissent, nous ne pourrions pas non plus nous présenter chez Boeing, ATR ou Embraer. […] Lorsque nous concluons un partenariat, c’est sous la forme d’un contrat de partage des risques et des bénéfices. Chacun apporte ses ressources humaines, ses compétences, mais aussi une contribution financière en fonction de sa participation au programme. En cas de réussite, les bénéfices sont partagés dans les mêmes proportions que les risques. Il en va de même pour les pertes en cas d’échec. Tout se fait dans la cohérence et dans la transparence. […] Nos partenaires sont généralement des entreprises françaises ou européennes, plus rarement américaines ou japonaises. Ces partenariats nous apportent également une ouverture culturelle et nous permettent d’être mieux armés pour aborder nos clients internationaux. »
Les liens créés sont purement contractuels, n’impliquant aucun problème de gouvernance. C’est grâce à cette logique que l’entreprise a pu créer des systèmes embarqués intelligents mettant en jeu des compétences multiples issues d’entreprises spécialisées dans différents secteurs de pointe. « Nous travaillons avec une petite société spécialisée dans les nanomatériaux qui compte seulement trois salariés. Notre plus gros partenaire fabrique des cartes électroniques et emploie environ cent cinquante personnes. Naturellement, tous les salariés de ces entreprises ne travaillent pas sur nos projets. »
Les réseaux d’orchestration
Situé à la croisée des logiques d’intégration et de spécificité forte des actifs du réseau, le réseau d’orchestration s’apparente au réseau transactionnel, mais apparaît globalement fondé sur un niveau d’intégration et de stabilité plus significatif.
En 2012, Marc Sevestre, PDG de Cap Group, s’interroge sur les moyens de développer son activité de spécialiste de la sous-traitance mécanique (usinage et travail sur les profilés métalliques), située dans le Calvados31. Il réalise alors un diagnostic stratégique complet avec un consultant dans le cadre du programme Acamas du Cetim (voir ci-dessus page 29). À l’issue de celui-ci, il ressent le besoin de s’allier avec des partenaires pour pouvoir proposer des offres complètes à ses clients de l’aéronautique. Il fait alors appel au réseau régional Normandie Aerospace pour présélectionner des partenaires potentiels. Après plusieurs échanges et groupes de travail, l’alliance Acticap Industries, sous forme de SAS dont chacun possède 33 % des parts, est créée avec deux d’entre eux : l’ingénieriste Activetech spécialisé en plasturgie, et l’intégrateur Sicap Electronique. « Ce regroupement de compétences nous permet de proposer à nos clients un produit dans son intégralité, du développement jusqu’à la production. » Une vingtaine de projets ont ainsi été traités par Acticap, comme une tablette pour un siège d’avion combinant mécanique et plasturgie, ou encore un support de vidéoprojecteur en opération de combat pour Airbus. À chaque nouvel appel d’offres, les trois chefs d’entreprise se concertent et forment une équipe projet adaptée au besoin identifié.Dans ce type de configuration, les liens établis tendent à devenir de type serré, parce que l’orchestration même des complémentarités requiert un savoir-faire spécifique qui devient un actif spécifique du réseau.
Au terme de ce panorama des logiques qui sous-tendent les partenariats ou alliances, nous allons nous intéresser de plus près à la « cuisine » d’une alliance, à partir du cas d’AGP Développement, afin d’en saisir les étapes de construction et d’en déceler toutes les chausse-trappes.
4. La « cuisine » d’une alliance : le cas d’AGP Développement
AGP Développement est un cas de figure intéressant pour rendre compte des mécanismes de construction des alliances entre PME. Il permet d’illustrer les choix offerts aux partenaires, les points de bifurcation de l’alliance, et la manière dont, à chaque étape, les partenaires négocient les difficultés pour parvenir à les dépasser. Le cas permet de mettre au jour, en creux, les pierres d’achoppement qui peuvent causer la mortalité des alliances.
Nous avons vu ci-dessus (page 45) les mobiles et circonstances qui ont conduit trois moulistes d’Oyonnax à conclure une alliance sous la forme d’une SAS dont le capital est réparti à 33 % chacun. Approfondissons.
Faisabilité. Au départ, il y avait dix moulistes, potentiellement candidats à l’alliance. Il est intéressant d’examiner les raisons pour lesquelles ils ne sont en définitive pas entrés dans le groupement. Cela permet de faire émerger a contrario les conditions de compatibilité des partenaires d’une alliance. Certains étaient intéressés par l’idée, mais la situation économique n’était pas aussi tendue qu’aujourd’hui et ils ne voyaient pas d’urgence à se regrouper. Quelques-uns voulaient bien s’associer si cela devait leur permettre de trouver de nouveaux contrats, mais ils étaient beaucoup plus réticents à l’idée de chercher des synergies pour gagner en productivité ou encore de construire des usines communes. L’un des membres du groupe était d’accord pour partager les commandes, mais pas les résultats. Un autre, qui était à la fois mouliste et injecteur, craignait de se retrouver en porte-à-faux dans un groupement de moulistes. Nombreux aussi étaient ceux qui craignaient de se faire « piquer » leurs salariés ou leurs marchés (absence de confiance). On voit donc que l’un des pré-requis d’une alliance relève de l’évidence : il faut que les dirigeants soient convaincus de l’intérêt de travailler en collectif et qu’ils soient prêts à se faire confiance – ce qui n’exclut pas bien sûr de rechercher quelques garanties. Beaucoup d’alliances se révèlent mort-nées, faute d’avoir « creusé » ce point si « évident ».
Stratégie. Nos trois moulistes restants étaient donc en concurrence les uns avec les autres. Ce qui leur a permis de travailler ensemble (logique additive), c’est l’iden- tification précise de leurs compétences et savoir-faire qui, derrière la concurrence apparente, a permis de faire émerger des complémentarités. Il s’agit là d’une phase essentielle, préalable à l’alliance, que les consultants nomment « définition des DAS » (domaines d’activités stratégiques) ou encore construction du « périmètre » de l’alliance. Cette étape permet d’identifier les complémentarités mais aussi les zones de recouvrement, et de prévoir comment gérer ces dernières.
En l’occurrence, la société JP Grosfilley est experte dans les pièces techniques multi-matières et multi-composants. Collomb Mécanique est spécialisée dans la fabrication d’emballages, notamment dans le domaine alimentaire, avec des techniques très performantes comme l’IML (in-mould labelling, étiquetage dans le moule), ou encore la réalisation d’emballages avec des parois très minces ou à très grande cadence. Quant au groupe Georges Pernoud, son cœur de métier consiste à fabriquer des moules d’injection mono-matière pour permettre de produire en plastique des pièces auparavant réalisées en métal, comme par exemple des pièces sous capot moteur, des rétroviseurs, des trappes à carburants ou encore des poignées de portes pour l’automobile.
Gouvernance . L’alliance est souvent confrontée à des changements dans la composition des partenaires. Il arrive fréquemment qu’elle succombe à cette étape. Le « A » de AGP faisait initialement référence à une autre société, Antisa, qui a quitté le groupement au bout de deux ans. L’alliance aurait donc pu s’arrêter dès cette époque, si Collomb n’était venu la remplacer. Un peu plus de dix ans après, le fondateur de Grosfilley a pris sa retraite et cherché à revendre son entreprise. Les deux autres ont envisagé de la racheter, mais y ont renoncé, car ils n’auraient été plus que deux. Or pour les fondateurs, il était essentiel que le nombre de partenaires soit impair pour permettre de dégager une majorité lors des votes. Ils ont donc préféré aider Grosfilley à trouver un repreneur qui accepte de s’intégrer au fonctionnement d’AGP. Le rachat de l’entreprise a d’ailleurs été facilité par l’existence du Groupe, qui a rassuré le repreneur.
Direction . Le consultant qui avait piloté la structuration du groupement avait suggéré un comité de direction bimensuel et une direction tournante avec rotation tous les six mois. Les trois dirigeants s’y sont essayés, mais cela a été un échec. Dans la pratique, ils étaient d’accord sur ce qu’il fallait faire, mais ensuite chacun retournait dans son entreprise, était happé par le quotidien et rien n’avançait. Cela les a conduits à recruter un nouveau consultant qui est devenu directeur à temps partiel de la SAS et qui était intéressé financièrement au développement du groupe. Il avait pour mission de « penser AGP » et de veiller à ce que la stratégie définie soit effectivement mise en œuvre. Il devait aussi s’assurer en permanence que chacun des partenaires progresse, même s’il n’était pas nécessaire que ce soit forcément au même rythme : tout le monde devait être gagnant d’une façon ou d’une autre, sinon le groupement risquait d’éclater. « Un réseau sera fondé sur la volonté partagée de respecter une équité entre les participants. »32
La désignation d’un directeur a eu également l’avantage d’éviter que le président de la SAS ne bénéficie d’un pouvoir de décision supérieur à celui des deux autres. Après dix ans, un nouveau directeur général a été nommé… à plein temps.
Pacte. En 2005, soit quatre ans après le début des opérations, l’alliance s’est dotée d’une charte de fonctionnement. Celle-ci fixe la philosophie de l’organisation, ainsi que les règles qui permettent de répartir les dépenses et les marchés entre les partenaires.
La charte définit les spécificités de chacune des trois sociétés, en fonction desquelles les marchés leur sont attribués de façon prioritaire. Par exemple, si le groupe Pernoud est consulté pour une pièce bimatière, il sous-traite le marché à Grosfilley qui s’engage à respecter les conditions de vente négociées par Pernoud. Si Grosfilley ne peut pas prendre la commande, Pernoud a le droit de la réaliser lui-même. Chaque fois que l’attribution d’un marché est sujette à discussion, la question est abordée en comité de direction et une nouvelle règle est établie pour que la conduite à tenir soit bien claire pour les collaborateurs des trois entreprises. L’objectif est de trouver des solutions pour que, dans tous les cas, le marché reste au sein d’AGP plutôt que de partir à la concurrence. Pour la répartition des dépenses, par exemple dans le cas du directeur commercial, il est payé au prorata du temps qu’il consacre à chaque société, et cette répartition fait l’objet d’une convention. Lors de la crise de 2008, alors que chacune des entreprises perdait 30 à 40 % de son volume d’affaires, la solidarité a joué à plein : dès que l’un recevait une commande, il partageait avec les deux autres pour que tous puissent survivre.
Organisation et mise en commun. C’est à partir de 2005 que l’activité de l’alliance s’est véritablement structurée avec la mise en place de politiques commerciales à trois ans et des objectifs de chiffre d’affaires. Un seul commercial a été dévolu au suivi de chaque client partagé, et les commerciaux se réunissent chaque semaine pour faire le point sur les affaires et les devis en cours. Les trois entreprises ont créé des commissions communes sur des sujets comme les achats, l’innovation ou les systèmes d’information. La commission Innovation réunit les responsables des bureaux d’études ; il n’a pas été facile d’inciter les ingénieurs à partager leurs savoirs, mais cela a permis au groupement de faire un grand bond en avant. Désormais, ils participent à des projets de recherche financés par le FUI, par la région ou l’Europe. Les trois entreprises ont également harmonisé leurs grilles de salaires sur la totalité des postes du groupe, car leurs salariés se parlent et des écarts de salaires trop importants auraient représenté un terrain de rivalités et empêché les collaborations. Elles se sont dotées d’un ERP commun d’une taille et d’un prix adaptés à des PME, qui permet de faire communiquer entre eux les systèmes de CAO, GPAO ou CRM. Cela a permis de gagner environ 38 % de temps sur la chaîne numérique, en faisant l’économie de nombreuses opérations de transfert de données et de conversion de formats. Les trois entreprises ont obtenu la certification ISO 9001 en 2005 et sont également certifiées par le Fraunhofer IPT (Institut für Produktionstechnologie) pour l’Allemagne. Elles ont commencé à se développer à l’international vers l’Allemagne, la Slovaquie, la Chine, l’Inde et les États-Unis : aujourd’hui, les États-Unis représentent 30 % du chiffre d’affaires de l’alliance.
Respect. Aujourd’hui, au bout de quinze ans, l’effectif total cumulé est de 200 salariés : 30 chez Collomb, 50 chez Grosfilley, 100 chez Georges Pernoud, et 20 pour AGP. La répartition révèle que les trois entreprises ne se développent pas à la même vitesse. Ce n’est pas un problème en soi. Elles ne le souhaitent pas forcément ou ne le peuvent pas. Certains projets intéressent les uns, mais pas les autres. Pernoud envisage, par exemple, de racheter une société aux États-Unis, mais Collomb n’est pas intéressé et Grosfilley préfèrerait commencer par une joint-venture. Toujours aux États-Unis, l’un des bureaux commerciaux est dédié au marché médical et appartient à Grosfilley, l’autre dépend du groupe Georges Pernoud et se consacre à l’automobile. L’important semble être de respecter le rythme de développement de chaque entreprise et la volonté de chaque dirigeant, en gardant l’idée de s’informer mutuellement sur les avancées de chacun et de ne mutualiser que ce qui semble offrir un intérêt pour les trois sociétés. Chacun doit rester libre de son propre développement.
***
À la différence de l’approche vertueuse et patiente d’AGP Développement, les alliances entre PME connaissent un taux de mortalité élevé. Interrogés à ce sujet33, Daniel Richet et Patrick Orlans du Cetim ont passé en revue quelques causes d’échec des alliances montées à la suite du programme Acamas de la FIM : individualisme et manque de motivation ou d’implication de certains chefs d’entreprise, entraînant différends et brouilles ; absence de vision stratégique partagée entre dirigeants, souvent par manque de travail en amont sur le positionnement et les performances attendues de l’alliance ; trop grand nombre d’entreprises participant à l’alliance ou l’effet « auberge espagnole » ; décalage entre objectifs court terme et long terme, manque de négociation dans la durée ou de conciliation des intérêts de tous, suscitant une méfiance difficile à combler ; cannibalisation et confusion entre les activités existantes des partenaires et celles de l’alliance, etc. Autant d’histoires singulières que de parcours d’alliances. Elles indiquent néanmoins que l’alliance durable en tant qu’étape possible de développement des entreprises est une voie porteuse mais aussi passablement escarpée.
- 20. Centre technique des industries mécaniques
- 21. Fédération des industries mécaniques.
- 22. W. W. Powell, 1990, «Neither Market nor Hierarchy: Network Forms of Organization», Research on Organizational Behavior, 12, (1990), 295-336. Cité in Weil Thierry, Stratégie d’entreprise, Presses des Mines, 2008, p. 52.
- 23. Dans son rapport Industrie du futur: du système technique 4.0 au système social (décembre 2017), l’Académie des Technologies insiste sur le préalable de l’ouverture du chef d’entreprise pour tout engagement dans le changement: «Mais d’autres paramètres entrent en ligne de compte comme l’ouverture de l’entreprise (de son dirigeant) au monde extérieur, à son écosystème où le partage ou la mutualisation de compétences est possible, aux laboratoires de recherche, etc. », p. 59.
- 24. Weil Thierry, Stratégie d’entreprise, Presses des Mines, 2008, p. 178-184.
- 25. Bertrand Benjamin, Bodenez Philippe, Hans Etienne, «Le Patron de PME, ou le syndrome de Peter Pan», 2009, https://www.ecole.org/fr/seance/810-le-patron-de-pme-ou-le-syndrome-de-peter-pan
- 26. Douard Jean-Pierre, Heitz Michèle, « Une lecture des réseaux d’entreprises : prise en compte des formes et des évolutions », Revue française de gestion, 2003/5, n°146, p. 23-41.
- 27. Ibid.
- 28. Nous empruntons cet exemple parlant à Weil Thierry, op. cit.
- 29. Ibid.
- 30. Cet exemple nous a été fourni par Daniel Richet, directeur du développement, et Patrick Orlans, délégué régional, du Cetim.
- 31. Exemple tiré de Cetim Infos n°238, juin 2017.
- 32. Weil Thierry, op. cit. p. 171.
- 33. Entretien avec l’auteur.
Conclusion
Le constat est sans appel : les ETI, un pilier de notre économie, sont trop peu nombreuses. Nous identifions dans cet ouvrage deux accélérateurs de croissance, le build-up et les alliances, pouvant être à l’origine de la transformation des PME en ETI.
Le build-up est une forme de stratégie de croissance externe très soutenue. Il peut être piloté par un chef d’entreprise, souvent de type ambitieux, ou par un fonds de capital-investissement, et repose sur une vision stratégique de long terme. Il peut répondre à différents objectifs stratégiques – atteindre une taille critique, s’internationaliser, se diversifier, se repositionner dans la chaîne de valeur en acquérant des technologies et des compétences – et s’accompagne souvent d’une transformation profonde de l’entreprise, au service de la construction d’un groupe pérenne. Qu’il s’agisse de l’identification d’entreprises-cibles porteuses de synergies ou de transformations organisationnelles associées au changement d’échelle de l’entreprise, les défis liés au build-up sont nombreux. En outre, les acquisitions nécessitent souvent le recours à un fonds de capital-investissement, ce qui peut être perçu comme un risque de perte d’autonomie stratégique et opérationnelle pour un dirigeant. Si le build-up représente une manière efficace de croître rapidement, ses contraintes dissuadent de nombreux chefs d’entreprises de sauter le pas.
Les alliances et partenariats constituent des alternatives intéressantes aux stratégies de croissance externe, en particulier pour les dirigeants de PME disposant de peu de marges de manœuvre sur le plan financier. Dans le cas des alliances, là encore, la tâche est immense. Partager une vision commune, avoir le sens du compromis, faire confiance… Les témoignages inspirants contenus dans cette note livrent certaines clefs du succès de ces opérations de croissance. Ils décrivent une « cuisine » exigeante, complexe, voire mystérieuse : tout un art.
Bibliographie
« Stratégie PME : Révélateur d’avenir », Cetim, Région Rhône-Alpes.
Bertrand Benjamin, Bodénez Philippe, Hans Étienne, « Le Patron de PME, ou le syndrome de Peter Pan », École de Paris du management, 2009.
Cahier Marie-Laure, Toubal Louisa, Paroles d’ETI : les entreprises de taille intermédiaires à la conquête de la croissance , La Fabrique de l’industrie, Presses des Mines, 2015.
Cahier Marie-Laure, Charlet Vincent, Rebondir et se réiventer : la résilience des ETI industrielles , La Fabrique de l’industrie, Presses des Mines, 2017.
Douard Jean-Pierre, Heitz Michèle, « Une lecture des réseaux d’entreprises : prise en compte des formes et des évolutions », Revue française de gestion, 2003/5, n°146, p. 23-41.
Glachant Jérôme, Lorenzi Jean-Hervé, Trainar Philippe, « Private equity et capitalisme français », Rapport, La Documentation française, 2008.
Harlé Emmanuel , « Marier stratégie et création de valeur : le build up », Vie et sciences de l’entreprise, 2011/1, n°187, p. 115-118.
Hossepied Luc, La course à l’innovation : la saga d’Antonio Molina , Ateliers Henry Dougier, 2017.
Marchesnay Michel, « La PME : une gestion spécifique », é conomie rurale, 1991, p. 11-17.
Weil Thierry, Stratégie d’entreprise , Presses des Mines, 2008.
Marie-Laure Cahier et Philippe Frocrain, Accélérateurs de croissance pour PME : buil-up et alliances, Paris, Presses des Mines, 2018.
ISBN : 978-2-35671-542-5
ISSN : 2495-1706
© Presses des Mines – Transvalor, 2018
60, boulevard Saint-Michel – 75272 Paris Cedex 06 – France presses@mines-paristech.fr
www.pressesdesmines.com
© La Fabrique de l’industrie
81, boulevard Saint-Michel -75005 Paris – France info@la-fabrique.fr
www.la-fabrique.fr