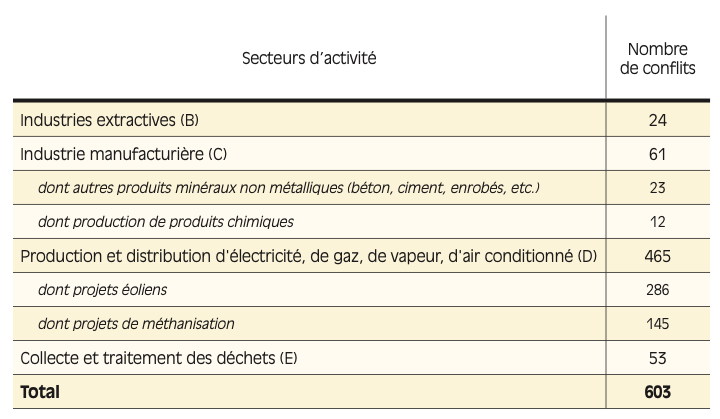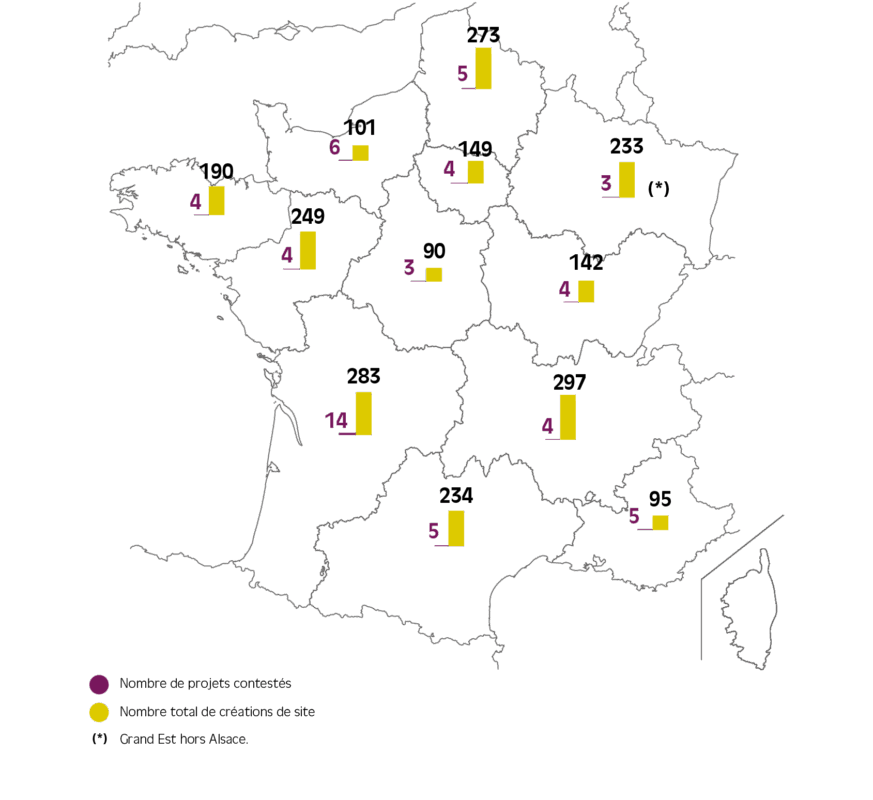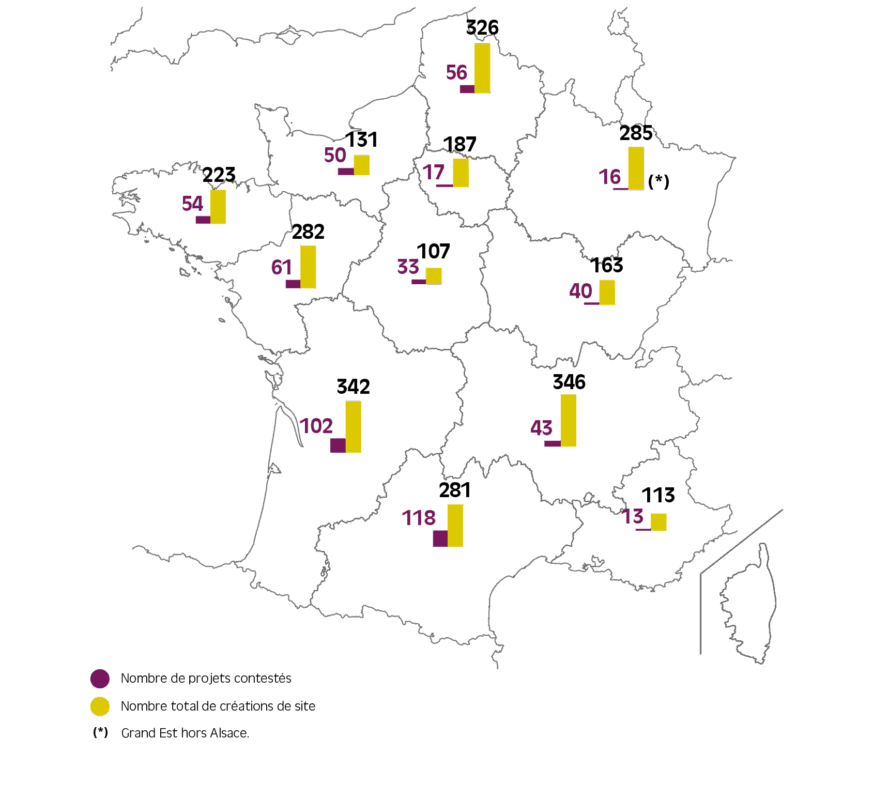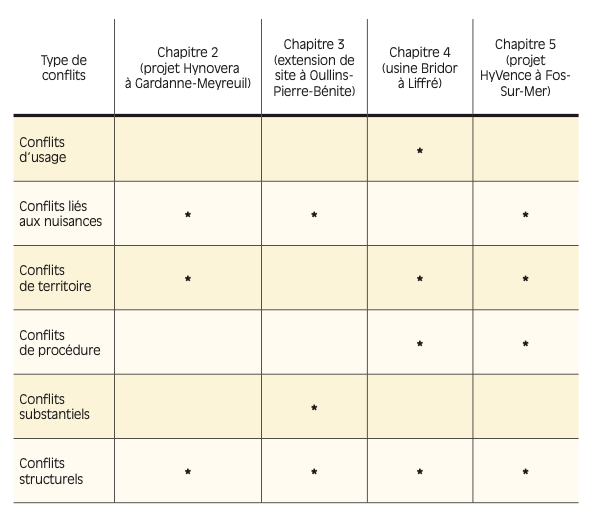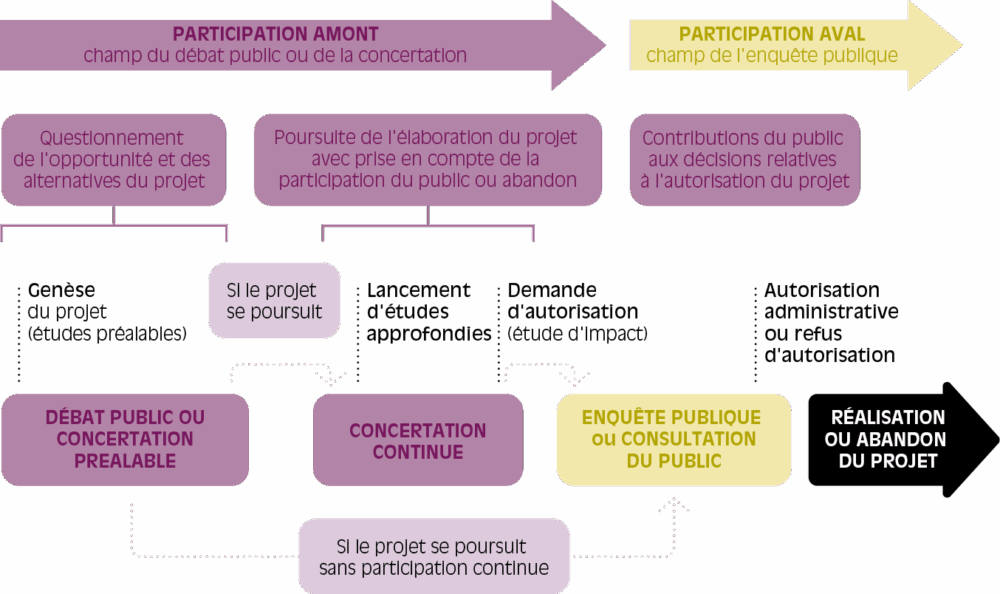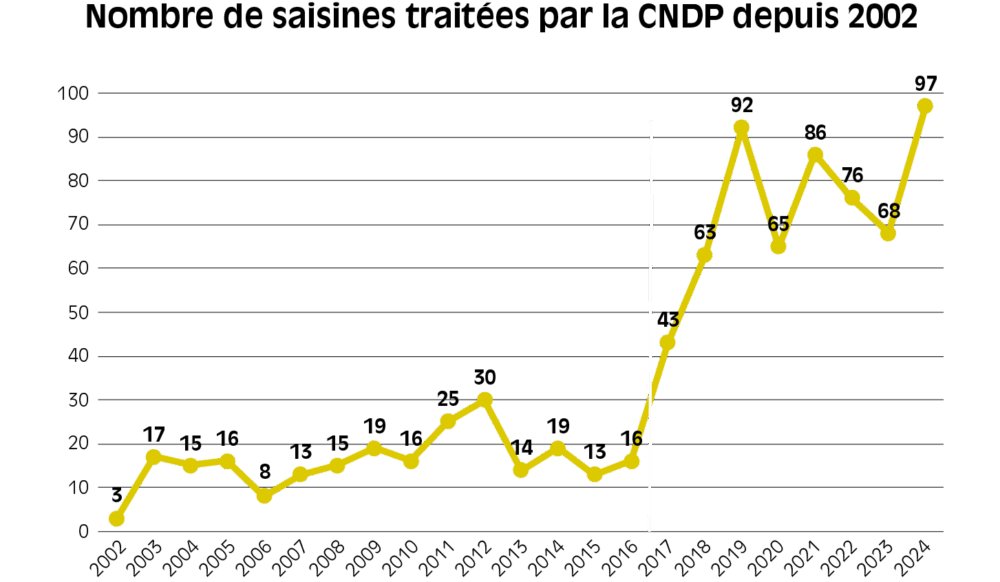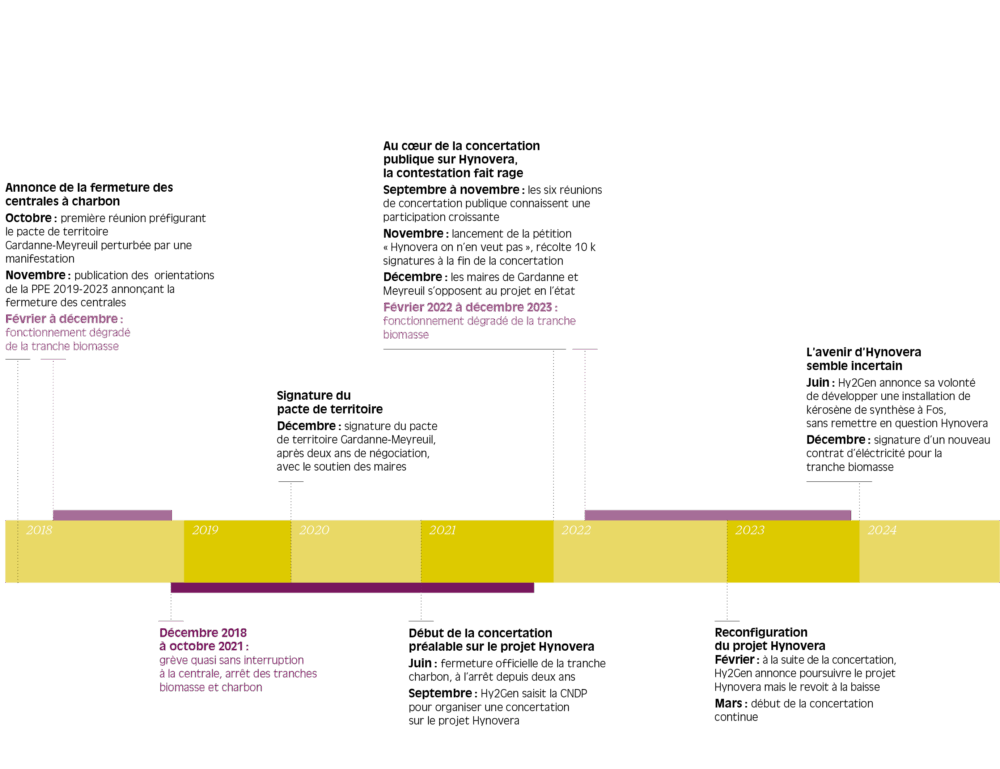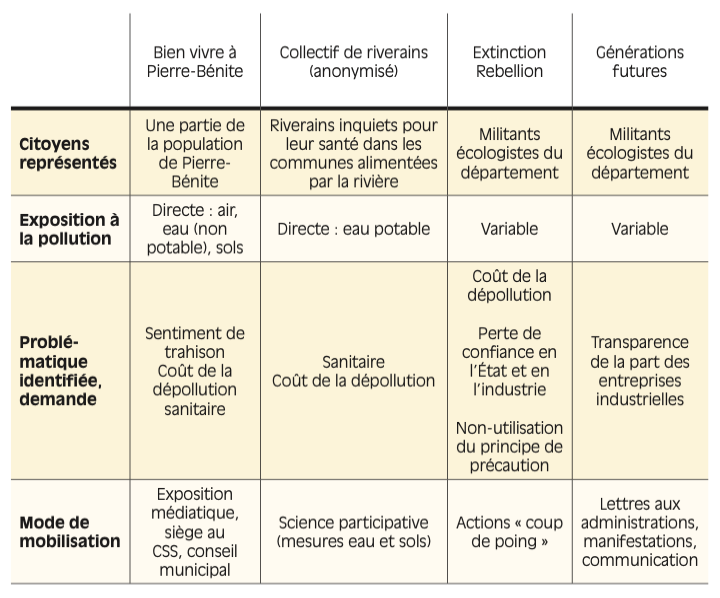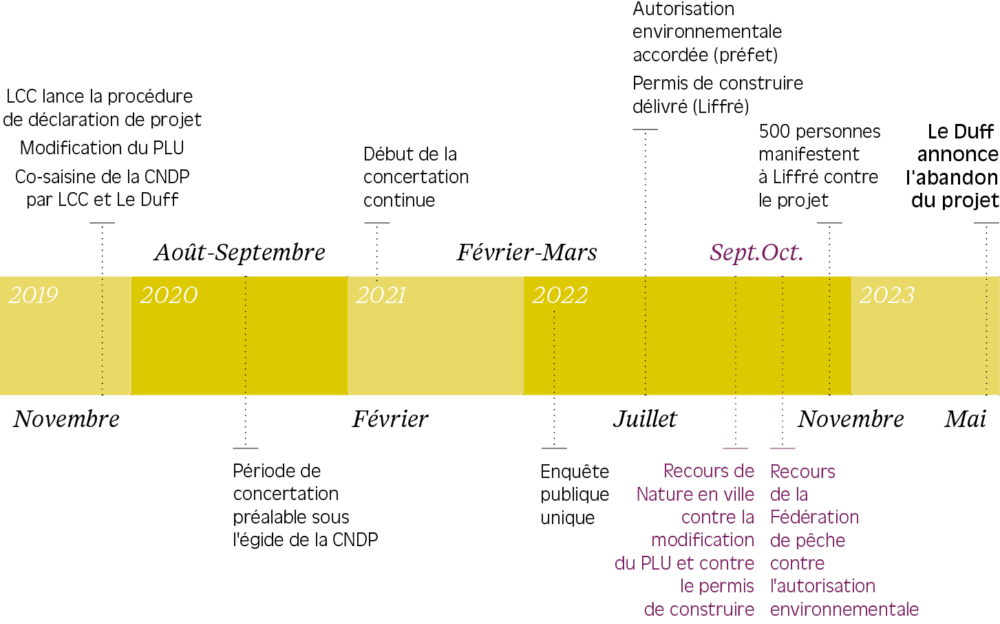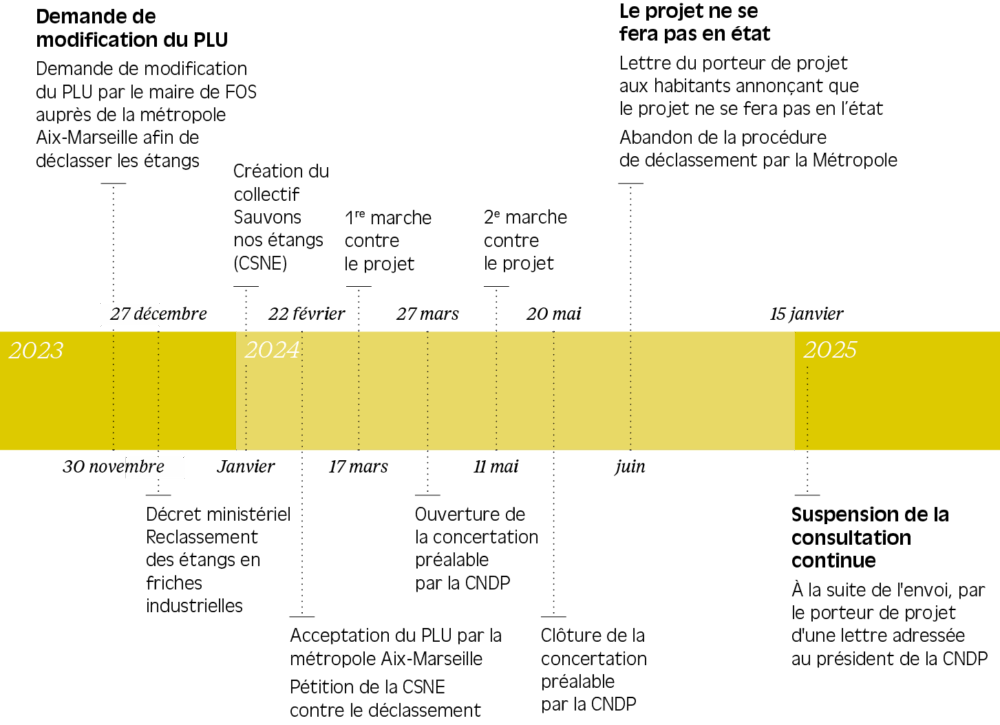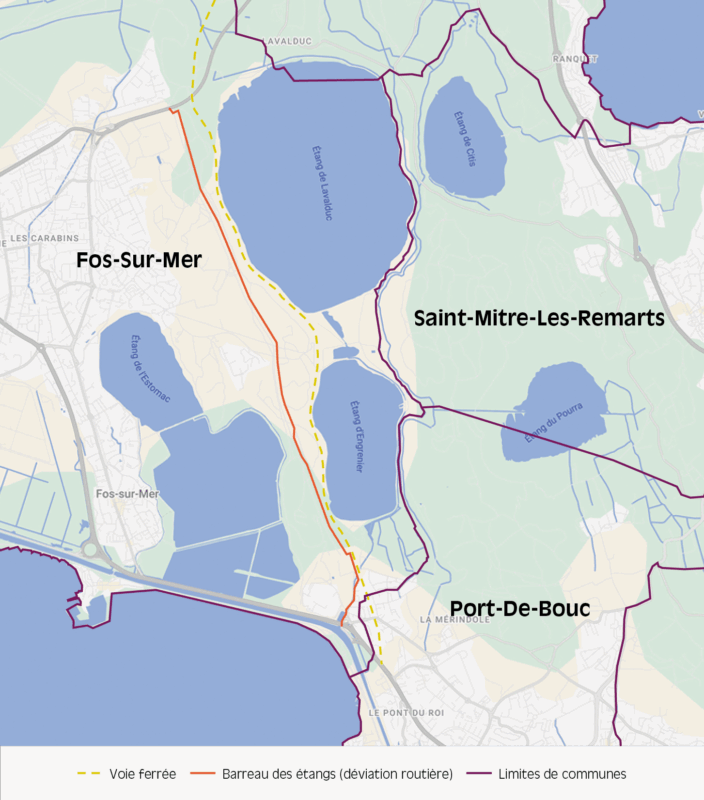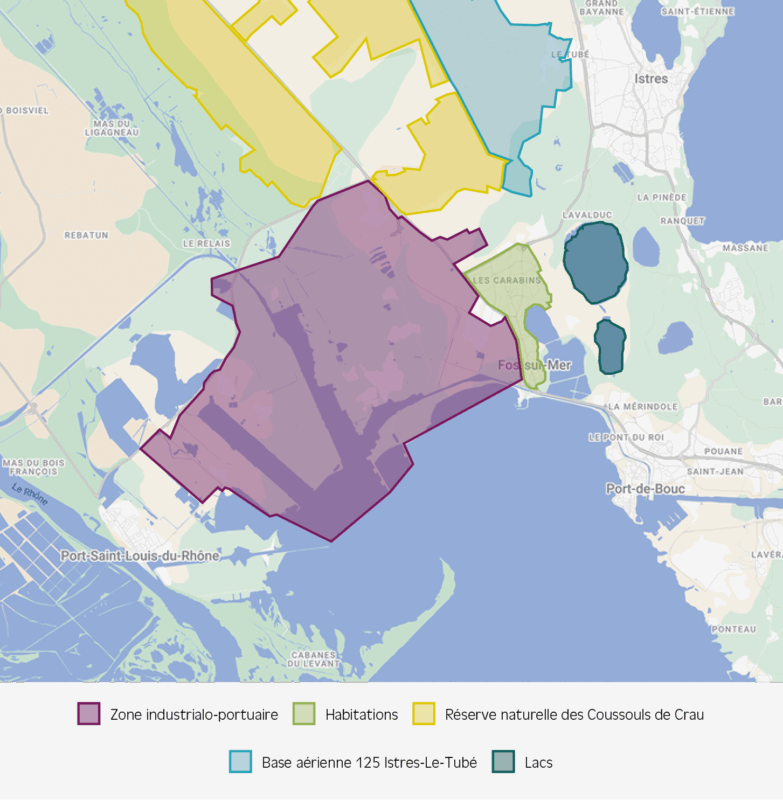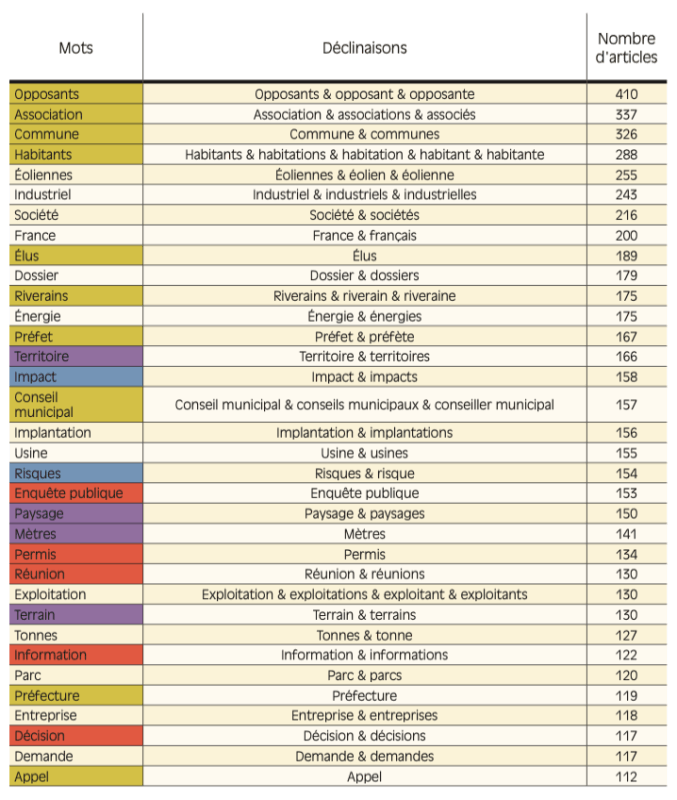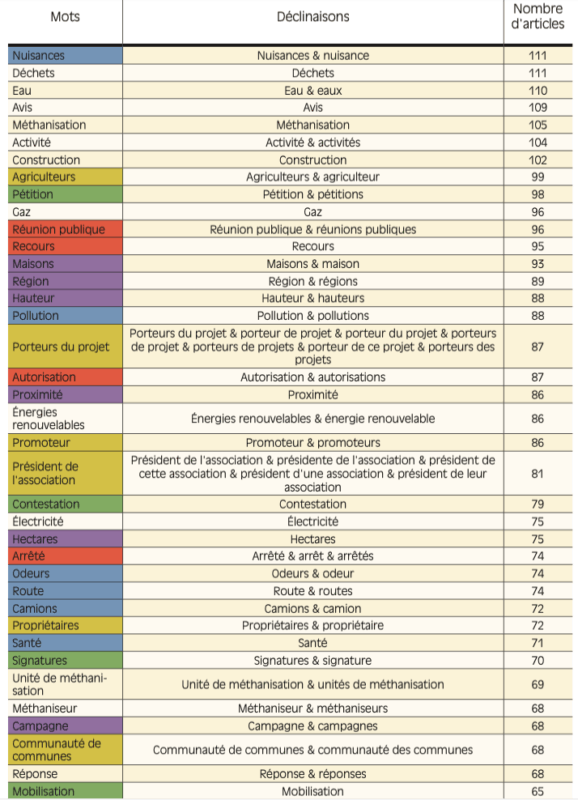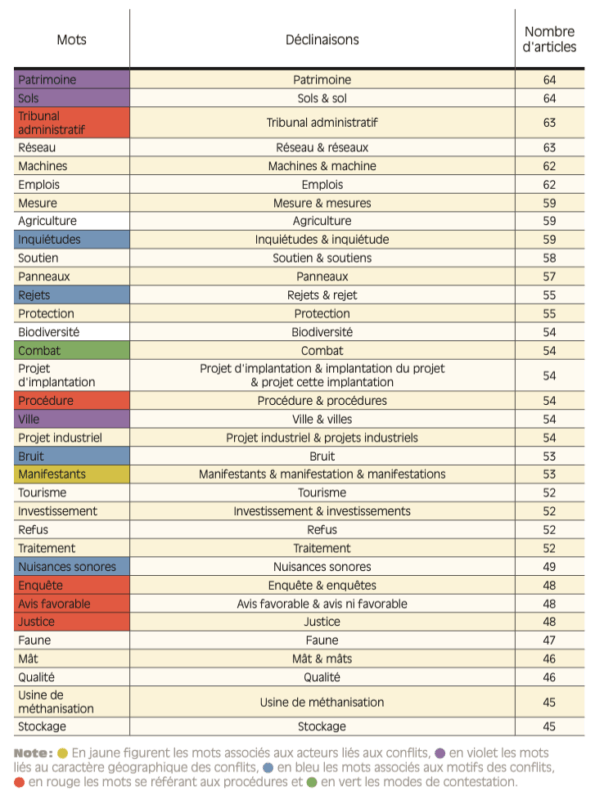Industrie et habitants, une équation insoluble ?

En tête – Préface
Cette note de La Fabrique de l’industrie traite d’un constat paradoxal important pour la réindustrialisation de la France : comment se fait-il que, Cette note de La Fabrique de l’industrie traite régulièrement, certains projets d’implantation ou d’extension de sites industriels suscitent une vive contestation locale au point d’être abandonnés par leurs promoteurs si, par ailleurs, les Français se déclarent majoritairement favorables à la réindustrialisation ?
Comment comprendre ce paradoxe ? La France veut se réindustrialiser, et ses citoyens l’affirment haut et fort : l’industrie est perçue comme un pilier de souveraineté, d’innovation et d’emplois. Car les faits sont là : l’image de l’industrie s’améliore. Dopée par la prise de conscience post-Covid de l’importance de la souveraineté, sa perception a bondi de + 13 points depuis 2019 (Baromètre Ipsos pour OPCO 2i). Elle n’est plus vue comme un vestige du passé mais comme une nécessité. Près de 8 Français sur 10 la considéraient d’ailleurs comme un secteur d’avenir (Ifop pour l’Observatoire Arts & Métiers 2024), un sentiment partagé par les jeunes (18-25 ans) qui l’associent à l’innovation (68 %) et à sa contribution économique (60 %) (Usine Nouvelle, 2025).
La réindustrialisation se joue évidemment sur les investissements actuellement en panne et sur la structuration des filières industrielles, et aussi – et peut être surtout – sur la bataille culturelle : montrer l’industrie telle qu’elle est vraiment pour redonner envie et attirer les talents qui manquent aujourd’hui et manqueront demain, dans un contexte démographique très défavorable.
Cette bataille culturelle se joue aussi sur le terrain, car certains projets d’implantation ou d’extension d’usines suscitent une opposition si vive qu’ils sont abandonnés. Les intérêts en jeu dépassent très largement la construction d’une usine : les très nombreuses parties prenantes, parmi lesquelles figurent notamment les habitants à proximité ont des postures mobilisant des perceptions diversifiées sur des enjeux de transition, de société, d’économie souhaitable, de démocratie… Ce contraste nous oblige à poser une question essentielle : que signifie « accepter l’industrie » aujourd’hui ?
Nous devons changer de paradigme. L’industrie ne peut plus être pensée comme une infrastructure isolée, mais comme un projet de société, ancré dans la vie des territoires, coconstruit avec leurs acteurs, porteur de sens et de bénéfices partagés. Ce n’est pas seulement une question d’usines, mais de vision collective : inventer une industrie qui inspire, qui respecte, qui relie.
L’acceptabilité ne se décrète pas. Elle se construit dans la proximité, là où les impacts sont tangibles et où les attentes sont fortes. Les territoires ne sont pas des espaces vides : ils portent une histoire, une identité, des aspirations. Chaque projet industriel vient s’inscrire dans ce tissu vivant, et c’est là que se joue la confiance, avec des modes de gouvernance décentralisée.
Cette note invite à changer de regard : la contestation n’est pas un refus de l’industrie, mais souvent l’expression d’un besoin de dialogue, de transparence et de bénéfices partagés. Elle propose des clés pour transformer les projets industriels en opportunités territoriales, en leviers de transition écologique, d’emplois durables et de cohésion sociale.
Réindustrialiser la France ne sera possible qu’en inventant une industrie désirée, et non simplement tolérée. Une industrie qui s’ancre dans les territoires, qui écoute, qui coconstruit, qui inspire, comme nous le faisons tous les jours sur l’attractivité de l’industrie et de ses métiers. Comme le rappelait Auguste Comte : « Le progrès n’est que le développement de l’ordre. »
La contestation n’est pas un refus du progrès, mais l’expression d’une exigence : celle d’une industrie transparente, responsable et créatrice de valeur pour tous. C’est à cette ambition que cette réflexion convie : faire de l’industrie non pas un sujet de débat, mais un projet collectif.
Mathieu Péraud
Délégué général de l’UIMM Ille-et-Vilaine et Morbihan
Merci
Les auteurs remercient vivement Clément Marquet et Liliana Doganova d’avoir consacré l’enquête de l’option « Affaires publiques et innovation » de Mines Paris – PSL aux controverses provoquées par les projets industriels.
Nous remercions les partenaires de l’observatoire des Territoires d’industrie (OTI) et leurs représentants pour avoir soutenu ce projet : Annabelle Boutet (ANCT), Lucas Chevrier (Intercommunalités de France – école des Ponts ParisTech), Aurore Colnel (ANCT), Camille Étévé (Banque des Territoires), Jean-Baptiste Gueusquin (ANCT), Isabelle Laudier (Institut CDC pour la recherche), Diane de Mareschal (Institut CDC pour la recherche), Camille Simoes (Banque des Territoires), Charlotte Sorrin-Descamps (Intercommunalités de France), Sinaa Thabet (Régions de France).
Merci également aux membres du conseil scientifique de l’OTI : Sébastien Bourdin (EM Normandie), Coline Bouvart (Institut Paris Région), Gilles Crague (école des Ponts ParisTech), Denis Carré (université Paris Nanterre), Philippe Frocrain (Agence d’urbanisme de la région nantaise), Nadine Levratto (université Paris Nanterre), Magali Talandier (université Grenoble Alpes) et Pierre Veltz (Institut des hautes études pour le développement et l’aménagement des territoires en Europe, école des Ponts ParisTech).
Nous remercions les participants au séminaire de l’Observatoire du 2 avril 2024 : Sébastien Bourdin, Alban Bruneau (président d’Amaris) et Régis Passerieux (alors sous-préfet d’Istres).
Merci à Émilie Binois pour son travail d’édition et à Vincent Charlet pour sa relecture, ainsi qu’à l’ensemble de l’équipe de La Fabrique pour nos discussions.
Pour résumer
Face aux épisodes médiatisés de contestation locale de projets industriels, d’une part, et aux enquêtes nationales indiquant que les Français admettent la réindustrialisation comme nécessaire et souhaitable, d’autre part, il est difficile de se faire une idée juste du degré d’attachement ou au contraire d’hostilité de ces derniers envers l’industrie. Il suffit pourtant de suivre le destin de quelques grands projets industriels pour comprendre à quel point leur bonne réception par le public est déterminante pour leur réussite. Certains, tels que l’usine de viennoiseries à Liffré, en Bretagne, ou l’unité de production d’hydrogène à partir d’énergie solaire à Fos-sur-Mer, ont en effet connu une issue défavorable à la suite des contestations de riverains, de collectifs d’acteurs et d’autres parties prenantes au territoire (le premier a été abandonné, le second est suspendu). Cet ouvrage, qui repose notamment sur l’analyse détaillée de quatre études de cas, cherche à comprendre la genèse des conflits locaux suscités par l’ouverture ou l’extension de sites industriels, ainsi que les mérites et les limites des dispositifs prévus pour organiser la participation et la concertation du public.
Tout d’abord, une géographie des conflits élaborée à partir de la presse quotidienne régionale permet de révéler que ces derniers sont très peu nombreux au regard du nombre total de créations ou d’extensions de sites industriels en France : 61 ont fait l’objet de conflits sur la période 2010-2024, quand 2 336 sites industriels ont été créés. Si l’on ajoute les activités minières et énergétiques, ce rapport est de l’ordre de 603 pour 2 786. En d’autres termes, il n’y a pas, tant s’en faut, d’opposition systématique des riverains français aux projets industriels qui se matérialise par une action (recours en justice, manifestation, médiatisation, etc.). En revanche, notre base de données met en évidence que certains projets sont particulièrement contestés. C’est le cas des carrières, des usines d’enrobage et chimiques, des usines de traitement de déchets et, par-dessus tout, des projets liés aux énergies renouvelables (parcs éoliens et des méthaniseurs notamment).
Il apparaît ensuite que les conflits liés aux projets industriels ne sont pas le fruit d’une contestation uniforme de la part de la population. Des craintes de nuisances locales à la remise en question de l’intérêt général du projet, en passant par la mise en doute de l’expertise apportée quant aux risques potentiels, les motifs alimentant ces conflits sont multiples. Cela s’explique avant tout par la diversité des parties prenantes dont les intérêts sont menacés par le nouveau projet : riverains, salariés, associations environnementales, élus… Cette diversité des acteurs impliqués et de leurs postures dans la controverse montre également que le périmètre « réel » du conflit se cantonne très rarement à celui de l’usine concernée. Ces épisodes de contestation mettent aux prises, a minima, différentes perceptions du territoire par ses habitants1. Bien souvent, les intérêts en jeu dépassent même le cadre du projet contesté et mobilisent différentes conceptions de la transition écologique, de l’économie souhaitable ou du fonctionnement démocratique.
Parmi tous ces motifs d’opposition, le rejet de l’industrie en tant que telle est donc très rare. De même, les contestations locales des projets industriels ne sont pas majoritairement expliquées par le phénomène Nimby (not in my backyard) si souvent invoqué, par lequel un riverain rejette un projet dont il admet pourtant l’intérêt général au terme d’un calcul individualiste sur les coûts et bénéfices occasionnés par une implantation dans son environnement proche. Bien d’autres raisons viennent alimenter les réticences constatées sur le terrain.
Premièrement, ces projets prennent place, matériellement parlant, dans un territoire. Le succès de leur implantation suppose donc de prendre en considération un certain nombre de caractéristiques territoriales et l’image que ses habitants s’en font : valeurs propres, attachement au lieu ou à certains de ses sites emblématiques, perception du territoire comme étant « industriel » ou au contraire « naturel », projet économique du territoire… Autant de paramètres, aussi « locaux » soient-ils, qui n’entrent pas en ligne de compte dans le calcul rationnel des externalités positives et négatives subies par chacun (le fameux Nimby, donc), et qu’un « simple » mécanisme de compensation financière, parfois prévu par la loi pour faciliter l’acceptation des projets, ne saurait ainsi évacuer.
Deuxième exemple important : ces conflits peuvent aussi révéler un problème d’asymétrie de l’information entre le public et le porteur de projet. Bien sûr, l’absence même partielle d’information alimente la méfiance du public. Mais y pourvoir ne suffit pas toujours : encore faut-il que l’information partagée soit reconnue comme lisible et fondée sur des connaissances fiables. Il aura ainsi suffi d’un documentaire, sur une chaîne de télévision publique, consacré aux rejets de PFAS2 par des usines chimiques localisées à Oullins-Pierre-Bénite, dans la vallée de la chimie, pour que soit remise en cause l’expertise menée de longue date sur le niveau de risque et les impacts environnementaux de l’industrie chimique locale. Usuellement, les acteurs se réfèrent aux outils de mesure et valeurs seuils définis par les agences de l’État. Néanmoins, en situation de controverse, le choix des mesures devient lui-même source de discussion, tout comme l’accès à l’information et son interprétation.
À l’aune des études de cas examinées dans cet ouvrage, il apparaît indispensable aux industriels et à la puissance publique de saisir toute la variété des motifs d’opposition mobilisés par les riverains pour accroître les chances de mener ces projets jusqu’à leur terme. Or, force est de constater que le cadre réglementaire national destiné à renforcer « l’acceptabilité » des projets industriels par les riverains (terme qui pourrait signifier que l’État entend leur faire accepter quelque chose qu’ils ne désirent pas) repose exclusivement sur le principe de l’information et de la participation, ponctuelles et tardives, du public.
Cela n’est pas nouveau : l’enquête publique trouve son origine au xixe siècle en France. Les récentes évolutions du cadre réglementaire, notamment dans les années 1980, ont certes cherché à favoriser une plus grande implication – ou une implication plus en amont – des citoyens, mais les dispositifs actuels de participation du public ne semblent pas toujours adaptés à la multiplicité des motivations qui peuvent alimenter des conflits. En particulier, la consultation menée par la Commission nationale du débat public (CNDP) et prévue par la réglementation apparaît à bien des égards ancrée dans des procédures administratives ne favorisant pas l’implication du public et ne lui garantissant aucun pouvoir d’influence sur la décision finale, alors même qu’elles induisent des délais et des coûts incompressibles pour les porteurs de projet. Il arrive toutefois que ces consultations fassent naître un dialogue entre les acteurs locaux ou soient l’occasion pour eux de faire la démonstration d’un rapport de force, mais c’est alors un outil à double tranchant : cela peut soit précipiter l’issue défavorable du projet (comme dans le cas de l’usine Bridor à Liffré), soit débloquer la situation en incitant le porteur de projet (comme pour la centrale biomasse de Gardanne-Meyreuil) à le repenser pour mieux l’inscrire dans son territoire d’accueil.
Ces dispositifs de concertation en amont sont bien sûr nécessaires à la participation des riverains et, donc, à la bonne réception des projets. Toutefois, pour surmonter leurs limites, et plus précisément pour sortir du cadre étroit d’une consultation ponctuelle, les études de cas invitent les porteurs de projet et les responsables publics à opter pour des mécanismes de coconstruction au long cours. Cela suppose de nouvelles formes de gouvernance, dont des exemples sont fournis dans l’étude, pour impliquer non seulement un plus grand nombre d’acteurs représentatifs du territoire, mais pour aussi engager de nouvelles formes d’expertise. Par exemple, par la construction locale de nouvelles données sur les effets indésirables de tel ou tel effluent, les acteurs locaux cessent d’être cantonnés à un rôle de riverains et peuvent être reconnus comme de possibles « experts profanes ». C’est typiquement par des mécanismes de ce type que devient envisageable la délicate articulation, opérationnelle et politique, entre la « démocratie environnementale » (celle où une perturbation majeure de l’environnement naturel local est nécessairement débattue par ses parties prenantes) et la « démocratie écologique » (celle où l’État se voit chargé, au moyen d’une planification descendante, de conduire la population vers l’atteinte des objectifs climatiques et environnementaux).
Au terme de cet ouvrage, il est possible d’écarter la crainte d’un rejet pur et simple de l’industrie de la part des Français, même quand il s’agit de projets concrètement envisagés dans leur environnement proche. En revanche, il est tout aussi incontestable que le grand public ne souhaite pas voir reproduite, purement et simplement, l’industrie du passé. L’acceptabilité locale des nouvelles installations industrielles se trouve donc ramenée à un problème d’élaboration des politiques publiques. Celles-ci doivent immanquablement s’appuyer sur une vision partagée de l’industrie du futur, qui soit en partie locale et ascendante et non pas uniquement le fait de décisions centralisées.
- 1 — Nous renvoyons ici à l’ensemble des précédentes publications de l’observatoire des Territoires d’industrie.
- 2 — Composés per- et polyfluoroalkylés
Introduction
Entre les Français et l’industrie, c’est “ Je t’aime, moi non plus ”. Voici comment L’Usine nouvelle intitule son article évoquant les résultats de son enquête menée auprès d’un échantillon représentatif de 1 000 Français, en partenariat avec CCI France et La Fabrique de la Cité, à l’automne 2024. La relation entre les Français et l’industrie serait ainsi ambiguë, voire contradictoire. À lire la presse3, des comportements « nimbystes » émergent localement de la part d’opposants aux nouvelles implantations d’usines, qui préfèreraient voir ces dernières localisées dans d’autres territoires plutôt que dans le leur. Dans le même temps, les enquêtes d’opinion révèlent que les Français sont plutôt favorables à l’industrie et à la réindustrialisation. Dans l’enquête de L’Usine nouvelle, la part des sondés favorables à l’industrie est de 69 %. Elle monte même à 82 % dans une étude de Bpifrance publiée en 2024 sur la réindustrialisation des territoires. Les Français sont-ils donc hostiles à l’industrie ?
Depuis le mouvement des « gilets jaunes » et le confinement lié au Covid-19, la notion d’acceptabilité a été très largement mobilisée pour caractériser l’accueil difficile que les citoyens font à de nouvelles mesures (Barbier, 2021). Elle est venue remplacer, dans le débat public, celle de social licence to operate 4, utilisée dans les industries extractives par analogie avec les permis et autorisations nécessaires pour exploiter les ressources naturelles.
Sans définition consensuelle, l’acceptabilité décrit parfois un processus destiné à tendre vers l’acceptation5 ; dans d’autres cas, elle se confond littéralement avec cette dernière (Batellier, 2015). Le terme allemand Akseptanz recoupe quant à lui deux dimensions : une dimension perceptive, représentant l’adhésion de la population à un projet, et une dimension comportementale, décrivant la mise en œuvre d’actions par la population pour défendre le projet (Depraz, 2005). Certains experts préfèrent quant à eux parler de « réception » des projets (Kent et Lane, 2009 ; Wüstenhagen, Wolsink et Bürer, 2007) ou d’« appropriation locale » des projets (Bourdin, 2020).
Conscients de cette absence de définition claire, mais compte tenu de notre souhait de mesurer, décrire et comprendre certaines manifestations d’hostilité des Français envers l’industrie, nous adoptons dans cet ouvrage une approche « instrumentale » de l’acceptabilité : cela signifie que nous cherchons à expliquer les raisons des conflits et leur issue, en particulier si le projet a été réalisé ou non. En d’autres termes, notre travail s’attache à identifier en quels endroits les projets industriels sont contestés, quelles sont les activités industrielles concernées, quels sont les motifs de contestation et quels sont les dispositifs mis en œuvre pour structurer les débats et dépasser les conflits.
Cette étude commence par situer l’industrie au regard des autres objets de l’acceptabilité sociale dans la littérature. Elle s’appuie ensuite sur une analyse de la presse quotidienne régionale française pour recenser les conflits liés aux projets industriels et en expliciter l’importance. Quatre cas de conflit sont enfin étudiés en profondeur par une promotion d’élèves ingénieurs de l’École des mines, dans le cadre d’une collaboration entre la Fabrique de l’Industrie et l’Option « Affaires publiques et innovation », qui introduit les étudiants aux enjeux politiques des sciences et des techniques (voir postface). Entre octobre 2024 et janvier 2025, quatre groupes d’élèves ont réalisé une analyse importante de la documentation associée à chaque projet contesté (sites web, informations techniques, consultations menées par la Commission Nationale du Débat Public) et une semaine d’enquête alternant entretiens semi-directifs (entre 12 et 22 selon les groupes) et visites des sites concernés. Les entretiens, d’une durée d’une à deux heures en moyenne, ont été menés avec une diversité de parties prenantes (entreprises, pouvoirs publics, élus, associations, experts, CNDP, etc.) et tous les acteurs ont été anonymisés. Les citations dans les chapitres viennent des entretiens, sauf indication contraire.
Cet ouvrage s’articule en six chapitres. Le premier, à portée générale, vise à contextualiser dans le cas français la question de l’acceptabilité sociale des projets industriels. Il estime le nombre de conflits liés à l’industrie et expose les motifs des oppositions identifiés par la littérature dans le cas de conflits d’aménagement. Les trois chapitres suivants correspondent à un cas de conflit récent causé par l’implantation ou l’extension d’un site dans le secteur manufacturier industriel : une plateforme de production de carburants renouvelables pour l’aviation à Gardanne-Meyreuil, dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (chapitre 2) ; une usine chimique à Oullins-Pierre-Bénite, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes (chapitre 3) ; et une usine de viennoiseries à Liffré, en Bretagne (chapitre 4). Le chapitre 5 est, quant à lui, consacré au cas d’un projet énergétique, celui de la centrale photovoltaïque flottante à Fos-sur-Mer. Enfin, le chapitre 6 met en avant des dispositifs favorisant l’acceptabilité des projets industriels par le public.
Au moment de la rédaction de cet ouvrage (été 2025), les quatre projets ayant fait l’objet de conflits ont des niveaux d’avancement variés. Le projet Bridor à Liffré a été publiquement abandonné en mai 2023. Le porteur de projet d’HyVence a demandé la suspension de la consultation auprès de la CNDP en février 2025, ce qui s’apparente à un abandon du projet. Hynovera en est au stade de la concertation continue prévue par la CNDP. Enfin, les demandes de suppression de l’arrêté autorisant l’extension de l’usine à Oullins-Pierre-Bénite ont été refusées en première instance ; elles sont portées en cassation.
- 3 — Suite au projet d’ouverture d’une mine d’or en Guyane, Le Monde du 27 juin 2018 écrit : « Mais les industriels sont unanimes : que ce soit en outre-mer ou en métropole, implanter une mine, une usine ou une éolienne est devenu difficile et long. Donc coûteux. »
- 4 — Lacey et Lamont (2014) définissent cette dernière comme un contrat social informel qui oblige les opérateurs à consulter les populations locales pour qu’ils acceptent le projet.
- 5 — Pour Caron-Malenfant et Conraud (2009), l’acceptabilité décrit le « résultat d’un processus par lequel les parties concernées construisent l’ensemble des conditions minimales à mettre en place pour qu’un projet, un programme ou une politique s’intègre harmonieusement et à un moment donné dans son milieu naturel et humain.»
Des oppositions avérées mais concentrées – Par Caroline Granier
Les cas d’opposition entre habitants et porteurs de projets industriels peuvent être étudiés par une analyse de la presse locale d’une part et une revue de littérature académique d’autre part. Il en ressort que ces oppositions, du moins celles qui se matérialisent par des engagements tangibles (manifestations, recours…), ne concernent qu’un petit nombre de secteurs industriels. En outre, l’imbrication des motifs de contestation invoqués tend à montrer que le fait industriel est moins en cause que des revendications d’ordre plus général.
De quels conflits parle-t-on ?
Caractériser les conflits liés aux installations industrielles n’est pas chose aisée. La littérature académique est peu bavarde à ce sujet, à l’exception des travaux qui portent sur les industries extractives (voir par exemple Harvey, 2014 ; Hall et al., 2015 ; Heffron et al., 2021). Il faut se référer aux travaux relatifs aux conflits environnementaux (l’environnement étant ici compris au sens de l’entourage habituel d’une personne)6 et aux conflits de voisinage pour mieux saisir l’état des lieux.
Revenons tout d’abord à la notion de conflit. Selon Torre et al. (2016), un conflit se différencie d’une tension par « le franchissement d’un seuil qualitatif qui correspond à l’engagement des parties et a pour but de crédibiliser leurs positions. […] Cet engagement a un coût irréversible, monétaire ou hédonique, et peut prendre différentes formes : le recours en justice, la publicisation (différend porté devant des instances publiques ou des services de l’État), la médiatisation (différend porté devant les médias), les voies de faits ou la confrontation verbale, la destruction de biens ou d’infrastructures, la production de signes (barrières, etc.) ».
D’un côté, Dziedzicki (2003, 2004) propose la notion de « conflit d’aménagement ». Il s’agit d’une situation liée à la réalisation d’un projet d’aménagement, de quelque nature que ce soit, qui suscite une réaction d’opposition de la part des populations concernées par ses impacts potentiels : infrastructures de transport linéaires et ponctuelles, infrastructures industrielles, infrastructures de production d’énergie, installations de traitement des déchets et des eaux (eau potable et eaux usées), projets d’urbanisme, projets d’aménagement touristique, etc. Qu’il s’inscrive dans un cadre territorial restreint ou au contraire étendu, il appartient à la catégorie plus large des conflits environnementaux.
D’un autre côté, Torre et al. (2016) mettent en avant la notion de « conflit de voisinage », qui comporte quant à elle deux caractéristiques principales : son inscription dans un territoire et sa matérialité. En d’autres termes, il se déroule entre voisins, tout en s’inscrivant également dans un cadre institutionnel régi par des instances locales et supra-locales et il existe en raison d’objets construits ou à construire, anticipés ou réalisés.
Ces deux catégories de conflits, d’aménagement et de voisinage, se recoupent certes mais en partie seulement. Une première distinction est que les conflits d’aménagement peuvent s’étendre sur de longues distances (que l’on songe à une ligne à grande vitesse par exemple) et donc dépasser le cadre local. De manière complémentaire, une seconde différence est que les conflits de voisinage incluent également des contestations survenant une fois l’usine implantée. Certains peuvent d’ailleurs s’atténuer si le projet démontre progressivement son utilité et son intégration harmonieuse dans le territoire. Inversement, des projets initialement acceptés peuvent perdre leur légitimité si des promesses non tenues ou des dysfonctionnements apparaissent (Batel et Devine-Wright, 2015).
Troisième cas de figure, il n’est pas rare que des conflits d’usage, c’est-à-dire des concurrences pour l’utilisation de l’espace, se soient exprimés avant ces conflits d’aménagement ou de voisinage (voir chapitre 4). Aussi bien pour Dziedzicki (2004) que pour Torre et al. (2016), ils en constituent un « préalable ».
Du point de vue des porteurs de projets, ces oppositions sont sources d’allongement des délais d’implantation voire de blocages. Elles peuvent aussi susciter des améliorations, lorsque le projet est modifié pour tenir davantage compte des caractéristiques locales. Pour les acteurs s’estimant lésés par un projet, l’opposition peut s’exprimer de différentes manières. Ils peuvent choisir un comportement parmi trois, selon la typologie de Hirschman (1970) reprise dans Torre et al. (2016) : la prise de parole (voice) pour exprimer leur opposition, la revente du foncier et le déménagement (exit), ou l’acceptation de la décision et l’absence d’opposition publique (loyalty). Toutefois, l’acceptation de la décision ne signifie pas nécessairement l’acceptation du projet : le silence d’une partie de la population peut n’être que le reflet de son manque de moyens pour le contester (Batellier, 2015). A contrario, on notera que les conflits peuvent être le fait d’une minorité d’acteurs et ne présagent donc pas d’une hostilité partagée par la population entière.
Qu’en dit la presse locale?
Dans leur article, Torre et al. (2016) s’appuient sur un inventaire de tous les conflits d’usage et de voisinage recensés, dans les zones rurales françaises entre 2006 et 2013, par la presse locale et dans les recours administratifs. Ils les regroupent selon la nature de l’objet contesté. En première position, les conflits les plus nombreux sont « sans conteste » ceux qui sont liés au développement résidentiel. En deuxième place apparaissent les conflits associés aux nouvelles installations industrielles. Viennent ensuite les conflits liés aux installations touristiques, après quoi arrivent, en quatrième place, les conflits qui portent sur les externalités négatives des activités industrielles implantées.
Dans le cadre de cette étude, nous avons recensé les conflits qui ont été l’objet d’au moins un article dans la presse quotidienne régionale entre 2010 et 2024 (voir encadré), tout en étant liés à des projets d’implantation et d’extension de sites industriels. Comme le rappellent Torre et al. (2016), l’utilisation de la presse locale présente un certain nombre de limites (omission d’événements, dissimulation, parti pris, euphémisation, etc.). En ce sens, notre recensement des projets contestés n’est sans doute pas exhaustif. Certaines tensions peuvent en effet ne pas apparaître dans la presse soit parce qu’elles ne sont pas suivies d’actes d’engagement et ne font donc pas partie de notre périmètre d’analyse, soit parce qu’elles ne sont délibérément pas couvertes par la presse. Par exemple, la création de la gigafactory Verkor à Dunkerque n’apparaît dans aucun des articles identifiés au moyen d’une recherche par mots-clés. Pourtant, après avoir participé à des réunions dans ce territoire, nous savons empiriquement qu’il soulève des questionnements critiques, par exemple quant aux risques liés à la manipulation quotidienne des matériaux entrant dans la composition des batteries ou encore au sujet des conséquences économiques de ce « méga-projet » pour les territoires voisins.
Méthodologie
A fin de recenser les conflits liés aux projets industriels, nous avons constitué un corpus d’articles de presse quotidienne régionale à partir de la base Europresse. Nous avons en cela suivi la méthodologie de Charlier (1999), qui a exploité la presse spécialisée pour étudier les contestations dans les zones rurales et de Bourdin et al. (2020).
Ces articles ont été collectés dans un ensemble de journaux couvrant la France sur la période 2010-2025 : La Voix du Nord et Courrier picard pour les Hauts-de-France, L’Union pour les Hauts-de-France et Grand-Est, Le Parisien pour l’Île-de-France, Paris Normandie pour la Normandie, Ouest-France et Le Courrier de l’Ouest pour les régions Bretagne et Pays de la Loire, La République du Centre, le Berry républicain, Le Populaire du centre, La Montagne, L’Écho républicain, La Nouvelle République du Centre Ouest pour Centre-Val-de-Loire, la Charente Libre, Sud Ouest, La Nouvelle République du Centre Ouest et Le Populaire du Centre pour Nouvelle-Aquitaine, L’Est républicain, Le Bien public et Le Journal de Saône-et-Loire pour Grand Est et Bourgogne- Franche-Comté, Le Journal du Centre pour Bourgogne-Franche-Comté, Midi libre et La Dépêche du Midi pour la région Occitanie, La Provence, pour la Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA), Le Progrès pour Auvergne-Rhône-Alpes ainsi qu’une partie de la région PACA, La Montagne pour Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle-Aquitaine. Les journaux alsaciens, DNA et L’Alsace, n’étant pas disponibles sur Europresse, la représentativité de notre corpus pour la région Grand Est est restreinte.
La collecte des articles s’est opérée à partir d’une combinaison de mots-clés : « usine », « industri* », « projet », « création », « implantation », « opposant* », « contestation », « extension ». Une fois la requête exécutée, nous avons procédé à une lecture des articles pour intégrer seulement ceux qui traitent bien de conflits liés aux projets industriels. Quand plusieurs articles (du même journal ou de deux journaux différents) traitaient du même projet, nous en avons conservé un seul, en fonction des informations qu’il apportait : ont été gardés les articles qui donnaient le plus d’informations sur l’objet du conflit et les acteurs concernés. Nous avons ensuite classé les conflits selon l’année, le secteur d’activité, la région.
Figure 1.1 – Conflits locaux recensés par la presse, par secteur d’activité (2010-2024, France hors Alsace et Corse)
Sources : Trendeo et Europresse. Traitements La Fabrique de l’industrie.
Cela étant rappelé, la presse locale constitue le moyen d’accéder à « la masse la plus complète d’événements dans un périmètre spatial et temporel le plus vaste possible » selon Olzak (1992), cité par Torre et al. Les études de cas apparaissent indiquées pour apporter un éclairage complémentaire à l’utilisation de la presse.
Les conflits se sont déplacés des industries extractives aux énergies renouvelables
En premier lieu, notre corpus d’articles montre que les épisodes de contestation locale concernent très fréquemment un petit nombre de secteurs d’activité : éoliennes et méthanisation principalement, le recyclage et le traitement des déchets ainsi que la fabrication de bitumes et d’enrobés arrivant loin derrière (voir figure 1.1). Ce caractère prépondérant, dans notre corpus de presse, des énergies renouvelables parmi l’ensemble des projets industriels remis en cause localement, offre par ailleurs un reflet cohérent du développement, depuis 2007, d’un large pan de la littérature académique autour de l’acceptabilité des énergies renouvelables (Batel, 2020).
Figure 1.2 – Nombre de projets contestés relativement au nombre de créations de sites, par région, sur la période 2010-2024
(a) Pour l’industrie manufacturière (2010-2024)
(b) Pour l’industrie au sens des sections B-E de la NAF (2010-2024)
Deuxième constat, relativement au nombre total de créations de sites industriels répertoriées en France par la société Trendeo sur la même période, le nombre de conflits apparaît modeste si l’on s’en tient au secteur manufacturier (section C de la NAF). En Île-de-France, pour 149 sites créés, 4 projets ont fait l’objet de contestations. En Occitanie, ce sont 5 projets industriels qui ont suscité des conflits, alors que dans le même temps 234 sites ont été créés. Pour la France, le ratio est de 61 projets contestés pour 2 336 créations de site7.
Ce résultat fait écho à celui d’une étude de Bpifrance Le lab consacrée aux « Industriels résistants » et publiée en 2025 : les 29 industriels interrogés et portant un projet d’implantation ou d’extension d’usine font état d’une quasi-absence d’opposition de la part des populations.
Pour la raison invoquée précédemment, ces chiffres diffèrent fortement dès lors que nous introduisons les projets d’énergies renouvelables. En Occitanie, pour 281 ouvertures, on dénombre 118 projets avec des oppositions. Ce ratio est de 33 pour 107 en Centre-Val-de-Loire. Il faut dire que les projets d’éoliennes ou de méthaniseurs apparaissent comme plus systématiquement contestés avec une variation plus grande entre les régions que pour le secteur manufacturier.
Un grand nombre de parties prenantes
Par une analyse lexicale des articles composant notre corpus, on peut retracer la multiplicité des parties prenantes aux conflits (voir annexe 1). Les collectivités territoriales figurent dans la liste des mots les plus fréquemment mentionnés dans les articles, que ce soit sous les traits du conseil municipal ou des intercommunalités. La figure du préfet y apparaît également, soulignant qu’à une organisation décentralisée des responsabilités vient toujours répondre sur le terrain une présence déconcentrée de l’État (dont les études de cas ci-après soulignent le caractère décisionnaire). Les collectifs de riverains ou d’opposants et les associations sont aussi fréquemment cités dans les articles de presse, ainsi que les propriétaires. Les porteurs de projet et plus généralement les industriels apparaissent dans une moindre mesure. Ce résultat, ainsi que l’absence d’autres acteurs tels que les syndicats, est lié à la domination des projets énergétiques dans notre corpus d’articles.
Cette multiplicité des acteurs recensés par la presse comme parties prenantes récurrentes des controverses locales porte en soi un éclairage sur la grande variété des intérêts et des niveaux d’influence qui vont peser sur le cours des projets industriels (Bourdin et Nadou, 2020). Si leur point commun est de voir leurs intérêts comme affectés, positivement ou négativement, par un projet donné, leur diversité laisse présager l’expression de différents motifs pour s’opposer à un même projet. Les articles de presse évoquent notamment les nuisances, dont le bruit et les odeurs, les risques, la pollution, les flux de camions.
Une diversité de motifs d’opposition
De manière générale, un conflit d’aménagement peut être motivé par diverses raisons8. La crainte que le projet n’entraîne des impacts négatifs sur son environnement familier, très fréquemment associée au syndrome Nimby, ne constitue qu’un seul des motifs d’opposition. Les acteurs locaux peuvent aussi s’opposer à un projet parce qu’ils en contestent la nature même ou qu’ils récusent le processus de décision qui a conduit à le proposer. Enfin, certains peuvent remettre en cause des dimensions plus structurelles, comme l’action publique ou le système économique dans sa globalité. Ces conflits sont également influencés par des facteurs culturels, sociaux et politiques corrélés au territoire dans lequel ils prennent forme. Enfin, ces différents motifs ne sont pas indépendants les uns des autres : ils coexistent et s’alimentent au contraire (Dziedzicki, 2004, 2015). Ainsi, pour un même projet, plusieurs de ces dimensions peuvent se manifester.
On n’en veut pas chez nous : le phénomène Nimby et son halo
Le premier motif d’opposition des populations locales à un nouveau projet industriel découle directement de la transformation qui en est attendue – ou redoutée – de leur environnement familier, principalement au voisinage de leur domicile. La population exprime alors des craintes sur la préservation de son cadre de vie, les risques pour sa santé, les perspectives de dévaluation de ses biens fonciers et immobiliers. Ces craintes sont liées à la perception de nuisances (sonores, visuelles, olfactives), de risques et d’incertitudes qu’entraînerait la réalisation du projet (Poirier Elliott, 1988).
Un tel rejet – ou tentation de rejet – d’un projet industriel au seul motif qu’il serait situé trop près de son lieu de vie est souvent considéré comme le « phénomène Nimby ». Entendu en ces termes très généraux, il fait peu de doutes que la plupart des contestations d’installations industrielles entrent dans cette vaste catégorie.
Une précision s’impose pourtant. Dans la littérature, la caractérisation du Nimby est plus précise que cela. Pour Wolsink (1994, 2000), elle désigne le fait que les nuisances redoutées représentent des externalités négatives, des coûts pour les riverains dit autrement, tandis que le projet, dont ils retirent peu ou pas d’avantages, tient son existence même du fait qu’il est aussi source de bénéfices pour d’autres acteurs9. Leur calcul individuel coûts-avantages les amène à adopter un comportement de passager clandestin, c’est-à-dire à vouloir bénéficier des avantages sans en supporter les coûts10. C’est pourquoi ce comportement est associé à l’individualisme, voire à l’égoïsme11.
On parle ainsi des habitants qui, tout en étant d’accord sur l’utilité collective dudit projet (infrastructure de transport, réseau d’approvisionnement en énergie, site de traitement de déchets…), s’y opposent en raison des externalités négatives qu’il fait peser sur leur environnement proche et donc sur leur bien-être personnel. Or, l’étude de Charlier (1999) évoquée précédemment montre que seuls 7 % des conflits recensés sur la période 1974-1994 sont liés au phénomène Nimby, ainsi strictement défini. Bien qu’ancienne et fréquemment invoquée, cette expression « Nimby » serait donc une explication assez pauvre des conflits locaux suscités par les projets industriels. Dès lors, il convient d’affiner la compréhension des mécanismes en jeu pour augmenter les chances de les éviter ou de les solder favorablement.
Au-delà du Nimby, des conflits ancrés territorialement
Comme elle se fonde avant tout sur la proximité, l’explication nimbyste est très souvent privilégiée pour tenter d’analyser un confit local. Toutefois, les contestations peuvent être déterminées par d’autres facteurs territoriaux que la proximité géographique : des valeurs personnelles, des symboles et des émotions, l’histoire du territoire ou encore l’action des élus.
Ainsi, si la modification esthétique d’un paysage par l’implantation d’éoliennes ou de lignes électriques apparaît comme la cause évidente et première aux contestations que cela soulève, des chercheurs tels que Devine-Wright (2009) et Bertsch et al. (2016) expliquent que la modification du paysage amène des personnes à défendre et à protéger un territoire en raison de leur attachement au lieu et à son identité12. L’opposition au projet est alors de nature émotionnelle et ne procède pas purement d’un calcul d’intérêt individuel.
Ensuite, les zones rurales possèdent souvent des paysages emblématiques, qui servent non seulement de repères visuels et esthétiques, mais aussi de symboles de l’identité culturelle locale. Ces paysages sont ainsi associés à un profond sentiment d’attachement de la part des communautés locales, qui leur attribuent une grande valeur émotionnelle et symbolique (Bourdin et Delcayre, 2025). Les projets industriels, en particulier les éoliennes et les projets de biogaz, sont perçus par les riverains comme dégradant la beauté naturelle de leur environnement et endommageant leurs espaces de vie. À noter toutefois que le temps et l’exposition quotidienne aux infrastructures peuvent réduire l’opposition initiale… sauf si les projets se multiplient et que ce foisonnement est à l’origine d’une saturation de la part des riverains. Cette saturation peut alors nourrir au contraire un nouveau sentiment d’injustice, celui de supporter plus que les autres territoires la charge de la transition écologique.
Le rôle joué par les émotions et les valeurs explique qu’un projet puisse susciter des réactions différentes au sein de la population, parce qu’il met en évidence différentes représentations des territoires. Dans le cas de projets d’éoliennes au Québec, Fournis et Fortin (2010) identifient trois groupes de personnes représentant trois manières de penser le paysage13 : un groupe aux préoccupations économiques, favorable au projet et qui ne mentionne pas de lien entre le paysage et les éoliennes ; un groupe d’opposants pour qui le paysage est source de plaisir esthétique (« paysage scénique ») ; et un groupe d’opposants voyant le paysage comme une ressource et comme un élément structurant du projet de territoire.
Troisièmement, les conflits sont dépendants de l’histoire du territoire dans lequel ils s’inscrivent. Selon Bourdin et Delcayre (2025), certaines régions14 sont marquées par une histoire d’oppositions sociales et de résistance aux projets industriels ou d’infrastructures, dont ils ont tiré une culture de lutte. C’est particulièrement le cas dans les Pays de la Loire, où les contestations passées autour du nucléaire ont pesé sur l’acceptabilité des projets actuels d’énergies renouvelables, selon les auteurs. En Bretagne, ces projets font également l’objet d’un accueil hostile, en raison de leur taille et de l’identité des porteurs, associés au modèle capitaliste et à l’intensification des process. Historiquement, la région bretonne est en effet attachée aux petites exploitations familiales, qu’elle considère comme un élément structurant de son patrimoine et de ses paysages. D’autres régions, comme les Hauts-de-France, se montrent moins hostiles. Selon les mêmes auteurs, la dépendance historique de la région à l’égard de l’industrie lourde a incité les acteurs locaux à mener une stratégie de diversification des activités économiques, ce qui a fait émerger une culture de la collaboration entre eux. Ce passé a favorisé, très tôt, la mise en place de mécanismes de consultation et de négociation, lorsque des projets d’énergies renouvelables ont été pensés. Plus globalement, le contexte historique, social et politique du territoire d’implantation joue un rôle dans la relation entre les Français et l’industrie.
Enfin, l’opposition à des projets peut provenir plus spécifiquement des élus, dès lors que le projet se situe dans une collectivité concernée par une élection : on parle alors de « phénomène Nimey » (not in my electoral year). Mais les motifs sous-jacents à cette opposition dépassent très largement le simple calendrier électoral. Toujours selon Bourdin et Delcayre (2025), les élus locaux ont la capacité de façonner, de réduire ou d’amplifier les oppositions en fonction de leurs intérêts stratégiques. L’action des élus est contrainte par un vaste ensemble de facteurs, outre le calendrier électoral déjà mentionné : la complexité des procédures administratives, les incertitudes sur le budget, le manque de coopération intercommunale, la fragmentation de la gouvernance, les priorités politiques. Pourtant, les élus sont aussi ceux qui sont les plus à même d’informer et de dialoguer avec les habitants, en raison de leur connaissance des différentes parties prenantes au territoire et de leur légitimité.
On n’en veut pas du tout : ni ici, ni ailleurs, ni menés de cette manière
Viennent enfin les motivations de la contestation qui ne revêtent pas de forte dimension territoriale intrinsèque. D’une part, le conflit de procédure remet en cause la manière avec laquelle le projet a été élaboré. Une absence de dialogue avec les riverains, l’insuffisance des dispositifs de participation ou encore l’opacité du processus de décision motivent alors des actions de contestation, plutôt que les impacts perçus du projet (Fortin et Fournis, 2014 ; Burningham et al., 2015). En matière d’aménagement, ce sont notamment les procédures administratives et la production de l’action publique qui sont contestées, car elles ne permettent pas aux acteurs locaux d’exercer une influence sur la décision (Dziedzicki, 2004, 2015). Ces contestations ne signifient pas nécessairement que la participation du public n’a pas du tout été pensée lors du processus de décision, mais qu’elle se révèle inadaptée ou insuffisante. Si elle intervient une fois le projet ficelé, par exemple lorsque les permis de construire sont déjà demandés, la population perçoit que son rôle consultatif est réduit à zéro et qu’elle n’a aucune marge de manœuvre pour apporter sa contribution au projet.
Parfois, c’est la nature et l’utilité du projet qui sont contestées, ainsi que la politique dans laquelle il s’inscrit, et non ses impacts potentiels sur le voisinage. Dziedzicki (2004, 2015) parle alors de conflit substantiel. Aux termes de ses opposants, le projet ne doit être mis en œuvre nulle part, en raison des risques qu’il présente pour la santé publique ou parce que la politique publique dont il relève est remise en question. Par exemple, Bourdin et Delcayre (2025) montrent que des conflits relatifs à l’implantation de méthaniseurs dans le quart nord-ouest de la France étaient davantage liés à la « marchandisation des efforts de transition énergétique et à l’alignement de ces projets sur des modèles capitalistes ou industriels ». À ce motif sont associés les termes de « Banana » (build absolutely nothing anywhere near anyone) et de « Niaby » (not in anyone’s backyard). Dès lors, ce ne sont plus seulement des intérêts locaux qui sont en jeu.
Enfin, on parle de conflit structurel lorsque la contestation ne porte littéralement plus sur le projet lui-même et embrasse au contraire une portée plus générale, par exemple quand les opposants remettent en cause la justice, l’ordre social, en particulier la légitimité des décideurs publics dans la définition de l’intérêt général, la qualité d’expert ou la représentation démocratique. La perception d’une répartition inéquitable des coûts et bénéfices du projet peut ainsi mener à des oppositions – on parlera de justice distributive. L’expertise peut aussi être remise en question si le rapport de l’expert est perçu comme un plaidoyer au service du porteur de projet. Par ailleurs, le conflit peut dissimuler une demande plus large des habitants de participer à l’élaboration des projets de leur territoire (« une demande sociale de participation »), les opérations d’aménagement apparaissant comme un terrain privilégié de démocratie participative.
Cette dernière catégorie de motif apparaît pertinente pour notre sujet au regard de la nouvelle disposition, édictée dans la loi sur l’industrie verte de 2023, qui permet d’associer des projets industriels à l’intérêt général. Cette loi introduit en effet le statut de projet d’intérêt national majeur (PINM) dans le code de l’urbanisme pour des projets soutenant la souveraineté nationale et la transition écologique, et dont l’investissement et la création d’emplois sont de taille importante15. À ce jour, quatre projets détiennent ce statut : le site d’extraction et de transformation du lithium à Échassières, dans l’Allier ; l’usine de recyclage moléculaire des plastiques à Saint-Jean-de-Folleville, en Seine-Maritime ; l’usine de production de minerai de fer réduit et d’hydrogène et l’usine de production de panneaux photovoltaïques à Fos-sur-Mer, dans les Bouches-du-Rhône. Plus généralement, comme le montrent les chapitres suivants, les projets énergétiques en faveur de la transition écologique et permettant d’atteindre l’objectif de neutralité carbone en 2050 peuvent aussi être concernés par ces conflits structurels.
Les motivations à la contestation dans les quatre études de cas suivantes
- 6 — « Le conflit environnemental est une opposition forte entre acteurs se traduisant par différents niveaux de violence, déclenchée par un équipement ou une infrastructure (en projet ou réalisés) modifiant l’environnement (considéré au sens large) familier (quotidien, hebdomadaire, saisonnier) des dits acteurs, exerçant des activités ou résidant à proximité. L’échelle concernée est donc locale et régionale et le conflit implique la co-présence » (Laslaz, dans Gérardot, 2012, p. 160).
- 7 — Les créations mesurées par Trendeo sur la figure 1.2 ne concernent que les sites avec un minimum de 10 salariés. Le total des créations, toutes tailles confondues, est de 3 966 pour la section C et de 5 222 pour les sections B à E. Parmi les 603 projets contestés, seuls 35 concernent des extensions de sites existants. On ne reporte donc pas sur la figure 1.2 le total des créations et extensions de site (ces dernières étant principalement mesurées par les créations d’emplois) de Trendeo égal à 8 323 pour la section C et 9 100 pour les sections B à E.
- 8 — Nous proposons ici une typologie des motifs qui regroupe celle proposée par Dziedzicki (2004, 2015) et celle de Bourdin et Delcayre (2025).
- 9 — Wolsink (2000) le définit comme le fait que « des personnes combinent une attitude positive et une résistance motivée par des coûts et des avantages personnels calculés ».
- 10 — Comme Wolsink (2000) le souligne, on est dans un cas de dilemme du prisonnier.
- 11 — Le concept de Nimby peut même être jugé péjoratif, car il sous-entend que, si le projet est expérimenté dans un autre « jardin » que le sien, l’opposant cessera d’être en désaccord.
- 12 — L’attachement au lieu est défini par Devine-Wright (2009) comme « […] un lien affectif positif avec des lieux familiaux tels que la maison ou le quartier, comportant des sous-dimensions sociales et physiques dont l’importance relative peut varier et menant à l’action, tant au niveau individuel que collectif ». L’identité du lieu décrit quant à elle « la façon dont les attributs physiques et symboliques de certains lieux contribuent au sentiment de soi ou d’identité d’un individu ».
- 13 — Les auteurs analysent les demandes déposées en 2005 auprès du BAPE (Bureau d’audiences publiques sur l’environnement), l’équivalent québécois de la CNDP, en particulier le type d’acteur, les discours tenus, les demandes formulées relativement au projet et la position vis-à-vis du projet.
- 14 — Les auteurs ne caractérisent pas l’ensemble des régions françaises quant à leur héritage culturel en matière de lutte sociale.
- 15 — Ce statut permet aux projets désignés par décret de bénéficier de procédures administratives simplifiées.
Focus – LA CNDP ou comment associer le public aux projets
L a Commission nationale du débat public (CNDP) est une autorité administrative indépendante, qui garantit les droits constitutionnels à l’information et à la participation des publics (article 7 de la Charte de l’environnement). Chaque citoyenne et citoyen a le droit d’être informé(e)s et de participer à l’élaboration des décisions concernant des projets, plans et programmes.
Quand saisir la CNDP ?
La saisine de la CNDP par le maître d’ouvrage est obligatoire pour les projets industriels dont le coût est évalué à plus de 600 millions d’euros. Les projets d’un montant compris entre 300 et 600 millions d’euros doivent faire l’objet soit d’une saisine par la CNDP, soit d’une concertation préalable organisée par le maître d’ouvrage dans un délai de deux mois après la publication du projet. La saisine de la CNDP s’effectue sur la base du volontariat pour les projets dont le coût est inférieur à 300 millions d’euros.
La saisine de la CNDP peut également être obligatoire pour les plans, schémas, programmes et autres documents de planification réalisés par les acteurs publics (État, collectivités) nationaux tels que le Schéma décennal de développement du réseau (SDDR), la Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) et la Stratégie nationale bas carbone (SNBC).
Une réflexion en amont des projets
La CNDP intervient dès l’origine des projets, à un moment où il est encore possible d’y renoncer ou de les modifier. La démarche participative se déroule avant les instructions techniques et environnementales. Selon la CNDP, la durée moyenne des démarches participatives est de neuf semaines, avec un maximum de treize semaines. Chose importante, une démarche participative en amont ne crée pas de contentieux juridique. Au contraire, elle intervient avant les études approfondies et permet d’informer et de sensibiliser en toute transparence ; de mieux appréhender les enjeux territoriaux ; de répondre aux inquiétudes et aux désaccords avec des espaces de dialogue adaptés ; d’enrichir la réflexion grâce aux contributions des publics et d’éclairer la décision du maître d’ouvrage.
En application du code de l’environnement, une démarche participative permet de débattre de l’opportunité, des objectifs, des caractéristiques, des objectifs du projet, ainsi que de ses impacts significatifs, environnementaux, socio-économiques, aménagement du territoire et de ses alternatives.
Elle constitue ainsi est un moyen pour les porteurs de projet d’évaluer dans quelle mesure le projet s’inscrit dans le territoire. En impliquant les citoyennes et les citoyens dès l’amont du projet, elle vise à créer une culture où chacune et chacun devient acteur de son territoire. Elle favorise le partage de connaissances entre les expert(e)s et les publics. Surtout, elle encourage la recherche de solutions adaptées aux besoins réels et ainsi stimule l’innovation sociale. Ainsi cette démarche permet d’aller au-delà de la simple collecte d’observations : elle représente un moyen de légitimer les décisions et d’adopter un processus décisionnel inclusif. En intégrant la participation des publics dans le processus décisionnel, le maître d’ouvrage a la possibilité de réduire les risques d’opposition et de blocages ultérieurs.
Le rôle croissant de la CNDP
Depuis l’ordonnance du 3 août 2016 créant de nouvelles règles de participation, le nombre de saisines a été multiplié par 7 entre 2016 et 2024. Parmi ces nouvelles règles, on trouve l’obligation de saisir la CNDP pour les plans et programmes nationaux et la possibilité pour les porteurs de projet de saisir volontairement la CNDP afin qu’elle désigne une personne chargée de garantir la concertation.
Sur ces saisines, la CNDP a décidé de l’ouverture de 580 concertations et de 120 débats publics. Les débats sont privilégiés aux concertations lorsque le projet est jugé d’intérêt général par la CNDP. À l’issue de l’étape de débat public*, 95 % des responsables de projet, plan ou programme ont poursuivi le processus de concertation ou d’enquête publique, avec modification du projet dans 63 % des cas (et poursuite tel quel dans 37 % des cas). Les projets, plans ou programmes ont donc été modifiés, à l’issue d’un débat public, dans environ deux-tiers des cas.
Où en sont les projets aujourd’hui ?
Par ailleurs, à l’été 2025, la CNDP a dressé un état d’avancement des projets qui ont fait l’objet d’un débat public. 15 % de ces 120 projets ont été mis en service, 23 % sont en cours de réalisation, 24 % se situent dans une phase d’étude, 34 % sont suspendus ou abandonnés ; 4 % relèvent de cas particuliers. Les suspensions ou abandons sont principalement dus à des changements de priorités politiques, des difficultés de financement, etc. Ils concernent principalement de projets d’infrastructures de transport, d’équipements industrialo-portuaires et de projets privés d’équipement.
Le rôle des garantes et des garants de la CNDP
Les garants et les garantes désignés par la CNDP doivent garantir que la démarche participative respecte un certain nombre de ces principes : indépendance, neutralité, transparence, argumentation, égalité de traitement, inclusion. Les garants et les garantes sont indemnisés par la CNDP pour conduire les missions et totalement indépendants des porteurs de projet et de toutes parties prenantes.
En amont de la démarche participative, ils et elles réalisent une étude de contexte territorial, rencontrent les protagonistes locaux pour identifier les sujets à mettre en débat et les publics à mobiliser. Elles et ils accompagnent le maître d’ouvrage dans la rédaction du dossier d’information destiné aux publics.
Pendant la démarche participative, les garants et les garantes doivent garantir la qualité, la sincérité et l’intelligibilité des informations diffusées et veiller au bon déroulement des échanges ainsi qu’à la possibilité pour le public de s’exprimer. Leur neutralité permet l’instauration d’un climat de confiance.
En aval de la démarche participative, elles et ils rédigent dans un délai d’un mois un bilan qui rend compte de l’information et de la participation des publics : ils synthétisent les arguments exprimés et formulent des recommandations sur l’information et la participation des publics si le projet se poursuit. Quant au maître d’ouvrage, il rend compte des enseignements qu’il tire de la démarche participative et des suites qu’il donne au projet.
* Les statistiques portent uniquement sur les débats et incluent les débats terminés au 15 décembre 2025.
Nathalie Durand,
déléguée régionale Île-de-France à la CNDP
Le projet Hynovera et l’émergence d’un conflit sur l’avenir d’un territoire – Par Yves Abraham, Jeanne Bessoud, Gabrielle Berrada Lancrey-Javal, Vania Clesca Dedieu et Juliette Jahan de Lestang
Le projet Hynovera, porté par l’entreprise Hy2Gen, prévoit la construction d’une plateforme de production de carburants renouvelables pour l’aviation et le fret maritime à Gardanne-Meyreuil. À l’heure de la clôture de ce texte, ce projet se situe au niveau de la phase de concertation continue qui précède l’enquête publique16. S’il n’a manifestement pas réussi à s’intégrer dans l’histoire et dans les caractéristiques du territoire, ce projet a surtout mis en lumière des visions sensiblement différentes, émanant des parties prenantes locales, sur ce que doit être son avenir.
Présentation du projet
En 2018, le président Emmanuel Macron a annoncé la fermeture avant 2022 des dernières centrales à charbon en France. Cette décision a eu d’importantes répercussions économiques et sociales sur les sites industriels concernés, dont celui de la centrale de Provence, à cheval sur les communes de Gardanne et de Meyreuil, dans les Bouches-du-Rhône. Cette centrale, installée depuis 1953, comprenait alors une tranche à charbon de 600 MW, ainsi qu’une tranche à biomasse de 150 MW mise en service en 2018. En 2021, l’exploitant de la centrale, GazelEnergie, a décidé de fermer la tranche charbon de manière anticipée et définitive – tranche qui, dans les faits, n’avait pas fonctionné depuis 2018 – et a déclenché un plan de sauvegarde de l’emploi, donnant lieu à des contestations sociales importantes et au blocage partiel de la centrale.
Pour préserver néanmoins le dynamisme économique du territoire de Gardanne-Meyreuil, tout en agissant pour la transition écologique, l’État a mis à disposition un fonds charbon de 10 millions d’euros et a soutenu la signature du Pacte pour la transition écologique et industrielle du territoire de Gardanne-Meyreuil en décembre 2020. Ce pacte vise à soutenir l’activité économique des sous-traitants affectés, dont le Grand Port maritime de Marseille, touché par l’arrêt de l’importation du charbon.
Figure 3.2 – Chronologie du projet Hynovera et du fonctionnement des tranches charbon et biomasse de la centrale de Provence
C’est dans le cadre de ce pacte que s’inscrit le projet Hynovera, porté par l’entreprise Hy2Gen. Cette dernière prévoyait, dans la version initiale du projet, la construction d’une plateforme de production de carburants renouvelables pour l’aviation et le fret maritime à partir de biomasse et d’hydrogène. Avec un investissement de 450 millions d’euros, dont 160 millions de subventions publiques, l’entreprise Hy2Gen voulait développer la filière hydrogène sur le site de la centrale et créer 50 emplois directs et 150 emplois indirects.
La concertation publique préalable, organisée en 2022, a été le théâtre d’une forte opposition et de dialogues tendus entre de nombreux acteurs, portant des points de vue très variés. À la suite de la concertation et face à la contestation rencontrée par le projet, Hy2Gen a annoncé, en février 2023, avoir revu à la baisse le projet Hynovera17puis, en juin 2024, s’engager dans un autre projet de kérosène de synthèse à Fos-sur-Mer – sans pour autant acter l’abandon du projet Hynovera. Si GazelEnergie n’est pas non plus revenu publiquement sur son soutien au projet Hynovera, celui-ci semble de plus en plus improbable et GazelEnergie envisage maintenant d’autres projets industriels18, ayant émergé plus tard, pour poursuivre sa stratégie de valorisation du foncier de la centrale laissé inexploité depuis la fermeture de la tranche charbon.
Par ailleurs, il faut souligner que le site de la centrale de Provence, sur lequel devait s’implanter le projet Hynovera, est le théâtre d’une contestation syndicale depuis 2018 et voit son autorisation d’exploiter attaquée en justice depuis 2010, ce qui complique naturellement l’installation du projet. Tout d’abord, une partie des anciens salariés de la centrale à charbon exigent d’être réemployés dans les futurs projets sur le site et considèrent à cette aune les perspectives d’emplois d’Hynovera insuffisantes. De plus, alors que le projet Hynovera prévoit de recourir aux ressources forestières régionales, l’autorisation d’exploiter la tranche biomasse de la centrale de Provence est contestée devant la justice administrative depuis 2013 par des associations et plusieurs communautés de communes, suivant un long feuilleton judiciaire toujours en cours19, 20.
Pour réaliser cette étude, nous avons visité la centrale et rencontré les différentes parties prenantes de la controverse afin de recueillir leur point de vue respectif. Nous avons ainsi interrogé : les acteurs industriels tels que GazelEnergie, Fibois Sud, Hy2Gen ; des associations environnementales et de riverains (Bouc-Bel-Air Environnement – BBAE – et le responsable d’une association de riverains de la centrale) ; la Confédération générale du travail (CGT) et l’Association des travailleurs de la centrale de Gardanne (ATCG), créée pour porter le projet de méthanation de la CGT, l’Autorité régionale de la santé (ARS) et l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD) ; la Commission nationale du débat public (CNDP) et Annie Augier, assistante à maître d’ouvrage à la concertation publique chez Iddest, deux membres du conseil municipal de la ville de Gardanne, ainsi qu’un membre de la sous-préfecture d’Aix-en-Provence ; et aussi un chercheur de l’OHM-CNRS, intéressé par le débat ayant cours autour du site de la centrale.
L’inscription d’un projet industriel dans un territoire
Lors de son introduction au cours de la concertation publique, l’entreprise Hy2Gen a présenté Hynovera comme un projet s’inscrivant naturellement dans la continuité du Pacte du territoire. Or, dès cette première réunion, le débat s’est détourné d’Hynovera pour se concentrer sur le pacte en question.
L’avenir dessiné par le pacte se heurte à des visions alternatives et contestataires
Le Pacte pour la transition écologique et industrielle du territoire de Gardanne-Meyreuil, porté par Gazel- Energie et les représentants de l’État, semble sceller l’avenir du site de la centrale en y maintenant une forte activité industrielle. Il veut transformer cette industrie, qui paraît polluante et dépassée, en une industrie « verte », promettant dynamisme économique et emploi aux habitants de la région, tout en contribuant aux stratégies nationales de décarbonation et de maintien de l’activité industrielle. Gazel souhaite également relancer l’activité industrielle du site en valorisant particulièrement sa tranche biomasse. « La priorité absolue est de pérenniser l’activité biomasse […]. GazelEnergie a vocation à développer […] d’autres projets d’énergies renouvelables sur le site de Provence et à accueillir sur son site d’autres projets industriels », est-il écrit dans le pacte. La CGT et l’Association des travailleurs de la centrale de Gardanne (ATCG), dont le président Loïc Delpech estime qu’« il ne faut pas opposer environnement et industrie »21, sont également en faveur d’une continuité industrielle à vocation énergétique sur le site. Selon eux, les seuls projets viables sont ceux qui créent de l’emploi, afin de compenser les licenciements de 2019, et qui garantissent aux nouveaux employés le statut des industries électriques et gazières (IEG). En résumé, en signant le pacte, l’État et GazelEnergie actent le fait que le site continuera à accueillir de l’industrie « lourde », tout en étant en ligne avec les politiques climatiques contemporaines, et qu’une extension à des « nouvelles activités technologiques et/ou de tertiaire supérieur [sera possible] en périphérie de site »22.
Ce pacte est décrit par les signataires comme « une mobilisation optimale des ressources foncières du territoire, dans une vision d’aménagement durable du territoire conciliant enjeux économiques, sociaux et environnementaux ». C’est également la vision qu’ont d’abord portée les maires de Gardanne et de Meyreuil. Le terme de « terre d’énergie » y revient à plusieurs reprises, notamment dans la section rédigée par la commune de Gardanne. Selon GazelEnergie, c’est même le maire de Meyreuil qui leur a proposé Hynovera : « Lors du premier entretien en 2020 avec le maire de Meyreuil, il y avait déjà le logo de Gazel sur leur dossier […] et il nous dit :“Ça serait bien que vous regardiez ce projet.” »
Pourtant, bien que les maires et la préfecture aient décidé de concert que ce bassin resterait un territoire industriel, les riverains ne se sont pas tous manifestés comme étant du même avis : « Tous les politiques étaient d’accord […] mais, [ils] ne s’étaient pas renseignés auprès de leurs administrés. Et les administrés disent “on veut bien des bureaux, des start-up, tout ce qu’on peut imaginer […], mais on ne veut plus d’industrie” », raconte notre interlocuteur à la Commission nationale du débat public (CNDP).
Ainsi, lors de la concertation préalable au projet Hynovera, ce désaccord profond s’est trouvé mis en lumière : ce projet, logique aux yeux des pouvoirs publics, ne convenait plus à une large partie des habitants, qui voulaient rompre avec l’industrie lourde, déjà touchée par la fin du charbon et la baisse d’activité de l’usine d’alumines Alteo23. Pour eux, le dynamisme économique de leurs communes ne passe plus par des industries « polluantes et nuisibles », mais par des projets alternatifs « modernes », qui correspondent à d’autres enjeux, comme le respect des riverains et de l’environnement. Ils souhaitent donc aller plus loin que le pacte, et mettre fin à l’industrie lourde sur le site de la centrale pour y accueillir des activités tertiaires, voire en réhabiliter une partie en parcs et jardins. Les associations environnementales et de riverains portent un projet de transformation du site de la centrale visant à en faire « une petite Silicon Valley provençale », selon un représentant de l’association Bouc-Bel-Air Environnement (BBAE), qui défend l’idée de « soft industry », un idéal d’industrie « propre et sans risque comme un data center », par opposition à une industrie chimique ou une centrale à charbon.
Des perspectives incompatibles
Le passé industriel de Gardanne et de Meyreuil est donc brandi comme argument, aussi bien par les acteurs favorables au maintien de l’industrie lourde sur le site de la centrale que par ceux qui souhaitent que le site change de vocation. La vision de l’avenir du territoire est donc influencée par la perception de chacun sur l’industrie d’hier et d’aujourd’hui. Pour certains, le passé industriel des communes de Gardanne et Meyreuil est vu comme un héritage à préserver : « Notre commune se trouve à un tournant de son histoire. […] À travers [ce pacte], Gardanne doit saisir l’opportunité d’évoluer et de rebondir, tout en conservant ses valeurs et en respectant ses racines », est-il écrit dans le pacte.
Pour d’autres, ce passé industriel est considéré comme un ensemble d’infrastructures dysfonctionnelles, en décalage avec les transformations vécues par ces territoires. Bien que les industries historiques en aient été une source de dynamisme économique, les riverains se rappellent aussi leurs conséquences nocives : une pollution atmosphérique générée par l’usine Alteo qui dépassait les seuils recommandés (Noack, 2023) ou encore le stockage de millions de tonnes de boues rouges près de Bouc-Bel-Air, qui a motivé la création de l’association BBAE. S’ajoutent des impacts sanitaires empiriquement observés et associés au fonctionnement de la centrale (bien qu’aucun dépassement des seuils réglementaires n’ait été démontré), comme une contamination de l’eau et des nappes phréatiques ainsi que des nuisances sonores.
Il existe également une scission perceptible au sein de la population, certains habitants témoignant d’aspirations divergentes. Les uns, originaires des communes du territoire et travaillant souvent dans la centrale ou dans une autre industrie gardannaise, sont attachés au passé industriel du territoire. Les autres, sans lien avec l’industrie, souhaitent un cadre de vie plus sain et plus paisible que celui proposé au voisinage d’un site industriel. En effet, les populations des villes de Gardanne et Meyreuil, qui comptent 28 000 habitants, ont beaucoup évolué ces dernières décennies et ont notamment connu un fort développement urbain24. Cette urbanisation tient à trois facteurs principaux : un prix des terrains avantageux autour de ces communes par comparaison avec le reste de la métropole Aix-Marseille, une modification du PLU ayant débouché sur la délivrance de permis de construire au plus près de la centrale du côté de Meyreuil, et des spéculations sur la possible fermeture définitive de la centrale de Provence. La majorité de la population nouvellement arrivée travaille dans les grandes villes alentour et n’a aucun lien avec l’activité industrielle, selon un chercheur de l’OHM BMP-CNRS : « De nombreux habitants n’ont pas vécu le passé industriel de ces communes, certains ne le connaissent pas. » Cette scission au sein de la population est mise en lumière à l’occasion de la concertation publique : « Dans la salle, les trois quarts n’étaient même pas issus des communes. Nous, on est des salariés d’ici, on est nés ici, on est fils, petits-fils, arrière-petits-fils de mineurs. […] Et on nous expliquait à nous ce que l’on devait faire », raconte un représentant des travailleurs de la centrale. Il oppose ainsi schématiquement les deux populations et questionne la légitimité des « nouveaux arrivants » sur l’identité de la région.
L’expression d’un phénomène Nimby ?
L’opposition au projet Hynovera repose en partie sur des préoccupations locales liées au cadre de vie des habitants, ce qui pourrait être interprété de prime abord comme une manifestation du phénomène not in my backyard (Nimby). En effet, certains riverains affirment être d’accord avec l’idée du projet, à condition qu’il se fasse sur la zone industrielle de Fos-sur-Mer. « Comme on ne pouvait pas discuter du Pacte de territoire, puisqu’il n’était pas l’objet de la concertation, la discussion tournait autour de l’idée qu’Hynovera devait juste se faire ailleurs », raconte une consultante accompagnant le porteur de projet. Toutefois, ce serait là oublier les nombreux autres motifs d’opposition au projet, de sorte que cette qualification de Nimby paraîtrait en réalité réductrice.
D’abord, les critiques ayant porté sur l’implantation du projet Hynovera montrent qu’une question reste ouverte sur la nature du backyard en question, c’est-à-dire sur la configuration territoriale et sociale dans laquelle le projet vient s’inscrire. Là où le porteur de projet voit un pur réflexe défensif alimenté par la crainte d’une dépréciation immobilière, les associations de riverains mobilisent un autre cadrage : elles proposent des projets alternatifs et se disent prêtes à accueillir l’industrie à condition qu’elle soit « propre ». « Nous n’avons rien contre l’industrie, mais nous voulons une industrie propre, parce qu’on est en ville », insiste le représentant de BBAE. Il ne s’agit donc pas d’un rejet global de l’activité industrielle, mais d’une mise en tension entre la nature du projet envisagé et celle du territoire d’implantation. « Ce n’était pas une mauvaise idée, mais ils n’ont pas tenu compte du territoire. […] On n’est pas contre [Hynovera], on est contre l’emplacement “prévu”. On ne peut plus mettre n’importe quoi sur ce territoire aujourd’hui, c’est tout. La population a changé, l’interpénétration des grosses usines polluantes et de l’habitat n’est plus supportée, les problèmes liés à l’environnement montrent que les normes ne sont plus respectées », explique le responsable d’une association de riverains de la centrale.
Pour d’autres, la contestation dépasse la question du territoire et s’élargit à une critique de la pertinence même du projet et de son objectif environnemental. En effet, certains participants récusent la terminologie employée et notamment le fait que les carburants du projet Hynovera soient qualifiés de « durables » ou de « neutres en carbone », estimant que « certifier réellement une forêt durable, ça n’existe pas » ou encore que « la carboneutralité, ça n’existe pas ». Cette opposition sur le vocabulaire employé, par le porteur de projet et la majorité des intervenants institutionnels, d’une part, et par une partie des opposants, d’autre part, révèle une première ligne de désaccord sur le cadrage méthodologique adopté pour traiter du projet.
D’autres encore rejettent purement et simplement l’aviation : « Là, vous continuez à produire du carburant, qu’il soit renouvelable ou écolo, c’est du carburant pour faire voler des avions, et on n’en veut plus des avions. » Dans ce cas, l’opposition ne vise plus seulement le projet Hynovera mais l’avenir de l’aviation elle-même, marquant une deuxième ligne de désaccord sur l’objectif.
Pour un des contributeurs aux tables rondes, « la question qui nous avait été posée, c’était : “ Pourquoi produire des carburants renouvelables pour l’aviation et le maritime ? ” […] [Une] manière d’interpréter cette question de façon un peu plus profonde, c’est : pourquoi est-ce qu’on veut organiser notre système productif pour faire voler des avions et naviguer des bateaux ? »
Ces critiques sur la durabilité des carburants peuvent être lues comme des tentatives de faire reconnaître le projet comme injustifiable. Il n’y a alors plus de backyard qui tienne, qu’il soit local, national ou international. Cette opposition s’apparente plutôt à un phénomène de not in anybody’s backyard (Niaby), autrement dit à un rejet du projet sur le fond.
La remise en question des processus de concertation
Les revendications portées lors de la concertation publique sur Hynovera
La concertation publique a suscité un fort intérêt, le nombre de participants augmentant progressivement pour atteindre plusieurs centaines de personnes par réunion, avec un engagement de plus en plus marqué. Plusieurs associations25 ont rapidement contesté le caractère démocratique de la concertation, son organisation et le projet qu’elle porte. La pétition « Hynovera, on n’en veut pas », lancée au milieu de la période de concertation, a récolté 10 000 signatures avant la mi-novembre 2022, date de la fin de la concertation. Pour ces associations, les droits à l’information et à la participation, dont la CNDP est garante, étaient bafoués. Leurs contestations ont fait ressortir trois limites quant à la bonne information du public, sur le but et les modalités de la concertation.
La première porte sur la nécessité d’une communication en amont de la concertation, afin que chacun puisse prendre part au débat dès le début de celle-ci. Dans ce cas, cette communication en amont a été inefficace, voire absente : peu d’acteurs ont été informés de l’ouverture de la concertation, sinon par le bouche-à-oreille : « Je n’étais pas à la première réunion, parce que je n’avais pas été informé », confirme même un membre du conseil municipal de Gardanne. Ayant eu le sentiment d’être pris de court, de nombreux citoyens se sont ensuite mobilisés pour les concertations suivantes. L’engouement était tel que les organisateurs n’avaient pas prévu de salles suffisamment grandes pour accueillir les centaines de personnes présentes. Cette forte affluence et les moyens inadaptés pour y répondre ont contribué à un climat agité, allant jusqu’au report d’une réunion.
La deuxième limite porte sur la nécessité d’une meilleure information sur le rôle de cette concertation. Il est essentiel de mettre en avant le caractère évolutif du projet et la capacité des riverains à le modifier par leurs retours. Ici le public a eu au contraire le sentiment de ne pas avoir accès aux informations indispensables à la bonne compréhension du projet : souvent, ils n’obtenaient pas de réponse du maître d’ouvrage aux questions portant sur ses aspects techniques, car Hy2Gen n’avait pas encore réalisé les études permettant d’apporter des informations complémentaires. Le public pouvait donc avoir le sentiment que ses questions n’étaient pas considérées comme importantes et qu’il ne participait pas à une discussion mais à une simple campagne d’information.
Les citoyens pouvaient présenter des projets alternatifs mais seulement à titre informatif, car l’enjeu de ces concertations n’était pas de choisir un nouveau projet. Le calendrier de la concertation, qui prévoit des réunions de discussion suivies d’un rapport de la CNDP sur les réponses à apporter et enfin une réponse du maître d’ouvrage sur ce qu’il mettra en place pour répondre en différé aux questions soulevées, induit un séquençage qui limite la capacité de dialoguer et contrarie le sentiment d’un échange entre tous les acteurs. Ce séquençage, en remettant en cause la validité démocratique du processus et l’impact réel des citoyens sur de telles décisions, a alimenté les contestations du projet.
Enfin, la troisième limite relevée est le manque d’information sur le caractère provisoire des études effectuées avant approfondissement. Une information pourtant nécessaire pour que les riverains ne se méprennent pas sur le sérieux du projet.
Bien s’informer pour proposer un débat constructif
Si la bonne information des riverains lors de la concertation apparaît primordiale pour faciliter toute adhésion au projet, celui qui le porte doit également s’informer sur le territoire et sur les points de vue des acteurs pour éviter les conflits, voire les blocages. En l’occurrence, c’est sans doute parce qu’il n’a pas mené ces recherches de manière assez approfondie que son projet a également été remis en question sur le fond.
Les principales critiques émises sur le fond tiennent à l’usage d’une quantité trop importante de biomasse sur un site par ailleurs déjà contesté pour cette raison, au faible nombre d’emplois générés en comparaison du montant investi, au statut Seveso du projet au voisinage d’habitations, et enfin, plus marginalement, à l’exploitation des eaux du canal de Provence sans considérer l’opportunité d’utiliser celles déjà présentes dans les anciennes mines. En somme, il est reproché à Hy2Gen de s’être précipitée pour lancer la concertation. « On a toujours dit à l’équipe d’Hynovera : n’allez pas trop vite parce que vous n’êtes pas prêts, vous n’aurez pas les réponses aux questions que la population vous posera, vous n’avez même pas commencé vos études. Et donner des réponses claires et complètes sera déterminant pour l’acceptabilité de votre projet », raconte un représentant local de l’État. D’après lui, l’empressement du porteur de projet peut s’expliquer par son raisonnement de start-up : « Tout était au vert sur la procédure, le calendrier, etc. Ils ont juste oublié de se mettre d’accord avec les maires et les parties prenantes. Et ils se sont dit, on est une start-up, on fait du green. […] Tout le monde nous aime. » Notamment, l’animatrice de cette concertation, Annie Augier, n’a pas été incluse dans l’élaboration d’une stratégie en amont, comme c’est habituellement le cas dans d’autres concertations publiques : « Je suis arrivée juste avant que la phase de concertation ne démarre, […] et il était trop tard pour faire un tour d’horizon de tous les acteurs du territoire. C’est-à-dire qu’il y a une temporalité dans la concertation : on a quelques mois avant que la saisine CNDP ne soit faite pour rencontrer les acteurs et prendre le pouls du territoire, on va chercher des avis, des controverses possibles par des interviews et des rencontres. »
Le Pacte du territoire remis en cause
Le rejet du projet Hynovera vient également du fait que de nombreux acteurs ne se sont sentis ni écoutés ni considérés lors de la rédaction du Pacte de territoire Gardanne-Meyreuil. Celui-ci, outil d’accompagnement du territoire après la fermeture de la centrale26, a en effet soulevé une opposition forte durant la concertation.
Alors que les auteurs du pacte affirment avoir inclus les riverains et les associations dès sa création, en les invitant à participer aux commissions, ces derniers considèrent ne pas avoir reçu une place suffisante. Ils ont été astreints à la seule commission « cadre de vie », une des trois que comporte le pacte, aux côtés des commissions « industrie » et « emploi et formation ». Cependant, un représentant de la sous-préfecture estime que « [les associations] se sont rapidement mises en opposition, alors qu’elles ont toujours été invitées à participer à l’élaboration du pacte territorial ». « Pourquoi ? Parce qu’elles n’étaient pas d’accord entre elles (comités d’intérêt de quartier, associations nationales et locales de protection de l’environnement), donc c’était assez compliqué de parler d’une seule voix, de représenter l’ensemble de la population. » « La mobilisation contre le projet Hynovera leur a finalement permis de se structurer », estime-t-il. Le processus d’élaboration du pacte préjugeait ainsi de rôles pour les citoyens et les acteurs associatifs, matérialisés par les différentes commissions.
De plus, les associations locales et environnementales dénoncent comme une injustice leur mise à l’écart des commissions « industrie » et « emploi et formation », alors que la CGT y participait. Ce sentiment est renforcé par le fait que le projet porté par la CGT a reçu un financement, alors que celui porté par les associations n’en a pas reçu. Deux justifications à ce traitement, inégal du point de vue des associations, nous ont été données : une tentative « d’acheter la paix sociale » et le fait que le projet de la CGT soit considéré comme plus élaboré et à caractère industriel, contrairement aux autres projets de reconversion du site de la centrale, condition indispensable pour que GazelEnergie puisse l’envisager.
Autrement dit, l’élaboration du pacte tout comme le choix des projets dont les études ont été financées s’accordaient avec une vision industrielle du devenir du site de la centrale, et plus largement du bassin Gardanne-Meyreuil. Dès lors, le pacte a nourri en lui-même les oppositions entre des perspectives incompatibles pour le territoire.
Le représentant de la sous-préfecture rappelle également que, bien qu’ils déplorent leur exclusion des décisions du pacte, les riverains y sont représentés à travers les maires qui ont participé à toutes les commissions : « Après plus de deux ans de discussions, le Pacte territorial a été signé par les maires des communes concernées, le président du conseil régional, du département, de la Métropole… Ce sont les représentants élus, qui naturellement tiennent compte des gens qui vivent et travaillent sur ce territoire. » On peut donc a priori avancer l’hypothèse d’un échec du mécanisme de représentation des citoyens par les élus locaux, dans ce cas particulier, puisque ces derniers ne sont pas allés dans le sens de leurs électeurs. On peut supposer que les maires n’anticipaient pas une telle opposition au projet Hynovera, et plus largement au contenu du pacte. Ce n’est qu’au cours des concertations publiques que les élus locaux ont constaté l’ampleur de ces contestations. Ils se sont donc opposés publiquement au projet Hynovera par la suite, alors qu’ils l’avaient soutenu en premier lieu. Ainsi, bien que les citoyens aient eu l’impression de ne pas être entendus, la reconfiguration en cours du projet Hynovera peut être vue comme la preuve d’un effet représentatif de la concertation publique, la parole de la frange contestataire de la population ayant finalement été écoutée.
À qui appartient la décision industrielle ?
Le cas d’Hynovera met en lumière les enjeux liés à l’espace de discussion autour d’un projet industriel et à la légitimité de la prise de décision. Qui décide finalement d’un projet industriel ? À quel point la concertation publique peut-elle et doit-elle influencer les décisions portant sur un projet industriel ?
La contestation des projets, un risque que les industriels doivent évaluer
Le propriétaire du foncier industriel a un pouvoir de décision évident quant aux projets pouvant voir le jour sur son terrain. GazelEnergie poursuit des objectifs économiques et, à ce titre, l’entreprise ne met pas au débat l’opportunité de poursuivre une activité industrielle sur le site de la centrale de Provence. Gazel est devenu propriétaire du site de la centrale en 2019, avec la volonté à court terme d’exploiter les installations existantes et, à plus long terme, d’en faire une « plateforme de développement dans le pays ». Cette stratégie est rappelée par un membre du comité exécutif de l’entreprise à l’occasion de la concertation publique sur le projet Hynovera : « [Nous avons répété] que ce foncier a une vocation industrielle, que GazelEnergie ne vendra pas son terrain, et qu’on fera une éco-plateforme avec un aménagement raisonné. »
Pourtant, cette stratégie se déclinant sur deux horizons temporels distincts a été contrariée par la contestation, sur le terrain de la justice administrative, de l’approvisionnement du site en biomasse27. Cette contestation s’est en outre accompagnée d’un mouvement social qui a atteint son paroxysme en 2021 avec l’envahissement du site par les grévistes. Cet épisode a débouché en 2022 sur un accord entre l’État, la CGT et GazelEnergie. L’État s’est engagé à soutenir des études nécessaires au projet proposé par la CGT pour une partie du site, GazelEnergie à réembaucher des salariés licenciés et la CGT à reprendre l’activité.
Bien que la décision économique revienne in fine à l’industriel, on constate donc que des travailleurs organisés peuvent influencer les orientations économiques d’un territoire : ils ont participé aux discussions sur la poursuite de l’activité de la tranche biomasse, et leur projet industriel pour le site de la centrale de Provence a bénéficié d’un soutien de l’État et de GazelEnergie. C’est parce qu’ils sont capables d’établir un rapport de force avec l’État quant à ses propres objectifs – maintien de l’activité sur le port de Marseille – et avec leur employeur que les travailleurs de la centrale ont eu un poids. Ils se sont appuyés sur des structures régulant la relation entre l’industriel et les travailleurs : organisations syndicales, les branches des industries électriques et gazières, justice du travail.
GazelEnergie est donc soumis aux mouvements sociaux, aux réglementations et aux contraintes politiques locales, qui l’obligent à réfléchir à l’acceptabilité de ses projets industriels. C’est bien en termes d’acceptabilité que les choses doivent ici être formulées : GazelEnergie a des objectifs économiques et industriels qui guident ses décisions d’investissement, et cherche à faire accepter ses décisions en se conformant à un certain nombre de contraintes sociales, politiques et réglementaires.
De ce point de vue, l’acceptabilité sociale peut être perçue par les industriels comme un des risques qu’ils doivent évaluer et limiter.
Un État accompagnateur de la décision industrielle
Notre étude de cas fait par ailleurs apparaître trois formes distinctes du pouvoir de l’État sur les décisions industrielles : un pouvoir réglementaire, un soutien financier et un rôle de conciliateur au sein d’espaces de décision clos. Ces trois dimensions du pouvoir de l’État sur l’industrie dessinent un État accompagnateur et régulateur, bien plus que décideur, et en aucun cas planificateur.
Son rôle de conciliateur, qui nous intéresse ici, s’exerce dans des cadres clos, comme ceux de la mission de transition Pacte Gardanne-Meyreuil, de la commission de suivi de site de la centrale de Provence, ou de toutes les réunions préalables à la mise en place d’un projet industriel. Il s’agit alors pour l’État d’accompagner la décision industrielle en organisant des négociations entre différentes parties prenantes, sur une question donnée. Ce rôle de médiateur lui permet également d’assister les acteurs industriels au sein du cadre réglementaire et administratif dans lequel il les fait évoluer, ce qui peut passer par l’octroi de dérogations. Les engagements pris par l’État dans le pacte décrivent bien l’esprit de ces concertations en monde clos : « Compte tenu de l’échéance de 2022 [relative à la fermeture des centrales à charbon], l’État s’engage également à jouer un rôle de facilitateur en agissant en transverse entre les investisseurs et ses différentes administrations afin, tout en restant dans les cadres réglementaires et légaux, d’aider au montage et à la réalisation des projets dans les délais les plus rapides, les actions inscrites au pacte pouvant dès que possible bénéficier de mesures de simplification et de facilitation administratives. »
La liste des questions traitées lors de ces concertations en monde clos, autant que celle des acteurs concernés, est arrêtée pour chaque occasion. La participation des citoyens repose alors sur les formes traditionnelles de la représentativité, par la participation des élus locaux ou nationaux et la prise en compte de décisions politiques relevant du fonctionnement usuel des institutions démocratiques, comme lors des négociations du pacte. Ponctuellement, des associations de citoyens représentant des points de vue bien identifiés sur les questions traitées sont incluses comme parties prenantes aux discussions. Il y a donc là des « espaces de débat relativement discrets ou fermés », qui peuvent être « plus ou moins conflictuels », pour reprendre Chailleux et Zittoun (2021). En suivant ces auteurs, on peut dire que ce type d’espace produit des « ordres du jour » dans lesquels s’inscrivent plutôt des « énoncés domestiqués de solutions » visant à redéfinir les problèmes pour les rendre solubles et « compatibles avec des solutions qui souvent leur préexistent ». Le pacte ramène ainsi la question de l’arrêt du charbon à Gardanne-Meyreuil à celle de la poursuite de l’activité industrielle sur ce territoire, en l’inscrivant dans le cadre d’une politique de transition énergétique qui préexiste largement au problème traité et lui offre immédiatement un ensemble de solutions concrètes, à savoir des projets industriels de transition comme la production de biocarburants. Selon Chailleux et Zittoun (2021), « l’énoncé domestiqué repose ainsi sur une définition d’un problème, traitable et couplé à une solution, et sur une légitimation de l’autorité en charge de l’appliquer et de remettre ainsi de l’ordre ».
Il est intéressant de constater que l’action de l’État, comme celle du secteur privé en matière industrielle, est également marquée par une recherche d’acceptabilité. Ses objectifs politiques sont défendus au nom de l’intérêt général : en matière industrielle, la sauvegarde de l’emploi et le développement de secteurs dits stratégiques sont des arguments récurrents. Il s’agit alors de faire appliquer des lignes politiques définies à l’échelle nationale et peu remises en cause lors de leur mise en œuvre territoriale, quitte à donner des gages de considération aux groupes qui peuvent s’y opposer localement. La commission « cadre de vie », ouverte à des associations opposées à un pacte qu’elles n’ont pas signé, semble relever d’une telle vision de la territorialisation de l’action publique. On peut également y voir une stratégie de « confinement qui enferme un sujet dans un espace et une forme déterminée », d’après Chailleux et Zittoun (2021), ce qui nous rappelle que la mise à l’ordre du jour et la formulation des problèmes sont des enjeux conflictuels.
La concertation publique comme ouverture du débat
C’est au regard de ces rapports de force entre l’État, les dirigeants d’industrie et les citoyens qu’il s’agit d’évaluer la pertinence de la concertation publique comme mode de participation des citoyens à la décision industrielle à l’échelle locale. Commençons par dire que la concertation publique ne remet pas fondamentalement en cause le fait que les décisions de production et d’investissement n’appartiennent pas aux citoyens, mais aux dirigeants d’industrie, dans le cadre réglementaire fixé par les décideurs publics. C’est donc par l’intermédiaire des décideurs publics, et dans les limites du pouvoir de ces derniers sur l’initiative industrielle, que la concertation publique peut exercer une influence sur les décisions. En effet, la concertation ne donne pas aux citoyens le pouvoir de participer directement et effectivement aux décisions relatives aux projets qu’elle porte à la discussion : elle ne contient aucune procédure en ce sens. Mais alors à quoi sert-elle ? Quel impact politique a-t-elle sur les décisions industrielles ? Et comment expliquer que, dans le cas d’Hynovera par exemple, elle ait manifestement pesé sur la décision jusqu’à conduire à l’arrêt du projet ? Citons un garant de la CNDP, qui nous livre son point de vue sur la question : « Si un projet est inacceptable au vu du public, autant le savoir tout de suite. Et ne pas faire des années d’études, labourer le terrain pour rien, acheter des terrains, dépenser des millions d’euros, principalement de l’argent public, pour rien. […] C’est l’objectif de la concertation. »
La concertation ferait donc émerger des oppositions qui seraient apparues par la suite sous d’autres formes, facilitant ainsi la mise en place de projets industriels. De ce point de vue, qui est celui des dirigeants d’industrie, elle est un outil de développement industriel ou de l’aménagement du territoire, plutôt qu’un outil de démocratie directe visant à faire participer les citoyens aux décisions. Il nous paraît nécessaire de préciser cette analyse dans deux directions.
Premièrement, si la concertation semble être nécessaire pour identifier le plus tôt possible les objections aux projets industriels, la crédibilité et la menace concrète que représentent ces oppositions – et qui leur confèrent une puissance politique – reposent sur d’autres modes d’actions : les recours en justice, les mouvements sociaux, la communication ou encore la représentation politique traditionnelle. Ces moyens d’opposition constituent les outils effectifs de la participation des citoyens aux décisions en matière d’industrie. En l’absence de procédure leur accordant une influence directe sur la décision, le pouvoir politique d’une concertation s’appuie donc sur l’existence conjointe d’un espace, moins délibératif, de la conflictualité politique dont elle reproduit au moins en partie les rapports de force. Dans le cas d’Hynovera, l’évolution de la position des maires apparaît comme le canal politique ayant donné un poids décisionnel aux oppositions formulées pendant la concertation.
En second lieu, si la concertation repose sur d’autres institutions pour conférer une influence positive aux oppositions qui s’y trouvent exprimées, elle joue un rôle politique décisif dans la mesure où elle permet de faire émerger de nouvelles questions, de nouveaux groupes d’acteurs et de nouveaux mondes possibles, en lien avec les objets techniques qu’elle porte au débat. Elle ne fait donc pas qu’anticiper ou révéler des rapports de force qui lui préexisteraient et qui seraient de toute façon apparus sans elle : elle participe de la constitution de ces rapports de force en offrant un espace de médiation politique particulièrement ouvert et propice aux débordements.
Autrement dit, rien ne garantit que la concertation sur le projet Hynovera n’ait fait que donner écho à une hostilité à l’industrie déjà présente, « prête à l’emploi », complètement prévisible et qui aurait dans tous les cas conduit les maires à changer d’avis plus tard au cours de l’avancement du projet. Il est à l’inverse plus probable que la concertation ait contribué à donner forme à cette opposition, comme le suggère la dynamique d’affluence croissante aux réunions publiques. Nous rejoignons ici Barthe, Callon et Lascoumes (2014), pour qui les controverses relatives aux objets techniques permettent une « exploration » du social.
C’est la forme publique et flexible de la concertation, par opposition aux espaces clos et cadrés de la conduite usuelle de la politique industrielle, qui a favorisé l’ouverture d’un espace de médiation politique. La concertation publique apparaît ici comme un intermédiaire entre les espaces fermés décrits plus haut et les « espaces publics ouverts et tout particulièrement l’espace médiatique au sein duquel il n’existe ni lieu concret de discussion entre un énonciateur et un auditoire, ni mécanisme clair pour identifier la production d’un ordre du jour, mais uniquement la production plus ou moins simultanée de discours à travers des instruments de médiation et de publicisation entre l’énonciateur et son public » (Chailleux et Zittoun, 2021). Il est particulièrement intéressant de constater que le format de la concertation publique tente de reproduire le cadre restreint qui est celui des espaces de débat fermés – avec des réunions thématiques, des garants, des interventions d’experts – et vise à domestiquer les problèmes traités. En effet, la concertation publique, en donnant la parole à n’importe lequel des citoyens se sentant concernés par un problème proposé au débat, autorise des « énoncés tragiques de problèmes publics » qui s’opposent en tout point aux « énoncés domestiqués de solutions » et permettent « de rendre compte de la façon dont les individus définissent collectivement le monde désordonné qui les entoure » (Chailleux et Zittoun, 2021).
En ce sens, les oppositions formulées par les riverains à l’occasion de la concertation publique sur le projet Hynovera ont témoigné de l’insuffisance des modes de représentation traditionnels, notamment des concertations en monde clos menées par l’État pour décliner sa politique industrielle : la représentation politique y est insuffisante pour faire émerger les questions dont veulent débattre les citoyens, et pour faire entendre correctement leur position. De ce point de vue, la concertation publique apparaît comme un complément aux modes de représentations et de concertation traditionnels, dont elle révèle les limites démocratiques, mais dont elle a besoin en retour pour peser sur les décisions.
- 16 — Le deuxième rapport intermédiaire des garants de la CNDP a été remis en mars 2025.
- 17 — Notamment en s’engageant à réduire de moitié la capacité de production, en abandonnant la production de méthanol pour sortir du classement Seveso et en envisageant un changement de procédé pour limiter la consommation de biomasse forestière.
- 18 — À la période de l’enquête, les projets envisagés incluaient notamment un data center, une usine de recyclage de tissus pour la production de bobines de fil et un projet de méthanation du « bois de fin de vie » porté par l’Association des travailleurs de la centrale de Gardanne (ATCG).
- 19 — Fin novembre 2013, deux recours ont été déposés devant le tribunal administratif de Marseille par France nature environnement (FNE), des associations locales, le conseil général des Hautes-Alpes, huit communautés de communes et trente-trois communes de la région. En 2017, le tribunal administratif a annulé l’autorisation d’exploitation et ainsi donné gain de cause aux requérants. Cette décision a ensuite été annulée en appel, en 2018, après quoi l’autorisation d’exploiter a été rétablie en 2020, à la suite d’un recours de l’État et de GazelEnergie. En 2023, un recours devant le Conseil d’État puis un renvoi en appel ont confirmé le jugement de première instance. Ils ont également exigé un complément à l’étude d’impact ainsi qu’une nouvelle phase de participation du public, au moyen d’une enquête publique interdépartementale, qui a eu lieu en mai 2025.
- 20 — En 2022, GazelEnergie a décidé de rompre le contrat de vente à prix fixe qui le liait à l’État. D’après l’entreprise, même après avoir résilié ce contrat, les prix de revente de l’électricité sur les marchés ne permettaient pas de couvrir les coûts d’exploitation. Finalement, en novembre 2024, GazelEnergie et l’État ont signé un nouvel accord, avec indexation, pour redémarrer la production d’électricité à partir de biomasse, moyennant un fonctionnement annuel de 4 000 heures par an et un tarif de rachat de l’électricité de 800 millions d’euros sur huit à dix ans.
- 21 — Propos de Loïc Delpech recueillis dans « Loïc Delpech, président de l’association des travailleurs de la centrale de Gardanne (ATCG), livre ses attentes », La Marseillaise, 2021.
- 22 — Pacte pour la transition écologique et industrielle du territoire de Gardanne-Meyreuil, 2020.
- 23 — Le territoire de Gardanne-Meyreuil porte l’empreinte d’un long passé industriel : une usine d’alumine créée en 1894 (à l’origine du scandale des boues rouges s’étalant de 1960 à 2020), les mines de lignite du bassin de Provence (exploitées depuis le début du xixe siècle et dont la fermeture, entre la fin des années 1990 et le début des années 2000, a entraîné le licenciement de plus d’un millier de personnes), et enfin la centrale à charbon mise en service en 1953 et arrêtée en 2019.
- 24 — Il est possible de se rendre compte de cette urbanisation en visualisant l’évolution de l’étalement urbain de 1960 à aujourd’hui sur le site Remonter le temps, de l’IGN.
- 25 — Notamment France nature environnement 13 et PACA, le Collectif climat du Pays d’Aix Alternatiba, l’Association de lutte contre toute nuisance et pollution (ALNP), les comités d’intérêt de quartier, Bouc-Bel-Air Environnement.
- 26 — En 2020, un Pacte de territoire est signé pour chaque territoire sur lequel est implantée une centrale à charbon encore en fonctionnement (cela concerne la centrale de Provence, mais aussi les centrales du Havre, de Cordemais et de Saint-Avold). Ces instruments se placent dans la droite ligne des contrats de transition écologique, outils de planification territoriale visant à « accompagner et soutenir la transition écologique des territoires », mis en place par le gouvernement à partir de 2018 et dont peuvent se saisir les territoires volontaires.
- 27 — Une des deux tranches encore en fonction de la centrale a été convertie à la biomasse en 2018. Dès l’annonce de cette conversion, l’usage de la biomasse a fortement été contesté et les associations environnementales, des syndicats mixtes et des communes, ont déposé un recours en justice.
L’extension d’une usine chimique à Oullins-Pierre-Bénite : la naissance d’un cas d’école – Par Julie Cavé, Blandine du Réau, Chloé Gomichon, Inès Narduzzi-Minatchy et Alison Profit
Le projet d’extension d’une usine chimique implantée dans la ville d’Oullins-Pierre-Bénite a fait émerger un mouvement de contestation de la part de citoyens, inquiets du risque de pollution environnementale et sanitaire aux composés per- et polyfluoroalkylés (PFAS). Les discussions et les recours qui l’ont accompagné ont remis en question les lieux et les formes du débat entourant la gestion du risque chimique. Surtout, ils ont permis de tester de nouveaux outils au sein d’un territoire qui fait désormais office de laboratoire scientifique, juridique et démocratique.
Présentation du projet
Deux industriels possèdent chacun à Oullins-Pierre-Bénite une usine soupçonnée par certains riverains de polluer leur environnement aux PFAS, parfois appelés « polluants éternels », exploités dans leur procédé de production. La première usine, nommée ici « usine A », est au cœur de notre étude. L’industriel annonce publiquement en novembre 2021 un projet d’extension : il s’agit d’ouvrir une nouvelle ligne de production utilisant un nouveau surfactant sans PFAS, contrairement au procédé employé jusque-là. Cette annonce d’extension arrive peu avant deux « séismes » médiatiques : la diffusion d’un numéro d’Envoyé spécial en mai 2022 et, en octobre, le reportage de la série documentaire Vert de rage, plus fourni et centré sur Oullins- Pierre-Bénite, dénonçant la responsabilité de l’industriel en question dans la pollution des eaux et des sols par des PFAS. Les mobilisations se multiplient et, en février 2024, les débats sont relancés par l’autorisation d’extension de l’usine B, utilisant elle aussi des PFAS dans son procédé de production. L’autorisation d’extension de l’usine A est finalement attribuée en mai 2024 sans étude d’impact, contre l’avis de nombreuses associations et collectifs. Des associations se lancent alors dans une bataille juridique pour obtenir des études d’impact, bien que cette modification du site ait été considérée comme non substantielle par les autorités publiques.
Figure 3.1 – Chronologie du projet d’extension de l’usine chimique à Oullins-Pierre-Bénite
Cette étude de cas s’appuie sur une enquête de terrain, réalisée notamment en région lyonnaise, durant laquelle ont été menés 22 entretiens (entre décembre 2024 et janvier 2025) auprès de profils divers : sociologues, membres de collectifs citoyens locaux, membres d’associations écologistes, élus locaux, industriels de la vallée de la chimie, journalistes, membres de l’administration et un avocat. Certains ont souhaité conserver l’anonymat.
La naissance des contestations
La contestation de l’extension de deux usines chimiques à Oullins- Pierre-Bénite est directement liée à l’émergence de l’enjeu des PFAS ; mais elle constitue aussi l’aboutissement d’une lente distension du lien entre ces deux usines et les habitants du territoire. En demandant en référé une étude d’impact environnemental, la contestation témoigne en partie de la lutte des acteurs locaux contre un manque perçu de transparence quant à l’avenir des activités d’un des deux industriels. Néanmoins, nous pouvons observer que cela vient s’ajouter à une perte de confiance plus générale dans l’industrie chimique de la part des habitants de la région lyonnaise, en raison de précédents scandales sanitaires et environnementaux.
L’usine et les habitants : un lien de plus en plus distendu
Construite autour de l’usine A, la commune de Pierre-Bénite était, il y a cent ans, considérée comme ouvrière. « [L’industriel] nous a fait vivre », résume un membre d’une association de riverains. Mais sa population s’est récemment diversifiée. Suivant une tendance nationale, la distance parcourue par les habitants entre leur domicile et leur lieu de travail s’est accentuée28 : le lien des riverains à l’usine, autrefois évident parce que celle-ci hébergeait bien souvent leur emploi, est devenu moins clair. Comme le souligne un élu local : « Avant, la plupart des gens qui travaillaient à l’usine habitaient la ville. On y allait de père en fils d’ailleurs. Et puis tout ça a changé, dans les années 2000 : les gens viennent y travailler, mais habitent beaucoup plus loin. » Cette dynamique a été accentuée par la fusion, effective depuis début 2024, des communes d’Oullins et de Pierre-Bénite. De nouveaux habitants, plus aisés, ne travaillant pas à l’usine et n’en ayant qu’une faible connaissance, cohabitent désormais avec ceux dont elle peuple au contraire l’histoire personnelle ou familiale. « Depuis la fusion avec Oullins, il semblerait que les attentes soient différentes », souligne un industriel.
Surtout, « depuis 1999, du fait que les ressources fiscales de l’entreprise ne sont plus reversées à la ville mais à la métropole », le lien financier entre la commune et l’industriel a disparu, rappelle un élu local. Cela déséquilibre nécessairement la relation entre les habitants et l’usine, puisque cette fiscalité constitue habituellement une forme de contrepartie au risque, comme l’explique le sociologue Emmanuel Henry : « Historiquement, il y avait des grosses retombées fiscales dans les villes concernées. Il y avait des équipements sportifs, des facilités d’équipements culturels qui étaient énormes dans les villes industrielles ou nucléaires. […] C’était souvent le deal dans les régions très industrialisées. » Cette perte de la contrepartie au risque peut expliquer la difficulté des habitants à accepter le risque inhérent aux usines chimiques, comme le souligne un membre des services déconcentrés : « Il y a une perte de culture du risque, et c’est quelque chose qu’on essaye de réinsuffler autour des sites industriels vis-à-vis du public. […] Il faut vraiment expliquer qu’une usine, surtout chimique, contient des produits chimiques… »
La fusion des communes, l’arrivée de nouveaux habitants et la disparition du lien financier entre la ville et l’usine sont donc autant d’éléments qui ont participé à décomposer l’entité « usine-ville », autrefois évidente, en deux éléments désormais bien distincts, l’usine d’un côté et la ville de l’autre. Dans ce processus de distinction, les liens historiques et financiers se sont défaits, remettant en question l’acceptation du risque inhérent à la présence de l’usine.
La révélation de la pollution aux PFAS aux alentours de l’usine
C’est un reportage29 du journaliste d’investigation Martin Boudot qui a révélé, en 2022, le risque de pollution aux PFAS. Son enquête a mis au jour une pollution aux PFAS dans les sols, l’air et l’eau aux alentours des usines. Bien que le sujet des PFAS fût déjà suivi et documenté par la presse régionale, la diffusion de ce reportage a eu beaucoup d’échos médiatiques et a conduit une partie de la population locale à reformuler sa perception du risque. De risque accidentel encouru par les habitants, la pollution aux PFAS est devenue pour certains d’entre eux un « empoisonnement » délibéré. Ce reportage a également été le déclencheur d’un premier mouvement de contestation, qui s’est traduit notamment par l’engagement des antennes lyonnaises d’associations ou de collectifs d’envergure nationale comme Extinction Rebellion ou Notre affaire à tous. Cette mobilisation rapide de ces importantes structures militantes s’est trouvée favorisée par la proximité de Oullins- Pierre-Bénite avec la métropole de Lyon, selon un membre d’un de ces collectifs : « Dans une grande ville, généralement, les organisations sont un peu mieux dotées et plus actives. Et je pense que [Lyon] est une ville plutôt active sur les sujets militants. »
Il faudra pourtant attendre l’annonce de l’extension de l’usine B pour que s’engagent les mobilisations locales les plus vives. Intervenant environ deux mois après les révélations de Martin Boudot, cette annonce est vécue comme une véritable provocation. Cette extension visait à localiser en France la production de BPAF, un nouveau PFAS, produit auparavant aux Pays-Bas. « J’ai lutté très longtemps pour avoir l’info et comprendre qu’il ne s’agissait pas seulement d’une extension mais d’une nouvelle activité. Les habitants se sont vraiment sentis floués », raconte Émilie Rosso, journaliste pour la télévision régionale. « Et, dans l’autorisation d’extension, l’argumentaire de l’industriel revenait grossièrement à dire que l’environnement étant déjà pollué, on pouvait se permettre d’ajouter une substance », ajoute le sociologue Valentin Thomas. Cette extension, annoncée dans un contexte tendu, a donc amplifié les inquiétudes et la méfiance de la population à l’égard des deux industriels.
Pourquoi la contestation a-t-elle été si tardive ?
S’il a fallu attendre 2022 et le reportage de Martin Boudot pour que la population se mobilise activement contre les risques liés à l’exposition aux PFAS, cette problématique est pourtant connue de longue date. Dès 2005, aux États-Unis, l’industriel DuPont avait été condamné à verser 16,5 millions de dollars à l’Agence de protection de l’environnement américaine pour avoir dissimulé des résultats d’études internes sur la toxicité d’un perfluoré, le PFOA. En France, dès 2009, l’Anses a été saisie par la Direction générale de la santé afin d’évaluer les risques sanitaires dus à l’exposition à deux perfluorés, le PFOA et le PFOS.
Le caractère tardif de cette mobilisation s’explique d’abord par la complexité du sujet, selon Martin Boudot : « Les PFAS, ce sont des milliers de composés chimiques, pas comme le glyphosate ou l’amiante. » Par ailleurs, la population la plus proche des usines est une population très peu aisée, ayant des préoccupations plus urgentes que de se mobiliser sur ce sujet. « Je suis allée enquêter dans les barres d’immeubles, où les habitants sont les premiers exposés, raconte Émilie Rosso. Soit ils parlent peu français, ce qui freine leur compréhension du problème, soit ils disent que leur problème majeur est le pouvoir d’achat et rappellent que l’usine emploie les jeunes. »
Ensuite, la survenue de plusieurs accidents industriels majeurs en France (la raffinerie de Feyzin dans le Rhône en 1966, AZF à Toulouse en 2001, Lubrizol à Rouen en 2019) a concentré l’attention du public sur le risque sécuritaire, laissant moins de place à l’étude « des potentielles expositions toxiques dues à des rejets moins spectaculaires mais plus constants », note Valentin Thomas. Plusieurs membres des organismes publics chargés de la prévention des risques et de la sécurité témoignent du nombre important de sujets à traiter, qui impose une priorisation des dossiers. La France a donc priorisé les pesticides, les engrais et le bisphénol A.
En outre, la mise sur le marché des agents chimiques utilisés dans l’industrie requiert souvent la seule autorisation de l’agence européenne des produits chimiques, l’ECHA30, qui ne fonctionne pas de la même manière que son homologue chargée de la sécurité des aliments, l’EFSA31. Cette distinction des rôles et des procédures ralentit d’autant l’émergence des controverses sanitaires et environnementales liées à ces molécules, dont l’analyse arrive a posteriori. « Dans le cas des OGM et des pesticides, l’évaluation scientifique des risques est un préalable à leur autorisation par l’EFSA. Cette dernière n’est en revanche pas impliquée dans le processus d’autorisation initiale des PFAS. L’avis rendu sur les PFAS par l’EFSA a en effet été commandé par la Commission européenne, car ces derniers se retrouvent dans les aliments », souligne un chercheur d’une agence européenne. De son côté, l’ECHA applique la réglementation européenne REACH, relative aux substances chimiques, qui participe à compliquer la prise en compte des effets des PFAS par les riverains. D’une part, REACH fonctionne molécule par molécule, or les PFAS représentent plusieurs milliers de molécules différentes. D’après Valentin Thomas, cela serait donc beaucoup trop long à réglementer : « Les systèmes de surveillance des produits chimiques sont incapables de saisir des groupes de substances. » D’autre part, Émilie Rosso explique que la réglementation ne concerne pas les espèces chimiques intermédiaires générées au cours de la transformation et faisant pourtant partie des rejets.
Les tensions structurelles autour de la gestion du risque
Lorsque les habitants se sont emparés du sujet, un mouvement qualifié de « panique » par les acteurs industriels ou de « crise » par les autorités publiques a bousculé le cours de la gestion des risques menée habituellement en binôme par l’industriel et l’inspection. Par une succession de mobilisations, les citoyens ont imposé aux autres parties prenantes une « accélération à marche forcée », raconte un représentant de l’administration. Les associations, collectifs et collectivités en ont appelé au principe de précaution pour mettre immédiatement en place des mesures de protection des populations exposées aux PFAS, dont on ne connaissait pas avec précision les effets sanitaires et environnementaux.
Le difficile déclenchement du principe de précaution
Cette étude de cas révèle combien, dans les faits, le principe de précaution est encore mal appréhendé par les autorités, tant il est difficile pour elles de déterminer quand il est pertinent de le déclencher, d’une part, et d’en anticiper les conséquences économiques, d’autre part. Théoriquement, il sert pourtant aux autorités à surmonter l’un des principaux freins à la décision : l’absence de certitude scientifique. Il vise en effet à articuler dans un même temps l’action politique avec l’exploration scientifique nécessaire à l’appréciation d’un risque avéré (Barthe, Callon et Lascoumes, 2001).
Pour analyser l’impact environnemental et sanitaire d’une molécule, les scientifiques doivent développer des méthodes de mesure et de collecte rigoureuses. Ce travail demande de nombreuses années, comme en témoignent plusieurs chercheurs des agences de l’État interrogés : « Développer une méthode, ça ne se fait pas comme ça. […] Il faut des standards pour s’assurer qu’on analyse bien la substance que l’on veut identifier et caractériser. […] Maintenant, ça va un peu plus vite parce qu’on a des outils d’extraction, mais tout ce process est long à mettre en place. » Se pose également le problème du temps nécessaire à l’industriel pour développer de nouvelles molécules. Si une substance doit être retirée du marché, il faut « parfois dix ans de R&D pour [lui] substituer une substance ayant le même effet », note un industriel. Des années de développement auxquelles s’ajoute par ailleurs un long processus d’homologation.
Le code de l’environnement prévoit que « l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement à un coût économique acceptable »32. C’est la formulation précise du principe de précaution. Dans le cas des PFAS, chaque rapport présente un état des lieux toujours plus inquiétant sur cette pollution. En 2008, l’EFSA a publié une première étude et conseillé de récolter davantage de données sur ces substances. Puis, en 2011, un rapport de l’Anses a dressé un état des lieux de la pollution assorti des premières mesures à mettre en place pour protéger l’environnement : « Considérant les importantes quantités de PFC déversées dans l’environnement au niveau des deux sites industriels étudiés, il conviendrait d’entreprendre des études sur l’impact environnemental pour les deux cours d’eau concernés (sédiments, biote,…). La mise en place de stations d’épuration industrielle adéquates permettrait de réduire le flux de pollution. » D’autres études scientifiques ont ensuite été menées, aux niveaux européen et national, confirmant systématiquement l’existence d’un problème sanitaire et environnemental. Néanmoins, la difficulté pour les autorités reste de définir le coût économique des mesures qu’elles pourraient prendre au nom du principe de précaution. Aussi, en dépit des études conduites depuis 2009 sur les PFAS à l’échelle nationale, il a fallu attendre 2022 pour que ce principe de précaution soit déclenché et que des mesures soient prises pour protéger l’environnement et la population d’un éventuel danger. Après l’alerte médiatique et citoyenne relatée ci-dessus, trois arrêtés préfectoraux successifs ont cherché à endiguer les potentiels dommages occasionnés par la pollution aux PFAS. Le premier prescrivait une surveillance renforcée de ces substances chimiques dans les procédés des usines A et B et leurs rejets liquides. Une analyse quotidienne des rejets aqueux a ensuite été ordonnée le 1er juin 2022. En septembre de la même année, un nouvel arrêté a allégé la fréquence de surveillance du procédé de l’usine B, tandis qu’il a prescrit à l’usine A la cessation de l’utilisation de toute substance PFAS au plus tard le 31 décembre 2024.
Ces mesures se sont toutefois révélées insuffisantes pour mettre fin à l’expression d’inquiétude de la part des opposants et reconstruire un lien de confiance avec la population. « L’arrêté préfectoral demandait à [l’industriel A] d’arrêter d’utiliser le 6-2-FTS en janvier 2025. Mais ils ont demandé ça parce que c’était déjà dans le plan d’action [de l’industriel] de ne plus utiliser de PFAS pour la production du [produit phare de l’industriel] à partir de janvier 2025 », rapporte un collectif. En d’autres termes, les opposants au projet reprochent à l’arrêté de n’être une décision préfectorale qu’en apparence, et réprouvent le fait qu’il puisse reposer sur un compromis avec l’industriel.
Les collectifs citoyens, acteurs du « déconfinement » du débat portant sur le risque industriel
Le cas d’Oullins-Pierre-Bénite a également mis en évidence le risque pour les élus locaux d’apparaître démunis, voire impuissants face aux questions soulevées par des projets industriels majeurs. Certaines parties prenantes à la controverse ont en effet vu en eux de simples porte-voix de décisions et d’avis émis par les services déconcentrés de l’État, sans capacité de remise en question ni de prise de distance.
Rappelons d’abord à ce sujet que les municipalités n’ont ni la vocation ni la compétence d’évaluer les risques associés à la présence d’une usine. Ces évaluations sont faites par l’État, sans que le cheminement menant aux résultats ne soit communiqué aux élus. Comme le souligne l’un d’entre eux : « C’est toujours la difficulté, on ne sait pas tout. Nous, on délivre uniquement un permis de construire en vérifiant s’il est compatible avec le plan local d’urbanisme. Mais pour tout ce qui a trait à l’exploitation et aux éventuelles difficultés liées à la production, cela relève effectivement de l’État, pas de nous. […] Normalement, on devrait se fier aux services de l’État. C’est ce qu’on fait. » Les questions d’exploitation ne donnent donc pas lieu à un débat, mais plutôt à une forme de consultation de l’État par les élus. Cette configuration peut faire croire que des questions et préoccupations émises par les riverains et relayées par les élus sont évacuées par des arguments d’autorité. Les élus sont même incités à ne pas relayer leurs inquiétudes auprès des habitants : « Je rappellerais qu’encore en 2020, quand on demandait à l’État et à un certain nombre d’organismes publics “ est-ce qu’il n’y aurait pas un sujet ‘ perfluoré ’ chez nous ? ”, on nous répondait “il n’y a pas de norme, donc il n’y a pas de sujet”. » Les élus déplorent donc une forme d’incapacité à se faire une place dans le débat, qui resterait confiné à des négociations entre l’industriel et les services de l’État.
De leur côté, certains citoyens estiment que la soumission des élus aux avis de l’État, pour conforme qu’elle soit au droit, peut aussi être utilisée pour se déresponsabiliser et justifier leur inaction : « Dès lors que l’ARS a dit “ oui il y a un dépassement de seuil, mais il n’y a pas de risque sanitaire ”, les élus se sont réfugiés derrière cette conclusion. Ils ont dit “ s’il n’y a pas de risque sanitaire, il n’y a pas de raison de bouger ”. », relate un membre de collectif citoyen. Quelle que soit la légitimité de l’inaction des élus, on observe que celle-ci devient intrinsèquement le ferment d’une défiance de la part des citoyens, qui estiment alors ne plus pouvoir s’exprimer par leur voix.
Plusieurs collectifs ont donc formé une voix citoyenne capable de « déconfiner » le débat. De nouvelles formes d’expression telles que la « science citoyenne », les actions dites coup de poing ou encore le témoignage dans les médias leur ont permis de se positionner dans les rapports de force. Un membre de collectif explique comment le succès de leurs réunions publiques a poussé les élus non seulement à prendre en considération l’inquiétude des citoyens, mais aussi à agir : « Quand on a organisé la première réunion publique, la salle était trop petite. Deux cent cinquante personnes sont venues et on en a refusé au moins une centaine parce qu’il n’y avait plus de place. Cela a été le point de départ de la prise de conscience des élus du fait qu’il s’agissait d’un sujet qui inquiétait. Ensuite, notre collectif, au départ insignifiant, a pris du poids. À chaque réunion qu’on organisait, on réunissait quatre cents personnes sur un petit village. Les élus interpellés tous les dimanches au marché ont compris que les gens étaient inquiets de la situation et ils ont commencé à bouger. » Les élus ont ainsi organisé des réunions avec les citoyens, mis en place un comité PFAS, participé à des réunions avec l’industriel lors des comités de suivi de site ou encore installé des filtres à charbons actifs dans tous les lieux accueillant des enfants.
Un collectif citoyen souligne l’importance du nombre de participants à ces réunions publiques locales. C’est grâce à cela que ce collectif a construit sa légitimité. De son côté, l’association Bien vivre à Pierre-Bénite existait depuis longtemps. Sa légitimité, déjà acquise, tenait en partie à celle de son président qui siégeait dans différents comités d’information ou de consultation, tant au niveau municipal qu’auprès de l’industriel.
Si les réunions publiques locales ont fait la force du collectif, la diversité des formes de mobilisation33 et leur continuité tout au long des phases de la contestation sont tout aussi importantes. L’association Bien vivre à Pierre-Bénite a permis de lancer l’alerte, puisqu’elle a participé au reportage de Martin Boudot. Ensuite, Ozon l’eau saine a pris le relais et étendu la zone d’influence, en alertant les communes voisines grâce à la mise en évidence d’une large zone polluée. Extinction Rebellion et Générations futures, elles, ont plutôt porté le sujet à échelle nationale.
De nouveaux outils pour définir l’avenir du territoire
Si le cas d’Oullins-Pierre-Bénite met en lumière une attente citoyenne de transparence et d’inclusion dans la gestion des risques de pollution, il révèle également des outils qui permettent d’y répondre.
Faire face à la crise de confiance
Derrière le mouvement de contestation qui a accompagné les projets d’extension des usines A et B, on décèle une perte de confiance plus profonde de la part des citoyens et des élus locaux à l’égard des industriels et de l’État. Le membre d’un collectif relie par exemple sa perte de confiance en l’État à l’incapacité des services déconcentrés à faire émerger la problématique des PFAS : « Jusqu’à il y a encore deux ans, la Dreal ne faisait pas le relevé des PFAS, donc on ne les voyait pas. […] En fait, la Dreal ne faisait pas son travail. » Une association impliquée dans le suivi du site de longue date considère de son côté que l’industriel « a menti » au sujet des PFAS et parle de « trahison ». Plus généralement, c’est la parole des industriels qui en est devenue suspecte, ceux-ci se retrouvant soupçonnés de pratiques d’influence consistant « pour certaines personnes à faire dire aux chiffres ce qui les arrange dans les couloirs de la Commission européenne ». À l’appui de cette accusation, les acteurs associatifs citent une enquête menée par quarante-six journalistes et coordonnée par Le Monde, sur les pratiques des représentants de l’industrie du plastique visant à défendre les PFAS. Dans cet article (Horel, 2025), les journalistes affirment démontrer que « la majorité des arguments des industriels contre l’interdiction des fluoropolymères sont faux, trompeurs et contraires à l’état de la science ». En outre, le remplacement du bisphénol A par des molécules tout aussi problématiques (Michel, 2021) a créé un antécédent, accentuant les doutes sur les solutions alternatives proposées par les industriels en pareille controverse. Un acteur associatif évoque ainsi le concept de « molécule sœur » pour expliquer sa défiance vis-à-vis de l’extension de l’industriel de Pierre-Bénite : « Ils ont demandé un délai qui a couru pratiquement jusqu’à la fin de l’année dernière pour arrêter de balancer ces molécules dans l’eau. […] Ils ont certainement remplacé cette molécule par une molécule sœur en changeant juste deux trois radicaux. »
Figure 3.2 – Comparatif des collectifs citoyens mobilisés au sujet des extensions d’usine à Oullins-Pierre-Bénite
L’évolution constante de l’état des connaissances publiques sur l’ampleur de la pollution et les mesures de protection à prendre participe à l’extension du doute au sein de la population. « Depuis deux ans, on reçoit des messages comme : “Il ne faut plus consommer ça et la zone s’étend. C’est Pierre-Bénite, c’est Oullins, ce sont les quarante communes autour et c’est Lyon 8e aussi.” C’est fou, c’est inimaginable, l’étendue de la zone de pollution et tout ce qu’il est interdit de consommer », déplore un collectif.
Cette perte de confiance est en partie liée au manque de communication de la part de l’industriel. Un membre de l’administration lui préconise « de donner des explications sur les procédés, les risques, la toxicité des substances, etc. C’est le manque d’information qui pèche le plus et qui rend la situation inextricable ». L’industriel A, conscient de cette insuffisance d’information, invoque la complexité du sujet : « Allez expliquer à un non-scientifique ce que sont les PFAS et quel est leur impact, c’est compliqué. » Ce nécessaire travail d’information est aussi souligné par l’administration déconcentrée, qui évoque des efforts à accomplir pour « rapprocher des mondes qui se connaissent peu ». L’industriel A reconnaît qu’un « changement est à opérer » en termes de culture : « La chimie, […] ce n’est pas du B2C [business to consumer], ce n’est pas une industrie qui a l’habitude de communiquer auprès du grand public. […] Néanmoins, beaucoup de données sont publiques puisque nous sommes sur un site Seveso. »
Face à cette perte de confiance, journalistes, collectifs et associations font appel à la transparence. Une demande qui se heurte à plusieurs obstacles. Un premier est le « secret de fabrication », qui autorise les industriels à ne pas divulguer l’ensemble des noms des molécules utilisées dans leurs procédés. « Tous les documents qui sont mis à disposition du public sont biffés pour des raisons de secret industriel et, moi, je mets des mois à obtenir des documents qui ne sont pas biffés », témoigne Émilie Rosso.
Un deuxième obstacle est la difficulté d’accès aux documents, doublée selon une représentante d’association d’un manque de lisibilité : « D’abord il faut les trouver, ensuite il faut les comprendre. Un relevé d’inspection, ce sont des catégories, des trucs qui sont issus du droit des ICPE. »
Mais faire preuve de transparence ne suffit pas à répondre aux attentes d’un public qui a perdu confiance en la parole du binôme industrie-État : « Je veux bien que la Dreal contrôle, mais je voudrais que nous puissions contrôler aussi », résume ainsi le membre d’une association de riverains. Les citoyens ont la possibilité de demander des analyses par le biais d’actions en justice ou d’encourager l’investigation par les médias. En outre, selon un membre d’une agence de l’État, « le fait que les recommandations de l’Anses soient publiques permet justement de rendre les problèmes publics. [….] Et si le gouvernement ne fait rien en réponse à une recommandation de l’Anses, c’est très facile pour les ONG – qui d’ailleurs ne s’en privent pas – de mobiliser les médias en disant que l’Anses a fait une recommandation et qu’il ne s’est rien passé. »
Néanmoins, le cas d’Oullins-Pierre- Bénite montre que les citoyens expriment le besoin de s’impliquer davantage dans la production d’information et que cela peut répondre à leur sentiment d’absence de dialogue ou de limite de la transparence. Ainsi, un collectif d’habitants a choisi de s’engager plus directement en organisant des réunions publiques, durant lesquelles un riverain docteur en chimie vulgarise les aspects scientifiques de la pollution aux PFAS et forme des citoyens au prélèvement afin de produire des analyses des sols. Ce collectif a transcrit ses propres « questions de recherche »34 dans un « partenariat » avec le laboratoire d’un chercheur canadien (voir plus loin). Un projet d’institut écocitoyen local est en outre étudié sous l’impulsion de la Métropole, indique Amandine Jacquet, directrice de la mission territoriale Vallée de la chimie. Ce projet repose sur le même principe que l’institut existant à Fos-sur-Mer et décrit par Valentin Thomas : « C’est un institut écocitoyen qui s’est formé à Fos-sur-Mer pour essayer de mesurer les pollutions industrielles dans la région, de façon un peu alternative aux institutions d’expertise qui existaient déjà, ou aux manières de faire de l’expertise qui existaient déjà. Il s’agit, un, de produire des connaissances sur ces pollutions industrielles, alors que ce n’était pas fait jusque-là. Et, deux, de se saisir de la question de ces pollutions d’une manière plus pertinente que les protocoles scientifiques qui prévalaient jusque-là. »
Le sociologue Emmanuel Henry décrit cette forme d’initiative comme une coopération des « recherches confinées » et « en plein air » : « Ce sont des formes de production de connaissances qui s’appuient beaucoup sur des alertes citoyennes, et qui adaptent les méthodes en fonction des connaissances précises qu’ont les populations des zones contaminées. […] L’institut écocitoyen, c’est essayer d’hybrider les standards scientifiques académiques avec des connaissances locales. »
Des projets participatifs, dont une étude des liens entre cancers et exposition aux PFAS, sont mis en place avec l’institut de Fos-sur-Mer et la Métropole de Lyon. Sans chercher à rétablir la confiance avec l’industrie, ils visent, en partenariat avec les riverains, à identifier des questions, à concevoir des méthodes et à conduire des études pour permettre, par exemple, de répondre aux questions que certains riverains se posent, à la fois sur les effets de l’exposition aux PFAS et sur les mesures de suivi médical recommandées à la suite de l’exposition.
Oullins-Pierre-Bénite comme laboratoire
Alors que d’autres sites industriels français pourraient, à première vue, être confrontés à des controverses très proches de celle d’Oullins- Pierre-Bénite, il semble que l’attention médiatique, législative et technologique, soit restée focalisée sur la région lyonnaise, ce qui en fait toute la singularité. Nous pouvons ainsi analyser ce site comme un « laboratoire », au sens proposé par l’Académie française : « Un lieu où l’on réunit et dispose les installations et produits nécessaires à des recherches, à des expériences, à des contrôles scientifiques et techniques. »
D’abord, Oullins-Pierre-Bénite fait office de laboratoire scientifique, un lieu où se sont croisés compétences et matériaux de recherche. La cartographie de la pollution aux PFAS permet la compréhension de son histoire, sa dynamique de diffusion et sa persistance. Les premiers prélèvements, faits par le journaliste Martin Boudot et analysés dans un laboratoire aux Pays-Bas, ont constitué les premières mesures françaises. Comme nous l’a expliqué le journaliste : « Ils [le laboratoire aux Pays-Bas] n’avaient aucune donnée venant de France, donc ça les intéressait beaucoup. On a trouvé un partenariat économique avec eux […] et on a commencé à réaliser tout un mapping, une cartographie de la pollution potentielle autour de Pierre-Bénite. »
Les résultats de ces mesures, montrant des taux de pollution aux PFAS très élevés, ont confirmé qu’Oullins- Pierre-Bénite réunissait des conditions intéressantes pour étudier le phénomène. À la suite de la diffusion du documentaire Vert de rage, on l’a vu plus haut, un collectif citoyen s’est emparé de la problématique en effectuant ses propres mesures à différents endroits du territoire pour confirmer ses hypothèses quant aux sources de contamination de son réseau d’eau potable : « On s’est dit qu’il y avait soit une autre source de contamination qui pouvait être l’air, soit un jeu de vases communicants entre le Rhône et un territoire plus élargi du fait qu’une grosse partie de la zone sud-est de Lyon est irriguée avec de l’eau du Rhône. C’était une première hypothèse qu’on a cherché à valider, donc on a fait des mesures de l’eau d’irrigation. » Ces réflexions sont menées en partenariat avec une équipe nord-américaine. Ainsi, les mesures utilisées à des fins locales enrichissent la recherche internationale et viennent compléter une cartographie mondiale en construction. Ces résultats ont également ouvert des recherches au niveau national sur le plan sanitaire, comme celle mentionnée plus haut, collaboration de Santé publique France avec l’institut écocitoyen de Fos-sur-Mer, pour entreprendre la première étude française de biosurveillance humaine en polluants PFAS chez les riverains des industries35. Les mesures prises à Oullins-Pierre-Bénite ont enfin permis de rouvrir le débat sur les seuils et les valeurs toxicologiques de référence (VTR), puisque « l’Anses a été mandatée pour fournir de nouvelles valeurs toxicologiques de référence à partir de mai-juin 2025 », souligne le membre d’un collectif.
L’apport de ce cas se manifeste aussi sur le plan réglementaire. En effet, un industriel rencontré se décrit lui-même comme un « poisson-pilote », « préfigurateur de la réglementation » de façon générale. On sent de la part de certaines parties prenantes locales une volonté de répliquer ailleurs les efforts de réglementation accomplis dans cette région, comme nous l’explique Denis Bariod, coréférent Générations futures Lyon : « Générations futures a vérifié les résultats des analyses de PFAS dans toutes les Dreal de France. Devant l’inégalité des données communiquées, un courrier a été envoyé au gouvernement et à toutes les préfectures de région pour demander que les informations soient les mêmes que celles transmises par la Dreal Auvergne-Rhône-Alpes. » Un élu affirme de son côté que « l’État essaie de se servir du cas de la métropole de Lyon pour faire un exemple à dupliquer sur tout le territoire national ».
Le cas d’Oullins-Pierre-Bénite se distingue également sur le plan juridique. Les acteurs, en multipliant les recours, ont affiné leur compréhension des modes d’action les plus efficaces pour défendre leur point de vue. Ils ont notamment eu recours à un référé pénal environnemental, dont l’objectif est de mettre un terme à une pollution constatée dans des délais très courts. Il s’agit d’un outil de contestation juridique encore jeune (2020) et dont l’utilisation et les conséquences dans la vallée de la chimie serviront de fondement pour des cas analogues à l’avenir. En parallèle, des plaintes contre X ont été déposées contre plusieurs industriels pour « mise en danger de la vie d’autrui ». Comme nous l’a expliqué un avocat : « J’aime bien présenter la vallée de la chimie comme un laboratoire juridique, parce qu’on a essayé des choses juridiquement. On finit par avoir une sorte d’échantillon de procédures, de modes d’action, de stratégies contentieuses, on voit ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Ce sont des recettes, des stratégies qui pourraient être répliquées ailleurs. » Chaque « bataille » juridique, quelle que soit son issue, peut être interprétée comme un essai technique dans une conjoncture inédite, et vient donc compléter l’état de l’art.
Enfin, il semble important de souligner que la diversité des acteurs qui y ont interagi a fait de Pierre-Bénite un laboratoire démocratique. Les collectifs citoyens engagés, décrivant un large panel des formes de mobilisations et d’expression possibles, pourraient donner naissance ensemble à un institut écocitoyen, produit hybride de leurs actions. L’exploration est toujours en cours pour définir les traits de cet institut, comme l’explique une association : « […] à Fos-sur-Mer, c’est un modèle uniquement scientifique. Nous, dans la vallée de la chimie, on plaide pour la création d’une branche juridique qui serait chargée de suivre les relevés d’inspection, de créer de l’information territorialisée. Quand on a fait des ateliers écocitoyens dans la vallée de la chimie pour estimer avec les riverains la faisabilité d’un projet comme ça, il y avait plein d’autres branches envisagées par les gens. Est-ce qu’on ne ferait pas une branche sociologique, une branche économique ? La recherche sur d’autres thématiques, ça peut être intéressant. »
Un membre de collectif va plus loin, et permet de comprendre pourquoi cet institut écocitoyen pourrait être perçu comme la « naturalisation » de leurs actions conjointes : « Si un institut écocitoyen se crée, nous, on n’a plus de raison d’exister. L’idée, ensuite, c’est que les membres du collectif puissent agir en tant que citoyens au sein de l’institut, et ce sera à l’institut de prendre le relais et d’aller mener des démarches un peu plus approfondies sur les choses que, nous, on a pu commencer à éclaircir un peu. » Cet institut pourrait donc être un moyen pour les citoyens de prendre part à la gestion du risque industriel.
- 29 — Ce reportage sur les PFAS est un épisode de la série documentaire Vert de rage, diffusée entre 2018 et 2024 sur France 5.
- 30 — European Chemicals Agency
- 31 — European Food Safety Authority
- 32 — Article L110-1 du code de l’environnement dont la valeur est depuis 2005 constitutionnelle.
- 33 — Outre les réunions, un collectif utilise habituellement la publicisation d’actions « coup de poing ». Ces actions, par leur caractère choquant, permettent une médiatisation forte et immédiate, donnant d’emblée une force à leur voix.
- 34 — Nous mobilisons ici les concepts associés aux degrés de coopération entre recherche confinée et recherche de plein air, introduits dans l’ouvrage Agir dans un monde incertain (chapitre 4).
- 35 — Métropole Grand Lyon. Communiqué de presse – Pollution aux perfluorés : « La Métropole de Lyon invite les citoyens à participer à des ateliers ». 25 octobre 2023.
L’usine Bridor à Liffré et la mise en question de l’utilité d’un projet industriel – Par Élisa Cotet, Robin de Truchis, Benjamin Grept, David Jung, Jules Parfouru, Kilian Provost
Bénéficiant de l’appui des élus locaux et présentant peu d’externalités négatives, le projet d’implantation d’une usine Bridor de production de pains et de viennoiseries surgelés à Liffré, en Bretagne, a pourtant avorté en raison des contestations qu’il a suscitées. Ce cas emblématique met au jour les attentes des populations à l’égard du rôle économique et sociétal d’un projet industriel.
Présentation du projet
Le groupe Le Duff est une multinationale du secteur alimentaire fondée en 1976, date d’ouverture de la première enseigne Brioche Dorée, à Brest, par Louis Le Duff. Le groupe breton, dont le siège social est situé à Rennes, a réalisé un chiffre d’affaires de l’ordre de 3 milliards d’euros en 2024. Il est constitué de huit filiales. Certaines sont spécialisées dans la restauration rapide ou traditionnelle, comme Del Arte et Brioche Dorée ; d’autres, comme Bridor, produisent des denrées alimentaires.
Bridor constitue l’essentiel du chiffre d’affaires du groupe Le Duff. L’enseigne produit des pains et des viennoiseries individuelles à destination des autres filiales du groupe et de clients à l’international, notamment dans l’hôtellerie de luxe.
Dans le cadre de sa stratégie d’extension de ses capacités de production, le groupe Le Duff a annoncé fin 2019 un investissement de 250 millions d’euros pour l’ouverture d’une nouvelle usine Bridor, à Liffré, en Bretagne. Baptisée Bridor 3, cette usine devait s’implanter dans une nouvelle zone d’activité, Sévailles 2, à proximité de l’A84 sur l’axe Rennes-Caen. Avec ses dix lignes de production, elle devait permettre la création de 500 emplois à terme et réaliser 30 % de l’activité de Bridor.
Le territoire de Liffré présentait de prime abord des caractéristiques qui en faisaient un site idéal pour l’implantation de ce projet industriel. Celui-ci disposait en outre du soutien actif de l’intercommunalité de Liffré-Cormier Communauté (LCC) et de celui d’élus du groupe Rassemblement national au conseil régional de Bretagne.
Figure 4.1 – Chronologie du projet Bridor
Une contestation environnementale s’est toutefois rapidement instaurée, remettant en cause la pertinence de cette installation industrielle à Liffré. Le collectif de citoyens CoLERE, né à cette occasion, ainsi que des associations de protection de l’environnement, comme Extinction Rebellion Rennes et Eaux et Rivières de Bretagne, se sont manifestés pour contredire les arguments avancés par le porteur de projet et souligner des problématiques jusqu’alors oubliées dans le cadre des études en amont. Compte tenu de la dimension du projet, ces divergences ont fait l’objet d’une concertation publique pour permettre une confrontation des arguments des différents acteurs. Cette phase de dialogue n’a pas suffi. Se sont alors mises en place des actions variées, allant de l’organisation de collectifs d’opposants et de manifestations aux recours devant les tribunaux, en passant par des actions plus violentes de contestation. Le 30 mai 2023, l’entreprise a annoncé renoncer à son investissement en raison des retards qu’occasionnaient les recours juridiques contre le projet.
Cette étude repose sur la réalisation d’une revue de presse, d’une analyse des documents disponibles relatifs au projet, et de quinze entretiens avec les représentants de différentes parties prenantes lors d’un voyage de terrain en région rennaise dans la semaine du 20 janvier 2024. Ont été interrogés : un représentant du groupe Le Duff, des représentants de la commune de Liffré et de la LCC, trois élus d’affiliations politiques différentes, trois associations de protection de l’environnement ou de représentation des riverains et cinq instances tierces indépendantes s’étant positionnées sur un aspect particulier du dossier ou ayant pris part de manière active au déroulement de la procédure.
D’un conflit de territoire à un conflit substantiel
L’abandon du projet présente des traits « classiques » que l’on retrouve dans des cas similaires (controverse environnementale, place de l’emploi dans les débats, choix du territoire…) ; mais ses particularités et les processus ayant mené à son échec en font un cas à part dans le paysage industriel français.
L’emploi, l’environnement et l’usage des ressources ont représenté les principaux nœuds de la discorde entre les parties prenantes, qui ont chacune défendu une vision nourrie de justifications. Mais, au-delà du débat argumenté autour de ressources territoriales, le conflit s’est déplacé vers des préoccupations plus larges relatives au système économique.
Une vision non partagée du territoire
Le choix même du territoire de Liffré et du site d’implantation du projet a constitué le point de départ de la controverse. La communauté de communes Liffré-Cormier Communauté est composée de neuf municipalités regroupant au total plus de 27 000 habitants. Issue de l’agrandissement d’une intercommunalité précédente (Pays de Liffré), LCC s’est créée en 2017 autour de Liffré, la plus grande des neuf communes, avec près de 9 000 habitants. « Liffré-Cormier Communauté s’est constituée à la suite d’un combat épique, puisque c’était contre l’avis du préfet », raconte un élu de LCC. « Il faut aussi avoir ça en mémoire parce que, dans les choix qui ont été faits par l’intercommunalité de Liffré-Cormier, l’accueil de l’entreprise Bridor était le signe du développement d’un territoire qui s’organisait d’une façon plus autonome, plus libre », ajoute un représentant de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe). Ses élus se sont en effet positionnés dès le début du projet en soutien à l’implantation de l’usine.
Le choix de ce lieu d’implantation était a priori pertinent, compte tenu de la place prépondérante de l’industrie agroalimentaire en Bretagne, tant par son poids économique que par la notoriété de grandes entreprises bretonnes du secteur. Un représentant du Medef Bretagne rappelle qu’aujourd’hui « la Bretagne est la première région agricole d’Europe et [qu’elle] s’adosse à une puissante industrie agroalimentaire », résultat d’une volonté historique de favoriser le développement des capacités agricoles du pays dans l’après-guerre. Un représentant de la Chambre de commerce et d’industrie d’Ille-et-Vilaine confirme le poids de l’industrie agroalimentaire dans la région et souligne que la compétitivité du modèle breton repose sur des volumes de production élevés : « C’est une industrie basée sur de forts volumes pour compenser la faible valeur ajoutée. On a beaucoup d’industries, beaucoup d’agriculteurs, un système de financement par les banques, et un système qui encadre l’agriculture et l’agroalimentaire comme les chambres d’agriculture, etc. »
Le groupe Le Duff s’inscrit pleinement dans cet univers breton de « l’agrobusiness », du fait de son histoire et de la présence d’une usine et de son siège social. Le représentant de l’entreprise met d’ailleurs l’accent sur les origines bretonnes et « l’aventure entrepreneuriale » du fondateur, Louis Le Duff : « C’est quelqu’un qui a donné beaucoup de son temps à la Bretagne, qui a donné beaucoup à travers les emplois et qui a fait vraiment des investissements majeurs ici et dans le reste de la France. »
Pour autant, ce récit, sur lequel s’alignent spontanément les représentants du monde économique de Bretagne et ceux de l’entreprise et de son fondateur, ne constitue pas une évidence pour d’autres acteurs. Il existe en effet une autre « vision » du territoire, centrée sur le patrimoine naturel et la paysannerie. La MRAe le souligne : « Cela participe d’un débat qui est très ancien dans notre région. Il ne faut pas oublier que dans les années 1960, la région Bretagne était une région en pleine dépression, avec des fuites de population, une sous-industrialisation. Aujourd’hui, demeure l’idée selon laquelle le développement industriel au sens très général du terme est une condition absolument indispensable pour que la région vive, respire, se développe. Mais il existe aussi un contre-courant plus moderne estimant que le territoire Breton, c’est un patrimoine, c’est de l’agriculture, ce sont des sols, c’est un climat, ce sont des paysages. » Ce décalage dans les imaginaires territoriaux n’est pas anecdotique : il est une première difficulté pour asseoir la légitimité du projet.
L’emploi, un argument in fine peu pris en considération
Au-delà des liens symboliques avec la région, la zone de Liffré semblait objectivement idéale pour cette implantation industrielle : à proximité d’une autre usine de la même entreprise, une culture industrielle et ouvrière forte et, habituellement, une bonne acceptation de ce type de projet, comme en témoignent d’autres installations dans le département, telles que celles de l’abattoir de Vitré ou de l’usine automobile Delphi, à 10 kilomètres de Liffré.
Ce projet mené par Bridor promettait en outre la création à terme de 500 emplois, essentiellement ouvriers, au moyen de vagues de recrutement successives sur le territoire. Pour un territoire, une telle implantation est a priori un événement positif, de nature à soutenir l’emploi. Les entreprises qui s’installent attirent des travailleurs et leurs familles, ce qui renforce la démographie du territoire et le dynamisme économique local36.
Pourtant, les oppositions qui se sont exprimées autour de ce projet montrent à quel point cette question de l’emploi est sensible, et qu’on ne saurait la réduire à l’intuition que toute création d’emplois a nécessairement un impact positif. En effet, chaque territoire relève d’un bassin d’emploi spécifique, dont les besoins et les contraintes ne peuvent s’accommoder de tout projet d’implantation. Dans le cas de Bridor, l’argument de l’emploi est ainsi, peu à peu, venu alimenter non pas le soutien mais l’opposition au projet. Certains acteurs ont notamment évoqué la difficulté à recruter sur les sites industriels existants dans la zone. Eau et Rivières de Bretagne rappelle que « sur le territoire de Liffré, c’est le plein-emploi. Le taux de chômage n’est que de 5 % ». Un argument également défendu par un sénateur écologiste : « Est-ce une bonne chose d’avoir 500 emplois dans ce secteur-là ? Non, parce que c’est un des territoires français où il y a le moins de chômage. »
Par ailleurs, la nature des emplois déjà présents sur le territoire a, elle aussi, joué un rôle important dans la réception du projet d’usine à Liffré. Selon un représentant politique de la région, opposé au projet, « la commune de Liffré, en bordure de la métropole de Rennes, a un bassin d’emploi plutôt tourné vers le tertiaire, à l’inverse du bassin de Fougères, plus ouvrier ». À cette aune, Liffré ne constituerait donc pas un territoire pertinent pour y installer des emplois ouvriers. Ce point est confirmé par un représentant de la Chambre de commerce et d’industrie du département : « À Liffré, on a un profil d’habitants périurbains d’une métropole, avec plus de cadres, davantage diplômés, etc. » Les habitants du territoire, selon certains opposants au projet, travaillent essentiellement à Rennes et occupent des positions dans le tertiaire plutôt que dans l’industrie.
Il y avait donc, selon certains acteurs opposés au projet, une inadéquation entre les attentes de l’entreprise et la réalité du bassin d’emploi. La direction du groupe Le Duff affirme malgré tout qu’elle aurait réussi à recruter suffisamment d’employés pour cette usine : « Il y a une tension sur le recrutement en Bretagne, c’est sûr, mais ça ne veut pas dire qu’on ne trouvera pas les emplois. » Selon elle, l’échelonnement du recrutement sur une durée suffisante ainsi que la relocalisation de certains emplois depuis l’usine de Servon-sur-Vilaine auraient permis de combler relativement aisément les besoins en main-d’œuvre. Les élus locaux de Liffré et de LCC avancent aussi que les récentes politiques de logement et de développement du territoire conduisent à l’arrivée de nouveaux habitants qui sont plutôt des « employés » que des « cols blancs ». Enfin, le Medef, soutien du projet du groupe Le Duff, met en doute la pertinence de l’argument portant sur les difficultés de recrutement. Selon l’un des représentants de l’antenne bretonne du Medef, « cela ne doit pas être une raison pour ne pas investir ».
Un impact écologique insuffisamment anticipé
Un autre argument des opposants au projet portait sur son impact écologique. L’usine Bridor aurait été la plus grande de toutes les usines de boulangerie-pâtisserie-biscuiterie du département37. Elle aurait occupé une surface artificialisée de plus de 20 hectares sur une zone naturelle et agricole, consommé 180 000 m3 d’eau par an et entraîné le transit de 150 camions par jour.
La question de l’eau potable a rapidement été placée au centre des débats, la région ayant été touchée par un épisode de sécheresse historique en 2022. Cette question porte à la fois sur des enjeux économiques, physiques et géographiques. La Bretagne ayant la particularité de ne pas avoir beaucoup d’aquifères profonds et, donc, pas de grandes réserves d’eau, l’approvisionnement se fait à travers un réseau. Aussi, en période de sécheresse, l’autorisation d’accès à la ressource en eau est très stratégique dans cette région : il s’agit de décider qui peut consommer alors que la ressource peut être temporairement sous contrainte. Un représentant du comité de bassin Loire-Bretagne38, qui s’est opposé au projet, affirme que la gestion de la ressource en eau sur le site de Liffré a constitué un des problèmes majeurs de l’usine Bridor : « Le problème […], c’est qu’il n’y a pas d’eau potable et pas de capacité épuratoire à cet endroit-là. » De son côté, la LCC affirme que l’eau n’est pas un problème : « Est-ce que j’ai assez d’eau pour le territoire et mettre dix entreprises ? Je vous réponds oui. » Pour la LCC, l’impact d’une usine sur la consommation en eau reste marginal par rapport à la consommation d’une grande ville voisine : « Avec une très grosse ville comme Rennes à côté […], si je consomme 100 000 m3 ou 200 000 m3, est-ce que ça pose un problème ? La réponse est non. C’est objectivement non. »
Du fait de cette tension sur la ressource en eau, accentuée par le développement urbain, il a été demandé à Bridor de prouver qu’il limiterait son impact. « C’est aux porteurs de projet de faire la démonstration des impacts cumulés. Une entreprise de cette taille est suffisamment structurée pour que son étude d’impact en fasse la démonstration », défend la MRAe.
Outre sa consommation en eau, Bridor devait aussi montrer que son implantation induirait une transformation modérée du territoire. L’entreprise devait artificialiser en grande partie la zone cible, où se trouvent une tête de bassin-versant, des zones humides, des refuges de biodiversité, une zone agricole, ainsi qu’un maillage bocager. Le porteur de projet devait alors s’inscrire dans différentes démarches réglementaires visant à respecter le principe « éviter, réduire, compenser » (ERC)39 ainsi que les plans de développement locaux. Or, les associations opposantes comme Eau et Rivières reprochent à Bridor de ne pas avoir été capable de le faire dans un contexte industriel et climatique nouveau : « Aujourd’hui, on ne peut pas faire sans ces paramètres. On sait qu’ils existent et le changement climatique est là. On ne peut plus faire des projets industriels comme il y a cinquante ans. Il faut que les industriels évoluent et prennent en compte leur territoire quand ils développent leurs projets. »
Le territoire a par ailleurs des particularités qui compliquaient la discussion. Même si un représentant du collectif CoLERE affirme que « n’importe quel technicien travaillant sur la question de l’eau confirmera qu’il est complètement incohérent de construire sur une tête de bassin-versant », la LCC défend son choix de site, assurant qu’il s’agissait du meilleur emplacement possible. La même controverse existait sur la qualification de zone humide et les impacts du projet sur la biodiversité. L’enjeu était alors de bien qualifier le territoire constructible à l’aide du plan local d’urbanisme (PLU). Ce dernier, modifié à la suite d’une expertise menée par un bureau d’études, avait estimé que le choix de Sévailles pour implanter l’usine Bridor était celui qui affectait le moins l’environnement. Néanmoins, lors des phases de concertation, cette conclusion a été fortement remise en cause par Eau et Rivières de Bretagne : « On a remis en question les inventaires des zones humides. […] Dans les premiers inventaires de cette zone, réalisés antérieurement à ce projet, il y avait 0 mètre carré de zone humide inventoriée. Une zone humide, ça n’arrive pas par le Saint-Esprit. »
Un projet économique désapprouvé
Certains des opposants au projet Bridor ont également critiqué son volet économique. Le groupe Le Duff, présent dans plus de cent pays, réalise 70 % de ses ventes à l’export. Le site de Liffré avait pour premier objectif de soutenir sa croissance à l’étranger, en particulier en Amérique du Nord, le marché à plus forte croissance pour l’entreprise. Un élu de Liffré a par ailleurs confirmé que deux sites d’implantation bretons étaient en concurrence avec un territoire allemand pour accueillir cette nouvelle usine du groupe.
Cette conception de l’usine de Liffré l’inscrivait pleinement dans un modèle de production à grande échelle. Sa localisation au bord d’une autoroute devait faciliter son intégration dans un circuit de longues distances – pour les marchandises tout d’abord, mais aussi pour les travailleurs qui auraient pu habiter loin de l’usine et faire quotidiennement l’aller-retour. Sa taille ensuite (70 000 m², contre 11 000 m² en moyenne pour les usines d’Ille-et- Vilaine du même type) devait permettre une très forte production. En résumé, l’usine est apparue comme relevant d’un « modèle » logistique, vivement critiqué par le sénateur écologiste : « Dès lors qu’on massifie, qu’on fait des choses de cette envergure, on ne peut pas avoir des ressources uniquement locales. Donc on va aller chercher très loin le lait, le beurre et autres », dit-il.
Cet argument économique a été peu repris par le reste de l’opposition, mais il n’est pas sans lien avec la question de la surexploitation des ressources de la région, mentionnée par un élu du comité de bassin Loire-Bretagne : « En Bretagne, on produit pour 10 millions d’habitants, alors qu’on n’est que 3,5 millions. Donc on fait déjà notre part, avec toutes les conséquences environnementales que cela suppose. » Pour lui, la région est proche de ce qu’il considère comme un seuil d’acceptabilité – voire de soutenabilité – du productivisme. On peut notamment penser aux scandales écologiques qui ont frappé la Bretagne ces dernières années (marées vertes, déchets azotés…). De ce point de vue, une tension apparaît alors entre la volonté de se sourcer localement et les conséquences environnementales d’une surexploitation des ressources.
D’autres représentants de collectifs de défense de l’environnement, assumant une approche plus politique, estiment que l’implantation de Bridor pose globalement la question du modèle économique et de développement qu’il convient de soutenir : « Est-ce qu’on veut un modèle de développement qui est existant depuis des décennies et qui est responsable du dérèglement climatique ? » Selon le sénateur écologiste interrogé, le projet Bridor porte avec lui une conception du système économique centrée sur l’accumulation de richesses et la recherche de croissance, qui n’est plus durable. Il estime que les indicateurs tels que le PIB représentent une fausse valeur, créée artificiellement par l’humain au moyen de calculs comptables qui ne tiennent pas compte des pertes environnementales. Il oppose donc cette « fausse valeur » à la « vraie richesse » créée localement, quand l’argent reste en circulation sur le territoire. Une autre élue municipale rencontrée a tenu un discours similaire, défendant des modes de production à plus petite échelle : « Je suis pour les boulangers artisanaux, je suis pour le maraîchage à taille humaine près des habitants, donc ça n’a rien à voir avec ce type de modèle. »
À l’inverse, les défenseurs du projet comme le Medef s’appuient précisément sur l’argument que ce modèle est utile, puisqu’il a permis une élévation significative du niveau de vie des Français.
La question de l’utilité : argument central des opposants au projet
Le modèle productiviste, articulé à un commerce à longue distance, n’est pas le seul point de divergence « conceptuelle » entre les parties prenantes à cette controverse : l’utilité proprement dite du projet a été au cœur des débats et s’est même rapidement transformée en argument central pour ses adversaires. « Il était reproché le fait que le seul intérêt général qui pouvait ressortir de ce projet, c’était la création de 500 emplois, jugés par certaines personnes du public comme étant [des emplois] précaires », explique un membre de la CNDP. Par exemple, l’élu écologiste a d’abord cité l’inutilité du projet comme raison de son opposition, avant d’évoquer les problématiques liées à la faune et la flore. Il a en effet expliqué être un grand défenseur de la réindustrialisation pour les choses qu’il jugeait « indispensable[s] à notre bien-être et à notre souveraineté ». Or il n’incluait pas les viennoiseries dans ce cadre : « Aujourd’hui, je n’ai jamais vu personne faire des manifestations dans la rue en disant : “Je veux des croissants, je veux des pains au chocolat !” […] Ça veut dire que ce marché est déjà couvert. Il n’y a pas de besoin de croissants ou de viennoiseries. Donc, qu’est-ce que ça veut dire de faire une nouvelle usine ? Là, on est typiquement dans une économie capitaliste qui vise à prendre des parts de marché […] à tous les artisans, tous les gens qui produisent déjà. »
Pour certains partisans du projet de Bridor, celui-ci s’inscrivait au contraire parfaitement dans l’objectif de réindustrialisation de la France, au point que son échec contribue à mettre en péril cette dynamique. Un élu régional du Rassemblement national rappelle ainsi que « nous avons tellement de mauvaises nouvelles d’entreprises qui ferment ou mettent la clé sous la porte que la perspective d’avoir ce site industriel performant, créé en plus par un Breton, était extrêmement satisfaisante ». « Les opposants au projet n’ont pas seulement remporté une victoire contre Bridor, ils ont remporté une victoire contre tout projet de réindustrialisation », estime-t-il.
Outre l’enjeu de l’industrialisation, certains soutiens du projet ont justifié son utilité sur le plan philosophique : la liberté d’entreprendre est une liberté fondamentale, nécessaire au bien-être de l’homme. « L’homme, de façon consubstantielle, est animé par la liberté, par l’esprit de liberté. La chose à laquelle les gens sont le plus attachés, c’est la liberté. […] On peut effectivement mettre des limites, mais il faut que ce soient des limites posées de façon démocratique et à une échelle géographique suffisamment vaste pour que cela ne nuise pas à l’économie concernée. […] Je pense que le commerce est un facteur d’enrichissement et un facteur d’ouverture d’esprit », souligne le représentant du Medef Bretagne.
Un conflit devenu substantiel
Les clivages autour du projet Bridor reflètent donc largement un schéma politique traditionnel d’affrontement gauche-droite, qu’il s’agisse des échelles de production et de commerce de l’entreprise ou de l’utilité même du projet. Bon nombre d’acteurs de l’opposition ont admis que, au-delà des arguments qu’ils ont portés contre le projet, c’était son principe même qui semblait poser problème. Les oppositions techniques cachaient pour beaucoup une opposition face à « l’idéologie » du projet. C’est ce que nous révèle une élue municipale militante LFI lorsqu’elle nous apprend que l’organisation des premières visites du terrain aux prémices du projet, avant même toute discussion avec le groupe Le Duff, avait déjà créé des oppositions : « On était contre dès le départ. C’était un projet démesuré et inutile. À quoi ça sert de fabriquer des brioches, des trucs avec des matières grasses hydrogénées, de la malbouffe ? »
Les vives tensions qui se sont exprimées au sujet de ce projet d’usine montrent donc une divergence profonde sur la façon dont doit fonctionner notre société40. L’élu RN nous dit : « L’idéologue, c’est celui qui a une conception de la vérité dont il ne supporte aucune contestation. C’est un constructeur d’un monde nouveau, et ces écologistes sont des idéologues. » Alors que d’autres estiment prendre ces positions pour la défense de la planète, un sénateur juge en outre que ce projet « s’adressait plutôt à une clientèle de luxe », or « le luxe, c’est aussi un des éléments qui vient impacter la soutenabilité pour l’espèce humaine sur la planète ». Ces divergences fondamentales semblent même avoir suscité une forme d’exaspération chez certains, comme cet élu RN : « Ils considèrent que, pour sauver la planète, il faut entamer un processus de décroissance, de désindustrialisation, de baisse du cheptel bovin. »
Quoi qu’il en soit, ces visions irréconciliables semblent avoir empêché toute forme de discussion constructive autour du projet. « Quand on essayait d’expliquer qu’on voulait de l’emploi sur le territoire, en face on nous opposait le modèle économique des entreprises en général », raconte un représentant de la communauté de communes.
De la concertation à la contestation : des modes d’actions variés pour faire émerger les problèmes
Pour cadrer le débat, mobiliser les acteurs et vérifier le bon déroulé des dialogues et la bonne transmission des informations, la CNDP a été saisie par le groupe Le Duff et la LCC. Elle a été chargée de la supervision d’une concertation préalable, puis d’une concertation de suivi, en préparation d’une enquête publique devant découler sur une décision finale du préfet sur le projet. Dans ce cas comme dans tout autre, la CNDP devait mettre en œuvre les conditions de l’exercice du droit constitutionnel à participer aux décisions ayant un impact sur l’environnement. Elle n’a pas de pouvoir décisionnel. Pour autant, son intervention a joué un rôle sur la suite du conflit, lors de l’enquête publique notamment. D’autres modes d’action, comme des manifestations ou les recours en justice, ont également eu une importance significative dans l’évolution de la controverse.
La CNDP : un fonctionnement contesté
Comme expliqué plus haut, l’intervention de la CNDP est justifiée par le postulat selon lequel « une décision est plus légitime et de meilleure qualité après avoir été soumise à l’épreuve de la discussion publique ». Son rôle est donc de veiller à ce que cette discussion se passe dans le meilleur cadre possible, pour aboutir à une décision « de qualité ». Les actions, droits et devoirs de la CNDP sont dictés par la loi, surtout concernant la bonne transmission de l’information : « La loi nous demande de vérifier la qualité, l’intelligibilité et la sincérité de l’information. C’est ça qu’on nous demande de faire. » Le bon déroulé de la concertation se base donc, selon la CNDP, sur une bonne transmission de l’information à travers trois principes : une diffusion large, sincère et intelligible.
Dans le cas Bridor, la CNDP se félicite du caractère large de la diffusion de l’information, par de multiples vecteurs (réseaux sociaux, affichage, affichage sur site, boîtage) et événements (réunions publiques par exemple). Les garants du projet (Bridor et LCC), ainsi que les parties prenantes, notamment au sein de l’opposition, ont confirmé ce bon déroulé. Certaines associations regrettent toutefois une faible mobilisation du grand public dans cette concertation.
La qualité, la sincérité et l’intelligibilité des informations échangées ont, quant à elles, été critiquées. C’est notamment vrai pour ce qui concerne les rapports d’études portant sur l’impact environnemental du projet, fournis par le groupe Le Duff. Ont été reprochés les éléments suivants : l’absence d’un rapport traduisant en langage non technique les études techniques réalisées (sur l’impact environnemental de l’usine), le poids des rapports techniques et surtout l’exactitude contestable des informations transmises. Un ancien élu, maintenant membre du collectif CoLERE, expose clairement la nécessité de décrypter les informations : « Si vous avez trois cents pages de langage technique, je ne suis pas sûr que le public sera beaucoup plus avancé dans le droit à l’information. Donc, il faut le traduire en langage accessible. » Certaines parties prenantes de l’opposition, comme des militants du parti LFI ou encore Eau et Rivières de Bretagne, soulignent ce point dès les premières pages de leur avis soumis à l’enquête publique. Pour eux, les documents techniques ne sont pas traduits, sont trop longs et restent inaccessibles au grand public. « Ces manquements nuisent à l’information du public et font peser des doutes quant à la sincérité des porteurs de projet, quant à leur réelle volonté de diffuser une information claire, lisible et accessible. » La Fédération départementale de pêche et de protection des milieux aquatiques ainsi qu’Eau et Rivières de Bretagne ont mis en doute, à d’autres reprises, la sincérité des porteurs de projet en questionnant l’exactitude et le sérieux des informations transmises. La Fédération estime par exemple que l’application du volet « évitement » de la séquence ERC n’est pas respectée, et que l’analyse est « faussée car elle n’est pas étayée par une étude diagnostique comparative et qu’elle est basée sur des données erronées ».
Le rôle ambivalent de la presse
Le journalisme peut également jouer un rôle au cours des étapes de concertation, en tant que vecteur de transmission indispensable de l’information. Idéalement, le débat devrait y être retranscrit correctement, selon les mêmes règles qu’ailleurs (des informations sincères et de qualité). Pourtant, les deux camps se plaignent d’avoir subi les effets d’un journalisme « polarisant ». Un membre du collectif CoLERE souligne que « les journalistes enferment dans des cases, vous collent une étiquette, et viennent chercher les éléments de langage qui sont en lien avec cette étiquette-là ». Selon ce point de vue, l’information serait filtrée avant d’être transmise, de sorte à rester en cohérence avec « l’étiquette » donnée. Le collectif regrette en particulier que seuls ses arguments écologiques aient été retenus et que jamais ses réflexions économiques n’aient été reprises. « Nous voulions montrer que nous ne sommes pas des écologistes radicaux, mais cela n’a pas été entendu par les médias », regrette l’ancien élu. Donnons comme exemple le titre du principal article du Figaro (Visseyrias, 2022) : « Harcelé par les écologistes radicaux, Bridor contraint de délocaliser un projet d’usine avec 500 emplois à la clé ». Des élus de LCC se plaignent aussi de cette polarisation, très pesante et constante. Ils soulignent pour leur part, tout comme le groupe Le Duff, la surreprésentation de l’opposition dans les médias : la majorité était pour eux silencieuse, et la minorité trop active dans les journaux.
Un manque de préparation
Les travers mentionnés ci-dessus peuvent relever en partie d’un manque de préparation de cette étape de concertation, et pas uniquement de la part des porteurs du projet. En effet, l’Office français de la biodiversité (OFB) souligne l’importance de l’anticipation ; selon eux, la prise en compte de leur avis aurait dû se faire bien en amont de la phase de concertation ou de l’enquête publique : « Quand on anticipe, quand toutes les parties prenantes discutent des projets en amont, on est capable de faire des projets qui sont équilibrés. »
Cependant, comme le souligne le collectif CoLERE, la consultation « n’avait pas été anticipée par les élus à l’époque ». Bridor a donc fourni des réponses incomplètes et pas toujours cohérentes avec les attentes du public. La CNDP se dit consciente de cette déception, et note bien que « le public s’attendait à avoir toutes les données des résultats, d’études d’impact, d’études faune-flore » dès la concertation préalable, alors que la temporalité de la procédure et le manque d’anticipation rendaient cela impossible. Cette déception peut avoir des conséquences assez néfastes sur l’issue d’un débat chronométré. Dans ce cas précis, cela a engendré « le sentiment que l’entreprise cachait quelque chose parce qu’il n’y avait pas les informations, mais elles ne pouvaient pas être données parce qu’on était au tout début de la procédure ».
Cela n’exclut pas, bien au contraire, que cette concertation ait exigé un travail très important de la part de Bridor et de LCC, rappelle la CNDP. Collecter des données, les traduire puis les diffuser, mener des études techniques… représente un ensemble de tâches lourdes. Les porteurs de projet ont donc eu à cœur de ne pas allonger les délais, au risque d’affecter la qualité de l’information.
Le collectif CoLERE estime en outre que la LCC a convaincu l’industriel de venir sur son territoire en omettant de lui mentionner certaines contraintes environnementales. En conséquence, le dossier du groupe Le Duff présentait des lacunes majeures. Le collectif cite notamment le cas des zones humides, pas ou peu prises en compte par Bridor, et le PLU de LCC. Cela a débouché sur des justifications a posteriori de la cohérence du projet avec l’inventaire des zones humides – ce qui a exacerbé les contestations écologistes, attaquant le manque d’intégrité de ces justifications. Eau et Rivières de Bretagne et la Fédération de pêche ont d’ailleurs fait de la destruction des zones humides un argument majeur de leur contestation.
Le cadre du débat se trouve nécessairement modelé au cours de la concertation et, comme le souligne la CNDP, cela vient du public : « Si vous voulez mobiliser le public, il faut le laisser choisir les sujets qui le mobilisent. » Il lui appartient donc de définir le cadre qu’il désire. Et, comme le précise un représentant territorial de l’OFB, si ce public interpelle le décideur « pour lui demander de répondre aux éléments qu’il [le public] a soulevés », celui-ci devra prendre en compte cette interpellation, développer la suite qu’il y donnera et la justifier.
Il est donc dans l’intérêt des porteurs des projets qu’ils soient bien conscients du caractère modulable du cadre du débat, et du préjudice qu’ils s’infligent s’ils en écartent un point controversé. Comme nous l’avons vu précédemment, dans le cas de Bridor, le cadre du débat s’est élargi au point de confronter deux visions du monde difficiles à concilier.
Enquête publique et décision finale
Une fois terminée la mission des garants de la CNDP, quand le projet est totalement ficelé, commence la phase d’enquête publique. Les parties prenantes sont alors mobilisées pour déposer leurs contributions, c’est-à-dire des courts textes dans lesquels chaque acteur ou institution exprime son positionnement. La décision revient ensuite au préfet, qui doit se déterminer en s’appuyant sur le dossier d’enquête publique. « Le décideur n’a pas obligation de donner une suite favorable à ce que dit le public, il a le droit de dire non, mais il a une obligation de justifier sa décision au regard de ce qu’a dit le public », explique la CNDP.
Malgré des écueils soulignés par les deux camps, la phase de concertation sur le projet Bridor a permis de mobiliser les parties et a activé la transmission d’informations. Elle a donc été un élément déclencheur essentiel du fait que l’enquête publique ait été particulièrement productive, avec plus de trois cents contributions.
Selon le collectif CoLERE, « à 95 %, les gens étaient contre, avec des arguments irréfutables ». Le commissaire enquêteur et le préfet ont néanmoins donné un avis positif sur le projet final en juillet 2022. L’enquête a donc débouché sur l’attribution d’un permis de construire et d’un classement ICPE (installation classée pour la protection de l’environnement). Pour le collectif citoyen, cette décision est le résultat d’un blocage politique : « Émettre un avis négatif, c’est toujours un peu compliqué à assumer politiquement derrière. » Les opposants au projet remettent donc en cause la décision du préfet parce qu’elle ne refléterait pas le contenu des avis déposés. Un opposant au projet va même plus loin : « Ce n’est pas parce qu’on a une autorisation qu’elle est légale. Elle est légale tant qu’il n’y a pas de recours », dit-il en rappelant l’importance des recours pour compléter le système de délibération. « L’exemple le plus probant est celui des autorisations de chasse. Les préfets en donnent en sachant qu’elles ne sont pas légales. Mais si ce n’est attaqué par personne, ça passe. Pendant ce temps-là, les chasseurs chassent des espèces protégées, jusqu’à ce qu’il y ait un recours – et il y a toujours un recours. »
Nos échanges ont même révélé une forme de défiance vis-à-vis des conclusions des instances administratives ayant procédé aux études d’impact : « Dans l’administratif, si un bureau d’études dit qu’il y a zéro zone humide, ce qui va être retenu, c’est qu’il y a zéro zone humide. Ça ne veut pas dire qu’elles ne sont pas existantes », affirme ce même opposant. Comment se mettre d’accord sur des points techniques si la confiance est rompue entre les citoyens, les collectifs défenseurs de l’environnement et l’État ? La discussion semble impossible et les recours inévitables.
Le recours aux tribunaux
Les opposants au projet de l’usine Bridor ont lancé trois recours contentieux pour retarder la construction de l’usine et, finalement, obtenir l’abandon du projet. Ceux-ci visaient l’autorisation environnementale délivrée par le préfet, la modification du plan local d’urbanisme (PLU) et le permis de construire délivré par la mairie. Ces démarches judiciaires, menées par des collectifs tels qu’Eau et Rivières de Bretagne, Bretagne vivante, la Confédération paysanne, Nature en ville, ainsi que par des riverains, avaient pour but de contredire la conformité réglementaire du projet et d’utiliser ses potentielles irrégularités pour faire échouer sa mise en œuvre.
Le recours en justice constitue un moyen cadré et efficace (selon Eau et Rivières de Bretagne, plus de 80 % des recours qu’ils ont soumis ont été validés par la justice) de contester une implantation industrielle. Un membre d’Eau et Rivières explique : « C’est le recours contentieux qui permet de poser des questions à la justice pour vérifier que la réglementation est respectée. […] Et nous, on était à peu près sûrs de ce qu’on disait, notamment sur la protection des espèces protégées, sur la consommation d’eau, sur le fait que certains impacts n’étaient pas mesurés ni compensés… » Il souligne également que ce type d’action ne serait pas entrepris si les projets respectaient réellement les normes en vigueur : « C’est pour ça qu’on est allés au contentieux, parce que le dossier ne tenait pas debout. S’il avait tenu debout, nous n’aurions pas pu y aller. »
En parallèle, pour les promoteurs du projet, la longueur des procédures et l’incertitude juridique liée aux recours constituent des obstacles majeurs à sa réalisation. Un sénateur affilié aux Écologistes résume ainsi la situation en France : « Il y a tout un tas de potentiels recours qui font peur aux investisseurs, en se disant qu’ils vont perdre beaucoup de temps. […] On est un des pays où il s’écoule le plus de temps entre l’intention d’installer une infrastructure et le moment où on entre dans la phase opérationnelle. Mais il n’est pas question d’amoindrir la qualité de l’instruction. » Cette temporalité constitue un défi stratégique : pour éviter des risques financiers ou d’être contrainte de démanteler une infrastructure déjà construite, l’entreprise a préféré abandonner le projet plutôt que de poursuivre dans un climat d’incertitude. En effet, les conséquences d’un recours à une autorisation de construire peuvent être particulièrement destructrices pour une entreprise : la justice pourrait exiger une remise en état du site comme si l’autorisation n’avait jamais été valide. Ainsi que l’explique un représentant de l’entreprise : « C’est du temps, de l’énergie et de l’emploi perdus pour la Bretagne, mais on ne peut pas attendre. »
Les localités sont aussi touchées par les recours juridiques et les risques d’abandon de projet. Une entreprise s’implante en effet en promettant des recettes fiscales et des emplois stables pour le territoire. Les élus peuvent donc se trouver en porte-à-faux lors de l’échec d’un projet. C’est pourquoi ils se doivent d’anticiper les éventuels recours auxquels les projets de leur territoire pourraient faire face. Comme le mentionne un représentant du collectif CoLERE, « les communes commencent de plus en plus à provisionner de l’argent pour les recours juridiques, parce que les habitants sont de mieux en mieux informés et ont une conscience écologique ».
[N.D.L.R :
À l’issue de la phase de concertation, la CNDP a considéré que les réponses apportées par le porteur de projet aux interrogations du public étaient complètes. Des précisions quant au suivi des engagements pris par Bridor et à la diffusion des informations concernant la finalisation des études ont toutefois été demandées par les garantes. L’étude faune-flore ou des quatre saisons a notamment bien été fournie par la société. Suite à la phase d’enquête publique, le projet a reçu un avis favorable par la DREAL et la validation du permis de construire par la Préfecture. Les opposants ont été déboutés de leur premier recours concernant le PLU lancé après ces validations et condamnés à verser 1 500€ € à LCC. Finalement, le groupe Le Duff a renoncé au projet en mai 2023.]
- 36 — Entre 2007 et 2023, chaque emploi créé dans les secteurs exposés à la concurrence (dans l’industrie notamment) a entraîné la création d’1,34 emploi dans les secteurs dits abrités (restauration, coiffure, etc.) (Karachanski, 2025).
- 37 — Une étude quantitative montre que la boulangerie-pâtisserie-biscuiterie représente 29 % de l’industrie agroalimentaire dans le département d’Ille-et-Vilaine, alors qu’elle ne compte que 4 sites sur les 79 du secteur. Les usines sont donc peu nombreuses mais de grande taille, par comparaison avec les autres activités.
- 38 — Les comités de bassin sont des assemblées de concertation entre les acteurs de l’eau composées des représentants des collectivités territoriales, de l’État, des usagers économiques (agriculteurs, industriels, etc.) et non économiques de l’eau (associations, etc.). Ils ont notamment la charge de l’élaboration du schéma directeur d’aménagement de gestion des eaux (SDAGE).
- 39 — La séquence ERC (éviter, réduire, compenser) ordonne, dans tout projet, l’approche générale à tenir pour prévenir les atteintes à l’environnement : d’abord en les évitant, sinon en les réduisant et enfin, en dernier recours, en les compensant.
- 40 — Remarquons que les termes « décroissance », « idéologie » ou « dogme » ne sont utilisés que par les défenseurs du projet Bridor, pour en discréditer les opposants.
Point de vue par Benoît Logeais – L’histoire d’un renoncement
Le projet de site Bridor à Liffré, c’est pour moi l’histoire d’un renoncement douloureux. Alors que nous avions un projet à la fois créateur d’emplois et vertueux environnementalement, nous avons été amenés à y renoncer. J’ai porté ce projet d’implantation d’un nouveau site de boulangerie industrielle pendant quatre ans.
Le projet initial porté dans l’étude d’impact était exemplaire et l’ensemble des autorisations environnementales ainsi que le permis de construire étaient acquis. Cinq cents emplois devaient être créés à terme et des mesures de compensation liées aux zones humides avaient été pensées. Pourtant, cette implantation a fait l’objet d’oppositions, pas du plus grand nombre, mais d’une grande intensité.
En 2020, conformément à la réglementation, nous avons organisé une concertation publique car notre construction entrait dans la catégorie des projets supérieurs à 150 millions d’euros, soumis à la CNDP (Commission nationale du débat public). Ces réunions ont rapidement été perturbées par des opposants et par des actions de contestation.
Parallèlement à cela, nous faisions face à une demande poussée et précise de données chiffrées de la part des garants de la CNDP. Par exemple, il nous a été demandé de fournir des chiffres concernant les impacts environnementaux que les experts eux-mêmes n’étaient pas en mesure d’apporter.
Par ailleurs, certains points soulevés lors de la consultation publique et relevés par les opposants au projet ne pouvaient faire l’objet de modification. En effet, il a, par exemple, été demandé de garantir un approvisionnement 100 % local, incompatible avec la réalité de la disponibilité des matières premières et avec nos contraintes de volumes. Il existe un marché pour de petits volumes artisanaux locaux mais il y a aussi des consommateurs à satisfaire à plus grande échelle. Les deux modèles ne sont pas opposés et doivent pouvoir vivre ensemble.
La question des messages véhiculés par les associations écologiques a aussi été importante sur ce projet. Il était primordial pour nous d’éviter tout amalgame créé par ces associations qui rassemblent parfois tous leurs sujets en un seul et unique combat. Ainsi, la lutte contre la prolifération des algues vertes en Bretagne ne devait pas être confondue avec un sujet d’implantation d’usine de viennoiseries.
À côté de cela, des projets demandant une forte puissance électrique ou impliquant le traitement de boues n’étaient pas contestés, bien que leurs incidences sur le voisinage ou la transition énergétique aient été avérées. Cela illustre parfaitement les différences de stratégies des territoires : certains misent sur le développement industriel et performent quand d’autres s’orientent vers d’autres modèles, moins favorables et plus lents.
Et dans le monde de l’industrie, les délais d’implantation comptent. Comment faire face à des concurrents qui, lorsqu’ils s’installent aux Pays-Bas, bénéficient d’un délai de procédure de quatorze mois alors qu’en France ce délai dépasse les vingt-quatre mois ?
Face à ces délais et malgré l’autorisation de construire, nous avons fait le choix d’annuler le projet. Pour répondre à nos besoins rapidement, notre groupe a donc investi à l’étranger, notamment au Portugal et aux États-Unis. Et c’est en 2025 qu’une nouvelle usine Bridor s’est implantée en France, sur l’ancien site de Frial (propriété du Groupe Le Duff) à Falaise en Normandie. L’accueil du projet par les acteurs publics et privés locaux y a été complètement différent et les questions soulevées ont permis de faire avancer le projet.
Benoît Logeais
Directeur industriel worldwide de Bridor et coordinateur du projet à Liffré
Le projet HyVence à Fos-sur-Mer : ce qui lie les habitants à leur territoire par Pierre-Eloi Bailliet, Marie Granotier, Paul Karam, Antonin Lezat et Antoine Preneux
Le projet HyVence porté par l’entreprise Géosel, qui consistait en l’installation d’une centrale photovoltaïque flottante couplée à une unité de production d’hydrogène à Fos-sur-Mer, a rapidement déclenché de vives oppositions locales. Pouvant être défendu comme un projet se plaçant au service de l’intérêt général, du fait de sa participation à la lutte contre le dérèglement climatique, il devait toutefois s’insérer dans le dernier espace naturel auquel les habitants de la zone ont accès. Cette étude de cas illustre l’importance, pour les porteurs de projet, d’identifier au mieux la réalité des espaces qu’ils souhaitent investir, en étudiant notamment les relations qui les lient aux populations.
Présentation du projet
Le porteur de projet, Géosel, est une société française fondée en 1967, spécialisée dans la constitution de stocks stratégiques nationaux d’hydrocarbures. Ce stockage se fait au sein de cavités creusées dans les couches géologiques de sel à Manosque, dans les Alpes-de-Haute-Provence. Le site est connecté par un réseau de pipelines à la zone industrialo-portuaire de Lavéra (Bouches-du-Rhône), ainsi qu’aux canalisations de distribution d’hydrocarbures en direction de la vallée du Rhône. Le fonctionnement de cet espace de stockage nécessite un flux bidirectionnel important, bien qu’irrégulier, d’eau saturée en sel appelée saumure. Celle-ci est entreposée dans les étangs de Lavalduc et d’Engrenier, situés à Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône), à une centaine de kilomètres de Manosque. La bonne coordination entre ces deux sites est stratégique, et permet de maintenir en activité l’un des plus grands sites de stockage d’hydrocarbures en France.
Figure 5.1 -Chronologie du projet HyVence
Le projet HyVence consistait en l’installation d’une centrale photovoltaïque flottante d’une surface totale de 500 hectares sur les étangs de Lavalduc et d’Engrenier. Le projet était conçu pour que la production d’électricité alimente un électrolyseur installé sur la zone du plan d’Aren (espace émergé entre les deux étangs), afin de produire 15 000 tonnes d’hydrogène vert par an.
Le 27 mars 2024, s’est ouverte la concertation préalable au projet HyVence, sous l’égide de la Commission nationale du débat public (CNDP). La consultation a été marquée très tôt par de vives oppositions, portées par différents collectifs de citoyens préexistants ou créés spécialement en réaction au projet. Les motifs de contestation étaient divers : si les risques industriels étaient évoqués, c’est principalement la localisation du projet sur les étangs qui a cristallisé l’ensemble des oppositions. L’hydrogène et les panneaux photovoltaïques n’étaient pas critiqués pour ce qu’ils étaient, mais pour le lieu où ils devaient être placés, le dernier du territoire où l’industrie n’est pas visible. La concertation s’est terminée le 20 mai 2024. Le 3 juin suivant, le porteur du projet a adressé une lettre aux habitants et aux élus des communes alentour, leur annonçant que « le projet, tel qu’il avait été initialement imaginé ne se [ferait] pas »41. Enfin, le 15 janvier 2025, le porteur du projet a fait parvenir une lettre au président de la CNDP demandant la suspension de la consultation continue sur le projet et, par là même, annonçant sa suspension.
Pour mener cette enquête, nous nous sommes appuyés sur de nombreux documents, notamment ceux de la consultation disponible en ligne. Nous avons également conduit quatorze entretiens répartis ainsi : deux avec le porteur de projet (dont un sur site), deux sur site avec des collectifs citoyens, deux avec des associations de protection de la biodiversité (dont un sur site), deux avec des agents de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, deux avec des agents du ministère de la Transition écologique, un avec une personne présente aux réunions de concertation préalable du projet, un avec un élu d’une commune environnante, un avec un autre porteur de projet hydrogène sur la ZIP de Fos, et un avec un historien spécialiste de l’histoire économique de la zone de Fos.
Fos-sur-Mer, un territoire à la croisée de multiples enjeux
Le projet HyVence, maillon important du hub hydrogène de Fos-sur-Mer
« Le texte mis en consultation en décembre 2023 affirmait la volonté de la France de développer l’hydrogène bas carbone à partir de hubs industriels qui étaient déjà consommateurs d’hydrogène gris42, et de s’étendre à partir de ces hubs », explique un agent de la Direction générale de l’énergie et du climat (DGEC). Cette déclaration illustre bien l’orientation prise par l’État français dans sa stratégie nationale pour le développement de l’hydrogène décarboné : faire de l’hydrogène un pilier de la transition énergétique, non seulement pour la mobilité verte, mais également pour la décarbonation de l’industrie lourde.
Pour ce faire, l’État souhaite développer une industrie de l’hydrogène, c’est-à-dire une industrie de la production d’hydrogène décarboné par électrolyse de l’eau, grâce à une production d’électricité bas carbone (nucléaire, énergies renouvelables). Il se fait ainsi le promoteur d’une politique industrielle active, et invoque des arguments liés à la souveraineté pour justifier la mise en œuvre d’une politique nationale d’approvisionnement dans laquelle il importe de produire massivement de l’hydrogène vert et d’organiser un secteur industriel en conséquence. Comme le montrent Brice Laurent et Alexandre Violle (2024), cette orientation donne lieu à une « territorialisation de l’industrie » sous la forme de hubs – c’est-à-dire des zones géographiques concentrant les investissements publics et privés autour de sites industriels existants, identifiés comme stratégiques pour la transition. Ce « style de territorialisation », entendu comme le processus par lequel le développement industriel est associé à la transformation territoriale, repose sur une intervention forte de l’État et sur l’implication d’acteurs industriels de grande taille, à la fois producteurs et consommateurs d’hydrogène gris, dans une logique de transformation des procédés industriels carbonés. Ces hubs sont identifiés à l’échelle nationale et désignés comme moteurs de la décarbonation en raison de la présence des industriels déjà implantés, sans consultation directe des acteurs locaux.
Fos-sur-Mer est un des hubs identifiés du fait de la présence d’industries lourdes : ArcelorMittal pour l’acier et plusieurs industries pétrochimiques. De plus, les cavités salines aujourd’hui exploitées à Manosque par Géosel pourraient être reconverties en stockage d’hydrogène dans les années à venir, comme nous le confirme un agent de la Dreal PACA. Le projet HyVence s’inscrit donc dans une politique nationale de production d’hydrogène. Il n’est pas le seul projet à émerger sur la zone industrialo-portuaire (ZIP) de Fos-sur-Mer, où doit aussi s’implanter le projet H2V de production d’hydrogène et de carburants de synthèse (e-méthanol et e-SAF) devenu le projet H4 depuis septembre 2025.
Ce hub se trouve également à la charnière entre les zones de production d’hydrogène situées dans la péninsule ibérique et les lieux de consommation en France et en Allemagne. « On a des projets d’import d’hydrogène par canalisation en provenance du sud de l’Europe, BarMar ou H2Med. L’hydrogène serait produit au Portugal ou en Espagne et serait amené par hydrogénoduc au large de Fos, pour ensuite alimenter des réseaux de transport qui remonteraient jusqu’en Allemagne et alimenteraient aussi des boucles locales, au niveau des industries essentiellement chimiques et pétrochimiques », explique un agent de la Dreal PACA.
Le hub de Fos participe plus largement à des efforts internationaux de production d’hydrogène, notamment par le biais de projets consistant à convertir d’anciens terminaux gaziers et pétroliers en points de réception pour l’ammoniac. Produite en Afrique du Nord, cette molécule, plus stable pour le transport, serait ensuite transformée en hydrogène à son arrivée sur le continent européen. Géosel serait a minima acteur de ce réseau par ses activités de stockage à Manosque.
Avec le projet HyVence, Géosel entendait devenir un acteur autosuffisant de production d’hydrogène bas carbone, puisque la centrale solaire installée sur les étangs aurait produit une quantité d’électricité suffisante43. En comparaison avec d’autres projets équivalents, « le projet HyVence avait un intérêt assez fort parce qu’il portait une brique photovoltaïque très importante, qui permettait d’équilibrer le bilan énergétique de l’opération en matière de consommation d’électricité », souligne l’agent de la Dreal, pointant ainsi du doigt la dépendance des industriels aux infrastructures existantes. La ZIP de Fos est en effet limitée aujourd’hui par ses capacités d’approvisionnement en électricité : les installations actuelles ne peuvent pas alimenter l’ensemble des projets étudiés sur la zone. Pour pallier ce manque, un projet de ligne très haute tension (HTC) entre Arles et Fos-sur-Mer est aujourd’hui mis en consultation ; mais le tracé de cette ligne fait débat. Le projet HyVence avait donc, d’après les services de l’État, l’avantage d’être autonome en énergie et même, selon son design définitif, de combler une partie du déficit énergétique de la ZIP en injectant dans le réseau l’éventuel surplus d’électricité produite.
Géosel se plaçait donc, avec le projet HyVence, comme un acteur majeur de l’hydrogène à Fos, à la fois producteur, transporteur et gestionnaire d’activités de stockage d’hydrogène. Le projet, quant à lui, répondait à des enjeux à la fois économiques et environnementaux, à l’échelle nationale et internationale.
Une analyse coûts-bénéfices des projets d’aménagement de la zone
Fos-sur-Mer a pour ambition de devenir un territoire industriel décarboné. À ce titre, de nombreux projets en lien avec la décarbonation s’installent sur la commune : le projet Carbon d’installation d’une gigafactory de panneaux photovoltaïques ; le projet GravitHy de production de fer réduit à partir d’hydrogène bas carbone pour alimenter les aciéries locales ; un projet de plateforme d’assemblage d’éoliennes offshore porté par le Grand Port maritime de Marseille (GPMM), etc. Ces projets sont au cœur de nombreuses problématiques, qui iront croissant avec la vague d’industrialisation de la zone et qui peuvent être sources de tension.
Tout d’abord, le territoire pourrait bénéficier de 10 000 emplois supplémentaires grâce à ces nouveaux projets industriels. Cela suppose de créer de nouveaux logements et d’aménager les axes routiers en conséquence. Selon un agent de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence : « Un des enjeux, c’est d’essayer de rapprocher zones d’habitat et zones d’emploi. Et là, il y a un paradoxe dans la relation ville-industrie. C’est de l’industrie lourde, qui peut engendrer des pollutions, qui peut être dangereuse, donc il ne faut pas la mettre trop près des centres urbains. Mais si c’est trop loin, on n’est pas non plus dans une bonne dynamique d’un point de vue environnemental (du point de vue de la mobilité pendulaire), donc il y a un peu tout ça à redéfinir. »
Cela nécessite d’impliquer non seulement la commune de Fos, mais aussi toutes les communes à proximité. Aujourd’hui, les infrastructures routières sont déjà chargées par les convois de poids lourds transitant d’est en ouest et du nord vers le sud. Chacun de ces itinéraires les amène à traverser les villes de Port-de-Bouc et de Fos. Un projet de contournement routier de Fos est donc étudié depuis plusieurs années. Comme l’explique le même agent de la Métropole Aix-Marseille-Provence : « Il y a trois options sur Fos-A54, dont celle du “barreau des étangs”, qui est portée par le maire de Fos. C’est celle qui conduirait au minimum de nuisances pour les habitants. C’est aussi l’option qui coûte le plus cher. » Ce tracé dit du barreau des étangs passerait le long de la voie de chemin de fer, et donc en bordure des étangs. Il permettrait de déplacer les émissions de particules fines liées aux poids lourds, ainsi que les nuisances sonores associées à leur déplacement.
L’association Mouvement citoyens de tous bords -golfe de Fos, environnement (MCTB) défend également cette version du projet. Bien que la route prévue soit visible depuis les étangs, elle pourrait selon eux désengorger la ville de Fos et améliorer significativement le cadre de vie des Fosséens. Ce projet routier s’inscrit en outre dans une prévision de flux futurs, sur la zone, depuis d’autres régions telles que la vallée du Rhône ou Marseille. Il vient donc répondre à des contraintes imposées à une échelle plus vaste que celle de la seule ville de Fos, et entend améliorer les conditions de vie des habitants de ce territoire.
Ce projet routier constitue un élément important, ou plutôt un contre-exemple éclairant, pour comprendre l’hostilité des riverains au projet HyVence. En effet, comme le projet routier présente des bénéfices directs pour la population, les collectifs mobilisés à l’échelle locale pour la préservation du territoire tolèrent cette transformation de leur environnement dans la mesure où cela améliorera leur cadre de vie. À l’inverse, comme le souligne un élu local, le projet HyVence vient bouleverser « l’équilibre » de la zone sans apporter de bénéfice direct aux populations. En modifiant l’aspect visuel des étangs, par la pose de panneaux solaires, et en installant un électrolyseur (classé Seveso) sur une zone de promenade, il vient dégrader le cadre de vie des habitants des communes alentour, selon ses opposants.
Figure5.2 -Tracé « le barreau des étangs », aménagement routier à Fos-sur-Mer
La capacité des Fosséens à définir les usages de leur territoire
La comparaison de l’accueil fait au projet routier et au projet HyVence éclaire plus généralement la capacité de la population à définir l’usage qui est fait de leur territoire. Cette question n’est pas nouvelle, comme le montre l’histoire de Fos-sur-Mer, un territoire profondément façonné par des projets industriels successifs, souvent imposés sans consultation ni prise en compte de la volonté des habitants.
À l’origine, Fos-sur-Mer n’était qu’un petit village de pêcheurs. Une usine de production de soude, destinée à la savonnerie, s’est installée sur les rives des étangs de Lavalduc et d’Engrenier au milieu du xixe siècle, avant de péricliter un siècle plus tard. Au milieu du xxe siècle, la ville de Marseille, souhaitant étendre son périmètre d’activités économiques mais ne possédant pas le foncier nécessaire à l’implantation d’industries lourdes, « pense à aller vers le golfe de Fos et à réinstaller même une sidérurgie », raconte un historien spécialiste de la zone. Cette ambition s’aligne alors avec celle de l’État de bâtir de grands ports industriels pour la France. L’État développe en effet le projet d’une zone industrialo-portuaire (ZIP) à Fos, où il rachète les terrains et aménage les lieux. Dans le même temps, les industriels du secteur sidérurgique ont saisi le potentiel des « usines sur l’eau », avec la création du bassin dunkerquois dans un contexte de reconversion des sites lorrains. Le projet de la zone industrialo-portuaire est ainsi devenu un projet majeur de la politique industrielle du vie plan (1971-1975). Enfin, la Délégation interministérielle à l’aménagement du territoire et à l’attractivité régionale (Datar) souhaitait faire de Marseille une métropole d’équilibre pour limiter les inégalités de développement économique à l’échelle de la France. Lors de plusieurs entretiens, le terme « traumatisme » a été utilisé pour nous décrire cette période. Les acteurs indiquent aujourd’hui que la transformation de la zone, alors semblable à la Camargue, s’est opérée sans concertation des populations.
En 2006, la Métropole de Marseille a souhaité se doter d’un grand incinérateur de déchets ménagers. Initialement envisagé dans la banlieue marseillaise, il a finalement été installé sur le site de Fos-sur-Mer, malgré une vive contestation de la population locale.
Ces deux épisodes illustrent, aux yeux de certains Fosséens, un sentiment de dépossession et de perte de contrôle sur leur propre territoire44. L’historien explique que nous assistons aujourd’hui à un renversement de cette idée : « Voilà que la décarbonation au sens large et la production d’hydrogène vert au sens plus restreint donneraient une chance au territoire de se réapproprier son aménagement, de se réapproprier son destin qui lui avait été volé par la première phase d’aménagement. » Avec les nouveaux projets dans la ZIP et plus particulièrement les projets décarbonés, les élus locaux essaient en effet de présenter cette industrialisation comme « choisie » et non plus comme « subie ». La mobilisation contre le projet HyVence donne vie à ce discours, car les habitants se mobilisent pour choisir les projets industriels qui y seront installés.
Sur la ZIP, les projets rencontrent peu de contestation locale, mais le projet HyVence, situé en dehors de cette zone, cristallise une opposition forte. Les opposants dénoncent un projet dont les bénéfices seraient principalement nationaux, tandis que les nuisances retomberaient exclusivement sur la population locale. Ils estiment que l’argument de la décarbonation, inscrit dans la stratégie nationale, ne justifie pas le sacrifice de leur cadre de vie, ni la perte de leur accès aux étangs.
Un processus de concertation inhabituel
La contestation autour du projet HyVence s’est structurée en plusieurs phases, avant, pendant et après la consultation préalable organisée par la CNDP. Chaque phase s’est accompagnée d’un répertoire d’actions spécifiques, reflétant les revendications des opposants.
Dès janvier 2024, les premiers signes d’opposition ont émergé avec la création du collectif Sauvons nos étangs (CSNE). Ce dernier permet à la population de se tenir informée, estimant « qu’elle ne l’était pas », et l’appelle à se mobiliser contre le projet. Dans un premier temps, le collectif a privilégié des moyens informels, comme les réseaux sociaux, pour diffuser ses messages. Progressivement, il a adopté des méthodes plus formelles, en sollicitant notamment la presse locale. Parallèlement, une pétition a circulé et deux marches ont été organisées, les 17 mars et 11 mai 2024, rassemblant environ 400 personnes. Ces mobilisations visaient à inciter les élus locaux à prendre une position défavorable au projet, car « ils sont les seuls à pouvoir bloquer un projet », rappelle un membre du collectif. Cette stratégie a porté ses fruits : dans les quatre communes concernées, seul le maire de Fos a donné un avis favorable avant le début des concertations, tandis que les autres ont affiché leur opposition au projet.
Une concertation tenue dans un contexte de défiance
La concertation préalable du projet HyVence s’est ouverte le 27 mars 2024 dans un contexte de défiance, du fait de la découverte tardive par les riverains de l’emplacement des panneaux solaires et des modifications du PLU (plan local d’urbanisme), effectuées en amont de la concertation et sans consultation du public. En effet, le 30 novembre 2023, le maire de Fos a demandé une modification du PLU, acceptée par la Métropole le 22 février 2024. « Nous avons aussi découvert que Géosel avait bénéficié d’un décret gouvernemental qui sort les étangs de la protection de la loi Littoral et classe le plan d’Aren en “friche industrielle”. Tout ceci avant la concertation, en 2023. Sans cette concertation, nous ne l’aurions pas su », peut-on lire dans le compte rendu de la concertation préalable. En effet, un décret ministériel publié le 27 décembre 2023 a reclassé les étangs en friches industrielles. Cette classification permet de déroger à la loi Littoral, qui interdit toute nouvelle urbanisation qui ne soit pas en continuité de l’existant.
Ces procédures administratives, exécutées en amont de la concertation, ont été perçues comme une « tromperie » de la part du porteur du projet et de la commune : les riverains n’ont été concertés qu’une fois les demandes effectuées. « Les dés sont pipés », affirme un membre d’une association de riverains. Cependant, d’après un élu local, ce type de démarche est assez fréquent dans le cadre des modifications des PLU. Ces ajustements anticipés permettent d’adapter le cadre réglementaire à l’avance, afin d’éviter les blocages une fois le projet lancé, et de garantir que la France demeure compétitive par rapport à ses voisins pour l’implantation industrielle, ce que nous confirme un membre de la Métropole : « Une modification du PLU, c’est a minima six à neuf mois de procédure. Par conséquent, la modification du PLU est enclenchée de façon qu’à la fin de la concertation, l’industriel puisse déposer les documents d’autorisation environnementale et d’urbanisme en même temps. Dans le phasage du projet industriel, c’est le plus cohérent. Effectivement, il n’y a pas eu de concertation sur la modification du PLU : le débat préalable CNDP est le principal outil de concertation du projet industriel. »
On constate donc une divergence profonde entre la vision des institutions, pour qui ces démarches technico-administratives relèvent d’une routine professionnelle, et celle des habitants, qui les perçoivent comme une stratégie antidémocratique. Alors que les riverains réclament davantage de concertation et de transparence, les impératifs économiques et la compétitivité justifient de leur côté une accélération des procédures.
Dissonance des discours et confrontation des expertises
La concertation s’est finalement réduite à la confrontation de « deux monologues », estiment plusieurs acteurs. D’un côté, Géosel a développé un argumentaire d’expert, couvrant des aspects techniques, économiques et environnementaux, notamment à travers des études de faisabilité, d’impact écologique, etc. Pour tenir compte des inquiétudes des riverains sur l’impact du projet sur le paysage, Géosel a également mandaté une école de paysage pour mener des études visant à soigner l’insertion visuelle du parc solaire. Il est cependant resté dans une logique argumentative, sans parvenir à établir une véritable connexion avec les préoccupations du public. De l’autre côté, les riverains ont surtout exprimé leur attachement au territoire et à leur cadre de vie. « Il y avait d’un côté les porteurs de projet qui prétendaient avoir l’expertise, y compris en matière de biodiversité, et de l’autre les gens de Fos-sur-Mer qui parlaient de leur enfance, de leur rapport et de leur attachement quasi sentimental à ce site », raconte un membre de l’association Cistude.
Cet attachement sentimental au cadre de vie rappelle le concept de « démocratie environnementale » évoqué par Floran Augagneur et Ilaria Casillo dans leur postface de Démocratie et environnement. Cette approche envisage l’environnement comme un bien commun, dont toute transformation doit être soumise à l’avis des personnes concernées. Il s’agit donc de démocratiser les décisions qui affectent l’environnement ou le cadre de vie des riverains. Dans leur réflexion, les auteurs encouragent à articuler ce concept avec celui de « démocratie écologique », plutôt opposé a priori, qui consiste à attendre des démocraties et de leurs procédures qu’elles se donnent pour objectif impératif de préserver l’habitabilité de la Terre. Dans le premier cas, le processus de décision est ascendant ; il est plutôt spontanément descendant dans le second. En première analyse, le projet HyVence, encouragé par les autorités, s’inscrit dans la dynamique de la démocratie écologique : il se conforme aux plans de l’État pour enclencher une dynamique vertueuse, par la production d’hydrogène vert permettant la décarbonation des activités industrielles de la ZIP. Cependant, le porteur de projet s’est cantonné au processus institutionnel de concertation, sans ouvrir la possibilité d’un exercice de démocratie locale. Dès lors, la recommandation des deux auteurs de parvenir à concilier les deux approches semble compromise.
Une concertation entre délibération et participation
Ces deux conceptions de la démocratie présentent deux façons d’aborder le débat public : d’un côté, un processus participatif, propre à la démocratie environnementale, qui cherche à mobiliser le plus grand nombre en donnant une voix aux citoyens concernés par les transformations de leur environnement. De l’autre, un processus délibératif, propre à la démocratie écologique, qui privilégie les arguments techniques et scientifiques pour préserver la viabilité de la planète. Cet affrontement entre participation citoyenne et expertise institutionnelle est au cœur de la concertation qui s’est déroulée autour de ce projet.
Géosel a adopté une logique délibérative, consistant à apporter des connaissances à même de défendre l’intérêt écologique de son projet. Ses représentants mettaient en avant les enjeux environnementaux, la sécurité et les aspects techniques, dans une démarche pédagogique. Une personne présente lors des concertations observe d’ailleurs que les compétences des participants se sont graduellement renforcées, ce qui est caractéristique de l’approche délibérative : « Les questions vont au-delà du projet lui-même, les gens posent des questions beaucoup plus globales sur le sujet de la décarbonation. »
À l’opposé, MCTB et Sauvons nos étangs adoptent une approche participative, mobilisant massivement la population. « La forte mobilisation des associations d’opposants s’est matérialisée par un effet de masse dans les salles lors des prises de parole45 », rapportent les garants de la concertation dans le bilan de la concertation préalable. Elle a aussi inspiré de nouvelles formes de démocratie. Certaines associations ont élargi le débat à des enjeux plus globaux, avec l’intention de déposer un recours pour annuler l’arrêté préfectoral et ministériel reclassant les étangs en friche industrielle. Elles ont également exprimé la volonté de créer un parc naturel protégé, un enjeu qui dépasse le cadre du projet HyVence.
Alors que Géosel possédait initialement le monopole de l’expertise, une contre-expertise profane46 a émergé de l’opposition, favorisant l’équilibre du rapport de force et offrant aux riverains la possibilité d’échanger d’égal à égal avec le porteur de projet. En effet, le collectif Cistude a pris part activement au débat technique grâce à ses études sur la biodiversité : « C’est une arme assez redoutable, dans le cadre des concertations, parce qu’elle permet d’opposer à l’expertise du porteur du projet une expertise citoyenne. Cela apporte aux citoyens une forme d’expertise pour être à armes égales, parce que c’est toujours le porteur de projet qui détient l’information. » Géosel s’appuyait notamment sur une étude réalisée par le bureau ECO-MED pour affirmer que la zone des étangs présentait une faible biodiversité. Après analyse, le collectif Cistude a publié une note contestant ces conclusions, en se fondant sur ses propres compétences de naturaliste. Cette contre-expertise a été discutée pendant la concertation en présence d’un membre d’ECO-MED, qui a reconnu la pertinence des critiques du collectif.
Une opposition qui va au-delà du Nimby
L’opposition au projet HyVence faisait écho, à première vue, au phénomène Nimby (Armour, 1985). Les riverains font ainsi mention des risques industriels encourus en cas d’explosion de l’électrolyseur, des gênes visuelles du projet et des dégâts infligés au cadre de vie (pour les activités récréatives ou pour l’attractivité touristique de la ville).
Figure 5.3 -Les zones inaccessibles au public autour des étangs de Lavalduc et d’Engrenier
Cependant, plusieurs éléments invitent à dépasser cette lecture et à proposer le concept de Nimylab (not in my last backyard, « pas dans mon dernier espace »). C’est ainsi que l’on peut reconsidérer l’opposition entre l’intérêt général tel qu’il est perçu à l’échelle locale et à l’échelle nationale. Fos-sur-Mer est en effet une zone très anthropisée, assumant déjà « beaucoup » de contraintes, d’après un membre d’une association de riverains. Les quelques espaces restants sur la commune de Fos sont la plage du Cavaou, dont le paysage est fortement marqué par l’industrie lourde, et le terrain d’environ 1 000 hectares autour des étangs de Lavalduc et d’Engrenier, où la présence de l’industrie est très peu visible. Un membre d’un collectif décrit la situation en faisant état de toutes les zones interdites dans les communes alentour (figure 5.3) : « Des endroits de campagne dans lesquels on peut se promener, par ici, il n’y en a plus. La Crau, vous n’avez pas le droit d’y aller. Autour du GPMM, la ZIP de Fos, vous ne pouvez pas y accéder : risque industriel, c’est interdit. Se promener dans les marais, ce n’est pas possible. Au nord de Fos, vous avez la base aérienne : inaccessible. Le seul endroit accessible à la population, pour aller chercher de la campagne […], c’est cet endroit-là [les étangs, ndlr]. » Ce dernier « poumon vert », comme le décrit un élu local, est considéré comme un bien commun, d’intérêt général à l’échelle locale, qu’il faut protéger. Ainsi, les opposants au projet défendent ce qu’ils considèrent comme leur intérêt général face à un intérêt général national, considérant que Fos a déjà « largement donné à l’industrie », a souligné Romuald Meunier, président de l’association MCTB, lors de la réunion d’ouverture de la concertation préalable du projet HyVence.
Tandis que les opposants au projet perçoivent la zone des étangs comme un espace naturel à sanctuariser (parc naturel) ou à protéger (arrêté préfectoral de protection des biotopes), ses partisans projettent sur la zone un espace industriel propre à l’implantation d’activités économiques productives. Cet affrontement entre les deux définitions du territoire se matérialise dans l’utilisation du langage. Quand Géosel qualifie les étangs de « réservoirs au service d’un usage industriel », le CSNE réagit sur Facebook en dénonçant « des éléments de langage de technocrates qui ne connaissent pas Fos ». « Depuis des siècles, Fos a des étangs ! », rappelle le collectif.
Des visions radicalement opposées : le territoire est-il « industriel » ou « naturel »
La concertation a donc permis de révéler deux visions du territoire, qualifié pour certains de « zone naturelle » et pour les autres de « zone industrielle ». Le recours déposé par les associations contre la mise en conformité du PLU déclassant la zone des étangs en zone industrielle pour accueillir le projet HyVence montre que le statut administratif de la zone est un enjeu stratégique de cette controverse.
Faire exister la nature industrielle : perception et visibilisation
Un premier écueil dont fait part Géosel est l’invisibilité de leur activité industrielle : « On est une zone industrielle mais ça ne se sait pas et ça se voit peu. » Les activités actuelles de Géosel sur le site de Fos consistent en la régulation du taux de sel dans la saumure des bassins, ainsi que dans le pompage des eaux salines pour vider les cavités de Manosque de leurs réserves de pétrole. Cette activité est non seulement peu visible, mais également parfois peu valorisée, puisqu’elle a été qualifiée de « Shadok »47 par le représentant de MCTB lors de la réunion d’ouverture de la consultation préalable au projet.
Géosel tente donc de souligner la dimension industrielle de cet espace. La visite des étangs avec le porteur du projet est éloquente de ce point de vue. Après une explication introductive de ses activités dans ses locaux, il nous a conduits au sud des étangs de saumure, où se trouve l’entrée du site d’exploitation. Nous avons franchi une barrière, puis une deuxième. Quelques panneaux indiquaient à l’entrée « Propriété privée, défense d’entrer. Accès interdit aux personnes non autorisées. Danger ». Des équipements de sécurité nous ont été fournis (casques de chantier, gilets jaunes) et nous avons fait une pause d’observation du paysage : la voie ferrée en direction de la ZIP, qui rappelle la présence de l’industrie à Fos, les deux étangs, la station de pompage un peu plus loin, la base aérienne d’Istres au nord… et, au premier plan, la station de pompage de Géosel.
Néanmoins, l’activité de Géosel sur le site demeure discrète. Pour un élu d’une commune voisine, la fonction industrielle des étangs est passive, laissant place à un espace de promenade et de détente sur les berges.
Le délicat usage de la pollution comme preuve d’existence industrielle
Lors de la visite des étangs, Géosel a rappelé que la fonction industrielle du site était ancienne, mentionnant en guise de preuve le terril situé à côté de la station de pompage, où reposent les terres polluées par l’usine de soude du xixe siècle. Cette pollution aux métaux lourds, bien que localisée, serait volatile et répandue les jours de grand vent. Les origines et le niveau de pollution du site ne sont d’ailleurs pas analysés de la même manière par les associations de défense de l’environnement et par l’industriel. Pour les premiers, la nature reprendrait ses droits et réparerait les terres polluées. Il est fait mention, par exemple, de roseaux absorbant la pollution. Ce récit vient notamment de nombreuses expériences de pollution dans la région (pollution à l’acide, pollution par des poudrières…). Les autorités publiques, elles, sont conscientes de la présence de métaux lourds sur le site. Cependant, un désaccord semble persister quant à l’entité qui devrait supporter les coûts de la dépollution.
S’agissant de Géosel, l’exploitant de l’usine de soude à l’origine de la pollution ayant disparu, il estime que ces coûts de dépollution incombent à l’État. À l’inverse, un élu local souligne que les Salins du Midi sont propriétaires du terrain depuis le début des activités de l’usine de soude et devraient, de ce fait, assumer leurs responsabilités, faisant écho au principe du pollueur-payeur. En tout état de cause, justifier le caractère industriel d’une zone par la présence d’une pollution, en cherchant à maintenir des usages industriels sans procéder à une dépollution, peut paraître hasardeux.
Industrialisation administrative
Si l’activité industrielle n’est pas assez visible au niveau des étangs, c’est aussi qu’elle se fait en dehors de la zone industrialo-portuaire (ZIP), acceptée comme une zone convertible en industries. C’est ce que nous confirme un porteur de projet voulant s’implanter dans la ZIP : « [C’est] plus simple quand les industries sont déjà présentes, être dans la ZIP joue en notre faveur pour l’acceptabilité du projet. »
Selon un membre de MCTB, la population ne se serait pas opposée à une installation d’HyVence en zone industrialo-portuaire puisqu’elle est définie par le PLU comme « à industrialiser ». « Le projet HyVence est hors de la ZIP. Pour nous, il est évident que c’est une extension dissimulée de l’activité industrielle et du territoire du périmètre de la ZIP », avance-t-il. Proposer l’installation d’HyVence sur un domaine classé « zone naturelle » serait pour lui une première extension de la ZIP.
Notons néanmoins que les panneaux solaires du projet HyVence, bien que souvent décrits comme une « ferme solaire », n’entrent pas dans le cadre de la loi Zéro artificialisation nette (ZAN) car ils sont flottants et rétractables, sans endommagement du terrain sur lequel ils s’implantent. Apparaît alors une nuance sur le caractère industriel du projet : s’il peut être considéré comme industriel, il n’artificialise pas le sol durablement comme le font usuellement les projets industriels et les fermes solaires implantées sur le sol.
Qualifications alternatives
Le chercheur en histoire économique et un élu local que nous avons interrogés perçoivent plutôt l’activité de pompage de la saumure des étangs comme une activité foncière. Selon le chercheur, l’installation de panneaux solaires relèverait davantage d’une valorisation foncière que d’une activité industrielle. En revanche, la construction d’un électrolyseur sur le plan d’Aren marquerait un tournant, faisant basculer cette activité foncière vers une activité industrielle à part entière.
Cette qualification « foncière », en tant qu’usage industriel d’une ressource naturelle, révèle l’ambiguïté du statut du lieu. Le chercheur en histoire souligne que, bien que l’industrialisation de Fos ait été marquante depuis les années 1960, elle est demeurée en deçà des ambitions initiales prévues pour la ZIP. Cette situation a laissé place à des friches, où la nature a progressivement repris ses droits au cœur même de la zone. Administrativement, cette ambivalence se manifeste par la présence de trames vertes et bleues des dispositifs d’aménagement identifiant les zones d’intérêt écologique, terrestres ou aquatiques, dans les schémas régionaux de cohérence écologique. Ces trames, intégrées au sein même de la ZIP, rendent visibles des espaces naturels au cœur d’un territoire a priori dévolu à l’activité industrielle. De la même manière, aux abords des étangs, cohabitent des infrastructures industrielles – telles que des pipelines – et des espaces boisés sauvages, typiques des paysages du sud de la France.
Qualification de la nature à travers le statut administratif
De leur côté, les associations s’appuient sur la qualification administrative antérieure à la modification du PLU pour légitimer leur vision de la zone des étangs comme une zone « naturelle ». « Sur le PLU, on identifie parfaitement les zones d’activité, les zones industrielles, les zones de construction, les inconstructibles, les zones naturelles, et ainsi de suite. Et sur le PLU, [les étangs] c’est une zone naturelle. Donc, c’est une zone naturelle. Ce sont des faits », explique un membre du collectif MCTB. Pour autant, si ces diverses associations opposées au projet défendent toutes le caractère naturel de la zone des étangs, elles ne partagent pas une vision unique de ses caractéristiques naturelles.
Une première conception, récurrente dans les comptes rendus de la concertation et les entretiens, consiste à assimiler la nature aux usages de loisirs qu’en ont les riverains. Ces usages sont multiples : ils peuvent être sportifs (randonnées pédestres ou équestres, vélo…) ou plus contemplatifs (observation du paysage). Lorsque nous demandons à un membre du collectif Sauvons nos étangs pourquoi il leur semble pertinent de créer un parc naturel sur la zone des étangs, il répond : « Pour le paysage. Il y a beaucoup de randonneurs, pédestres, équestres […]. Énormément de monde vient faire du cheval dans la zone. Si on couvre l’étang de panneaux photovoltaïques, les écuries peuvent fermer. » Il ne s’agit donc pas tant de protéger la nature que de maintenir les bénéfices que les écosystèmes naturels apportent aux sociétés humaines. Ces services incluent la production de ressources (eau, nourriture, bois), la régulation des processus naturels (climat, qualité de l’air, pollinisation), les bénéfices culturels (valeurs esthétiques, récréatives, spirituelles) et le maintien des conditions de vie sur Terre (formation des sols, cycle des nutriments).
Cette vision anthropocentrique est contrebalancée par une deuxième, plus écocentrique. C’est celle du collectif Cistude, qui met l’accent sur la protection des organismes endémiques du plan d’Aren. « Il existe ici des espèces protégées. Elles ne sont pas très belles, mais elles sont rares. Elles sont protégées parce qu’elles sont rares. »
Ces deux visions, respectivement axées sur les bienfaits que les étangs apportent aux humains et sur la valeur écosystémique des espèces endémiques du plan d’Aren, ne se recoupent pas nécessairement. Cependant, elles peuvent être invoquées conjointement pour s’opposer au projet HyVence.
Dépasser la binarité apparente vers le continuum
À première vue, il semble que les parties prenantes à cette controverse cherchent à définir les étangs en fonction de leur propre vision, qu’elle soit centrée sur la dimension naturelle ou industrielle. Cependant, il devient de plus en plus difficile de tracer une frontière nette entre nature et industrie. Le terme « anthropisation » employé par l’un des représentants d’association paraît le plus approprié. Bien que les étangs soient anthropisés (présence de pipelines, de constructions permettant de gérer la salinité et le remplissage…), ce n’est pas incompatible avec leur caractère naturel, leur rôle de réservoir d’une biodiversité non nécessairement belle, mais protégée et sauvage. De même, le terme « sauvage » ne peut s’opposer que partiellement à l’industrie : dans la ZIP, les espaces sauvages, comme les friches, semblent ne pas manquer.
- 41 — Lettre adressée par le directeur de Géosel à la population.
- 42 — L’hydrogène est dit gris lorsqu’il est produit à partir de combustibles fossiles, comme le gaz naturel.
- 43 — Concernant la production d’hydrogène à partir de l’électrolyse de l’eau, on le dit vert si l’électricité utilisée est d’origine renouvelable, et bas carbone si l’électricité est d’origine nucléaire.
- 44 — Cela n’engendre cependant pas de rejet de l’industrie tant qu’elle se trouve sur la ZIP, comme tiennent à nous le rappeler des membres de collectifs citoyens.
- 45 — Ginette Vastel, Bernard-Henri Lorenzi, Bilan de la concertation préalable, HyVence, 27 mars 2024 au 20 mai 2024.
- 46 — Nous désignons par l’expression « expertise profane » les connaissances produites en dehors du cadre des expertises professionnelles.
- 47 — Les Shadoks sont les personnages d’une série animée française, célèbres pour leur absurdité et notamment pour leur obsession de pomper sans cesse.
De la compensation à l’appropriation du projet, l’acceptabilité en jeu – Par Caroline Granier
Lorsqu’un projet industriel est localement contesté, les riverains expriment une multiplicité de motifs d’opposition. La réponse à leur apporter est donc nécessairement complexe. Ce chapitre étudie les divers cheminements possibles vers cette réponse, dans une perspective instrumentale : il s’attarde sur les conditions minimales à mettre en place pour qu’un projet, un programme ou une politique s’intègrent harmonieusement, à un moment donné, dans son milieu naturel et humain (Caron-Malenfant et Conraud, 2009).
Compenser pour équilibrer coûts et bénéfices, ou comment répondre
au Nimby ?
Quand les riverains ont la perception que les nuisances d’un projet industriel ne retombent que sur eux, tandis qu’ils ne bénéficient pas de ses retombées économiques, des mécanismes de compensation socio-environnementale peuvent être décidés par l’État dans le cas de projets à intérêt national, ou par les municipalités et les porteurs de projet dans les autres cas. Ces mécanismes permettent de rééquilibrer les impacts négatifs et les retombées positives. On parle alors de justice distributive48. Parmi ces mécanismes, monétaires ou non, figurent les taxes spéciales, les accords de partage des bénéfices et le financement participatif.
Des taxes spéciales ont été mises en place, dans le cas des projets d’éoliennes en mer, pour certaines communes littorales. Plus précisément, les communes d’où les éoliennes sont visibles à moins de 12 milles marins et les usagers de la mer (comités de pêche et d’élevage marin, l’Office français de la biodiversité, organismes de sauvetage et de secours en mer agréés) bénéficient d’une taxe annuelle sur les équipements qui produisent de l’électricité à partir du vent49, localisés dans les eaux intérieures ou la mer territoriale. Cette taxe est payée par les exploitants des parcs éoliens. Il existe également des compensations sous la forme d’une nouvelle offre en matière d’infrastructures collectives. Ainsi, certaines municipalités ayant accepté l’implantation de centres de stockage de déchets ont négocié des investissements dans les transports publics, les écoles ou les équipements sportifs pour compenser les coûts du projet pour les habitants.
Parfois, le rééquilibrage entre coûts et bénéfices ne passe pas par l’action publique. Au Canada et en Australie, des accords de partage de bénéfices (benefit sharing agreements) sont ainsi négociés directement entre les porteurs de projet et les communautés locales. Ils existent dans les secteurs exploitant les ressources naturelles et dont l’activité peut avoir des effets négatifs sur l’environnement et la biodiversité : les industries extractives, l’exploitation forestière, la bioprospection et la construction de grandes infrastructures (Clavel, 2023). Ces accords visent non seulement à partager les bénéfices du projet avec la communauté locale, mais aussi à les rassurer sur les risques que fait peser l’activité sur leur santé et sur l’environnement. L’accord le plus répandu est l’entente sur les répercussions et les avantages (ERA) ou Impact and benefit agreement (IBA)50. Selon l’Institut du Nouveau Monde (2013), ce mécanisme de négociation se situe toutefois dans « une zone grise de légalité » et son impact redistributif est limité par l’absence de représentativité politique et de processus démocratique. Pour l’institut, seul l’État a la capacité d’« assurer la planification, la redistribution et l’attribution de droits aux citoyens ».
Un autre mécanisme qui donne à la population la possibilité de participer aux retombées économiques positives du projet est le financement participatif. Régulé depuis 2014 en France, il permet au porteur de projet d’utiliser une plateforme de financement en ligne pour collecter de l’argent auprès d’une communauté, dans des conditions préalablement définies. Ainsi, le projet d’éoliennes en mer à Dieppe a fait l’objet de ce type de campagne de financement. On notera par ailleurs que le financement participatif est aussi un moyen de créer de la confiance envers le porteur de projet. Soland et al. (2013) montrent en effet que l’actionnariat joue un rôle sur la confiance accordée par les habitants aux porteurs de projet d’unités de méthanisation. En particulier, la population est davantage ouverte à un projet porté par des agriculteurs individuels appartenant à la communauté que par des investisseurs externes ou des sociétés énergétiques.
Ce concept de justice distributive est à différencier de celui de justice procédurale qui s’appuie, quant à lui, sur l’équité dans l’accès à la prise de décision politique et à la justice comme institution (c’est-à-dire au recours à la loi). La justice procédurale peut être obtenue en offrant aux riverains un moyen d’accéder à l’information au sujet des projets, voire de participer à leur élaboration, ce qui, à son tour, aide à établir des relations de confiance entre les parties.
Une participation du public instituée mais incomplète
L’information et la participation du public dès le début du projet sont un moyen de répondre aux différents motifs de conflits que nous avons vus dans le premier chapitre. Le principe de participation a lui-même été énoncé dans la convention d’Aarhus du 25 juin 1998 sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, ratifiée par la France le 8 juillet 200251. L’article 6 énonce en particulier : « Les résultats de la participation doivent pouvoir influencer la décision finale. Sinon, c’est le principe même de la participation qui sera remis en cause. » Toutefois, pour certains observateurs comme Zarka (2016), cette disposition ne précise pas si le porteur de projet a l’obligation de s’engager à prendre en compte le retour du public dans l’élaboration de son projet.
La Charte de la participation du public
Créée en 2016 par le ministère de l’Environnement la Charte de la participation du public constitue un guide de bonne pratique à destination des porteurs de projet et du public engagé (ou prévoyant de l’être) dans un processus participatif. C’est un instrument incitatif basé sur le volontariat donc non contraignant – autrement dit un instrument de soft law – qui vient compléter un ensemble de dispositifs en matière de dialogue environnemental*. Elle vient préciser les « valeurs et principes définissant le socle commun et intangible de tout processus participatif ». Elle-même rédigée de manière participative, elle remplace la Charte de la concertation élaborée par le ministère de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement en 1996, la Charte MATE. Elle ne s’applique qu’aux projets menés par l’État comme maître d’ouvrage.
Selon la charte, la participation du public nécessite un cadre clair et partagé ainsi qu’un état d’esprit constructif où les divergences de points de vue seront un atout pour renforcer la qualité du projet débattu. Elle suppose la mobilisation de tous les types de public et doit considérer les propositions des citoyens.
*La Charte de la participation du public vient compléter le dispositif législatif adopté en matière de dialogue environnemental avec l’ordonnance nº 2016-488 du 21 avril 2016 relative à la consultation locale sur les projets susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement et l’ordonnance nº 2016-1060 du 3 août 2016 sur la démocratisation du dialogue environnemental, qui a notamment renforcé la concertation en amont du processus décisionnel.
De l’enquête publique à la concertation
Historiquement, l’enquête publique est le premier dispositif français ayant eu comme objectif d’informer le public sur un projet d’aménagement et de le faire participer à sa mise en œuvre. Créée au xixe siècle, elle a été mise en place pour légitimer l’intérêt public d’un projet et l’expropriation de propriétaires privés. C’est pourquoi les déclarations d’intérêt public sont précédées depuis 1833 d’une enquête publique. Toutefois, cette enquête publique est depuis longtemps contestée pour son incapacité à faire participer le public. Selon Webler et Renn (1995), ces réunions publiques ou hearings existent depuis le xve siècle en Grande-Bretagne. Outre le fait qu’elles sont organisées tardivement dans le processus de décision, elles apparaissent comme des vecteurs de confrontation stérile plutôt que comme vecteur de discussion (Hadden, 1989). Par ailleurs, seule une petite partie de la population peut réellement y participer. Finalement, elles répondent davantage à une obligation légale qu’à une véritable volonté d’associer le public au processus de décision. On retrouve la même critique dans le cas français. Ainsi, pour Caillosse (1986), l’enquête publique a pour but de « faire connaître et accepter les projets poursuivis ou autorisés par l’administration ». La réforme de l’enquête publique par la loi Bouchardeau en 1983, qui a introduit le registre dans lequel le public consigne ses remarques et qui en a fait un outil de protection de l’environnement, n’y a rien changé. Dès lors, seule, elle ne peut être un instrument servant à résoudre les conflits.
En réalité, depuis les années 1980, plusieurs textes législatifs ont favorisé l’information et la participation du public dans les projets d’aménagement affectant par définition les habitants des territoires. Par exemple, le code de l’urbanisme prévoit depuis 1985 une concertation avec « les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées » pour certains projets et pour l’élaboration des documents de planification urbaine. La concertation se matérialise alors par des réunions publiques, des forums de discussion sur Internet, etc. Les différents textes ont aussi réaffirmé le rôle de la participation du public comme levier pour protéger l’environnement. Ainsi, le code de l’environnement prévoit depuis 2010 l’organisation d’une enquête publique pour tous les projets soumis à évaluation environnementale (ou étude d’impact) avec pour objectif d’étudier les conséquences du projet sur l’environnement52.
La concertation, nouvel outil de résolution des conflits d’aménagement, personnifiée par la CNDP
La loi Barnier relative au renforcement de la protection de l’environnement du 2 février 1995 institue quant à elle la Commission nationale du débat public (CNDP), visant à faire participer le public aux grands projets d’aménagement (voir page 36). Sans pouvoir décisionnel, elle organise le débat. Tout projet industriel d’envergure nationale ou dont le coût dépasse 600 millions d’euros doit obligatoirement saisir la commission pour garantir la concertation et la participation du public. Un projet de décret a été déposé en 2024 pour supprimer la saisine obligatoire de la CNDP pour les projets d’équipements industriels. Il a été retoqué au début de l’année 2025.
Lorsque la commission est saisie, des garants de concertation, indépendants du projet, sont désignés pour organiser le processus. La démarche commence généralement par une concertation préalable, bien avant l’implantation du projet, où les grandes orientations sont débattues avant leur validation. Ce processus prend diverses formes : réunions publiques, ateliers, débats mobiles ou échanges en ligne via un site spécifique. Une fois cette étape franchie, le projet, souvent maintenu mais parfois modifié pour répondre aux attentes du public, entre dans une phase de concertation continue, en préparation d’une enquête publique devant découler sur une décision finale du préfet sur le projet.
Comme le souligne Régis Passerieux, ancien sous-préfet d’Istres et actuel président de l’Institut pour la refondation publique53, « les débats de la CNDP sont bien structurés et se déroulent bien, avec deux limites. D’une part, un risque d’épuisement, dans la mesure où l’approche se fait projet par projet, avec un certain nombre de répétitions. D’autre part, la représentativité parfois discutable des participants. Nous avons un dialogue très riche avec la CNDP à ce sujet. Il me semble que la CNDP devrait qualifier davantage la représentativité des participants et réfléchir à la façon de communiquer auprès de ceux qui n’assistent pas à ces débats.
Ce foisonnement de lois, de comités et de procédures met ainsi la participation au cœur de la réponse aux contestations. Ici, la participation peut en effet être considérée comme une réponse aux conflits de procédure et de nuisances tout comme aux conflits structurels. La difficulté demeure toutefois en pratique d’assurer que les contributions du public soient effectivement prises en compte et participent à la coconstruction du projet.
La concertation, outil de prévention des risques pour la sécurité des personnes et pour l’environnement
La création de la zone industrialo-portuaire à Fos dans les années 1960 et 1970 s’est accompagnée de celle du Secrétariat permanent pour les problèmes de pollutions (S3PI ou SPPPI) de Fos-étang de Berre. Son objectif initial est de surveiller les pollutions atmosphériques, en particulier les rejets d’oxyde de soufre. Pour cela, il réalise des études sur les rejets industriels et met en place des actions destinées à les réduire et plus largement à prendre en considération des dimensions sociales et urbaines (Daumalin, 2020). Ainsi, en 1979, il se dote d’un standard téléphonique destiné à recevoir des appels de la part des habitants de la zone qui signalent les nuisances liées à l’activité industrielle. Mis en place dans d’autres territoires dans les années 1990 à l’instar de Dunkerque, il peut être vu comme un premier espace de concertation entre les industriels, les pouvoirs publics et la population (Daumalin, 2020).
À la suite de l’explosion de l’usine d’engrais AZF à Toulouse en 2001, les pouvoirs publics ont souhaité améliorer la concertation et l’information sur les risques industriels et favoriser le débat sur les moyens de les prévenir et de les réduire. La loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, dite loi Bachelot, crée un nouveau document de planification, le plan de prévention des risques technologiques (PPRT), dans le cas des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)54 qui présentent des dangers importants pour la sécurité et la santé des populations voisines et pour l’environnement. Ces PPRT permettent notamment de redéfinir les plans d’urbanisme et de construction, en y intégrant des zones de maîtrise de l’urbanisation future sur lesquelles il est possible d’interdire ou d’autoriser sous des conditions très spécifiques la construction et d’utiliser le droit de préemption. Ils autorisent également des mesures foncières comme le renforcement du bâti ou l’expropriation. Au passage, notons que le classement ICPE contraint les industriels à remplir une déclaration, à s’enregistrer ou à demander une autorisation environnementale d’exercer selon le niveau de risque et de nuisance de leur exploitation. Cette procédure d’autorisation suppose notamment la réalisation d’une étude de dangers visant à évaluer les risques technologiques et une étude d’impact.
La loi Bachelot instaure aussi des comités locaux d’information et de concertation (CLIC) associés aux ICPE. Ces comités regroupent le préfet et les services de l’État, les collectivités territoriales, des représentants industriels, des salariés et des habitants. Ils ont pour vocation d’offrir un cadre d’échange et d’informations relatives à la réglementation, aux mesures de gestion des risques, etc., et de donner un avis consultatif. Les industriels des sites ICPE doivent notamment leur reporter les actions accomplies pour la prévention des risques et leur coût, le bilan du système de gestion de la sécurité, ou encore le compte rendu des incidents et accidents ayant affecté leurs établissements. Ces comités deviennent en 2012 des comités de suivi de site (CSS)55 qui, par essence, s’inscrivent dans le long terme. La création des CSS est obligatoire pour les sites Seveso seuil haut et les centres collectifs de stockage de déchets non inertes, c’est-à-dire qui se décomposent, brûlent ou produisent une réaction chimique.
Encore une fois, ces instances sont critiquées pour la faible implication du public. Selon leurs détracteurs, elles serviraient surtout à éviter les contestations et fonctionneraient principalement pour répondre à une opacité informationnelle de la part des porteurs de projet, mais ne parviendraient pas à mobiliser plus que la participation du public. Dans le cas de la vallée de la chimie traité précédemment, les informations données émanent des services de l’État et des industriels ; les riverains les reçoivent sans pouvoir les contester et, lorsqu’ils posent des questions au sujet des pollutions, il leur est répondu que les seuils de rejet sont respectés (Le Naour, 2024). L’étude de cas détaillée de Pierre-Bénite montre combien le fonctionnement réel de cette instance n’est pas de nature à faciliter l’acceptation du projet par les riverains. De leur côté, les travailleurs et les syndicats ne s’expriment que très rarement dans ces instances. Toutefois, selon Alban Bruneau, président d’Amaris (association nationale des collectivités pour la maitrise des pollutions et risques industriels), la qualité de l’accompagnement de ces comités diffère selon les territoires ou d’une préfecture à une autre56.
Dialoguer dans le temps long
Dans les territoires concernés par des installations à risques, des actions et dispositifs sont mis en œuvre pour informer et sensibiliser la population aux risques sur le temps long. L’intercommunalité Caux Seine agglo dispose ainsi d’un service « risques majeurs » depuis 2018, dont la mission est d’accompagner les communes à la fois dans la gestion de leur environnement industriel (élaboration du PPI, du PPRT, animation de l’association d’industriels…), dans les dispositifs de sauvegarde des populations (plan communal et intercommunal de sauvegarde, plans de mise à l’abri) et dans la prévention (avec notamment l’organisation de la Semaine de la sécurité). L’intercommunalité travaille également en coordination étroite avec une association dont le périmètre géographique couvre le pays de Caux, Incase (Industries Caux Seine)57, dont l’une des missions, au-delà de fédérer les industriels, est de sensibiliser le public aux risques associés.
Il faut dire qu’outre son exposition à des risques naturels (inondations, mouvements de terrain), le territoire comprend neuf entreprises classées Seveso seuil haut et trois en projet, ainsi que quatre entreprises classées Seveso seuil bas et deux en projet. Sur ce territoire, on observe donc une pluralité d’actions : un club des Seveso pour que les entreprises à l’origine des risques se connaissent entre elles et puissent partager leurs bonnes pratiques, voire organiser une entraide ; la participation des communes aux exercices de sécurité menés dans les entreprises ; la formation, parmi les citoyens, des « nez », c’est-à-dire des personnes capables d’identifier les différentes odeurs émises par une usine pétrochimique, ce qui leur permet de donner l’alerte ; la réalisation d’enquêtes de perception par les industriels pour identifier les facteurs d’inquiétude de la population.
Créer des espaces de coconstruction sur le long terme
Contrairement aux enquêtes publiques et aux concertations préalables de la CNDP, qui interviennent à un instant précis dans les projets d’implantation, certains autres dispositifs mis en œuvre localement visent à inscrire dans le long terme la participation des populations à la construction des territoires. Sans obligation légale, ces dispositifs représentent de nouvelles formes de dialogue et de coconstruction entre les parties prenantes au territoire. Selon Theveniaut (2013), la coconstruction d’une décision ou d’un projet acte représente la « reconnaissance des conditions de vie au quotidien et traduit une responsabilité partagée d’agir ». En d’autres termes, on désigne par là des situations où les autorités publiques ne sont plus les seuls acteurs légitimes pour décider de l’aménagement d’un territoire et, donc, de son devenir. Ces dispositifs témoignent d’une volonté de dépasser une conception trop descendante des politiques publiques. Parmi les exemples de tels dispositifs qui ont retenu notre attention dans les territoires industriels figurent les pactes locaux, d’une part, et le laboratoire territorial industrie Fos-Berre (ou Inlab), d’autre part.
Le pacte local, révélateur des engagements de chacun
Selon Theveniaut (2013), « un pacte local est une dynamique collective territoriale, un processus construit dans la durée, avec un système de relations qui porte une action pour répondre à des problèmes identifiés. Il permet à tous les acteurs concernés, unis par des valeurs humanistes, de construire, de façon contractuelle, des réponses adaptées aux spécificités de chaque société locale, en particulier ses spécificités culturelles ». Plus simplement, le pacte vise à fédérer les acteurs, à décrire les engagements de chacun et à simplifier le fonctionnement opérationnel des actions. Un pacte industriel58 peut cibler explicitement l’implication des populations dans les projets industriels et ainsi faciliter leur mise en œuvre (c’est le cas du pacte industrie-territoire Rochefort-Royan-Marenne-Oléron), ou avoir d’autres objectifs comme la structuration d’une filière (le pacte Sud avenir hélico dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a pour mission de faire de la filière hélicoptère une filière durable).
Le pacte industrie-territoire Rochefort-Royan-Marenne-Oléron est né de la volonté de l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), dans le cadre du programme Territoires d’industrie, d’impliquer les territoires dans le développement local et la promotion d’une image positive de l’industrie. Rochefort-Royan-Marenne-Oléron a été choisi comme cas d’école par l’ANCT pour expérimenter ce que pourrait être un pacte entre élus, industriels et riverains. L’idée est de pouvoir ensuite répliquer ce pacte dans les autres territoires labellisés Territoires d’industrie.
Le pacte, élaboré par la société de consultants Compagnum, comprend un ensemble d’engagements réciproques pris par les entreprises et les représentants et partenaires des collectivités territoriales. Ces engagements portent notamment sur l’attractivité du territoire (amélioration de l’image positive de l’industrie et soutien au rayonnement du territoire), l’environnement (progrès sur le développement durable, architecture intégrée au paysage, immobilier sobre et bas carbone), la formation et l’emploi (la pérennité de l’emploi local et le renforcement de la formation pour l’industrie, contribution aux solidarités territoriales), l’innovation (contribution au progrès des filières et à la sous-traitance locale, et recherche régulière d’innovation et de diversification), les implantations et mutualisations (mutualisation des ressources et recherche de synergies, communication sur les projets d’implantation) et la mobilité et le logement (amélioration de la qualité de vie des collaborateurs).
Un laboratoire pour expérimenter le dialogue
Face aux inquiétudes et aux tensions récurrentes concernant les risques sur la santé et l’environnement occasionnés par les activités industrielles, face également aux nouvelles oppositions qui se sont levées contre des activités naissantes liées à la transition écologique (cf. chapitres 2 et 5), le laboratoire territorial industrie Fos-Berre (Inlab) est né de la volonté de restaurer un dialogue de confiance et à long terme entre les acteurs industriels, les pouvoirs publics et la population locale. À l’initiative de la préfecture des Bouches-du-Rhône et du sous-préfet d’Istres, il a le statut de laboratoire interministériel d’innovation publique, dont l’objectif est de créer des solutions en partant du terrain pour répondre aux besoins des citoyens et des agents publics. Selon le rapport annuel 2024, l’objet d’Inlab est « la définition des voies et moyens d’un développement industriel articulé avec le meilleur niveau de normes environnementales et la préservation du cadre de vie. […] Le Lab industrie Fos-Berre a pour mission de faire converger le niveau de connaissance des problématiques industrielles de l’ensemble des acteurs du territoire, afin de favoriser l’émergence d’une vision commune, intégrée et partagée, de son avenir industriel à moyen et long terme, et de codéfinir les critères de sa soutenabilité, en termes de cadre de vie, d’environnement et d’habitat ».
L’organe principal du Lab, appelé collégialité, est un lieu de débat et de coconstruction. Il est composé d’une soixantaine de membres représentatifs du territoire, c’est-à-dire dont les intérêts peuvent être affectés par la réalisation d’un projet : trente citoyens volontaires, des représentants industriels, des représentants de l’État et des collectivités territoriales, des associations et des organisations spécialisées (notamment l’association Piicto et l’Institut écocitoyen pour la connaissance des pollutions, fournisseur d’une expertise indépendante). Ces dernières organisations ne sont pas les seules à avoir le statut d’expert : les représentants de l’État, parmi lesquels la préfecture des Bouches-du-Rhône, la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (Dreal) et la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) apportent aussi leur expertise réglementaire à la collégialité.
Ces membres se réunissent tous les mois dans des ateliers, avec trois grands objectifs : la réalisation d’un diagnostic du territoire (atouts, faiblesses), la construction de scénarios à l’horizon 2040 et l’élaboration d’« indicateurs de bonification du territoire » destinés à être convertis en indicateurs de management de projet par les industriels. Ces indicateurs sont issus de la méthode « économie de la réciprocité », développée par le groupe Mars avec l’université d’Oxford, et basée sur des indicateurs de « bonification » du capital social, naturel, financier, sociétal du territoire.
Comme le souligne Régis Passerieux, préfet d’Istres entre 2021 et 2024, « le terme de bonification [lui] paraît plus judicieux que celui d’acceptabilité, car celui-ci laisse entendre qu’il faudrait contraindre la population à accepter l’industrie. Avec ce type d’approche, on est sûr d’aboutir à un blocage. Nous devons plutôt chercher à définir ensemble ce qu’est une “bonne” industrie pour notre territoire, et comment résoudre l’équation très complexe du besoin de réindustrialisation, de l’exigence de transition énergétique et des impératifs de protection de la santé, de l’environnement, de la biodiversité. Un tel défi ne peut être relevé qu’à condition de se montrer extrêmement concret et pragmatique »59.
Parallèlement à cette collégialité, trois autres comités se réunissent, celui des élus, qui rassemble tous les maires, un comité d’experts composés d’universitaires qui procurent des données objectives et un comité de pilotage constitué du préfet des Bouches-du-Rhône, du sous-préfet d’Istres et d’un représentant du Groupement maritime et industriel de Fos et sa région (GMIF, représentant les industriels), chargé de l’organisation des activités d’Inlab. Le public élargi peut assister à des conférences thématiques et des vidéos sont mises à leur disposition sur le site Internet d’Inlab.
Cette démarche de concertation s’inscrit en complémentarité avec le dispositif RÉPONSES (Réduire les pollutions en santé environnement) mis en place en 2018 par le SPPPI de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Ce dispositif cherche à apporter des solutions aux attentes et aux questions des habitants du pourtour de l’étang de Berre concernant la qualité de l’air et les gaz à effet de serre. Il s’appuie pour cela sur un processus de concertation régulier avec les habitants et sur la diffusion d’études visant à informer le public sur ces sujets.
La jeunesse de ce dispositif nous empêche pour l’instant de présager de sa pérennisation et de la prise en compte effective des recommandations des citoyens, limites des dispositifs classiques de concertation prévus par la loi. À ce sujet, le bassin industrialo-portuaire a bénéficié du nouveau dispositif prévu par la loi Industrie verte de 2023, à savoir la possibilité d’organiser un débat global portant sur plusieurs projets lorsque ces derniers concernent un territoire délimité et homogène. La CNDP a ainsi été saisie par trois préfets (Bouches-du-Rhône, Alpes-de-Haute-Provence, Gard) pour organiser un débat public « Fos Berre Provence : un avenir industriel en débat », qui s’est déroulé entre avril et juillet 2025 et qui a porté sur 51 projets. Ce débat a été notamment l’occasion d’aborder le sujet de la ligne très haute tension prévue par voie aérienne et des effets cumulés des projets sur les risques. À noter que cette nouvelle procédure permet d’exonérer les projets de concertation et de débat public durant les huit années suivantes.
- 48 — Plus généralement, la justice distributive cherche à résoudre des conflits de répartition d’un ensemble de biens entre des individus (Forsé et Parodi, 2006).
- 49 — Conformément à l’article 1519B du code général des impôts.
- 50 — Les IBA désignent au Canada « toutes les formes d’accords conclus entre une communauté autochtone ou locale, qu’elle soit notamment bande, nation ou peuple autochtone, et un organisme privé, public ou parapublic, dont l’objectif principal est de permettre l’avancement d’un projet de développement énergétique ou d’extraction des ressources de la terre » (Clavel, 2023).
- 51 — L’article 7 de la Charte de l’environnement de 2005, qui a valeur de loi constitutionnelle, stipule que « toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ».
- 53 — Voir le séminaire de l’observatoire des Territoires d’industrie du 2 avril 2024.
- 54 — Sont des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) « les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers et inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique » (article L. 511-1 du code de l’environnement). Les installations classées sont régies par le livre V, titre 1er du code de l’environnement (parties législative et réglementaire). Outre les sites ICPE, les sites caractérisés par des risques d’accident majeur, c’est-à-dire qui entraînent des effets graves et immédiats sur les employés, les riverains, l’environnement et les biens, sont classés comme des sites Seveso et, en tant que tels, doivent mettre en place une prévention marquée. Cette prévention passe notamment par l’information du public, l’organisation des moyens de secours, la maîtrise de l’urbanisation et bien sûr la maîtrise du risque par l’industriel dans son installation.
- 55 — Les CSS succèdent également aux commissions locales d’information et de suivi (CLIS) mises en place pour les installations de traitement des déchets.
- 56 — Voir le séminaire de l’observatoire des Territoires d’industrie du 2 avril 2024.
- 57 — L’association a été créée en 1972 sous le nom d’Association des entreprises de Port-Jérôme et sa région (AEPJR) pour étudier les phénomènes de pollution atmosphérique de la basse Seine et collecter et éliminer les déchets industriels. Puis, progressivement, elle a été amenée à traiter les questions de sécurité, de soins médicaux, de transport du personnel. Dénommée Incase depuis 2022, elle est à la fois une plateforme fédérant des entreprises industrielles, des sociétés proposant des services et du support, des entreprises de logistique, de stockage et de transport, des sociétés de collecte et de traitement des déchets, des cabinets de recrutement et de formation et un véhicule diffusant les consignes de sécurité auprès du grand public.
- 58 — Parmi les autres pactes territoriaux, nous pouvons citer l’exemple des Projets alimentaires territoriaux (PAT) ou le Pacte parisien pour les quartiers populaires.
- 59 — Voir le séminaire de l’observatoire des Territoires d’industrie du 2 avril 2024.
Point de vue – À Fos-Berre, la nécessité de répondre au besoin de considération et de dialogue de la part des populations locales par Nicolas Mat
Figurant parmi les plus grands espacesindustrialo-portuaires d’Europe, le territoire dit de Fos-Berre regroupe plusieurs plateformes industrielles historiques situées sur le pourtour de l’Étang de Berre (La Mède, Lavéra, Berre, Marignane) et sur la zone de Fos-sur-Mer. Cet espace stratégique, proche de Marseille, constitue une plaque industrialo-aéroportuaire de première importance à l’échelle nationale, avec une présence marquée et diversifiée de l’industrie, au sein de ces plateformes et sur des sites plus isolés. S’y côtoient des activités massives de transformation et de production industrielle, dans les domaines du raffinage, de la sidérurgie, de la chimie, de la pétrochimie, du traitement des déchets, de la production énergétique, de l’aéronautique, de la cimenterie, etc.
Dans le contexte géopolitique mondial actuel, cet espace est fortement exposé aux grands enjeux du moment – maintien de l’activité industrielle et consolidation des emplois, maintien de la compétitivité et concurrence accrue, problématiques de réindustrialisation, de décarbonation de l’industrie et plus globalement de nos usages, gestion des ressources et préservation des milieux naturels, coexistence d’activités et gestion des risques technologiques, conflits d’usages sur les ressources – pour n’en citer que quelques-uns.
Engager les habitants dans le processus de transformation du territoire, clé de l’acceptabilité des projets
Or cette zone vit depuis près de trois ans une séquence assez inédite dans l’histoire de son développement. Depuis quelques années, plusieurs projets industriels sont apparus dans le paysage économique du territoire. Certains de ces projets, que l’on pourrait qualifier d’endogènes, sont portés par des industriels existants et visent à transformer sensiblement leurs outils de production actuels, en se dotant de nouvelles unités, en investissant sur des technologies moins émettrices de gaz à effet de serre, en électrifiant certains procédés, en faisant davantage appel à des logiques de circularité dans la gestion des ressources par exemple. D’autres projets sont portés par des acteurs extérieurs au territoire souhaitant s’implanter sur la zone. Parmi les porteurs de ces projets exogènes, on trouve des start-up et aussi des grands groupes français ou internationaux.
Cette séquence de développement et d’attractivité renouvelée de la zone Fos-Berre est telle que l’État a souhaité mettre en place en 2025 une démarche de concertation globale (Débat de zone), sous l’égide de la Commission Nationale du Débat Public (CNDP). Cet exercice de concertation globale à l’échelle d’une zone, sur la base de plusieurs projets industriels, est assez inédit en France et a été riche d’enseignements pour l’ensemble des parties prenantes impliquées (services de l’État, CNDP, porteurs de projets, collectivités, associations de riverains, associations environnementales, syndicats, représentants de secteurs et de filières, etc.).
Parmi ces enseignements, on peut noter le fait que les différentes concertations publiques menées ces dernières années ont révélé que la compréhension des transformations de ce territoire, en cours et à venir, est un élément essentiel d’acceptabilité pour les projets. En effet, si cette zone apparaît plutôt propice à accueillir des projets industriels de grande envergure, le seul fait d’insister sur leur caractère contributif à la décarbonation ou à la souveraineté ne suffit plus. Ils doivent également montrer dans quelle mesure ils s’inscrivent pleinement et concrètement dans les transformations attendues du territoire. L’identité de cette zone, et notamment de Fos-sur-Mer, indissociable de son histoire industrialo-portuaire qui a façonné depuis plus de cinquante ans le tissu social local et dont dépendent encore directement de nombreuses familles, et le consensus sur la nécessité de décarboner l’industrie, ne suffisent plus à garantir l’acceptabilité des projets. Au-delà d’un manque de compréhension sur la nature ou le bien-fondé des projets, souvent complexes à appréhender pour des publics non experts, c’est en parallèle un profond besoin de considération et de dialogue qui s’exprime de la part des populations locales. Cela se traduit par des inquiétudes renouvelées et non apaisées, relatives notamment aux enjeux environnementaux, aux risques sanitaires et/ou technologiques, et aux besoins de renforcement des infrastructures (routières par exemple) et des services souvent considérés comme non adaptés face à ce flot de nouveaux projets. La présence d’associations, notamment environnementales, constituées bien souvent à l’initiative des habitants pour défendre la santé, la biodiversité et la qualité de vie, est une manifestation claire de ce besoin de clarification et de participation citoyenne effective dans le processus local de développement et d’aménagement.
Créer un point de rencontres et faciliter les échanges entre tous les acteurs du territoire
Cela suppose de maintenir et de renforcer quelques prérequis essentiels. D’une part, établir des relations de confiance entre les parties prenantes (porteurs des projets, adversaires aux projets, observateurs) de manière à parler d’un même objet, quand bien même les avis sur ce dernier peuvent diverger voire s’affronter parfois. D’autre part, arriver à apprécier ces projets à travers des référentiels de temps et d’espace fluctuants. Étant donné son temps de développement puis d’exploitation (souvent sur plusieurs dizaines d’années), il est nécessaire de considérer un projet à travers son impact direct immédiat (à court terme) sur le territoire mais également dans un contexte de plus long terme (considérant les évolutions attendues ou potentielles de la société, de nos besoins, du cadre réglementaire, de l’évolution des marchés, etc.). En outre, s’il est amené à s’implanter sur la zone de Fos-Berre, un projet industriel majeur a souvent intérêt à tirer parti des infrastructures et des facilités logistiques qu’offre une ZIP. Dès lors, le projet, bien qu’ancré sur une partie du territoire, peut s’avérer d’autant plus stratégique si l’on étudie finement son interconnexion avec d’autres sites industriels situés localement ou plus éloignés. Les projets développés actuellement autour de l’hydrogène ou de la valorisation du CO2 illustrent bien cette logique de maillage et d’interdépendance progressive et nécessaire entre grandes places industrielles, que ce soit à une échelle régionale ou interrégionale. Ces différents aspects, désormais réclamés lors des échanges dans les espaces de concertation supposent d’appréhender la notion de complexité, nécessaire à la prise de décisions stratégiques dans des environnements incertains et sous contraintes.
C’est ici la contribution d’une association comme PIICTO, qui anime et développe depuis plus de dix ans une dynamique d’écologie industrielle et territoriale (EIT). Désormais déployée à l’échelle de ce territoire Fos-Berre, cette démarche associative fédère aujourd’hui plus d’une soixantaine de membres (industriels, collectivités, autorité portuaire, académiques, etc.) autour de thèmes de travail et d’action aussi variés que la décarbonation, l’économie circulaire, la préservation des ressources, la mutualisation des moyens ainsi que la gestion collective des risques industriels. Si cette démarche a vocation à aider ses membres industriels à concilier leurs enjeux d’excellence environnementale et leur performance économique dans une logique de maintien des activités et des emplois sur le territoire, elle sert aussi d’interface entre les besoins collectifs des industriels engagés dans la transition écologique et les politiques d’aménagement portées par les collectivités publiques sur le territoire. C’est cette expertise en animation territoriale, combinée à une connaissance approfondie des projets industriels mutualisés qu’elle accompagne, qui confère à PIICTO une certaine crédibilité pour, d’une part, apporter des outils d’aide à la décision stratégique à ses membres et, d’autre part, distiller une information utile auprès du grand public dans le cadre des réunions de concertation. Les sujets concrets traités par l’association (circularité des ressources) apportent en effet des réponses directes aux préoccupations des habitants qui accueillent parfois avec crainte l’arrivée de nouveaux projets industriels. En ce sens, l’association a plusieurs fois été sollicitée pour contribuer au débat de zone « Fos-Berre » durant ce premier semestre 2025.
Pour soutenir l’acceptabilité sociale nécessaire à la réussite de la transition écologique du territoire, l’association PIICTO accentue aujourd’hui ses travaux autour de la mise en information et sur la vulgarisation des projets et leur remise en contexte dans le mouvement général du territoire (mise en récit). Il s’avère en effet nécessaire d’aider nos membres industriels à communiquer efficacement et de manière transparente sur la nature de leurs projets et la manière dont ceux-ci s’inscrivent dans les trajectoires de décarbonation et de développement durable du territoire. Par ailleurs, nous nous devons aussi de fournir au grand public les informations claires et vulgarisées, issues de notre expertise terrain, permettant d’éclairer les enjeux sur ces thèmes complexes (d’un point de vue technique et organisationnel) et les bénéfices liés à cette transition.
Conclusion
Dans cet ouvrage, nous avons cherché àrépondre au constat paradoxal suivant : comment se fait-il que, régulièrement, certains projets d’implantation ou d’extension de sites industriels suscitent une vive contestation locale au point d’être abandonnés par leurs promoteurs si, par ailleurs, les Français se déclarent majoritairement favorables à la réindustrialisation ?
Un premier faisceau de réponses, quantitatives, découle d’un travail de recension des conflits relayés par la presse locale et régionale. Il en ressort que, sur la période 2010-2024, seuls un petit nombre de projets des créations et extensions de sites manufacturiers ont fait l’objet de contestations repérables dans la presse. Il est donc possible d’exclure l’hypothèse d’une opposition systématique des Français ou d’habitants de certains territoires aux projets industriels.
Toutefois, certains secteurs d’activité représentent un terrain d’expression privilégié de ces contestations. On pense notamment aux sites chimiques, aux usines de ciment ou d’enrobés et, par-dessus tout, aux projets d’énergies renouvelables, contre lesquels des voix s’élèvent beaucoup plus fréquemment.
Un second faisceau de réponses provient d’une analyse qualitative du corpus de presse ainsi constitué et des études de cas qui sont relatées dans cet ouvrage. On y découvre que ces conflits mettent en scène des acteurs aux intérêts différents. Autrement dit, un conflit est rarement motivé par une seule raison et ne pourra donc être soldé par une réponse simple et unique. En particulier, le phénomène Nimby à proprement parler, c’est-à-dire le calcul rationnel d’un individu ou d’un collectif qui estime supporter une part excessive des externalités négatives d’un projet qu’il considère par ailleurs légitime et justifié, n’est qu’un argument minoritaire des opposants. Il faut ajouter à cela différentes postures, qui s’expriment certes en termes territoriaux mais qui ne procèdent pas d’une telle analyse coût-bénéfice, comme l’attachement émotionnel au territoire et aux lieux symboliques qu’il comporte. Par ailleurs, parmi les intérêts défendus par les contestataires, d’autres dépassent le cadre du territoire et même parfois celui du projet : c’est notamment le cas des parties prenantes qui remettent en question la représentation démocratique, l’expertise ou le système économique dont les projets industriels leur apparaissent comme des incarnations.
On comprend, devant une telle multiplicité des motifs d’opposition, que la seule concertation organisée par la CNDP ne soit pas à même d’adapter le projet aux intérêts de chaque partie prenante. On a même vu, dans certaines études de cas, qu’elle avait au contraire permis la structuration des oppositions au point de précipiter l’abandon du projet. Les projets industriels étudiés dans cet ouvrage invitent donc à considérer des solutions alternatives aux dispositifs usuels de concertation et de participation du public, en allant au-delà du cadre réglementaire et en cherchant à inscrire la délibération dans le temps long. En cela, les « bonnes pratiques » relevées dans les territoires, qui s’avèrent capables de prévenir ou de solder positivement des controverses déclenchées par des projets industriels contestés, présentent des similitudes frappantes avec celles qui sont observées dans d’autres études où elles favorisent l’ancrage de l’industrie dans les territoires : inscription des procédures dans le long terme, travail collectif sur un projet de territoire, sens local de l’initiative pour répondre et au besoin réorienter les décisions nationales descendantes.
Certaines oppositions, aussi peu nombreuses soient-elles, atteignent une telle intensité qu’elles peuvent allonger les délais d’implantation voire mener au renoncement au projet : l’acceptabilité sociale de l’industrie n’est donc pas un acquis mais un actif du territoire, à construire et entretenir.
Ce faisant, cet ouvrage revient sur un certain nombre de postulats fréquents concernant l’acceptabilité sociale des projets industriels, déjà contestés par Batellier (2015). Premièrement, il s’avère que la population n’est pas systématiquement favorable à tout projet vertueux d’un point de vue environnemental : dans le cas des conflits liés aux projets HyVence et Hynovera, on voit bien que la dimension « verte » des projets n’est pas une garantie suffisante pour qu’ils ne génèrent pas de contestation. Deuxièmement, on constate également qu’une absence de contestation ne signifie pas que les habitants adhèrent au projet : les inquiétudes entourant les PFAS, substances chimiques très contestées, ont suffi à amorcer un conflit concernant l’extension d’une usine près d’un siècle après son implantation. Troisièmement, l’opposition aux projets industriels ne peut être réduite à des considérations visuelles et esthétiques. Dans le cas d’HyVence, ce n’est pas l’esthétique du projet qui explique son rejet, mais la perspective d’artificialiser la dernière portion de terrain qui ne l’était pas au sein d’une vaste zone industrialo-portuaire. Quatrièmement, les opposants sont parfois très bien informés des aspects technico-économiques des projets qu’ils sont capables de maîtriser : le cas de Pierre-Bénite montre que des experts profanes peuvent venir contester les tests effectués par les porteurs de projet et apporter de nouvelles preuves solides à l’appui de leur posture. Enfin, contrairement aux principes fondateurs des dispositifs prévus par la loi, la participation publique ne favorise pas toujours l’acceptation d’un projet par les riverains, mais elle fait émerger un dialogue entre les parties prenantes d’un territoire qui peuvent être amenées, ensemble, à le redéfinir, comme l’illustre le cas d’Hynovera.
Bibliographie
Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) (2011). Campagne nationale d’occurrence des composés alkyls perfluorés dans les eaux destinées à la consommation humaine : ressources en eaux brutes et eaux traitées .
Armour, A. (1985). The Not in My Backyard Syndrom . York University Press.
Augagneur, F., & Casillo, I. (2022). Postface. Démocratie et environnement. Pour une délibération participative. Dans Fourniau, J., Blondiaux, D., Bourg, D. et Cohendet, M. La Démocratie écologique : Une pensée indisciplinée (p. 391-408). Hermann.
Barbier, R. (2021). L’acceptabilité sociale est devenue le nouvel impératif des porteurs de projets. In R. Barbier & P. Hamman (dir.), La Fabrique contemporaine des territoires (p. 109-116). Le Cavalier bleu.
Barthe, Y., Callon, M. & Lascoumes, P. (2014). Agir dans un monde incertain. Essai sur la démocratie technique . Seuil.
Batel, S. (2020). Research on the social acceptance of renewable energy technologies : Past, present and future. Energy Research & Social Science , 68.
Batel, S., & Devine-Wright, P. (2015). Towards a better understanding of people’s responses to renewable energy technologies : Insights from Social Representations Theory. Public Understanding of Science , 24 (3), 311-325.
Batellier, P. (2015). Acceptabilité sociale. Cartographie d’une notion et de ses usages. Cahier de recherche UQAM : les publications du centr’ERE .
Bertsch, V., Hall, M., Weinhardt, C., & Fichtner, W. (2016). Public acceptance and preferences related to renewable energy and grid expansion policy : Empirical insights for Germany. Energy , 114, 465-477.
Bourdin, S. (2020). Le NIMBY ne suffit plus ! Étude de l’acceptabilité sociale des projets de méthanisation. L’Espace Politique. Revue en ligne de géographie politique et de géopolitique , (38).
Bourdin, S., Jeanne, P., & Raulin, F. (2020). « La méthanisation, oui, mais pas chez moi ! » Une analyse du discours des acteurs dans la presse quotidienne régionale. Natures Sciences Sociétés , 28(2), 145-158.
Bourdin, S., & Nadou, F. (2020). The role of a local authority as a stakeholder encouraging the development of biogas : A study on territorial intermediation. Journal of Environmental Management , 258(2).
Bpifrance Le Lab. (2025). Industriels résistants en des temps turbulents.
Caron-Malenfant, J., & Conraud, T. (2009). Guide pratique de l’acceptabilité sociale : pistes de réflexion et d’action . Éditions DPRM.
Chailleux, S. et Zittoun, P. (2021). Entre pluralité des espaces de débat et singularité des ordres du jour : la carrière sinueuse du gaz de schiste. Revue française de sociologie , 62(2), 253-281.
Clavel, S. (2023). Les accords de partage de bénéfices : les entreprises extractives face aux communautés locales. Dans Lopez, B. (dir.), Commerce transnational et industries extractives , Institut Joinet. 2023.
Daumalin, X. (2020), « La création du Secrétariat permanent pour les problèmes de pollutions industrielles Fos/étang-de-Berre », Rives méditerranéennes , 61.
Delcayre, H., & Bourdin, S. (2025). In search of “fertile ground”: How territorial characteristics influence the social acceptability of renewable energy projects. Environmental Management , 75(4), 867-882.
Depraz, S. (2005). Le concept d’« Akzeptanz » et son utilité en géographie sociale. Exemple de l’acceptation locale des parcs nationaux allemands. L’Espace géographique , tome 34(1), 1-16.
Devine-Wright, P. (2009). Rethinking NIMBYism : The role of place attachment and place identity in explaining place-protective action. Journal of Community & Applied Social Psychology , 19(6), 426-441.
Dziedzicki, J. M. (2003). La gestion des conflits d’aménagement entre participation du public et médiation. Annuaire des collectivités locales , 23(1), 635-646.
Dziedzicki, J. M. (2004). Au-delà du Nimby : le conflit d’aménagement, expression de multiples revendications. In P. Melé et al . (éd.), Conflits et territoires (p. 35-64). Presses universitaires François-Rabelais.
Dziedzicki, J.-M. (2015). Quelles réponses aux conflits d’aménagement ? De la participation publique à la concertation. Participations , 13(3), 145-170.
EFSA (2008). Opinion of the scientific panel on contaminants in the food chain on perfluorooctane sulfonate (PFOS), perfluorooctanoic acid (PFOA) and their salts. The EFSA Journal , 653, 1-131.
Forsé, M. et Parodi, M. (2006). Justice distributive. La hiérarchie des principes selon les Européens. Revue de l’OFCE , 98(3), 213-244.
Gérardot, M. (2012). Dictionnaire des conflits . Atlande.
Hall, N., Lacey, J., Carr-Cornish, S., & Dowd, A. M. (2015). Social licence to operate : Understanding how a concept has been translated into practice in energy industries. Journal of Cleaner Production , 86, 301-310.
Harvey, B. (2014). Social development will not deliver social licence to operate for the extractive sector. The Extractive Industries and Society , 1(1), 7-11.
Heffron, R. J., Downes, L., Rodriguez, O. M. R., & McCauley, D. (2021). The emergence of the ‘social licence to operate’ in the extractive industries ? Resources Policy , 74 , 101272.
Hirschman, A. O. (1970). Exit, Voice, and Loyalty : Responses to Decline in Firms, Organizations, and States . Harvard University Press.
Horel, S. (avec Felke, C. [NDR], Calatayud, J. M. & Pilz, S.[Forever Lobbying Project], Värjö, D. [Sveriges Radio]). (2025). La campagne de désinformation du lobby du plastique pour défendre les PFAS. Le Monde .
Insee (2023). Le trajet médian domicile-travail augmente de moitié en vingt ans pour les habitants du rural. Insee Première , 248.
Institut du Nouveau Monde, avec la collaboration de la Corporation de protection de l’environnement de Sept-Îles. (2013). Étude sommaire sur les processus et les facteurs d’acceptabilité sociale pour le secteur industriel .
Karachanski, D. (2025). Comment l’industrie crée de l’emploi aujourd’hui ? Les Notes de La Fabrique. Presses des Mines.
Lacey, J., & Lamont, J. (2014). Using social contract to inform social licence to operate : an application in the Australian coal seam gas industry. Journal of Cleaner Production , 84 , 831-839.
Laurent, B & Violle, A. (2024). The territorialisation of industry in times of transition : Ecosystems, infrastructures and hubs in the green hydrogen sector. Journal of Environmental Policy and Planning , 26(5),1-14.
Michel, C. (2021). Perturbateurs endocriniens : pourquoi les remplaçants du bisphénol A posent aussi problème. The Conversation . 3 mai 2021.
Le Naour, G. (2024). Développer de nouveaux savoirs pour en finir avec « l’acceptabilité sociale » des risques industriels, Questions de communication , 45 (1), 173-190.
Noack, Y. (2023). Réflexions sur la concertation Hynovera, projet d’implantation d’une usine de biocarburant.
Soland, M., Steimer, N., & Walter, G. (2013). Local acceptance of existing biogas plants in Switzerland. Energy Policy , 61, 802-810.
Theveniaut, M. (2013). Du pacte local au pacte territorial : une démarche méthodique pour une gouvernance démocratique du social et de l’économique. Céreq , 37.
Torre, A., Aznar, O., Bonin, M., Caron, A., Chia, E., Galman, M.,& Kirat, T. (2006). Conflits et tensions autour des usages de l’espace dans les territoires ruraux et périurbains. Le cas de six zones géographiques françaises. Revue d’économie régionale & urbaine , (3), 415-453.
Torre, A., Kirat, T., Melot, R., & Pham, H. V. (2016). Les conflits d’usage et de voisinage de l’espace. Bilan d’un programme de recherche pluridisciplinaire. L’information géographique , 80(4), 8-29.
Vastel, G. & Lorenzi B-H. (2024). Bilan de la concertation préalable , HyVence, 27 mars 2024 au 20 mai 2024.
Visseyrias, M. (2022). Harcelé par les écologistes radicaux, Bridor contraint de délocaliser un projet d’usine avec 500 emplois à la clé. Le Figaro .
Webler, T., & Renn, O. (1995). A brief primer on participation : Philosophy and practice. In Fairness and Competence in Citizen Participation : Evaluating Models for Environmental Discourse (p. 17-33). Dordrecht : Springer Netherlands.
Wolsink, M. (1994). Entanglement of interests and motives : assumptions behind the NIMBY-theory on facility siting. Urban studies , 31 (6), 851-866.
Wolsink, M. (2000). Wind power and the NIMBY-myth : Institutional capacity and the limited significance of public support. Renewable energy , 21(1), 49-64.
Wolsink, M. (2007). Wind power implementation : The nature of public attitudes : Equity and fairness instead of ‘backyard motives’. Renewable and sustainable energy reviews , 11(6), 1188-1207.
Wüstenhagen, R., Wolsink, M., & Bürer, M. J. (2007). Social acceptance of renewable energy innovation : An introduction to the concept. Energy policy , 35 (5), 2683-2691.
Zarka, J-C. (2016). La Charte de la participation du public. LPA du 9 déc. 2016, nº 122, p. 6.
Annexe 1 – Champ lexical des articles de presse identifié par le logiciel Cortext
Caroline Granier (dir.), Industrie et habitants, une équation insoluble ? Les Notes de La Fabrique, Paris, Presses des Mines, 2025.
ISBN : 978-2-38542-742-9 ISSN : 2495-1706
© La Fabrique de l’industrie
81, boulevard Saint-Michel 75005 Paris
info@la-fabrique.fr
www.la-fabrique.fr