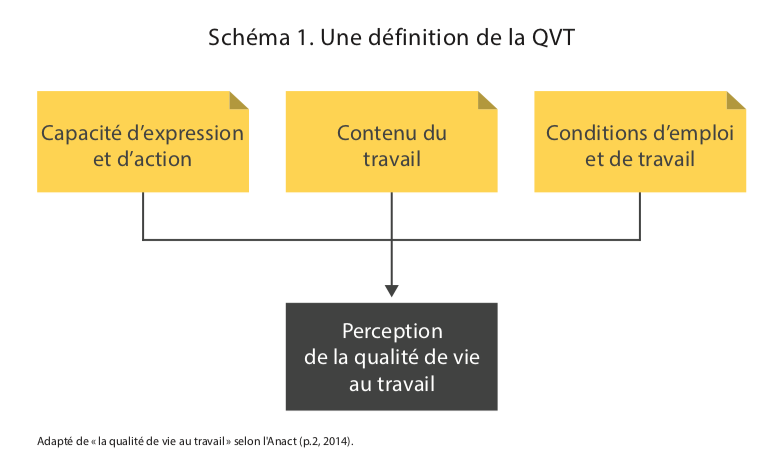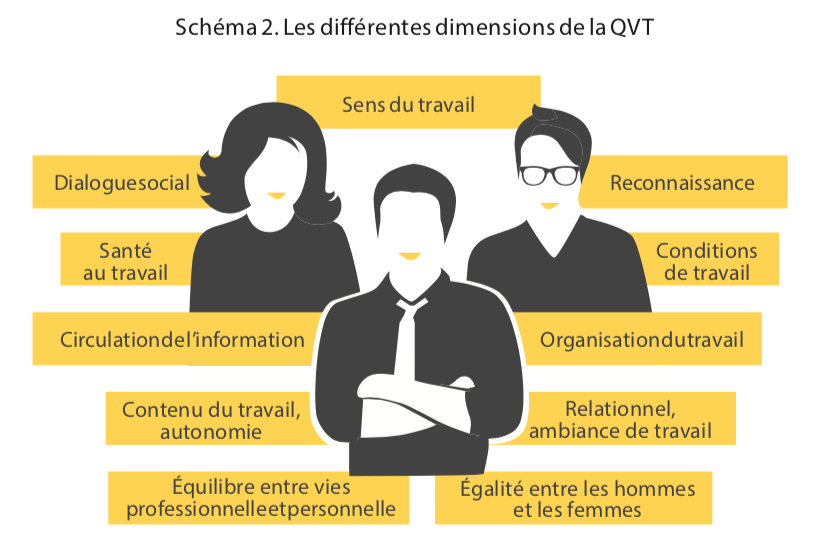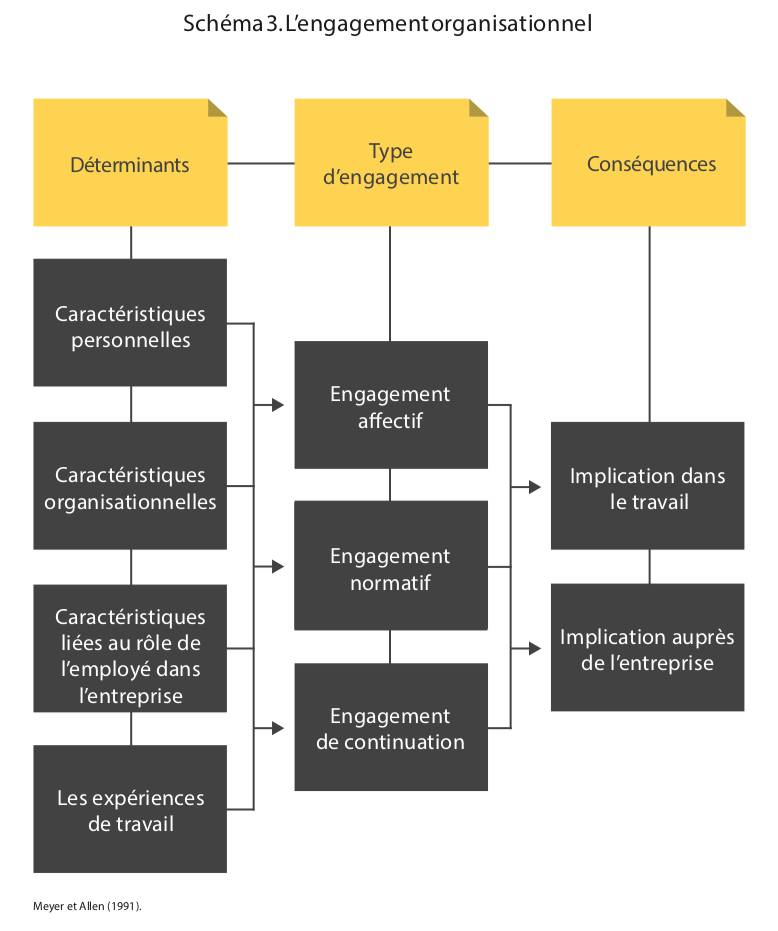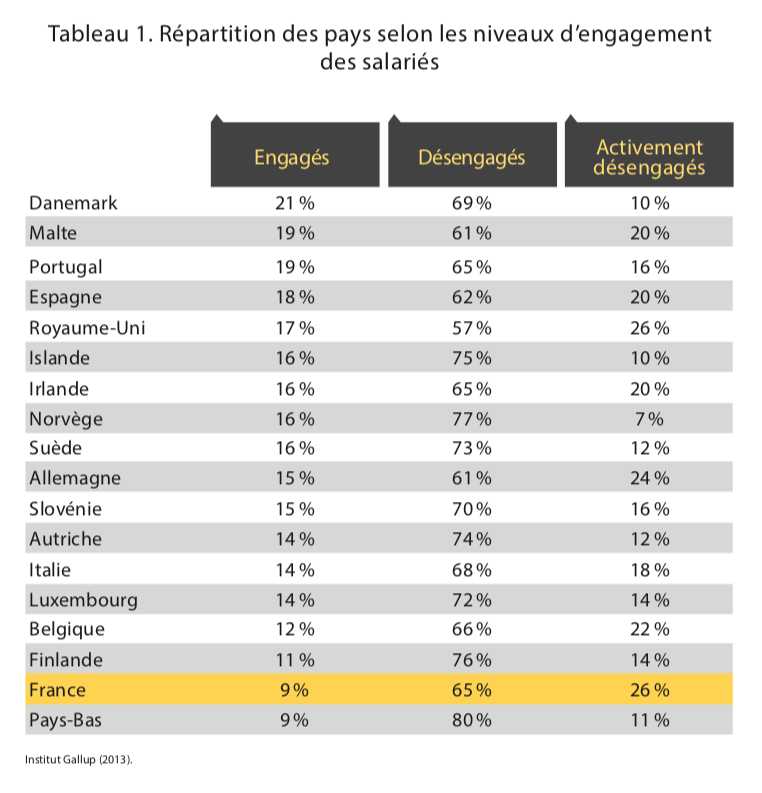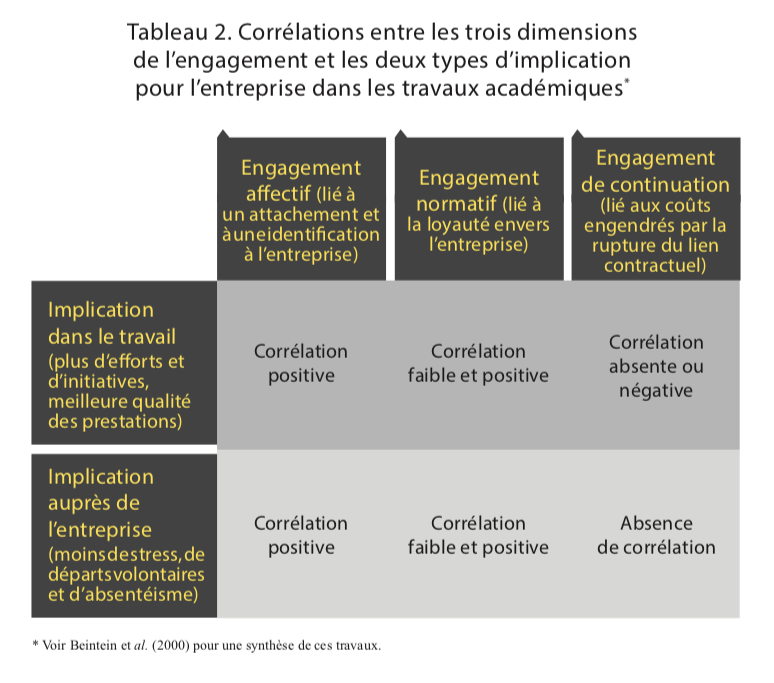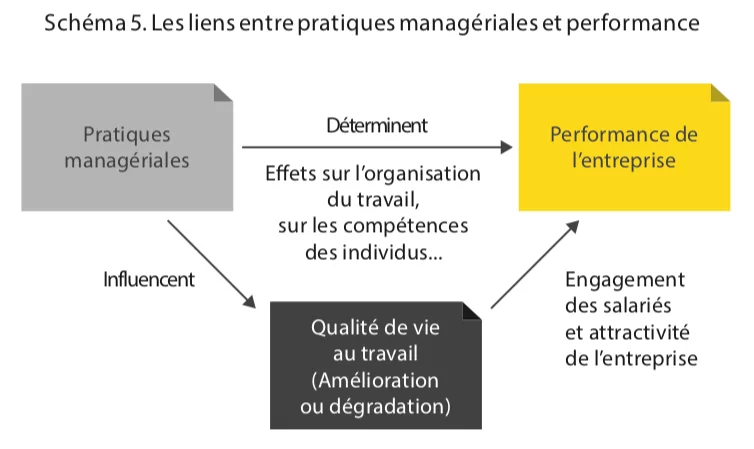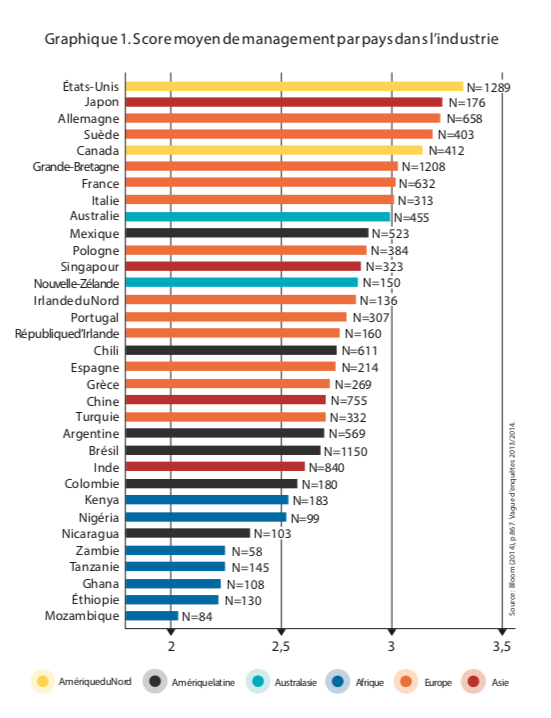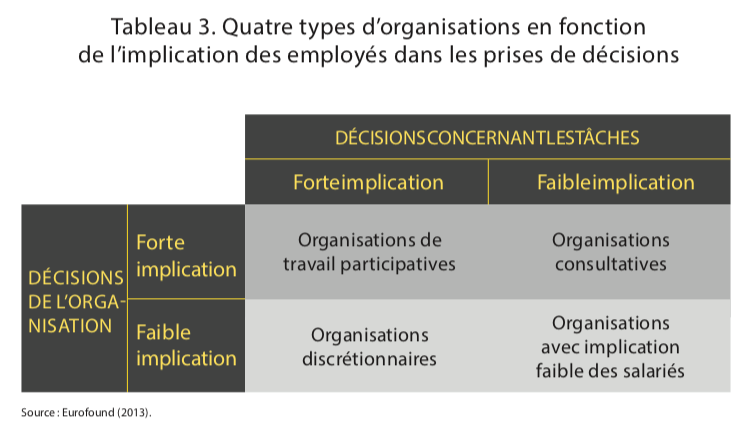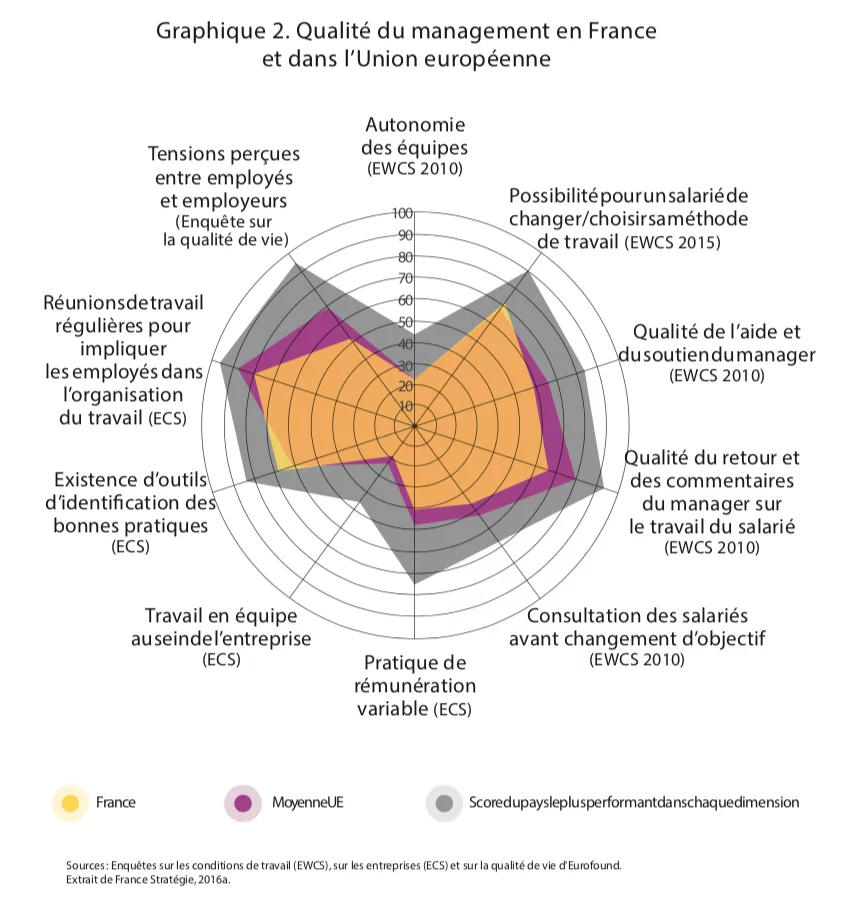La qualité de vie au travail : un levier de compétitivité

(Sans titre) AM81-65-148 Kandinsky Vassily (1866-1944) Localisation : Paris, Centre Pompidou - Musée national d'art moderne - Centre de création industrielle Photo © Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais / Droits réservés
Préface
En situant la qualité du travail au centre des démarches concourant à la fois à l’épanouissement des personnes et à la compétitivité des entreprises, l’étude qui suit la met à sa vraie place.
Curieusement, le concept de forces morales est absent du vocabulaire de l’entreprise. Or, lorsque les auteurs soulignent que la satisfaction des besoins humains est un levier de performance qui ne le cède en rien aux facteurs organisationnels et techniques, ils lui donnent toute son importance.
Ce faisant, ils nous invitent à considérer la qualité de vie au travail non comme un ensemble de remèdes à des maux que pourraient générer nos organisations, mais comme une démarche globale visant à éviter que ces maux apparaissent et, au-delà, à créer les conditions pour que la personne puisse se développer dans toutes ses dimensions. Puisse se développer, et non être développée, car placer la personne en situation de faire ses choix elle-même est une condition fondamentale du respect de sa dignité.
Croire qu’il est possible de susciter un engagement durable sans cela est une illusion. C’est donc bien à la qualité de l’activité de travail qu’il faut s’atteler d’abord. Dans cette perspective, cette étude accorde une place essentielle aux démarches destinées à redonner aux employés la maîtrise de leur travail par la pratique d’une plus grande autonomie. Cette démarche de responsabilisation des équipes, quelle que soit la façon dont on la nomme et dont on la conduit, sera de plus en plus reconnue comme la condition première de l’engagement des personnes, un puissant facteur de cohésion sociale et un levier incontournable de compétitivité.
Elle aura cette triple vertu à condition d’être sincère et ambitieuse. En milieu professionnel, l’autonomie est la somme d’un pouvoir d’agir à l’intérieur d’un cadre clair mais aussi large que possible, d’une maîtrise des moyens comme des modalités de l’action et du sentiment d’avoir à rendre des comptes. Qu’il manque l’un des deux premiers ingrédients et l’autonomie, tronquée, provoque la frustration ; qu’il manque le dernier et elle sombre dans l’irresponsabilité.
Cette démarche suppose une relative mise en retrait des managers et certainement pas leur disparition, du moins dans les grandes organisations. Mais ce retrait s’accompagne d’une participation permanente aux décisions du niveau supérieur. La connaissance intime de l’esprit de ces décisions permet alors au manager de diffuser dans son équipe une compréhension des finalités et des enjeux propice à la prise de décisions pertinentes par ceux-là même qui conduiront l’action.
Cette mise en retrait suppose aussi que chaque manager fasse l’effort d’identifier les quelques sujets sur lesquels sa responsabilité personnelle commande que la décision lui revienne, qu’il invite ses équipiers à décider de tout le reste et qu’il résiste à la tentation de reprendre les rênes au premier coup de vent.
Je crois aussi qu’il ne faut pas considérer la responsabilisation comme une démarche essentiellement individuelle. Certes, chaque personne aura à assumer personnellement les conséquences de ses décisions, mais il importe de ne pas l’isoler dans sa responsabilité. Chacun doit trouver dans son équipe les possibilités de délibération propres à soutenir sa capacité à décider dans son domaine, puis à analyser les actions au fur et à mesure qu’elles arrivent à leur terme. On voit bien, par cette combinaison d’une orientation claire, de processus décisionnels croisant plusieurs champs d’expertise, de délibérations fréquentes, et d’un souci constant de comprendre pourquoi les choses se sont bien ou mal passées que nous ne sommes pas loin du concept des organisations apprenantes auquel, en fin de compte, nous donnons là une forme particulière.
Ces équipes, au sein desquelles un fort lien social se développe parce que le travail y est plus collectif, vont ainsi naturellement générer, dans l’action et au quotidien, un dialogue professionnel soutenu. Celui-ci n’est plus alors un dispositif qu’on vient plaquer sur une organisation de travail donnée ; c’est la façon dont s’organise le travail qui le fait vivre jour après jour. C’est ce qui lui donne sa force et décuple l’aptitude de l’entreprise à accroître son efficience.
En termes de performance et de compétitivité, l’enjeu de cette démarche à forte résonance humaine et sociale est de taille. Les auteurs de cette étude y insistent à juste titre. Il s’agit en fait de transformer des entreprises obéissantes (à des managers, à des référentiels, à des procédures…) en des entreprises intelligentes où les équipes apprennent chaque jour dans et par l’action. Imagine-t-on un seul instant que les clients, les employés et les investisseurs de telles entreprises ne leur manifestent pas demain une forte loyauté ?
Jean-Dominique Senard
Président de la gérance du groupe Michelin
Remerciements
Cette étude est le fruit de la collaboration entre La Fabrique de l’industrie, Terra Nova et l’Aract Ile-de-France. Nos remerciements s’adressent à tous ceux qui nous ont permis sa réalisation.
Nous remercions d’abord Martin Souchier qui nous a apporté son aide lors de la phase exploratoire de cette étude.
Nos remerciements s’adressent également aux professionnels de l’industrie et du numérique qui ont accepté d’être interviewés : Silja Druo (Captain train), Ariane Malbat (Airbus Group), Françoise Papacatzis (DuPont France), Cécile Roche (Thales), Laure Wagner (Blablacar) et Jean Agulhon (groupe RATP, ex Renault France), Philippe Blandin (Eneixia, ex Mécachrome), Jean-Yves Bonnefond (Cnam), Dominique Foucard (Michelin), Giovanni Loiacono (Airbus Group), Eric Néri (Maille Verte des Vosges), Carlo Olejniczak (Booking.com), Bruno Rémy (Maille Verte des Vosges), Martin Virot (DuPont France), José Schoumaker (Valeo), Didier Wakin (Chaîne de valeur).
Nous souhaitons aussi remercier les membres du groupe de travail pour leur présence aux auditions organisées en 2015 et leurs commentaires avisés : Patricia Guéret (ex CFE-CGC), Agnès Laleau (GIM), Aymeline Rousseau (Paris Descartes/Paris 1 Panthéon Sorbonne), Amélie Seignour (Greco Montpellier) et Philippe Blandin, Vincent Bottazzi (FGMM CFDT), Vincent Charlet (La Fabrique de l’industrie), Arnaud Coulon (DGA UNIFAF ex Aract-Ile-de- France), Jean-Marc Le Gall (Conseil en stratégies sociales), François Pellerin (Région Nouvelle- Aquitaine), Jean-Claude Thoenig (CNRS), Thierry Weil (La Fabrique de l’industrie).
Nous remercions enfin chaleureusement les experts qui nous ont fait part de leurs réactions suite à la relecture d’une première version de cette étude ainsi que ceux qui nous ont proposé une contribution écrite : Martine Keryer (CFE-CGC), Paola Tubaro (Université Paris Sud), Michèle Sebag (Université Paris Sud), Marie-Laure Signoret (Collectivité locale) et Gabriel Artero (CFE-CGC Métallurgie), Bertrand Ballarin (Michelin), Denis Boissard (UIMM), Philipe Caillou (Université Paris Sud), Tony Fraquelli (CGT), Franck Gambelli (UIMM), Isaac Getz (ESCP Europe), Frédéric Gonand (Université Paris-Dauphine), Olivier Goudet (Université Paris Sud), Diviyan Kalainathan (Université Paris Sud), Yves Laqueille (GIM), Hervé Lanouzière (Anact), Stéphane Lescure (Pro Conseil), Pierre-Yves Montéléon (CFTC), Thierry Pech (Terra Nova), Philippe Portier (FGMM CFDT), Grégoire Postel-Vinay (DGE), Patrice Roussel (Université de Toulouse Capitole), Jean-Pierre Schmitt (Cnam), Yves Trousselle (Aigle International), Jérôme Vivenza (CGT).
Résumé exécutif
Risques psychosociaux, stress, santé au travail, qualité de vie au travail (QVT), bien-être ou bonheur au travail…Ce qui frappe dès lors qu’on examine la vie au travail, c’est la diversité des termes utilisés1 (et des visions que ceux-ci recouvrent), que ce soit au sein des entreprises, au cours des négociations sociales, dans les débats publics et médiatiques ou même dans la sphère académique.
1. Pourquoi s’intéresser à la QVT ?
En dépit de son caractère souple et polysémique, la QVT est sans doute le terme le plus englobant pour aborder un grand nombre d’aspects de la vie au travail : le travail lui- même, son contenu, ses conditions matérielles d’exercice, son organisation, le système de relations sociales dans lequel il s’insère, le pouvoir d’agir des individus et de donner du sens à leurs actions, c’est-à-dire la capacité qui leur est donnée de faire du bon travail dans de bonnes conditions. Dès lors, ce concept dépasse (et de loin) la question traditionnelle des conditions de travail, chères aux syndicats, ou de l’environnement de travail, cher aux start-up. Il permet également de donner une valeur positive au travail, en écartant les conceptions exclusivement doloristes du travail. Le travail est une dimension essentielle de la qualité de vie en général, le droit au travail est d’ailleurs inscrit dans notre Constitution.
Ce concept embrasse-t-il trop large pour être véritablement opérant ou au contraire permet- il d’ouvrir le débat et de faire dialoguer les parties prenantes, en mettant le travail au cœur de l’entreprise ? Nous défendons dans cette étude la thèse selon laquelle la qualité de vie au travail commence par une réflexion sur la qualité du travail. Les salariés ne demandent pas aux entreprises de faire leur bonheur, mais d’agir sur ce sur quoi elles ont prise : le travail et son organisation.
2. La QVT a des effets sur la performance économique
Les doutes des équipes dirigeantes sur les retombées économiques de la QVT persistent alors même que de très nombreux travaux de recherche mettent en évidence des liens entre cette dernière et la performance économique des entreprises.
Premièrement, la qualité de vie au travail facilite le recrutement des employés dans l’entreprise. Alors que l’industrie peine à recruter des collaborateurs, elle peut constituer un réel facteur d’attractivité, notamment auprès des jeunes2, alors même que la notation des entreprises par leurs salariés tend à prendre de l’importance3. Elle est aussi et surtout un déterminant de l’engagement des salariés. Il existe sur cet aspect une littérature scientifique foisonnante. Il en ressort que des salariés engagés4 dans l’entreprise sont moins souvent absents, moins stressés, changent moins souvent de poste ou d’entreprise, fournissent plus d’efforts, font un travail de meilleure qualité et prennent plus d’initiatives. Les gains espérés de l’engagement sont donc potentiellement importants. La corrélation entre QVT et performance économique est établie dans la littérature, le débat qui subsiste porte sur le sens de la relation (causalité). Il faut plutôt voir cette interaction comme un cercle vertueux à enclencher. D’une part, la qualité de vie au travail est un levier de compétitivité pour les entreprises car elle permet de mobiliser pleinement le potentiel des employés et de l’organisation. D’autre part, la performance est un signe et une condition de la santé des salariés, ainsi qu’un moyen de trouver des ressources qui peuvent être consacrées à l’amélioration des conditions d’exercice du travail. QVT et performances peuvent donc se renforcer mutuellement.
3. La QVT pour accompagner la montée en gamme de l’industrie française et la révolution numérique
Les caractéristiques de l’appareil productif français, trop concentré sur des productions de moyenne gamme, se lisent dans les conditions de travail. Pour ne prendre qu’un exemple, la Commission européenne (2014)5 indique que la proportion de salariés qui signalent des mouvements répétitifs et des positions fatigantes ou douloureuses est la plus forte en France et en Espagne (40%), soit un niveau très supérieur à la moyenne européenne (28 %) ou au score de l’Allemagne (21 %). Les enquêtes européennes nous alertent ainsi sur la nécessité pour notre pays de reprendre l’offensive pour améliorer notre outil de production, et partant la qualité du travail.
Si nos usines deviennent plus robotisées et font plus appel aux technologies numériques6, la nature du travail se modifie, de même que le niveau des compétences requises. C’est dès lors tout le regard sur le travail qui doit changer. Et l’approche par la QVT s’impose alors comme un levier d’efficacité indispensable. La QVT devient un moyen d’accompagner une politique industrielle ambitieuse en matière de qualité des produits et services, d’élévation des compétences, de capital humain et de conditions de travail. Dans ce contexte, point n’est besoin de choisir entre une posture idéologique ou morale, et une logique de l’efficience. Les deux se rejoignent. Inexorablement.
De nombreux témoignages vont dans ce sens; certains de nos interlocuteurs relèvent qu’il n’est pas possible de fournir des biens et services de qualité, d’apporter de la satisfaction aux clients, si une attention n’est pas portée à la qualité du travail et des conditions de travail des collaborateurs dans l’entreprise. Il est désormais nécessaire d’accompagner les mutations de l’économie, en envisageant le travail comme un investissement, source de créativité, d’innovation, de richesse plutôt que comme un coût qu’il s’agirait à tout prix de diminuer7. Relevons enfin que dans le cadre des réflexions en cours sur l’usine du futur, les conditions de travail, la qualité du travail, le développement des compétences, la qualité du management tiennent une place tout aussi importante que l’organisation des process industriels et les technologies pour le développement de la compétitivité industrielle8.
4. Les leviers de la QVT et de la performance
L’étude permet d’identifier les principaux leviers de la QVT et de la performance. Susciter l’engagement des collaborateurs est possible pour peu que les entreprises se préoccupent des besoins fondamentaux des individus au travail, qui stimulent leur engagement : reconnaissance, compétence, relation à autrui, contribution, soutien social, autonomie, sens, en les intégrant dans un système cohérent (mais pas forcément normatif). Dans ce cadre, les pratiques organisationnelles et managériales jouent un rôle clé. Ces dernières peuvent en effet dégrader ou améliorer la qualité de vie au travail des salariés. Une étude d’Eurofound (2013) montre que certaines pratiques dites innovantes (degré élevé de formation des employés, autonomie importante, concertations fréquentes, etc.), participent de la qualité du management et conduisent à une double performance économique et sociale9. Or, il s’avère que la France a des marges de progression pour parvenir au meilleur niveau de ses voisins européens en la matière10. Il s’agit donc de progresser pour celles des entreprises qui seraient engluées dans des modes de relations trop hiérarchiques, descendants, pauvres en échanges. Les entreprises françaises laissent encore trop peu de place au dialogue professionnel et au dialogue social. La question est de savoir comment les équipes dirigeantes et d’encadrement prendront le virage de la confiance, de l’autonomie et de la responsabilisation des collaborateurs.
5. La place centrale de l’autonomie et du dialogue professionnel
Les responsables des entreprises auditionnées s’appuient sur un levier central dans le concept de QVT : la latitude donnée aux salariés, qu’ils soient opérateurs dans l’industrie ou collaborateurs d’une entreprise du numérique, pour s’exprimer et agir sur leur travail. Leurs expériences se structurent autour de modes d’organisation destinés à développer l’autonomie, la capacité à prendre des décisions, le dialogue entre les salariés et avec leur hiérarchie. C’est le creuset de toutes les démarches.
Comme le promouvaient les pionniers du lean et du toyotisme (dans sa version originelle, non celle qui est souvent déployée et dévoyée aujourd’hui), et comme l’ont constaté nos interlocuteurs, il est en effet plus efficace de demander aux opérateurs et aux employés en contact avec les clients de proposer des solutions aux problèmes professionnels qu’ils rencontrent que de faire élaborer celles-ci par des techniciens éloignés du terrain. C’est le principe de subsidiarité (faire prendre les décisions au bon niveau) que cherchent à mettre en œuvre tous ceux que nous avons rencontrés.
L’autonomie peut porter sur différents niveaux, l’opérateur pouvant avoir son mot à dire sur la tâche individuelle qu’il réalise (le poste de travail), son environnement immédiat (l’organisation de son équipe) ou les objectifs, les priorités et les modes d’organisation de l’entreprise (la gouvernance). Diverses approches dont nous discutons les présupposés et l’impact en termes de QVT et de performance – lean, entreprise libérée, entreprise responsable – se concentrent souvent sur une partie seulement de ces niveaux.
Mais ces démarches de responsabilisation n’ont rien de « naturel ». Elles peuvent susciter autant de méfiance que d’adhésion chez les opérateurs comme chez les managers. Elles présupposent une maturité organisationnelle préalable, souvent fondée sur la confiance, sur des modes d’organisations du travail et de relations déjà éprouvés, qui conditionnent le choix des terrains d’expérimentation de ces méthodes. Car accepter la controverse sur le travail, animer le dialogue professionnel, est un exercice exigeant : il demande formation, expérimentation, retours d’expérience, changements jusqu’au plus haut niveau de l’entreprise et pour toutes les parties prenantes… Les dirigeants et managers ont un rôle essentiel à jouer dans ce cadre, et il est nécessaire d’accompagner ces derniers car ils ne sont pas spontanément formés à cela. Les syndicats peuvent également y trouver une occasion de renouer avec le thème du travail et ainsi avec les préoccupations concrètes des travailleurs.
- 1. Cette étude mobilise des notions et concepts définis dans le glossaire situé à la fin de ce document (voir p.163). Les mots ou expressions avec un astérisque dans le texte y renvoient.
- 2. Une chronique postée sur le site du Harvard Business Review soulignait par exemple que les jeunes accordaient beaucoup d’importance à l’ambiance de travail et à la reconnaissance lorsqu’ils choisissent leur emploi.
- 3. Les sites de notations en ligne prennent de l’ampleur tout comme les classements d’entreprises à l’image de « Great place to work ». Voir talenteo.fr ou le rapport du Conseil d’orientation pour l’emploi (2015).
- 4. La littérature scientifique distingue trois formes d’engagement qui n’ont pas les mêmes implications pour la performance de l’entreprise, ni les mêmes liens avec la qualité de vie au travail des salariés (voir p.55).
- 5. Eurobaromètre publié par la Commission européenne en 2014.
- 6. Cette étude ne traite pas de l’impact des technologies numériques sur la qualité de vie au travail. Pour des développements sur ce thème, se référer au rapport de Bruno Mettling (2015).
- 7. Voir à ce sujet la contribution de Bruno Palier (2016) au débat « Compétitivité que reste-t-il à faire ? » de France Stratégie (2016a).
- 8. Joseph Puzo (PDG d’Axon’Cable), en réaction à une première version de cette étude, relève que les changements technologiques des quatre révolutions industrielles ont fourni à chaque fois des opportunités pour perfectionner les organisations d’entreprise. L’industrie du futur, le «4.0», avec ses innovations accélérées est actuellement une superbe opportunité. La rapidité des changements et la nécessité de monter en gamme imposent de donner plus d’autonomie aux salariés et de répartir tout grand projet entre de « petites équipes apprenantes ».
- 9. L’étude de la Fondation de Dublin (Eurofound) a été menée à partir de données récoltées en 2012 auprès de 44 000 employés situés dans 34 pays (voir pp.80-81).
- 10. Voir France stratégie (2016a) qui relève que l’indicateur synthétique du World Management Survey place la France assez loin derrière les pays anglo-saxons, nordiques et l’Allemagne. Le World Management Survey est un projet collaboratif qui regroupe des chercheurs de la London School of Economics, des universités de Stanford, Harvard Business School, Oxford et Cambridge. Il étudie les pratiques de management dans l’industrie à partir d’enquêtes faites auprès des managers de 20 000 entreprises dans 35 pays.
INTRODUCTION
La QVT, un levier de compétitivité négligé
Parmi les leviers de la compétitivité industrielle, les facteurs de coûts (travail11, énergie, capital…) sont fréquemment étudiés, certains éléments hors coûts également (innovation, infrastructures, formation12, design, normalisation13…). D’autres leviers en revanche le sont moins, c’est le cas de la qualité de vie au travail (QVT). Celle-ci est rarement examinée14, en France, en tant que levier de performance économique et de compétitivité industrielle pour plusieurs raisons.
D’abord, le sujet de la QVT en tant qu’axe de développement stratégique n’est pas toujours pris très au sérieux par les chefs d’entreprise : sujet sympathique, certes, mais un peu fantaisiste et renvoyant plus spontanément dans certains esprits aux plantes vertes et aux massages qu’à l’organisation du travail. Ensuite, dans un contexte de chômage de masse où l’un des problèmes essentiels à traiter est l’emploi, le thème de la QVT, et donc du travail, est plus difficile à imposer. Enfin, la relation directe et « mathématique » entre qualité de vie au travail et performance n’est pas évidente à démontrer malgré l’existence de nombreux travaux scientifiques et rapports. La variété des disciplines intéressées par cette relation induit une pluralité d’approches et donc une grande diversité des concepts mobilisés, de définitions, d’objets d’étude, d’hypothèses, de modèles, d’outils de mesure… Faire « parler » la littérature est donc un exercice délicat. Difficulté supplémentaire pour la France, peu d’équipes de recherche se sont lancées dans l’exploitation simultanée de données d’enquêtes relatives à la qualité de vie au travail et à la performance.
Par conséquent, la corrélation entre ces deux concepts et le sens de la relation (causalité) font encore et toujours l’objet de débats, ce qui n’aide pas à convaincre les directions d’entreprises qui voudraient disposer de preuves sans ambiguïté et de chiffres précis sur les retombées économiques de la QVT avant de s’engager. Malgré tout, beaucoup d’entreprises industrielles investissent pour améliorer la QVT par conviction ou pour entretenir un bon climat sans en attendre forcément un bénéfice économique.
Dans ce contexte, chercher à mieux comprendre les retombées économiques de la qualité de vie au travail peut aider à y voir plus clair et, pourquoi pas, à lever les nombreux doutes et interrogations qui subsistent encore dans les entreprises. C’est ce que nous proposons dans cette étude.
Le volet 1 comprend trois chapitres qui se concentrent principalement sur les enseignements à tirer des travaux académiques et rapports. Le volet 2 comprend quant à lui deux chapitres, il est axé sur les expériences de terrain : onze entreprises ont été auditionnées, dont cinq dans le cadre d’un groupe de travail, et quatre modèles archétypaux d’organisations du travail ont été examinés15 : le lean management, l’entreprise libérée, l’entreprise responsable et les organisations responsabilisantes. Sont insérées au fil du document les réactions d’experts et d’industriels à une première version de ce document.
Le lecteur pourra se consacrer à tout ou partie de l’étude selon ses attentes et préoccupations. Il y trouvera notamment des moyens concrets pour faire rimer QVT avec compétitivité.
- 11. Koléda (2015).
- 12. Bidet-Mayer et Toubal (2014).
- 13. Bourdu et Souchier (2015).
- 14. Bien entendu, le champ de la QVT n’est pas délaissé par les entreprises en particulier parce qu’elles ont des obligations légales (accords signés par les partenaires sociaux, obligations de préserver la santé mentale et physique des salariés, obligation de négocier suivant la loi Rebsamen d’août 2015) ou sont impliquées dans des politiques relevant de la responsabilité sociale et environnementale. Par ailleurs, des investissements lourds peuvent être réalisés si ces dernières ont été confrontées à des drames sociaux : harcèlement, stress, burnout, suicides.
- 15. Retrouvez l’ensemble des précisions méthodologiques p.167.
VOLET 1. QVT ET PERFORMANCE ÉCONOMIQUE : QUE DIT LA RECHERCHE ?
Qualité de vie au travail : de quoi parle-t-on ?
La QVT est une notion souple, qui s’est enrichie des travaux de recherche sur la vie au travail, d’une part, et des débats entre partenaires sociaux, d’autre part. Examinons ce qu’elle recouvre.
1. La QVT, héritage de plusieurs traditions scientifiques
A. L’école des relations humaines
Le concept de qualité de vie au travail émerge dans le discours des chercheurs dans les années 1970 même si des recherches portant sur la vie au travail ont bien entendu vu le jour plus tôt.
Au début du XXe siècle, on commence à s’intéresser aux conditions matérielles de travail (propreté, bonnes ventilation et luminosité par exemple), les principes des organisations fordistes postulant que leur amélioration participe à la progression de la productivité des travailleurs (Tavani et al., 2014).
L’école des relations humaines apparaît aux États-Unis suite aux expérimentations réalisées par Elton Mayo dans l’usine de la Western Electric Company – Hawthorne Works – à partir de 1928 (David, 2013). Il teste avec son équipe l’influence de la luminosité sur la productivité des ouvrières de l’usine et observe, contre toute attente, que la productivité des femmes ne chute pas, même dans le cas d’une très faible intensité lumineuse (Tavani et al., op.cit.). Cet effet, qui a été qualifié d’effet « Hawthorne », s’explique par l’influence de facteurs psychologiques sur la performance16*, en particulier du sentiment de reconnaissance provoqué par le fait de participer à une expérience, c’est-à-dire d’être observé, reconnu. La subjectivité des individus est ainsi mise en avant comme élément contribuant à leur performance au travail. Lors d’autres expérimentations, Elton Mayo et ses collègues relèvent l’impact positif du travail en équipe sur la productivité en comparaison avec le travail d’un ouvrier solitaire.
Cette école de pensée met l’accent sur les facteurs psychologiques, sur les besoins de valorisation de l’individu dans l’entreprise. La satisfaction des besoins individuels extrinsèques (temps de travail, rémunération, organisation du travail) et intrinsèques (développement personnel, participation aux décisions, individualisation du travail) est au cœur des travaux de l’école des relations humaines (Larouche et Trudel, 1983).
B. L’approche sociotechnique
L’approche sociotechnique des organisations apparaît dans les années 1950 au Royaume-Uni, au sein du Tavistock Institute of Human Relations. Fred Emery et Eric Trist17, deux psychosociologues emblématiques de ce courant, pensent que l’école des relations humaines ne remet pas assez en cause l’organisation taylorienne. Bien qu’elle mette l’accent sur les facteurs individuels et psychologiques de la performance, sur la dynamique des collectifs de travail, sur les dimensions affectives, elle ne s’attaque pas à la sphère productive, à la façon dont le travail est organisé, aux procédures techniques mises en œuvre. Pour ces chercheurs, la qualité de vie au travail ne peut être pensée sans s’intéresser simultanément au système de relations sociales et au système technique, présents dans chaque organisation. C’est ce qui ressort d’une recherche-action menée par Eric Trist dans des mines de charbon en Angleterre (1950) (voir encadré 1).
« La qualité de vie au travail ne peut être pensée sans s’intéresser simultanément au système de relations sociales et au système technique, présents dans chaque organisation. »
C’est lors de la conférence d’Arden House, tenue en 1972 aux États-Unis, que l’expression « quality of working life » a été utilisée pour la première fois. Différentes écoles de pensée qui traitaient du concept de QVT sans nécessairement le définir se sont réunies : le Tavistock Institute of Human Relations à l’origine de l’approche sociotechnique du travail, les groupes de recherche d’Europe du Nord qui défendaient une approche collective du travail, des chercheurs américains de Los Angeles, du Michigan, de New York qui s’inscrivait dans une approche plus individualiste du travail, dans le courant de l’école des relations humaines.
On trouve en 1977 une première « définition » de la QVT par Louis E. Davis, qui s’inscrit dans le courant de l’approche sociotechnique ; la qualité de vie au travail « devrait s’appliquer à la nature des rapports entre le travailleur et son environnement général et mettre en évidence la nécessité de tenir compte, dans l’organisation du travail, aussi bien du facteur humain, si souvent négligé, que des facteurs techniques et économiques. » (Davis, 1977).18
Encadré 1. L’intervention d’Eric Trist dans les mines de charbon
Eric Trist (1950) a mené une recherche-action dans des mines de charbon en Angleterre. Il a constaté que l’organisation était axée sur des techniques d’exploitation et de production valorisant des activités très parcellisées, soit sur un modèle d’organisation taylorien (système technique). Préparation et extraction étaient réalisées sur des lieux différents par des équipes qui ne se rencontraient jamais et à l’intérieur desquelles les relations étaient mauvaises, les individus étaient isolés, en compétition sur les salaires (système social). Cette forme d’organisation du travail engendrait de mauvais résultats en termes de productivité, d’accidents du travail, de rotation du personnel et d’absentéisme.
En accord avec les responsables de la mine, il a expérimenté une nouvelle forme d’organisation du travail donnant plus de souplesse, d’autonomie (groupes semi-autonomes gérant l’ensemble des processus), a instauré un système de rémunération basé sur le collectif… En conclusion, Eric Trist a observé que la mise en place de groupes autonomes, l’enrichissement des tâches et l’amélioration des conditions de travail avaient amélioré à la fois la productivité et le climat social. Pour le chercheur, c’est la preuve de l’interdépendance entre les systèmes technique et social, soit de l’intérêt d’une approche sociotechnique de l’organisation.
C. Les apports récents de la recherche sur la qualité du travail
Pour le psychologue du travail français Yves Clot (2008, 2010), le travail est au cœur de toutes les problématiques de QVT et de santé au travail*. Par ses travaux récents, il a sans aucun doute fait évoluer les représentations sur le travail, et par là même contribué à élargir le périmètre de la QVT. Pour lui, la priorité est de soigner le travail 18. Voir aussi Davis et Cherns (1975). plutôt que de chercher à soigner les individus ; leurs symptômes – stress*, troubles musculo-squelettiques* (TMS), risques psychosociaux* (RPS) – ne sont que le résultat de maux bien plus profonds, spécifiques à chaque organisation de travail. La QVT, comme la prévention du stress ou des pathologies du travail, se génère donc là où l’activité se réalise, au plus près du processus de travail. En résumé, « pas de QVT ni de santé au travail sans qualité du travail* ».

Encadré 2. Devoir faire des choses que l’on désapprouve… dans le dispositif Evrest
Evrest (Évolutions et Relations en santé au Travail) est un observatoire pluriannuel par questionnaire, construit en collaboration par des médecins du travail et des chercheurs, pour pouvoir analyser et suivre différents aspects du travail et de la santé de salariés. Depuis 2011, le dispositif intègre une question sur le fait de « devoir faire des choses que l’on désapprouve ».
21 % des salariés de l’échantillon Evrest national 2012-2013 ont répondu « Oui tout à fait » (3 %) ou « Plutôt oui » (18 %) à « devoir faire des choses que vous désapprouvez ». Cette proportion varie de 17 % pour les cadres à 25 % pour les ouvriers.
« Devoir faire des choses que l’on désapprouve » apparaît d’abord très lié à des situations de travail où les contraintes de temps sont fortement ressenties
Il apparaît également que les salariés qui ont le sentiment de faire des choses qui sont en conflit avec « ce qui compte » pour eux sont ceux qui ont peu de soutien ou encore qui travaillent avec la peur de perdre leur emploi. Ces situations s’accompagnent d’une fréquence accrue de troubles dans le domaine psychique : les salariés qui disent « devoir faire des choses qu’ils désapprouvent » ont une probabilité 1,6 fois plus élevée de cumuler fatigue, troubles du sommeil et anxiété.
Les résultats présentés ici sont issus de l’échantillon national Evrest de 2012-2013, composé de 24 903 salariés nés en octobre des années paires. Ils ont été interrogés à l’occasion d’un entretien périodique (ou assimilé), par 895 médecins du travail et/ou infirmiers (ères).
Extrait de Evrest Résultats (2014).
« Faire du bon travail est une des propositions qui revient le plus lorsque l’on interroge les salariés français au sujet de ce qui est important dans leur travail. »
D. À la recherche du sens du travail
Le sens du travail joue un rôle clé dans la construction du sentiment de bien faire son travail. Dès la fin des années 1990, Morin et Cherré (1999) expliquent que le sens du travail, au niveau individuel, comporte trois dimensions :
1/ La signification du travail, sa valeur aux yeux de l’individu et la représentation subjective qu’il en a.
2/ L’orientation, la direction de la personne dans son travail, ce qu’elle cherche dans l’exercice d’une activité professionnelle, les buts et desseins qui guident ses actions et ses prises de décisions.
3/ La cohérence entre la personne et le travail accompli, entre ses besoins, ses valeurs, ses désirs et les gestes et actions qu’elle fait au quotidien dans son milieu de travail.
Dans Le mythe de Sisyphe (1942), Albert Camus pointait déjà du doigt les dangers pour la santé liés au fait d’exercer un travail qui n’a pas de sens «Les dieux avaient condamné Sisyphe à rouler sans cesse un rocher jusqu’au sommet d’une montagne d’où la pierre retombait par son propre poids. Ils avaient pensé avec quelque raison qu’il n’est pas de punition plus terrible que le travail inutile et sans espoir.» (voir aussi encadré 3).
Encadré 3. La question du sens du travail
Dans de nombreux emplois, il est impossible d’imaginer que c’est l’attrait du métier qui fait venir les salariés chaque matin. Il y a les bullshit jobs selon l’article de David Graeber, On the Phenomenon of Bullshit Jobs (Strike Magazine n°3, août 2013). Ils n’ont pas de sens, ce qui n’est pas très grave pour la collectivité, car ils sont d’une utilité douteuse, mais se révèlent passablement angoissant pour les intéressés.
Le plus grave, ce sont les emplois utiles, tenus par des travailleurs qui n’ont ni perspective de progression, ni reconnaissance de la part du grand public: par exemple ces gens qui, tôt le matin et tard le soir, passent l’aspirateur dans les bureaux, vident les corbeilles à papier et nettoient les toilettes. Il est rarissime que ces hommes et femmes de ménage exercent ce métier par vocation. Quant à lui trouver du sens… Nombre de métiers sont exclusivement alimentaires. Comment faire pour que celles et ceux qui sont contraints de les exercer s’épanouissent dans l’entreprise (ce qui est en l’occurrence plus large que «au travail»)? Matthew Kelly (2007), un consultant, a traité ce cas de façon créative dans un récit de fiction qu’il a ensuite mis en œuvre dans les entreprises. Mais à ma connaissance son livre n’a pas été traduit et son travail de consultant n’a inspiré personne de ce côté de l’Atlantique !
Réaction de Marc Mousli à une première version de l’étude. Voir aussi son article «Quel est votre rêve ? » (3 mai 2011) sur alternatives-economiques.fr
Mathieu Detchessahar (2013) explique que le travail de construction de sens et d’actualisation du sens passe par le dialogue sur le travail, soit par l’investissement d’>espaces de discussion* qui servent à réguler l’activité des équipes. Il est précisé dans le rapport Lachmann-Larose-Pénicaud (2010) que ces espaces sont indispensables à la fois pour que les salariés s’approprient leurs pratiques professionnelles, pour redonner une place à l’action collective dans l’entreprise et enfin pour prévenir les conflits et s’assurer que les problèmes rencontrés sont réglés collectivement.
Enfin, la question du sens du travail se pose également en entreprise du point de vue du collectif. Martin Richer (2013) souligne à ce sujet que ce qui nuit actuellement à la qualité de vie au travail est moins la charge de travail que l’absence de sens dans l’action collective, lorsque les employés ne perçoivent pas la finalité concrète de leur travail, ni son articulation avec la stratégie poursuivie par leur entreprise.
2. La QVT, un sujet de compromis entre acteurs sociaux
A. Des conditions de travail à la QVT
En entreprise, jusque dans les années 1990, on parle de « conditions de travail ». L’Anact, l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail, est créée en 1973. En 1975, les partenaires sociaux signent un accord dont le préambule commence par rappeler que « l’amélioration des conditions de travail est l’un des principaux problèmes sociaux de notre époque. » À l’époque, l’attention est portée prioritairement sur les conditions matérielles du travail : conditions de chaleur, lumière, bruit, fumées toxiques… Les organisations tayloriennes du travail commencent à être remises en cause, de nombreuses revendications se concentrent sur la pénibilité physique du travail. Par conséquent, un des titres de l’accord est dédié à l’hygiène, la sécurité et la prévention.
Mais les autres titres portent en eux des dimensions qui vont au-delà des seules conditions matérielles : ils évoquent l’organisation du travail, l’aménagement du temps de travail, la rémunération du travail au rendement et le rôle de l’encadrement, soit différents aspects de la vie au travail.
Pascale Levet (2013) explique que dans les années 1990 et plus encore dans les années 2000, les sujets de négociation foisonnent et intègrent de nouveaux ingrédients, tels que la santé psychique au travail qui s’ajoute à la pénibilité physique. Le stress fait l’objet d’un accord national interprofessionnel en 2008.
C’est dans les années 2000 qu’a culminé cette conception doloriste du travail, perçu comme pathogène. L’évocation médiatique des « vagues de suicides » dans de grandes entreprises françaises, durant cette période, contribue à forger une telle approche.
Au tournant des années 2010, la perspective change. Un certain nombre d’études s’attachent à mesurer le coût de ce « mal-être » tandis que d’autres évaluent le lien entre performance et qualité de vie au travail. En 2010 précisément, le rapport Lachmann-Larose-Pénicaud approfondit la réflexion portant sur ce lien. Pour les auteurs, les enjeux des conditions de travail dépassent le sujet de la prévention et du travail envisagé comme un coût et un ensemble de risques. Une telle conception est en effet trop étroite car elle n’intègre pas les dimensions positives du travail, élément créateur de valeur pour l’entreprise et facteur de développement des personnes. On retrouve donc sur la scène politique la trace des évolutions qu’a connues la recherche scientifique. En France, les chercheurs Christophe Desjours et Yves Clot jouent un rôle clé dans l’évolution des représentations du travail durant cette période.
B. L’ANI de 2013 pose une définition possible de la QVT
En 2013, les partenaires sociaux négocient sur la qualité de vie au travail. Désormais, le travail, au-delà des aspects relatifs à sa pénibilité, est aussi envisagé comme une ressource. Les négociateurs rappellent très clairement dans le préambule de l’accord signé en juin 2013 que la qualité de vie au travail participe aussi bien au développement des individus qu’à celui des entreprises20 : « La qualité de vie au travail désigne et regroupe sous un même intitulé les actions qui permettent de concilier à la fois l’amélioration des conditions de travail pour les salariés et la performance globale des entreprises, d’autant plus quand leurs organisations se transforment. »
Ils précisent aussi : « les conditions dans lesquelles les salariés exercent leur travail et leur capacité à s’exprimer et à agir sur le contenu de celui-ci déterminent la perception de la qualité de vie au travail. » La qualité de vie au travail est donc un sentiment subjectif, lui-même influencé par des conditions objectives de travail et d’organisation dans l’entreprise (voir schéma 1).
Précisons que les partenaires sociaux ne donnent pas de définition notionnelle de la QVT dans cet accord ; ils se bornent à désigner ce qu’elle recouvre, ce qui du point de vue juridique constitue un défi. Comme le rappelle Pierre-Yves Verkindt, professeur à l’École de droit de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne : « pour le juriste, le fait de ne pas avoir de définition notionnelle est une difficulté car il a besoin de qualifier, de faire rentrer un fait dans une catégorie juridique pour en tirer un certain nombre de conséquences et prendre des décisions. La QVT n’est pas une catégorie juridique, la normativité immédiate de l’accord de juin 2013 n’est donc pas très apparente. Elle provoque ainsi des réticences chez certains juristes. Un débat est en cours entre ceux qui pensent que les accords de ce type n’ont pas d’intérêt (« c’est de la déclaration de principe ») et ceux qui rétorquent que cette appréhension de la QVT ouvre des opportunités. Le grand défi est alors de savoir comment on fait vivre l’accord et la QVT. »21 (voir encadré 4).
Encadré 4. Deux familles d’accords nationaux interprofessionnels
Il existe deux types d’accords interprofessionnels.
Les accords transactionnels reposent sur la logique classique du donnant-donnant, plus ou moins équilibrée selon l’évolution des rapports de force. Ils se traduisent par l’élaboration d’objectifs, aussi précis et tangibles que possible (reposant sur des chiffres, des avancées matérielles, de nouveaux articles dans le code du travail…).
Les accords relationnels s’appuient davantage sur la mise en débat et la synthèse de représentations. Ils se traduisent par des constats partagés et des orientations à plus grand angle, plus adaptables en fonction du terrain (grand groupe versus PME, etc.).
Alors que la vaste majorité des ANI ressort de la première famille, l’accord QVT fait clairement partie de la seconde, qui inclut également l’un de ses prédécesseurs, l’ANI sur le stress (juillet 2008). Chacune de ces deux familles a ses mérites. Dans la première famille, on produit des acquis sociaux, dans la seconde, on produit de l’innovation sociale… qui, une fois appropriée par les acteurs, les renforce dans leur capacité à générer du progrès.
Martin Richer (2014).
Le préambule de l’accord précise encore que : « la qualité de vie au travail vise d’abord le travail, les conditions de travail et la possibilité qu’elles ouvrent ou non de “faire du bon travail” dans une bonne ambiance, dans le cadre de son organisation. Elle est également associée aux attentes fortes d’être pleinement reconnu dans l’entreprise et de mieux équilibrer vie professionnelle et vie personnelle. » La « définition » a un peu évolué sous l’influence de l’Anact, lors de la négociation qui s’est ouverte dans la Fonction Publique (janvier 2015). En reprenant des éléments du préambule de l’ANI de 2013 et en aménageant la définition de l’Anact, les partenaires sociaux de la fonction publique expliquent que : « La notion de qualité de vie au travail renvoie à des éléments multiples, qui touchent les agents individuellement comme collectivement et permettent, à travers le choix des modalités de mise en œuvre de l’organisation du travail, de concilier la qualité des conditions de vie et de travail des agents et la qualité du service public. L’amélioration de la qualité de vie au travail est une démarche qui regroupe toutes les actions permettant d’assurer cette conciliation. Il s’agit d’un processus social concerté permettant d’agir sur le travail (contenu, organisation, conditions, contexte) à des fins de développement des personnes et des services. »
D’un point de vue opérationnel, l’annexe de l’article 13 de l’ANI 2013 propose les « éléments descriptifs destinés à faciliter l’élaboration d’une démarche de qualité de vie au travail dans le cadre du dialogue social » répartis en dix champs d’action (voir annexe 1 pour une présentation détaillée) :
1. La qualité de l’engagement de tous à tous les niveaux de l’entreprise.
2. La qualité de l’information partagée au sein de l’entreprise.
3. La qualité des relations de travail.
4. La qualité des relations sociales, construites sur un dialogue social actif.
5. La qualité des modalités de mise en œuvre de l’organisation du travail.
6. La qualité du contenu du travail.
7. La qualité de l’environnement physique.
8. La possibilité de réalisation et de développement personnel.
9. La possibilité de concilier vie professionnelle et vie personnelle.
10. Le respect de l’égalité professionnelle entre hommes et femmes.
Dans l’industrie, un document paritaire a été récemment adopté par le comité technique des industries de la métallurgie sur l’amélioration de la performance et la santé au travail (octobre 2015). Il a été adopté à l’unanimité par les cinq fédérations syndicales de la métallurgie et l’UIMM en 2015. Ce texte paritaire prône explicitement un management participatif et fait des préconisations pour faire en sorte que le travail soit à la fois « efficace, motivant, enrichissant et collectif » ; trois principes essentiels sont rappelés : i) engager une démarche globale, collective et pérenne c’est-à-dire s’attacher à répondre aux attentes de toutes les parties prenantes de l’activité de l’entreprise, ii)impliquer dans la durée tous les acteurs de l’entreprise (équipe de direction, encadrement, maîtrise, opérateurs, fonctions support ou transverse) et iii) prendre en compte les situations de travail réelles de travail.
Pour l’Anact, la QVT est un objet de dialogue social structurant pour toute l’entreprise ; Hervé Lanouzière (2013), son directeur général, indique que dans cet accord de 2013 « les négociateurs n’ont pas sombré dans le piège du bonheur en entreprise. Ils invitent plutôt à revenir à des fondamentaux du management. De ce point de vue, l’accord constitue non pas un substitut aux risques psychosociaux mais l’étape qui leur succède, une approche au-delà de l’exposition à des risques, qui explore les ressorts du développement de l’individu au travail ». Il établit ainsi une distinction très nette entre le concept de QVT et ses enjeux, et la notion de bonheur au travail*.
3. Un engouement médiatique pour le thème du « bonheur au travail »
Aujourd’hui, un certain nombre de consultants, think tanks, chefs d’entreprise, médias et chercheurs se font les promoteurs du bonheur en entreprise comme levier de développement personnel et économique. Parallèlement, des voix s’élèvent dans certaines organisations, ou dans des entreprises industrielles et des syndicats de salariés pour dénoncer les risques d’une telle quête du bonheur. Le risque majeur est que les entreprises se concentrent sur des aspects périphériques au travail (décoration des bureaux, massages, etc.) et non sur le travail lui-même, son organisation, la relation entre les travailleurs, leur sentiment d’être ou non en mesure de réaliser un travail de qualité.
Ces réserves découlent notamment de la forte dimension subjective, contextuelle et personnelle du bonheur, qui prend ses racines dans de nombreuses autres sphères que celles du travail22 ; dès lors n’est-il pas excessif de demander aux entreprises d’assurer le bonheur ? Le témoignage de Françoise Papacatzis de l’entreprise DuPont France est éclairant : « Si le travail apporte des revenus, un accès aux soins et à la retraite, s’il constitue un facteur de dignité, d’estime de soi et d’insertion sociale, l’entreprise n’a pas pour autant vocation à apporter le bonheur. Le travail est avant tout un contrat, avec des droits et des devoirs. Pour sa part, le salarié n’a pas à tout donner à son entreprise ; il doit aussi s’investir dans sa vie privée, familiale, amicale et sociale. Le sens donné au travail est individuel : chacun y met ce qu’il souhaite. Charge à l’entreprise de fournir des conditions de travail suffisamment bonnes pour que chacun des salariés puisse se sentir en sécurité et donner un sens à son activité professionnelle. Telle est la qualité de vie au travail. »
De la même façon, les syndicats ont pris leur distance avec la notion de bonheur au travail qui leur semble éloignée : i) des racines de la problématique de la QVT, qu’ils situent dans l’organisation du travail et le management, ii) des méthodes qui leurs semblent efficaces (prévention primaire voire secondaire, plutôt que tertiaire)23 et iii) des compétences et des outils dont ils disposent (Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail* (CHSCT), négociation d’accords).
Quoi qu’il en soit, force est de constater que le bonheur au travail s’est peu à peu imposé dans les médias et dans le débat public à partir des années 2010 (voir encadré 5), et que le grand public trouve un intérêt à ce sujet. Le Bonheur au travail24 diffusé sur Arte en février 2015 serait le webdocumentaire le plus diffusé dans l’histoire de la chaîne.25 Par ailleurs, certaines entreprises appelées « libérées » (voir p.124) disent agir dans cette direction ; Vincent Champain et Orit Suleyman26se demandaient même dans Les Échos en 2014 si le bonheur au travail ne pourrait pas être un sujet de négociation sociale : « curieusement, la question du bonheur au travail est le grand absent des agendas sociaux. Certes, elle se prête difficilement à des lois, mais elle pourrait faire l’objet de discussions avec les représentants des salariés ou constituer une orientation utile des programmes de formation. »
Encadré 5. Le bonheur au travail dans la presse et les entreprises
Le thème du bonheur au travail a émergé timidement dans la presse française pendant les années 2000 puis le rythme des publications s’est accéléré à partir de 2012. En 2010, on comptait 37 articles à ce sujet. En 2012, ce chiffre s’élève à 56 puis à 100 environ en 2013 et 2014 pour atteindre 233 mentions en 2015.27 Cette année-là, la question du bonheur au travail s’est largement répandue grâce au documentaire Le Bonheur au travail diffusé sur Arte en février et à l’animation du débat qui a suivi par La Fabrique Spinoza. Ont également été médiatisées des structures privées ou publiques donnant plus d’autonomie à leurs salariés, réinterrogeant le rôle des managers et les modèles d’organisations pyramidales28. Parmi ces exemples, les entreprises dites « libérées », industrielles pour la plupart mais de toutes tailles : Favi, Lippi, Poult, Chronoflex, IMA technologies, Gore… Les conférences sur ce thème ont fleuri partout en France (Journées du bonheur au travail par exemple.).
On constate parallèlement l’apparition de nouveaux métiers relatifs au bonheur au travail. Kiabi a nommé récemment son Chief hapiness officer, qui explique être là « pour créer un climat pour que chacun se sente le mieux possible dans l’entreprise. » Airbnb emploie des Ground control managers29 chargés de tout mettre en œuvre pour que les salariés soient heureux dans l’entreprise (organiser des événements, régler des problèmes du quotidien au bureau…). On peut citer également le poste de Feel good manager au sein de la start-up Marco Vasco, un poste à mi-chemin entre DRH et responsable de conciergerie ou encore la fonction de Facility manager chez Captain train, dont la mission est de faciliter la vie des salariés au travail. Enfin, le secteur public n’échappe pas à cette « vague de bonheur » : entre 2009 et 2013, le ministère de la sécurité sociale belge s’était doté d’une direction du bonheur au travail.
4. La convergence entre les notions de QVT et de RSE
Soulignons pour finir que la qualité de vie au travail converge de plus en plus nettement avec un autre sujet de négociation, la responsabilité sociale et environnementale de l’entreprise (RSE). La QVT apparaît ainsi de plus en plus comme le déploiement au sein de la relation de travail des principes de la RSE, soucieuse de l’impact des activités sur le travailleur et son écosystème, c’est-à-dire de la soutenabilité du travail. La notion de QVT rappelle en effet la nécessité de préserver la santé du collaborateur, partie prenante essentielle de l’entreprise. Elle incite à renforcer les collectifs de travail dans l’objectif d’en faire des environnements capacitants au sens d’Amartya Sen et Martha Nussbaum (2012), c’est-à-dire des lieux propices au développement du pouvoir d’agir des individus. L’Anact a bien résumé cette convergence entre QVT et RSE : « La qualité de vie au travail est un processus dynamique et réflexif qui implique les parties prenantes engagées dans la transformation des conditions d’emploi et de travail en réponse à des exigences internes et externes. Ce processus a des effets positifs au plan de la performance de l’entreprise et du développement des salariés (capacité d’agir, santé et employabilité). Ce processus intègre, par exemple, la (re)conception des postes de travail, l’auto-organisation des équipes de production, l’amélioration continue, l’engagement des salariés dans les décisions d’organisation. » (Anact, 2013).
La QVT contribue à la fois à la performance* sociale et économique. Elle est un pas vers la notion de performance globale – économique, sociale, environnementale – qui constitue la colonne vertébrale des politiques RSE.
Conclusion
La QVT est une large notion. Fruit de près d’un siècle d’observations scientifiques du travail, d’une part, et de négociations entre partenaires sociaux, d’autre part, la QVT recouvre de nombreux aspects de la vie au travail. Pour Tavari et al. (2014), la QVT serait même plus intéressante à étudier comme un objectif à poursuivre que d’un point de vue conceptuel, tant elle est reliée à de nombreux autres concepts (voir glossaire p.163). Pourquoi poursuivre cet objectif ? Certaines entreprises le feront par obligation30, il s’agira alors de réduire la survenue des risques psychosociaux (approche défensive), quand d’autres poursuivront des logiques d’attractivité des talents, en travaillant leur marque employeur ou certaines encore y verront une façon de repenser leur organisation du travail, soit une possibilité d’accroitre leur compétitivité (approche offensive).
- 16. Les mots ou expressions avec un astérisque dans le texte renvoient au glossaire p.163.
- 17. Pour en savoir plus voir Trist (1981).
- 18. Voir aussi Davis et Cherns (1975).
- 19. Mary Parker Follet, dans son texte le plus célèbre (le conflit constructif), écrivait : « Puisque le conflit – la différence – existe et que nous ne pouvons l’éviter, nous devons l’utiliser » (traduction Marc Mousli).
- 20. Le terme compétitivité apparaît six fois dans l’accord ; le terme performance, sept fois.
- 21. Propos recueillis lors de la séance n°3 « Regards croisés sur la qualité de vie au travail » organisée par le réseau Jeunes Chercheurs Travail et Santé à l’EHESS le 15 décembre 2015.
- 22. Le travail contribue à la qualité de vie globale des individus. Paola Tubaro, en réaction à une première version de cette étude, explique que nombre d’études sur le chômage ont fait ressortir a contrario l’importance du travail dans la qualité de vie en général (perte de sens de l’existence, perte des liens sociaux par les chômeurs).
- 23. La prévention primaire au travail vise à résoudre les problèmes « à la source » c’est-à-dire à améliorer durablement les conditions de travail et l’organisation, à concevoir des situations de travail adaptées à l’homme. La prévention secondaire se concentre sur l’atténuation des manifestations d’un problème. Elle vise à renforcer la capacité des individus et des collectifs à faire face aux situations à risque incompressible et à limiter les conséquences du risque sur la santé. La prévention tertiaire permet de prendre en charge les salariés en souffrance dans une perspective curative et d’adapter leur situation de travail pour éviter que leur état de santé ne se dégrade.
- 24. « Le Bonheur au travail », Documentaire de Martin Meissonnier, Production ARTE France, RTBF, Campagne Première, France, 2014, DVD, 90 mn.
- 25. Interview d’Alexandre Jost dans l’émission « La tête au carré » (France inter) diffusée le 02/09/2015.
- 26. Vincent Champain est président de l’Observatoire du long terme, Orit Suleyman dirige AO Conseil, Cabinet de recrutement de cadres dirigeants.
- 27. Entre le 01/01/1990 et le 31/12/2000, 16 articles de presse mentionnent l’expression « bonheur au travail ». Entre le 01/01/2001 et le 31/12/2010, on en compte 274, puis 815 entre le 01/01/2011 et le 08/01/2016. Consultation de la base europresse le 8 janvier 2016.
- 28. Voir par exemple Laloux (2015).
- 29. «The Ground Control Manager is the ultimate host – anticipates needs, has a pulse on the feeling of the office and is able to take action on creating something that will improve morale, increase productivity or celebrate an accomplishment, whatever it is that the team needs. This person is flexible, empowered and can make magic happen at the drop of a hat. This person consistently inspires the team to do the same. » Extrait d’une offre d’emploi en ligne sur le site d’Airbnb consultée le 23 septembre 2015.
- 30. Une loi de 1991 modifiée en 2002 stipule que les entreprises doivent préserver la santé physique et mentale de leurs salariés.
La mesure de la QVT : un foisonnement d’outils s’appuyant sur des modèles reconnus
Différents modèles contribuent de près ou de loin à la construction d’enquêtes, d’indicateurs ou de classements, proposés par une multitude d’acteurs publics ou privés. Dans le champ du stress et des risques psychosociaux (RPS), les questionnaires de Karasek et Sigriest sont des références. Le suivi d’indicateurs sociaux, de santé et de sécurité au travail est également une pratique courante en entreprise. D’autres méthodes de mesure se concentrent quant à elles sur les dimensions psychologiques et les comportements stimulés par la QVT. L’engagement, bien décrit par les chercheurs Meyer et Allen (1991), est l’un des concepts RH les plus mesurés à l’heure actuelle.
1. Les approches centrées sur la santé au travail
Le suivi de la QVT dans une nation, un territoire ou une entreprise s’inspire fréquemment des modèles de Karasek (1985) ou de Sigriest (1996), qui permettent d’élaborer leurs enquêtes.
A. Le modèle de Karasek
Le questionnaire de Karasek fait un lien entre le vécu au travail et les risques que ce travail fait courir à la santé. Dans ce modèle, chaque situation de travail est caractérisée par la combinaison :
- d’une « demande psychologique » : quantité de travail, contrainte de temps, demandes contradictoires, interruptions fréquentes…
- d’une « latitude décisionnelle » : possibilité de prendre des décisions, d’être créatif, de maîtriser ses moyens, d’avoir des marges de manœuvre, de pouvoir utiliser ses compétences…
- et d’un certain niveau de soutien social, c’est-à-dire professionnel et émotionnel.
Il est ainsi possible d’évaluer, pour chaque salarié, l’intensité de la demande psychologique à laquelle il est soumis, la latitude décisionnelle dont il dispose et le soutien social qu’il reçoit sur son lieu de travail. Le job strain* est défini comme une situation où la demande psychologique est forte et la latitude décisionnelle faible, ce qui constitue une situation à risque pour la santé (Dares Analyses, 2016). Dans les faits, ce sont des situations tendues où les exigences du travail sont importantes et où les ressources disponibles pour y faire face sont insuffisantes. Le risque est aggravé si le salarié bénéficie d’un faible soutien social.
B. Le modèle de Siegrist
Le questionnaire de Siegrist (1996) est basé sur le couple efforts-récompenses et sur les déséquilibres potentiels entre ces deux notions. Il ajoute au modèle précédent la dimension essentielle de la reconnaissance des efforts effectués dans le travail. La notion d’effort recoupe les contraintes de temps, les interruptions, les responsabilités et la charge physique. La notion de récompense concerne la rémunération, l’estime au travail et le statut professionnel (sécurité de l’emploi et perspectives professionnelles). Un travail où l’effort consenti dépasse la récompense obtenue pourra être source de stress. José Shoumaker, directeur des relations sociales Monde de Valeo, explique que son groupe s’en est inspiré : « En 2011, une première enquête sur le “mieux-être” est lancée, elle concerne l’ensemble des salariés français. Elle a été basée sur les tests de Siegrist qui interrogent différentes dimensions relatives à la qualité de vie au travail : management, charge de travail, définition du poste, évolution de carrière, contribution aux changements, reconnaissance… »
Les questionnaires de Karasek et Siegrist aboutissent à des résultats comparables (au sein d’une même entreprise, entre divers établissements ou services par exemple). Les dimensions qu’ils explorent sont aujourd’hui intégrées aux questionnaires d’enquêtes mobilisés pour le suivi statistique des conditions de travail et des risques psychosociaux en France et en Europe.
C. Le modèle C2R de l’Anact
L’Anact propose un modèle d’analyse de risques psychosociaux en entreprise, le modèle C2R (contraintes-ressources-régulations). C’est à la fois un modèle de mesure et d’analyse. Il repose sur la reconnaissance d’une tension permanente dans le travail entre les exigences de l’organisation et celles des salariés. Les exigences de l’organisation sont celles qui sont nécessaires pour atteindre les objectifs en termes de production. Celles des salariés visent à effectuer le travail dans de bonnes conditions, ainsi qu’à se réaliser professionnellement. Cette tension est également impactée par l’état des relations professionnelles et le contexte socio-économique de l’entreprise.
Selon l’écart perçu par les salariés entre ces exigences dans le cadre de situations de travail, la tension est plus ou moins forte. Et le vécu de ces situations plutôt positif ou plutôt douloureux, avec des effets sur la santé, les relations professionnelles, l’engagement et la performance. Les processus de régulation, lorsqu’ils existent, visent à « réguler » cette tension entre contraintes et ressources.
Le modèle C2R est intégré à la démarche de prévention proposée par l’Anact. Lors de la phase de diagnostic, au travers d’entretiens avec des salariés ou des groupes de salariés, puis avec l’employeur, le modèle permet d’expliquer ce qui rend le travail difficile – les contraintes – et ce qui au contraire le facilite – les ressources. Ce travail d’investigation est en général réalisé au niveau de l’entreprise, puis ensuite au niveau des services ou des métiers les plus concernés. C2R peut également être utilisé pour analyser finement des situations de travail précises, notamment les « situations-problème » dans lesquelles les processus de régulation en défaut sont observés à la loupe. Après le diagnostic, le modèle C2R peut à nouveau être employé lors de la phase de construction du plan d’action. Au niveau de l’entreprise, d’un service ou d’une situation-problème, trois grands leviers peuvent alors être activés pour prévenir les RPS : réduire les facteurs de contraintes, développer les facteurs de ressources, et favoriser les processus de régulation.
D. Le suivi statistique des conditions de travail et des risques psychosociaux
En France, le suivi des conditions de travail et des RPS repose en grande partie sur deux enquêtes : « Sumer » (Surveillance médicale des expositions aux risques professionnels) et l’enquête « Conditions de travail », impliquant toutes deux la DARES. Nous avons également cité plus haut le dispositif Evrest, lancé en 2008 (voir encadré p.30).
En Europe depuis 1990, la fondation de Dublin, aussi appelée Eurofound, a la charge de l’European Working Conditions Survey (EWCS) (voir encadré 6 page suivante). Les premiers résultats de la 6 enquête réalisée en 2015 viennent d’être publiés. Par ailleurs, Eurofound réalise deux autres enquêtes récurrentes :
- ECS : Enquête sur les entreprises en Europe, tous les 4 ans, depuis 2004-2005. La troisième enquête a eu lieu en 2013.
- EQLS : Enquête européenne sur la qualité de vie, tous les 4 ans, depuis 2008, la quatrième débutera fin 2016.
Encadré 6. Le suivi statistique des conditions de travail en France et en Europe
En France, le « Collège d’expertise sur le suivi statistique des risques psychosociaux au travail » a élaboré des propositions pour un suivi statistique de ces risques autour de six dimensions : les exigences du travail, les exigences émotionnelles, l’autonomie et les marges de manœuvre, les rapports sociaux et les relations de travail, les conflits de valeurs et l’insécurité économique. La majorité des questionnaires y font référence.
L’enquête Sumer, copilotée par la DARES et la DGT (Inspection médicale du travail), décrit les contraintes organisationnelles et relationnelles, les ambiances et contraintes physiques, les expositions professionnelles de type physique, biologique et chimique auxquelles sont soumis les salariés. Depuis 2003, de nouveaux thèmes sont abordés grâce à un auto-questionnaire : la perception qu’a le salarié de son travail et la relation qu’il fait entre sa santé et son travail. Sumer 2010 est représentative de près de 22 millions de salariés, soit 92 % des salariés français.
L’enquête « Conditions de travail » de la DARES a été menée pour la première fois en 1978. Elle était alors surtout consacrée aux conditions de travail des ouvriers, notamment pour évaluer la pénibilité physique et l’augmentation de la répétitivité des tâches. Ont été ajoutées rapidement des questions autour de l’organisation du travail, les contraintes de rythme, l’autonomie, les marges de manœuvre laissées aux salariés. En 2005, ont été intégrées pour la première fois des questions sur la demande émotionnelle (contact avec des personnes en situation de détresse par exemple) et sur la prévention des risques au travail. Les résultats de la dernière enquête portent sur l’année 2013.
Au niveau européen, c’est l’European foundation for the improvement of living and working conditions (Fondation de Dublin) qui est chargée d’une enquête sur les conditions de travail (EWCS). La première remonte à 1990, elle s’intéressait surtout à l’exposition aux risques dans le monde industriel. Le questionnaire s’est étoffé depuis grâce à l’introduction d’indicateurs sanitaires, de critères subjectifs, cognitifs, psychologiques et psychosociaux.
Sources : Dares Analyses (2016), Sarazi et Jaouën (2010).
Encadré 7. La mesure de l’intensité du travail
Statistiquement, l’intensité du travail se mesure à la manière dont le rythme de travail est déterminé par des contraintes « marchandes » (demande du public ou de clients exigeant une réponse immédiate) ou par des contraintes « industrielles » (déplacement automatique d’un produit, cadence imposée par une machine, normes ou délais à respecter en une journée au plus). Les enquêtes conditions de travail révèlent que le premier type de contraintes n’est plus seulement lié aux services, ni le second à l’industrie. Près d’un tiers des salariés cumulent ainsi des contraintes de type marchand avec des contraintes de type industriel. Cela s’explique notamment par des modes d’organisation du travail en flux tendu, qui mettent l’accent sur la réactivité autant que sur la qualité.
Extrait de CESER Bretagne (2015) d’après Alvaga (2014).
Que nous apprennent ces enquêtes ? Dans Dares Analyses (2016) (exploitation des enquêtes Sumer), il apparaît qu’en France en 2010, 39 % des ouvriers non qualifiés de l’électricité et de l’électronique et 38 % de ceux des industries de process sont sujets au job strain, la moyenne nationale tous métiers s’établissant à 23 %. Quant aux ouvriers qualifiés, notamment ceux de la mécanique, des industries graphiques ou du travail du bois, de l’ameublement ou travaillant par enlèvement de métal, ils sont nombreux à déclarer un manque de reconnaissance31 (64 % pour une moyenne s’établissant à 49 %). Il est aussi précisé qu’en 2010 comme en 2003, la probabilité de se trouver dans une situation de travail tendue est plus forte pour les salariés soumis à au moins trois contraintes de rythme, qui travaillent au-delà des horaires officiels ou qui sont exposés à des pénibilités physiques. Les enquêtes conditions de travail montrent que la proportion de salariés dont le rythme de travail est déterminé par au moins trois contraintes a largement augmenté en France entre 1984 et 2013, passant de 6 % à 35 % (voir encadré 7). Un partenariat entre l’université Paris-Sud et La Fabrique de l’industrie a donné naissance à un projet visant à examiner les relations entre QVT et performance (encore en cours). Les premiers résultats, basés sur l’exploitation de la base de données DARES 2013, portent sur les conditions de travail factuelles des individus et leurs ressentis ; ils sont disponibles ici : www.la-fabrique.fr/fr/projet/qualite-de- vie-au-travail-et-competitivite-industrielle.
Parallèlement à cette intensification du travail, on observe un certain recul de l’autonomiestrong>* dans le travail en France entre 1998 et 2013. Exploitant les résultats de l’enquête « Conditions de travail » de la DARES, Algava et Vinck ont montré en 2015 que l’autonomie au travail régressait. La proportion de salariés déclarant que leurs supérieurs leur disent comment faire leur travail a crû entre les trois dernières vagues de l’enquête : 14,2 % en 1998, 18,4 % en 2005, 19,3 % en 2013. En 2013, 80,7 % des salariés déclarent que leurs supérieurs hiérarchiques leur indiquent seulement l’objectif, contre 85,8 % en 1998. En 2013, dans les secteurs industriels de « fabrication de matériels de transport » et « fabrication d’autres produits industriels », la proportion des salariés déclarant du travail prescrit par leur supérieur est plus élevée que la moyenne : 29,8 % et 22,6 % respectivement (moyenne de 19,3 ٪).
L’augmentation du travail prescrit concerne toutes les catégories socioprofessionnelles : ouvriers, employés, professions intermédiaires, cadres, les deux premières se situant au-dessus de la moyenne observée pour l’ensemble des salariés (28,3 ٪ et 21,8 ٪ respectivement en 2013). La proportion de ceux dont le travail implique des tâches monotones est passée de 15 % en 2005 à 21 % en 2013 et, pour les ouvriers, de 23 % à 33 %. Plus de la moitié des salariés (55 %) pensent que certaines de leurs compétences ne sont pas utilisées et cette proportion monte à 65 % chez les 20-24 ans et à 61 % chez les 25-29 ans (puis diminue au fur et à mesure dans les classes d’âges plus mûres).
E. Les indicateurs sociaux, de santé et de sécurité au travail
Les indicateurs sociaux, de santé et de sécurité au travail désignent les taux d’absentéisme, de turnover, d’accidents du travail ou bien encore la part de salariés touchés par des TMS, des troubles psychosociaux… Ils constituent des signaux pour les managers, les directions d’entreprise, de l’état des conditions de travail et de leur évolution. Ils peuvent aussi être convertis en pertes ou en gains économiques pour l’entreprise, un secteur ou la société dans son ensemble. En revanche, ils ne permettent pas de comprendre quels sont les mécanismes concrets à l’œuvre dans le travail entraînant le mal-être et sur lesquels doivent porter les actions correctives ou préventives.
Les troubles psychosociaux représentent un coût de plusieurs milliards d’euros en France et en Europe. Une étude de l’Eu-Osha (1999) a montré que le coût total annuel des maladies liées au travail, pour les 15 pays de l’UE, était compris entre 185 et 289 milliards d’euros, soit entre 0,2 % et 0,3 % du PIB de ce groupe de pays en 1999. Plus récemment, en France, une étude de l’INRS et de l’école Arts et Métiers Paris Tech (2010)32 estimait33 que le coût social du stress atteignait a minima34 2 à 3 milliards d’euros en 2007, soit entre 0,1 % et 0,15 % du PIB, ceci incluant le coût des soins et la perte de richesse pour cause d’absentéisme, de cessation prématurée d’activité et de décès prématuré.
Au niveau de l’entreprise, Philippe Blandin (ex-secrétaire général de Mécachrome) rappelait lors de son audition que « le taux d’absentéisme se calcule en pourcentage de la masse salariale, le réduire d’un point a donc un impact financier direct. » Dans une étude de l’Eu-Osha de 201435, les auteurs citent le projet européen « Matrix » qui, en suivant plusieurs entreprises de pays différents sur un an, révèle qu’un euro dépensé en prévention des RPS en milieu de travail se traduit par un 1 à 13€ € d’économies de coûts. Cette plage est très large : cela s’explique par la grande la variété des programmes de prévention testés, notamment des améliorations de l’environnement de travail, de la gestion du stress et des traitements psychologiques, ainsi que par celle des méthodes de calcul. Ces dernières sont principalement de deux sortes : des comparaisons de type « avant-après » (voir encadré 8) ou encore des méthodes quasi-expérimentales se caractérisant par le suivi de « groupes traités ».36
Encadré 8. Retombées d’un programme de santé au travail au Royaume-Uni
En 2009, un programme de prévention des risques psychosociaux a été proposé à 500 personnes dans un établissement au Royaume-Uni : information personnalisée sur la santé et le bien-être au travail, passation d’un questionnaire d’appréciation des risques psychosociaux (évaluation du risque d’anxiété ou de dépression), séminaires et ateliers sur le sujet. Le programme a permis en un an de réduire l’absentéisme et d’améliorer la productivité de manière significative, pas de réduire l’incidence de la dépression. Le coût de l’intervention s’est élevé à £ 40,000 ; l’économie des coûts liés à l’absentéisme à £ 110,527, celle des coûts liés aux défauts de productivité à £ 277,195 et le système de santé a économisé £ 10,522. Le coût de cette politique a donc été compensé par des effets positifs dix fois supérieurs.
Pour en savoir plus : Knapp et al. (2011) et Matrix (2013).
2. Les approches psychologiques et comportementales
Une autre façon de mesurer la QVT, plus offensive, est de se concentrer sur les dimensions psychologiques et comportementales qu’elle stimule. Parmi celles-ci, l’engagement* fait l’objet de mesures régulières en entreprise. Il peut être pris comme un indicateur de la qualité de vie au travail. Le bien-être* au travail a également été largement étudié. Nous renvoyons le lecteur intéressé aux travaux d’Abord de Chatillon et Richard (2015) qui proposent une modélisation des conditions du bien-être au travail, le SLAC (pour Sens, Lien, Activité et Confort).
A. Le modèle de Meyer et Allen de l’engagement organisationnel
La notion d’engagement a fait l’objet de nombreuses recherches, tant théoriques qu’empiriques depuis les années 1970 aux États-Unis et en Europe. Elles ont pour objectif de distinguer les différents aspects de l’engagement, ses déterminants et ses conséquences, notamment au niveau de la performance et du bien-être des individus. Cette attitude nous apparaît central pour relier QVT et performance au travail, c’est pourquoi nous nous y arrêtons.
Le modèle dominant de l’engagement organisationnel est celui de Meyer et Allen (1991). Tridimensionnel, il inclut les formes affective, normative et de continuation (voir schéma 3).
L’engagement est décrit comme un état psychologique qui caractérise l’individu dans son rapport à l’entreprise et au travail. Il explique pourquoi un individu choisi de rester dans une entreprise et pourquoi il s’y investit plus ou moins.
Meyer et Allen distinguent trois types de nature d’engagement qui coexistent à des degrés plus ou moins variés chez un même individu :
- L’engagement affectif concerne une identification et un attachement émotionnel à l’entreprise, c’est-à-dire que ses membres se retrouvent dans ses idées et objectifs.
- L’engagement normatif renvoie à une attitude de loyauté envers l’entreprise.
- L’engagement de continuation est basé sur l’évitement des coûts engendrés par la rupture du lien contractuel avec l’entreprise : perte du salaire, des avantages liés à l’emploi, transférabilité limitée de compétences spécifiques dans un nouvel emploi, etc.
Beintein et al. (2000) résument : « les individus affectivement engagés restent membres de leur entreprise parce qu’ils le désirent, ceux qui éprouvent un engagement de continuation restent parce qu’ils y sont contraints et ceux qui sont normativement engagés restent parce qu’ils en ressentent l’obligation. » (p.133)
Il existe quatre catégories de critères repérés par la littérature scientifique, qui suscitent l’engagement des employés envers l’entreprise.
- les caractéristiques personnelles : variables démographiques (âge, ancienneté́, etc.) et « dispositionnelles » (personnalité, valeurs, etc.).
- les caractéristiques organisationnelles : centralisation des décisions, politique de gestion et de communication interne à l’entreprise, etc.
- les caractéristiques liées au rôle de l’employé dans l’entreprise : le spectre des tâches de l’employé est large ou spécifique, est clairement défini ou non. Cet aspect inclut également les relations entre un supérieur et son subordonné ou entre collègues.
- les expériences de travail : la confiance qu’inspire l’entreprise à ses employés, l’importance qui leur est accordée, les attentes réalisées des employés, le sentiment d’être soutenu, etc.
Les ressorts de l’engagement sont ainsi déterminés par des dimensions clés de la QVT. Un modèle de mesure de l’engagement organisationnel, l’Organizational Commitment Questionnaire (OCQ) a été proposé par Porter et al. dès 1979. Il contient 18 questions (voir l’annexe 2). Aujourd’hui, les statistiques qui circulent sur l’engagement des salariés à travers le monde proviennent souvent de l’Institut Gallup, cabinet ayant développé un modèle de mesure de cet état psychologique à destination des entreprises.
Notons au passage que la mesure de l’engagement ou d’autres états psychologiques comme le bien-être, le bonheur ou la satisfaction au travail est un marché florissant pour bon nombre d’instituts de sondages, d’organismes d’assurance-santé et prévoyance, de cabinets de consultants. Le nombre d’indicateurs, d’enquêtes ou de classements développés par ces acteurs est important, il serait impossible ici de les mentionner tous. Précisons également que leurs outils de mesure s’appuient pour partie sur les questionnaires d’analyse de risques psychosociaux déjà cités, en plus de questions qui sont fonction de l’importance accordée à telle ou telle dimension liée au travail, par exemple à la qualité de ce travail, aux valeurs, à l’engagement vis-à-vis de l’organisation ou bien encore aux aspects managériaux. Les questionnaires diffèrent donc, ce qui ne permet pas de comparer leurs résultats.
De plus, le choix des termes utilisés pour qualifier ces enquêtes est révélateur d’un souci de communication vis-à-vis des salariés et de l’extérieur. On préférera par exemple parler d’une enquête « mieux-être » ou « bien-être » plutôt que d’une enquête « risques psychosociaux », moins mobilisatrice, quand bien même les questions posées aux salariés relèvent très largement de l’analyse des RPS. La Fabrique Spinoza a tenté de regrouper dans un guide douze37 des principaux outils de mesure du bien-être. Le questionnaire de l’Institut Gallup sur l’engagement, très utilisé par les entreprises, en fait partie.
B. Le questionnaire de l’Institut Gallup, une vue partielle du contexte de travail
L’Institut Gallup utilise les catégories et définitions suivantes :
1/ engagement : salariés motivés, proactifs, qui lient volontiers leur épanouissement personnel à la bonne marche de l’entreprise et sont prescripteurs des produits de leur entreprise.
2/ désengagement : salariés qui ne sont pas réellement actifs, faisant leur travail de manière neutre, en quête de sens du travail. Ils sont susceptibles d’évoluer en fonction des circonstances dans un sens positif ou non.
3/ désengagement actif : personnes qui manifestent un sentiment négatif à l’égard de l’organisation pour laquelle elles travaillent, voire sont potentiellement hostiles à leur entreprise.
Les sondés sont classés dans ces catégories en fonction de leurs réponses à douze questions Q12(c).38
Pour l’Institut Gallup le coût du désengagement est élevé en termes de perte de productivité. Il représenterait :
- entre 450 et 550 milliards d’euros par anaux États-Unis (soit entre 3,6 % et 4,4 % du PIB de 2012, date de parution de l’étude),
- entre 112 et 138 milliards d’euros par an en Allemagne (soit entre 4,1 % et 5,1 % du PIB).
En France, selon le modèle développé par Gallup, seulement 9 % des salariés seraient « engagés » en 2013 : c’est le score le plus bas parmi l’ensemble des salariés des pays européens enquêtés (voir tableau 1). En outre, plus d’un quart des salariés français seraient « activement désengagés », quand la moyenne mondiale est de 13 %. Cela étant, même le Danemark, qui domine le palmarès, ne compte que 21 % de salariés engagés.
Nous avons creusé cette question dans le cas de grandes entreprises comme Airbus Group. Là aussi, la faiblesse des résultats pose question. Patrice Roussel, enseignant-chercheur à l’IAE Toulouse 1 Capitole, se demande : « Comment expliquer qu’une telle entreprise puisse conduire des projets industriels de grande ampleur avec seulement 7 % de salariés engagés (enquête de 2010) ? »39 Ariane Malbat, DRH Airbus Group de Saint-Nazaire, explique que, dans son établissement, « la faiblesse des résultats en matière d’engagement s’explique par les irritants du quotidien : le manque de moyens, des produits ou pièces manquantes, le relationnel entre collègues, le manque de visibilité sur les évolutions professionnelles (pour les blue collars en particulier). »
Paola Tubaro, chercheuse en sciences sociales, explique que le fait que notre société valorise le travail comme une activité humaine digne de respect et de reconnaissance, au point qu’il est inscrit dans la Constitution et que nombre de bénéfices sociaux y sont rattachés, contribue probablement à façonner les attentes des travailleurs et leur ressenti face à des conditions de travail spécifiques, ce qui ressort ensuite dans les réponses aux questions des enquêtes.
Beaucoup font dire aux résultats Gallup que le travail est une valeur en déclin en France. Nos concitoyens sont pourtant ceux qui, en Europe, attachent le plus d’importance à cette valeur selon les différentes vagues d’enquêtes de l’European values surveys (EVS). Encore, l’enquête de la Commission européenne de 2012 sur les valeurs des Européens précise que les Français sont ceux qui sont les plus opposés à l’idée qu’il faudrait donner plus d’importance aux loisirs plutôt qu’au travail (61 %) aux côtés des Allemands (62 %), des Lituaniens (63 %) et des Néerlandais (68 %). Davoine et Méda (2009) relèvent que : « selon Thomas Philippon (2007), il n’y aurait pas de crise de la valeur travail en France mais l’expression d’un fort malaise au travail. Les relations sociales en France seraient tellement exécrables que les salariés désespéreraient du travail et se mettraient en quelque sorte dans une position de retrait. (…) Plus généralement, la France apparaît mal placée, en Europe, du point de vue de la perception par les salariés de leurs conditions de travail, de la sécurité de l’emploi et des aspects matériels de leur travail. »
En fait, la méthodologie développée par Gallup ne propose qu’une vue partielle du contexte du travail, concentrée sur les dimensions managériales et relationnelles (on demande aux salariés enquêtés s’ils ont un(e) très bon(ne) ami(e) dans l’entreprise par exemple). Les enseignements du management interculturel suggèrent aussi que le type de questions posées par l’Institut peut renvoyer à des modes culturels différents, tant de la part du management (formes de félicitations qui peuvent apparaître bienvenues ou inutilement paternalistes selon les pays), que de la part des salariés (l’humeur frondeuse ou d’auto-dénigrement étant plus répandue en France, sans qu’elle traduise toujours sans biais le ressenti), si bien que les résultats ne sont pas nécessairement comparables dans chaque pays (voir encadré 9). Dans d’autres enquêtes, les taux d’engagement sont bien plus élevés. Celle de l’observatoire du travail BVA-BPI 2014 montre que 75 % des salariés français sont très ou assez engagés et 25 % peu ou pas engagés, des résultats conformes aux enquêtes universitaires, explique Patrice Roussel (op. cit.). Par ailleurs, comme toute enquête déclarative (voir annexe 4), les résultats de l’Institut Gallup sont à prendre avec précaution. Françoise Papacatzis, responsable QVT et RPS de DuPont France explique : « Dans le questionnaire annuel d’engagement, les salariés répondent parfois à une autre question que celle qui est posée : lorsqu’ils affirment ne pas être engagés, ils témoignent en fait leur désaccord vis-à-vis de ce qui se produit sur leur site ou de la vision de l’entreprise. »
Encadré 9. Témoignage de Pascal, cadre d’une entreprise agroalimentaire
Mon entreprise a récemment été rachetée par un grand groupe anglo-saxon de l’agro-alimentaire. L’enquête Gallup sur l’engagement joue un rôle central dans l’évaluation des cadres, ce que je déplore. L’intention est louable mais sa mise en application est à la fois frustrante et dévoyée.
D’une part, sur le fond, je ne suis pas convaincu que l’évaluation de la performance d’une personne doive reposer essentiellement sur l’avis qu’en donnent ses subalternes : il y a d’autres considérations à prendre en compte. D’autre part, sur la méthode, il y a beaucoup à redire. Les questions sont toutes qualitatives, parfois très éloignées de ce que l’on attend d’une personne au travail (par exemple : « Avez-vous un(e) meilleur(e) ami(e) au travail ? »). De ce fait, les biais culturels d’interprétation sont immenses. La première année que nous y avons été soumis, alors que notre filiale est très nettement la plus performante du groupe et que son turnover est au plus bas, nous avons eu les pires résultats en termes d’engagement. Nos nouveaux grands dirigeants américains eux-mêmes ne comprenaient pas, pas plus que nous d’ailleurs. Puis nous nous sommes rendus compte qu’un Français moyen et un Américain moyen ne répondent pas du tout de la même façon. Dans les moeurs américaines, la critique est toujours formulée en termes positifs : les appréciations spontanées sont très élevées et la pire critique que l’on puisse faire à son supérieur est de le noter 3/5. En France, tout le monde a appris à l’école que la perfection est hors de portée. Demandez à un Français, normalement « engagé » dans son travail, s’il a les moyens de le faire correctement : son avis sera au mieux mitigé et assez facilement négatif. Contrairement à son collègue américain, il a le sentiment d’être clément en notant 3/5. Bref, il a fallu expliquer à nos équipes qu’elles devaient évaluer « à l’américaine », c’est-à-dire entre 3 et 5 étoiles uniquement, traduire « meilleur ami » par « collègue sympathique », etc.
Le plus grave, à mes yeux, est ailleurs : il tient au dévoiement du principe de l’enquête dans le management quotidien. Les opérateurs ont très vite compris que leurs cadres étaient soumis à la contrainte impérieuse d’être bien notés au Gallup. C’est donc devenu une monnaie d’échange, un moyen de pression : « donne-moi ce que je te demande, ou je te note sévèrement à la prochaine enquête. » Aujourd’hui, un cadre qui fait l’objet d’une notation défavorable se dit qu’il a un an pour trouver le « Judas » de son équipe et s’en séparer, sous peine d’être lui-même remercié si ses mauvais résultats sont confirmés par l’enquête suivante. Inversement, quand il n’y a pas de conflit particulier, chacun comprend qu’il a intérêt à rendre des appréciations maximales pour avoir la paix et, cerise sur le gâteau, donner à son supérieur toute la légitimité possible pour l’aider à obtenir de la hiérarchie des crédits ou d’autres marges de manoeuvre opérationnelles. Cela devient alors une pure formalité. Dans tous les cas de figure, on est assez loin d’une mesure sérieuse de l’engagement au travail.
Conclusion
Améliorer la QVT suppose de savoir la mesurer. Le rapport Lachmann-Larose-Pénicaud (op. cit.) rappelle que cette évaluation doit être suffisamment simple, s’inscrire dans la durée et être discutée par l’ensemble des parties prenantes (management, partenaires sociaux, service de santé au travail, etc.).
De nombreuses organisations se sont lancées sur le marché de la mesure de la QVT, du bien-être, de l’engagement, du bonheur au travail… Cela entretient une confusion sur les concepts, les méthodes de mesure et l’interprétation des résultats. Face à ce foisonnement, nous avons pointé les modèles de mesure faisant consensus dans la sphère académique et sur le terrain.
Y aurait-il un intérêt à aller plus loin et à élaborer un référentiel commun, normalisé ? Sur le plan international, une norme de management de la santé et de la sécurité au travail est en cours d’élaboration (ISO 45001). Au Québec, une norme « Entreprise en santé » (Norme BNQ 9700-800)40 est proposée aux entreprises qui souhaitent s’engager dans des pratiques organisationnelles favorables à la santé en milieu de travail.
Notons que ces deux exemples de référentiels sont, une fois de plus, tournés vers les problématiques de santé et de sécurité au travail. Or, pour que la QVT puisse être considérée comme une source effective de compétitivité, il faut aussi se pencher sur ses bénéfices économiques.
- 31. Voir Bigi et al. (2015) qui donnent la parole aux salariés sur leur travail et font le constat que ces derniers sont en quête de reconnaissance. L’ouvrage s’appuie sur plusieurs années d’enquêtes auprès de salariés d’une douzaine d’entreprise.
- 32. Voir le résumé de l’étude en version pdf : http://www.inrs.fr/dms/inrs/PDF/cout-stress-professionnel2007.pdf.
- 33. Pour une revue de la littérature sur l’évaluation des coûts du stress au travail, voir le rapport de recherche écrit par Jean-Pierre Brun, Christine Lamarche (2005). L’Eu-Osha (2014) propose également conseils et méthodes de calculs pour évaluer le coût des RPS au niveau de l’entreprise.
- 34. ll s’agit d’une évaluation a minima car cette étude prend essentiellement en compte le job strain qui représente selon les auteurs moins d’un tiers des situations de travail fortement stressantes. D’autre part, les pathologies retenues sont celles qui ont fait l’objet de nombreuses études : maladies cardiovasculaires (infarctus, maladies cérébrovasculaires, hypertension…), dépression et certains troubles musculosquelettiques. Enfin, cette dernière estimation ne prend pas en compte toute la dimension du coût pour l’individu, en particulier la souffrance et la perte de bien-être que le stress occasionne.
- 35. Calculating the cost of work-related stress and pyschosocial risks de l’EU-Osha (2014) est une synthèse d’études européennes sur le coût des risques psychosociaux, complétée d’approches extra-européennes.
- 36. Ce second type de méthode est plus satisfaisant que le premier car il cherche à éliminer les biais de sélection.
- 37. Dans le « Guide pratique des outils de mesure du bien-être au travail » (La Fabrique Spinoza, 2013), on trouvera des outils variés tels que l’indice du bien-être au travail (IBET) développé par Mozart Consulting, inspiré de la santé au travail qui prend en compte des données objectives du type accident, départs non volontaires, turnover, absentéisme, maladie… ou le palmarès « Great place to work », listant les entreprises où il fait bon travailler (les entreprises sont volontaires et évaluées par leurs employés).
- 38. Voir Harter et al. (2006).
- 39. Patrice Roussel, enseignant-chercheur à l’IAE Université de Toulouse 1 Capitole, intervenant au débat organisé par l’observatoire du travail impliquant BPI Group, BVA et Liaisons sociales, le 27 janvier 2015.
- 40. Le programme de certification amène les entreprises à agir dans les quatre sphères d’activités reconnues pour avoir une incidence notable sur la santé du personnel : les habitudes de vie du personnel ; l’équilibre travail-vie personnelle ; l’environnement de travail ; les pratiques de gestion.
Pourquoi les entreprises ont-elles intérêt à s’engager dans des démarches de QVT ?
Les évaluations de l’impact économique de la QVT sont essentielles pour que cette dernière puisse être considérée comme un levier de performance. Mais tester la relation entre QVT et performance économique est complexe car cela implique de relier deux notions multidimensionnelles et largement discutées. La QVT est régulièrement approchée dans les travaux par le bien-être au travail, la satisfaction au travail (voir encadré 10), l’engagement au travail. La performance, quant à elle, est souvent évaluée sur des critères productifs et financiers.
Les travaux et rapports recensés dans ce chapitre établissent un lien assez net entre qualité de vie au travail et performance. Les initiatives visant à renforcer les capacités d’action et d’expression des salariés, à donner du sens au travail, à reconnaître le travail effectué exercent une influence non négligeable sur l’engagement des collaborateurs et la performance des entreprises. Et les pratiques managériales sont, dans ce cadre, déterminantes.
Encadré 10. Quelques résultats extraits des études économétriques
Dans leur recension de la littérature, Delobbe et al. (2009) concluent que la corrélation entre bien-être au travail et performance individuelle est positive, significative et comprise entre 0,20 et 0,50 selon les études. Wright (2010) observe que le bien-être des employés permet d’expliquer plus de 25 % des variations de performance entre employés.
Le coefficient de corrélation s’élève à 0,27 dans une étude de Parker et al. (2003) et à 0.30 dans celle réalisée par Judge et al. (2001). Dans un document de travail récent (2015), Bryson, Forth et Stokes concluent qu’il existe une relation claire, positive et significative entre le niveau moyen de satisfaction au travail et la performance sur le lieu de travail en Grande-Bretagne, la performance désignant ici la performance financière, la productivité du travail et la qualité des produits et services rendus. Ils observent que les entreprises qui ont amélioré leur score de niveau moyen de satisfaction au travail de leurs salariés entre 2004 et 2011 ont vu progresser leur niveau de performance économique. Les auteurs relèvent que ces résultats sont cohérents avec une étude similaire réalisée en Finlande (Bockerman et Ilmakunnas, 2012).
1. L’engagement des salariés impacte la performance des firmes
Certains éléments de la qualité de vie au travail déterminent l’engagement des salariés, qui est lui-même susceptible d’influencer leur efficacité et la performance de l’organisation.
A. Le rôle de l’intensité et de la qualité de l’engagement
L’intensité de l’engagement des collaborateurs prédit de plus fortes performances au travail. Martin Virot, Président de DuPont France, dresse le constat suivant : « Les indicateurs d’engagement éclairent les raisons pour lesquelles certains ateliers fonctionnent mieux que d’autres en termes de sécurité, de propreté, de coûts et d’amélioration continue. À cet égard, une certaine corrélation peut être établie entre le niveau d’engagement des sites et leurs résultats. » Dans le même ordre d’idée, Gallup observe que les unités productives placées dans le premier quartile en termes d’engagement, comparées aux unités situées dans le dernier quartile, ont des niveaux de productivité, de profitabilité, de satisfaction client plus élevés (respectivement +21 %, +22 % et +10 %), et des taux d’absentéisme et d’accident du travail plus faibles (-37 % et -48 %)41.
Patrice Roussel (op.cit.) prévient néanmoins qu’il existe un phénomène de courbe en cloche dans la relation entre engagement et performance. Ainsi, un engagement excessif ou « workaholisme » concrétise une dépendance au travail, où la vie professionnelle prend le dessus sur la vie familiale, et où les risques de burn out sont plus forts.
La qualité de l’engagement est également déterminante. La théorie de l’autodétermination (Deci et Ryan, 2002, Cartwright et Cooper, 2009) distingue deux formes » de motivation* au travail : les motivations autodéterminée (ou autonome) et contrôlée. Forest et Mageau (2008) expliquent que la première fait référence « au fait d’accomplir une ou plusieurs tâches au travail par intérêt, par plaisir ou encore par satisfaction inhérente. » À l’opposé, la motivation contrôlée « correspond au fait d’agir par conformité ou encore pour la recherche de récompenses externes et l’évitement de punitions. » Entre ces deux cas extrêmes, il existe un continuum de motivation.
Plus la motivation est autodéterminée, plus les performances au travail sont fortes. Selon Patrice Roussel, la motivation contrôlée favoriserait tout de même la performance, mais à court terme et serait à l’origine de risques de burn out, tandis que la motivation autonome la favoriserait à long terme et soutiendrait le bien-être au travail. Les auteurs de la théorie de l’autodétermination soulignent que les besoins psychologiques d’autonomie, de compétence et de relation à autrui sont fondamentaux pour préserver et développer les conditions du bien-être au travail et la motivation autodéterminée. Abord de Chatillon et al. (op.cit.) les décrivent ainsi.
« L’autonomie implique que l’individu décide volontairement de son action, qu’il ne se réduit pas à un comportement d’agent, mais qu’il est un sujet qui assume pleinement les conséquences de ses actions. Le besoin de compétence se réfère à un “sentiment d’efficacité sur son environnement”, qui stimule le goût de relever des défis, de “faire face” et de “prendre en charge” les actions, qui contribue à nourrir en retour le sentiment d’estime de soi et de confiance en soi. Le besoin de relation à autrui com prend le sentiment d’appartenance et le sentiment d’être en lien avec des personnes importantes pour soi. »
S’agissant de l’autonomie et de ses relations avec la performance, une équipe de chercheurs (2004) a montré pour la France, en utilisant les résultats de l’enquête REPONSE (Relations professionnelles et Négociations d’entreprise) de 1998, que l’organisation en équipes autonomes et la rotation des postes sont associées à une plus forte innovation dans les produits et services. La latitude décisionnelle et la polyvalence permettent ainsi aux salariés d’exprimer leurs capacités de création et d’imagination. Gillet et al. (2012) ajoutent que lorsque les managers laissent une autonomie importante aux employés, le bien-être et la ténacité de ces derniers s’améliorent, avec des effets sur la performance.
Cécile Roche, Lean & Agile Director du groupe Thales, précise : « l’autonomie d’une équipe n’est pas son indépendance. Une équipe autonome n’agit pas à sa guise, et n’est pas non plus abandonnée à elle-même. Elle est capable de piloter sa journée de travail, de savoir si la journée est un succès et de faire face aux problèmes. »
L’étude ECWS 2010 d’Eurofound (voir encadré 6 p.50) souligne qu’en France, dans l’industrie, 15,8 % des salariés travaillent dans une équipe autonome, 61,1 % dans une équipe supervisée par la direction, 23,1 % ne travaillent pas en équipe. Les pays les plus avancés en la matière sont la Suède, la Finlande, l’Autriche et l’Allemagne.
B. La nature de l’engagement et ses relations différenciées avec la performance
Des travaux vont plus loin, en distinguant l’effet de la nature de l’engagement sur l’implication des collaborateurs. Ils observent aussi que tous les facteurs relatifs à la qualité de vie au travail n’ont pas les mêmes effets sur les trois types d’engagement décrits par Meyer et Allen (voir p.155). C’est pourquoi il convient de décomposer la qualité de vie au travail pour comprendre les liens spécifiques entre certaines de ses dimensions et la performance de l’entreprise.
Dans le tableau 2, on observe qu’il existe des différences significatives entre les liens reliant les trois catégories d’engagement – affectif, normatif et de continuation – et les deux types d’implication des salariés.
Si certains liens sont positifs comme c’est le cas entre l’engagement affectif et l’implication dans le travail par exemple, les liens entre l’engagement de continuation et les deux types d’implication sont souvent nuls et parfois négatifs. Le fait de développer l’engagement de continuité sans chercher à stimuler les autres catégories d’engagement ne permet pas d’améliorer la performance des employés. Cette situation peut par exemple se développer lorsqu’une entreprise est en situation de monopsone42 local pour les compétences des travailleurs, ces derniers resteront en effet « par défaut » dans l’entreprise puisqu’ils ne peuvent trouver un autre emploi dans la même région.
Les travaux empiriques montrent que l’engagement affectif contribue à une présence au travail plus constante, des absences volontaires moins élevées. Ce type d’engagement et l’intention de quitter son entreprise sont négativement corrélés, qu’elle soit mesurée par les projets de départs ou ceux réellement effectifs. À ce sujet, l’enquête internationale du Corporate Leadership Council et du Corporate Executive Board (2004) indique que les salariés engagés ont une probabilité de quitter leur organisation de 87 % inférieure à celle des salariés désengagés.
De nombreuses études ont cherché à déterminer les relations entre les variables qui influencent l’engagement (soit, pour rappel, les caractéristiques personnelles, organisationnelles, liées au rôle de l’employé dans l’entreprise ainsi que les expériences de travail, voir p.56), et les trois formes d’engagement. Par exemple, les caractéristiques personnelles apparaissent comme faiblement corrélées à l’engagement affectif qui est en revanche significativement corrélé avec certaines caractéristiques organisationnelles comme la décentralisation des décisions dans l’entreprise. Autre exemple, la non transférabilité des compétences d’une entreprise à une autre est positivement corrélée à l’engagement de continuation.
C. Les conditions de l’engagement affectif
L’engagement affectif, lié à un attachement et à une identification à l’entreprise, semble être la source la plus forte d’implication dans le travail et auprès de l’entreprise (cf. tableau 2). La majorité des recherches empiriques lui ont été consacrées (Vandenberghe, 1998). Elles soulignent le rôle déterminant des expériences de travail positives, elles-mêmes activées par quatre principaux mécanismes (extrait de Beintein et al., op.cit.) :
- le fait de se sentir soutenu et considéré,
- la perception de la justice des procédures qui sont appliquées au sein d’une entité,
- le sentiment de contribution personnelle : plus les salariés estiment que leurs contributions sont importantes pour l’entreprise, plus ils vont s’engager affectivement à son égard. L’engagement affectif est positivement corrélé avec le sentiment de participer aux prises de décisions et avec l’autonomie dans les tâches accomplies. De même, plusieurs recherches ont démontré l’existence d’un lien entre la réceptivité de la direction quant aux idées émises par le personnel et le développement de l’engagement affectif.
- le sentiment de réalisation personnelle : les salariés vont s’engager affectivement vis-à-vis de l’entreprise dans la mesure où celle-ci satisfait leurs besoins, rencontre leurs attentes et leur permet d’atteindre leurs objectifs.
Un certain nombre de ces mécanismes renvoient aux trois besoins psychologiques déjà évoqués : relation à autrui, compétence et autonomie (p.71), auxquels on peut ajouter les besoins de reconnaissance, de sens et de contribution. Ces six besoins fondamentaux de l’être humain sont des leviers sur lesquels les managers peuvent s’appuyer pour engager leurs équipes (voir schéma 4). D’ailleurs, de nombreux travaux se sont concentrés sur les pratiques managériales et leurs relations avec l’engagement et la performance des organisations.
2. Pratiques managériales, QVT, engagement, performance : des liens multiples
Certaines pratiques managériales ont été identifiées comme meilleures que d’autres sur des critères de performance boursiers, financiers ou productifs. Celles-ci ont aussi un impact sur la qualité de vie au travail des employés, et donc sur leur engagement dans l’entreprise. Le lien entre pratiques managériales et performance est donc double : direct et indirect par le biais de l’engagement des salariés (voir schéma 5).
Il est envisageable qu’une pratique managériale, en cherchant à améliorer la productivité des individus, dégrade leur qualité de vie au travail et nuise donc à leur engagement. L’effet final sur la performance de l’entreprise est incertain : il peut rester positif malgré la baisse de la motivation des salariés, être nul, ou même négatif si la dégradation de l’engagement surpasse la hausse de la productivité. En revanche, une pratique managériale permettant d’améliorer la qualité de vie au travail en même temps que la productivité des travailleurs peut avoir un double effet sur la performance de l’entreprise : le travail est mieux organisé et les salariés sont plus engagés.
A. Les High-performance work systems (HPWS) et les High-performance work practices (HPWPs)
Bloom (2014) a montré qu’une part substantielle des écarts de productivité entre entreprises ou pays s’expliquait par la qualité du management et des pratiques organisationnelles. Dans l’industrie française, le « score moyen de qualité du management » qu’ils calculent43 est situé en dessous de ceux des États-Unis, du Japon, de l’Allemagne, de la Suède, du Canada et du Royaume-Uni (voir graphique 1).
Une littérature très dense a vu le jour dans les années 1990 sur les High-performance work systems (HPWS) et les High-performance work practices (HPWPs). Wood (1999) indique que la grande majorité des travaux académiques établissent un lien entre ces dernières et la performance économique.
Combs et al. (2006) précisent que les HPWPs renvoient à la participation des employés aux décisions concernant l’organisation du travail, c’est-à-dire à la capacité à décentraliser le processus de décision, à autonomiser les salariés et à les faire travailler en équipe. Cela désigne aussi des arrangements de travail flexibles (flexibilité du temps de travail par ex.), des systèmes d’incitation à la performance et de promotion des talents ou encore des possibilités offertes aux salariés de se former. Ces pratiques RH amélioreraient le niveau de connaissance, de compétence et les habiletés des salariés, augmenteraient leur motivation tout en impactant positivement les bénéfices des entreprises. Ils précisent qu’une augmentation d’un point de la fréquence de mise en œuvre des HPWPs se traduit par une augmentation de 4,6 ٪ du taux de rentabilité des actifs nets.
Beintein et al. (op.cit.), qui ont passé en revue des travaux empiriques s’étant concentrés sur les principales pratiques de GRH et leurs effets sur l’engagement affectif dans le travail, indiquent en outre que les pratiques de sélection et de recrutement sont impactantes. « Les entreprises fournissant aux postulants des informations précises mentionnant les aspects positifs comme négatifs de leur éventuel futur travail peuvent ensuite augmenter l’engagement affectif envers l’entreprise et la satisfaction au travail. Les pratiques de socialisation jouent également. » La plus forte corrélation positive et significative porte sur « la manière avec laquelle les nouvelles recrues estiment recevoir un support positif versus négatif des membres plus anciens de l’entreprise. » Plus généralement, les programmes de socialisation destinés à familiariser les salariés aux objectifs et aux valeurs de l’entreprise pourraient avoir un impact positif sur l’engagement affectif, quel que soit le programme.
B. Des systèmes de pratiques RH cohérents avec la stratégie
Des auteurs ont mis en évidence que les pratiques managériales doivent former des systèmes cohérents. Les HPWPs citées précédemment en forment un. Ichniowski et ses co-auteurs concluent à son influence positive et significative sur la performance économique, sur la base de recherches menées dans des entreprises sidérurgiques (voir encadré 11).44
Encadré 11. Les travaux d’Ichniowski sur les lignes de finition en acier
Ichniowski et al. (1997) ont révélé que les lignes de finition d’acier qui utilisent des systèmes de pratiques managériales innovantes (dans cette étude : rémunération au rendement, travail en équipe, attribution souple des tâches, sécurité de l’emploi et formation) ont une meilleure productivité que celles utilisant un modèle managérial traditionnel. Dans un autre article, Ichniowski et Shaw (1999) ont collecté des données provenant de quarante-et-une lignes de finition d’acier pour tester l’effet comparé de pratiques de GRH utilisées aux États-Unis et au Japon. Au Japon, ils ont observé que les lignes de production utilisaient une combinaison de pratiques RH incluant des groupes de résolution de problèmes, des programmes de formation continue, un fort partage des informations, une attribution souple des tâches, la sécurité de l’emploi, un système de partage des profits. Aux États-Unis, la majorité des implantations combinait seulement une ou deux de ces pratiques et une minorité d’entre elles utilisait un système de pratiques RH de type « innovant » comparable à celui adopté au Japon. Les auteurs ont relevé que les sites japonais étaient significativement plus productifs qu’aux États-Unis et que les sites américains ayant expérimenté le système de pratiques RH japonais dans sa totalité voyaient leur performance en termes de qualité et de productivité atteindre le niveau des sites japonais.
Chaque pratique de GRH n’opère pas de façon isolée. Au contraire, les entreprises développent des systèmes de GRH complexes, conçus pour être compatibles avec la stratégie globale de l’entreprise, notamment avec la nature de l’avantage concurrentiel recherché : compétitivité prix ou hors-prix. Un système de pratiques managériales non adapté à la stratégie poursuivie par l’entreprise peut produire des effets négatifs sur ses performances. Il n’existe donc pas a priori de systèmes RH meilleurs que d’autres mais différents systèmes RH adaptés à diverses stratégies. Arthur (1992) ou Guthrie et al. (2002) ont montré que « les pratiques sophistiquées de GRH (formation, implication, système de motivation, de promotion…) contribuent à l’avantage concurrentiel des firmes qui recherchent une compétitivité-qualité alors que les firmes qui optimisent une compétitivité-coût ont des pratiques de GRH orientées vers le recrutement de salariés peu qualifiés pour lesquels les efforts de formation sont faibles et pour lesquels l’exigence d’implication est limitée. » (p.129)
En somme, les stratégies de montée en gamme doivent s’accompagner d’une réflexion poussée sur la qualité des pratiques organisationnelles et managériales. Ces dernières sont déterminantes pour la performance : elles permettent d’assurer la qualité du travail, des conditions de travail et du capital humain.
3. Impliquer les salariés : vecteur d’engagement, de performance et de QVT
A. Les organisations du travail participatives plus performantes
Le rapport d’Eurofound Work Organization and Employee Involvement in Europe (2013), basé sur l’EWCS 2012 (voir encadré 6, p.50), montre l’intérêt de construire des « organisations de travail participatives » (OTP ou High involvement working organisations), qui procurent aux salariés un espace d’implication, de participation directe, de capacité d’influence et de décision sur leur travail et leur organisation, et qui sont favorables à la performance (voir tableau 3).
En Europe, les secteurs où les employés travaillent le moins dans des OTP sont l’industrie manufacturière, le transport, le commerce de détail et la construction. Dans le secteur de l’industrie manufacturière, près de 22 ٪ des employés travaillent dans une OTP, alors que 45 ٪ travaillent dans une organisation avec implication faible des salariés. Or, c’est dans les OTP que l’on trouve les plus forts taux de mise en œuvre de la formation professionnelle, des processus d’évaluation des salariés, des promotions ; la qualité des conditions de travail y est meilleure, à la fois sur les plans physique et psychique. Les OTP sont également favorables à la performance économique des organisations. La motivation, l’engagement au travail, la fidélité y sont plus forts. L’absentéisme y est beaucoup plus bas.
Le rapport pointe le mauvais classement de la France en matière d’OTP, en dessous de la moyenne des pays de l’Union européenne, des Pays-Bas, du Royaume-Uni, de la Belgique, du Luxembourg et de l’Irlande. D’après une autre étude européenne, se référant également à l’EWCS 2012, la proportion des salariés qui déclarent pouvoir influencer les décisions qui sont importantes pour leur travail est relativement faible en France : 31 %, contre 40 % pour la moyenne des 28 pays de l’UE, 38 % en Allemagne, 45 % au Royaume-Uni, 32 % en Italie et 39 % en Espagne. Parmi les 28 pays de l’UE, seule la Slovaquie présente un score plus faible (28 %).
Dans un autre rapport publié en 2015 (Akkerman et al., 2015), Eurofound examine45 les modalités de participation des salariés en Europe. Elles sont d’une grande diversité, soit indirectes (au travers du dialogue social), soit directes : participation à des réunions, envoi de newsletters, mise en place de boîtes à idées… Un peu plus de 30 % des établissements européens combinent un haut niveau de dialogue social et une forte implication directe des salariés.
Comment est définie cette notion d’implication directe des salariés ? Le rapport reprend une définition qui fait référence, celle donnée par John Geary et Keith Sisson, dans leur étude de 1994. Il s’agit des « opportunités que le management donne ou des initiatives qu’il soutient sur le lieu de travail en termes de consultation, de délégation de responsabilités, de capacité de prise de décision pour leurs subordonnés, aussi bien en tant qu’individus qu’en tant que collectifs de travail. Ces opportunités ou initiatives concernent les tâches immédiates, l’organisation du travail et/ou lesconditions de travail. » Il s’agit d’une approche très empirique de l’autonomie au travail.
Le défi français tient au fait que notre pays se caractérise à la fois par une piètre qualité du dialogue social (participation indirecte) mais aussi du dialogue professionnel (participation directe des salariés).
B. L’intérêt de modes d’interactions ascendants et riches en échanges
L’enquête EWCS sur laquelle s’appuie Eurofound permet de recenser les différents modes d’interaction (outils et processus) entre management et employés mis en œuvre dans les établissements des 28 pays de l’UE. Sur cette base, Eurofound propose une classification des établissements en cinq familles :
- Implication limitée : les interaction sont très descendantes et se concentrent sur les réunions d’équipe, les newsletters internes et la consultation d’informations sur l’intranet ou internet.
- Implication conventionnelle : les interactions privilégient le contact humain : réunions d’équipes, réunions de management ouvertes à tous les salariés, etc.
- Implication ad-hoc : les modes d’interaction ci-dessus sont utilisés mais s’y ajoute une forte proportion de réunions thématiques ou à la demande, provoquées lorsqu’une nécessité se fait jour.
- Implication consultative : aux modes d’interactions traditionnels descendants, s’ajoutent les modalités ascendantes – écoute des suggestions du personnel, administration de questionnaires.
- Implication extensive : forte part des consultations ascendantes : recensement formalisé des idées et suggestions du personnel, utilisation plus forte des média sociaux et des questionnaires.
Les trois pays dans lesquels on trouve la plus forte proportion d’établissements à implication limitée (type 1) sont l’Italie et le Portugal (18 % des établissements), suivis par la France. Notre pays est également surreprésenté dans le mode d’implication ad-hoc (type 3, 25 % des établissements), dans lequel il arrive aussi en troisième position, derrière la Belgique (29 %) et la Pologne (27 %). Les établissements français apparaissent ainsi fortement marqués par les modes d’interaction descendants et pauvres en échanges. À l’inverse, ils sont très peu représentés dans le mode d’implication extensive (type 5), qui fait une place importante à la communication ascendante et à l’interactivité. Sans surprise, ce sont les pays nordiques qui comptent la part la plus importante de leurs établissements dans cette famille : 80 % pour la Suède, 75 % pour la Finlande, 71 % pour le Danemark. L’Allemagne et le Royaume-Uni se situent autour de 50 %. La France ne se situe qu’à 38 % et seuls trois pays sont moins bien classés : l’Italie, la Pologne et le Portugal.
L’implication des salariés n’est pas une démarche anodine en termes de performances économique et sociale. La prévention des arrêts maladie, la fidélisation du personnel, la motivation des salariés et le climat social sont meilleurs dans les entreprises qui développent un bon niveau de dialogue social. Le sens de la causalité entre ces deux indicateurs n’est cependant pas une évidence.
En parallèle, la participation directe des salariés améliore également la QVT. « Une importante décision à prendre dans l’organisation du travail consiste à déterminer s’il y a lieu de centraliser la prise de décision (afin de la confier exclusivement à la haute direction) ou de la décentraliser (afin que l’employé exécutant la tâche puisse prendre des décisions). Une plus grande latitude dans la prise de décision au niveau des employés est associée à leur plus grand bien-être. » Dans un article de la revue d’Eurofound, Agnès Parent-Thirion poussait plus loin l’analyse sur ce point : « L’implication dans la prise de décision est clairement associée à des niveaux de bien-être plus élevés. (…) La participation aux décisions organisationnelles plus larges a un effet plus important sur le bien-être des travailleurs que la capacité d’influencer les décisions concernant les tâches professionnelles, cet effet persistant même dans des conditions de forte intensité de travail. » (« Foundation Focus », 2014).
Certains auteurs attirent l’attention sur le fait que l’implication directe est liée au bagage de formation des salariés et de ce fait, relativement limitée dans les établissements qui emploient une forte proportion de travailleurs non ou peu qualifiés. Ils incitent les responsables de ces établissements à y développer davantage les modalités d’implication.
Conclusion
La relation entre QVT et performance est donc établie par la littérature mais elle est en partie indirecte, via des états psychologiques individuels comme l’engagement. Pour cette raison notamment, la démonstration sur le sens de la causalité est ardue. Il est en effet possible que la performance économique explique un haut niveau de QVT quand le lien réciproque tiendrait surtout à un effet indirect, engendré par exemple par une amélioration de l’efficacité organisationnelle ou par l’attraction de salariés « intrinsèquement » motivés donc plus productifs. Par ailleurs, il n’existe pas de relation simple entre des aspects précis de la qualité de vie au travail et les indicateurs de performance. La plupart des entreprises combinent différentes actions en matière de qualité de vie au travail. Celles qui constatent une progression de leur performance ne savent pas identifier précisément les liens de cause à effet (Jungblut, 2010). C’est finalement un cercle vertueux qu’il faut parvenir à enclencher.
Parmi les conditions de la QVT et de l’engagement, on retiendra que les organisations attentives à l’implication de chacun dans les décisions relatives au travail ou à l’organisation sont les plus performantes. Elles activent ainsi un levier psychologique fondamental : l’autonomie. On retiendra également que les individus ont besoin de relation à autrui, de pouvoir utiliser leurs compétences, de contribuer, d’être reconnus, soutenus et de trouver un sens à ce qu’ils font et à la stratégie de l’entreprise. La possibilité qui est donnée à chacun dans l’entreprise de faire du bon travail, dans de bonnes conditions, est ainsi au cœur de la relation entre QVT, engagement et performance.
- 41. La méthode utilisée pour aboutir à ce résultat est celle de la méta-analyse. Une méta-analyse est une démarche statistique qui combine les résultats d’une série d’études indépendantes sur un problème donné de sorte à contrôler les multiples sources d’erreurs de chaque étude prise individuellement (taille de l’échantillon, erreur de mesure ou autres) (voir Hunter et Schmidt (1990) pour en savoir plus). Elle élimine ainsi un certain nombre de biais et permet d’estimer la relation entre les variables étudiées. L’étude de l’Institut Gallup 2013 porte sur 192 organisations de secteurs variés (industrie, finance, services, transport…) soit une base totale de 49 928 business units et 1 390 941 répondants (depuis 1997). Pour en savoir plus : Gallup (2013), Harter et al. (2002).
- 42. Le monopsone désigne la situation inverse du monopole quand un demandeur se trouve face à un grand nombre d’offreurs.
- 43. Pour calculer les scores, les auteurs se basent sur des interviews durant lesquelles les individus interrogés attribuent une note allant de 1 à 5 pour évaluer dix-huit pratiques clés de management dans trois domaines prioritaires : 1. le suivi de ce qui est réalisé dans l’entreprise et l’utilisation des informations pour l’amélioration continue des procédés existants, 2. les objectifs et les moyens disponibles pour y parvenir, la capacité à modifier la stratégie en cas d’incohérence entre objectifs et résultats et 3. le management des RH (systèmes d’incitation à la performance, de promotion des talents).
- 44. Relevons toutefois quelques limites à ces travaux. D’abord, des résultats tels que ceux mis en avant par Ichnowski et ses co-auteurs ne sont par nature pas généralisables à l’ensemble des secteurs d’activité. Ensuite, Capelli et Neumark (2001) relèvent que si ces pratiques ont bien un effet sur la productivité des employés par exemple, elles ont aussi un coût qui soulève une interrogation quant à leur bénéfice net.
- 45. Ce rapport s’appuie sur des séries de données issues de la troisième enquête ECS (European Company Survey) couvrant 32 pays européens (les 28 États-membres de l’Union Européenne, la Macédoine, le Monténégro et la Turquie). Ces données récentes bénéficient d’une large couverture fonctionnelle : les représentants de la direction (RH préférentiellement) ont été interrogés ainsi que les représentants du principal organe de représentation des salariés (Comité d’entreprise ou équivalent), ce qui permet de couvrir une large gamme de problématiques. Au total, les réponses de plus de 30.000 dirigeants et plus de 9.000 représentants des salariés ont été enregistrées. Contrairement à beaucoup d’enquêtes qui se contentent d’interroger des grandes entreprises, l’ECS couvre les établissements de plus de 10 personnes, ce qui permet d’incorporer la « vision PME ».
VOLET 2. QVT ET PERFORMANCE ÉCONOMIQUE : LES EXPERIENCES DE TERRAIN
QVT et performance dans les entreprises
Et sur le terrain, que se passe-t-il ? Comment les entreprises abordent-elles concrètement le lien entre qualité de vie au travail et performance ? Prudents, nos interlocuteurs ne cherchent pas à démontrer un lien causal unidimensionnel. Ils savent que de multiples facteurs pèsent sur la compétitivité. Cette relation se lit plutôt dans le contexte de chaque entreprise et par rapport à ses objectifs propres. En ce sens, la qualité de vie au travail est une condition nécessaire mais non suffisante de la performance.
Nous avons auditionné onze entreprises pour recueillir leur expérience (voir p.169). Sept sont des entreprises industrielles, dont une PME, auxquelles s’ajoute une TPE du conseil. Nous avons également rencontré trois responsables d’entreprises du numérique pour élargir notre vision à des sociétés récemment créés, dans un secteur en pleine expansion, et qui affichent leur conviction d’un lien étroit entre QVT et performance. Nous décrivons dans les pages qui suivent les motivations, les moyens mis en œuvre, les conditions de réussite propres à chacun, et leur appréciation de leurs résultats.
1. Rechercher une efficacité sur le terrain
Toutes les entreprises que nous avons auditionnées sont à la recherche d’une meilleure efficacité. Mais leurs points d’entrée sont différents.
Quelques exemples :
Chez Valéo, c’est l’impulsion du directeur général qui a conduit le directeur des relations de travail à vouloir signer un accord sur le « mieux-être » au travail. C’est donc du terrain des relations sociales qu’est partie cette initiative. « Il a été décidé de négocier un accord sur le mieux-être au travail en France suite aux affaires de suicides dans de grandes entreprises telles que Renault, France Télécom et compte tenu des vagues de restructurations au sein de Valéo. Entre mi 2008 et mi 2010, Valéo était en situation de réorganisation. La charge de travail RH était telle qu’il n’était pas possible de se pencher sur le sujet de la prévention des risques psycho-sociaux en France. À l’époque, le directeur général insistait pour que le projet soit initié. La réflexion a débuté fin 2009 pour la France puis a été élargie à tous les sites dans le monde à partir de 2011. Finalement, la négociation d’un accord a débuté fin 2010 ; celui-ci a été signé en 2014. »
Chez Renault, le circuit de décision est assez similaire, mais le projet est né pour une toute autre raison. « L’idée de l’expérimentation avec le Cnam a germé il y a près de cinq ans, après une rencontre informelle entre la direction générale de Renault et les organisations syndicales. La discussion avait suscité la perplexité du directeur général, Patrick Pélata, sur un aspect en particulier : comment expliquer que les parties ne parviennent pas à converger vers une vision commune sur un sujet tel que les conditions de travail ? À l’époque, la réflexion sur ces questions n’était pas aussi avancée qu’aujourd’hui, et l’on tendait essentiellement à objectiver les conditions de travail à travers des indicateurs (taux de fréquence et taux de gravité des accidents, cotations ergonomiques…). » décrit Jean Agulhon, à l’époque DRH France (et aujourd’hui DRH du groupe RATP). Pour explorer cette question, Renault s’adresse à Yves Clot, titulaire de la chaire de Psychologie du travail au Cnam et responsable de l’équipe de recherche clinique de l’activité. Il est décidé de mener une expérimentation sur une ligne de production « montage de portes » à l’usine de Flins (78) avec Jean-Yves Bonnefond, l’un des chercheurs de l’équipe.
Renault vise aussi un objectif de performance. « Dans une même logique, nous devions réunir des conditions de réussite managériales. La personnalité du directeur de l’usine de Flins a constitué un argument fort, d’autant qu’il était à la tête du site ayant le plus important défi de compétitivité à relever. Même si la décision d’y affecter la fabrication des Micra de Nissan n’était pas encore prise, nous savions que c’était une option possible. Or Nissan achèterait la Micra à un prix prédéterminé, ce qui imposait à l’usine d’atteindre un coût de fabrication compétitif. »
Chez Michelin, c’est la recherche d’une meilleure efficacité qui est clairement affichée ; l’entreprise a lancé une nouvelle démarche managériale dès 2000. Intitulée Michelin Manufacturing Way (MMW), elle s’est poursuivie après de nouvelles initiatives visant à « libérer l’autonomie » des opérateurs, notamment via la notion d’organisation responsabilisante (OR) puis la démarche du Management du progrès et de la performance (MAPP), étape initiée en 2013. Dominique Foucard, directeur de la performance industrielle, explique : « L’objectif des organisations responsabilisantes, au sein de MMW, est de faire croître en synergie trois axes de progrès : 1/ la performance de l’entreprise (taux de service, coûts de production, etc.), 2/ la qualité de vie au travail (comment je me sens dans mes relations avec mes collègues, mes chefs et les autres secteurs), 3/ le développement personnel (perspectives, plan de carrière, évolution). »
Chez Maille Verte des Vosges, les enjeux sont bien différents. Cette PME du textile de 30 salariés a réussi à survivre à un dépôt de bilan après avoir lancé une démarche proche du lean. Son PDG, Eric Néri, son responsable de production, Bruno Rémy et le consultant qui les a aidés, Didier Wakin, nous ont présenté leur démarche en détail (voir encadré 12).
Contexte encore différent pour DuPont France. Martin Virot, le PDG, nous a exposé un mode de fonctionnement entièrement structuré autour de la sécurité, donc de la prévention des risques. Risques physiques, mais aussi risques psychiques, puisqu’un poste dédié à la prévention des RPS a été créé dans l’entreprise, il y a maintenant plus de dix ans, par Françoise Papacatzis, désormais responsable QVT. Françoise Papacatzis y a développé un modèle de management Reciprox® fondé sur trois principes : un cadre clair, du lien social et une politique de reconnaissance. Si ces trois piliers sont mis en œuvre – par tous – dans l’entreprise, les risques psychosociaux peuvent être contenus.
Du côté des entreprises du numérique, le lien entre QVT et performance est une évidence. Silja Druo, responsable ressources humaines de Captain Train56 explique « Nos salariés ont 30 ans en moyenne ; mais peu importe la génération : chaque personne aime que son travail soit utile. À un moment, certains employeurs s’en sont sans doute moqués, ils étaient focalisés sur la performance. Mais aujourd’hui, on sait que la performance, la croissance, l’innovation… puisent leur source dans le bien-être au travail des collaborateurs, le sentiment de reconnaissance et de se sentir utile. »
Encadré 12. Maille Verte des Vosges, histoire d’un redressement
Cette petite entreprise textile, située dans l’Est de la France, s’est redressée en appliquant une méthodologie de résolution de problèmes par les opérateurs. « Longtemps, Maille Verte des Vosges a essentiellement fourni l’industrie automobile », explique Eric Néri, son PDG. « Sous l’effet de la crise de 2008, elle a dû déposer le bilan et procéder à une restructuration. De ses 150 salariés d’hier, il en reste aujourd’hui une trentaine. Cette restructuration assez brutale a été vécue comme un traumatisme, d’autant qu’elle faisait suite à des années fastes. Il faut reconnaître que l’organisation s’était habituée à une certaine facilité, laissant cours à une dérive des structures, de la qualité des produits et des salaires. Les réclamations des clients affluaient, et des tensions s’étaient installées en interne. L’enjeu pour le management était donc de redresser la société tout en offrant des perspectives d’avenir au personnel. »
« Dans le secteur textile, seuls les grands groupes connaissaient le lean management, explique Didier Wakin, le consultant qui a accompagné l’entreprise57 La question des conditions de travail n’entrait pas dans les préoccupations initiales du programme, mais est apparue en chemin. Il s’est en effet avéré que l’implication du personnel méritait une approche particulière dans les entreprises de petite taille. C’est au travers de l’accord national interprofessionnel de juin 2013 que j’ai découvert les dix axes de la qualité de vie au travail. Avec le recul, il apparaît que nous y avons de fait répondu » explique-t-il. C’est en effet une démarche lean «sur mesure» et «ascendante» qu’ont appliquée les responsables de MVV. Une démarche qui a visé avant tout l’implication des opérateurs. «Sans cela, constate le PDG Eric Néri, je ne vois pas comment nous aurions obtenu leur adhésion». Tout en reconnaissant qu’il n’avait pas le choix: « Nous avons mis en œuvre le sous la contrainte, au pied du mur. L’industrie textile a connu une évolution technique considérable et est devenue fortement capitalistique. La productivité y a crû grâce à une réduction de la main-d’œuvre doublée d’investissements technologiques massifs. Tant que les entreprises ont eu les moyens d’investir, elles estimaient n’avoir besoin de rien d’autre et n’ont pas questionné leur modèle. »
Laure Wagner, porte parole de l’entreprise BlaBlaCar, responsable développement durable et déléguée du personnel, ajoute : « La qualité de vie au travail, pour nous, est une priorité. Nous portons une très grande attention au bien-être au travail. Chacun doit avoir le sentiment qu’il n’est pas juste “un pion”. Nicolas Brusson, le COO (chief operating officer), a été investisseur et membre du board de nombreuses start-up. Il a mesuré l’importance de la culture d’entreprise et du bien-être au travail pour la performance. Nous avons la conviction que l’on ne peut pas faire du bon travail dans de mauvaises conditions. Nous voulons que nos collaborateurs se sentent reconnus, sachent à quoi sert leur travail. »
À cette conviction s’ajoute un enjeu d’attractivité et de fidélisation. Laure Wagner : « Nous recrutons des compétences rares. Nous cherchons des profils internationaux (nous sommes implantées dans 19 pays), bilingues anglais voire trilingues, très compétents dans leur domaine et ayant un état d’esprit d’entrepreneurs, proactifs. Pour les convaincre, nous devons être attractifs car les candidats nous choisissent autant que nous les choisissons. »
Si la croissance de l’entreprise repose sur la qualité du produit et par ricochet sur la qualité de vie au travail des collaborateurs, le défi sera de gérer cette croissance tout en conservant ces valeurs. Silja Druo : « Captain Train a démarré en 2009, il est passé de la start-up à la PME. La croissance rapide de l’effectif constitue un défi pour la direction et la DRH : il s’agit d’assurer une croissance pérenne tout en maintenant les valeurs de l’entreprise, des conditions du travail qui conviennent aux collaborateurs présents et futurs ainsi que l’esprit start-up. L’entreprise est ainsi en pleine phase de structuration. L’objectif est de pouvoir garder la créativité et l’autonomie des collaborateurs. »
2. Mettre en place une nouvelle organisation
Comme l’indique Jean-Yves Bonnefond, chercheur au Cnam intervenu chez Renault : « Toute structure, quelle qu’elle soit, engendre des problèmes. Notre préoccupation est d’aider les opérateurs à développer leur efficacité d’une façon qui ne soit pas clandestine. Parfois en effet, les régulations qui permettent à une organisation de fonctionner sont souterraines. » Il s’agit donc de « tester des transformations organisationnelles permettant d’agir sur la qualité du travail avec les opérationnels concernés. » (voir encadré 13).
Encadré 13. Les transformations organisationnelles testées chez Renault Flins
Nous avons organisé un dialogue sur la qualité du travail entre opérateurs à l’échelle de l’atelier. Pour cela, nous avons d’abord passé du temps à observer leur travail sur la chaîne et à échanger avec eux. Une fois qu’ils ont accepté d’entrer dans l’exercice, nous leur avons proposé des outils permettant de mener une analyse de leur travail, en particulier des captations vidéo de leurs opérations servant de support aux échanges. Les professionnels avaient intériorisé la conviction selon laquelle il était vain de s’exprimer sur le travail car aucun changement n’en découlerait. Il n’existait d’ailleurs, dans le quotidien de l’atelier, aucun cadre technique ou social propice à la tenue d’un dialogue. Or dès que ce dialogue a pu s’instaurer, des problèmes très concrets sont apparus. L’expérimentation a mis en lumière le défaut de conception d’une pièce de porte, un lécheur, entraînant des efforts de montage intolérables et des conflits. Jusque-là, le chef d’équipe savait que la reconception de cette pièce était hors de sa portée. Au mieux pouvait-il espérer que ce défaut ne se poserait plus sur le modèle suivant. Sa principale préoccupation tenait à la façon dont les opérateurs s’accommodaient de cette difficulté. Le renoncement était généralisé à tous les niveaux de l’atelier.
En comité de suivi, il a été décidé de construire une organisation capable de répondre aux problèmes identifiés dans les diagnostics des opérateurs. Elle devait à terme pouvoir s’affranchir du Cnam, voire être généralisée dans l’usine. Ce processus de dialogue, d’action et de décision (conçu par les opérateurs et leurs responsables, N.D.E), a été étendu à l’ensemble du département montage, soit 26 unités élémentaires de travail (UET) et 600 opérateurs. L’une de ses particularités est de reposer sur une fonction d’opérateur référent élu pour six mois par ses pairs. Chaque référent a dans son périmètre vingt à trente opérateurs. Il dispose d’un temps de sortie de chaîne pour circuler sur la ligne, dialoguer avec ses collègues, repérer avec eux les problèmes et recueillir les solutions qu’ils imaginent. Il croise ensuite ses constats avec l’opérateur référent de la contre-équipe (le travail est organisé en 2×8). Ensemble, ils font le point sur les difficultés et les solutions, hiérarchisent les problèmes et construisent un point de vue à discuter avec leur hiérarchie.
Les deux référents rencontrent alors les deux chefs d’équipe à qui ils soumettent le fruit de leur analyse : obstacles identifiés, solutions envisagées et périmètre d’élaboration de celles-ci (opérateur, unité de travail, chef d’atelier ou de département, voire directeur d’usine s’agissant de défauts de conception de pièces). Ces éléments sont formalisés et enregistrés dans une base de données. Toutes les semaines, le référent fait le point sur le traitement apporté aux sujets en cours. Quand une solution est mise en place, il doit s’assurer qu’elle est considérée comme valide par les opérateurs. Tant qu’une solution n’est pas validée par ces derniers, le problème n’est pas considéré comme soldé.
Sont par ailleurs prévues quarante minutes d’arrêt de fabrication par mois, à raison de deux fois vingt minutes tous les quinze jours, durant lesquelles l’équipe se réunit (opérateurs, référents et chef d’équipe) pour dresser un état des lieux de la situation de travail et discuter à bâtons rompus sur les problèmes traités et les difficultés en cours.
Le dispositif concerne tous les opérateurs y compris les intérimaires, dont il arrive que certains soient élus référents. Ce processus engagé depuis plus d’un an au département montage fait l’objet d’un suivi. Une référente des référents est détachée une fois par semaine pour circuler dans les unités élémentaires de travail afin de veiller au bon fonctionnement du dispositif. L’ensemble des référents tient par ailleurs une réunion trimestrielle pour faire le point sur le processus. Après un an de fonctionnement, 1 190 problèmes ont été recensés. Près des trois quarts d’entre eux ont été traités, 16 % sont collectés mais non encore traités, 11 % sont en traitement et 1 % sont identifiés comme non traités et critiques par les opérateurs.
Au final, 96 % des problèmes concernent le poste de travail, et seulement 4 % sont transversaux.
Propos de Jean-Yves Bonnefond, Cnam.
Chez Michelin, les nouvelles organisations responsabilisantes mises en place cherchent aussi à renforcer l’engagement par plus d’autonomie, comme l’explique Dominique Foucard. « Les organisations responsabilisantes (OR) utilisent des principes qu’on retrouve dans le lean manufacturing : au niveau 1 de l’OR, chaque équipe décrit ses règles de vie, de fonctionnement dans un livre d’équipe. Ensuite, au niveau 2 de l’OR, on nomme des correspondants flux, qualité, sécurité principalement, qui sont des ouvriers qui en plus de leur travail de producteur sont chargés de faire le lien avec les équipes amont, aval, montante et descendante. Tout ceci dans un contexte où les chefs d’équipe (appelés “responsables d’îlots” dans les OR) sont passés au travail en 2/4. Aujourd’hui, 80 % des ouvriers Michelin travaillent en “îlots de production” et ne voient leurs chefs qu’un tiers de leur temps passé en usine. Bien entendu, à tout moment, une personne représente l’entreprise légalement en cas de problèmes.
Un îlot, c’est un groupe de machines, de personnes, avec des produits entrants et sortants, qui produisent 24h/24h et 7j/7j. Le responsable d’îlot manage trente à quarante personnes au maximum, réparties entre quatre ou cinq équipes qui se suc cèdent par rotation. Le fonctionnement en îlots s’applique bien partout, car finalement, demander aux salariés de prendre des responsabilités et reconnaître les prises de responsabilités, cela marche partout. »
Depuis septembre 2014, le site industriel d’Airbus Saint-Nazaire a lancé la démarche « libérer les énergies ». Cinq cents personnes travaillent sur l’A380 (sur les 136 000 salariés que compte le groupe dans le monde), dans le cadre de mini-usines, ce qui revient à repenser la façon dont est organisé le travail et dont il est managé. Giovanni Loiacono, ancien responsable de production, est aujourd’hui responsable d’un service support opérationnel aux mini-usines. Il témoigne : « Nous avons supprimé un niveau hiérarchique, le mien. La nouvelle organisation repose sur des responsables de lignes qui sont devenus leaders des mini-usines, et qui sont maintenant en journée normale. Les anciens responsables d’unités sont devenus responsables d’un service axé sur le support opérationnel aux mini-usines et la préparation du futur : innovation, projets, etc. Toutes les mini-usines ont une relation client-fournisseur. »
Chez Maille Verte des Vosges, parmi d’autres innovations, les responsables de l’entreprise ont adopté le principe du management visuel avec l’aide de Didier Wakin. Eric Néri, le PDG : « Nous étions capables d’enregistrer une commande et de la lancer avec la matière nécessaire, mais à la question “où en est ma commande ?” – la pire que puisse nous poser un client – nous étions en peine de répondre. Tout juste pouvions-nous lui indiquer quelle semaine elle serait prête. Tous les matins, Bruno Remy partait en quête de rouleaux dans l’en-cours, ignorant à quelle étape de la production ils se situaient. Nous devions donc progresser en termes de rangement, d’identification, de traçabilité et d’organisation. Il fallait maîtriser la complexité des mouvements des en-cours entre les postes. » Mais l’outil a été adapté : « Le processus aurait pu être automatisé et informatisé, mais nous avons tenu à construire un outil très simple, que chacun puisse s’approprier immédiatement. »(voir encadré 14).
Encadré 14. Le management visuel chez Maille Verte des Vosges
Bruno Remy, le responsable de production, a conçu un tableau de pilotage permettant de recenser, à un instant donné, tous les en-cours sur chacun des postes. Cet outil, constitué de casiers en bois dans lequel sont insérées des fiches, a été construit par les ateliers et placé au centre de l’usine. Chaque case représente un ordre de priorité et une zone dans laquelle se trouve l’en-cours. Les opérateurs déplacent des cartes (une par lot) de case en case, au fil de l’avancement des lots dans la production. Quand un opérateur a fini un lot, il retire sa fiche et la met à disposition dans le flux, après quoi Bruno Remy reprogramme l’étape suivante. « Ce tableau présente l’avantage de la simplicité, mais aussi de maintenir le contact avec les opérateurs. Il devient un lieu de rencontre, de discussion et d’arbitrage . »
3. Donner du sens à l’activité
Pour autant, l’engagement ne surgit pas automatiquement d’une nouvelle organisation, de conditions de travail favorisant l’autonomie ni même d’un management plus responsabilisant. Tout dépend de la manière dont ces procédures se mettent en place et du sens qui leur est donné. « Dans les îlots, on peut encore faire le constat que certaines personnes sont plus engagées que d’autres, explique Dominique Foucard de Michelin. Lors des points 5 minutes, dans le cadre du management quotidien de la performance, on observe parfois que lorsque les sujets et problèmes du groupe sont évoqués, seules quelques personnes répondent et les autres regardent leurs chaussures. » Cette observation a poussé l’entreprise à aller plus loin et à demander une étude.
« Cette enquête a été réalisée par un médecin du travail qui a interrogé des centaines de salariés partout dans le monde dans une dizaine de sites, pendant trois mois : France, Allemagne, Espagne, Italie, Grande- Bretagne, Canada, États-Unis, explique Dominique Foucard. L’enjeu était de savoir ce que les collaborateurs – ouvriers, syndicalistes, hiérarchie, responsable d’îlots – pensaient de MMW. Le résultat était assez décapant au niveau ouvrier : il ressortait qu’ils n’avaient pas tous compris le sens des outils ou des choses à faire. Ils appliquaient les consignes sans savoir toujours pourquoi. En revanche ils ajoutaient qu’il n’était pas question de revenir à l’organisation antérieure. »
C’est en partant de ces constats, et après avoir demandé aux opérateurs leurs propositions, que Michelin a décidé d’aller plus loin, d’abord sous la forme d’une expérimentation dans six usines volontaires à travers le monde pour mettre en place le « MAPP » (Management autonome du progrès et de la performance). Le premier signe qu’il s’agissait vraiment d’une démarche nouvelle, c’est que chaque pays y est allé à sa façon. L’entreprise a décidé de ne rien imposer, le Canada a mis 6 mois à démarrer, mais le siège n’est pas intervenu pour autant.
« Nous ne voulons pas écrire un référentiel et cela, c’est déjà très nouveau ! Tout le monde rouspète contre les référentiels mais tout le monde est perdu quand il n’y en a pas… Nous avons donc décidé qu’il n’y aurait pas de “référentiel OR3” sur le modèle de celui des OR. Nous allons mettre en place ce qu’on appellera un “MAPP tour”, c’est-à-dire des visites dans les usines les plus avancées. »
De son côté, DuPont « place l’engagement au cœur de la qualité de vie au travail. Celui-ci repose pour une large part sur l’adhésion aux valeurs fondamentales de l’entreprise » décrit Martin Virot, le PDG du groupe en France. Ces valeurs, quelles sont-elles ? D’abord la santé et la sécurité, première valeur de DuPont, à laquelle s’ajoutent le respect des personnes, le respect de l’environnement et l’éthique. Concrètement « jamais une réunion, qu’il s’agisse d’un comité d’entreprise ou d’un comité de direction, ne commence sans un point sur la sécurité. Outre qu’elle permet d’éviter des coûts directs et indirects, la sécurité constitue une école de management et contribue à valoriser l’image de l’entreprise. » Le président de DuPont France constate que plus le nombre des incidents baisse dans une organisation, plus la qualité, la productivité, l’efficacité, le moral des employés et la maîtrise des coûts s’améliorent. Pour lui « il y a là un levier de changement non négligeable. »
Mais chez DuPont, pas d’autonomie sans accompagnement des salariés et réflexion sur le sens du travail : « Nous faisons réfléchir les salariés sur la place du travail dans leur vie, à l’occasion d’ateliers de formation et de sensibilisation dans lesquels leur sont dispensées des notions de psychosociologie comme de macroéconomie, décrit François Papacatzis, responsable de la prévention des RPS et de la Qualité de vie au travail. « Nous y trouvons l’opportunité de rappeler quelques principes sur le travail : il apporte des revenus, un accès aux soins et à la retraite, il constitue un facteur de dignité, d’estime de soi et d’insertion sociale, l’entreprise n’a pas pour autant vocation à apporter le bonheur. Le travail est avant tout un contrat, avec des droits et des devoirs. »
Donner du sens, c’est aussi favoriser l’innovation. Chez Airbus à Saint-Nazaire, dans le cadre des mini-usines, deux ateliers spécifiquement dédiés à l’innovation en matière de poste de travail ont été créés. Giovanni Loiacono : « Deux ateliers du compagnon ont été ouverts, un pour la structure et un autre pour le système. Nos compagnons, techniciens et même nos managers, sous des règles légales d’hygiène, de sécurité et d’environnement, et sous réserve qu’ils ne fassent pas de pièces avionnables dans ces ateliers, peuvent venir concrétiser leurs idées. Les idées portent principalement sur des améliorations du poste de travail. » L’initiative est appréciée : « Au début du lancement de ces ateliers, en mai 2015, on comptait une dizaine d’éléments par mois réalisés ou proposés, aujourd’hui (à l’automne 2015), on en dénombre 50. Les salariés sont autonomes dans le cadre de ces ateliers, ils organisent la production avec leurs collègues pour pouvoir s’y rendre ; ils ne le font pas sur leur temps de pause ou libre. Tout le monde s’organise pour libérer du temps à la personne qui a une idée. Ils ont juste à demander les clés de l’atelier. »
Certaines de ces expérimentations éclairent les conditions de réalisation d’un « bon travail ». Un sujet crucial car le travail, et surtout les différentes manières de concevoir ce qu’est « un bon travail », sont des concepts à peu près absents des modèles de construction de la performance. Jean-Yves Bonnefond : « La qualité du travail recouvre certes la qualité du produit ou du service délivré, mais aussi celle du geste technique, du process et du collectif. Il est coûteux pour la santé d’être dans l’impossibilité de faire du bon travail, de n’avoir d’autre choix, à son corps défendant, que de contribuer à un travail que l’on juge inabouti. C’est encore plus douloureux lorsqu’on sait comment il faudrait procéder pour réaliser du bon travail, mais que l’on en est empêché. Cette amputation du pouvoir d’agir constitue, de notre point de vue, une définition de la souffrance. »
Or, explique-t-il, « nul consensus ne prévaut sur les critères de la qualité du travail, en particulier dans les organisations qui recouvrent une grande variété de fonctions et de postes, articulés dans des rapports hiérarchiques. Dans les organisations contemporaines, ce conflit de critères est massivement nié, et se trouve à la source de nombreuses atteintes à la santé et à la performance. Pour remédier à cette occultation, il est nécessaire de créer des instances et des processus susceptibles d’ouvrir le dialogue sur la qualité du travail, en s’appuyant sur les opérationnels concernés. »
4. S’appuyer sur une nécessaire maturité organisationnelle
Dans leur recherche d’une organisation favorisant ce que nous appelons la qualité de vie au travail, les responsables d’entreprises auditionnées s’accordent à pointer l’importance d’une forme de « maturité organisationnelle ». Martin Virot : « L’excellence en sécurité est le résultat d’un processus en plusieurs étapes qui permet de passer d’un mode réactif à un mode préventif. Au stade avancé de maturité organisationnelle, le niveau d’autonomie des individus est très élevé, ce qui permet de libérer les énergies. Atteindre la dernière étape est ardue : elle demande trois ans à un site. Elle implique que les individus quittent des facteurs de motivation exclusivement externes (conformité, sanctions), pour intégrer des facteurs internes d’engagement (compréhension, implication). » Même type d’analyse chez Michelin, Thales ou encore Airbus. Ariane Malbat, DRH du site de Saint-Nazaire : « Le premier élément essentiel pour le choix des équipes projets qui basculent dans la démarche “Libérer les énergies” est le niveau de maturité industrielle. Dans certains services ou secteurs, on est arrivé à un niveau de maturité, de confiance, de responsabilité des salariés sans qu’on ne décrète rien tel que la démarche a pu être lancée. On a trouvé dans ces zones un mode de fonctionnement qui s’est naturellement mis en place entre managers et salariés. Les KPI sont meilleurs, le niveau de performance industrielle supérieur, les indicateurs sociaux mieux tenus (absentéisme, turnover, accidents du travail…) et on observe que des process assez naturels se sont mis en place : petits déjeuners une fois par semaine entre cols blancs et cols bleus par exemple. »
5. Viser de meilleures relations professionnelles et sociales
Même si ce n’est pas un levier explicitement visé, les nouvelles organisations et modalités d’exercice du travail ont un impact direct sur les relations professionnelles. Chez MVV, les modalités du contrôle qualité ont été transformées : « Dans notre métier, la pratique est de contrôler en aval chaque mètre de tissu, explique Eric Néri. Non seulement l’exercice est fastidieux mais encore il intervient trop tard, une fois que le défaut s’est produit. Nous avons entrepris de réaliser ce contrôle au moment de la production. L’opérateur appose désormais une gommette de couleur sur le tissu pour signaler qu’il a rencontré des défauts ou des casses dans son rouleau. Cela facilite le travail pour l’équipe suivante, qui identifie immédiatement les éventuelles imperfections.»
Eric Néri explique que, en changeant le moment où le contrôle qualité intervient dans la production, « un< aspect essentiel de la relation au travail s’est trouvé modifié. Très souvent en effet, même dans un atelier commun, les opérateurs de la séquence d’entrée ignorent tout de la séquence de sortie. Chaque équipe livre son travail à la suivante, sans avoir de comptes à rendre. » Didier Wakin complète : « Traditionnellement, l’équipe du tricotage se considérait comme l’élite par rapport à celle de la rame, et le régleur n’avait pas pour habitude de se remettre en cause. Désormais, lui et les bonnetiers sont attachés à livrer à la rame un produit irréprochable.»
Deux entreprises nous ont dit viser explicitement le dialogue social dans la mise en place de leur démarche QVT : Valeo et surtout Renault. Avec des effets évidents. José Schoumaker, directeur des relations du travail Valeo Monde : « La négociation de l’accord mieux-être a modifié la qualité des relations avec les organisations syndicales : nous avons instauré un processus de négociation, permettant une co-construction d’accord, qui a été reconduite dans le cadre d’autres négociations. » Valeo, comme toutes les entreprises industrielles auditionnées, s’est donné du temps : la négociation initiée en 2010 s’est achevée par la signature d’un accord (unanime) en 2014.
Chez Renault, Jean Agulhon précise qu’Yves Clot a accepté de participer à une démarche dans ce cadre, à une condition expresse : travailler avec l’ensemble des organisations syndicales. « Le social était par ailleurs une dimension essentielle de la démarche, car l’observation du travail réel constituait certes une finalité, mais aussi un moyen de redynamiser le débat entre les organisations syndicales et la direction de l’entreprise. La matière première recueillie sur le terrain devait nourrir le dialogue social. Le laboratoire du Cnam postulait que si les parties s’obstinaient à si peu s’intéresser au travail même, elles risquaient de perdre leur crédibilité aux yeux des collaborateurs. La robustesse de la démocratie sociale était menacée. Pour éviter ce risque, l’enjeu était de réinvestir la question du travail réel et de la replacer au cœur du dialogue social. » Là aussi, le temps était une donnée importante : « Il a fallu un an de discussions entre les équipes d’Yves Clot, les fédérations et les délégués syndicaux centraux pour s’assurer que l’ensemble des parties étaient prêtes à se lancer dans l’expérimentation. Ensuite, l’usine a été choisie notamment en fonction de la perception qu’avaient les organisations syndicales de Renault de la qualité de leurs relais locaux.»
L’évaluation fait également partie du dialogue social « d’autant que les parties prenantes ne partagent pas la même vision de ce qu’est une expérimentation réussie. » Elles se sont accordées en tout cas sur un parti pris : rester discret. « Pendant près de deux ans et demi, nous avons décidé collectivement – organisations syndicales, direction et Cnam – de ne pas communiquer sur cette expérimentation. Elle n’est pas encore suffisamment robuste pour que nous en tirions des conclusions définitives et l’exposions publiquement. Le risque, à mettre le focus médiatique sur une relation entre organisations syndicales et direction, est de se voir plaquer une interprétation où chaque partie est renvoyée à sa caricature. » explique Jean Agulhon.
6. Communiquer et informer
Dans l’accompagnement de leurs nouvelles organisations, les entreprises auditionnées s’appuient sur des pratiques de communication issues du lean (réunion de cinq minutes, de quinze minutes en vigueur dans toutes les entreprises industrielles auditionnées) mais aussi sur des modalités spécifiques, notamment dans les entreprises du numérique. Ainsi le dispositif de BlaBlaCar est-il très structuré. Laure Wagner, à propos du BlaBlaTalk : « Tous les mercredis, dans notre auditorium, le responsable d’un pôle (marketing, product, tech, finance…) vient présenter le travail de l’équipe pendant trois quarts d’heure. Cette présentation a deux avantages. Elle permet de créer du respect entre nous car chacun peut comprendre à cette occasion le travail des autres équipes et mesurer leur investissement. Elle permet aussi de développer la confiance car chaque équipe présente ses succès, bien sûr, mais aussi ses échecs. Elle évite ainsi à d’autres de se heurter aux mêmes murs. Les pôles écrivent d’ailleurs des “playbook”, des sortes de livres de recette sur les projets – beaucoup sont récurrents – accessibles à tous. C’est une façon de mettre en action une de nos valeurs : “Fail. Learn. Succeed” (échouer, apprendre, réussir). Cette conférence se fait en anglais et est retransmise en vidéo pour nos équipes à l’étranger. Elle se conclut par un quart d’heure de questions. À la fin d’un cycle de huit semaines, les trois fondateurs de BlaBlaCar viennent expliquer où en est l’entreprise et ses projets. Les BlaBlaTalks renforcent ainsi la synchronisation et la mise en relations entre les équipes, cassent les silos, permettent d’obtenir de la reconnaissance. »
Silja Druo, RRH Captain Train : « Différents types de réunions ont été mis en place. D’une part, des réunions en one-to-one, un quart d’heure par semaine entre le salarié et son lead. Le créneau est figé. Cette réunion consiste à parler, pas forcément des tâches et des projets, mais du travail dans sa globalité. On demande comment ça va et on écoute la réponse : Est-ce que ça va au global ? Est-ce que ça va dans la société ? On cherche toutes les raisons qui peuvent bloquer les collaborateurs pour faire leur travail. Nous avons également instauré des entretiens individuels tous les 6 mois, qui consistent à des réflexions sur le moyen terme : qu’est-ce que j’ai fait ? Qu’est-ce que j’ai réussi à faire ? Qu’est-ce que j’ai envie de faire ? Où est-ce que j’ai envie d’aller ?… Au moment où les one-to- one ont été mis en place, tout le monde s’est demandé à quoi ça allait servir. On observe que chacun y a trouvé son compte aujourd’hui et que ça fonctionne. »
Chez Booking, Carlo Olejniczak, le directeur régional France-Espagne-Portugal, promeut une nouvelle forme de communication, moins top-down : « Quand je suis arrivé, j’ai beaucoup travaillé sur le management. En l’absence de directeur France, le management était auparavant plus éloigné, beaucoup de décisions venant directement d’Amsterdam, sans filtre, avec pour message “à exécuter”. Elles étaient alors parfois mal comprises par le middle-management et génératrices de conflits car mises en place avec assez peu de discussion. J’ai expliqué aux équipes que je n’attendais pas qu’elles exécutent les directives du siège, mais qu’elles les comprennent, les adaptent au marché et qu’elles les challengent lorsqu’elles ne paraissent pas adaptées. Si on veut doper la performance des équipes, il ne faut pas imposer un modèle ou une organisation mais essayer de comprendre ce que les collaborateurs sont prêts à donner, ce qu’ils ont envie de faire et comment cela se rapproche de vos objectifs en tant que manager ou directeur.
Aujourd’hui, on est sur un management de proximité. Nous organisons des sessions de questions-réponses en direct avec les équipes lorsqu’il y a des personnes du siège qui viennent. Des temps informels permettent aussi l’échange : pauses café, au cours desquelles il est important d’être accessible en tant que manager. Des temps formels sont également essentiels : les revues de performance trimestrielle et bi-annuelle. »
José Schoumaker, chez Valeo, explique que l’entreprise a voulu faire évoluer les espaces de dialogues du lean. « Il y a des espaces de discussion obligatoires, du fait des cinq axes. Dans ces moments on est moins centré sur l’objectif à réaliser que sur la perception qu’ont les collaborateurs des moyens dont ils disposent pour pouvoir atteindre les objectifs dans les délais et répondre aux clients. On se concentre plus aujourd’hui sur les personnes que sur les résultats. De plus en plus, on tient compte de la manière dont les collaborateurs ont atteint les résultats dans les systèmes d’évaluation. Un chef qui obtiendrait de bons résultats en mettant son personnel anormalement sous pression verrait ses résultats dégradés. »
7. Prendre au sérieux l’environnement physique
Une question centrale dans tout notre travail est celle de la différence entre qualité de vie au travail et qualité du travail. Même si l’environnement physique peut être relié directement au travail (la propreté d’un atelier par exemple), il a à voir aussi avec la qualité de vie. De même que la possibilité d’équilibrer vie privée et vie professionnelle a des conséquences sur la qualité du travail.
Cette approche est diversement partagée. Jean-Yves Bonnefond opère d’ailleurs une distinction nette entre QVT et qualité du travail : « La qualité du travail établit (donc) un lien entre la santé et la performance. Parler de qualité de vie au travail conduirait à s’écarter de ce qui constitue le cœur de la question : l’activité de travail elle-même. Il n’y a pas de bien-être possible au travail sans la possibilité d’effectuer correctement son travail. »
Cependant, l’ANI QVT faisant explicitement référence à l’environnement de travail, nous avons évoqué ce thème avec nos interlocuteurs. Et d’abord bien sûr avec Philippe Blandin qui en a fait son cœur de métier puisque son entreprise, Eneixia, conseille les entreprises en matière d’aménagement de locaux et d’environnement de travail. En effet souligne-t-il « Le management se heurte à des écueils lorsqu’il se met en quête de solutions pouvant marier bien-être et performance. Je les ai moi-même expérimentées lorsque, prenant la présidence d’un CE ou d’un CHSCT, les élus ont tenu à me faire découvrir les “coulisses” de l’usine qui m’étaient peu connues, non pas les machines ni les bureaux, mais les sanitaires et la cantine, relativement dégradés, ou les ateliers dont le sol était maculé d’huile de coupe. Ils demandaient des solutions. Pour ma part, je jugeais ces conditions de travail inacceptables dans une entreprise performante et dont les salariés étaient fiers des produits qu’ils produisaient. » Mais il se jugeait en même temps peu armé pour mener des actions efficaces dans un domaine finalement absent des livres de management. D’où la création de son entreprise de conseil. D’où aussi sa préoccupation de donner aux salariés un cadre de travail symbolique du respect avec lequel ils sont considérés.
C’est ce que veulent manifester les entreprises du numérique. Silja Druo, RRH Captain Train : « Le choix du quartier est délibéré (IXe arrondissement de Paris). Le déménagement est récent, le souhait depuis les débuts de Captain Train est d’être au cœur de Paris pour faciliter les déplacements des salariés. C’est un coût et un atout pour attirer les salariés d’être dans ce type de quartier. On a pris un grand immeuble (capacité de 200 collaborateurs environ) car on a d’importantes perspectives de croissance et de recrutement, donc on ne veut pas déménager tous les ans. Ce sera l’immeuble Captain Train. Dans nos métiers tout bouge tout le temps, il faut que certaines choses soient stables. » L’aménagement intérieur est lui aussi pensé : Captain Train ne veut pas d’open space « mais des box semi-fermés car on est sur du travail de réflexion. Deux-trois personnes par box. Le principe est donc d’avoir des espaces calmes pour le travail, puis sur chaque étage, des espaces pour que des réunions spontanées puissent avoir lieu, ou qui permettent de s’isoler, de se retrouver à deux ou plus et être libres de faire du bruit. On a une table de baby-foot, de ping-pong… qui servent lors des instants de pause. La cuisine est collective, avec de grandes tablées, ce qui nous permet de tous nous retrouver et de discuter avec des gens différents. Un architecte est en train de travailler sur l’ensemble des espaces, afin de proposer des améliorations en termes de confort de travail. » Chez Captain Train un poste de facility manager est même dédié au bien-être des équipes.
Ces notions d’environnement et de conditions de travail s’étendent aux crèches d’entreprises, conciergeries et autres cantines gratuites… Toutefois, il faut noter que ces leviers ont un impact sur l’engagement de continuité (la fidélité à l’entreprise) mais peu sur l’engagement vis-à-vis de l’entreprise ou du travail dans les travaux de recherche (voir p.73). Ce qui peut expliquer les résultats en demi-teinte de certaines enquêtes d’engagement.
8. Soutenir les managers
Le rôle des encadrants de proximité (chef d’équipe, responsable d’îlot, responsable de ligne de production…) est déterminant dans la mise en place de nouvelles formes d’organisation. C’est pourquoi le déploiement de la QVT nécessite un accompagnement spécifique de la ligne managériale (Richer, 2016).
Carlo Olejniczak, directeur régional France- Espagne-Portugal de Booking : « Je crois plus en l’autogestion. Le manager doit coacher, doit dire quand c’est bien, indiquer les axes de progression, tirer vers le haut ses collaborateurs mais surtout faire en sorte que les salariés aient envie de faire leur job. Quelles que soit les générations, le côté chef qui donne des ordres ne fonctionne pas. On dit que la nouvelle génération a des besoins et attentes spécifiques. Mais avec des gens qui ont 40-50 ans, c’est la même chose : l’excès de pouvoir ne fonctionne pas. Il faut plutôt convaincre qu’imposer. C’est important de faire en sorte que les gens se sentent responsabilisés. La contrainte va plutôt freiner la performance et l’engagement. Après, il y a des gens qui savent travailler sans aucun contrôle, d’autres sont moins à l’aise avec cela. Quoi qu’il en soit, le management hiérarchique uniquement descendant ne fonctionne pas. Je manage depuis 15 ans, je me retrouve à chaque fois avec des équipes jeunes : ils ne sont pas plus difficiles à gérer que des personnes plus expérimentées. Le fait d’être ouvert, d’être à l’écoute, de ne pas imposer mais plutôt de responsabiliser, ça marche avec tout le monde. Il faut juste reconnaître un peu plus l’expérience des plus âgés, mais en ce qui concerne la liberté, ça marche vraiment pour tous. »
Silja Druo, RRH Captain Train : « Pour tenir le cap (…), il est évident que la personnalité des dirigeants compte. Si toute l’organisation est faite pour donner de l’autonomie et de la liberté d’initiative et que les dirigeants sont sur un mode autoritaire avec leurs salariés, ça ne peut pas fonctionner. Les dirigeants doivent donner l’exemple et ce sont eux qui donnent le ton. Le recrutement suit alors cet état d’esprit et la croissance se fait autour de la volonté des dirigeants. »
Chez Renault, la question des managers s’est posée très vite. Deux constats émergent : la diversité des profils de managers et le manque de formation au dialogue avec les opérateurs. Jean Agulhon : « Le dispositif a transformé la façon dont les managers abordaient leur rôle de responsable hiérarchique. Certains chefs d’unité de travail ou d’atelier étaient déjà ouverts à des démarches participatives, quand d’autres s’attachaient surtout à étouffer les remontées du terrain. Le nouveau dispositif représente indéniablement une menace pour ceux qui n’envisagent leur fonction que sous l’angle du pouvoir, de l’autorité hiérarchique. Les grèves ont d’ailleurs éclaté là où les chefs d’unité n’avaient pas été suffisamment accompagnés dans l’évolution de leur rôle. » Jean-Yves Bonnefond : « Ceux qui sont issus de la ligne de fabrication et qui ont eu l’occasion d’occuper plusieurs postes dans l’usine considèrent généralement ce dispositif comme une aubaine, un moyen d’agir sur la performance et de développer un climat favorable dans leur équipe. En revanche, ceux qui ont eu un parcours plus réduit en usine se trouvent malmenés par l’expertise qui remonte de la ligne. Enfin, les jeunes ingénieurs chefs d’équipe ou d’atelier peuvent être très fortement déstabilisés par ce mode de dialogue qui ne leur a jamais été enseigné. C’est toutefois pour eux une formidable occasion de développer leur rapport au réel. Au-delà, certains cadres dirigeants manifestent des craintes vis-à-vis des remarques susceptibles d’émerger du terrain. Ils se contentaient jusque-là de “tenir” leurs équipes, en donnant le primat au rapport social plutôt qu’au rapport au réel, en occultant les problèmes. » Jean Agulhon conclut : « De façon générale, le dispositif est d’autant plus acceptable et supportable que chaque niveau hiérarchique est autorisé à tenir le même type de débat que les échelons inférieurs. En effet, chacun détient alors une marge de manœuvre. Aujourd’hui, l’un de nos enjeux majeurs est d’accompagner la ligne hiérarchique afin qu’elle se transforme aussi rapidement que le terrain l’exige. »
Dominique Foucard, Michelin, se préoccupe lui aussi d’un accompagnement tout au long de la ligne hiérarchique, après avoir constaté, au vu des enquêtes d’évaluation, que certains managers pouvaient se sentir en difficulté. Il évoque la question du sens : « Au niveau des responsables d’îlots, c’est le plus difficile. Certains n’avaient pas compris en profondeur le sens de MMW, et pratiquaient les outils sans en avoir compris l’intérêt. Finalement, avec les responsables d’îlots et les chefs d’équipe, nous avions beaucoup insisté sur la technique et les outils et pas suffisamment sur le “pourquoi”, sur le sens des choses. Ils avaient déjà eu un gros changement, passer en 2/4 ça veut dire ne plus être celui qui résout le problème, mais être celui qui aide les gens à résoudre eux-mêmes le problème, ce n’est pas évident pour tout le monde. Dans cette perspective, nous n’avons pas fait assez de coaching. Certains sont en difficulté car ils sont encore à mi-chemin entre les deux rôles. De plus, ils n’ont parfois pas pu basculer complètement dans leur nouveau rôle parce que leur hiérarchie elle-même n’a pas assez évolué, en restant sur un mode très “reporting” de la performance. Donc nous avons également un travail à réaliser au niveau de la hiérarchie, y compris jusque dans les “centraux” ».
Didier Wakin a proposé chez MVV, un « mode d’emploi » du dialogue pour les managers : « Souvent, les managers fuient le dialogue de peur de ne pas pouvoir répondre aux questions qui leur sont remontées. Pourtant, il est simple d’établir un dialogue. C’est cependant un travail de longue haleine qui demande un investissement et un intérêt pour autrui. » Sa méthode ? « Les opérateurs exprimaient le désir de participer à la résolution des problèmes. Or la plupart des responsables (chefs d’équipe et responsables d’atelier) n’étaient pas formés à dialoguer avec eux. Ils redoutaient parfois même une telle éventualité, n’en ayant pas le “mode d’emploi”. La démarche de résolution des problèmes a justement fourni ce dernier, sous la forme d’un questionnement en trois temps. (1) détecter : la responsabilité en incombe à l’opérateur. (2) corriger : l’opérateur met en place l’action correctrice s’il en est capable, et se fait sinon accompagner par son responsable. (3) éviter : il s’agit ici d’éliminer le problème à la source, tâche plus complexe. C’est bien l’opérateur qui est le bénéficiaire de ce processus, car il est aidé par son responsable à lever les freins qui l’empêchent d’atteindre ses objectifs. Il s’est donc agi de former les responsables à dialoguer avec leurs équipes, à doubler leur rôle hiérarchique traditionnel d’un accompagnement à la résolution de problèmes. »
Françoise Papacatzis, responsable de la QVT chez Dupont, s’est dotée aussi d’un modèle de régulation psychosociale à l’intention des managers : « Les salariés ont besoin de s’appuyer sur des repères pour être en mesure de surmonter les transformations permanentes de nos organisations. C’est à cette fin que j’ai créé ce modèle de régulation psychosociale, appelé Reciprox®. Ce modèle est construit sur trois grands piliers : le lien social (besoins identitaires d’intégration et d’existence), le cadre (besoin de règles), la reconnaissance (besoins de valorisation et d’individuation) qui répondent aux cinq besoins identitaires de tout individu. Bien qu’il repose sur des soubassements complexes, ce modèle présente le mérite de la simplicité pour les managers. Ces derniers sont invités à consolider ces trois piliers dans leur équipe pour améliorer la qualité de vie au travail et prévenir les risques psychosociaux. »
Cécile Roche, Lean & Agile director Thales constate : « Le lean transforme en effet le rôle des managers. Il faut les y accompagner. Naturellement, il est plus facile – mais inopérant – de leur inculquer la théorie du lean. Il est bien plus contraignant de les inviter à développer chez leurs collaborateurs deux aspects essentiels et indissociables : la connaissance de leur métier et la capacité à résoudre les problèmes collectivement. Cela présente en outre le mérite de remettre à l’honneur le métier, plutôt que de considérer que n’importe qui peut effectuer n’importe quelle tâche à condition de suivre de bons processus. » Pour elle si cette tâche est difficile pour certains managers, « d’autres s’y révèlent de façon inattendue. »
9. Apprécier les résultats, même émergents
Comme nous l’avons évoqué tout au long de cette note, la relation entre la QVT et la performance, notions elles-mêmes multi-dimensionnelles et multifactorielles, ne tient pas en un chiffre, qui serait aisément mesurable. C’est sur le terrain que nos interlocuteurs constatent néanmoins les résultats.
Martin Virot, PDG de DuPont France : « Les indicateurs d’engagement éclairent les raisons pour lesquelles certains ateliers fonctionnent mieux que d’autres en termes de sécurité, de propreté, de coûts et d’amélioration continue. L’enjeu est de faire gagner les organisations en maturité, c’est- à-dire de faire prendre conscience aux collaborateurs qu’ils sont les acteurs de leur propre performance. C’est un exercice de longue haleine, qui doit être régulièrement entretenu. » Même constat de la part de Dominique Foucard, directeur de la performance industrielle de Michelin : « Aujourd’hui, dans le groupe Michelin, nous avons 80 % d’OR2. Aucun site n’a perdu en performance pendant la période de mise en place. Et comme je l’ai déjà dit, notre performance industrielle s’est nettement améliorée ces dernières années. » Pour Giovanni Loiacono, chez Airbus Saint-Nazaire, la performance durable reste à démontrer : « La démarche a été lancée en 2014 et les changements organisationnels ont eu lieu il y a quelques mois à peine. Ces trois dernières années, nous avons connu des évolutions de la productivité à deux chiffres d’une année sur l’autre, la performance industrielle est là. Ce qu’il reste à démontrer avec cette nouvelle démarche c’est que cette performance peut être durable, ce que des entreprises comme Gore ou SEW ont démontré58. » Confirmation prudente chez Renault Flins : « Dans les entités de l’usine où l’expérimentation a le plus d’ancienneté, il semble que certains indicateurs sociaux classiques aient plutôt tendance à s’améliorer. Ce constat mérite toutefois la plus grande prudence. La corrélation entre la démarche et, par exemple, la baisse de l’absentéisme et de l’accidentabilité reste à prouver. Il n’en demeure pas moins qu’au département montage, qui mène l’expérimentation depuis une bonne année, l’accidentabilité a diminué de plus de moitié, et l’absentéisme s’améliore de façon spectaculaire. »
José Schoumaker (Valeo) va dans le même sens et souligne au passage la difficulté à quantifier les effets sur la performance : « Il est difficile d’établir une relation nette entre les actions engagées et les résultats de Valeo, compte tenu des changements rapides dans l’entreprise et de sa bonne santé économique ces cinq dernières années. Les performances économiques se sont améliorées de façon spectaculaire et il est évident que cela est dû en grande partie à d’autres variables. Quoi qu’il en soit, relation nette ou pas, on continue nos actions. »
Les cadres de DuPont et de Michelin confirment que ce n’est pas dans les indicateurs corporate que l’on peut trouver la preuve de l’efficacité de ces démarches, et expliquent pourquoi. Martin Virot : « Nous avons une bonne vision de l’engagement au niveau des sites. C’est moins facile au niveau global : des dynamiques externes ou dynamiques macro-économiques (restructurations, acquisitions, scissions…) viennent brouiller la donne. » Et Dominique Foucard de compléter : « Au départ de ce genre de démarche de responsabilisation, c’est certain, il y a un acte de foi dans le fait que la performance industrielle en sortira gagnante (et on le fait pour cela !). Il est difficile de démontrer le retour sur investissement étape par étape. Il ne faut donc pas réagir à chaque fois en termes de rendement immédiat (par exemple : combien de production vais-je perdre si j’arrête les machines une heure par mois pour une réunion d’îlot ?). Si les managers ne sont pas convaincus que donner une heure à l’îlot pour organiser son travail est forcément un bon investissement, il est clair qu’il vaut mieux ne pas commencer. Cette heure, c’est un levier de motivation des salariés pendant toutes les autres heures de production, ce qui in fine va améliorer la performance. »
Autre point d’attention : les enquêtes de satisfaction montrent que l’amélioration de la qualité de vie au travail est un projet au long cours. Ariane Malbat, DRH Airbus Group du site de Saint-Nazaire : « Au mois de novembre 2014, on a reçu la Gallup survey portant sur la satisfaction du personnel et son engagement. On a été globalement déçus car on observe une stagnation, même dans des secteurs mûrs du point de vue industriel, entre les chiffres de l’enquête précédente, trois ans plus tôt, et celle de 2014, alors même qu’on a mis en place des actions : séminaires, petits déjeuners, QVT, crèche d’entreprise… »
De son côté, José Schoumaker, constate dans les enquêtes de satisfaction au travail et d’engagement que mène l’entreprise que « presque tous les sites bien classés sont des sites de structure : headquarters et centres de recherche, sans doute parce que le travail effectué n’est pas lié à une chaîne de fabrication, qu’il n’est pas cadencé par la machine avec des procédures très précises. Bien entendu, ces sites de structure ont aussi des délais et des procédures à respecter mais on constate plus de latitude décisionnelle dans l’organisation du travail. »
La démarche peut même provoquer de la méfiance avant de susciter l’adhésion. Jean Agulhon Renault : « Certains opérateurs ont d’abord refusé d’entrer dans la démarche, n’y voyant qu’une tentative de l’entreprise pour s’offrir une bonne conscience. Étonnamment, l’une de ces personnes est finalement devenue la référente des référents. Elle est notamment chargée de la formation et de l’accompagnement des référents nouvellement élus. Il semble donc que le sentiment d’une parole inutile s’estompe. Les effets de désengagement ou d’altération de la santé qui en découlaient hier diminuent. Dans les périmètres concernés par l’expérimentation, les propos fatalistes se font nettement moins entendre, si ce n’est aucunement. Pour autant, le degré d’exigence induit par la démarche vis-à-vis des opérateurs a conduit certains secteurs, dans un premier temps, à se mettre davantage en grève qu’auparavant. La grève est finalement, ici, la manifestation de l’utilité du système. » Et d’ajouter : « dans les ateliers de Flins où a été menée l’expérimentation, le corps social se montre également plus disposé à effectuer volontairement des heures supplémentaires, pour faire face à des volumes imprévus ou rattraper le retard d’un programme de fabrication par exemple, comme si le partage de l’intérêt général avait progressé. »
Conclusion
Cette dernière remarque de Jean Agulhon pourrait être interprétée comme une preuve d’instrumentalisation : l’expérimentation menée à Flins aurait contribué à rendre les ouvriers consentants à leur propre exploitation… C’est une interprétation possible. Toute expérimentation comporte en effet des risques. Trop d’heures supplémentaires peuvent dégrader la santé au travail, mais comme l’exprime Jean-Yves Bonnefond, la santé se fortifie aussi dans la possibilité de faire du « bon travail ». Développer le pouvoir d’agir et d’expression sur leur travail des salariés, c’est aussi renforcer leur capacité et leur légitimité à faire valoir leur point de vue, y compris dans les intérêts contradictoires qui s’expriment au sein de l’entreprise.
Le chapitre suivant explique justement à quelles conditions l’autonomie au travail et la responsabilisation décrites dans nos auditions s’inscrivent dans une démarche de qualité de vie au travail. Il s’agit notamment de comprendre comment se construisent des coopérations novatrices et efficaces autour du travail réel et quel type d’organisation les favorisent.
- 56. L’entreprise a été rachetée en mars 2016 par son concurrent britannique Trainline.
- 57. Dans le cadre du programme lean lancé par l’Union des Industries textiles et la Direction générale des entreprises du ministère de l’Industrie à destination de 30 entreprises du textile dont Mailles Verte des Vosges. La question des conditions de travail n’entrait pas dans les préoccupations initiales du programme.
- 58. Giovanni Loiacono fait ici référence à deux entreprises dites « libérées » : Gore, la société américaine à l’origine du célèbre Gore-Tex et Sew, filiale française d’une PME industrielle allemande, leader européen des moteurs électriques.
QVT et performance dans les organisations du travail « émergentes »
Parmi la multiplicité de formes organisationnelles émergentes, nous avons choisi de mettre l’accent sur celles qui ont le plus sensiblement occupé le débat public ces dernières années : le lean management, l’entreprise libérée, l’entreprise responsable, les organisations responsabilisantes. Les témoignages de nos différents interlocuteurs viennent éclairer ce débat. Ces formes organisationnelles ont un point commun : elles affichent toutes une volonté forte de favoriser l’autonomie au travail.
1. Lean management
Né dans les années 1980 à partir du Toyota Production System (TPS), le lean management n’est pas à proprement parler une forme organisationnelle émergente59. Le terme lean management a été créé en 1990 par un groupe de chercheurs du MIT, dont James P. Womack, directeur de la recherche du International Motor Vehicle Program (IMVP) au Massachusetts Institute of Technology (MIT) à Cambridge, qui a par la suite fondé et présidé le Lean Enterprise Institute. Cependant, les différentes mues qu’il a connues à la faveur de son extension de l’industrie vers les services justifient de s’interroger à nouveau sur ses liens avec la QVT.
Les liens entre lean manufacturing et QVT sont évidents. Nous avons d’ailleurs consacré une audition complète à ce sujet. Tous nos interlocuteurs ont souligné les similitudes du lean avec la démarche d’amélioration de la qualité de vie au travail, tout en pointant et en critiquant les nombreux cas où le lean avait été dévoyé. Ceux-ci ont laissé de telles traces au sein des entreprises et du corps social que le mot lean est encore très négativement connoté.
A. Des origines du lean au lean dévoyé
Les objectifs initiaux du lean étaient centrés sur la performance : éliminer les gaspillages de diverses natures, maîtriser la variabilité de la demande, supprimer la surcharge des employés et des équipements, tout en recherchant la qualité. Mais il s’agissait aussi de mieux répondre aux besoins des clients avec moins d’efforts, de stress, de charge de travail et de ressources. Ce modèle d’organisation accordait une place centrale à l’implication directe des opérateurs et à la dimension collective de l’activité. Trente-cinq ans plus tard, la mise en place du lean a souvent été un échec : retour de la pression sur les employés, montée du stress et des TMS et surtout faible autonomie…
Selon les cas, les démarches QVT reviennent donc à compléter les démarches lean ou, inversement, à remettre en cause la manière dont elles ont été mises en œuvre.
Jean Agulhon, ancien DRH France de Renault : « Quand le laboratoire du Cnam nous a présenté le processus dialogique, nous pensions l’appliquer déjà depuis trente ans via les UET60 et les principes de qualité totale et de lean. En réalité, nous parlions davantage du lean que nous ne le mettions en œuvre. Le CNAM, au contraire, faisait du lean sans le citer. »
Pour lui « le déploiement mécaniste du lean qui a prévalu jusqu’à présent atteint ses limites en termes de gains de productivité. Toutes les entreprises en font le constat. À ne pas accompagner le lean par une réflexion approfondie sur l’organisation, on se prive du potentiel de productivité et de compétitivité qu’ont su maintenir les Japonais.
Dans le management Hoshin par déploie ment d’objectifs tel qu’il est pratiqué en France, le manager se contente d’imposer un objectif à un collaborateur qui ne bronche pas. Au Japon, l’objectif est un bien commun entre le supérieur hiérarchique et son subordonné. Il engage autant l’un que l’autre, dans les résultats à atteindre mais aussi dans les moyens mis en œuvre pour y parvenir. Il fait l’objet de discussions régulières au cours de l’année. »
Cécile Roche61, directrice Lean chez Thales explique ce qui à son avis, a conduit les entreprises françaises à dévier des principes originels du lean : « En France, le lean est souvent appréhendé sous l’angle des process et de l’organisation. Il est perçu comme un facteur de rationalisation, “d’amaigrissement”, d’amélioration continue, d’efficience voire de normalisation. C’est oublier que l’objectif premier du lean est de satisfaire totalement les clients, et par conséquent de les fidéliser, et qu’il est avant tout une démarche de croissance plutôt que de réduction des coûts.
Une entreprise ne peut satisfaire un client que si ses salariés sont eux-mêmes satisfaits. Le y contribue en répondant à l’aspiration des collaborateurs à bien faire leur travail. Il leur en offre les moyens. En découlent deux principes managériaux du : le respect et le .(…) Le respect implique de considérer que les salariés sont les mieux placés pour améliorer leur propre travail, bien davantage que des experts qui viendraient leur dicter la marche à suivre. Aussi faut-il se donner les moyens d’écouter les collaborateurs.
Rien n’est plus éprouvant pour un salarié que de ne pas savoir s’il effectue ou non du bon travail. L’un des principes du est de permettre à chaque employé de savoir si ce qu’il réalise est conforme, et ce qu’il devra faire ensuite. Plus une entreprise se rap proche de cet objectif, plus elle accroît sa productivité. (…) Au total, le ne couvre pas tout le spectre de la qualité de vie au travail. Pour autant, la qualité de vie au travail est constitutive du . Les salariés sont en effet invités à s’impliquer dans l’amélioration de leur travail au quotidien, sont aidés à bien faire du premier coup, se voient accorder de l’autonomie, ont accès à des espaces de discussion, sont écoutés, participent à l’élaboration des standards, sont systématiquement associés au réaménagement de leur poste de travail. Il peut être difficile pour certains collaborateurs de quitter un modèle d’exécution. Je constate toutefois sur le terrain que les équipes y adhèrent très vite. »
B. Les collaborateurs experts de l’activité
Pour Philippe Lorino, professeur à l’ESSEC en contrôle de gestion et en théorie des organisations, avec le lean, il s’agit bien de faire plus avec moins, mais pas dans le sens productiviste (obtenir plus d’output avec moins d’input, c’est-à-dire la productivité directe). Au contraire, il s’agit de mieux répondre aux besoins des clients avec moins d’efforts. Cette approche qui fait passer l’efficacité (« do the right things ») avant l’efficience (« do things right ») est favorable à la QVT et à l’implication directe des opérateurs, considérés comme des « penseurs » de l’activité. Elle ne masque pas la dimension collective de l’activité (groupes plurifonctionnels) et favorise un système d’apprentissage basé sur l’expérience. Enfin, elle ménage un certain « mou organisationnel » (« slack »)62, qui concrétise l’autonomie au travail. Ohno, le concepteur du Toyota Production System, indique qu’au-dessus de 80 % de taux moyen d’utilisation des capacités, le moindre aléa conduit à des comportements chaotiques.
Le slack a deux finalités : répondre aux aléas et ménager les capacités réflexives des opérateurs. L’implémentation d’aujourd’hui fait malheureusement souvent l’impasse sur cette approche : elle suit un modèle d’économie de la ressource dans lequel les acteurs de terrains sont vus comme des porteurs de coûts plutôt que comme experts de l’activité. Les gaspillages réapparaissent très vite, la capacité d’apprentissage collectif ou d’innovation se dilue, les menaces pour l’intégrité physique et psychologique des acteurs se manifestent.
La grande erreur est donc de penser le slack comme un gaspillage, du « temps mort », alors qu’il s’agit d’une ressource de l’autonomie au travail, donc du temps vivant. Cette confusion est défavorable à la performance car elle nie le potentiel de création de valeur du slack. Une recherche intéressante publiée par Zeynep Tom (2014), professeur à la célèbre MIT Sloan School of Management le montre : elle compare la rentabilité d’entreprises du secteur de la distribution entre celles qui se placent en overstaffing (recrutement au-delà des stricts besoins afin de donner du slack aux employés) et celles qui « staffent » au plus juste. Elle constate que les premières sont de loin les plus rentables, « du fait de la possibilité donnée aux employés de penser, de mieux servir les clients, d’optimiser le rangement des rayons, de se former mutuellement et de s’entraider ». Les temps morts ne le sont pas toujours pour la création de valeur…63
« Le Lean organise des espaces de discussion cadrés mais ignore trop les échanges informels (les moments de pause collectifs, les discussions à table le midi…) selon Thierry Bertrand, professeur à l’École des mines de Nantes et coauteur en 2010, avec Arnaud Stimec (université de Reims), d’une étude comparant trois sites industriels se revendiquant du lean management.
Il confirme que les temps morts ne sont pas du temps perdu : « ils constituent au contraire des facteurs modérateurs pour limiter le stress, ils apportent de la régulation aux travers organisationnels », affirmait-il64
Ces deux auteurs ont identifié deux autres critères pour que le lean ne se développe pas au détriment des conditions de travail : mettre les chefs d’équipe (ou managers de proximité) en capacité d’assumer leur rôle et laisser une latitude décisionnelle aux opérateurs. Cela confirme l’importance de l’autonomie au travail.
C. Lean imposé versus lean ascendant
Cette « chasse aux temps morts » n’est pas sans effets néfastes en termes de santé et sécurité au travail, à tel point que l’Agence européenne pour la santé et la sécurité au travail (Eu-Osha) a publié en 2010 un rapport alertant sur les dangers d’une mauvaise mise en œuvre du lean. Elle tente de trouver une voie de conciliation entre « le lean qui cherche à minimiser le gaspillage et la santé/sécurité au travail qui tente de minimiser le risque » et pointe le fait que tous deux partagent les mêmes challenges : « parvenir à prendre en compte la variabilité des productions, l’ajustement des ressources, la gestion des aléas ».
Pour Dominique Foucard, directeur de la performance industrielle de Michelin : « le lean manufacturing mal compris peut être très mal vécu. Prenons l’exemple du tableau heure par heure. Durant ses 8 heures de travail en équipe, l’opérateur sait qu’il doit faire en moyenne tant de production par heure, et renseigne le tableau heure par heure. L’objectif est de lever les obstacles à la production et de prendre les décisions au bon moment pour assurer la bonne marche de l’atelier. Mais dans une usine mal préparée, ce tableau peut être vécu comme un “flicage” : on passe son temps à expliquer pourquoi on n’a pas fait, au lieu de trouver les solutions. Dans une usine mûre, le tableau heure par heure, c’est ce qui permet de se dire entre collègues : “nous avons un problème”, pour ensuite se mettre d’accord en équipe sur la compréhension du problème et définir ensemble la solution. L’esprit du lean c’est cela. » Cécile Roche, Thales, confirme : « Entre aider les équipes et les contrôler, la frontière est ténue. Dans le lean, les outils visuels ne sont pas des dispositifs de contrôle. Ils permettent à l’équipe de savoir si son travail est conforme et ouvrent un espace de discussion pour traiter les non-conformités. En d’autres termes, le lean rapproche les managers des problèmes des équipes, sans demander aux équipes d’endosser les problèmes des managers. »
Ariane Malbat, DRH d’Airbus Saint-Nazaire compare le lean et la démarche expérimentée sur son site : « La démarche que l’on vit n’est pas opposée au lean, au contraire, c’est une continuité. On observe que les leaders sur la libération des énergies et sur les mini-usines sont les anciens du lean. Dans cette nouvelle démarche, on essaie toujours de standardiser, d’améliorer le travail mais l’idée est que ce ne sont plus les experts qui proposent mais les salariés eux-mêmes, et ces mêmes salariés vont chercher les experts quand ils en ressentent le besoin. Les besoins d’innovation et d’aménagement viennent des salariés, c’est le prérequis dans la démarche de libération des énergies.
Par exemple, sur l’aménagement des “postes doux” 65 , on a pu observer l’intérêt de solutions imaginées par les salariés eux-mêmes. Tout est parti d’une salariée enceinte qui n’allait plus pouvoir effectuer certaines tâches. Ils ont imaginé un poste doux de façon “artisanale”, certes, et ils ont recréé ce qu’on avait créé ailleurs avec des experts mais très clairement, ils ont eu des résultats extraordinaires. Ils ont fait revenir des salariés en restriction, les salariés en arrêts longs sont revenus également. L’absentéisme a été divisé par deux. Le cherchait certainement le mieux, cette démarche ne cherche pas le mieux mais est portée par les salariés. »
C’est aussi le sens des recommandations de l’Anact (2015), à la recherche de la conciliation entre le lean et la QVT, qui s’articulent autour de trois champs de progrès : impliquer les salariés dans la conception du travail, soutenir et reconnaître les régulations autonomes (individuelles et collectives), favoriser un management du travail.66
2. Entreprise libérée
Le modèle de « l’entreprise libérée » (EL) bénéficie d’un fort engouement dans notre pays. Il est d’ailleurs efficacement promu, à tel point que l’expression « entreprise libérée » a été déposée auprès de l’INPI.67 Il faut nous poser la question de la nature, de l’étendue et du caractère émancipateur de cette « libération », ainsi que de ses effets sur la QVT et la performance.
A. Un modèle hérité de plusieurs traditions managériales
Le concept de l’entreprise libérée est difficile à appréhender car il n’est pas figé. Des entreprises de culture et de formes organisationnelles très différentes s’y réfèrent, tout en poursuivant des objectifs eux aussi différents… C’est pourquoi il faut revenir à la source, celle du livre écrit en 2009 par Isaac Getz et Brian M. Carney, Freedom Inc (Liberté & Cie pour la traduction française). On y trouve les ingrédients de la « libération »68 :
- le rôle déterminant de l’écoute, notamment de la part des dirigeants,
- le renoncement par ces mêmes dirigeants aux symboles, marques distinctives et autres privilèges,
- le travail sur la vision et le projet de l’entreprise, qui doivent être appropriés par les collaborateurs,
- l’allégement des contrôles, des normes de comportement, du prescrit, au profit de l’autonomie et de la responsabilisation des opérateurs,
- l’arrêt des stratégies de motivation (primes variables, etc.) au profit de la mise à disposition d’un environnement de travail favorable.
Si l’on s’arrête à ces ingrédients, le concept n’a rien de nouveau puisqu’on les trouve déjà chez Mary Parker Follett (1868-1933) et Douglas McGregor (1906-1964). Depuis les années 1960, tel ou tel de ces ingrédients ressurgit à la faveur d’une expérimentation, d’une publication d’un chercheur, d’une nouvelle mode managériale qui accompagne la transformation des entreprises69 : de la sociocratie, au digital leadership, sans oublier l’holacratie, les organisations « opales », l’organisation holomorphe, la subsidiarité, la délégation, la pyramide inversée, l’intrapreneuriat, le management participatif, les expériences autogestionnaires et leur version assagie, les coopératives de production (SCOP), les organisations du travail mises en place par Volvo à Kalmar en 1973 et à Uddevalla en 1986, les groupes semi-autonomes inspirées de l’école socio-technique du Tavistock Institute (voir p.27) et mises en œuvre, entre autres, par les entreprises suédoises Volvo et Saab ou encore le Toyota Production System, le lean management ou les unités élémentaires de travail chez Renault.
Tom Peters a remis l’EL au goût du jour en 1988 et complété son analyse dans son ouvrage paru en 1993 « L’entreprise libérée : libération management » (Dunod), traduction de son ouvrage publié aux États-Unis l’année précédente sous le titre Liberation Management (Ballantine Books). Le sous-titre de l’édition américaine portait la mention Necessary disorganization for the nanosecond nineties, ce qui reflète bien le contenu très orienté sur l’innovation. C’est là une différence avec l’approche « française » (Isaac Getz et Brian M. Carney), plus orientée sur l’organisation, plus introvertie.
Ces ingrédients, de surcroît, sont hybridés par l’intrusion du numérique, qui apporte ses propres innovations organisationnelles comme l’entreprise « agile » ou l’open lab innovation. Enfin, comme l’explique Jean-Marie Bergère (2016) « Les entreprises libérées ont une particularité : elles s’intéressent d’abord aux salariés et à leur travail. » ce qui les « (…) rapproche d’autres mouvements, les Sociétés à objet social étendu (SOSE), les Benefits Corporations (B Corp, dont Nature et Découvertes, Ben & Jerry’s ou encore Patagonia), les Flexible Purpose Corporation (FPC), les entreprises qui se revendiquent de l’Économie sociale et solidaire (ESS), les Sociétés coopératives d’intérêt collectif (SCIC) qui, chacune à sa manière, contestent la réduction des entreprises à leurs objectifs utilitaires et financiers ».
Parmi les entreprises emblématiques de l’EL, beaucoup se réclament aussi de l’holacratie. Ce modèle de management a été théorisé en 2015 par Brian Robertson, fondateur de la start-up Ternary Software aux États-Unis.70 Il stipule que les dirigeants et managers doivent disparaitre au profit d’une nouvelle organisation. Les « postes » sont remplacés par des « rôles » et de nombreuses structures nouvelles au sein de l’entreprise, qui permettent de « distribuer » le management sur une population large.
B. Les apports de l’EL
Dans bien des cas, les effets de cette « libération » sur la QVT et sur la performance sont positifs (voir encadré 15 p.128). En effet, l’EL fait appel au triptyque autonomie / confiance / responsabilité, qui fait levier sur les besoins de sens, de contribution et de reconnaissance. Dans certaines organisations, ce triptyque devient la pierre angulaire de l’organisation du travail.
L’EL apporte une réponse à la contestation montante du principe de subordination, qui voudrait que nous abdiquions notre liberté en franchissant le seuil de l’entreprise. Ce principe de subordination connaît aussi des excès, efficacement combattus par une organisation suivant les principes de l’EL : bureaucratie, soumission aux « petits chefs », excès d’autoritarisme du management « à la française » (trop fondé sur la hiérarchie plutôt que sur la recherche de l’adhésion), contrôles tatillons, enfermement dans des tâches trop restreintes et sous-qualifiées par rapport au potentiel du salarié, absence de sollicitation de la créativité et des facultés de proposition, etc.
En sollicitant les capacités d’autonomie des opérateurs, en leur rendant du pouvoir d’agir, l’EL revalorise le travail humain et le remet sur le devant de la scène, ce qui constitue une évolution très positive après des décennies de négation du travail (Gomez, 2013). C’est ce qu’exprimait Tom Thomison, co-fondateur de l’holacratie, avec sa célèbre formule : « rien ne se met en travers du travail »71, que nous pourrions, dans une perspective plus française, rapprocher des travaux d’Yves Clot sur « le travail empêché ». Dans sa première prise de position officielle sur l’EL, l’Anact (2015) attirait l’attention sur des excès potentiels mais soulignait la possible solution mutuellement gagnante entre QVT et performance : « Si le sujet suscite autant d’intérêt, c’est qu’il semble répondre aux aspirations des salariés et aux préoccupations des dirigeants d’entreprise. Le stress et le désengagement engendrent, en effet, un coût non négligeable. Dans l’entreprise libérée, le salarié, responsabilisé, retrouve du sens et de la motivation pour son travail. Gérant son activité et régulant lui-même les dysfonctionnements, il serait moins soumis au stress. »
En allant plus loin, l’EL développe la polyvalence et encourage les opérateurs à « sortir de leur poste », ce qui contribue à lutter contre la parcellisation du travail et rend au travailleur la plénitude de son activité (empowerment). « Selon eux, si les conditions sont réunies pour cela, l’homme cherchera volontiers à accomplir au mieux son travail. Cela va à l’encontre de la vision qui considère que le travail est une contrainte, ce qui conduit l’organisation à mettre en place des systèmes visant à s’assurer que ses salariés ne se défaussent pas de leurs engagements. Pour ces chercheurs, plus on fait confiance aux salariés, plus on leur laisse la liberté de s’organiser et plus ils s’efforceront d’assumer au mieux leurs responsabilités » 72
Un autre aspect positif de l’EL est l’accent mis sur la qualité de la relation avec le client et avec le salarié. Dans leur livre, Getz et M. Carney citent Stan Richards, PDG de Richards Group, une agence de publicité américaine : « des salariés qui auront le sentiment d’être traités correctement auront tendance, à leur tour, à traiter correctement leurs collègues et leurs clients. » Cette mise en équivalence de la relation employé avec la relation client est une avancée à mettre au crédit de l’EL. Aujourd’hui, les collaborateurs veulent être traités avec l’attention prêtée aux clients ; les clients veulent être traités avec la proximité dont bénéficient les collaborateurs. Un signal avant-coureur de cette évolution est la montée de la thématique de la « symétrie des attentions », popularisée par le livre à succès de Vineet Nayar (2010).
Encadré 15. Les aspects positifs de l’entreprise libérée en matière de QVT
Au fil de la lecture de l’ouvrage publié en 2009 par Isaac Getz et Brian M. Carney, Freedom Inc., on relève les points ci-après :
- Partage de la vision et de la stratégie par les dirigeants.
- Dépassement des habitudes de travailler en silos pour ouvrir des canaux de communication et de coopération transversaux.
- Décentralisation des prises de décision au plus près du terrain, développement de la délégation, renforcement du pouvoir d’agir des opérateurs, passage d’un management basé sur l’autorité à l’adhésion, allègement des contrôles compensé par la confiance mutuelle.
- Privilégier la motivation intrinsèque (lorsqu’une personne trouve son propre plaisir dans son travail) plutôt que la motivation extrinsèque (liée aux notions de récompenses et de punition).
- Processus de sollicitation et de reconnaissance des idées (intelligence collective) et des innovations (innovation participative) ; droit à l’erreur.
- Suppression des symboles de distinction des dirigeants (attributs symboliques de pouvoir) et dépassement de l’égo au profit d’une prise de décision informée.
- Importance dévolue au service client et à la valeur ajoutée perçue par le client.
- Réévaluation du travail, de la coopération et reconnaissance ; création d’espaces de discussion sur le travail.
C. Les limites de l’EL
De façon similaire à ce que nous avons observé pour le lean management, bon nombre de démarches de « libération » ont conduit à des excès et reposent sur une caricature de l’approche de responsabilisation. Il s’agit avant tout de réduire de façon drastique le management intermédiaire et les fonctions support. Les résultats peuvent alors se situer à l’inverse de ceux escomptés car la diminution des moyens de régulation et d’assistance à la disposition des collaborateurs est une cause majeure de stress. Ainsi par exemple, il est rare que l’autonomie puisse s’acquérir par les opérateurs… en autonomie. Elle est le fruit d’un apprentissage et le rôle du management de proximité est essentiel.
La démarche d’empowerment (responsabilisation et autonomie) des opérateurs suppose une forte maturité professionnelle et une polyvalence développée. Ceci requiert une ingénierie importante (organisation de la rotation des postes, plan de formation, etc.), souvent sous-estimée. C’est pourquoi Gilles Verrier (2016a), auteur de Faut-il libérer l’entreprise ? Confiance, responsabilité et autonomie au travail, précise : « Nous partageons la nécessité pour l’entreprise de se réinventer en promouvant liberté et responsabilité tout en donnant du sens. Mais imaginer que tout part du haut, avec “un leader libérateur” qui supprimerait les corps intermédiaires que sont les managers et les fonctions support, ne nous paraît pas une réponse d’avenir. De même, promouvoir la liberté et la responsabilité des collaborateurs sans travailler leur montée en compétences et leurs modes d’interaction nous semble illusoire. »73
Charles-Henri Besseyre des Horts, Professeur Émérite à HEC Paris, exhorte les dirigeants et les DRH à « sérieusement s’interroger avant de décider d’embarquer leur entreprise dans une démarche de libération » d’autant que « si ce concept, déjà ancien a été récemment remis à l’honneur (…), c’est qu’il porte en lui l’espoir d’une forme nouvelle d’entreprise répondant mieux aux aspirations des collaborateurs d’aujourd’hui, notamment ceux issus de la génération Y et bientôt Z. »74 L’EL est ainsi vue par bon nombre d’entreprises comme un moyen d’assurer la cohésion intergénérationnelle en leur sein, face aux interrogations posée par une génération nouvelle que les anciens peinent parfois à comprendre.
Le management intermédiaire, souvent cible directe de l’EL, joue un rôle majeur en matière de QVT, comme l’a très bien démontré le rapport Pénicaud-Lachmann-Larose (2010). Dans son analyse critique des propositions présentées par ce rapport, trois ans après sa publication, Terra Nova (2013) pointait le décalage entre leur excellent accueil aussi bien par les DRH que par les représentants du personnel et les profondes lacunes dans leur mise en œuvre.
Une autre limite de l’EL est de centrer la démarche sur l’initiative personnelle du dirigeant qui porte la dynamique, qui l’incarne à lui seul. Cela rend la méthode très attractive et valorisante auprès des dirigeants, notamment ceux qui disposent du charisme nécessaire, mais cela fragilise sa pérennité. C’est ainsi que la simple succession du dirigeant peut remettre en cause le modèle, trop dépendant d’un individu – c’est ce qui s’est passé par exemple chez Harley Davidson.75 Cela risque également de démotiver les autres dirigeants, qui peuvent légitimement ne pas se sentir acteurs de la transformation.
Plus encore, le stade ultime de l’EL semble se définir dans un modèle de relation directe entre le dirigeant, leader charismatique et libérateur, et les salariés, en court-circuitant les « corps intermédiaires » qui sont aussi des facteurs de régulation : syndicats, managers de proximité, DRH et autres fonctions support. La conséquence peut se révéler dramatique en termes de QVT avec à la fois un surinvestissement de la part des collaborateurs responsabilisés, un phénomène d’isolement et une diminution des possibilités de trouver du soutien.
Derrière le but louable de solliciter la motivation et l’engagement les plus forts possible de la part des salariés, se cache le risque de surinvestissement au travail. Celui-ci apparait clairement, par exemple, lorsqu’Isaac Getz nous dit dans Focus RH (2016): « Dans un tel mode de fonctionnement, direction, management et contrôle laissent la place à la vision, l’auto-direction et l’auto-contrôle. Cela conduit à un engagement et une performance bien plus élevés. Les salariés sont engagés parce que leurs besoins psychologiques sont satisfaits. L’équilibre vie privée-vie professionnelle ne se pose pas dans ce type d’entreprise, car le salarié ne voit pas le travail comme un lieu de contrainte mais d’épanouissement. »76
La forte déstabilisation de la chaîne managériale et des fonctions support peut provoquer des pertes de repères (savoir qui est responsable de quoi, à qui s’adresser pour résoudre tel problème, etc.) mais aussi une multiplication des injonctions paradoxales et une montée des risques psychosociaux. Si l’on ajoute la fragilisation des processus d’arbitrage, cet environnement de travail est propice à la montée de l’anxiété et de la frustration. Les collaborateurs peuvent être fortement perturbés, ce qui peut se traduire par un turnover important et non souhaité. Bon nombre de collaborateurs, parfois parmi les plus engagés dans l’entreprise, peuvent ne pas y trouver leur place et décider de quitter l’entreprise (voir encadré 16 p.132).
Un collectif de chercheurs, consultants et praticiens (MECREANTS, 2016) a partagé et formalisé les critiques vis-à-vis du dévoiement de l’entreprise libérée dans un livre blanc en accès libre.
Autre point faible du modèle de l’EL : il ignore totalement les espaces et les collectifs assurant la régulation dans l’entreprise. Jean-Yves Bonnefond pointe dans la revue des conditions de travail n°3 de l’Anact (2015) la conception trop étroite de l’autonomie vue par l’EL : « On trouve l’appel à un “leadership libérateur” pour supprimer les entraves organisationnelles qui limitent l’initiative des opérationnels (Getz, 2012). Ici, l’argumentation est basée sur des exemples hétérogènes d’entreprises présentées comme “libérées” par un leader pour des salariés gagnant en autonomie. Cependant, cette question est complexe et souvent confondue avec la situation où les salariés ont en fait des possibilités d’opter entre des alternatives limitées, dans un cadre de dépendance prédéfini. L’autonomie effective est d’un autre ordre, elle se joue dans la production de règles, c’est-à-dire, paradoxalement, dans le développement de l’hétéronomie et, par conséquent, de la prescription. » Gilles Verrier (2016b) confirme les dangers de ce manque de régulation : « si l’initiative de chacun est libérée et que l’organisation n’est plus régulée par des processus et par les managers, comment vont se passer les articulations entre les collaborateurs ? Le corps social d’une entreprise, ce n’est pas seulement une collection d’individus, mais un ensemble de relations organisées et d’ajustements entre les individus et entre les groupes. Faute de modalités de régulation, des hiérarchies effectives mais officieuses se créent, des structures d’allégeance se mettent en place, les jeux politiques internes prennent le dessus. »
Ce déficit de régulation se traduit aussi par l’inexistence du dialogue social. Certes, les syndicats et les représentants du personnel ne sont pas toujours les alliés les plus enthousiastes des transformations, mais on est frappé de constater, en lisant le livre d’Isaac Getz et Brian M. Carney ou en visionnant le documentaire d’Arte Le bonheur au travail, que sur la trentaine d’exemples mobilisés, seuls trois mentionnent l’action de syndicats, Harley-Davidson (USA), GSI (France) et le Service public fédéral (SPF) belge de Sécurité sociale. Les deux premières ont abandonné toute velléité de « libération » et, quant à la troisième, on ne jugeait même pas utile de nous indiquer quelle fut leur action. Il semble bien que l’EL ait tiré un trait définitif sur le dialogue social. Quels seront alors les modes de traitement de la conflictualité, inévitable, qui ressurgira à la faveur d’une restructuration ou d’une réorganisation mal acceptée ?
Encadré 16. L’EL décevante : exemples concrets
Sans nier les succès obtenus par des entreprises qui ont mis en œuvre le modèle de l’EL ou son constituant l’holacratie, il nous semble utile d’attirer l’attention vers des situations plus problématiques, qui aident à poser des questions pertinentes.
Le témoignage d’un cadre, Pierre Denier, qui a vécu la libération de son entreprise et ses dérives durant 5 ans, évoque le contrôle par le management, remplacé par le contrôle par tous. « Je suis passé devant un groupe de collaborateurs qui ne connaissent pas mon métier mais qui étaient en charge de décider de mon augmentation. (…) La pression financière est reportée sur les salariés : c’est à eux de trouver les solutions pour faire mieux avec moins. »77
Google a été un moment séduite par l’idée de « l’entreprise sans manager » et l’a temporairement mise en œuvre avant de revenir brutalement en arrière après six semaines d’implémentation douloureuse. Laszlo Bock, “head of people operations” de Google a raconté cette expérience et cette déconfiture dans son livre Work Rules!. Aujourd’hui, Google conduit des expériences sur la qualité du management et publie le fruit de ses recherches qui montrent que les salariés qui jugent leur manager le plus positivement sont aussi les plus productifs, les moins sujets à l’absentéisme et les plus loyaux. Il n’est plus question de supprimer les managers !
Zappos, un distributeur online de chaussures et de vêtements, filiale du groupe Amazon, a longtemps constitué une référence pour les promoteurs de l’EL. Le déploiement de l’holacratie a provoqué une hausse brutale du turnover, qui a atteint le niveau alarmant de 14 %. Plusieurs publications américaines se sont fait l’écho des graves problèmes organisationnels rencontrés par cette entreprise.78
Morning Star, un transformateur de tomates californien, est aussi une référence pour les promoteurs de l’EL. Le célèbre consultant Gary Hamel lui a consacré un article dans la HBR (2011). Il y relève de nombreux points positifs mais aussi le fait que, selon Chris Rufer, le président de l’entreprise, il faut au moins un an à un nouvel embauché pour atteindre un bon degré d’efficacité dans cet environnement « sans manager ». Un autre dirigeant, Paul Green, indique que 50 ٪ des nouveaux embauchés finissent pas quitter l’entreprise avant deux ans, du fait des difficultés d’adaptation à cet environnement.
L’entreprise américaine Medium a décidé, après plusieurs années de pratique, d’abandonner l’holacratie. En cause, le manque de scalability (capacité à grandir) du modèle, le temps jugé trop important pris par les opérateurs pour documenter leurs rôles et se coordonner (par rapport à une organisation hiérarchique). « Nous en avons conclu que le fait de devoir documenter les responsabilités de chacun a fini par constituer un obstacle à l’attitude proactive et au partage des objectifs que nous recherchons. » indique Andy Doyle (2016), son directeur général dont on peut lire le témoignage.
Pierre Deheunynck, ex-directeur des ressources humaines groupe de Crédit agricole, attire l’attention sur les aspects managériaux. Ayant récemment intégré ENGIE en vue de devenir DGA en charge des ressources humaines, il éclaire le rôle clé du manager et analyse les pratiques et comportements managériaux dans un environnement en mutation. « Les ingrédients qui font le succès des “entreprises libérées” sont si particuliers qu’il est difficile d’imaginer que le modèle puisse être facilement dupliqué ou constituer même un modèle d’organisation des entreprises. Ce qui m’intéresse dans ces entreprises, c’est la notion de responsabilité. Elle est partagée et n’est pas concentrée autour d’un groupe restreint de managers. Ceci crée de la performance durable en ce sens que tous les acteurs de l’entreprise y contribuent et pas seulement quelques-uns. »79
Jean-Marie Bergère (op.cit.) pointe la contradiction entre les valeurs portées et l’absence de dispositifs pour les faire vivre : « Le discours des tenants des “entreprises libérées” est imprégné de valeurs et de postulats démocratiques. Ils s’opposent au taylorisme, aux hiérarchies rigides, aux procédures imposées. On s’en réjouit. Leur faiblesse est d’oublier que ces valeurs ont besoin de supports institutionnels pour les discuter, analyser leurs conséquences concrètes pour toutes les parties prenantes et protéger ceux qui alerteraient sur les dysfonctionnements ou les entorses aux règles déontologiques. »
3. Entreprise responsable
A. Qu’est-ce qu’une entreprise responsable ?
Ce concept s’insère dans la mouvance de la Responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE) et du développement durable, appliqués au monde de l’entreprise. La définition « officielle », d’après la Plateforme RSE80, se réfère à une entreprise qui se donne pour objectif la performance globale (économique, sociétale et environnementale). Nous ajoutons que c’est aussi une entreprise qui s’impose de veiller à la qualité de ses relations avec ses parties prenantes, minimiser ses externalités négatives (coûts sociaux, environnementaux, etc.) et optimiser ses impacts positifs sur la société et l’environnement.
Dans bien des cas, l’entreprise responsable (que l’on appelait aussi « citoyenne » dans les années 1990) se distingue dans ses pratiques de management par la place allouée aux parties prenantes, c’est-à-dire « les organisations ou des individus qui ont un ou plusieurs intérêts dans une décision ou activité quelconques d’une organisation ou d’une entreprise »81. En cela, c’est une extension de la QVT qui elle aussi est soucieuse de la qualité de la relation entretenue avec ses parties prenantes mais en focalisant sur les parties prenantes internes et plus particulièrement sur les salariés. L’entreprise responsable s’efforce d’allouer du temps, de l’attention, du dialogue avec l’ensemble de ses parties prenantes reconnues comme prioritaires, c’est-à-dire son écosystème. Certaines entreprises animent ainsi des comités de parties prenantes et incluent des parties prenantes dans la co-construction et le pilotage de projets communs.
Par rapport aux autres formes organisationnelles présentées, l’entreprise responsable présente la particularité de se concentrer en grande partie sur la gouvernance, cette dernière est en effet l’un des sept piliers de la RSE définis par la norme ISO 26000. Parmi les bonnes pratiques de gouvernance et de management qui ont un impact à la fois sur la QVT et la performance, on trouve par exemple :
- l’introduction de représentants des salariés dans les organes de gouvernance (conseil d’administration ou de surveillance)82 ;
- la place donnée à la négociation collective plutôt qu’à la simple information-consultation ;
- l’utilisation d’indicateurs en matière de santé au travail (par exemple, taux de fréquence et de gravité des accidents du travail) pour définir une partie de la rémunération des dirigeants ou des managers ;
- la mise en œuvre de politiques de GRH permettant de matérialiser la responsabilité de l’entreprise : non-discrimination, intégration de travailleurs handicapés, égalité professionnelle, politique de formation inclusive, etc.
Mais l’entreprise responsable n’ignore pas l’autonomie laissée aux salariés sur la tâche ou le collectif de travail car les partenaires sociaux préconisent dans l’ANI QVT (19 juin 2013) de mettre en place des démarches facilitant l’expression des salariés. Les solutions aux problèmes rencontrés ne peuvent, en effet, s’élaborer que dans un effort commun, par le partage de l’information, par un dialogue permanent pour confronter les objectifs stratégiques avec les réalités opérationnelles. On retrouve ici une démarche proche de celles qui s’expriment dans le cadre de l’EL.
L’entreprise responsable investit sur la qualité de ses relations avec ses parties prenantes, internes et externes. En particulier, elle se soucie de donner des moyens au développement d’un dialogue social riche et équilibré. De ce point de vue, la troisième enquête ECS (Eurofound, voir note 45 p.81) vient de confirmer le retard de la France sur la formation des représentants du personnel. La part des représentants du personnel qui ont bénéficié d’une formation liée à leur mandat au cours des douze derniers mois n’est que de 16 % en France, soit… la moitié de la moyenne de l’UE 28 (31 %) et largement en-deçà de ce que pratiquent nos principaux voisins européens : 54 % en Allemagne, 25 % Royaume-Uni, 28 % en Italie, 29 % en Espagne. Les seuls pays moins bien classés que la France parmi les 28 sont l’Irlande, Malte et la Roumanie.
B. Entreprise responsable, performance et QVT
On peut citer la tentative récente de France Stratégie (2016b) de mesurer l’impact de la RSE sur la compétitivité. Les auteurs relèvent : « Quelles que soient la mesure de la performance économique (profit par tête, excédent brut d’exploitation ou valeur ajoutée par tête) et la dimension de la RSE (environnement et éthique, ressources humaines, relation client, relation fournisseur), on observe un écart de performance économique d’environ 13 % en moyenne entre les entreprises qui mettent en place des pratiques RSE et celles qui ne le font pas. Ces écarts de performance moyenne varient selon les dimensions observées : ils s’échelonnent de 5 % pour la relation client à 20 % pour la dimension “ressources humaines”. Les entreprises qui mettent en place des pratiques RSE semblent ainsi concilier management responsable (envers les clients et fournisseurs, envers les salariés), respect de l’environnement et exigence de compétitivité. » Bien entendu, comme dans le cas des études testant la relation entre QVT et performance, on peut s’interroger sur le sens de la causalité et sur le poids des effets indirects (meilleure organisation, attraction de salariés motivés et plus productifs). D’autres travaux en illustrent plusieurs aspects, dans le numéro des Annales des Mines consacré à la RSE et à la mesure de ses impacts83.
L’impact en termes de QVT réside dans la coïncidence partielle des objectifs : les entreprises les plus avancées en RSE sont aussi généralement, les plus avancées en QVT compte tenu de l’importance de la partie prenante « salarié ». Le baromètre des enjeux RSE 2016, réalisé par Malakoff Médéric et l’ORSE84 a mis en évidence la forte convergence entre RSE et QVT : 69 % des entreprises mentionnent l’existence de dispositifs en faveur de la santé, sécurité au travail et QVT dans leur politique RSE. Et pour 66 % des entreprises interrogées, les dirigeants estiment que les actions en faveur de la santé et sécurité au travail améliorent les performances économiques de leur entreprise. Avec la montée de la problématique de marque-employeur, la QVT devient une approche de différenciation sur le marché de l’emploi, stimulée par la volonté de déployer des politiques RSE appropriées par les salariés.
L’entreprise responsable tente d’hybrider la QVT avec la mobilisation de parties prenantes externes en faveur de l’environnement. Par exemple, dans le but de réduire les temps de transport et le stress des salariés, un PDE (plan de déplacement d’entreprise) peut organiser une navette de bus en coopération avec les autres entreprises du bassin d’implantation et rechercher un impact écologique positif.
4. Vers des organisations du travail responsabilisantes
Lean management, entreprise libérée ou entreprise responsable: ces trois formes d’organisations du travail mettent l’accent sur l’autonomie des collaborateurs. Elles sont toutes à leur manière des organisations de travail responsabilisantes, terme popularisé par le groupe Michelin. Les formes les plus abouties sont aussi celles qui abordent l’autonomie de la façon la plus large. Elles semblent en effet favoriser l’autonomie au travail dans trois dimensions : la tâche elle-même, la coopération dans l’activité de travail et la gouvernance. C’est cette triple ambition qui les distingue des trois autres modèles présentés. C’est en cela que ces approches globales libèrent effectivement le travail et la performance, sous réserve qu’elles soient le fruit d’un compromis sincère entre la recherche d’une meilleure compétitivité et la volonté de donner aux travailleurs la possibilité d’effectuer un travail de qualité.
A. Un modèle d’analyse de l’autonomie au travail
Les chapitres précédents montrent qu’il est pertinent de centrer notre réflexion sur l’autonomie au travail. En rassemblant les différentes approches présentées jusqu’ici, nous proposons un modèle de l’autonomie au travail, qui s’articule autour de trois niveaux (voir tableau 4).
Niveau 1 : la définition des tâches que les travailleurs ont à effectuer, déterminée par la latitude dont ils disposent pour intervenir sur le séquencement de leurs tâches, la méthode d’exécution, le rythme de travail, les outils utilisés ;
Niveau 2 : l’environnement organisationnel du collectif de travail dans lequel ils évoluent déterminé par la possibilité d’implication dans l’amélioration de l’organisation du travail de leur équipe, la capacité à influer sur les décisions qui concernent leur travail, la marge de manœuvre pour définir les modes de coopération dans le travail ;
Niveau 3 : leur implication dans la gouvernance de leur entreprise, rôle et place du dialogue social, importance de la négociation par rapport à la simple information et consultation, degré d’influence sur le partage de la valeur créée, mise en œuvre d’un mode de management participatif, présence de représentants des salariés dans les organes de gouvernance.
Ces trois niveaux délimitent un espace d’implication, de participation directe, de capacité d’influence et de décision sur leur travail, que les salariés ont pu construire : autonomie sur la tâche, sur l’organisation et sur la gouvernance. Ils sont parfois hétérogènes au sein d’une même entreprise (diversité d’un atelier à un autre) ; parfois cumulatifs (un collectif de travail se caractérise par son autonomie sur les trois niveaux) ou au contraire spécifiques (par exemple un collectif de travail a essentiellement construit son autonomie sur le niveau 2 sans s’intéresser aux niveaux 1 et 3).
Les formes organisationnelles émergentes font appel à l’un seulement ou plusieurs des trois niveaux d’autonomie.
B. L’autonomie dans les organisations du travail émergentes
Il est clair que le lean management, tel qu’il est majoritairement pratiqué en France, est centré sur le premier niveau (autonomie sur les tâches) et adopte ainsi une vue étroite de l’autonomie, ce qui bride son potentiel de performance organisationnelle et humaine. C’est ce qu’exprime Patrick Conjard (2014), chargé de mission à l’Anact : « Le lean management sollicite l’expertise des salariés, leur demande de contribuer à l’élaboration des processus de travail mais cette sollicitation s’inscrit dans un objectif de standardisation de leur travail. Il appelle à plus d’autonomie, de responsabilisation mais place les travailleurs dans un cadre très formalisé et contraint. » Pour « libérer son potentiel », il faudrait que le lean, conformément à son sens originel, intervienne davantage sur les niveaux 2 et 3 de notre modèle – sans perdre son ancrage sur le niveau 1. Comme l’indiquait Michel Sailly (2014), ergonome durant de nombreuses années au sein du groupe Renault, dans des fonctions RH et fabrication, puis durant deux années chez Nissan au Japon et membre du groupe ressources de la FGMM CFDT sur la Qualité de Vie au Travail : « Le lean est potentiellement favorable à l’émergence d’une démocratisation de l’entreprise par le bas et à la création d’un nouveau lien entre santé et performance… à condition de permettre la discussion sur les outils, la méthode, sa mise en application, de structurer des espaces de discussion, de rééquilibrer les pouvoirs entre certaines fonction support (ingénierie, qualité, achats…) et la fabrication, de nouer un dialogue social au plus près du travail. »
L’entreprise libérée s’intéresse essentiellement au niveau 2 (transversalisation des processus, remontées et mise en œuvre des idées émises par les opérateurs) avec une sollicitation du niveau 1 (diminution des contraintes au profit de l’initiative). D’une certaine manière, elle complète donc le lean management (qui se présente dans la configuration inverse) et partage avec lui le fait d’ignorer le niveau 3 (la gouvernance) qui pourrait pourtant lui apporter la régulation nécessaire.
Par rapport aux autres formes organisationnelles présentées, l’entreprise responsable présente l’originalité d’être centrée sur le troisième niveau du modèle d’autonomie au travail. Elle l’est beaucoup moins sur les niveaux 1 et 2 du modèle.
Enfin, certaines entreprises auditionnées comme Michelin ou Renault, mais on pourrait aussi citer Redex ou Somfy, ont mis en place des organisations responsabilisantes, combinant les apports du lean et de l’EL avec l’autonomie. Elles se traduisent notamment par la création d’îlots de production au sein des usines et introduisent de nouvelles méthodes de travail plus collaboratives, plus participatives.85 « On ne parle pas chez Michelin de suppression de la hiérarchie. Elle est toujours là. C’est le mode d’exercice de l’autorité qui est différent. Toutes les décisions sont prises au niveau de l’îlot de production, sauf celles que ses membres ne réussissent pas à prendre eux-mêmes. »86
Ces formes d’organisations du travail responsabilisantes présentent la particularité de s’intéresser aux trois niveaux d’autonomie. Cette complétude apparaît surtout dans l’expérimentation menée par Renault à Flins avec le laboratoire du CNAM. Comme l’a décrit Jean-Yves Bonnefond durant son audition et dans son article de la revue de l’Anact (op.cit.), le dispositif d’intervention repose sur trois institutions : les unités élémentaires de travail (UET), un comité local réunissant les organisations syndicales, la direction et le management, la DRH, le service de santé au travail, les intervenants Cnam et des opérateurs, et enfin un comité de suivi national paritaire.
L’enjeu consiste à discuter du travail, à confronter des points de vue sur l’action, afin de décider collectivement des améliorations concrètes à apporter aux méthodes de travail. Les discussions circulent dans l’ensemble des trois institutions, la parole des opérateurs ne restant pas confinée dans les seules UET. Un opérateur référent, élu par les pairs, fait vivre ce projet au-delà de la présence des intervenants du Cnam (voir p.97). En fait, il ne s’agit pas de lancer une « simple mise en discussion du travail », comme le précise Jean-Yves Bonnefond en conclusion de son article : plus fondamentalement, il s’agit d’ancrer les capacités d’action des opérateurs dans des dispositifs conçus pour prendre des décisions à partir des réalités opérationnelles. C’est la condition pour développer un pouvoir d’agir individuel et collectif sur le travail et son organisation.
Il s’agit donc de mobiliser les ressources du dialogue social au lieu de les contourner, voire de les éliminer. « Ce type d’organisation ne peut s’envisager sans la concertation des organisations syndicales et des instances représentatives du personnel. Elles jouent un rôle de vigilance sur l’environnement du travail et font ainsi remonter les dysfonctionnements évoqués par les salariés. De nombreuses entreprises comme Michelin les informent et les associent à la démarche (définition des objectifs, concertation sur les méthodes employées) pour susciter l’adhésion de leurs salariés à chaque étape du processus de transformation »87.
C. Une nécessaire transition du management « à la française »
On comprend ici pourquoi, comme nous l’avons dit plus haut, le rôle du management et plus particulièrement du management intermédiaire est crucial. Il fait le lien entre les trois niveaux d’autonomie. Il permet, dans le cadre des processus de travail, que soient sollicitées l’initiative et la responsabilité humaines dans l’activité (niveau 1), dans le coopération (niveau 2) et dans la régulation (niveau 3).
L’autonomie suppose la délégation, le dessaisissement d’une partie des prérogatives exercées par le management. Ceci nécessite de la confiance entre acteurs. Or on sait, notamment depuis les travaux d’Algan et al. (2012) que la France est particulièrement mal placée sur ce plan. France stratégie (2016a) relève que ce manque de confiance est un frein aux possibilités de coopération dans le travail et à la mise en œuvre de meilleures pratiques managériales.
Le développement de l’autonomie se heurte à un autre point faible de la relation de travail en France, qui fait le pendant du manque de confiance : sa très forte imprégnation de distance hiérarchique. Le psychologue et sociologue néerlandais Geert Hofstede s’est intéressé aux différences culturelles entre les habitants de différents pays, et a tenté de classifier les différences comportementales.88 Il a construit un indice synthétique de la distance hiérarchique, qu’il définit comme « la perception du degré d’inégalité du pouvoir entre celui qui détient le pouvoir hiérarchique et celui qui est soumis ».
Geert Hofstede attribue à chaque pays un indice synthétique de distance hiérarchique, qui s’étage de 0 (IDH faible) à 100 (IDH fort). L’IDH calculé pour la France (68) est largement supérieur à la moyenne mondiale (57) mais aussi à celui de la plupart des pays qui sont nos compétiteurs sur les marchés internationaux : Italie (50), États-Unis (40), Canada (39), Pays-Bas (38), Australie (36), Grande-Bretagne (35), Allemagne (35).
Plus généralement, les enquêtes sur les pratiques organisationnelles des entreprises révèlent le retard important de notre pays dans toutes les dimensions identifiées comme influençant positivement la qualité du management (autonomie des salariés, encadrement des managers, organisation du travail…) (voir graphique ci-après). Or on a vu dans le chapitre 3 que la qualité du management entretenait des liens avec la QVT, l’engagement et la performance, et qu’elle est indispensable pour accompagner des stratégies de compétitivité de montée en gamme.
Enfin, donner de l’autonomie suppose que le management exerce une fonction d’appui, de soutien des collaborateurs. Or, les managers n’auraient plus que 10 % de leur temps disponible à y consacrer (communiqué du cabinet Syntec, 2010). Quand on leur demande, à quoi ils se consacrent au quotidien, 30 % des managers répondent en premier : la résolution des problèmes et des urgences. Dans 50 % des autres réponses, le temps est prioritairement occupé au pilotage de l’activité, à l’orientation de l’action ou au contrôle des résultats. Seuls 20 % des managers disent que l’accompagnement, le développement et le soutien des équipes sont leur occupation quotidienne première. Il s’agit d’un paradoxe puisque pour près de la moitié des managers, les relations avec les membres de leur équipe constituent la motivation première de leur travail.89
Pour Mathieu Detchessahar (2011), ce n’est donc pas d’une hypertrophie du management dont les entreprises souffrent mais au contraire de sa relative carence dans son rôle de soutien des collaborateurs et de développement professionnel.90 Pour le chercheur, le manager de proximité est littéralement « empêché » aujourd’hui d’occuper la scène du travail avec pour double conséquence de laisser les collaborateurs seuls face aux exigences accrues de l’activité (multiplication des objectifs de performance : maîtrise des coûts et délais, accroissement de la réactivité et de la qualité, processus d’innovation permanente…) et les encadrants dans une grave crise de sens concernant leur mission et leur rôle dans l’organisation. Cette situation nuit selon lui à la santé au travail et à la performance globale des organisation.
Conclusion
Les méthodes organisationnelles dominantes laissent à penser qu’adopter une méthodologie normée suffirait à déclencher la performance. Mais elles n’y parviennent pas systématiquement car elles sont trop dépendantes de procédés réplicables de standardisation et de rationalisation de l’activité de travail et de production, qui nient le potentiel de l’autonomie et enferment le travail humain.
Les difficultés rencontrées par les entreprises dans leur transformation tiennent pour une large part à leur approche partielle et compartimentée de l’autonomie au travail. Ainsi par exemple, vis-à-vis de notre modèle de l’autonomie,
- le lean management est trop exclusivement centré sur le niveau 1 (la tâche) et 2 (la coopération dans l’activité de travail),
- le modèle de l’EL sur le niveau 2 et 1,
- l’entreprise responsable sur le niveau 3 (la gouvernance).
Notre analyse du lean, de l’entreprise libérée et de l’entreprise responsable nous ont convaincus qu’il faut avant tout s’interroger sur la nature et l’étendue de l’autonomie au travail, et ce, indépendamment de la méthode implémentée.
Les expériences d’organisations responsabilisantes les plus abouties, bien que balbutiantes et moins figées dans un modèle structuré, nous semblent bénéfiques par leur recherche d’équilibre. Elles s’intéressent à la fois aux trois niveaux d’autonomie et en cela, proposent une solution mutuellement gagnante pour l’ensemble des acteurs sociaux, qui favorise la performance en reconnaissant l’homme au travail dans la totalité de ses capacités et de sa volonté d’accomplissement.
- 59. Philippe Lorino fait remonter les origines du lean à la théorie de la performance comme démarche d’enquête collective sur l’activité, élaborée par Shewhart en 1939.
- 60. Unités élémentaires de travail : organisation mise en place en 1990 dans le cadre du SPR (système de production Renault), réunissant une vingtaine de collaborateurs en production, qui travaillent ensemble sur 8 axes de progrès (qualité, standardisation, implication, maîtrise de la performance, etc.).
- 61. Elle a publié en 2016 l’ouvrage Le Lean en questions (L’Harmattan).
- 62. Voir March (1991).
- 63. Voir Ughetto (2015).
- 64. Colloque de l’Aract Poitou-Charentes sur le lean management, Poitiers, 13 septembre 2012.
- 65. Les postes doux désignent les postes de travail adaptés aux personnes en situation de handicap ou faisant face à des situations d’inaptitude ou en restriction.
- 66. Voir Mélanie Burlet (2015) et la fiche qu’elle a rédigée « Comment articuler performance et conditions de travail ? », Travail & Changement, septembre 2013. Voir également Mélanie Burlet et Virginie Leblanc (2012).
- 67. « Entreprise libérée » a été déposée par Lablib, société présidée par Isaac Getz. « Campus des entreprises libérées » a également été déposé, directement par Isaac Getz, bien que l’expression figure dans le titre de l’ouvrage largement diffusé de Tom Peters (1993).
- 68. Voir « L’entreprise libérée est-elle socialement responsable ? » http://management-rse.com/2015/11/23/lentreprise-liberee-est-elle-socialement-responsable/
- 69. Pour approfondir, voir Marc Mousli (2016).
- 70. Voir Robertson (2016) pour la version française.
- 71. « Nothing gets in the way of the work. »
- 72. « L’entreprise libérée », Manageris, février 2016.
- 73. Voir Verrier (2016c).
- 74. Dans Revue « Personnel » (ANDRH) (2016).
- 75. On peut d’ailleurs remarquer que cette liberté octroyée, celle de l’esclave affranchi par son maître, n’a pas forcément la même valeur que celle qui a été conquise, surtout si elle n’est concédée que le temps du mandat d’un dirigeant particulier.
- 76. Ce type d’assertion est réfuté notamment par Gideon Kunda (Engineering Culture). La surimplication du salarié, encouragée par un système de gestion de la culture locale, déstabilise souvent la vie familiale de l’individu et n’est pas soutenable.
- 77.Voir la vidéo de ce témoignage: http://www.youtube.com/watch?v=rwwjeJtfn7w
- 78. Rigoni et Nelson (2016), Gelles (2016).
- 79. « Ma vision du management, interview de Pierre Deheunynck » par Fanny Barbier (2016).
- 80. La Plateforme RSE est un organe de réflexion et de concertation installé en avril 2013 placé auprès du Premier ministre, rattachée à France Stratégie.
- 81. Définition selon l’ISO 26 000.
- 82. Charlet et Gauron (2014).
- 83. http://www.annales.org/ri/2011/ri_mai_2011.html ; http://www.annales.org/ri/2011/ri-mai-2011/POSTEL-VINAY.pdf ; http://www.annales.org/ri/2011/ri-mai-2011/COTIS.pdf
- 84. Observatoire sur la Responsabilité Sociétale des Entreprises.
- 85. Voir la synthèse de Bidet-Mayer et Toubal (2016). Une étude approfondie paraitra en novembre 2016.
- 86. Nassif (2015).
- 87. Bidet-Mayer et Toubal, op. cit.
- 88. Dans le cadre du projet Hermès, il a pour cela interrogé 90 000 salariés d’IBM situés dans différents pays.
- 89. CSP Formation, « 1 baromètre des managers : Les résultats de l’édition 2012 », mars 2013.
- 90. Detchessahar (2011). Voir aussi Dujarier (2006), Courpasson et Thoenig (2008).
Conclusion générale
Il existe une littérature foisonnante sur les liens entre la qualité de vie au travail (ou des notions proches) et la performance des entreprises. Même si cette littérature est difficile à synthétiser et à exploiter du fait de la variété des indicateurs retenus pour évaluer la qualité de vie au travail, l’autonomie ou l’engagement des salariés, la performance et la compétitivité de l’entreprise, il semble qu’un lien robuste puisse être établi dans de très nombreuses situations. Le lien est à la fois direct (une corrélation entre des indicateurs liés à la qualité de vie au travail et un indicateur de performance) et indirect : une bonne qualité de vie au travail, incluant notamment une certaine autonomie et responsabilisation des collaborateurs, suscite un engagement plus fort dans le travail, qui conduit à une amélioration de la performance de l’entreprise, et notamment de sa résilience, de sa capacité d’adaptation et d’innovation.
Les auditions réalisées par le groupe de travail confirment ces résultats. Nos interlocuteurs restent toutefois prudents, car les initiatives prises dans le domaine de la qualité du travail et de la responsabilisation des salariés le sont en général dans le cadre de modifications plus larges de l’organisation du travail, de sorte qu’il est difficile d’attribuer le succès (ou parfois son absence) à un seul facteur.
Un aspect essentiel de la qualité de vie au travail est l’autonomie des salariés. Celle-ci peut prendre des formes diverses : organisation du travail individuel et du poste de travail, fonctionnement de l’équipe ou du collectif local, participation à la gouvernance de l’entreprise et à la définition des objectifs. Diverses théories de gestion se différencient par le poids qu’elles donnent à ces diverses formes d’autonomie, d’où des prescriptions nombreuses et parfois contradictoires qui peuvent perturber les dirigeants.
L’expérience montre qu’on ne décrète pas du jour au lendemain que les opérateurs sont autonomes ou l’entreprise libérée. Il faut créer des conditions favorables à la fois au niveau de l’organisation du travail, de la formation des personnels à tous les niveaux hiérarchiques, des outils de gestion et de régulation. Il n’est pas simple de passer d’une organisation hiérarchique accordant peu d’autonomie aux opérateurs à une « organisation responsabilisante » reposant sur des modes de coordination souples entre pairs. Il faut souvent organiser au préalable un dialogue sur le contenu du travail, ses finalités et ses critères de qualité, passer par diverses étapes de formation, d’écoute, d’explication, de retour d’expérience, d’adaptation, en tenant compte du contexte et de la culture locale.
La France a des marges de progression en matière de qualité du travail et des conditions de travail. L’autonomie ressentie y a récemment régréssé, la distance hiérarchique est exceptionnellement forte, la confiance trop limitée et le contrôle par la hiérarchie pesant. Le management intermédiaire s’épuise à alimenter des rapports pour le niveau supérieur et n’a pas suffisamment le temps de travailler en support des opérateurs et de veiller à leur développement individuel. Ces caractéristiques, déjà dommageables pour la performance dans des industries organisées de manière taylorienne, le sont encore plus quand la production monte en gamme et repose sur des opérateurs impliqués et créatifs, contribuant à l’amélioration continue des offres et des processus.
Améliorer la qualité de vie au travail et le dialogue sur le contenu, la finalité et l’organisation du travail n’est donc pas un luxe réservé à quelques entreprise spécialement soucieuses du bien-être de leurs salariés, même si cette dernière préoccupation est un aspect parfaitement respectable de la responsabilité sociale et environnementale d’entreprises qui n’oublient pas les employés parmi leurs parties prenantes. C’est de plus en plus un levier de compétitivité majeur pour des entreprises soucieuses de leur résilience et de leur agilité dans un environnement turbulent.
COMMENTAIRES
La QVT est l’affaire de tous dans l’entreprise
Par la CFE-CGC Métallurgie
L’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 19 juin 2013 « vers une politique d’amélioration de la qualité de vie au travail et de l’égalité professionnelle », rend ses dispositions obligatoires, depuis le 23 avril dernier 2014, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d’application.
L’accord précise d’abord les contours et la compréhension commune de la qualité de vie au travail (QVT). Il décrit ensuite les dispositions négociées pour améliorer l’égalité professionnelle et la QVT, celles-ci étant applicables, en fonction de leur nature, soit au niveau interprofessionnel, au niveau des branches ou au niveau des entreprises.
La CFE-CGC a, bien entendu, signé cet accord mais qu’en est-il sur le terrain ?
C’est un sujet majeur abordé dans les relations professionnelles. Et si ce sujet prend une telle importance, c’est incontestablement que se cache un profond changement des modèles sociétaux et sociaux. Le temps des entreprises s’accélère, les salariés sont toujours plus sous pression, mais en parallèle, pour les nouvelles générations le travail n’est pas une raison de vivre mais un moyen de mieux vivre.
Les entrepreneurs les plus modernes acceptent l’idée qu’un salarié « heureux » puisse rendre ses clients « heureux », phénomène qui est amplifié par des nouveaux modes d’organisation comportant moins de niveaux hiérarchiques, donnant plus d’autonomie au salarié et un rôle au manager plus axé vers la coordination. La QVT peut donc trouver sa place si elle vise ces objectifs. Toutefois nous émettons de sérieuses réserves sur la notion « d’entreprise libérée », concept qui, s’il peut être mieux entendu dans l’esprit start-up, semble difficile à transposer dans les ETI et autres grands groupes. Tel que l’indique Gilles Verdier dans cette étude « imaginer que tout part du haut avec un “ leader libérateur ” qui supprimerait les corps intermédiaires que sont les managers et les fonctions support, ne nous paraît pas une réponse d’avenir. De même, promouvoir la liberté et la responsabilité des collaborateurs sans travailler leur montée en compétences et leurs modes d’interaction nous semble illusoire ». Enfin s’il y avait quelque chose à libérer, ce serait avant tout de libérer les managers souvent contraints à travailler dans les carcans de charges administratives et reporting tous azimuts.
La QVT est dans ces conditions à prendre comme une nouvelle approche de sujets déjà abordés, parfois depuis longtemps, touchant aux rapports santé / sécurité, organisation / condition de travail, vie professionnelle / vie personnelle. Elle met finalement les entreprises au défi de traiter concrètement ces sujets, afin de créer un équilibre performance globale / bien-être individuel. Ces traitements étant par essence fonctions de problématiques de terrain.
Qui dit recherche de QVT dit identification de problèmes, et donc espace – physique et temporel – de discussion. Il en découle très souvent des initiatives qui transforment l’organisation locale du travail et recréent de l’engagement professionnel. Les changements de rôle touchent essentiellement le management, mais touchent aussi les représentants du personnel. Chacun doit repenser sa place et sa valeur ajoutée dans le nouveau système. La participation de plus en plus directe des salariés aux prises de décision suppose, pour réussir, des relations de confiance et un dialogue social de bonne foi. Le management intermédiaire a donc un rôle essentiel à jouer. Le manager-gestionnaire, le manager-petit chef doit laisser la place au manager-coach.
On note dans ce contexte l’apparition, à un niveau mondial, de quatre axes d’innovation managériale : renforcer l’autonomie des salariés, considérer l’innovation comme l’affaire de chacun, faire créer par le client un sentiment d’utilité du salarié, mettre les managers au service de leurs équipes. D’une manière transverse, ces axes de travail doivent prendre en compte la diversité et doivent s’étendre à toute la chaîne de valeur de l’entreprise (clients comme fournisseurs). Ce dernier point implique un impact sur les politiques d’achat, du moins en théorie
Observons d’abord le fait que la vie familiale prend l’ascendant sur la vie professionnelle et pénètre de plus en plus le cercle du travail. Avec pour corollaire une forte sensibilisation des salariés à la notion même de QVT et, la nécessité, pour les directions générales, de prendre des décisions concrètes, visibles et compréhensibles. Si nous devons entrer dans une nouvelle économie, les entreprises qui resteront seront celles qui auront créé les conditions de travail permettant aux salariés de pleinement exprimer le potentiel de leur cerveau plus que de leurs bras ! Pour autant, une direction peut faire le choix de voies simples et progressives qui entraîneront tout le monde dans un cercle vertueux : crèches d’entreprises, télétravail, droit à la déconnexion sont les sujets sur lesquels les entreprises grandes ou petites sont les plus attendues. Le stade suivant sera de sortir d’une vision taylorienne du travail. Il s’agit de permettre au salarié de s’approprier son travail, pour en être satisfait et enfin, fier. Plus encore que les conditions matérielles de travail, c’est la motivation, l’envie qui fera la différence. À cet effet, la QVT c’est aussi : comprendre le sens de son travail, avoir de l’autonomie, se sentir en confiance, être encouragé, être formé, être reconnu…
Malheureusement l’environnement économique et industriel fait en quelque sorte de la QVT « un sport de riches » : elle passera après la recherche de rendements ou de performances techniques et financières. À ce titre, si le lean est certes plus responsabilisant en demandant aux principaux concernés leur avis, ces organisations induisent malgré tout des contraintes. Il faut tout mesurer, tout contrôler. C’est ce qui a conduit à un dévoiement complet du lean manufacturing .
La QVT est une affaire politique dans l’entreprise, et elle doit donc être initiée au plus haut niveau. Mais c’est aussi une multitude de sujets propres à chaque équipe, au niveau le plus élémentaire, et il faut donc investir du temps et des moyens pour identifier, discuter et traiter ces sujets. Il est illusoire de vouloir bâtir à long terme un environnement propice sans dialogue social performant. On ne peut pas espérer développer la responsabilité, l’autonomie des salariés sans leur donner les moyens de comprendre et d’influer sur les choix de l’entreprise.
La position de la Métallurgie CFE-CGC est d’inciter les élus, mandatés, militants CFE-CGC, à prendre le pouvoir en matière de QVT et à challenger les entreprises, à les « prendre au mot » de leurs discours, pour changer le quotidien. Les corps intermédiaires sont indispensables à ce dialogue, sous réserve que les deux parties, entreprises et syndicats, le veuillent vraiment, en prenant le risque de la confiance mutuelle pour bâtir des compromis induisant efforts et bénéfices partagés.
Parler du travail, d’abord !
Par Tony Fraquelli et Jérôme Vivenza (CGT)
La CGT a participé activement aux négociations de l’Accord QVT. Mais pour dire les choses simplement, c’est un concept qui nous apparaît un peu fourre-tout, et nous sommes peu convaincus par les artifices qui entourent la QVT.
Nous sommes par contre toujours disposés à parler de travail. C’est pourquoi quand la CGT négocie sur ce thème de la Qualité de Vie au Travail, elle négocie en fait sur la « Qualité du Travail ».
Nous sommes confrontés aujourd’hui dans les entreprises à des normes de gestions qui s’opposent à la qualité de la production et des services. Et la Qualité du Travail est donc un enjeu pour les salarié.es parce qu’elle est constitutive de la santé des salarié.es. Pouvoir bien faire son travail, c’est pouvoir s’émanciper, se reconnaître dans ce que l’on fait, être reconnu pour ce que l’on fait !
Alors, parler du travail est un exercice qui chahute. Et il n’est pas rare que la QVT, pour le patronat, reste un moyen de ne pas remettre en cause sa stratégie en se focalisant sur les « périphériques » du travail comme le chèque services, la salle de repos, etc. Autant dire un pansement sur une jambe de bois. Notre démarche est de recentrer la négociation autour des questions de travail.
Nous avions réussi à le faire à la SNCF. La CGT est arrivée aux négociations avec un « contre-projet » qui a servi de base aux discussions. Nous avions réussi, avec les autres organisations syndicales, à avancer ensemble sur ce terrain. D’ailleurs, et ce n’est pas un détail, l’accord soumis à la signature – écrit à 90 % par la CGT – était nommé « accord pour la Qualité du Travail et QVT ». Au final, nous ne l’avons pas signé… Et on a été jusqu’à le dénoncer car la fin de ces négociations s’est confrontée à l’actualité : la réforme du système ferroviaire ainsi que l’annonce de suppression d’effectifs. Il y avait là un paradoxe : comment la Direction pouvait être capable de s’engager sur la Qualité du Travail et dans le même temps, nous annoncer l’éclatement de l’entreprise en trois entités, ainsi que des suppressions d’emplois ? ! Nous craignions que si l’accord nous échappait, il puisse servir à mettre en place cette restructuration.
Il s’est passé le même scénario par la suite dans la fonction publique.
Là encore, un travail exemplaire y a été mené par notre organisation, avec créativité et engagement. Mais il a été percuté par l’actualité qui est venue tout anéantir, avec l’annonce de suppressions d’emplois, des réorganisations féroces, des non remplacements d’effectifs. La QVT paraît à côté de cela « hors sol » quant au quotidien des travailleurs – lesquels se retrouvent dans des situations de travail difficiles, qu’ils vivent pour beaucoup dans l’angoisse du lendemain.
Tout cela, au fond, illustre un manque de confiance qui n’est ni le fait des cheminots, ni de la CGT et de ses équipes militantes, mais des Directions qui négocient la QVT d’un côté et font des « coups bas » dans le dos des négociateurs syndicaux de l’autre (en n’annonçant pas les suppressions d’emploi ou les réorganisations). Pour sortir de l’ornière et avancer, nous avons besoin d’établir un tout autre climat, avec un maître mot : la loyauté, le retour à une morale et une éthique du côté des Directions.
Un mot sur « l’engagement ».
Les salariés sont engagés, investis dans leur travail ; sinon ça ne fonctionnerait pas. C’est parce qu’ils mettent leur intelligence au service de leur activité que des trains roulent, l’électricité arrive dans nos foyers, etc.
Une société dans laquelle les salariés ne seraient pas « engagés » dans ce qu’ils font, s’effondrerait très rapidement. Mais l’engagement dont les politiques des Ressources Humaines nous parlent n’est pas celui-là. Il s’agit en fait « d’adhésion » à la politique de l’entreprise, à ses projets et stratégies industrielles. On ne parle pas de la même chose.
Pour synthétiser nos propos nous pourrions dire que quand nous abordons le thème de la QVT (dans les médias, par exemple), nous parlons rarement de « choses qui fâchent » : ce qui est présenté comme relevant de la QVT est une liste de pratiques ou de projets « de bon sens » ou « consensuels » qui amélioreraient immédiatement la vie au travail des salariés, sans que rien dans leur activité professionnelle ne change véritablement. Or le travail est source et lieu de conflits, de controverse ! C’est inhérent au travail et c’est ça qui est facteur de santé.
De même, dans la « littérature » sur la QVT, il est rarement question de « la QVT et Santé des salarié.es », mais plutôt de la « santé » du marché et de l’Entreprise, de sa performance économique et de la compétitivité.
Et il nous semble qu’on assiste là, sur la question du travail à travers le prisme de la QVT, à un processus similaire au détournement managérial de la question de la mixité professionnelle Femme-Hommes, perceptible dès le début des années 2000 ( cf . Fortino et al. , 2009).
La mixité était devenue un thème consensuel pour aborder la question du droit des femmes en entreprise, de l’égalité femme-homme. Globalement, la « littérature » produite dans cette période a contribué à cette construction – le patronat comprenant que la mixité pouvait être moteur de performance et s’y engouffrant… mais en « négligeant » l’égalité professionnelle. Aujourd’hui, même là où des politiques volontaristes en faveur de l’égalité ont été déployées, les inégalités ont persisté.
Or, si l’on n’y prend garde, comme dans le cas de la mixité, la QVT peut très bien se passer de véritable progrès social et ne concerner que des éléments totalement anecdotiques de la vie des salariés.
De même la tentation de développer le numérique exclusivement dans la perspective d’avoir des entreprises plus compétitives existe également. Pourtant celui-ci pourrait être au service du travail et de la démocratie en entreprise.
Le passage par de l’expérimentation pour montrer les possibles est certainement une bonne démarche. Descendre sur la qualité du travail est la clé pour être dans le vrai et rentrer « dans le dur » des nécessaires transformations des situations de travail. Et le but de la démarche doit être la santé des travailleurs, sinon nous retomberons dans la distorsion développée ci-dessus.
Passer d’une approche segmentée à une approche systémique de la QVT
Par la CFTC
L’accord national interprofessionnel (ANI) du 19 juin 2013 « vers une politique d’amélioration de la qualité de vie au travail et de l’égalité professionnelle » a notamment pour objectif « de permettre, par une approche systémique, d’améliorer la qualité de vie au travail et les conditions dans lesquelles les salariés exercent leur travail et donc la performance économique de l’entreprise ».
Très peu de commentaires se sont intéressés à l’approche systémique prônée par cet accord. Elle est pourtant incontournable pour parvenir aux deux objectifs fixés par l’ANI : l’amélioration de la qualité de vie au travail et l’égalité professionnelle. D’ailleurs, dans son article 13, l’accord donne l’avertissement suivant : « L’approche systémique de la qualité de vie au travail et de l’égalité professionnelle a pour ambition de résoudre cette difficulté, en s’affranchissant des approches segmentées qui n’ont pas donné jusqu’à ce jour les résultats escomptés, pour à la fois améliorer la qualité de vie au travail et faire progresser l’égalité professionnelle et la conciliation des temps. »
Chacun a puisé dans l’ANI comme dans un livre de recette y voyant tantôt un outil de prévention des risques psychosociaux (à travers la liste des indicateurs en annexe de l’accord), tantôt le moyen d’atteindre le bonheur des entreprises (augmentation de la performance) en s’appuyant sur un dialogue social focalisé sur la liste indicative des thèmes qui seront à traiter par le dialogue social (article 15).
Du diagnostic partagé à la mise en œuvre d’un plan d’action visant à améliorer la qualité de vie au travail, le travail à réaliser est considérable. C’est peut-être pour cette raison que la plupart des acteurs ont tout simplement ignoré l’approche systémique continuant ainsi à promouvoir une vision segmentée des problématiques abordées par l’ANI.
Pour la CFTC, la qualité de vie au travail passe par l’interrogation du travail lui-même, les conditions du travail (salaire, transport, logement, environnement économique…) tout autant que les conditions de travail (santé au travail, organisation du travail, environnement de travail…). Ces deux éléments étant indissociables dans la recherche d’une qualité de vie dans laquelle le travail s’intègre à la fois comme un facteur de bien-être social et de développement personnel.
Cette réflexion sur les conditions dans lesquelles s’exercent les métiers, leurs relations avec les différents acteurs dans et autour de l’entreprise conduit à repenser l’organisation du travail. Cette refondation co-construite du système propre à l’entreprise qui s’engage dans la démarche redonne du sens au travail et permet de mieux identifier les déterminants de la performance globale de l’entreprise.
La CFTC a insisté sur la prise en compte du travail réel par le développement des capacités d’expression des salariés et que l’organisation du travail devienne un objet de dialogue social. Pour être efficace, ce travail sur la qualité de vie au travail doit être porté par la direction de l’entreprise et impliquer l’encadrement dans une démarche d’amélioration continue des conditions de/du travail.
La CFTC est attachée à l’absence de discrimination quelle qu’en soit la nature. L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, mais aussi l’égalité professionnelle entre les personnes exerçant le même métier dans les mêmes conditions. Cette absence de discrimination permet la reconnaissance du travail collectif accompli et promeut le bien-être au travail.
Pour la CFTC, la conciliation entre la vie personnelle et la vie professionnelle est une des clés essentielles au développement de la performance de l’entreprise et du bien-être au travail. La prise en compte des situations particulières liées aux contraintes du travailleur comme le handicap ou la situation d’aidant familial. Cette conciliation nécessite, au-delà d’ajustements propres à l’entreprise (aménagements d’horaires, télétravail, etc.), un dialogue avec les collectivités locales ou régionales sur l’aménagement du territoire : infrastructures d’accueil (logement, crèches…) et de communication et de transport.
La CFTC considère que la qualité de vie au travail est notamment déterminée par le soin apporté à la préservation de la santé des travailleurs, au maintien et au développement de leurs capacités de travail par une formation professionnelle continue adaptée et aux efforts de prévention de la désinsertion professionnelle des travailleurs les plus fragiles. La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) est un des outils permettant de déterminer les actions à conduire.
Enfin, les approches segmentées traitant par exemple séparément l’égalité professionnelle, la lutte contre les risques psychosociaux, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, la sécurité, l’environnement économique et social de l’entreprise, ne permettent pas d’assurer l’adaptabilité de l’entreprise aux incessants changements imposés par son environnement.
Pour la CFTC, la qualité de vie au travail est en effet un levier de la compétitivité des entreprises si elles acceptent de repenser leurs organisations du travail dans une approche systémique de l’entreprise et de son environnement qui ne laisse de côté aucun des aspects des conditions du travail et des conditions de travail. Un diagnostic partagé par l’ensemble des acteurs de l’entreprise et un plan d’action concerté défini par le dialogue social sont les clés de la réussite de la démarche de développement de qualité de vie au travail au service de la performance globale de l’entreprise.
S’adapter ou mourir
Par François Pellerin, Animateur du projet Usine du futur de la Région Nouvelle-Aquitaine
Les entreprises qui ne passeront pas sur un mode de fonctionnement en équipes autonomes , décloisonnées entre elles, sont en grand danger. Tout pousse vers un nouveau modèle d’organisation du travail plus transversal : le numérique, le lean , l’arrivée de la nouvelle génération, l’agilité, l’innovation, la complexité. La tension entre le modèle hiérarchique traditionnel français et ces tendances émergentes va devenir insoutenable.
Cette étude de La Fabrique de l’industrie, en coopération avec l’Aract Ile-de-France et Terra Nova, qui approfondit l’impact des organisations sur la qualité de vie au travail et promeut l’autonomie au travail, arrive à point nommé.
Il ne faut pas s’y tromper, le retentissement considérable en France du livre de Getz et Cartney « Liberté & Cie » ( op.cit. ) est le révélateur d’une faille qui ne cesse de s’agrandir entre le modèle traditionnel hiérarchique français, fils de notre tradition étatique colbertiste et de l’organisation scientifique du travail de Taylor, et les aspirations profondes des individus au travail vers plus de sens, de reconnaissance et d’autonomie.
De plus, le fossé se creuse aussi entre les discours véhiculés par l’entreprise sur les attentes en termes de responsabilisation, leadership et compétences d’une part, et les pratiques quotidiennes de travail, le contrôle permanent et le reporting étouffant d’autre part.46
Des leviers puissants poussent pourtant vers un nouveau modèle organisationnel plus souple et plus transversal.
La transformation numérique ne s’accommode pas du silo et de la pyramide. Le lien hypertexte, le réseau internet, les pratiques collaboratives et les réseaux sociaux sont transversaux par nature. La nécessaire circulation de l’information dans les projets digitaux nécessite une organisation ouverte, transparente, organique47. La continuité de la chaine jusqu’au client, et la fluidité des interfaces avec lui, vont dans le même sens. Il est d’ailleurs frappant de constater que la quasi totalité des start-up du numérique des années 1990 et 2000 qui sont devenues des grands groupes ont gardé un modèle d’organisation souple, même si la plupart d’entre elles ont mis en place des éléments de hiérarchie (Google, Facebook, Netflix, Spotify, Linkedin…)
Le déploiement du Lean manufacturing en France est particulièrement révélateur des limites de notre modèle hiérarchique. Dans les années 1990 et 2000, une version tronquée du lean a été déployée top-down. Des gains rapides ont été recherchés sans prendre en compte la nécessaire appropriation par les équipes. On a alors vu le projet se résumer à chronométrer les opérateurs, induisant du même coup des TMS. Le résultat a été catastrophique en terme d’engagement des équipes et les gains de productivité initialement réalisés ont été perdus. Le déploiement du lean a été repris depuis la fin des années 2000 dans de bien meilleures conditions en prenant pleinement en compte le respect des personnes48 et en s’appuyant, dans les expériences les plus réussies, sur des équipes autonomes49. Les gains économiques ont alors été à la fois considérables et durables. En effet, le cœur de la démarche est l’amélioration continue par la base (le Kaizen), et le succès est maximum lorsque les équipes prennent leurs décisions en autonomie. On a alors des améliorations plus pertinentes et mieux appliquées. « Les individus ne s’engagent entièrement que dans des actions dont ils ont pu déterminer les objectifs de façon autonome » expliquent A. Léonard, A. Guedira de la communauté Ouishare.50
Cette (r)évolution est attendue par les digital natives comme le confirme l’étude récente BNP Paribas/The Boson Project.51 Rejetant le modèle hiérarchique, ils sont entrepreneurs dans l’âme (47 % souhaiteraient créer leur entreprise) et entrepreneurs d’eux mêmes (84 % choisiront leur métier par passion). Ils recherchent une entreprise fun, innovante, éthique et internationale, et des missions variées. L’entreprise dont ils rêvent est plus confiante, plus agile, plus « flat », plus humaine, plus égalitaire, plus flexible, plus porteuse de sens, plus ouverte.
On comprend mieux le phénomène du job out52, consistant à stopper une carrière peu après l’entrée sur le marché du travail, pour s’abstraire d’une hiérarchie écrasante, de tâches monotones, du sentiment de ne pas participer au bien commun, du manque de reconnaissance.
Dans ce contexte, pour attirer les talents…et les retenir, une profonde transformation des entreprises est nécessaire, et les premières marches sont le sens et l’autonomie.
Dans ce monde complexe et incertain, l’agilité des organisations est capitale. L’enjeu est la capacité de réaction à une évolution de l’environnement. Là encore, la structure hiérarchique traditionnelle est dépassée : la remontée des informations terrain jusqu’à la tête et son appropriation par la chaine hiérarchique induisent un temps de réaction inapproprié. Une analogie est le mode réflexe dont les animaux sont dotés et qui permet de réagir instantanément en cas de danger. La fonction réflexe ne remonte pas au cerveau, c’est un mode de réaction local. L’agilité est une caractéristique des start-up et une faiblesse des grandes organisations. Pourtant, General Electric a déployé depuis 2014 une nouvelle stratégie. Baptisée « Fastworks » et basée sur les méthodes agiles (Lean Start up), elle promeut aussi la responsabilisation et l’autonomie des salariés.
Dans le modèle taylorien qui nous est encore trop souvent imposé, l’innovation et la créativité sont le privilège de quelques uns : la fonction R&D, la fonction méthode, l’encadrement (ceux qui sont censés savoir). De plus cette minorité est parcellisée et enfermée dans des silos qui empêchent la circulation de l’information et les échanges. La créativité et l’innovation sont étouffées. Dans l’entreprise de demain, l’innovation et la créativité sont l’affaire de tous : de l’ouvrier dans l’atelier, à la fonction RH et au marketing. Les innovations sont partout : produits et process, mais aussi relation client, organisation et RH, et la créativité est stimulée par le contact entre des profils et des parcours variés. Le changement culturel est de faire prendre conscience à chacun de sa capacité de créer et d’innover. Le temps où l’ouvrier n’était pas là pour penser mais pour exécuter est révolu.
Dans un monde globalisé, complexe et incertain, il faut trouver le bon équilibre entre efficacité (point fort de la grande entreprise) et adaptabilité (caractéristique de la start-up), c’est-à-dire entre contrôle et autonomie. Plus l’environnement est complexe et plus l’autonomie doit être élevée53. L’exemple de l’organisation adoptée par le général McChrystal (voir Team of teams54) pour faire face à la disruption djihadiste en Irak est édifiante : organisation souple, décentralisation des décisions lui ont permis de retourner à son avantage une situation compromise. La surprenante efficacité de cette nouvelle organisation est ici encore due à la pertinence des décisions prises au niveau du terrain, mais aussi au fait qu’une personne qui prend une décision devient plus investie dans son résultat. D’autre part, McCrystal nous montre que l’autonomie des équipes exige une vision commune qui est fondée sur la libre circulation de l’information, la transparence et la confiance.
Il faut donc débloquer la structure hiérarchique à la fois verticalement (autonomie) et latéralement (supprimer les silos pour fluidifier la circulation de l’information entre fonctions de l’entreprise). C’est à cette dernière condition que la vision commune peut être construite. Les équipes autonomes ont besoin de connaître l’environnement dans un contexte large pour prendre les bonnes décisions.55
Ces deux déblocages (vertical et horizontal) sont la condition pour créer la confiance entre salariés et dirigeants d’une part, et entre fonctions de l’entreprise d’autre part.
- 46. La transformation numérique de l’entreprise et de ses mythes, par Aurélie Dudezert, theconversation.fr, 11/07/2016.
- 47. Le succès du management horizontal dans les projets digitaux, par Kilian Bazin, linkedin.com, 06/04/2016.
- 48. Voir Roche (2016).
- 49. « Comment Michelin “libère” ses cols bleus » par Nicolas Lagrange, Liaisons Sociales Magazine, 21/10/2015.
- 50. « Société collaborative : La fin des hiérarchies », Ouishare, Rue de l’Echiquier, 2015.
- 51. Étude sur la Génération Z « La Grande InvaZion », janvier 2015.
- 52. « Le job-out ou l’art de quitter une carrière bien rangée », par Guirec Gombert, regionsjob.com,11/08/2015.
- 53. « L’obsession de l’efficacité, et ses dégâts dans les entreprises », par Willy Braun, Paristech review.com, 22/06/2016.
- 54. General Stanley McChrystal, Team of teams, Portfolio Penguin, 2015. S’adapter ou mourir La qualité de vie au travail : un levier de compétitivité
- 55. « La complexité, un défi pour nos organisations », linkedin.com, par François Pellerin, 02/09/2016.
Créer les conditions de l’entreprise responsabilisante
Par Yves Trousselle, Directeur RSE & SSE & Projets du groupe Aigle International ainsi que président du réseau RSE Altère depuis 2016 (Nouvelle-Aquitaine).
Depuis toujours, l’entreprise et plus particulièrement son organisation cherche à améliorer sa performance financière (au sens rentabilité) par l’innovation organisationnelle. Ces actions portent sur l’organisation du travail. On pense ici au taylorisme, fordisme, toyotisme pour les plus connus. Cela aboutit à la reconfiguration des processus opérationnels industriels et/ou administratifs par la robotisation/informatisation, par le reengineering des processus, par le lean… Ces changements organisationnels ont donné lieu à de nombreux projets stratégiques d’entreprise pilotés de manière centralisée par une maîtrise d’ouvrage et une maîtrise d’œuvre à la manœuvre c’est-à-dire une organisation de projet respectant strictement les préceptes méthodologiques établis, issus de projets antérieurs et dont on duplique souvent les principes sans prendre suffisamment en compte le contexte nouveau, notamment humain. Certes, des moyens sont bien consacrés à l’accompagnement des salariés (formation, participation aux réunions d’améliorations continues…) mais on est encore loin de considérer en priorité et en amont les conditions de travail de demain du salarié après changements mis en place. Le salarié reste en effet souvent considéré et traité comme un « impacté » par le changement plutôt que d’en être au cœur.
1. Du salarié impacté au salarié responsable
Placer le salarié au cœur du changement organisationnel en lui donnant envie et moyens d’en être responsable plutôt que d’en être « accompagné » est l’une des caractéristiques principales de l’entreprise responsabilisante. Cette responsabilisation de/dans l’entreprise peut être obtenue grâce à la confiance donnée par les propriétaires /actionnaires de l’or ganisation à ceux qui ont en charge de la faire bien fonctionner à savoir les différents salariés : les directeurs, employés, ouvriers, cadres,… Cette confiance est obtenue par ces mêmes salariés lorsque ceux-ci ont su/pu démontrer leur engagement sincère à vouloir améliorer durablement la performance de l’entreprise.
Ces engagements des salariés et cette confiance des « propriétaires » seront plus large ment obtenus si l’entreprise met en place une réelle stratégie RSE (Responsabilité sociale, sociétale et environnementale) et des projets concrets et pragmatiques pour la mettre en œ uvre. S’engager dans une démarche responsabilisante RSE, c’est pour les actionnaires et le chef d’entreprise faire le pari que la majorité de ses salariés est prête à s’engager demain pour une performance durable de l’entreprise. Il s’agit en effet pour tous de s’engager à préserver sur la durée les ressources naturelles , humaines et sociétales utilisées pour faire son travail au quotidien. S’investir pour améliorer la qualité de vie au travail est un des leviers majeurs pour préserver les individus sur la durée.
J’ai cette grande chance en tant que directeur RSE chez Aigle de pouvoir compter sur cette confiance réciproque actionnaires/salariés. Aigle a 163 ans d’existence. Les différents actionnaires qui se succèdent depuis plus 20 ans continuent à s’inscrire sur la durée avec Aigle plutôt que de rechercher le profit à très court terme. J’ai également pu juger de l’engagement durable de nos salariés. Lorsque j’ai créé en 2014 la direction RSE chez Aigle, j’ai demandé s’il y avait des volontaires pour former « bénévolement » un club RSE en interne pour nous aider à promouvoir le développement durable chez Aigle. Plus de vingt-cinq collaborateurs de tous horizons ont répondu spontanément présent pour intégrer ce club, ce nombre a doublé l’année suivante.
2. Des pistes pour l’action
On peut se demander pourquoi l’entreprise responsabilisante et ces changements d’organisations basés sur l’individu et sur la qualité de vie au travail font encore débat chez les décideurs.
Le premier frein provient en partie du lourd héritage managérial qui préconise de scinder décisions et exécution, de découper le travail en tâches répétitives et spécialisées, de centraliser nombre de fonctions (les fonctions supports)… Ces recettes ont, en leur temps, fait leurs preuves, mais elles réduisent énormément le potentiel de responsabilisation salariale. Ces normes de « Best Practice » étaient fondées en des temps de croissance, de stabilité et du « temps lent ». Il faut en ces périodes turbulentes, moins lisibles et presque sans plus aucune contrainte géographique et temporelle requestionner ces acquis et rééquilibrer les choses pour plus d’agilité.
Quelques suggestions (vécues) de rééquilibrage :
- rouvrir le dialogue social à tous les niveaux de l’entreprise (et plus seulement entre instances représentatives du personnel et la direction),
- ne plus seulement s’intéresser au travail prescrit mais observer et comprendre le travail réel pour l’améliorer,
- redonner un poids plus important à la réussite collective en recalibrant les primes variables liées à la performance individuelle…
Lancer un projet QVT, c’est décider d’examiner tous ces possibles rééquilibrages. Permettre à chacun de contribuer à y réfléchir et à gérer les changements qui l’entourent, c’est mettre en place un contexte « responsabilisant » . C’est aussi réguler finement et au plus près du terrain ces choix managériaux antagonistes (centraliser/décentraliser…) en fonction des contextes (compétences et disponibilités individuelles, ententes et forces des collectifs, situation de travail : nouvelle ou rodée, variable ou prévisible …) en recueillant objectivement les avis des personnes concernées. J’ai à ce sujet pu expérimenter de très bons outils « QVT » proposés par les Aract (préconisés pour la prévention des risques psychosociaux) comme l’analyse des « Situations problèmes », le modèle « C2R » (Contraintes, Ressources, Régulations) facilitant le fonctionnement des espaces de discussions (voir p.48).
Cependant, se lancer dans ces changements d’habitudes nécessite du temps et donc de l’argent pour l’entreprise. C’est un co û t dont le retour d’investissement reste très difficile à calculer . C’est le second frein pour l’entreprise responsabilisante. Si intuitivement on perçoit bien une relation entre la qualité de vie au travail, engagement au travail et une meilleure rentabilité du travail réalisé, il est difficile de dire de combien et quand la rentabilité deviendra meilleure.
En matière de gouvernance d’entreprise, le choix de la mise en place d’une démarche générale responsable d’entreprise et plus particulièrement d’une démarche de qualité de vie au travail reste donc à ce stade plus une affaire de conviction personnelle, de choix de positionnement stratégique d’avenir que de décision managériale rationnelle et démontrable. Sur ce point Aigle a passé le pas pour aller progressivement d’une gestion des ressources basée sur une vision DRH « industrielle » : prix de revient et frais fixes du personnel vers une vision « business support » et une approche coûts et retour sur investissement des collaborateurs.
À titre individuel, en tant que manager, prendre la décision de ce changement de paradigme, c’est accepter de ne plus faire les choses telles qu’on les a apprises et telles que déjà vécues. C’est décider de sortir de sa zone de confort. C’est savoir perdre du temps aujourd’hui à semer ces changements pour n’en récolter les fruits que demain. C’est prendre le risque d’innover et donc peut-être d’échouer. L’échec, c’est aussi ce qui peut arriver au « managé » qui a décidé de s’engager personnellement pour proposer à son responsable de faire son travail différemment plutôt que de se contenter d’exécuter consignes et procédures organisationnelles. L’échec est la rançon de l’innovation. Mais l’entreprise responsabilisante est une entreprise qui sait « sécuriser » l’engagement de ses collaborateurs, quel que soit leur niveau hiérarchique. C’est celle qui sait non seulement pardonner les échecs, mais qui sait en plus les faire fructifier. L’entreprise responsabilisante va donc de pair avec l’entre prise innovante et apprenante. Trois voies à suivre assurément pour une compétitivité renforcée.
L’entreprise libérée et la qualité de la vie
Par Isaac Getz, Professeur à l’ESCP Europe
Comme en témoigne cette étude sur la qualité de vie au travail, l’entreprise libérée rencontre un vif intérêt en France, auprès des acteurs de l’entreprise et des chercheurs. Je profite de l’invitation de ses auteurs pour évoquer mon aventure intellectuelle autour de ce phénomène et de son lien avec la qualité de vie en général.
Dès le début de notre recherche avec Brian Carney en 2005, des patrons libérateurs nous ont entretenus de sujets philosophiques : pourquoi on se lève le matin, ce qu’est la vie bonne. En ethnographes, nous les avons notés avec attention et – surprise. Nous aussi, nous voulions comprendre comment « ça marche », comment sont organisées ces entre prises fondées non plus sur le pouvoir mais sur la responsabilité, non plus sur le contrôle mais sur la liberté. Nous cherchions des pratiques à ériger en modèle et n’en avons trouvé aucune qui soit universellement présente. Dans toutes les entreprises étudiées, nous avons rencontré beaucoup de salariés au visage souriant, qui nous renvoyaient au concept philosophique de la « vie bonne » déjà entendu chez leurs patrons – et non à un modèle d’organisation. Ainsi, le phénomène étudié nous a imposés, à nous les chercheurs, sa nature philosophique – et non celle d’un modèle d’organisation. En 2009, nous publiions les résultats de nos recherches.
1. De l’entreprise du père à l’entreprise des pairs
J’avais alors introduit dans un article académique le concept d’entreprise libérée comme étant « une forme organisationnelle dans laquelle les salariés sont totalement libres et responsables des actions qu’ils jugent bon d’entreprendre pour l’entreprise » (le terme en anglais était freedom-form company)91. C’est là une définition philosophique, qui n’évoque pas de caractéristiques structurelles (comme l’absence ou la présence d’une hiérarchie ou d’une pointeuse) mais une fonction : permettre la liberté et la responsabilité de l’action, concepts éminemment philosophiques.
Les définitions par fonction plutôt que par structure sont inhabituelles dans les sciences organisationnelles, mais courantes en ingénierie. Un pont est un ouvrage permettant le pas sage par-dessus un obstacle, un aqueduc permet à l’eau de couler par-dessus un obstacle. Les ponts et les aqueducs peuvent partager les mêmes caractéristiques structurelles, comme le prouve le Pont – l’aqueduc – du Gard. Les ingénieurs admettent que le pont soit défini par sa fonction, et non par un modèle, mais les chefs d’entreprise et les chercheurs acceptent plus difficilement que la notion d’entreprise – comme l’entreprise libérée – le soit aussi. C’est qu’il y a depuis Taylor plus d’un siècle de pensée organisationnelle fondée autour des modèles.
On comprend alors qu’il faut être philosophe pour construire une entreprise libérée. Il s’agit d’un acte de foi : croire que les hommes veulent la liberté et peuvent assumer la responsabilité qui va de pair. Les patrons philosophes ne datent pas d’hier. Au XIXe siècle, Robert Owen, qui faisait visiter ses filatures aux grands de ce monde, croyait que les ouvriers méritaient des conditions dignes de travail et de vie. À la fin du XVIIIe siècle déjà, le célèbre fabricant de porcelaine Josiah Wedgwood avait les mêmes convictions et fournissait logis et services médicaux aux ouvriers. C’est ce que l’on nomma plus tard « paternalisme », consistant en l’échange de la protection des salariés contre leur obéissance – protection matérielle contre obéissance existentielle. Car Wedgwood, bien que leur fournissant de bonnes conditions de travail, ne faisait pas confiance à ses ouvriers et avait installé des pointeuses. Il visait les besoins matériels des ouvriers mais non pas leurs besoins existentiels, appelés aujourd’hui psychologiques.
Il a fallu attendre les années 1920 pour que le tchèque Tomas Bata, fabricant de chaussures, abandonne la logique paternaliste pour bâtir son entreprise autour des besoins psychologiques de ses salariés – respect, responsabilité, confiance dans leur intelligence, équité, réalisation de soi et autodirection. Bata disait « La réflexion est pour les gens, le travail pour les machines ».92 C’est la fonction, finalité philosophique qu’il attribuait à son entreprise – servir le bien commun – qui a amené Bata à prendre en compte les besoins psychologiques de ses salariés. En France aussi, il existait avant les années 1950 des patrons qui ressemblaient à Bata, selon l’ancien Cégétiste Hyacinthe Dubreuil.93
C’est seulement dans les années 1960 que les premiers patrons-philosophes, au rang desquels Bill Gore de W.L. Gore et Robert Townsend de AVIS, construisent systématiquement leurs entreprises autour des besoins psychologiques des salariés.94 La psychologie, avec la théorie de la hiérarchie des besoins publiée en 1943 par Abraham Maslow, est venue appuyer les convictions philosophiques de ces patrons. Maslow ne s’intéressait pas au monde organisationnel et c’est un autre psychologue, Douglas McGregor, qui a traduit en 1960 sa théorie en attitudes managériales réalistes. A savoir, que les gens cherchent à donner le meilleur d’eux-mêmes, qu’ils recherchent la responsabilité, qu’ils sont intelligents et créatifs. Il a appelé l’ensemble de ces attitudes « Théorie Y », et l’a opposé à un autre ensemble d’attitudes – appelé « Théorie X » – dont la principale est que les salariés auraient une aversion intrinsèque pour le travail et préféreraient être dirigés afin d’échapper aux responsabilités. La Théorie X pose le problème de la direction des salariés, problème dont la solution consiste dans le modèle organisationnel hiérarchique.95 McGregor était convaincu que la théorie Y triompherait de la théorie X, non-fondée psychologiquement, et qu’en dix ans toutes les entreprises développeraient des modes organisationnels autour de l’autocontrôle et de l’autodirection. Entre 1960 et 2010, les entreprises qui l’ont fait ne se comptent qu’en dizaines…
Mais alors, pourquoi si peu d’entreprises l’ont fait ? Et surtout pourquoi, depuis 2010, est-ce que des centaines d’entreprises sont entrées en libération en France et en Belgique ? J’ai tenté de répondre à la première question dans plusieurs publications auxquelles je renvoie le lecteur.96 Laurent Marbacher et moi avons proposé une réponse à la deuxième question dans un texte paru dans l’ouvrage collectif « Entreprises vivantes ».97 Et c’est là l’enjeu : qu’est-ce que la vie bonne dans l’entreprise ?
2. La vie bonne dans la société bonne
Aristote disait déjà que la véritable question n’était pas de réussir dans la vie – de la cité, de la famille – mais de réussir une vie bonne. Cette tradition s’est poursuivie jusqu’au XX e siècle, et notamment chez les penseurs de l’entreprise, à l’image de McGregor, qui s’interrogeait non sur l’organisation pour rendre performante l’entreprise, mais sur celle qui était bonne pour les besoins psychologiques des salariés. Comme Aristote, il cherchait la « société bonne » . Robert Greenleaf, l’inventeur du leadership serviteur , se posait la même question : « Une société [humaine] bonne voit le jour lorsque beaucoup de gens réalisent leur potentiel grâce à des contributions nombreuses et variées. »98
En ce sens, l’entreprise libérée est une réponse possible aux patrons qui cherchent à construire une société bonne. Bill Gore, le premier leader libérateur de l’histoire, disait ainsi : « L’un des buts d’une société [humaine] bonne vise à donner l’occasion à chaque être humain de maximiser ses réussites. »99 Bâtir un environnement dans lequel les salariés jouissent de leur liberté et de leur responsabilité d’action – deux ingrédients essentiels d’une vie bonne – voilà la raison d’être de l’entreprise libérée, sa finalité philosophique. Jean-Michel Guillon, directeur du Personnel du groupe Michelin, abonde dans le même sens : « Le concept d’entreprise libérée nous intéresse car elle permet de revenir aux fondamentaux de l’entreprise qui est l’humain . Notre leitmotiv historique reste » Deviens ce que tu es « ».100 La finalité de la démarche de libération de Michelin, qu’ils nomment « responsabilisation » est précisément de créer un environnement dans lequel chacun puisse se réaliser et s’épanouir – vivre une vie bonne.
On comprend pourquoi les leaders des entreprises libérées ne citent pas de chiffres pour prouver que « ça marche » . Ils préfèrent, comme Stéphane Magnan, évoquer cet ouvrier qui ne baisse plus les yeux quand il lui adresse la parole, comme Jean-François Zobrist, remarquer que les opératrices ont commencé à mettre du rouge à lèvres, comme Stanislas Desjonquères, parler d’ouvriers qui « bombent le torse ». Ou un tel patron libérateur à qui un jour un opérateur a confié un secret que même sa famille ignorait – qu’il ne pouvait pas lire et écrire – en lui demandant de lui apprendre. Certes, les patrons libérateurs disent que l’argent est important pour l’entreprise libérée. Mais ce n’est pas sa finalité, c’est la résultante du fait que les gens sont biens dans l’entreprise et donnent le meilleur d’eux-mêmes. Si ces exemples et arguments ne sont pas convaincants aux oreilles de tous, ils le sont pour ces leaders qui ont créé un environnement de travail dans lequel les gens mènent une vie bonne – eux-mêmes compris.
- 91. I. Getz, «Liberating Leadership: How the Initiative-Freeing Radical Organizational Form Has Been Successfully Adopted », California Management Review, Summer 2009, p.34 (republiée comme « Le leadership libérateur, forme radicale de l’organisation » dans L’Expansion Management Review, septembre 2010, pp.63-81).
- 92. I. Getz, « L’entreprise libérée : Sa notion, son processus de libération et ses antécédents ». In J.-M. Saussois (Dir.), Les organisations : États des savoirs, Editions Sciences Humaines, 2016, pp.420-430.
- 93. On peut lire les vues de ce penseur majeur de l’organisation qui présageait l’entreprise libérée dans Isaac Getz, La liberté, ça marche !, Flammarion, 2016. L’entreprise libérée et la qualité de la vie
- 94. On peut lire leur vues philosophiques et psychologiques dans I. Getz, La liberté, ça marche !, ibid.
- 95. Car la hiérarchie constitue la solution mathématique permettant de diriger le maximum de salariés avec le minimum de managers ; cf. M. Halévy, Petit traité de management postindustriel, Dangles, 2010.
- 96. L’article de 2009 déjà cité ; le livre co-écrit avec B. Carney « Liberté & Cie », nouvelle édition, Flammarion 2016 ; l’article « Des salariés libres d’agir : théorie ou destin ? » Gérer et Comprendre, Juin 2012, 27-38 ; « L’entreprise libérée : Sa notion, son processus de libération et ses antécédents », ibid.
- 97. « L’entreprise libérée : Une philosophie pratique stimulée par un écosystème », dans l’ouvrage collectif sous la direction de M. Mack et Ch. Koehler, Entreprises vivantes : Ensemble, elles peuvent changer le monde, 2016, pp.17-39 (téléchargeable sur www.nouvelles-logiques.info)
- 98. Cité dans I. Getz, La liberté, ça marche !, ibid., p.127.
- 99. Ibid., p.199.
- 100. Interview lors des rencontres ANDRH, Le Journal de l’éco.fr, 2015 (https://www.youtube.com/watch?v=EMJjQ045FZs; consulté 24 août 2016).
Collectivités territoriales : repenser le travail pour repenser l’action publique
Par Marie-Laure Signoret, Directrice de Pôle dans une ville de 10 000 habitants
La fonction publique territoriale, dans la quelle je travaille, pourrait avoir un rôle important à jouer dans la transformation d’organisations du travail obsolètes en organisations du travail responsabilisantes.
Le système hiérarchique y est ultra-pyramidal : un maire, puis des élus, puis une direction générale des services, puis des directeurs adjoints, puis des directeurs de pôles, puis des chefs de services.
À cela s’ajoute la difficile question de la double direction : politique et administrative. Les ordres proviennent à la fois des élus et de la direction générale.
Le baromètre 2015 du bien-être au travail dans la fonction publique territoriale (réalisé par la Gazette des Communes, N.D.E) montre une dégradation alarmante de la qualité de vie au travail, particulièrement chez les cadres. Sur 5 000 agents interrogés, 60 % déplorent l’indifférence des élus à leur égard et 57 % notent une pression croissante dans leur travail. 48 % des cadres ne s’épanouissent pas, 55 % d’entre eux n’entrevoient pas de perspectives professionnelles et 72 % n’ont pas confiance dans l’avenir du service public.
Il y a une vraie perte de sens dans le travail, accompagnée d’un manque de vision politique et d’une volonté marquée de ne pas partager une once de pouvoir. Et c’est bien là le problème.
Ce système d’organisation du travail est improductif. Pire, il provoque un mal-être au travail qui renforce l’absentéisme. Les jeunes cadres qui entrent dans la fonction publique territoriale aujourd’hui n’ont pas le même rapport au travail que leurs aînés. Ils veulent pouvoir partager les décisions, les comprendre, participer aux définitions stratégiques de leur collectivité parce que, pour eux, l’action publique est encore porteuse de sens. S’opère alors un véritable choc des générations entre des managers et des élus de l’ancienne école, pour qui un ordre est un ordre, et des jeunes cadres qui cherchent à comprendre et à partager.
Nos organisations publiques auraient tout à gagner à modifier leur système décisionnel. Les services publics pourraient ainsi être repensés à l’aune des nouvelles attentes de nos concitoyens. L’action publique en elle-même pourrait se démocratiser et répondre ainsi à la demande toujours plus forte de participation. Les élus pourraient enfin montrer qu’ils ont compris les signaux forts régulièrement envoyés par les électeurs, en partageant le pouvoir et la prise de décision et en faisant confiance à ceux qui détiennent la légitimité technique.
Je rêve de collectivités publiques capables de devenir de véritables laboratoires repensant le travail et le lien entre les citoyens et les organisations.
La qualité de vie au travail, composante majeure de la stratégie de l’entreprise
Par Hervé Lanouzière, Directeur Général de l’Anact
Depuis 2010 et la remise au Premier ministre de l’époque du rapport d’Henri Lachman, Muriel Pénicaud et Christian Larose « Bien-être et efficacité au travail », le concept de qualité de vie au travail et les démarches qui s’en réclament ont gagné une large audience auprès des acteurs sociaux et des pouvoirs publics : les partenaires sociaux ont conclu en 2013 un accord interprofessionnel innovant par sa conception et ambitieux dans son contenu ; les entreprises sont désormais tenues (depuis la loi sur le dialogue social et l’emploi d’août 2015) de négocier annuellement sur un « paquet thématique » « égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail ». Et sur un plan plus institutionnel, « Améliorer la qualité de vie au travail, levier de santé, de maintien en emploi des travailleurs et de performance économique et sociale de l’entreprise » constitue l’une deux priorités stratégiques du 3 e Plan Santé au Travail, qui doit orienter les différents acteurs de la prévention jusqu’en 2020.
La France semble ainsi, quelques décennies après les pays anglo-saxons et d’Europe du Nord, « découvrir » le potentiel d’une action sur les différentes dimensions constitutives de la qualité de vie au travail pour améliorer la performance durable de l’entreprise. Même si la dynamique de négociation à la suite de l’ANI de 2013 n’a pas été aussi forte qu’escomptée (mais le contexte économique y est pour beaucoup), la concertation et la négociation sur ce thème tendent à se développer, quantitativement et qualitativement. Les acteurs du dialogue social ont pris conscience que les maux du travail ne trouveront pas réponse seulement avec la prévention classique, et que les nouveaux équilibres socio-économiques ne pourront être atteints simplement avec les méthodes habituelles d’accompagnement du changement ou d’optimisation de la performance opérationnelle.
Pourtant, il n’est pas certain que la notion de QVT, en devenant de plus en plus populaire, ne soit pas en train de se diluer et de perdre tout ce qui fait l’originalité et la puissance de sa « proposition de valeur ». Il suffit de regarder du côté de l’offre pléthorique de conseil sur la QVT pour constater que la plasticité de la notion, dans un pays ou elle ne s’est acclimatée que très récemment, permet de la « mettre à toutes les sauces » : l’acronyme « QVT » devient le véhicule des pratiques les plus diverses allant de l’hygiène de vie (sport, lutte contre le tabagisme, diététique, méditation…) à l’outillage gestionnaire ( lean…) ; tantôt associée à des notions philosophiques (le bonheur…), tantôt à des aspects plus terre à terre (aménagement d’espaces récréatifs, séances de massages…), ou encore à des nouveaux « modèles » de management (l’entreprise libérée…). On aboutit à une situation paradoxale où les acteurs dans les entreprises souffrent à la fois d’une surabondance d’informations sur le sujet et d’un manque de repères clairs et stabilisés pour agir efficacement.
Personne ne peut nier qu’il est agréable de pouvoir bénéficier, sur son lieu de travail, de services personnalisés pour prendre en charge certaines contraintes domestiques ou d’un équipement ludique pour faire une pause entre collègues. Mais réduire la QVT à cela, c’est un peu comme croire que c’est en installant une table de ping-pong qu’une entreprise va acquérir l’esprit start-up…
Le grand mérite de cette publication est précisément de clarifier un certain nombre d’ambiguïtés, et de donner à ses lecteurs des clés pour comprendre en quoi une démarche QVT doit s’axer sur l’essentiel pour réellement tenir sa promesse : cet « essentiel », c’est une organisation de travail qui porte l’autonomie et la responsabilisation des salariés, permet une expression individuelle et collective sur la manière dont le travail se fait et promeut des modes de management qui génèrent de l’engagement.
On le voit, on est loin de la table de ping-pong, et on comprend qu’un tel degré d’ambition puisse effrayer. Il effraye d’autant plus que le terreau français des relations sociales et de la culture managériale ne prédispose pas à la prise de risque et à sortir des sentiers battus. Quel sens donner au travail ? Quels liens établir entre l’engagement des salariés et la performance collective ? Offrir des réponses organisationnelles à ces questions suppose d’agir sur le registre du dialogue professionnel plus que sur celui du dialogue social traditionnel : espace de discussion sur le travail, décloisonnement entre les concepteurs et les opérationnels, intégration de l’analyse du travail dans la conduite des projets de transformation… Des apprentissages collectifs importants sont nécessaires ici, qui nécessitent d’innover sur un autre registre, méthodologique celui-là : avec des méthodes, un outillage, des savoirs pratiques.
Les nombreux exemples de démarches d’entreprise présentées dans l’ouvrage devraient inciter à passer à l’action : porter la QVT comme composante majeure de la stratégie de l’entreprise (et pas simplement comme mantra managérial ou comme slogan agité par une fonction ressources humaines en quête d’image-employeur) déclenche des dynamiques internes capables de libérer des potentiels insoupçonnés. Les pistes ici présentées pour avancer vers des organisations responsabilisantes puisent en partie dans les retours d’expérience que le réseau Anact-Aract documente au bénéfice de l’ensemble des employeurs et des salariés. Ces travaux donnent des indications précieuses pour avancer dans une « voie de la QVT » qui soit à la fois ambitieuse sur les finalités et pragmatique sur la manière de faire face aux obstacles. C’est ce à quoi nous espérons que cette publication pourra contribuer.
Des expérimentations portées par des équipes syndicales : l’exemple de Toyota
Par Philippe Portier, Secrétaire général de la FGMM-CFDT
Notre fédération, depuis plusieurs années, sous la pression des disparitions d’emplois dans notre secteur professionnel et de la baisse de la part de l’industrie dans l’économie française, réfléchit à la voie et aux moyens pour que les entreprises industrielles redeviennent compétitives. À ce titre nous avons engagé une réflexion notamment sur les facteurs sur lesquels agir pour améliorer la performance des entreprises. Nous sommes arrivés assez rapidement à la conclusion que la compétitivité « coûts », la seule dont on nous parle, était bien entendu un facteur important mais que bien d’autres, souvent ignorés ou sous-estimés, mériteraient d’être pris en compte. La qualité de vie au travail, les organisations du travail en sont des exemples pertinents.
Nous avons ainsi décidé d’investir ces domaines et c’est sous la conduite de Jean Luc Collin secrétaire national et Vincent Bottazzi secrétaire fédéral que de nombreux travaux ont été réalisés. La littérature est effectivement abondante sur le sujet, il est parfois difficile « d’y retrouver ses petits ». La chance quand on est syndicaliste c’est que nos représentants, militants dans les entreprises nous remontent une masse importante d’informations concrètes.
La souffrance au travail pour certains, de plus en plus nombreux, le manque de reconnaissance, la maladie du « reporting » consommatrice de temps pour un travail rarement exploité, la perte du sens de son travail sont les principales critiques formulées par les salariés dans toutes les catégories socioprofessionnelles.
Mais comment répondre à ces nombreuses difficultés ?
Il nous est apparu que la réponse ne pouvait être trouvée qu’au plus près du salarié là où le travail se réalise. Nous avons donc décidé de lancer des expérimentations sur le terrain, une trentaine d’équipes syndicales sont volontaires pour les porter, la moitié va se concrétiser rapidement. La bonne surprise est qu’en rencontrant de nombreuses directions d’entreprises, nous avons constaté que beaucoup d’entre elles étaient très intéressées par cette démarche syndicale, signifiant leur volonté de se pencher sur ces problèmes. Autre surprise, la direction de Toyota s’est montrée très ouverte à lancer une expérimentation dans ce domaine. C’était pour nous surprenant car l’organisation du travail étant au cœur de la stratégie industrielle de Toyota, nous pensions que ce ne serait pas avec ce type d’entreprise que nous trouverions un terrain favorable. Mais en y réfléchissant, c’est logique car Toyota pratique le lean en ayant complètement intégré sa philosophie à la différence de beaucoup d’autres entre prises qui n’en n’ont pris que les outils.
C’est à ce moment qu’avec les représentants CFDT nous avons proposé une démarche QVT. Sur cette base, et après échange avec les autres partenaires sociaux, nous l’avons déployée sur une ligne pilote de l’atelier assemblage comprenant 30 postes de travail répartis en 6 équipes de 5 employés avec un « Team leader ». Un questionnaire permet de faire un état des lieux du ressenti de départ des employés sur leur environnement et leur équipe. Ils sont ensuite appelés à s’exprimer sur des problèmes qui les impactent au quotidien durant une séquence de 50 minutes tous les 15 jours. Ils vont grâce aux outils de résolutions de problèmes, proposer des solutions d’amélioration, qu’ils finiront par mettre en place eux-mêmes ou si cela est nécessaire avec le soutien des services Ingénierie, Maintenance.
Les premiers résultats sont encourageants et au bout six mois, ce sont 270 « défaillances » qui sont réglées, soit un taux de 80 %. Notre référent QVT sur place, nous informe que le taux de satisfaction des salariés est de 75 %, trois fois le score de celui de l’enquête à l’initialisation de la démarche. Il n’en faudra pas plus pour que soit décidé d’étendre à toutes les équipes de l’usine ce principe. Pour la CFDT c’est une vraie satisfaction.
Notre enjeu global est de tout faire, en effet pour qu’il soit possible de maintenir et développer un site performant de fabrication de petits véhicules en France et le faire en transformant le travail avec les opérateurs en fait partie. Alors que les autres constructeurs automobiles nous affirment qu’il n’est pas possible de fabriquer, dans l’hexagone, ce type de véhicules dits du « segment B », nous avons un contre-exemple concret pour lequel il est clair que l’organisation du travail et la prise en compte de la qualité de vie au travail en sont des points essentiels.
Il est donc urgent pour l’industrie française que les entreprises revoient leurs organisations du travail, mettent en place des organisations du travail « apprenantes » où l’entreprise a autant à apprendre du salarié que l’inverse, bref remettent le salarié au centre du travail. Les dirigeants d’entreprise doivent changer et adopter des critères pour juger de la performance de leur entreprise qui ne soient pas seulement économiques et financiers mais aussi des critères de responsabilité sociétale des entreprises. Qui pourrait dire non à une source de compétitivité qui améliore la qualité du travail et le bien-être au travail, deux notions intimement liées ? Nous devons reconnaître que depuis deux années, progressivement, la façon dont sont traités ces dimensions par un certain nombre d’acteurs va dans le sens d’une économie de la qualité que nous revendiquons.
Le rôle de l’organisation syndicale dans ce domaine est de convaincre que cette voie est digne d’intérêt, et ensuite de poser un cadre pour que dans l’entreprise et grâce à la coopération de tous, une nouvelle organisation puisse voir le jour. Nous devons également veiller à « trouver notre place » pour que le dialogue professionnel qui s’instaure entre le salarié et sa hiérarchie soit le premier vecteur des solutions au plus près : le dialogue social devant lui venir en appui.
Le maitre mot est la confiance réciproque entre les acteurs, facteur d’implication et d’engagement et promotrice de l’autonomie.
Refonder les organisations du travail : convaincre le dirigeant
Par Jean-Pierre Schmitt, Professeur honoraire au Cnam
Nous voyons, d’un côté, la réussite « évidente » des entreprises ayant opté pour des organisations nouvelles (responsabilisation, autonomisation, libération…), tant sur le plan économique que sur le plan social et, de l’autre, peu de mises en place.
« Il est frappant de voir que des expériences dont les résultats au plan économique sont sans aucune ambiguïté n’aient pas été étendues avec plus de résolution. 101 »
Aider le dirigeant à franchir le pas est une mission importante au bénéfice de l’entreprise et du personnel. Il y a actuellement une fenêtre ouverte pour le faire : beaucoup d’écrits et de discours et une vague d’intérêt, mais aussi beaucoup d’interrogations.
« Ce qui rend fausses beaucoup de théories économiques, c’est qu’elles sont fondées sur l’hypothèse que l’homme est raisonnable. 102 »
1. De quelles organisations s’agit-il ?
Déjà, en 1975, paraissait un ouvrage commandité par la confédération patronale suédoise : « Expériences suédoises de gestion participatives des ateliers, bilan de 500 cas de réorganisation des tâches », où l’on s’appuyait aussi sur les réalisations de démocratie industrielle en Norvège. Il faut dire que, selon un ouvrage paru en 198103, en Suède, le climat entre le patronat et le syndicat, entre le patron et l’ouvrier, est très différent de celui qui prévaut en France, beaucoup plus coopératif. Cela favorise évidemment la mise en place de la participation.
En France, on a mis en place des « nouvelles formes d’organisation » selon le terme des années 1970 : élargissement, enrichissement, amélioration des conditions de travail physiques et psychologiques (profil de poste Renault), puis la participation, les cercles de qualité, la qualité totale… l’équipe responsabilisée sur ses activités, l’équipe autonome d’entreprise et, plus récemment, l’entreprise libérée.
2. Origines des réticences à la mise en place
La visite d’une réussite, le discours d’un dirigeant ayant réussi, les chiffres de performance… ne suffisent pas pour convaincre un dirigeant de s’engager. Pourquoi ?
Le comité Hyacinthe Dubreuil, créé peu après sa mort en 1971, a réuni de nombreuses fois pendant une dizaine d’années, des chefs d’entreprise devant lesquels venait témoigner un dirigeant qui avait conduit avec succès de telles réalisations. L’auteur a eu de multiples occasions de présenter des réalisations faites dans des entreprises qui développaient la responsabilisation et l’autonomie des équipes. Par ailleurs, il a participé en Europe à la mise en place d’une organisation appelée « Technologie de Groupe104 », développée à l’Université de Manchester (GB) et a fait visiter à des dirigeants, des entreprises organisées ainsi.
Dans les trois cas, le succès relatif obtenu dans la conversion des dirigeants, face à ces réalisations dont la performance était impressionnante et incontestable, a conduit l’auteur à s’interroger105.
Oui, on connaît
Comme le faisaient déjà remarquer les conseils en organisation de la première moitié du XX e siècle, pour beaucoup de dirigeants le fait d’imaginer, de conceptualiser, de faire tourner la proposition dans sa tête, c’est l’avoir fait, confondant ainsi savoir et faire, savoir et savoir être.
Ces propositions ne seraient plus pertinentes, compte-tenu de l’évolution des populations salariées, plus nombreuses à être formées et plus informées, de la culture qui a changé, des demandes des jeunes de la génération Y… Mais, quelles sont les origines des « burn-out » et des « bore-out » ? Si ce n’est essentiellement le désir premier des hommes et des femmes d’être reconnus et respectés dans leur travail, ainsi que responsables ?
Chez nous, cela ne marchera pas
Oui, dans son secteur, pour sa taille…c’est possible, mais pas pour son entreprise.
On peut montrer et non démontrer la supériorité économique de la nouvelle organisation
Trop de facteurs sont en jeu, la complexité est grande et il faudrait raisonner sur le long terme, ce qui n’est pas dans l’esprit des dirigeants auxquels on demande de gérer à court terme. Une réorganisation peut permettre rapidement de faire plus de la même chose. Les organisations nouvelles dont nous parlons permettent de faire mieux en innovant…mais il faut plus de temps.
Henri Savall expliquait ainsi le constat mis en exergue ci-dessus : « Elles (ces expériences) sont jugées comme des expériences très ponctuelles faites dans des conditions artificiellement favorables, on se demande quelle sera la durée de l’effet positif constaté, quelle est la part due à l’effet Hawthorne, à tel point que la fiabilité des résultats est fortement mise en question, ce qui diminue considérablement la valeur exemplaire de ces expériences. »
Peur de perdre la maîtrise
Le dirigeant craint de ne pas maîtriser les risques, tant au cours de la mise en place que dans la nouvelle organisation, car c’est un changement profond :
- la mise en place demande des changements de culture et de croyance, casse des frontières, introduit de nouvelles règles de jeu.
- la nouvelle organisation bouleverse tout le management de l’entreprise. Les relations de subordination, les circuits de décision, les représentations liées à l’organisation et aux buts de l’entreprise sont profondément modifiés.
- dans le cas de la Technologie de Groupe, l’obstacle majeur est la remise en cause des façons de faire non seulement à l’atelier, mais de toutes les fonctions de l’entreprise et donc de leurs relations et de leurs pouvoirs respectifs : méthode/atelier, contrôle de gestion/atelier, informatique/toutes fonctions.
Si bien que la nouvelle organisation apparaît comme un monument imposant : « faire tout cela ! ».
Il faut se rappeler que les cercles de qualité ont été très bien « vendus » en insistant sur le fait « qu’ils ne remettaient pas en cause la structure de l’entreprise ». Mais alors, le ver est dans le fruit et il empêche celui-ci de grandir et mûrir.
3. Comment motiver les dirigeants à faire ?
Il s’agit bien d’une innovation. Les organisations proposées satisfont les cinq preuves utilisées pour évaluer un projet d’innovation :
- Preuve d’innovation : en effet, la nouvelle organisation résout un problème important et l’on s’attache à détecter tous les acteurs nécessaires à la mise en place et au fonctionnement, ainsi qu’à préciser leurs rôles (chaîne de valeur).
- Preuve d’utilité : toutes les entreprises et institutions sont concernées ; certaines plus que d’autres ? On a la connaissance des dysfonctionnements, des manques, dans les organisations existantes, en termes d’engagement et de compétitivité.
- Preuve de concept : on a choisi les croyances et les valeurs que l’on veut promouvoir dans l’entreprise, ainsi que les comportements qui en découleront ; on connaît les grandes étapes ; même si toute mise en place est spécifique de l’entreprise, on peut anticiper les risques principaux.
- Preuve de praticité : manifestement ces organisations nouvelles fonctionnent.
- Preuve de rentabilité : on constate les résultats économiques et sociaux, performance et
engagement, même si on peut, éventuellement, les obtenir par une autre organisation.
Certains dirigeants sont frustrés face à la difficulté d’améliorer la productivité et l’engagement des personnels. Comment les engager à refonder l’organisation du travail de leur entreprise ?
S’appuyer sur l’expérience des dirigeants qui ont fait
Quelles ont été leurs motivations ? Qu’ont-ils de particulier ?
Un dirigeant exprime ainsi sa détermination : il faut une vision, une ferme volonté et beaucoup d’endurance. Les dirigeants pionniers ont en commun une conviction, la représentation humaniste de la personne, qu’ils considèrent avec respect, dans son accomplissement et sa dignité, même si ce qu’ils ont mis en place dépend du secteur industriel ou de service, de la taille de l’entreprise, de la population salariée et de l’environnement économique. Les dirigeants humanistes voient à long terme, contrairement aux gestionnaires du court terme.
Les théories X et Y de Mac Gregor montrent bien que la conception du type de leadership et de l’organisation de l’entreprise dépendent de la représentation qu’a le dirigeant de la personne salariée.
En revanche, l’expérience montre que le seul objectif économique ne suffit pas pour aller loin et que vouloir cueillir trop vite les fruits condamne la réussite.
Une nouvelle organisation « évidemment » rationnelle n’est acceptée automatiquement par personne. Il faut en percevoir les aspects émotionnels et agir en conséquence.
Deux méthodes sont particulièrement efficaces pour engager la discussion avec des dirigeants sur ce thème :
- Le schéma proposé par Argyris106 pour le cheminement de la pensée qui est composé de six étapes :
- Observation et recueil des données
- Signification à partir des éléments culturels et tirés de l’expérience
- Hypothèses
- Conclusions
- Principes d’action
- Actions
• Les éléments du changement à partir des six « Niveaux neurologiques » chez les individus et dans les organisations (R. Dilts)107 :
Environnement : il concerne les opportunités et les contraintes externes que les personnes et les institutions doivent identifier et prendre en compte, où et quand le succès interviendra.
Comportements : ils déterminent les actions prises pour assurer le succès et précisément quoi doit être réalisé pour réussir.
Compétences et Savoirs : ils concernent les images mentales, les plans et les stratégies qui mènent au succès et comment les actions sont choisies et conduites.
Croyances et valeurs : elles renforcent nos motivations, intentions et permissions, qui favorisent ou limitent l’expression de nos capacités et de nos comportements. Elles concernent le pourquoi des motivations profondes des raisons pour lesquelles nous agissons ou persévérons.
Identité: elle concerne le sens du rôle ou de la mission pour les personnes concernées, à savoir qui une personne ou un groupe se sent être.
Vision : elle concerne le système englobant dont font partie les personnes concernées : pour qui ou pour quoi, une action a été entreprise (l’objet).
Les croyances et les valeurs déterminent le sens que nous donnons aux événements et sont au coeur du jugement et de la culture.
Une mission et définie en terme du service réalisé dans le cadre du rôle de la personne et dans le respect des autres au sein d’un système étendu.
4. La conviction acquise…
Une fois la conviction acquise, il est utile d’insister sur quelques points critiques pour la réussite de la mise en place :
- Ne pas chercher à copier : le transfert de solution ne marche pas. En effet, ce serait oublier que si l’entreprise « modèle » a réussi la mise en place, c’est justement parce que les actions se sont succédées et ont, les unes après les autres, été modelées par les intéressés, alors que le transfert conduit à plaquer une solution complète sans prendre la précaution, ni la possibilité d’ailleurs, de recueillir l’accord des parties prenantes. Le transfert consiste à copier les pratiques, sans installer les valeurs et les croyances sous-jacentes, qui, justement, sont à l’origine de nouveaux comportements. Il ne s’agit pas de faire abstraction d’une solution qui marche, mais de la « distribuer », morceau par morceau, afin d’appliquer ce que dit Georges Dumézil : « L’homme s’approprie les idées en jouant avec », il expérimente.
Laisser le temps au temps : il faut du temps pour convaincre, faire adhérer, trouver les modalités convenables pour l’entreprise… action après action.
- Les situations nouvelles entraînent le sentiment d’être inadaptés et incompétents. Face à l’incertitude et à l’insécurité ressenties par le personnel et l’encadrement à tous les niveaux, un dirigeant conseille « d’agir avec enthousiasme, de ne rien cacher des conséquences, et de traiter les effets menaçants ; alors, l’application a un caractère dynamique et ouvert et les intéressés sont rassurés ».
- Faire participer un maximum de personnes, car la réussite peut être mise en échec à cause d’un manque d’information ou d’un détail de conception qui ne peut être traité correctement que par une certaine personne.
- 101. Savall Henri, Enrichir le travail humain: l’évaluation économique, Dunod Entreprise, 1978, p.139.
- 102. Propos de O.L. Barenton, confiseur, p.39, Éd. du Tambourinaire, 1962.
- 103. Planus, Paul, Patrons et ouvriers en Suède, Plon, 1938.
- 104. Graham Edwards, Jean Pierre Schmitt, pp.14-28, 1973. « Manufacturing – Not So Much a Technology More a Way of Life », Personnel Review, Vol. 2 Iss : 2, pp.14-28.
- 105. Schmitt, Jean-Pierre, De la difficulté d’innover : la technologie de groupe, Humanisme & Entreprise, n° 188, pp.57-82, 1991
- 106. Robert Dilts, Tim Hallbom & Suzy Smith, Croyances et santé, Paris, La Méridienne et Desclée de Brouwer, 1994, 2 éd.
- 107. Journal of Applied Behavioral Science June 1983 vol. 19 no. 2 115-135
Glossaire
Les concepts liés à la QVT mobilisés dans cette étude sont les suivants :
L’autonomie (dans le travail) : autonomie vient du grec auton (soi-même) et nomos (la loi, la règle, l’organisation) : il s’agit de déterminer soi-même ses propres règles. L’autonomie dans le travail «renvoie communément à l’idée de capacité d’initiatives, de discernement, d’auto-organisation, voire de “liberté” dans le travail. Elle suppose intelligence et réflexion pour réagir rapidement à des situations plus ou moins imprévisibles, quel que soit le niveau hiérarchique des individus, même si le niveau d’autonomie tend à augmenter avec celui des classifications» (Everaere, 2007).
Le bien-être (au travail), tout comme le bonheur, est un objet d’étude de la psychologie positive. Les recherches sur le bien-être se structurent autour de deux logiques : hédonique et eudémonique (Abord de Chatillon, Richard, op.cit.). L’approche hédonique envisage le bien-être comme l’obtention du plaisir (Kahneman et al., 1999), qui consiste- rait à vivre beaucoup d’affects agréables (plaisir, confort, optimisme…), et peu d’affects désagréables (peur, inconfort, stress…). L’approche eudémonique privilégie la réalisation de soi et de son potentiel (Ryan et Deci, 2001). L’expression bien-être au travail est privilégiée dans le rapport Lachmann-Larose-Pénicaud (2010) ou dans le rapport de La Fabrique Spinoza (2012, 2013)108. Emmanuel Abord de Chatillon propose de modéliser les conditions du bien-être au travail par l’étude de quatre dimensions: le sens, le lien, l’activité et le confort, soit le modèle SLAC (op. cit.).
Le bonheur (au travail) dépendrait non seulement de notre capacité à éprouver du plaisir, mais aussi à nous engager dans des expériences enrichissantes et à donner un sens à notre existence (Seligman, 2002). Voir Marie-Pierre Feuvrier (2014) pour une synthèse de la littérature sur le bonheur et le bonheur au travail ou encore les travaux de Claudia Senik (2014). Pour Pascal, chercher le bonheur, c’est avant tout échapper au malheur. Il reprend une définition déjà vieille de 2000 ans au XVIIe siècle : pour Epicure, le bonheur c’est la tranquilité d’esprit, l’absence de douleur et de troubles.
Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) est « constitué dans tous les établissements occupant au moins 50 salariés, (il) a pour mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés ainsi qu’à l’amélioration des conditions de travail. Composé notamment d’une délégation du personnel, le CHSCT dispose d’un certain nombre de moyens pour mener à bien sa mission (information, recours à un expert…), d’un crédit d’heures et d’une protection contre le licenciement. Ces moyens sont renforcés dans les entreprises à haut risque industriel. En l’absence de CHSCT, ce sont les délégués du personnel qui exercent les attributions normalement dévolues au comité. » (Extrait de travail-emploi.gouv.fr)
Le dialogue sur le travail, selon Mathieu Detchessahar (chercheur en sciences de gestion), est l’activité de régulation tout à fait nécessaire au bon travail, à un travail praticable au quotidien, qui soit bon pour la santé. L’activité de travail, au-delà des règles et procédures utiles au fonctionnement de chaque entreprise, mobilise une activité de régulation des équipes pour faire face, chaque jour, à des situations particulières, inattendues, dans lesquels les travailleurs affrontent des aléas. (Interview de juin 2016 pour le CESE, Mission « L’investissement dans les conditions de travail »).
L’engagement (au travail) est un objet d’étude privilégié des sciences de gestion et de la psychosociologie. L’engagement au travail est décrit comme un état psychologique qui caractérise l’individu dans son rapport à l’entreprise et au travail. Il explique pourquoi un individu choisit de rester dans une entreprise et pourquoi il s’y investit plus ou moins.
Les espaces de discussion sur le travail sont définis par l’Anact comme « des espaces collectifs qui permettent une discussion centrée sur l’expérience de travail et ses enjeux, les règles de métier, le sens de l’activité, les ressources, les contraintes. Cette discussion se déroule suivant des règles co-construites avec les parties prenantes. Les espaces de discussion sont inscrits dans l’organisation du travail, ils s’articulent avec les processus de management et les institutions représentatives du personnel et visent à produire des propositions d’amélioration, des décisions concrètes sur la façon de travailler. » Extrait de Travail et changement, n°358, 2015.
Le job strain ou situation de travail tendue correspond à la combinaison d’une forte pression et d’une faible autonomie dans la réalisation du travail.
La motivation (au travail) « concerne les facteurs agissant dans l’énergie déployée au travail et la direction du comportement du travailleur » (Blais et al. , 1993). La théorie de l’autodétermination distingue la motivation au travail autodéterminée, stimulée par des facteurs de motivation interne comme la satisfaction ou le plaisir à faire une tâche, et la motivation contrôlée, renvoyant à des facteurs de motivation externes (évitement de sanctions, recherche de récompense).
La performance renvoie souvent, dans les travaux mentionnés dans cette étude, à des critères relatifs à l’analyse financière, à l’excellence technique ou sociale (maîtrise des coûts, augmentation du chiffre d’affaires, hausse de la productivité, baisse de l’absentéisme, du turnover…). Cette acception est évidemment discutable puisque la performance d’une organisation repose aussi sur la qualité, la sécurité, l’innovation, la satisfaction du client, la mobilisation des partenaires, des ressources humaines, des ressources naturelles… soit des aspects organisationnels, productifs ou encore commerciaux qui soulèvent la question du rapport au temps dans l’évaluation de la performance ainsi que celle de la stratégie de l’entreprise. Une entreprise peut en effet chercher une performance de court-terme, en évaluant ses résultats sur des critères comptables traditionnels mais aussi se projeter sur le long-terme, auquel cas les indicateurs à suivre concernent des dimensions plus variées. La stratégie de l’entreprise, sa gouvernance, peuvent également fortement influencer le choix des indicateurs de suivi de la performance.
La qualité du travail, dans les travaux d’Yves Clot, est assimilable à la notion de travail bien fait « qui consiste, pour le salarié, à atteindre les buts qu’il s’est fixés ou qu’on lui a fixés, et à parvenir ainsi à un résultat qui est défendable à ses propres yeux ». Il n’y a pas de qualité de vie possible au travail sans la possibilité d’effectuer correctement son travail. Il est en effet coûteux pour la santé d’être dans l’impossibilité de faire du bon travail, de n’avoir d’autre choix que de contribuer à un travail que l’on juge inabouti. C’est encore plus douloureux lorsqu’on sait comment il faudrait procéder pour réaliser du bon travail, mais que l’on en est empêché. La santé est ainsi mise en danger par la frustration liée à la performance « gâchée ».
Les risques psychosociaux (RPS) lorsqu’ils produisent des troubles, sont liés à une mauvaise QVT. Selon le ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social, ils sont à l’interface de l’individu et de sa situation de travail, d’où le terme de risque psychosocial. D’après Michel Gollac, « ce qui fait qu’un risque pour la santé au travail est psychosocial, ce n’est pas sa manifestation, mais son origine : les risques psychosociaux seront définis comme les risques pour la santé mentale, physique et sociale, engendrés par les conditions d’emploi et les facteurs organisationnels et relationnels susceptibles d’interagir avec le fonctionnement mental. » (Rapport du Collège d’expertise sur le suivi des risques psychosociaux au travail, avril 2011).
La santé (au travail) « état complet de bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité. » (Définition figurant en préambule de la Constitution de l’Organisation mondiale pour la santé, 1948).
Le stress (au travail) est un: « déséquilibre entre la perception qu’une personne a des contraintes que lui impose son environnement et la perception qu’elle a de ses propres ressources pour y faire face », selon l’Agence européenne de santé et de sécurité au travail. Le stress est un phénomène d’adaptation du corps rendu nécessaire par l’environnement. D’après l’INRS (Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles), il n’y a, scientifiquement, ni bon ni mauvais stress. En revanche, il faut distinguer le stress « aigu » du stress « chronique ». « L’état de stress aigu correspond aux réactions de notre organisme quand nous faisons face à une menace ou un enjeu ponctuel (prise de parole en public, changement de poste, situation inattendue…). Quand la situation prend fin, les symptômes de stress s’arrêtent peu après. L’état de stress chronique est une réponse de notre corps à une situation de stress qui s’installe dans la durée : tous les jours au travail, nous avons ainsi l’impression que ce que l’on nous demande dans le cadre professionnel excède nos capacités. Le stress chronique a toujours des effets néfastes sur la santé. » (http://www.inrs.fr/risques /stress/ ce-qu-il-faut-retenir/html).
Le travail réel : cette notion est à la base d’une discipline nommée ergonomie. «Il y a d’un côté le travail prescrit, c’est-à-dire ce qui est attendu du travailleur et formalisé dans des procédures, des directives, des marches à suivre, des codes, des programmes, etc. Et par ailleurs le travail réel à savoir ce que l’opérateur produit et a le sentiment de produire effectivement, tantôt en deçà, tantôt au-delà des règles et des attentes formelles. » Extrait de Maulini O., 2010, p.23.
Les troubles musculosquelettiques (TMS) des membres supérieurs et inférieurs sont des troubles de l’appareil locomoteur pour lesquels l’activité professionnelle peut jouer un rôle dans la genèse, le maintien ou l’aggravation. Les TMS affectent principalement les muscles, les tendons et les nerfs, c’est-à-dire les tissus mous.
Précisions méthodologiques
Pour examiner la relation entre QVT et performance économique, deux axes complémentaires ont fait l’objet d’investigations.
Axe 1. Que nous apprennent les travaux de recherche ?
Méthode : recension de la littérature et réalisation de travaux quantitatifs sur données françaises.
La littérature sur le sujet de la qualité de vie au travail et de la performance étant particulièrement dense, nous nous sommes principalement concentrés sur les disciplines suivantes: économie, gestion, psychologie, psychosociologie. Les bases de recherche de publications scientifiques Econlit, Business Source Elit et Cairn ont été mobilisées. Ont aussi été consultés des rapports et des chiffres produits par des institutions reconnues: l’European Foundation for the improvement of living and working conditions (Euro- found), l’European agency for safety and health at work (Eu-Osha), l’OCDE, la Commission européenne, France Stratégie, la Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES), pour ne citer qu’elles. Les références de l’ensemble des travaux consultés sont indiquées tout au long de l’étude.
Par ailleurs, à notre connaissance, peu d’équipes de recherche ont travaillé sur des données françaises. Nous avons réuni par conséquent un groupe de chercheurs intéressés pour le faire109. Ces derniers ont déposé un projet de recherche dans le cadre de l’appel à projet 2015-2016 de l’Institut de la société numérique qui a été retenu. Pour des raisons d’accès aux données et de temps de traitement, les premiers résultats seront disponibles fin 2016/ courant 2017. Un premier travail portant sur les conditions de travail objectives des salariés français et leurs perceptions est disponible sur le site www.la-fabrique.fr.
Axe 2. Que nous apprennent les expériences de terrain ?
Méthode : recueil de témoignages (cycle d’auditions adossé à un groupe de travail, entretiens, analyse de la presse nationale et de la presse quotidienne régionale (PQR), comptes rendus de conférences).
Le recueil de témoignages s’est d’abord concentré sur les auditions réalisées dans le cadre d’un groupe de travail qui s’est réuni entre le 15 mars et le 16 septembre 2015, composé de :
- Philippe Blandin, ex-secrétaire général de Mécachrome, fondateur de Eneixia,
- Vincent Bottazzi, secrétaire fédéral en charge du suivi de la QVT, FGMM CFDT,
- Emilie Bourdu, Vincent Charlet et Thierry Weil, La Fabrique de l’industrie,
- Patricia Gueret, anciennement chargée d’études santé au travail, CFE-CGC,
- Agnès Laleau, responsable pôle santé sécurité environnement du GIM,
- Jean-Marc Le Gall, professeur au Celsa,
- François Pellerin, animateur du programme Usine du futur en Nouvelle-Aquitaine,
- Marie-Madeleine Péretié, Aract Ile-de-France et Arnaud Coulon, DGA UNIFAF ex Aract- Ile-de-France,
- Martin Richer, responsable du pôle Entreprise, Travail, Emploi de Terra Nova,
- Aymeline Rousseau, doctorante, universités Paris Descartes / Paris1 Panthéon Sorbonne,
- Amélie Seignour, chercheure au Greco Montpellier,
- Jean-Claude Thoenig, directeur de recherche CNRS, sociologue.
Les personnes auditionnées ont évoqué avec nous l’organisation du travail dans leur entreprise, sa stratégie, son marché, et la place de la QVT dans ce contexte. Des interviews supplémentaires ont ensuite été réalisées par les auteurs de l’étude. La liste complète des personnes interviewées se trouve dans le tableau page suivante. Sauf mention contraire, les citations sont extraites de ces auditions. Par ailleurs, la lecture de la presse nationale, de la presse quotidienne régionale ou de comptes rendus de certaines conférences ont nourri nos analyses. Enfin, des experts dont les témoignages apparaissent au fil de la lecture ont réagi à une première version de cette étude.
- 109. Diviyan Kalainathan, Olivier Goudet, Philippe Caillou, Michèle Sebag, et Paola Tubaro, TAO, INRIA-Saclay et LRI, CNRS UMR 8623, Université Paris-Sud ; Jean-Luc Bazet et Ahmed Bounfour, RITM, Chaire européenne de l’immatériel, Université Paris-Sud ; Valérie Fernandez et Valérie Beaudouin, SES, Telecom-ParisTech et Institut Interdisciplinaire de l’Innovation, CNRS UMR 9217.
Annexe 1. Annexe à l’article 13 de l’ANI QVT (juin 2013)
Éléments descriptifs destiné s a faciliter l’élaboration d’une démarche de qualité de vie au travail dans le cadre du dialogue social
La qualité de l’engagement à tous les niveaux de l’entreprise
- Prise en compte des enjeux de la vie personnelle des salariés par les dirigeants des entreprises à̀ tous les niveaux, par les partenaires sociaux et pour ce qui concerne l’environnement de l’entreprise, par l’État et les collectivités territoriales.
- Modes d’implication des salariés, y compris de l’encadrement, favorisant l’expression des femmes et des hommes dans la vie au travail.
La qualité de l’information partagée au sein de l’entreprise sur :
- L’environnement économique
- Les objectifs et orientations stratégiques (cf. les discussions interprofessionnelles sur la modernisation du dialogue social)
- Les valeurs auxquelles se réfère l’entreprise (exprimées par exemple dans les chartes d’entreprise) y compris dans ses relations avec son environnement
- Les « caractéristiques » des salariés.
La qualité des relations sociales et de travail :
- Reconnaissance du travail
- Égalité salariale entre les femmes et les hommes
- Respect, écoute des salariés
- Mise en place d’espaces de dialogue et d’expression des salariés
- Information adaptée aux enjeux des relations sociales et de travail (cf. les discussions interprofessionnelles sur la modernisation du dialogue social)
- Dialogue social aux différents niveaux (établissement, entreprise, groupe)
- Rôle des Institutions représentatives du personnel
- Modalités de participation aux décisions (cf. les discussions interprofessionnelles sur la modernisation du dialogue social).
La qualité du contenu du travail
- Autonomie
- Variété des tâches
- Degré de responsabilité
- Enrichissement des compétences
- Capacité d’expression des salariés
- Sens donné au travail
La qualité de l’environnement physique
- Sécurité
- Ambiances physiques
La qualité de l’organisation du travail
- Qualité du pilotage
- Capacité d’appui de l’organisation dans la résolution des problèmes
- Rôle et appui du management de proximité
- Démarche de progrès
- Anticipation de la charge de travail pour sa gestion optimale
- Organisations apprenantes
- Conséquences de l’impact de la généralisation des nouvelles technologies de l’information et de communication (distinction des temps de travail liés aux moyens électroniques tels que email à distance, portable…)
- Anticipation des conséquences des mutations et restructurations des entreprises sur la qualité de vie au travail et l’emploi
Les possibilités de réalisation et de développement personnel
- Formation
- Acquis de l’expérience
- Développement des compétences
- Déroulement de carrière et égalité de ces déroulements de carrière entre les femmes et les hommes
- Égal accès entre les femmes et les hommes aux fonctions de direction
- Lutte contre les stéréotypes attachés à la maternité et à la parentalité
- Prise en compte des diversités
La possibilité de concilier vie professionnelle et vie personnelle
- Prise en compte de la parentalité (au cours de la vie professionnelle)
- Attention portée à la conciliation vie professionnelle/vie personnelle
- Rythmes et horaires de travail
- Attention portée aux temps sociaux (transports, accès aux services)
Annexe 2. L’Organizational Commitment Questionnaire
Mowday, steers, anD porter
Table 1: Organizational Commitment Questionnarie (OCQ) Instructions
Listed below are a series of statements that represent possible feelings that individuals might have about the company or organization for which they work. With respect to your own feelings about the particular organization for which you are now working (compagny name) please indicate the degree of your agreement or disagreement with each statement by checking one of the seven alternatives below each statement. 110
1. I am willing to put in a great deal of effort beyond that normally expected in order to help this organization be successful.
2. I talk up this organization to my friends as a great organization to work for.
3. I feel very little loyalty to this organization. (R)
4. I would accept almost any type of job assignment in order to keep working for this organization.
5. I find that my values and the organization’s values are very similar.
6. I am proud to tell others that I am part of this organization.
7. I could just as well be working for a different organization as long as the type of work was similar. (R)
8. This organization really inspires the very best in me in the way of job performance.
9. I would take very little change in my present circumstances to cause me to leave this organization. (R)
10. I am extremely glad that I chose this organization to work for over others I was considering at the time I joined.
11. There’s not too much to be gained by sticking with this organization indefinitely. (R)
12. Often. I find it difficult to agree with this organization’s policies on important matters relating to its employees. (R)
13. I realy care about the fate of this organization.
14. For me this is the best of all possible organizations for which to work.
15. Deciding to work for this organization was a definite mistake on my part. (R)
- 110. Responses to each item are measured on a 7-point scale with scale point anchors labeled: (1) strongly disagree; (2) moderately disagree; (3) slightly disagree; (4) neither disagree nor agree; (5) slightly agree; (6) moderately agree; (7) strongly agree. An « R » denotes a negatively phrased and reverse scored item.
Annexe 3. Les limites des démarches de type « enquêtes de perception »
Les enquêtes sur la QVT s’appuient souvent sur du déclaratif. Elles fournissent des informations sur le vécu au travail des salariés (voir encadré 17). Quel que soit leur intérêt, ces études de perception donnent parfois lieu à des difficultés d’interprétation, Molinié et Volkoff (1982) expliquent pourquoi : « elles reflètent au moins autant l’attitude de l’enquêté vis-vis de son travail que la situation de travail elle-même. Les réponses se réfèrent donc aux conditions de travail telles qu’elles sont, aux facultés d’adaptation du salarié, à son goût pour la critique ou pour la conciliation, à ses « attentes » en matière de travail (eu égard à son éducation, sa formation, son âge, etc.) et plus généralement à l’appréciation d’ensemble, diffuse, et plus ou moins favorable que porte le salarié sur la vie au travail, appréciation qui peut varier considérablement, par exemple, selon le jour et l’heure de l’enquête.
Encadré 17. L’avis des salariés français sur la QVT dans les enquêtes d’opinion
Une enquête CSA de 2013 portant sur l’ensemble des salariés français des secteurs public et privé indique que la note moyenne de qualité de vie au travail au moment de l’enquête est de 6,5 (1 : très dégradée, 10 : très bonne).
Elle est de 6,3 dans l’industrie (score le plus bas observé parmi l’ensemble des secteurs d’activité). 30 % des salariés de l’industrie pensent que la qualité de vie au travail s’est dégradée lors de l’année écoulée, contre 31 % en moyenne nationale. Le score moyen de QVT parmi la population ouvrière est de 5,89 ; ils sont 37 % à penser que leur qualité de vie au travail s’est dégradée lors de l’année écoulée (score observé le plus haut selon les statuts). Si l’on compare les différentes fonctions dans l’entreprise, ce sont les fonctions de production et celles en contact direct avec le public, les clients, les usagers ou les bénéficiaires qui pensent que leur QVT s’est le plus détériorée.
Les leviers qui sont spontanément cités par les salariés pour améliorer la QVT sont par ordre d’importance : « Entretenir une bonne ambiance dans l’entreprise » et « Donner les moyens de bien faire son travail » (à égalité), « Reconnaître le travail de chacun » et « Améliorer l’organisation du travail pour faire mieux, plus facilement ». Ces résultats sont cohérents avec ceux d’une autre enquête réalisée en 2014 par l’Observatoire du Capital humain de Deloitte et Cadremploi portant sur les salariés français. La reconnaissance du travail est considérée dans leur étude comme premier facteur d’influence de la qualité de vie au travail, alors que 7 salariés sur 10 disent ne pas se sentir reconnus à leur juste valeur.
Bibliographie
Abord de Chatillon E., Richard D., 2015, « Du sens, du lien, de l’activité et de confort (SLAC). Proposition pour une modélisation des conditions du bien-être au travail par le SLAC », Revue française de gestion, 2015/4 (N° 249), pp.53-71.
Akkerman A., Sluiter R., Jansen G., 2015, « Third European Company Survey – direct and indirect employee participation », Eurofound report, 14 décembre.
Algan Y., Cahuc P., Zylberberg A., 2012, La fabrique de la défiance… et comment s’en sortir, Albin Michel.
Alvaga E., Vinck L., 2015, « Autonomie dans le travail – Enquêtes conditions de travail », Synthèse Stat’ de la DARES, n°16, octobre.
Anact-Aract Le réseau, 2015, Travail et Changement, n°358, janvier-février-mars, p.2.
Anact, 2015, « L’entreprise libérée : une véritable innovation managériale ? », 6 octobre.
Anact, 2013, « Les promesses de la qualité de vie au travail », Contribution à la table-ronde N°2 de la Grande conférence sociale, 20 juin.
Barbier F., 2016, « Ma vision du management, interview de Pierre Deheunynck », Metis, 31 Janvier.
Beinten K., Stinghlamber F., Vandenberghe C., 2000, « L’engagement des salariés dans le travail », Revue québécoise de psychologie, vol. 21, n°3.
Bergère J.-M., 2016, « Homo democraticus contre homo economicus », Metis, 31 Janvier.
Bidet-Mayer T., Toubal L., 2014, Formation professionnelle et industrie : le regard des acteurs de terrain, La Fabrique de l’industrie, Presses des mines.
Bidet-Mayer et Toubal, 2016. « Mutations industrielles et évolution des compétences », Les Synthèses de La Fabrique, Numéro 5, Avril.
Bigi M., Cousin O., Méda D., Sibaud L., Wieviorka M., 2015, Travailler au XXI e siècle. Des salariés en quête de reconnaissance , Ed. Robert Laffont.
Blais M. R., Brière N.M., Lachance L. Riddle A.S., Vallerand R.J., 1993, « L’inventaire des motivations au travail de Blais », Revue québécoise de psychologie, vol. 14, n°3, p.186.
Bloom N., Sadun R., Van reenen J, 2013, « Management as a Technology », LSE mimeo.
Bloom N., 2014, « JEEA-FBBVA Lecture 2013 : the new empiricial economics of management », Journal of the european economic association , Vol. 12 (4).
Bonnefond J.Y., 2015, « Qualité de vie au travail : négocier le travail pour le transformer ; enjeux et perspectives d’une innovation sociale », Revue des Conditions de Travail (RDCT) No 3, décembre.
Bourdu E., Souchier M., 2015, Réglementation, normalisation, leviers de la compétitivité industrielle, La Fabrique de l’industrie, Presses des mines.
Rigoni B., Nelson B., 2016, « The No-Managers Organizational Approach Doesn’t Work”, Gallup, February.
Brun J.P., Lamarche C., 2005, « Evaluation des coûts du stress au travail », rapport de recherche, Université de Laval, de la chaire en gestion sur la santé et de la sécurité du travail dans les organisations.
Burlet M., 2015, « Lean : les recommandations de l’Anact », 19 novembre.
Burlet M., 2013, Fiche « Comment articuler performance et conditions de travail ? », Travail & Changement, septembre.
Burlet M, Leblanc V., 2012, « Lean management : comment préserver les conditions de travail », Entreprise & Carrières, n° 1112, février.
Camus A., 1942, Le mythe de Sisyphe, Collection Folio essais (n° 11), Gallimard (2013).
Capelli P., Neumark D., 2001, “Do ‘High-Performance’ Work Practices Improve Establishment- Level Outcomes?”, Industrial and Labor Relations Review , 54(4), pp.737-775.
Cartwright S., Cooper C.L. (Eds.), 2009, The Oxford Handbook of Organizational Wellbeing, Oxford University Press.
CESER Bretagne, 2015, « Pour des activités industrielles créatrices d’emplois durables en Bretagne », juin, pp.100-101. d’après Alavaga E. (dir.), 2014, « Conditions de travail. Reprise de l’intensification du travail chez les salariés », Dares Analyses , n° 049, juillet.
Champain V., Suleyman O., 2014, « Le bonheur au travail, un sujet de négociation sociale à méditer », Les Échos, mercredi 19 mars, n°21650.
Charlet V., Gauron A., 2014, Réussir la mise en place des administrateurs salariés, La Fabrique de l’industrie, Presses des Mines, Paris.
Clot Y., 2008, Travail et pouvoir d’agir, PUF, Paris.
Clot Y., 2010, Le travail à cœur, Pour en finir avec les risques psychosociaux, La Découverte, Paris.
COE « L’impact d’internet sur le fonctionnement du marché du travail », mars 2015.
Combs C., Yongmei L., Hall A., Ketchen D., 2006, “How much do high-performance work practices matter? A meta-analysis of their effects on organizational performance”, Personnel Psychology : A Journal of Applied Research, Vol. 59, 2006, pp.501–528.
Commission européenne, 2014, Conditions de travail : une nouvelle enquête fait apparaître une détérioration et de grandes disparités en matière de satisfaction des travailleurs », Communiqué sur l’Eurobaromètre de l’UE, 24 avril.
Conjard P., 2014, « Le management du travail : une alternative pour améliorer bien-être et efficacité au travail », Anact.
Corporate Leadership Council, Corporate Executive Board, 2004, « Driving Performance through Employee Engagement: a quantitative analysis of effective engagement strategies ».
Courpasson D., Thoenig J-C., 2008, Quand les cadres se rebellent, Vuibert, 2008, 179 p.
CSA, 2013, « Qualité de vie au travail : représentations, vécus et attentes des salariés français », étude N° 1300028.
Dares Analyses, 2016, « L’organisation du travail à l’épreuve des risques psychosociaux », janvier.
David A., 2013, « La place des chercheurs dans l’innovation managériale », Revue française de gestion 2013/6 (n°235), pp.91-112.
Davis L.E, Cherns A., 1975, The quality of working life: Problems, Prospects and the State of the art .
Davis L. E., 1977, « Pour une vie de travail meilleure. L’évolution aux États-Unis », Revue Internationale du Travail, Vol. 116, n°1, juillet-août, pp.53-65.
Davoine L., Méda D., 2009, « Quelle place le travail occupe-t-il dans la vie des Français par rapport aux Européens ? », Informations sociales 2009/3, n° 153, pp.48-55.
Deci E.L., Ryan M. (Eds.), 2002, Handbook of Self-Determination Research, University of Rochester Press.
Delobbe N., Van Tolhuysen L., Berck P., Wattiaux F., 2009, « Bien-être au travail et performance de l’organisation », Etude réalisée à la demande de la direction générale humani- sation du travail, SPF Emploi, Travail et concertation sociale, Université catholique de Louvain.
Detchessahar M., « Santé au travail : quand le management n’est pas le problème mais la solution », Revue française de gestion, 2011, 5 n° 214.
Detchessahar M., 2013, « Faire face aux risques psychosociaux : quelques éléments d’un management par la discussion », Négociations, n° 19, pp. 57-80.
Doyle A., 2016, “Management and Organization at Medium”, March 4.
Dujarier M-A., 2006, L’idéal au travail, Ed. PUF.
Eurofound, 2013, « Work organization and employee involvement in Europe ».
Eurofound, 2015, « Third European Company Survey – Direct and indirect employee participation ».
EU-OSHA, 2010, « Mainstreaming OSH into business management ».
EU-Osha, 2014, « Calculating the cost of work-related stress and pyschosocial risks ».
Everaere C., 2007, « Proposition d’un outil d’évaluation de l’autonomie dans le travail », Revue française de gestion, 2007/11 (n° 180), pp.45-59.
Evrest Résultats, 2014, « Devoir faire des choses que l’on désapprouve… », n° 7, novembre.
Feuvrier M.-P., 2014, « Bonheur et travail, oxymore ou piste de management stratégique de l’entreprise ? », Management & Avenir 2/2014, n° 68, pp. 164-182.
Forest J., Mageau G.A., 2008, « La motivation au travail selon la théorie de l’autodetermination », Psychologie Québec, volume 25, numéro 05.
Fortino Sabine, Hélène Meynaud, Les cahiers du genre n° 47 – La mixité au service de la performance économique.
France stratégie, 2016a, « Compétitivité : que reste-t-il à faire ? », mars.
France stratégie, 2016b, « Responsabilité sociale des entreprises et compétitivité – Evaluation et approche stratégique », par Benhamou S. et Diaye M-C., en collaboration avec Crifo P., janvier.
Gallup, février 2013, « The relationship between engagement at work and organizational outcomes – 2012 Q12® Meta-analysis ».
Geary J., Sisson K., 1994, “Conceptualizing direct participation in organizational change; the EPOC project, Eurofound.
Gelles D., 2016, « The Zappos Exodus Continues After a Radical Management Experiment », New York Times, January 13 ; http://bits.blogs.nytimes.com/2016/01/13/after-a-radical- management-experiment-the-zappos-exodus-continues/?_r=0
Getz I, Carney B.M., 2009, Freedom Inc (Liberté & Cie pour la traduction française).
Getz I., 2016, « Il n’y a pas d’entreprise libérée sans forte implication des RH », Focus RH, 25 avril.
Gillet N., Fouquereau, E., Forest, J., Brunault, P., Colombat, P. 2012, « The impact of organizational factors on psychological needs and their relations with well-being », Journal of Business and Psychology , 27 , pp.437-450.
Gomez P.Y, 2013, Le travail invisible ; enquête sur une disparition, Ed. François Bourin, février.
Hamel G., 2011, « First, Let’s Fire All the Managers », Harvard Business Review, December.
Harter J.K, Schmidt F.L., Killham E.A, Asplund J.W, 2006, « Q12(r) Meta-Analysis ».
Harter, J.K., Schmidt, F.L., Keyes, C.L., 2002, « Well-being in the workplace and its relationship to business outcomes : a review of the gallup studies », in Keyes, C.L. and Haids, J. (Eds), Flourishing : The positive person and the good life, pp.205-224).
Hunter J.E., Schmidt F.L., 1990, Methods of Meta-Analysis: Correcting Error and Bias in Research Findings, Newbury Park, CA: Sage, 592 p.
Ichniowski C., Shaw K., Prennushi G., « The Effects of Human Resource Management Practices on Productivity: A Study of Steel Finishing Lines », The American Economic Review , Vol. 87, No. 3 (Jun., 1997), pp.291-313.
Ichnowski C., Shaw K., 1999, « The Effects of Human Resource Management Systems on Economic Performance: An International Comparison of U.S. and Japanese Plants », Management science , vol. 45, issue 5, pp.704-721.
Judge T.A., Thorensen C.J., Bono J.E., Patton G.K., 2001, The job satisfaction-job performance relationship : a qualitative and quantitative review », Psychological Bulletin 127, pp.376-407.
Kelly M., 2007, The Dream Manager, Ed. Hyperion, New York.
Kahneman D., Diener E., Schwarz E. (Eds.), 1999, Well-being, The foundations of hedonic psychology , Russel Sage Foundation, New York.
Knapp M., McDaid D., Parsonage M., 2011, « Mental health promotion and mental illness prevention: the economic case », Department of Health, London, UK.
Koléda G., 2015, Allégements du coût du travail : pour une voie favorable à la compétitivité Française, La Fabrique de l’industrie, Presses des mines.
La Fabrique Spinoza, 2013 « Le bien-être au travail, objectif en soi et vecteur de performance économique » (2ème édition ; 1ère édition en 2012).
La Fabrique Spinoza, 2013, « Guide pratique des outils de mesure des outils de bien-être au travail ».
Lachmann H., Larose C., Penicaud M., 2010, « Bien-être et efficacité au travail – 10 propositions pour améliorer la santé au travail », rapport fait à la demande du Premier ministre.
Laloux F., 2015, Reinventing organizations : vers des communautés de travail inspirées, ed. Diateino, octobre, 483 p.
Lanouzière H., 2013, « Un coup pour rien ou tournant décisif ? L’accord du 19 juin 2013 sur la qualité de vie au travail », Semaine sociale Lamy n°1597, 16 septembre.
Levet P., 2013, « Des risques psychosociaux à la qualité de vie au travail – Equiper les acteurs pour négocier le travail, l’expérience de l’Anact », Négociations, 2013/1 n°19, pp.97-111.
Lorenz E., Michie J., Wilkinson F., 2004 , “HRM complementarities and innovative performance in French and British industry”, in Christensen, J.L. and Lundvall, B-A (eds.), Product innovation, interactive learning and economic performance, Amsterdam, Elsevier.
Manageris, 2016, « L’entreprise libérée », février.
March J., 1991, « Exploration and exploitation in organizational learning », Organization Science, Vol. 2, No. 1, Special Issue: Organizational Learning: Papers in Honor of (and by) James G. March (1991), pp.71-87.
Martha C. Nussbaum, 2012, « Capabilités : Comment créer les conditions d’un monde plus juste », éditions Climats, Paris.
Matrix, mai 2013, Final report « Economic analysis of workplace mental health promotion and mental disorder prevention programmes ».
Maulini O., 2010, « Travail, travail prescrit, travail réel », FORDIF-Formation en direction d’institutions de formation, p.23, Lausanne).
MECREANTS, 2016, « Entreprise Libérée : la fin de l’illusion », livre blanc, janvier à télécharger sur http://www.e-rh.org/index.php/blogs/les-articles-du-blog/243-la-fin-de-l-illusion
Mettling B., 2015, « Transformation numérique et vie au travail », Ministère du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et du dialogue social, septembre.
Meyer J-P., Allen N.J., 1991, « A three-component conceptualization of organizational commitment », Human resource management review, 1, pp.61-89.
Meynaud H.-Y., Fortino S., Calderón J., 2009, « La mixité au service de la performance économique : réflexions pour penser la résistance. Introduction », Cahiers du Genre 2009/2 (n° 47), pp.15-33.
Molinié A.F., Volkoff S., 1982, « Quantifier les conditions de travail », Travail et Emploi, n°11, janvier-mars.
Morin E. M., Cherré B., 1999, « Les cadres face au sens du travail », Revue française de gestion, 126 : 83-93.
Mousli M, 2016, « Le bonheur, nouvel objectif de l’entreprise ? », L’Économie politique, n°71.
Nassif P., 2015, « Existe-t-il de grandes entreprises libérées ? », Contrepoints, 4 juin.
Nayar V., 2010, Employee First, Customer Second; Turning Conventional Management Upside Down, Harvard Business Review Press, may.
Nussbaum M., 2012, Capabilités. Comment créer les conditions d’un monde plus juste ?, Paris, Flammarion, coll. « Climats », 300 p., trad., Solange Chavel.
Palier B., 2016, « Pour une stratégie inclusive de montée en qualité de l’économie et de la société française », contribution au débat « Compétitivité que reste-t-il à faire ? » de France Stratégie, avril.
Parent-Thirion A., « Foundation Focus » n°١٥, June, ٢٠١٤.
Parker P.A., Baltes B.B., Young S.A., Huhff J.W., Altmann R.A. Lacost H.A., Roberts J.E., 2003, « Relationship between psychological climate perceptions and works outcomes : a meta-analytical review », Journal of organizational behavior , 24, pp.389-416.
Peters T., 1993, L’entreprise libérée : libération management, Ed. Dunod.
Philippon T., 2007, Le capitalisme d’héritiers. La crise française du travail, Paris, Le Seuil.
Porter L.W., Mowday R.T., Steers R.M., 1979, « The measurement of organizational commitment », Journal of vocational behavior , 14, pp.224-247.
Institu Gallup , étude mondiale réalisée en 2011-2012 « State of the Global Workplace: employee engagement insights for business leaders worldwide ».
Rapport de la commission européenne, direction générale communication, 2012, « Les valeurs des européens », réalisé par TNS Opinion & Social à la demande de la commission.
Revue « Personnel » (ANDRH), Janvier 2016, n°566, pp.40-41.
Richer M., 2013, « La RSE comme réponse à la crise du sens : 3 chantiers de progrès », article paru sur management-rse.com.
Richer M., 10 janvier 2014, « Qualité de vie au travail : un accord déjà oublié », Metis.
Richer M., 2016, « Démarches QVT : la nécessaire refondation du rôle du manager de proximité » in Anact, « Qualité de vie au travail : négocier le travail pour le transformer ; enjeux et perspectives d’une innovation sociale », Revue des Conditions de Travail (RDCT) No 4, mai
Rigoni B., Nelson B. 2016, « The No-Managers Organizational Approach Doesn’t Work”, Gallup, February 2016.
Robertson B. 2016, « La révolution Holacracy, le système des entreprises performantes », Alisio, mars.
Roche C., 2016, Le Lean en questions, Ed. L’Harmattan.
Ryan R.M., Deci E.L., 2001, « To be happy or to be self-fulfilled : A review of research on hedonic and eudaimonic well-being », Annual Review of Psychology , vol. 52, p. 141-166.
Sailly M., 2014, « Le lean management, une histoire de détournement ? », Séminaire n° 35 de l’Observatoire des Cadres, Paris, 15 octobre.
Sarazin B., Jaouën M., 2010, « Bien-être au travail, quand l’humain retrouve sa place », Travail et Changement, Anact, n°334, Novembre/Décembre.
Seligman M.-E.-P., 2002, Authentic Happiness : Using the New Positive Psychology to Realize Your Potential for Lasting Fulfillment , Free Press, New York.
Senik C, 2014, L’économie du bonheur, Seuil, La République des idées.
Tavani J-L., Monaco G. Lo, Hoffmann-Hervé L., Botella M., Collange J., 2014, « La qualité de vie au travail : objectif à poursuivre ou concept à évaluer ? », Archives des maladies professionnelles et de l’environnement.
Terra Nova, 2013, « Bien-être et efficacité : pour une politique de qualité de vie au travail », Note de Terra Nova, rédigée par Martin Richer, 18 mars.
« The Good Jobs Strategy”, New Harvest, 2014.
Trist E., 1981, « The evolutional of socio-technical systems », Occasional paper n°2, june.
Trist E., 1950, « The relations of social and technical systems in coal-mining », paper presented to the Bristish Psychological Society , industrial section.
Trontin C., Lassagne M., Boini S., Rinal S., 2007, « Le coût du stress professionnel en France en 2007 », INRS, Arts et Métiers et GRID.
Ughetto P., 2015, « Le travail à l’heure du lean », in L’Industrie, notre avenir, cordonné par Veltz P. et Weil T., Eyrolles.
Vandenberghe C., 1998, « L’engagement des salariés dans l’entreprise », Interactions, Vol. 2.
Verrier G., 2016a, Faut-il libérer l’entreprise ? Confiance, responsabilité et autonomie au travail, Dunod.
Verrier G., 2016b, « Faut-il libérer l’entreprise ? », RHinfo, 11 janvier.
Verrier G., 2016c, « Les entreprises doivent développer l’autonomie », Liaisons Sociales Magazine, 5 janvier.
Vialeur J., Trudel V., 1983, « La qualité de vie au travail et l’horaire variable », Relations industrielles, vol. 38, n°3.
Wood S., 1999, “Human resource management and performance”, International Journal of Management Reviews , Vol. 1, No. 4, 1999, pp.367–413.
Wright, T.A., 2010, More than meets the eye: The role of employee well-being in organizational research. Garcea (Eds.), Oxford Handbook of Positive Psychology and Work. New York, NY: Oxford University Press
Par Emilie Bourdu, Marie-Madeleine Péretié, Martin Richer, La qualité de vie au travail : un levier de compétitivité. Refonder les organisations du travail, Paris, Presses des Mines, 2016.
ISBN : 978-2-35671-424-4
ISSN : 2495-1706
© Presses des MINES – TRANSVALOR, 2016
60, boulevard Saint-Michel – 75272 Paris Cedex 06 – France
presses@mines-paristech.fr
www.pressesdesmines.com
© La Fabrique de l’industrie
81, boulevard Saint-Michel -75005 Paris – France
info@la-fabrique.fr www.la-fabrique.fr