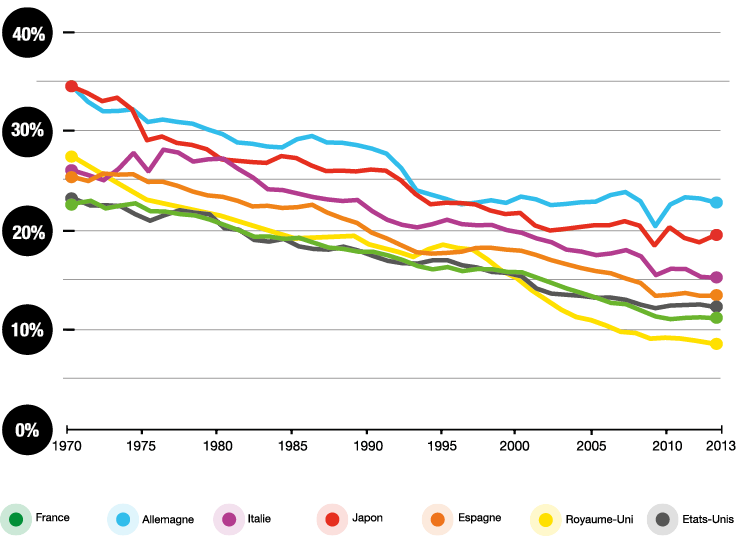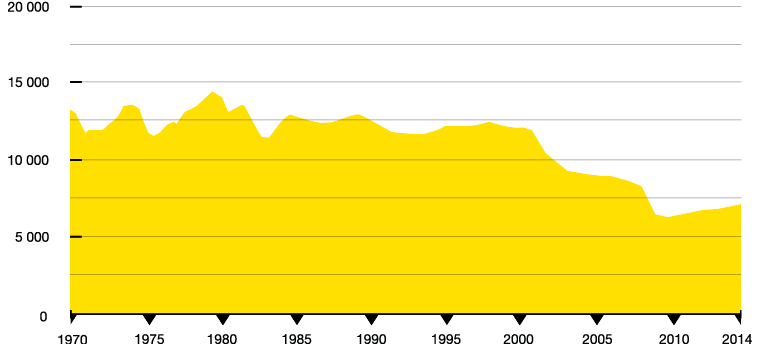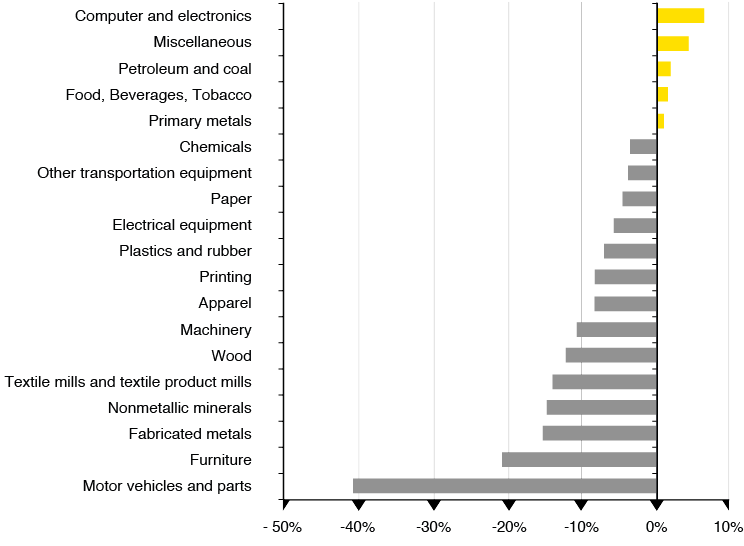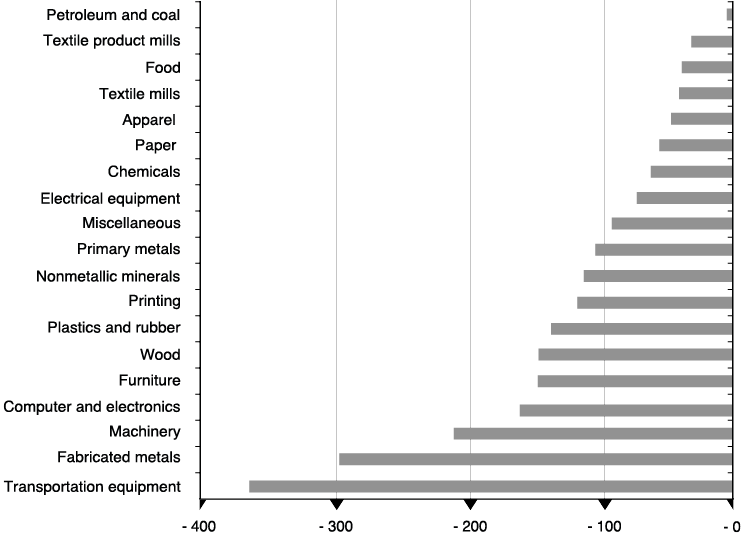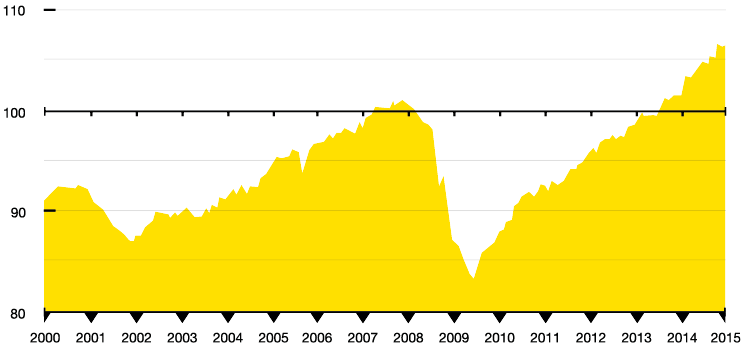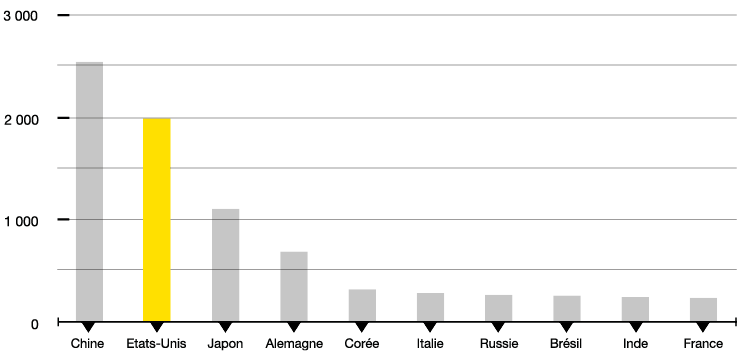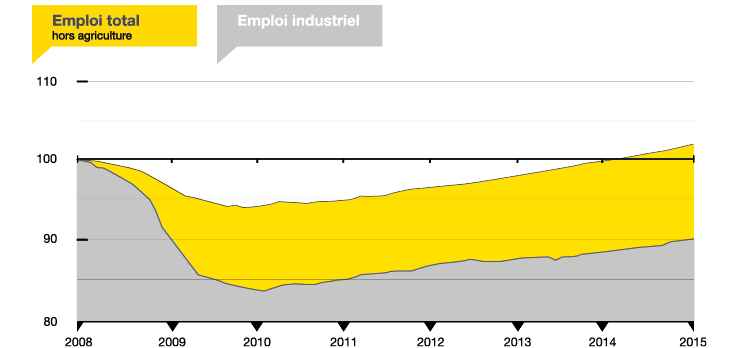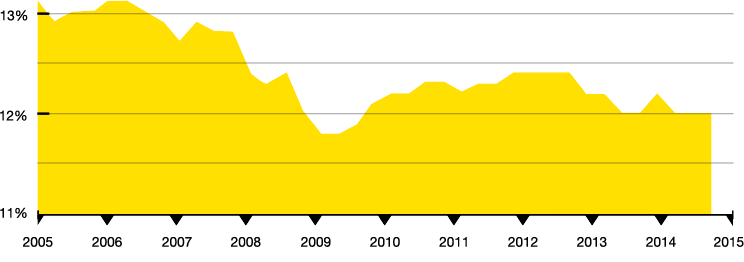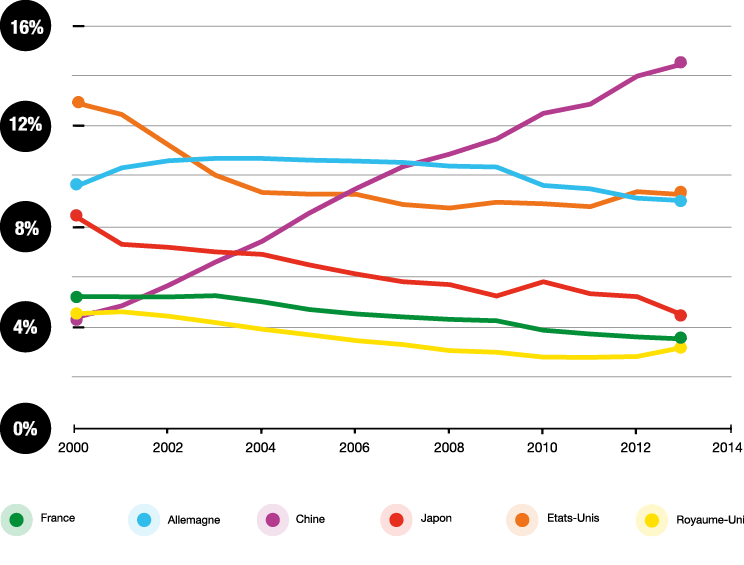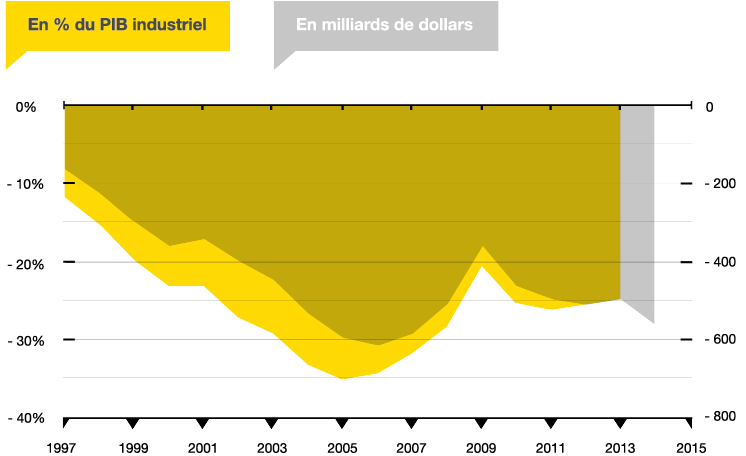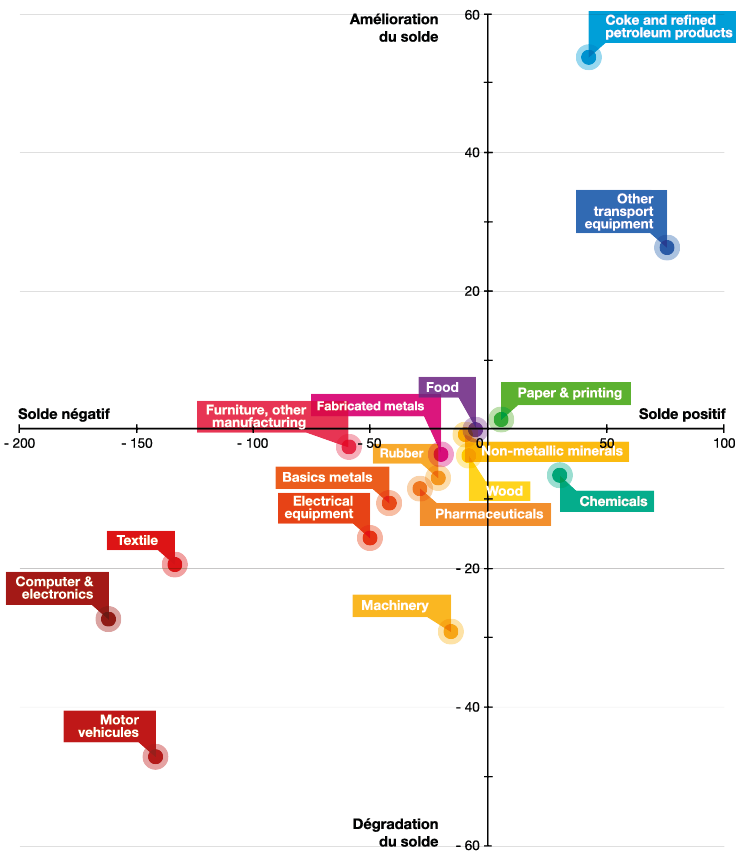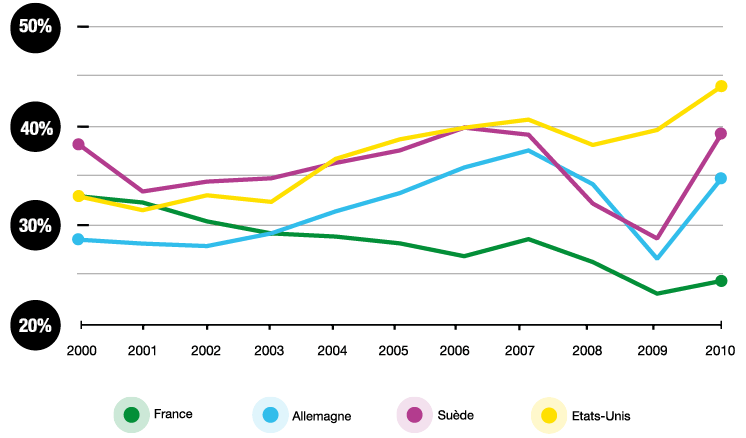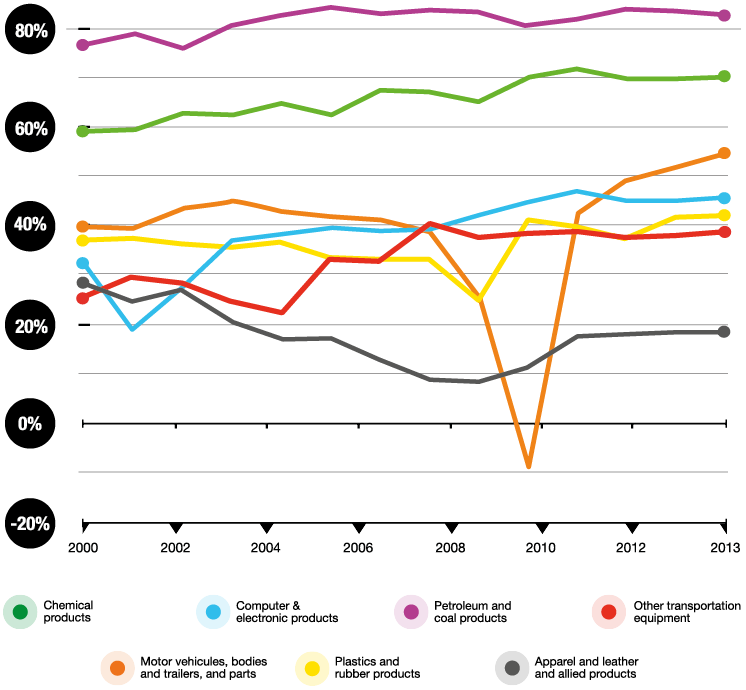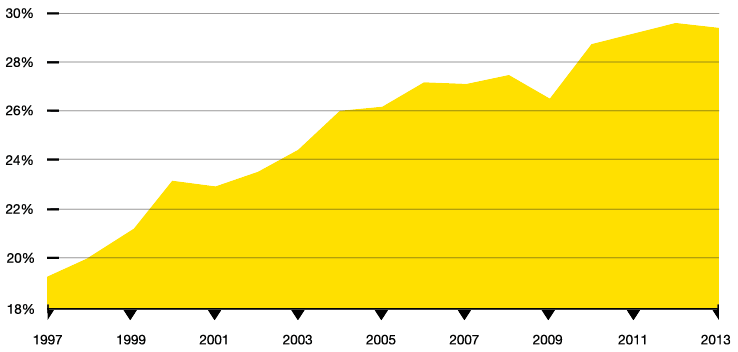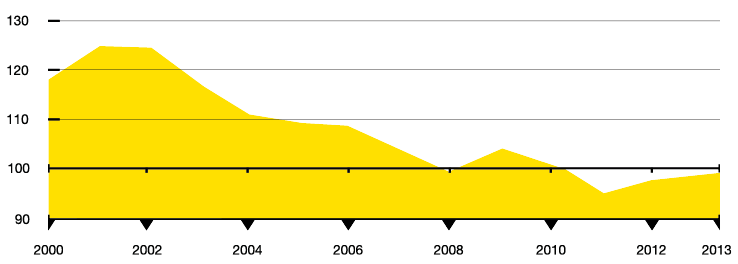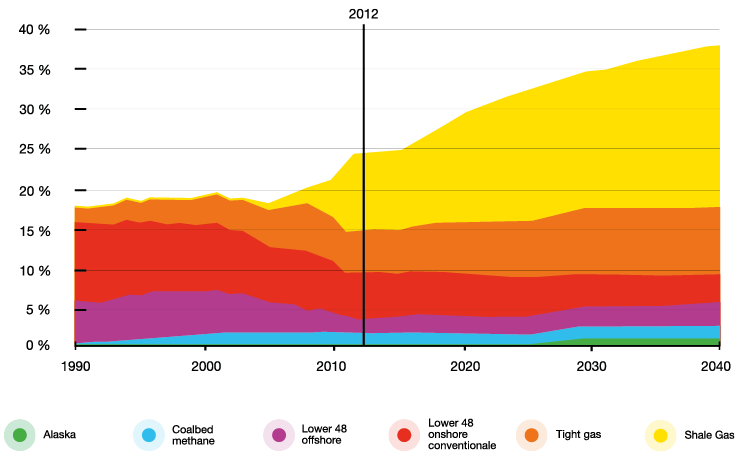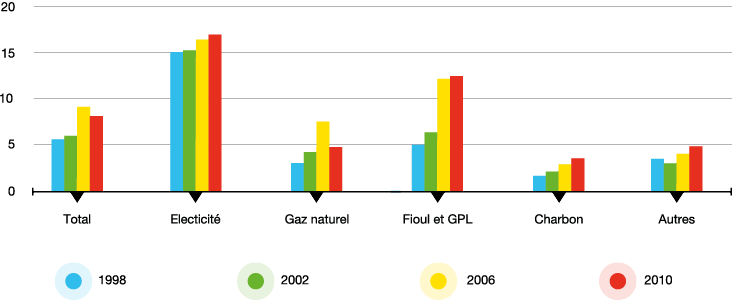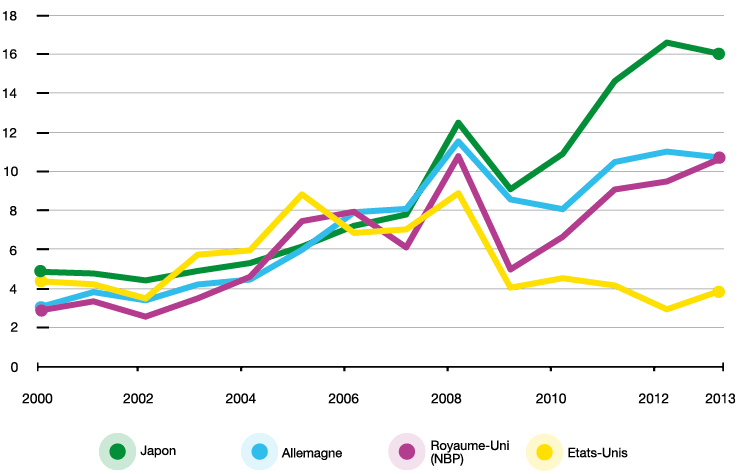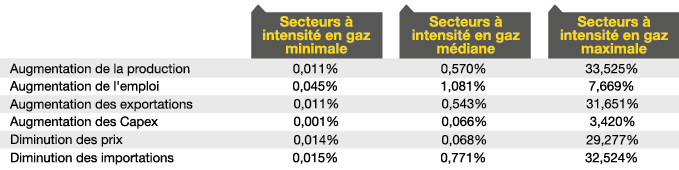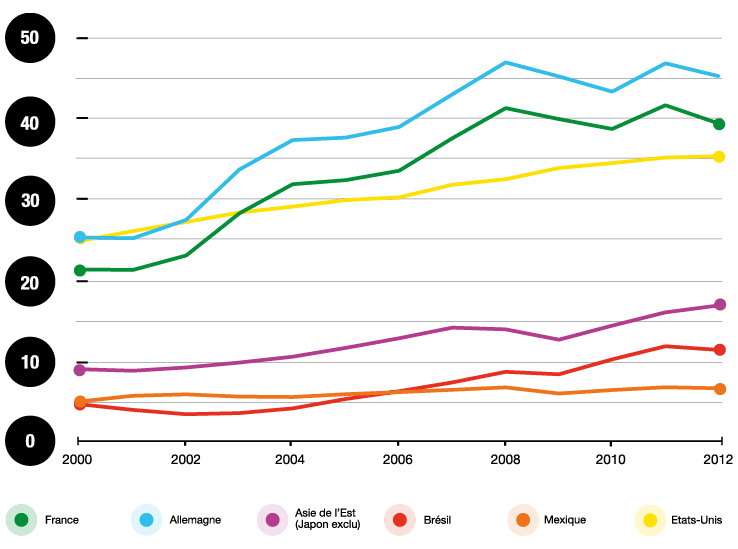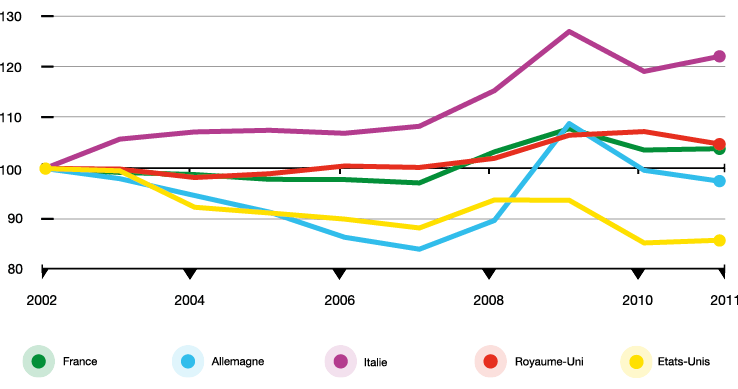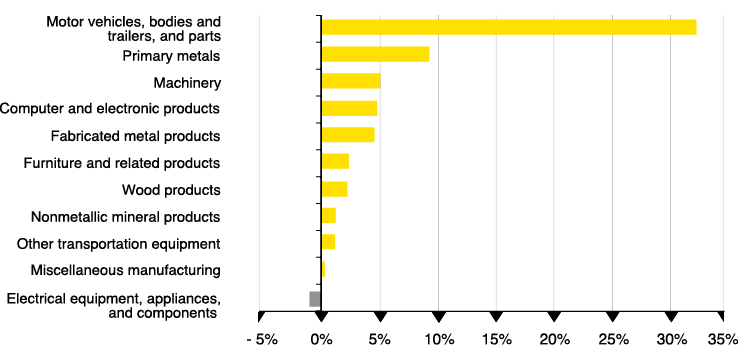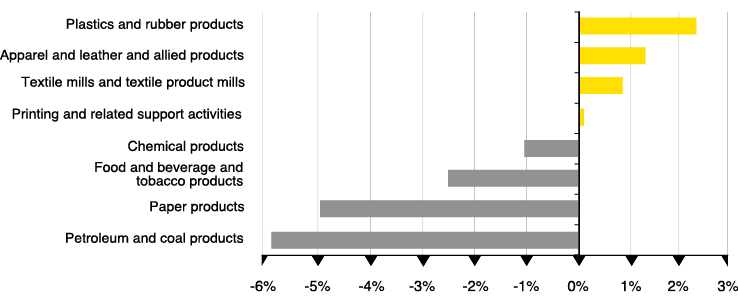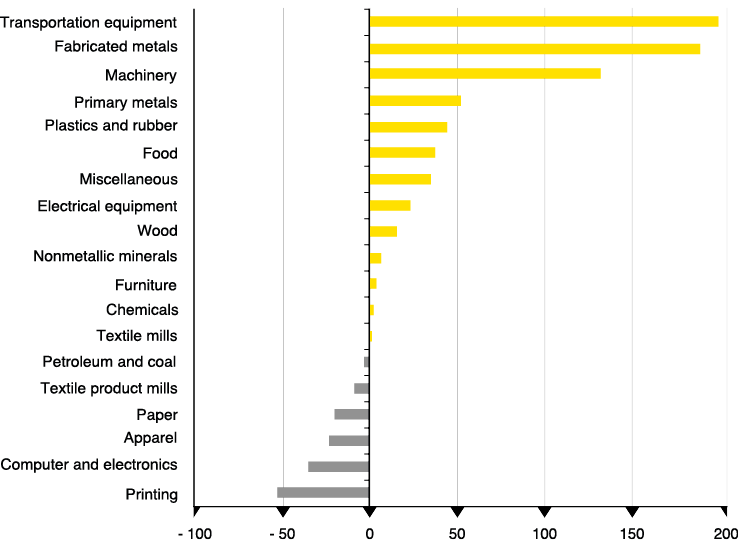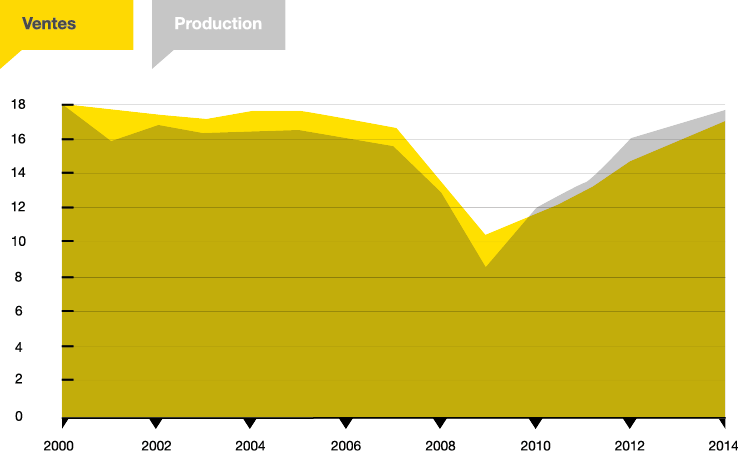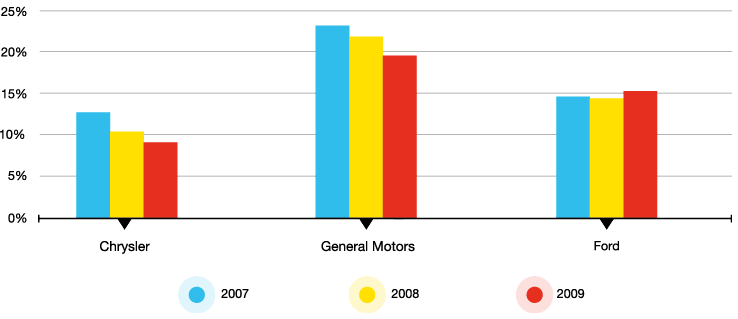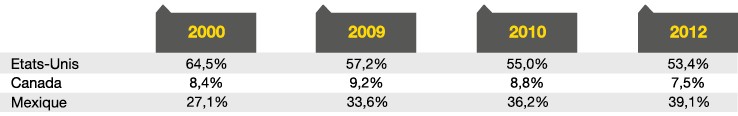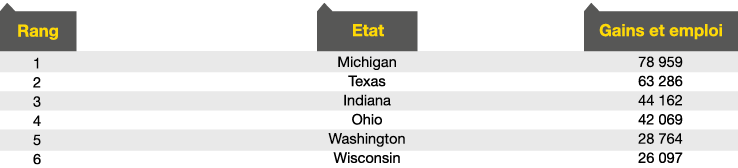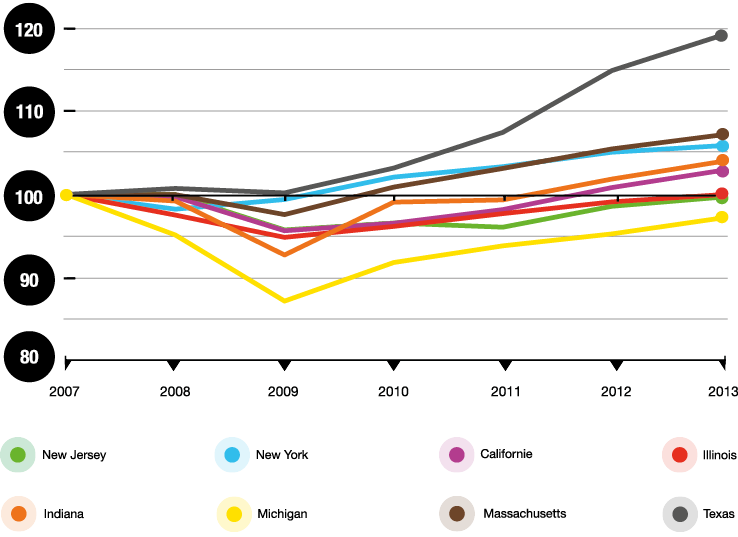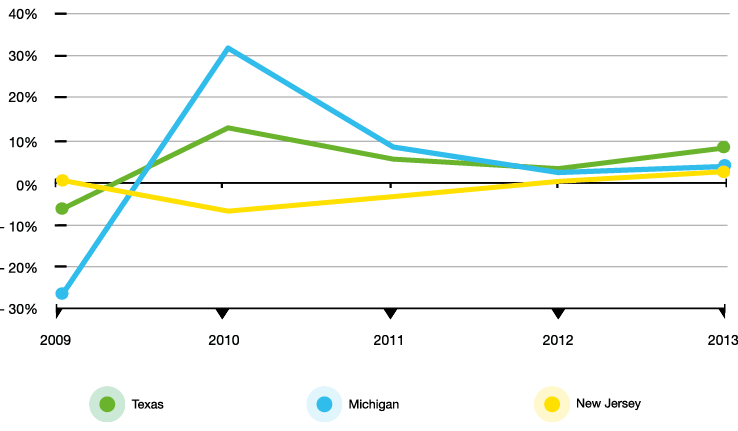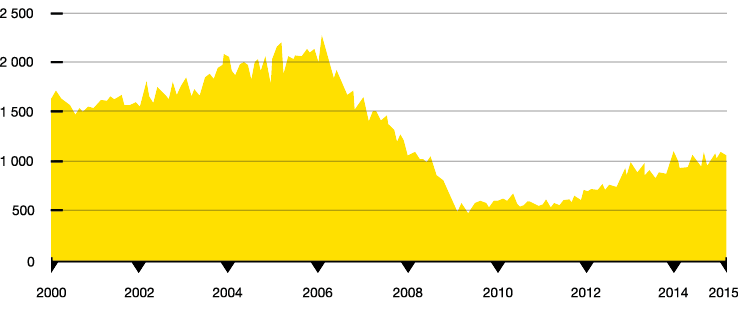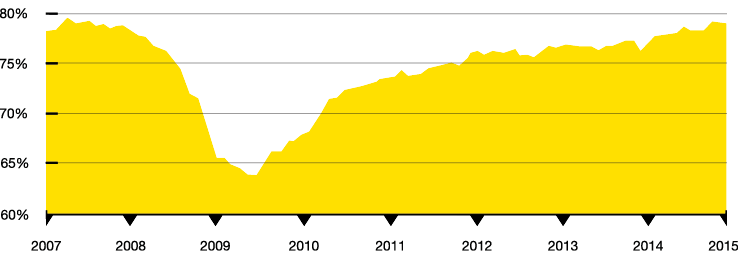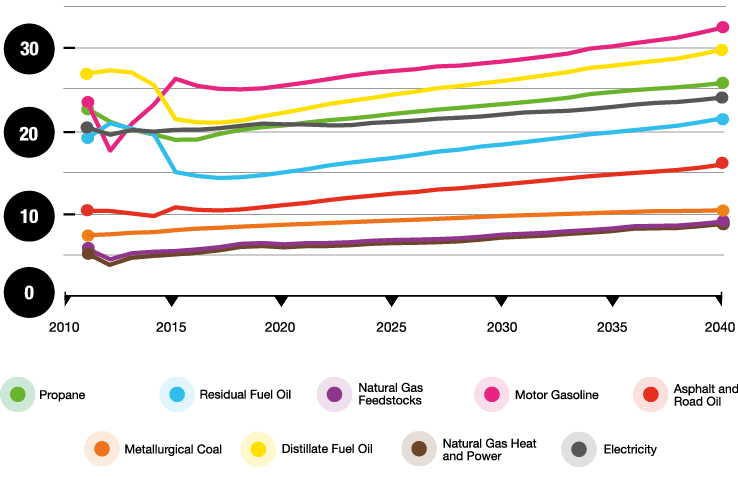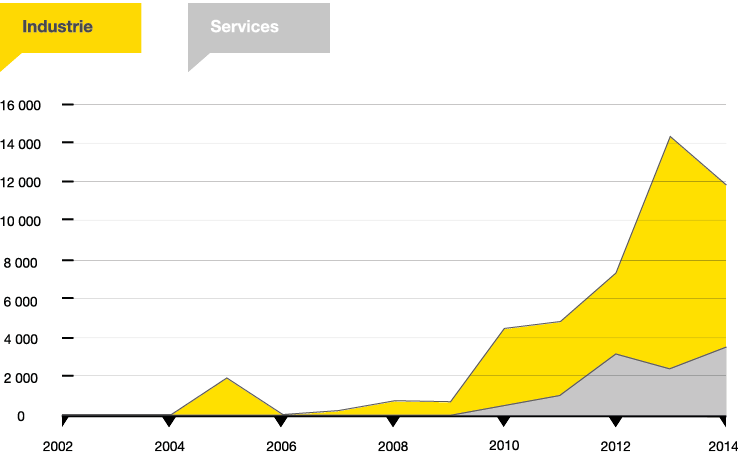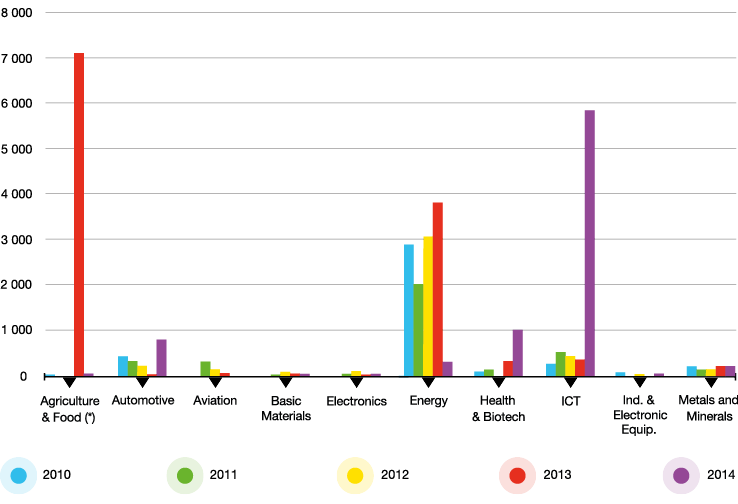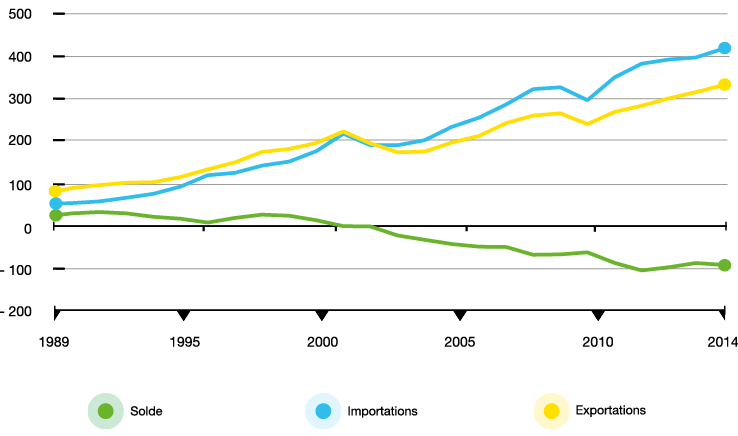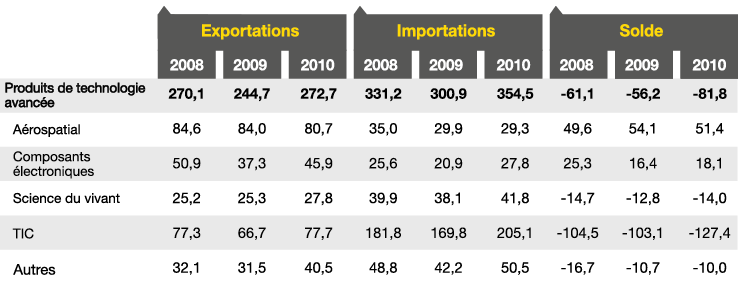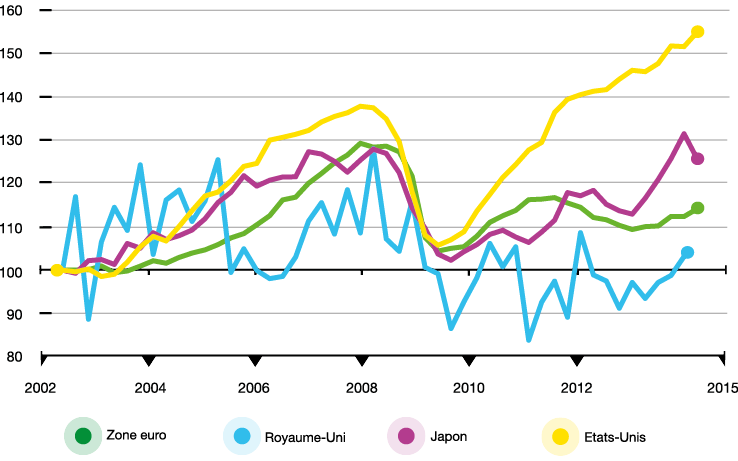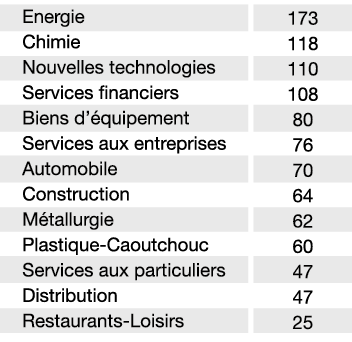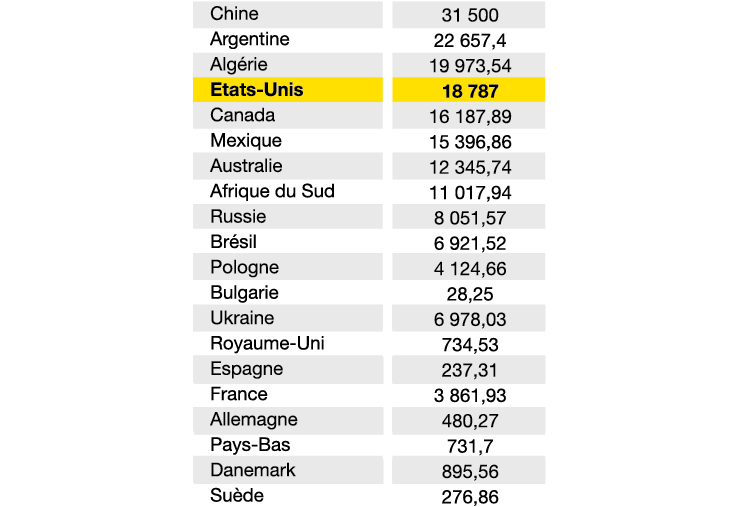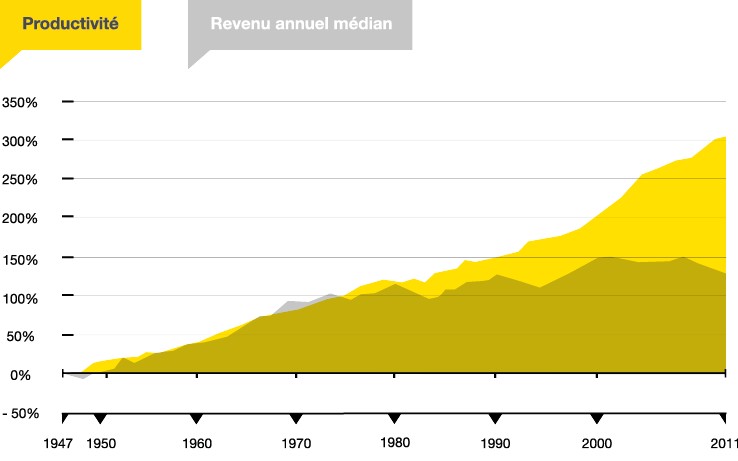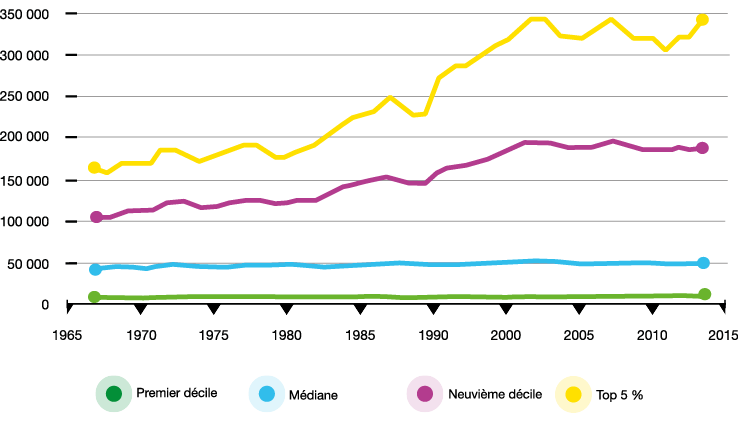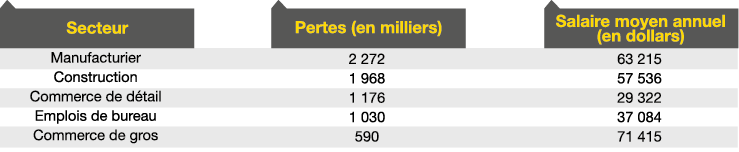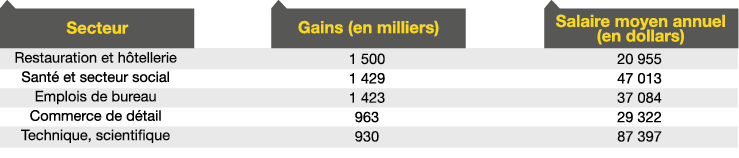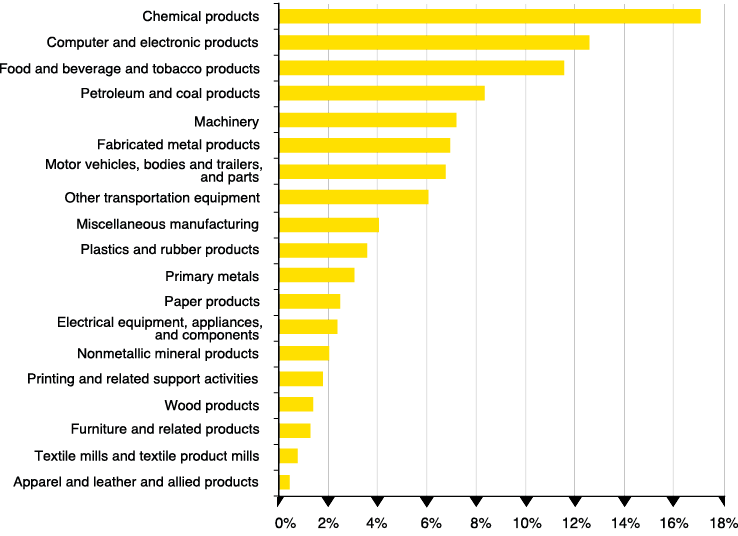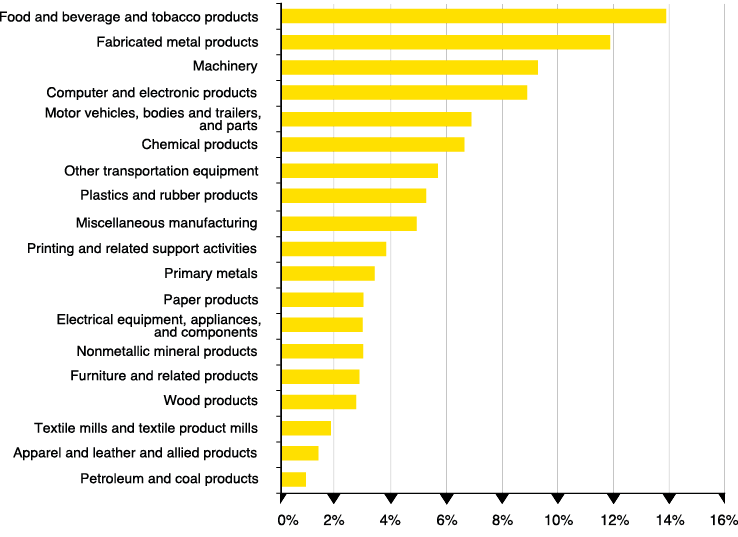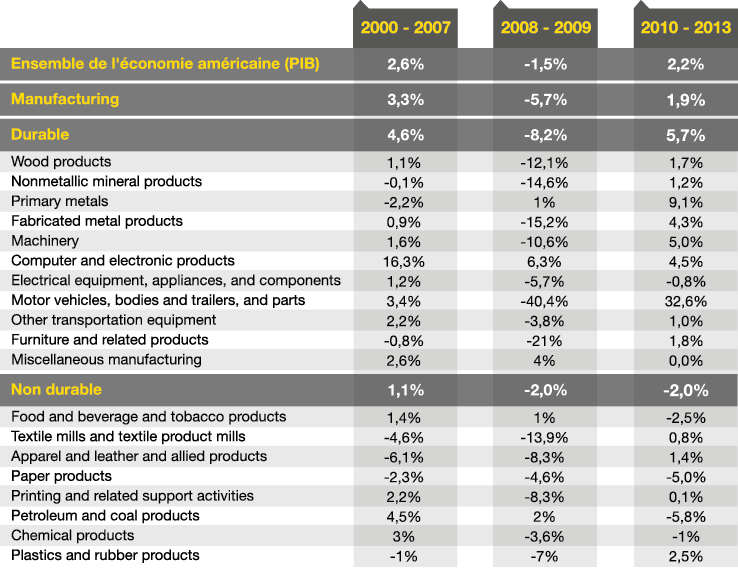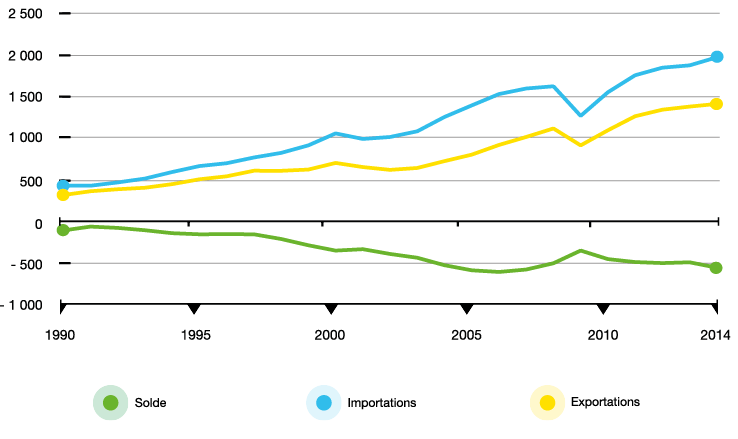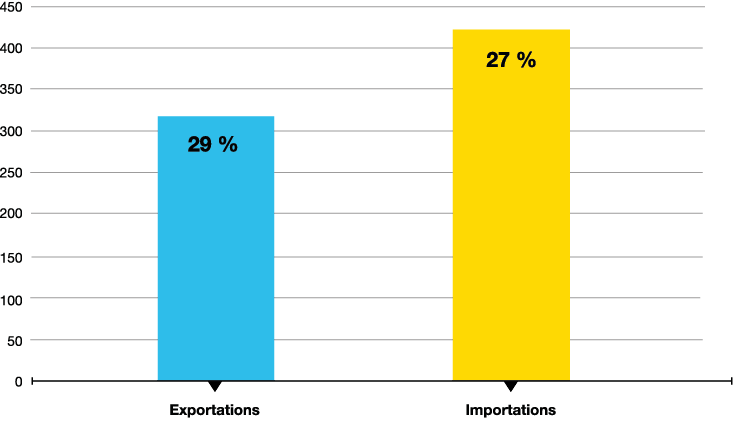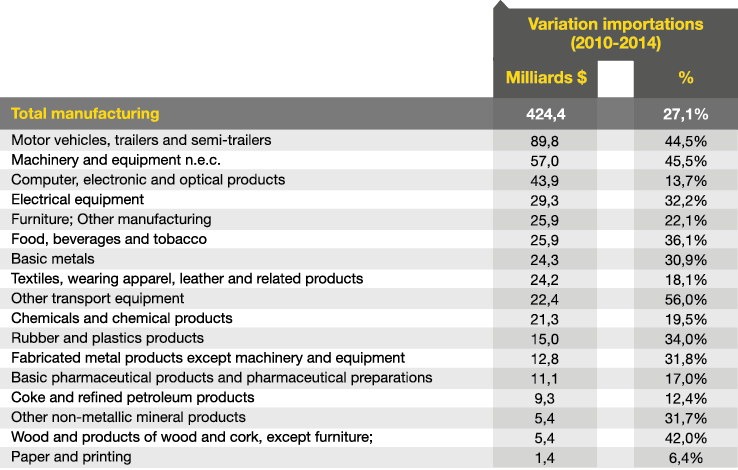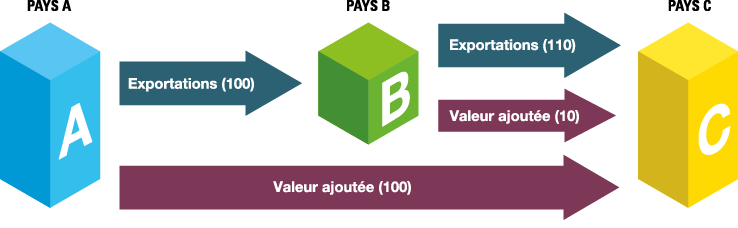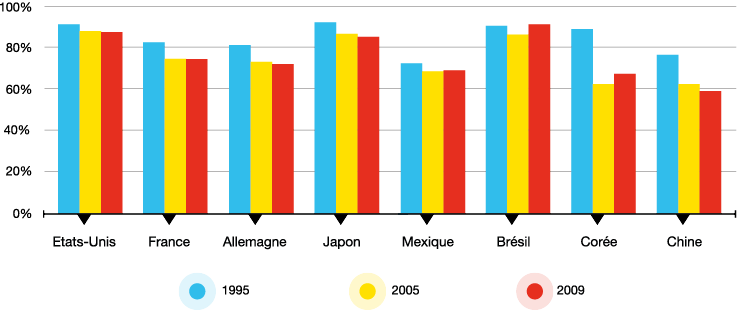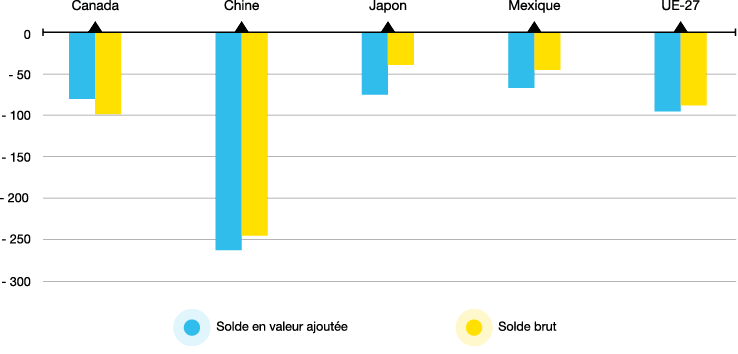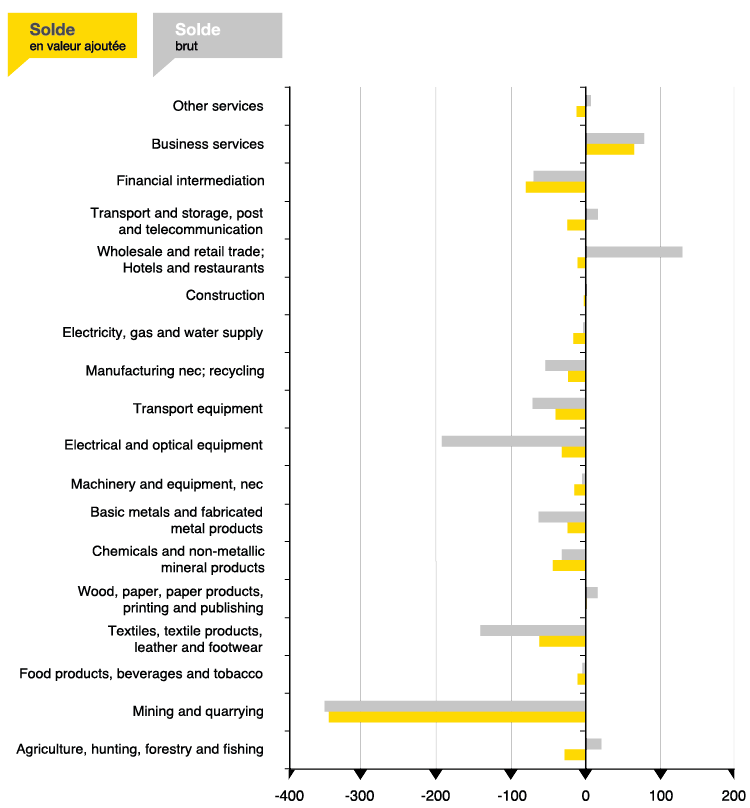L’industrie américaine : simple rebond ou renaissance ?

Stanimirovitch Douchan (1912-1978), Gratte-ciel © Archives Alinari, Florence, Dist. RMN-Grand Palais / Douchan Stanimirovitch
Remerciements
Cette publication a été réalisée par La Fabrique de l’industrie et grâce au concours de nombreux experts du sujet. Nous tenons ici à remercier toutes les personnes qui, par leur contribution écrite, leur relecture attentive ou leurs commentaires avisés, nous ont permis d’enrichir ce travail.
Nous souhaitons plus particulièrement remercier Patrick Artus (Natixis), Daniel Atlan, Martine Azuelos (université Sorbonne Nouvelle), Jean-François Boittin (DG Trésor), Sébastien Bouchet (Microsoft), Pascal Colombani (Valeo), André Gauron (Lasaire), François Gayet (Cercle de l’Industrie), Pierre-Noël Giraud (Ecole des Mines), Pierre Grandjouan (DG Trésor), Bernard Jullien (Gerpisa), Philippe Le Corre (Brookings
Institution), James Manyika (McKinsey), François Marion (Valeo), Tanguy Marziou (AmCham), Elisabeth Paté-Cornell (université de Stanford), Patrick Pélata (SalesForce), Jean-Loup Picard, Sree Ramaswamy (McKinsey), Denis Randet (ANRT), Nicolas de Warren (Arkema) et Michael M. Woody pour leur précieuse collaboration.
Préface
Après des années sombres, l’industrie semble retrouver quelque couleur en France. Mais cette évolution, encore timide, contraste avec la vigueur de la reprise enregistrée par l’industrie américaine depuis la fin de la crise. La « Grande Récession » de 2008-2009 a certes marqué les esprits outre-Atlantique ; elle a pourtant aujourd’hui laissé la place à un rebond tout aussi impressionnant.
La production industrielle américaine a dépassé son niveau d’avant-crise et, phénomène plus remarquable encore, de nouveaux emplois se créent dans le secteur, ce qui n’était pas arrivé depuis plus de quinze ans. A tel point que le mot de « renaissance » a fini par s’imposer dans la presse et parmi de nombreux observateurs.
Cette reprise, par son ampleur, éveille la curiosité. Pour l’expliquer, certains avancent le rôle prépondérant du facteur énergétique, depuis la mise en exploitation des immenses réserves d’énergie non conventionnelle dont disposent les Etats-Unis. D’autres affirment que la modération salariale imposée sur la dernière décennie a rendu le territoire américain plus attractif. D’autres encore soulignent que le regain industriel n’aurait pu avoir lieu sans le volontarisme des pouvoirs publics durant la crise, citant en exemple le sauvetage de l’industrie automobile.
Dans cette note, La Fabrique de l’industrie cherche à mieux comprendre les déterminants de ce redressement spectaculaire. Elle nous apprend qu’on ne peut ramener les bonnes performances de l’industrie américaine à un seul des facteurs régulièrement avancés. Aucun ne suffit à lui seul à expliquer l’embellie mais tous participent à la restauration d’un climat économique favorable. A cela s’ajoute évidemment, le développement incroyablement rapide du numérique et en particulier du secteur internet et la domination qu’il exerce au plan mondial, repoussant les limites de ce qu’on appelle l’« industrie ».
Ce qui étonne en revanche, c’est qu’il reste difficile de déceler une amélioration généralisée de la compétitivité des entreprises. Les industriels ont certes retrouvé des niveaux de marges confortables mais le déséquilibre extérieur de la plupart des secteurs manufacturiers ne s’est pas résorbé. Cela reste un sujet d’inquiétude et une faiblesse pour leur développement. Le mouvement supposément « massif » de relocalisation d’activités, autrefois transférées vers les pays à bas coût de main d’œuvre, peine également à convaincre dans les faits. La reconstitution du tissu industriel, miné par des années de délocalisations, demeure un défi majeur et le numérique lui-même ne produit pas jusqu’à présent les gains de productivité attendus. D’autres obstacles, faisant écho aux préoccupations françaises, tels que la formation d’une main d’œuvre qualifiée ou l’attractivité du secteur, devront aussi être surmontés.
C’est pourquoi le redémarrage de l’industrie américaine, ainsi que le contexte singulier dans lequel il s’est opéré, constituent des éléments précieux pour inspirer les stratégies de reconquête de l’industrie pour la France.
Louis Gallois
Résumé exécutif
La sortie de crise : rebond ou renaissance ?
Les Etats-Unis ont dominé l’industrie mondiale pendant un siècle avant d’être dépassés par la Chine en 2010. A l’image de nombreux pays développés, l’économie américaine a vu l’importance de son industrie diminuer au cours des dernières décennies. Plus de 8 millions d’emplois industriels ont été détruits entre l’apogée de 1979 et 2011, sous l’effet d’importants gains de productivité, de l’externalisation d’emplois à des entreprises spécialisées, mais aussi d’une perte de compétitivité vis-à-vis des pays à bas coûts de main d’œuvre et de la vague de délocalisations qui s’en est suivie. En particulier, le déficit commercial par rapport à la Chine dans les produits manufacturés a été multiplié par 31 entre 1990 et 2013 et représente plus des deux tiers du déficit manufacturier américain.
Depuis 2010, la tendance semble s’être retournée. La production industrielle a retrouvé début 2014 son niveau d’avant la crise et quelque 850 000 emplois industriels ont été créés. Ce dynamisme fait de nombreux envieux dans les pays qui, comme la France, assistent au délitement continu de leur industrie. Aux Etats-Unis, le mot « renaissance » a été abondamment repris, avec soulagement et fierté, pour caractériser cette reprise du manufacturing.
Ce terme nous paraît toutefois prématuré voire trompeur : la renaissance suppose en effet une amélioration structurelle durable de la situation de l’industrie. Or la croissance récente compense à peine la saignée qu’a représentée la période 2008-2009, rebaptisée Grande Récession. Par ailleurs, l’embellie n’est pas générale : les secteurs industriels suivent des trajectoires très contrastées, tout comme les différentes parties du territoire américain. Enfin et surtout, c’est à tort selon nous que cette croissance est attribuée à un regain de compétitivité : le sursaut de l’industrie américaine est d’abord un rebond autocentré.
L’invisible regain de compétitivité
L’industrie manufacturière américaine bénéficie, depuis bien avant la crise, d’une excellente compétitivité-coût. Le coût unitaire de la main-d’œuvre a baissé de 15 % entre 2002 et 2011, alors qu’il augmentait (en dollars) de 80 % en Italie, 53 % en France, 43 % en Allemagne. Même en tenant compte des effets de change, la modération salariale dans l’industrie manufacturière fut plus importante outre-Atlantique qu’en Allemagne. Les industriels américains bénéficient également de l’abondance d’une énergie bon marché. Aux Etats-Unis, l’électricité est globalement deux fois moins coûteuse qu’en Europe ou au Japon pour les industriels, et ce depuis longtemps. De plus, depuis la mise en exploitation de nombreux gisements de gaz de schiste, le gaz naturel y est lui aussi devenu deux à trois fois moins cher.
Toutefois, contrairement à ce que suggèrent de nombreux commentateurs, la reprise d’après 2008 ne semble pas avoir été le fruit d’une compétitivité accrue. En effet, le déficit commercial dans les biens manufacturés, structurel depuis le début des années 1990, s’est réduit durant la crise avec le ralentissement du commerce mondial, mais il n’a cessé de se dégrader jusqu’en 2014 et représente 566 milliards de dollars1. L’augmentation de l’excédent commercial dans les services ainsi que la baisse de la facture énergétique ont eu tendance à masquer cette réalité dans de nombreuses analyses.
En réalité, seuls deux secteurs industriels se distinguent nettement des autres par l’amélioration de leur solde commercial. Il s’agit de l’industrie aéronautique et des produits pétroliers raffinés. Le premier est historiquement un fort contributeur aux exportations américaines grâce à l’implantation d’entreprises comme Boeing. Leur activité a bénéficié du redémarrage du marché mondial et les exportations du secteur ont atteint en 2014 un nouveau record à 137 milliards de dollars. Le second a pour sa part tiré profit d’un récent et impressionnant boom des pétroles non conventionnels. Hormis ces deux exceptions, la quasi-totalité des autres secteurs présentent un déficit commercial qui se dégrade. En particulier, le déficit s’accroît dans des secteurs comme l’automobile, dont la production a pourtant fortement rebondi depuis 2009, ou les produits informatiques et électroniques, qui sont restés très dynamiques sur les dernières années. Au total, la part des importations dans la consommation américaine de biens manufacturés est passée de 27 % en 2007 à 29 % en 2013.
Certes, quelques cas de relocalisations font sensation dans les médias et alimentent de nombreuses publications. Pourtant, leur poids n’apparaît pas déterminant. L’estimation, probablement optimiste, de la Reshoring Initiative évalue à 100 000 les créations d’emplois manufacturiers liées aux relocalisations entre 2010 et 2013. Cela compense tout juste les délocalisations intervenues sur la même période. De nombreuses firmes, en particulier dans le secteur des hautes technologies, ont annoncé qu’elles allaient rapatrier des activités sur le sol américain mais n’ont jamais sauté le pas en raison des nombreux obstacles qu’une telle démarche rencontre.
Le propos n’est pas ici de nier que l’industrie américaine soit compétitive mais de contester que le « miracle » récent de l’emploi industriel puisse être attribué à une amélioration drastique de l’offre.
Un rebond autocentré et hétérogène
C’est principalement une dynamique autocentrée de rattrapage, reposant sur la vigueur de la demande, qui a permis à l’industrie manufacturière américaine de se relever après la Grande Récession. Le retour du crédit et de la confiance, stimulé par une politique monétaire accomodante, les investissements du secteur énergétique, entre autres facteurs, ont incité les consommateurs et les firmes américaines à réaliser d’importants achats de biens durables qu’ils avaient reportés en raison de la crise. Ainsi, les secteurs pour lesquels la valeur ajoutée et l’emploi sont en plus forte croissance sont aussi ceux qui ont été les plus durement touchés pendant la crise, à l’image de l’industrie automobile dont la valeur ajoutée a progressé de plus de 30 % par an entre 2010 et 2013. Le soutien des administrations Bush et Obama au secteur et en particulier à Chrysler et General Motors fut décisif. La chute de ces empires aurait emporté un nombre colossal de fournisseurs, avec le risque de voir du même coup les capacités de production de l’écosystème industriel américain se dégrader subitement.
D’autres secteurs ont connu des croissances importantes entre 2010 et 2013 à l’image des métaux primaires (9,1 % par an en moyenne), les machines (5 %), les produits informatiques et électroniques (4,5 %), ainsi que les produits métalliques (4,3 %). Le plus gros secteur industriel en termes de valeur ajoutée, la chimie, ne s’est pas encore remis de la Grande Récession. Ce secteur est dans une phase de transition, la mise en service de capacités de production additionnelles destinées à tirer profit du faible coût du gaz naturel ne débutant qu’à partir de 2015.
Par ailleurs, on constate depuis 2010 que les principaux gains en emplois manufacturiers sont concentrés dans six Etats (Michigan, Texas, Indiana, Ohio, Washington et Wisconsin), c’est-à-dire dans les zones qui concentrent l’activité des secteurs en croissance.
Le caractère hétérogène de la reprise, sur les plans sectoriel et géographique, est donc frappant.
Un comeback du made in America ?
Après dissipation des effets de rattrapage, l’industrie devrait poursuivre sur une bonne tendance en 2015 et 2016 grâce à une consommation soutenue et des investissements importants. L’emploi et la production devraient donc progresser régulièrement dans les prochaines années puis marquer le pas, pâtissant à terme du ralentissement de la croissance dans le secteur des matériels de transport.
Allons-nous assister à un retour massif des activités de production aux Etats-Unis ? Certes, les divergences mondiales des prix continueront de favoriser une redistribution de la production de biens intensifs en énergie, au profit des Etats-Unis et du Moyen-Orient, et au détriment de l’Union européenne. L’Agence internationale de l’énergie estime ainsi qu’entre 2011 et 2035, la part de marché de l’UE à l’export passera de 40 à 30 % pour les produits chimiques et de 16 à 7 % pour les métaux non ferreux. Mais les Etats-Unis ne seront pas la seule région du monde, loin de là, à rapatrier ces activités, l’attractivité étant largement multifactorielle. Concrètement, les parts de marché américaines ne devraient pas augmenter de manière drastique : passant de 13 à 15 % pour les produits chimiques, et de 5,25 à 6,5 % pour les métaux non ferreux. Il y a donc bien des gains à attendre en termes de production et d’exportations pour les secteurs intensifs en énergie américains, mais ils ne seront pas aussi spectaculaires que certains l’annoncent aujourd’hui.
Pour tous les autres secteurs manufacturiers, les coûts croissants de gestion des chaînes de valeur mondialisées, associés à un recentrage de l’économie chinoise sur son marché intérieur, pourraient favoriser un certain retour du made in USA. On observe en outre une montée en puissance des investissements chinois à destination des Etats-Unis à partir de 2010, date à laquelle ils ont dépassé le seuil – certes modeste mais symbolique – du milliard de dollars. Ils ont depuis enregistré une progression fulgurante, en se concentrant très largement dans l’industrie (76,2 % des investissements réalisés entre 2002 et 2014). Les cas anecdotiques de relocalisations pourraient dès lors être les prémices d’un retour des activités délocalisées ces dernières décennies. Cette perspective reste toutefois aujourd’hui incertaine et controversée. Plusieurs observateurs conjecturent par exemple que le Mexique, hinterland-atelier américain, serait le grand gagnant du rééquilibrage économique entre la Chine et les Etats-Unis.
La question du leadership américain dans le domaine du numérique prête également à débat. Le déficit de la balance commerciale dans les produits de technologie avancée n’a cessé de se creuser depuis le début des années 2000 et amène certains commentateurs à remettre en cause la suprématie de l’industrie high-tech américaine. D’autres arguent du fait que le secteur industriel n’est aujourd’hui encore qu’au début d’un processus de profonde transformation. Ils rappellent que le logiciel et les applications représentent une grande partie de l’activité du secteur des TIC et qu’une analyse se limitant aux produits est nécessairement incomplète. La diffusion du numérique bouleverse les modes de production et les marchés pour de nombreuses activités, repoussant les limites entre industrie et services. Les Etats-Unis n’auraient ainsi rien perdu de leur domination, bien au contraire.
Quoi qu’il en soit, l’industrie manufacturière américaine devra surmonter de nombreux obstacles dans les années à venir. Premièrement, à force d’avoir éloigné les activités de production, les entreprises américaines vont devoir « réapprendre à produire », ce qui suppose entre autres de rebâtir des écosystèmes performants entre donneurs d’ordres et sous-traitants. Deuxièmement, elles pourraient voir menacée leur domination dans la recherche et l’innovation, du fait là encore d’un éloignement prolongé entre les zones de conception et de fabrication. Se pose ensuite la question de la soutenabilité des pratiques de modération salariale, au regard de l’augmentation des inégalités sociales et des tensions afférentes. Enfin, l’industrie souffre d’un déficit de main-d’œuvre qualifiée, notamment de techniciens spécialisés, qu’elle peine aujourd’hui à combler en raison de la mauvaise image dont elle souffre dans l’opinion.
- 1 – Rappelons que le déficit commercial français dans les biens manufacturés est d’environ 46 milliards de dollars et que le solde commercial européen est positif.
Executive summary
US manufacturing: upturn or renaissance?
The United States dominated global industry for a century before being overtaken by China in 2010. Like many developed countries, the American economy has seen its industry shrink during recent decades. Over 8 million industrial jobs were destroyed between the 1979 peak and 2011, impacted by considerable productivity gains, outsourcing to specialized companies, and reduced competitiveness in the face of countries offering cheap labour, prompting a wave of offshoring. In particular, the trade deficit compared to China for manufactured goods was multiplied by 31 from 1990 to 2013, representing over two-thirds of the American manufacturing deficit.
Since 2010, the trend seems to have turned around. In early 2014, industrial production returned to its pre-crisis level, and some 850,000 industrial jobs have been created. This impetus is the envy of countries like France, whose industry continues to collapse. In the United States, the word “renaissance” is frequently used with relief and pride to describe this manufacturing recovery.
However, we consider this term to be premature and even misleading: renaissance implies long-term structural improvement in the industry’s situation. Yet the recent growth barely makes up for the huge losses incurred from 2008-2009, now known as the Great Recession. In addition, the improvement is not general: industrial sectors are following very different trends, as are different areas of the American territory. Last but not least, we consider that it is incorrect to explain this growth by increased competitiveness: the surge in American manufacturing is mainly self-sustained.
Invisible increase in competitiveness
The American manufacturing industry is particularly cost-competitive, and was even well before the crisis. The unit labour cost dropped by 15% from 2002 to 2011, whereas it rose (in dollars) by 80% in Italy, 53% in France and 43% in Germany. Even taking exchange rates into account, wage moderation in the manufacturing industry was greater across the Atlantic than it was in Germany. American industrials also benefit from abundant, cheap energy. In the United States, electricity generally costs industrials half as much as it does in Europe or Japan, and has for a long time. Added to this, the prolific extraction of shale gas has cut the price of natural gas by half or two-thirds.
However, unlike suggestions made by numerous commentators, the post-2008 recovery does not seem to have been the result of increased competitiveness. The trade deficit of manufactured goods, which had been structural since the early 1990s, shrank during the crisis with the global trade slow-down, but then continued to deteriorate until 2014, representing 566 billion dollars2. The higher service trade surplus and a drop in the energy bill have tended to mask this fact in numerous analyses.
In reality, only two industrial sectors clearly show an improved trade balance: aviation and refined petroleum products. The former has historically contributed significantly to American exports thanks to the installation of companies like Boeing. Its activity has benefited from a pick-up in the global market, with exports from the sector reaching a new record of 137 billion dollars in 2014. The petroleum products sector has benefited from an impressive boom in unconventional oil production. Apart from these two exceptions, almost all of the other sectors show a worsening trade deficit. In particular, the deficit is increasing in sectors like the automative industry, despite a significant production upsurge since 2009, and computer and electronic products, which have remained very dynamic over recent years. Overall, the share of imports in American manufactured goods consumption went from 27% in 2007 to 29% in 2013.
It is true that some reshoring stories have hit the news and are frequently cited in numerous publications. However, their impact does not appear to be considerable. The probably optimistic estimate made by Reshoring Initiative is that 100,000 manufacturing jobs were created thanks to reshoring from 2010 to 2013. This just about compensates for the activities offshored during the same period. Numerous firms, mostly in the high-tech sector, have announced that they intend to reshore activities in the USA, but they have not yet done so due to the many obstacles involved.
Our intention here is not to deny that US industry is competitive, but to challenge the idea that the recent industrial employment “miracle” can be put down to a drastic improvement in supply conditions.
Self-sustained, uneven upturn
It is mainly self-sustained adjustment based on vigorous demand that has enabled the American manufacturing industry to get back on its feet following the Great Recession. The return of credit and confidence, stimulated by an accommodating monetary policy and investments in the energy sector, among other factors, have encouraged consumers and American companies to make significant purchases of durable goods that they had put off during the crisis. As a result, the sectors in which added value and employment are seeing strong growth are the same ones that were hardest hit by the crisis, such as the automative industry, which grew by over 30% a year from 2010 to 2013. The support that the Bush and Obama administrations gave the sector, especially Chrysler and General Motors, was decisive. The demise of these empires would have brought down a colossal number of suppliers, and risked bringing about a sudden drop in the production capacities of the American industrial ecosystem.
Other sectors grew significantly from 2010 to 2013, such as primary metals (average of 9.1% per year), machines (5%), computer and electronic products (4.5%) and fabricated metal products (4.3%). The biggest manufacturing sector in terms of added value, the chemical industry, has not yet recovered from the Great Recession. This sector is in a transition phase, and additional production capacities designed to take advantage of the low cost of natural gas will only start operating in 2015.
What is more, since 2010, the main manufacturing job gains have been concentrated in six states (Michigan, Texas, Indiana, Ohio, Washington and Wisconsin), in other words, in the zones harbouring the growth sectors’ activity.
The uneven distribution of the recovery, in terms of both sector and geography, is striking.
Is “Made in USA” making a comeback?
Once the adjustment effects have died down, manufacturing is likely to continue its upward trend in 2015 and 2016 thanks to sustained consumption and significant investments. Employment and production should therefore grow steadily over the next few years and then slow down, weakened in the long term by slower growth in the transport equipment sector.
Are we likely to see a massive turnaround in production activities in the United States? It is clear that global price differences will continue to foster a redistribution of the production of energy-intensive goods, to the advantage of the United States and the Middle East and to the detriment of the European Union. The International Energy Agency thus predicts that from 2011 to 2035, the EU’s export market share will drop from 40% to 30% for chemical products and from 16% to 7% for non-ferrous metals. Yet the United States will not be the only region in the world to repatriate these activities, far from it, since attracting them involves several factors. Concretely, US market shares are unlikely to increase drastically: from 13% to 15% for chemical products, and 5.25% to 6.5% for non-ferrous metals. Energy-intensive sectors in the USA can therefore expect to gain in terms of production and exports, but the impact will be a lot less spectacular than some people are announcing today.
For all the other manufacturing sectors, the rising costs of managing globalized value chains, along with the Chinese economy’s new focus on its domestic market, could encourage a slight move back to “Made in USA” goods. We also observe an increase in Chinese investments in the United States starting from 2010, when they passed the modest but symbolic threshold of one billion dollars. Since then, they have grown dramatically, mostly concentrated in industry (76.2% of investments made from 2002 to 2014). The anecdotal reshoring cases could thus mark the early stages of the return of activities offshored during recent decades. This perspective is however currently still uncertain and controversial. Several observers, for example, are speculating that America’s hinterland workshop, Mexico, will be the major winner in the economic balancing out between China and the United States.
The question of American leadership in the digital domain is also debateable. The trade balance deficit of advanced technology products has been constantly growing since the early 2000s, leading some commentators to question the supremacy of the American high-tech industry. Others argue that the industrial sector is currently still only in the early stages of a profound transformation process. They point out that software and applications alone represent two-thirds of activity in the ICT sector and that an analysis restricted to products is necessarily incomplete. The spread of the digital economy is profoundly changing production modes and markets for numerous activities, moving the boundaries between industry and services. The result would therefore bolster the dominant position of the United States.
Whatever the case, the US manufacturing industry is set to overcome numerous obstacles in the coming years. Firstly, having moved their production activities further afield, American companies will need to “learn how to produce again”, which implies among other things rebuilding efficient ecosystems between order-givers and sub-contractors. Secondly, they could undergo a threat to their domination in research and innovation, once again due to the long-term separation between design and manufacturing zones. Another question is whether wage moderation practices are sustainable, in terms of greater social inequalities and the resulting tension. Lastly, manufacturing suffers from a lack of qualified labour, in particular specialized technicians, which it is currently struggling to fill because of its negative popular image.
- 2 – Note that the French trade deficit for manufactured goods is around 46 billion dollars and that the European trade balance is positive.
INTRODUCTION
A l’instar de nombreux pays développés, les Etats-Unis ont vu la part industrielle de leur PIB diminuer au cours des dernières décennies, au profit du secteur des services. Alors que le secteur manufacturier en représentait encore un quart en 1970, il en représente aujourd’hui moins de 12,5 %. Ce repli relatif, qui s’est accompagné d’un fort déclin de l’emploi industriel en termes absolus à partir de la récession de 2001 (éclatement de la bulle internet), résulte de la conjugaison de plusieurs facteurs : les gains de productivité, l’augmentation de la part des services dans la consommation, l’externalisation des services et, phénomène plus inquiétant, la concurrence internationale qui a conduit à une perte de part de marché des Etats-Unis.
Le secteur manufacturier reste néanmoins un pilier de l’économie américaine. Il réalise en effet 70 % de la recherche et développement du secteur privé, 90 % des brevets, et la majorité des exportations. Il propose également des emplois mieux rémunérés que la moyenne, communément appelés « good jobs ».
En cela, les Etats-Unis s’apparentent à tous les pays de l’OCDE. Mais ce qui est plus rare, c’est de constater un net accroissement de l’emploi et de la production industriels depuis 2010, au point que le mot « renaissance » est fréquemment employé dans les publications journalistiques ou scientifiques. Bon nombre d’auteurs tiennent ainsi pour acquis que le secteur manufacturier américain a renforcé sa compétitivité.
Certes, l’industrie outre-Atlantique a fortement rebondi suite à la crise. Toutefois, il n’existe pas à ce jour de consensus sur son état réel. Certains experts, optimistes, mettent en avant les gains de productivité importants réalisés au cours des dernières décennies, les quelque 850 000 créations d’emplois depuis 2010, une révolution dans la production de gaz naturel et des annonces de relocalisations. D’autres, à l’inverse, pointent les délocalisations massives depuis une vingtaine d’années, à l’origine d’un appauvrissement de l’écosystème industriel américain, une balance commerciale structurellement déficitaire et des politiques nettement moins ambitieuses et agressives qu’ailleurs, notamment en matière d’innovation.
Il reste donc prématuré de parler de « renaissance » aujourd’hui, au regard de la saignée qu’a représentée la période 2008-2009, rebaptisée « Grande Récession ». Il est plus hasardeux encore de lier ce regain à une amélioration structurelle de la compétitivité de l’industrie.
En effet, très peu de secteurs ont amélioré leur solde commercial sur la période 2010-2014. Le secteur automobile, qui a porté l’essentiel de la reprise jusqu’à présent, a pu se restructurer grâce au soutien public et à la nationalisation de General Motors, avant de bénéficier de la reprise de la demande interne ; mais son solde commercial se dégrade continûment. Le secteur de l’informatique et de l’électronique, qui a tiré la croissance industrielle durant une quinzaine d’années, a très bien résisté à la crise mais ne cesse de détruire des emplois et reste, lui aussi, largement déficitaire sur le plan du commerce extérieur. Dans le même temps, on peut être optimiste pour certains secteurs, comme la chimie de première transformation qui bénéficie d’un gaz naturel bon marché, favorisant ainsi la production domestique et les exportations. Cela reste toutefois assez localisé et ne suffit pas à entraîner toute l’industrie, ni même toute l’industrie chimique.
L’industrie américaine s’appuie sur de nombreux atouts structurels, qui laissent penser que la dynamique actuelle pourra se poursuivre au-delà du seul rattrapage conjoncturel, habituel après de tels épisodes de crise. Mais le retour de l’industrie ne sera pas aussi fulgurant que ce que certains observateurs enthousiastes le prédisent. Plusieurs grands défis devront en effet être surmontés, au premier rang desquels la nécessité de reconstruire des écosystèmes territoriaux dévastés par des années de délocalisations ou encore la difficulté pour les industriels de disposer d’une main d’œuvre qualifiée.
La présente note est organisée en quatre parties. La première s’intéresse au déclin de l’industrie américaine sur longue période et au rebond qu’elle a connu depuis la fin de la crise. La deuxième analyse l’évolution de la compétitivité des principaux secteurs, en s’intéressant plus particulièrement à deux aspects régulièrement mis en avant pour expliquer le regain industriel américain : l’effet de l’exploitation des énergies non conventionnelles et la modération du coût du travail. La troisième partie propose une analyse sectorielle, mettant en évidence l’impact sur la reprise des industries de biens durables et en particulier de l’automobile, dans une configuration de croissance autocentrée. Enfin, la note explore les principaux facteurs susceptibles de peser sur le cours de l’industrie manufacturière aux Etats-Unis dans les prochaines années.
Cette note a été complétée par une enquête de terrain réalisée par Jean-François Boittin, fonctionnaire à la Direction générale du Trésor et spécialiste de l’économie américaine, auprès d’une trentaine de chefs d’entreprise ou témoins privilégiés présents aux Etats-Unis. Cela a permis de recueillir leur perception de la « renaissance » de l’industrie manufacturière annoncée outre-Atlantique
Jean-François Boittin – Renaissance industrielle : qu’en pensent les acteurs de terrain ? – COMMENTAIRES
Jean-François Boittin est fonctionnaire à la Direction générale du Trésor, où il est notamment spécialisé dans les questions de négociations commerciales. Jean-François Boittin a par ailleurs dirigé les équipes économiques du Trésor au sein de l’ambassade de France à Washington pendant douze ans, jusqu’en 2013.
Aux Etats-Unis, le débat sur la reprise du manufacturing est brouillé par deux éléments : la communication politique et un certain « effet de mode » autour de cette thématique. D’un côté, le soutien affiché par l’administration Obama au secteur industriel se heurte à l’opposition « pavlovienne » des républicains contre toute initiative du président américain. De l’autre, le traitement médiatique et la communication de certaines entreprises autour du reshoring peuvent donner une ampleur excessive à l’appréciation ce phénomène.
Le travail de terrain qui a été mené a consisté à interroger une trentaine de responsables d’entreprises ou d’experts présents aux Etats-Unis. Il présente justement l’intérêt de s’abstraire de ce discours public et de ses biais.
Il faut toutefois signaler que les témoignages recueillis se montrent en majorité optimistes quant à la dynamique de l’industrie américaine. Quatre thèmes en ressortent :
- Le reshoring. La montée des salaires en Chine est souvent revenue dans les discussions mais plus globalement, les industriels américains semblent redécouvrir les inconvénients et les coûts des délocalisations : faible qualité et important turn-over de la main d’œuvre, problèmes logistiques liés à l’éloignement des lieux de production, difficultés liées à l’environnement légal et à la protection de la propriété intellectuelle, etc.
Cela ne signifie pas que les activités textiles ou électroniques implantées dans les pays asiatiques vont revenir aux Etats-Unis mais on peut néanmoins anticiper un certain rééquilibrage. L’implantation d’une usine en Chine n’est plus le choix « par défaut » car à moyen terme, même une logique purement financière peut conduire certaines entreprises à choisir de localiser leur production aux Etats-Unis compte tenu des coûts globaux de la délocalisation.
- L’exploitation des énergies non conventionnelles. L’impact des gaz et du pétrole de schiste ne semble pas être le facteur le plus déterminant dans le rebond de la plupart des secteurs industriels. Certains territoires peuvent faire preuve d’un extraordinaire dynamisme mais il est moins lié aux activités extractives qu’aux services qui leurs sont associés. Le boom des gaz de schistes confère néanmoins un avantage non négligeable par rapport à l’Europe en termes de coûts de production et de sécurité d’approvisionnement. Par ailleurs, cela nourrit un optimisme extraordinaire qui est excellent pour ce que Keynes appelait les « esprits animaux ». Ce dernier aspect, purement psychologique, est très important.
- La main-d’œuvre. Les interlocuteurs indiquent qu’il est très difficile de recruter de la main-d’œuvre bien formée alors qu’une génération de baby-
boomers commence à quitter les usines et devra être remplacée par des personnes formées aux métiers industriels. Il y a en effet une concurrence considérable des activités de services et le système scolaire américain est très mal adapté. La mesure de la performance d’un établissement scolaire dans le secondaire dépend principalement du nombre d’étudiants allant à l’université alors que l’industrie recrute beaucoup de techniciens issus des community colleges (deux ans d’études supérieures). Les industriels doivent dès lors dépenser beaucoup d’énergie pour plaider la cause de leurs entreprises. Cependant, l’immigration apporte de la main-d’œuvre qualifiée et certains Etats favorisent la mise en place de formations aux métiers industriels. La motivation et l’engagement des travailleurs sont par ailleurs très forts et permettent à certaines entreprises de pallier d’éventuelles difficultés de recrutement.
- La culture industrielle. L’entrave à la renaissance de l’industrie est plutôt liée à l’absence de culture industrielle. Le manufacturing n’a pas une très bonne image au sein de la population, les métiers de l’industrie étant souvent considérés comme pénibles et instables. Toutefois, il y a une diffusion lente – favorisée par des implantations d’entreprises étrangères, en particulier allemandes – de nouveaux modèles. Cette évolution est marquée dans le secteur automobile où l’on voit un changement dans la relation constructeur-fournisseur.
En bref, si, comme le reconnaît modestement Garner Carrick, vice-président du Manufacturing Institute, « nous ne serons pas l’Allemagne », les interlocuteurs interrogés se révèlent unanimement « bullish on America and on the american industry ».
L’industrie américaine après la Grande Récession : simple rebond ou renaissance ?
1. Un long repli depuis 1970
Les Etats-Unis ont connu un mouvement continu de désindustrialisation au cours des dernières décennies : la production de l’industrie manufacturière, qui s’élevait encore à près de 25 % de la richesse nationale au début des années 1970, ne représente aujourd’hui plus que 12 % du PIB environ.
Ce mouvement n’a rien de spécifique aux Etats-Unis : il a même été encore plus marqué dans des pays tels que l’Espagne ou le Royaume-Uni. En Allemagne et au Japon, au contraire, la base industrielle s’est davantage maintenue. L’industrie a même progressé en Allemagne après la crise de 2008-2009.
Ce repli relatif de l’industrie s’explique par la conjugaison de plusieurs facteurs : l’augmentation plus rapide de la productivité dans l’industrie que dans les services ; l’externalisation d’activités à des sociétés spécialisées relevant du secteur tertiaire ; une consommation qui se tourne de plus en plus vers les services3 ; et, pour finir, un déficit de compétitivité vis-à-vis notamment des pays à bas coûts de main d’œuvre dans un contexte d’ouverture croissante de l’économie mondiale.
Les trois premiers phénomènes, assez naturels, ne sont pas révélateurs d’un déclin industriel. Seul le dernier est réellement inquiétant, car il a entraîné le transfert de nombreuses activités de production vers des « pays-atelier », principalement asiatiques. En particulier, le déficit de l’industrie manufacturière américaine vis-à-vis de la Chine a été multiplié par 31 entre 1990 et 2013, passant de 12 à 363 milliards de dollars4. L’impact sur l’emploi a également été important : Autor, Dorn et Hanson (2011) estiment qu’au moins un quart des 3,7 millions d’emplois manufacturiers détruits entre 1990 et 2007 seraient directement imputables à l’augmentation des importations en provenance de Chine. Au total, l’industrie américaine a perdu 8,3 millions d’emplois, c’est-à-dire 40 % de ses effectifs, entre son plus haut atteint en 1979 et 2011.
Graphique 1 – Evolution de la part de la valeur ajoutée de l’industrie manufacturière dans le PIB
Source : United Nations National Accounts Main Aggregates Database
Graphique 2 – Evolution de l’emploi dans le secteur manufacturier américain (en milliers)
Source : Bureau of Labor Statistics
2. Une forte aggravation durant la crise
Dans ce contexte de recul tendanciel, l’industrie américaine a été fortement touchée par la crise de 2008-2009, tant sur le plan de l’emploi que sur celui de la production. L’industrie automobile et les secteurs en amont, ainsi que les secteurs dépendant de la construction (produits métalliques, produits minéraux non métalliques5, meubles et bois, plastiques et caoutchoucs, appareils ménagers…), ont enregistré les plus fortes chutes. Des secteurs déjà très fragilisés comme le textile ont également beaucoup souffert. Au final, alors que l’économie américaine « limitait » son recul annuel moyen à 1,5 % entre 2008 et 2009, le secteur manufacturier pris dans son ensemble s’effondrait pour sa part de 5,7 %. Exception notable, le secteur des produits informatiques et électroniques se distinguait comme étant en croissance. Le débat d’experts est toujours ouvert pour savoir si cela tient principalement à un artefact statistique ou à une réelle vigueur de ce secteur6.
Graphique 3 – Secteurs ayant enregistré les plus fortes variations de la valeur ajoutée réelle entre 2008-2009 (variations annuelles)
Source : Bureau of Economic Analysis, calculs des auteurs
En termes d’emplois, ce sont les secteurs du bois et des meubles, particulièrement touchés par la crise de l’immobilier, qui ont enregistré les plus fortes diminutions relatives. En effectifs absolus, les pertes les plus importantes ont été relevées dans les secteurs « automobile » – principale composante du secteur des matériels de transport – (300 000, soit le tiers du million de salariés industriels qu’employait le secteur avant la crise7), « produits métalliques » (298 000) et « machines » (211 000). Au total, ce sont presque 2,3 millions d’emplois industriels qui ont été détruits au cours des années 2008 et 2009.
Parmi les rares secteurs ayant résisté à la récession, aucun n’a enregistré de création nette d’emplois. La situation du secteur des produits informatiques et électroniques est en cela remarquable : l’augmentation de la production (6,2 % sur la période 2008-2009) ne s’est pas traduite par des créations d’emplois mais, bien au contraire, s’est accompagnée de la destruction de 161 000 emplois sur la même période.
Il y a deux interprétations possibles de cette déconnexion entre l’emploi et la production. La première considère que, grâce à des gains de productivité exceptionnels, le secteur affiche une très forte croissance de la production tout en détruisant des emplois. La seconde, développée notamment par Houseman et al. (2014), considère qu’il n’y a pas de raison à ce que le secteur de l’informatique se comporte différemment des autres secteurs industriels, pour lesquels une croissance de la production est associée à une croissance (même faible) de l’emploi, et explique ce paradoxe apparent par un biais statistique important (cf. Encadré 1 et Annexe 2).
Graphique 4 – Evolution de l’emploi dans le secteur manufacturier entre 2008 et 2009 (en milliers)
Source : Bureau of Labor Statistics, calculs des auteurs
Encadré 1 – UNE CROISSANCE DU SECTEUR DE L’INFORMATIQUE ET DE L’ÉLECTRONIQUE QUI REFLÈTE DES GAINS EN QUALITÉ
Selon les statistiques de l’administration américaine, la valeur ajoutée réelle dans l’informatique et l’électronique a été multipliée par 5,17 entre 2000 et 2010 – soit une augmentation de 417 %. L’ITIF8 relève que la croissance dans ce secteur explique à elle seule 113 % de la croissance du secteur manufacturier ou encore 15 % de la croissance du PIB américain sur la période. Il souligne également qu’il est difficile de croire qu’on ait produit 5 fois plus d’ordinateurs en 2010 qu’en 2000 aux Etats-Unis, alors même que l’emploi a diminué de plus de 40 % dans ce secteur et qu’une part non négligeable de la production a été délocalisée.
Houseman et al. (2014) avancent que la croissance de la valeur ajoutée réelle de ce secteur s’explique principalement par une augmentation de la qualité des produits. Typiquement, un accroissement dans la qualité correspond pour un ordinateur à une augmentation de la puissance de calcul à prix inchangé. Si l’on peut comprendre que, du point de vue du consommateur, ces progrès dans la qualité soient très importants, ils ont tendance à fausser les interprétations sur l’état du secteur industriel concerné voire, compte tenu de son importance, du secteur manufacturier en général. La croissance de l’industrie s’expliquerait principalement par des gains de qualité dans un secteur bien particulier et non par une croissance générale des volumes produits ou de la valeur ajoutée unitaire.
3. La sortie de crise, première étape d’une renaissance ?
L’industrie américaine a connu un rebond spectaculaire suite à la crise de 2008-2009. Depuis le début de l’année 2014, les Etats-Unis ont en effet effacé l’effondrement de leur production industrielle enregistré durant ces deux années de récession. L’emploi et la production ont rebondi davantage et plus rapidement que lors des précédents épisodes de crise9.
En outre, l’industrie est redevenue un sujet d’intérêt dans la politique américaine. La perte du leadership mondial au profit de la Chine a symboliquement mis en évidence son délitement, pourtant entamé il y a plus de quarante ans. Elle a induit une prise de conscience des risques que faisait peser la désindustrialisation sur l’économie, cette désindustrialisation ne concernant plus uniquement les activités à faible valeur ajoutée mais frappant également les secteurs des hautes technologies sur lesquels la domination américaine était longtemps restée incontestée.
Graphique 5 – Evolution de la production industrielle (base 100 en 2007)
Source : Board of Governors of the Federal Reserve System
Graphique 6 – Valeur ajoutée générée par l’industrie manufacturière dans les dix principaux pays en 2012 (en milliards de dollars)
Source : United Nations National Accounts Main Aggregates Database
Le thème de la réindustrialisation a été central dans la campagne présidentielle de Barack Obama en 2012, sur un mode presque affectif : le président a parié sur l’attachement des Américains à l’industrie, un secteur qui a largement contribué au confort matériel et généré des good jobs. Ce thème de campagne fut également déterminant pour conquérir les neuf swing states, dont cinq font partie du top 15 des Etats où la part de l’emploi industriel est la plus forte10. A l’exception de la Caroline du Nord, tous ont basculé dans le camp démocrate. Ce résultat tient à divers facteurs mais il est probable que le soutien de l’administration Obama à l’industrie automobile ait influencé le vote ouvrier dans le Midwest (et particulièrement dans l’Ohio11), d’autant que son rival Mitt Romney s’y était opposé12.
Le discours sur l’état de l’Union du 24 janvier 2012 a symbolisé le tournant politique et le premier pas de la stratégie présidentielle de reconquête industrielle13. Barack Obama y annonce son plan pour renforcer l’économie américaine et déclare : « ce plan d’action commence par l’industrie américaine. […] Nous ne pouvons pas faire revenir tous les emplois qui ont quitté notre territoire. Mais aujourd’hui, il devient plus onéreux de faire des affaires dans des endroits comme la Chine. Pendant ce temps, l’Amérique est plus productive. Il y a quelques semaines, le PDG de la société Master Lock m’a dit qu’il devient désormais rentable de relocaliser des emplois. »
Les Etats-Unis ont depuis œuvré au durcissement de leur politique commerciale afin de faire face à la concurrence internationale. Ils ont complété cette action par la National Export Initiative (NEI), qui s’est fixée pour objectif de stimuler les exportations par le soutien à l’internationalisation des PME, l’exploration de nouveaux marchés en particulier depuis l’accession de la Russie à l’Organisation mondiale du commerce (OMC), la signature de partenariats commerciaux14… Un autre volet de l’action présidentielle repose sur le soutien à l’innovation : le National Network for Manufacturing Innovation (NNMI) lancé en 2012 vise à combler le fossé identifié entre la recherche amont et la recherche appliquée, et ainsi à accélérer la transformation des avancées scientifiques en applications commercialisables.
Selon certains observateurs, cet activisme des autorités pour redonner à l’industrie américaine sa place de premier plan, associé non seulement à la forte reprise mais également à la forte baisse des prix de l’énergie et à la modération salariale enregistrée sur la dernière décennie, sont autant de facteurs permettant d’espérer une véritable « renaissance » industrielle.
Si cela ne peut aujourd’hui être formellement exclu, il convient néanmoins de rappeler qu’il est normal que les indicateurs macroéconomiques reviennent à la tendance à la suite d’une crise. Or, si la production industrielle a rattrapé son niveau d’avant-crise, c’est loin d’être le cas pour l’emploi. Certes, 850 000 emplois ont été créés entre janvier 2010 et novembre 2014, mais ce chiffre est à mettre en perspective avec les 2,3 millions d’emplois détruits en 2008-2009. En outre, l’emploi industriel a progressé moins rapidement que l’emploi total, ce qui signifie que sa part continue de baisser. C’est également le cas pour la valeur ajoutée industrielle dont la part n’a pas progressé malgré le rebond de la production.
Les chapitres suivants de la note étudient donc en quoi on peut parler, ou pas, d’une amélioration structurelle de l’industrie américaine et de sa compétitivité.
Graphique 7 – Evolution comparée de l’emploi total hors agriculture et de l’emploi industriel (base 100 en janvier 2008)
Source : Bureau of Labor Statistics, calculs des auteurs
Graphique 8 – Evolution de la part de l’industrie manufacturière dans le PIB
Source : Bureau of Economic Analysis
- 3 – Aux Etats-Unis, un consommateur consacrait en 1960 environ 0,5 dollar à l’achat de biens pour chaque dollar dépensé, il n’en dépense plus que 0,33 dollar aujourd’hui. Ce comportement n’est pas propre au consommateur américain : au fur et à mesure que le pouvoir d’achat des ménages augmente, la part des dépenses consacrée aux services progresse, les besoins en équipements étant satisfaits.
- 4 – OCDE (STAN).
- 5 – Ce secteur regroupe essentiellement la production de céramiques, de verre, de ciment, et de chaux.
- 6 – La valeur ajoutée réelle correspond à la valeur ajoutée nominale corrigée des variations de prix et des changements dans la qualité des produits. Ces derniers sont particulièrement importants dans les secteurs de l’informatique et de l’électronique, car la puissance de calcul évolue très rapidement, et peuvent fausser l’interprétation des statistiques.
- 7 – Notons que la majorité des emplois liés à l’automobile ne se trouvent pas dans le secteur manufacturier mais dans les services, notamment le retail (voir : http://www.bls.gov/iag/tgs/iagauto.htm).
- 8 – Atkinson et al., 2012.
- 9 – Celasun et al., 2014.
- 10 – Caroline du Nord, Iowa, New Hampshire, Ohio, Wisconsin.
- 11 – Daziano L., 2013.
- 12 – Mitt Romney dans le New York Times : « Let Detroit Go Bankrupt ». Plus tard, Romney déclarait que l’administration Obama avait en réalité fait ce qu’il préconisait dans cet article, mais cette déclaration fut interprétée comme une volte-face peu convaincante.
- 13 – Dans ce discours, Barack Obama utilise huit fois le mot « manufacturing » et sept fois le mot « manufacturers ».
- 14 – Klossa G., Guillon S., 2012. Les auteurs précisent que c’est principalement vis-à-vis de la concurrence chinoise que cette politique commerciale se veut plus ferme.
Un regain de compétitivité à l’origine de la reprise ?
Comme on l’a indiqué au chapitre précédent, l’industrie américaine a connu une reprise remarquable depuis la fin de la crise de 2008-2009. De nombreux auteurs attribuent cela à une amélioration structurelle de la compétitivité, qui s’expliquerait notamment par la baisse des coûts énergétiques, la modération salariale ou encore la faiblesse du dollar. En outre, elle se traduirait par une vague de relocalisations des entreprises sur le sol américain, principalement depuis la Chine où l’avantage-coût relatif tendrait à disparaître.
Reprenons ces éléments un à un ; nous verrons que ce tableau est sans doute exagérément enthousiaste.
1. Une performance commerciale en demi-teinte, qui ne traduit pas d’amélioration généralisée
de la compétitivité
Les exportations de biens manufacturés ont augmenté de 320 milliards de dollars entre 2010 et 2014 (cf. Annexe 3), alors que sur la même période la production progressait de 948 milliards. La croissance des exportations représente donc 30 % de la croissance industrielle115. Mieux, on a assisté à une légère augmentation (0,4 point) de la part des exportations américaines dans les exportations mondiales – ce qui pourrait indiquer une amélioration de compétitivité, en rupture avec les performances du Japon, de l’Allemagne ou encore de la France (cf. Graphique 9).
Graphique 9 – Evolution de la part de marché à l’export pour une sélection de pays (biens manufacturés)
Source : OCDE (STAN), calculs des auteurs
Pour certains, c’est là le signe d’un regain de compétitivité, pour les raisons déjà exposées (énergies non conventionnelles, modération salariale, baisse du dollar). Toutefois cette interprétation omet de préciser que seuls deux secteurs industriels, aux trajectoires exceptionnelles, affichent une amélioration de leur solde commercial (cf. Graphique 10). Il s’agit du secteur « autres matériels de transport », qui comprend principalement l’industrie aéronautique, et de celui des produits pétroliers raffinés.
Graphique 10 – Positionnement des différents secteurs industriels en fonction de leurs performances à l’international (en milliards de dollars, évolutions entre 2010 et 2014)
Légende : Le secteur « Other transport equipment » présentait en 2014 un excédent commercial de 75 milliards de dollars, en progression de 26 milliards par rapport à 2010.
Source : OCDE (STAN)
Le premier est historiquement un fort contributeur aux exportations américaines grâce à des entreprises comme Boeing, United Technologies ou Lockheed Martin. Leur activité a bénéficié du redémarrage du marché mondial et les exportations du secteur ont atteint en 2014 un nouveau record à 137 milliards de dollars. Ce dynamisme est lié à la demande mondiale, bien plus qu’aux facteurs de compétitivité-coût sur le sol américain.
Le second secteur a, pour sa part, bénéficié de l’essor récent et impressionnant du pétrole non conventionnel. La progression des ventes à l’étranger du secteur est fulgurante – elles ont été multipliées par cinq entre 2006 et 2014 – alors que les importations fléchissent depuis quelques années.
En dehors de ces deux exceptions, la quasi-totalité des secteurs présentent un déficit commercial et voient leur situation à l’international se dégrader entre 2010 et 2014. On retrouve notamment dans cet ensemble des secteurs comme l’automobile et les machines, dont la production a pourtant fortement rebondi depuis 2009, ainsi que celui des produits informatiques et électroniques, qui est resté très dynamique sur les dernières années.
Loin de bénéficier d’un regain de compétitivité qui serait généralisé et décisif, nous pensons donc que le secteur manufacturier américain profite essentiellement d’un rebond autocentré, tiré par la demande domestique : à partir de 2010, les consommateurs et les firmes américaines ont réalisé d’importants achats de biens durables qu’ils avaient reportés en raison de la crise. Mais, pour tous les secteurs industriels hormis les deux exceptions susmentionnées, ce rebond s’est traduit par une augmentation des importations plus forte que celle des exportations.
Le déficit commercial dans l’industrie manufacturière, structurel depuis le début des années 1990, est par ailleurs colossal (566 milliards en 2014) et s’est fortement creusé depuis 2009 (cf. Graphique 11). Sans considérer qu’il s’agisse là de la seule explication, il est difficile de ne pas rapprocher ce déficit structurel de l’ouverture économique de la Chine depuis les grandes réformes de 1979. Un double mouvement s’est alors initié : d’abord, la délocalisation en Chine des activités de production de nombreuses entreprises américaines (ce phénomène restant toutefois moins important que le déploiement de ces mêmes entreprises pour conquérir le marché chinois), ensuite, la constitution d’une force industrielle chinoise compétitive pouvant prétendre entrer sur le marché américain. La Chine ne représentait que 10,5 % du déficit américain dans les biens manufacturés en 1990, contre plus des deux tiers aujourd’hui16. L’administration Obama a tenté de réagir et s’est fixé pour objectif de doubler les exportations américaines entre 2010 et 2014 dans le cadre de la National Export Initiative. L’objectif est loin d’être atteint puisqu’elles n’ont progressé « que » de 29 % entre 2010 et 2014.
Graphique 11 – Evolution du déficit commercial pour les biens manufacturés
Source : OCDE (STAN), calculs des auteurs.
La part du déficit commercial dans le PIB industriel n’a pas pu être calculée pour l’année 2014, le Bureau of Economic Analysis n’ayant pas encore publié de statistiques sur la valeur ajoutée industrielle en 2014
2. Une amélioration sensible des marges des entreprises
Depuis 2000, les industriels américains ont sensiblement amélioré leur taux de marge. Le fait que les marges des industriels s’érodent en France est assez connu. Le fait qu’elles progressent plus vite aux Etats-Unis qu’en Allemagne ou en Suède l’est sans doute moins. Envisagée sous cet angle, l’industrie américaine a même particulièrement bien résisté à la crise.
Cette augmentation des marges est concomitante de la forte baisse du coût du travail unitaire dans l’industrie manufacturière. De même, la nette progression enregistrée en sortie de crise (+4 points entre 2007 et 201317) doit beaucoup au maintien de coûts bas : le rattrapage en termes de production s’est en effet accompagné d’un rebond beaucoup plus lent de l’emploi et des salaires.
Graphique 12 – Evolution du taux de marge dans l’industrie pour une sélection de pays
Source : OCDE (STAN). Le taux de marge correspond à l’excédent brut d’exploitation rapporté à la valeur ajoutée
Comme on le voit sur le graphique 13, les différents secteurs ont connu des évolutions contrastées. Mais pour la plupart, le bilan de la période 2000-2013 est nettement favorable. Même ceux qui ont traversé des crises profondes (électronique d’abord, automobile ensuite) ont réussi à renouer avec des marges toujours en hausse.
Dans le cas particulier du secteur automobile, si les pertes ont été très élevées au plus fort de la crise, on remarque que la profitabilité suivait un cours défavorable avant 2008. La crise des subprimes a donc peut-être révélé la faible compétitivité du secteur autant qu’elle ne l’a aggravée. Autre cas notable, les secteurs de la chimie et des produits du pétrole et du charbon, à très forte intensité capitalistique, ont été peu impactés par la crise et conservent des marges particulièrement élevées.
Graphique 13 – Evolution du taux de marge dans différents secteurs de l’industrie manufacturière
Source : Bureau of Economic Analysis, calculs des auteurs. Le taux de marge correspond à l’excédent brut d’exploitation rapporté à la valeur ajoutée.
3. Le phénomène du reshoring
Un récit très répandu au sujet de l’industrie américaine veut qu’elle ait amélioré sa compétitivité-coût au point que les entreprises rapatrient en grand nombre sur le sol national les activités de production autrefois délocalisées, notamment en Asie. Le raisonnement sous-jacent est très simple : l’industrie américaine bénéficiant désormais de coûts réduits (énergie, coûts de main-d’œuvre unitaires…) et d’un dollar faible, tandis que les coûts locaux chinois et les coûts de la logistique trans-pacifique augmentent à vive allure, il redeviendrait rentable de produire made in USA.
Depuis la fin de la crise en effet, les cas de relocalisations font sensation dans les médias et alimentent de nombreuses études, menées en particulier par de grands cabinets conseil, et dans une moindre mesure par des universitaires. Une enquête menée par le Boston Consulting Group montre que plus de la moitié des dirigeants américains dont l’entreprise génère plus d’un milliard de dollars de chiffre d’affaires ont prévu ou envisagent de relocaliser leur production de la Chine vers les Etats-Unis18. Ces relocalisations pourraient permettre la création de 2 à 3 millions d’emplois dont 400 000 à 750 000 emplois industriels au cours de la prochaine décennie. Dans son étude, le MIT19 montre pour sa part que 33,6 % des firmes interrogées envisagent de relocaliser et que 15,3 % ont programmé une relocalisation d’activité sur le territoire américain. Ce mouvement concernerait principalement les secteurs suivants : matériels de transport, appareils ménagers et matériels électriques, ordinateurs et électronique, vêtements, machines, meubles, produits métalliques, plastiques et caoutchoucs20.
Parmi les principaux facteurs motivant la décision de relocaliser, les chefs d’entreprises mentionnent avant tout la nécessité de réduire les délais de commercialisation, la qualité plus grande des produits fabriqués aux Etats-Unis, les économies sur les coûts de gestion cachés de la chaîne d’approvisionnement ou encore les risques liés à la violation du droit de la propriété intellectuelle, dont la protection est mal assurée en Chine en particulier. Le responsable d’un grand groupe américain de produits de consommation témoigne par exemple que, malgré les efforts du gouvernement chinois pour lutter contre la contrefaçon, le groupe a récemment découvert qu’un atelier de fabrication parallèle avait été installé à proximité de son usine.
L’accès direct au marché américain – 320 millions d’habitants à fort pouvoir d’achat et une natalité forte pour un pays développé – ainsi que le raccourcissement de la chaîne d’approvisionnement semblent être les motivations principales des entreprises se réimplantant outre-Atlantique. Là encore, ce responsable explique qu’une implantation en Chine fait peser de trop fortes incertitudes logistiques sur des cycles de fabrication globaux en flux tendus : « avec des clients comme Walmart ou Carrefour, l’erreur n’est pas permise pour le lancement d’un produit. » Cette stratégie de localisation à proximité de son marché offre plusieurs avantages : une adaptation plus rapide aux changements dans les goûts des consommateurs, une réduction des risques de « perturbations » dans la chaîne d’approvisionnement21, le rapprochement des équipes d’ingénieurs et de designers de la production, ou encore l’atténuation des risques de change.
Dans un climat de patriotisme économique22, plusieurs sociétés américaines parmi les plus connues communiquent largement sur leur « retour » aux États-Unis (cf. Encadré 2). Le point de vue d’un dirigeant américain en charge de la stratégie chez Schneider Electric, reste toutefois mesuré : « nous sommes dans la perspective d’un rééquilibrage entre les implantations de la société, mais pas d’une révolution. »
En réalité, deux ans après l’enquête du MIT, il est difficile de constater la vague de relocalisations annoncée. Le phénomène est plus modeste que ce que les annonces corporate prédisaient ; il représenterait environ 15 % des nouveaux emplois industriels américains selon la Reshoring Initiative (cf. Encadré 3). Rice et Stefanelli (2014) mettent en évidence des changements dans les choix de localisation de la production : diversifier les lieux de production afin de ne pas concentrer le risque dans certaines régions du globe, produire à proximité des marchés finaux pour s’adapter plus rapidement aux évolutions du marché. Cependant, selon leurs dernières recherches, les relocalisations ne constituent pas pour autant une tendance nette23.
Encadré 2 – RESHORING ET PATRIOTISME ÉCONOMIQUE
Apple, dont le fondateur et président charismatique, Steve Jobs, avait répondu succinctement au président Obama que les emplois partis en Chine ne reviendraient pas aux États-Unis24, a changé de communication, sinon de stratégie, avec Tim Cook, successeur de Jobs. L’entreprise annonçait l’an dernier créer, en partenariat, une usine en Arizona, en même temps qu’elle développait une nouvelle production d’ordinateurs Mac au Texas, en utilisant davantage de composants made in USA.
General Electric a également communiqué abondamment sur l’ouverture d’une ligne d’assemblage de chauffe-eaux jusque-là produits en Chine, puis de réfrigérateurs auparavant assemblés au Mexique sur son site historique de Louisville dans le Kentucky.
Walmart, géant de la grande distribution, se voit régulièrement reprocher les montants colossaux d’importations de produits en provenance de Chine (environ 30 milliards de dollars par an) et est accusé d’être directement responsable de la disparition d’emplois à due concurrence. Il n’est donc pas complètement surprenant que le président de la société ait annoncé une initiative afin de soutenir l’industrie américaine et de créer davantage d’emplois industriels aux Etats-Unis. Walmart compte réaliser 50 milliards de dollars d’achats supplémentaires de produits made in USA sur dix ans, pour un montant total d’achats de 250 milliards de dollars sur la même période. L’entreprise a annoncé dans la foulée un accord passé avec une société textile, 1888 Mills, pour produire des serviettes de coton en Géorgie, qui seraient vendues dans les rayonnages de Walmart avec l’étiquette « made here ». L’engagement du patron de Walmart est significatif de l’intérêt que la société espère retirer de l’affichage de son patriotisme économique. L’exemple du secteur textile ne convaincra pas les économistes, même s’il est bien reçu dans les Etats du sud des Etats-Unis, où les pertes d’emplois ont été particulièrement élevées. Ces déclarations avaient d’ailleurs suscité un scepticisme des commentateurs, qui ont immédiatement souligné qu’une partie importante des ventes de Walmart consiste dans des produits d’épicerie, par nature produits localement.
Alors que la presse avait salué les annonces d’Apple et de General Electric, elle n’a pas toujours repris les informations les plus récentes : le sort de l’usine dans laquelle Apple avait investi à Mesa (Arizona) aux côtés de GT Advanced Technologies est incertain depuis la faillite de ce partenaire. De son côté General Electric a lancé l’opération de cession de ses activités dans les produits blancs à Electrolux, ce qui montre que le reshoring n’est pas nécessairement au cœur de la stratégie de la société.
Ces trois exemples emblématiques, pris parce qu’ils ont été présentés à l’époque comme signes d’un changement d’attitude du patronat américain sur la délocalisation et d’un tournant décisif sont en réalité très significatifs de l’ambiguïté du phénomène.
De nombreuses firmes, en particulier dans le secteur des hautes technologies, ont annoncé qu’elles allaient rapatrier des activités sur le sol américain mais n’ont pas sauté le pas. Diez et Gopinath (2014) concluent également que peu d’éléments soutiennent la thèse d’une dynamique de relocalisation. Ils mettent en avant l’augmentation soutenue de la part des importations dans la consommation américaine de produits manufacturés (cf. Graphique 14)25. Enfin, le cabinet de conseil en stratégie A.T. Kearney a affirmé dans un récent communiqué de presse que les délocalisations étaient plus importantes que les relocalisations en 201426.
Graphique 14 – Evolution de la part des importations dans la demande domestique de biens manufacturés
Source : Bureau of Economic Analysis, OCDE (STAN), calculs des auteurs
Le retour d’activités autrefois délocalisées – s’il a lieu – se fera de manière diffuse, car il s’agit d’une tâche lourde pour les entreprises, en dépit des nombreuses incitations et subventions proposées par les Etats (exemptions fiscales, aides à la mise en place de programmes de formation, etc.). Les premières entreprises à se décider peuvent en effet faire figure de pionnières, tant les défis à relever sont importants.
Le premier d’entre eux est la reconstruction d’écosystèmes de production qui ont souvent été affaiblis au cours des dernières décennies, précisément à cause des délocalisations. Un industriel envisageant de se réimplanter aux Etats-Unis doit ainsi convaincre ses fournisseurs de s’installer à proximité pour que la démarche ait un réel intérêt.
Un autre obstacle aux relocalisations régulièrement cité est celui de l’accès à une main d’œuvre qualifiée. Or, la pénurie de techniciens qualifiés représente un handicap important aux Etats-Unis. Ainsi, un projet de relocalisation suppose souvent la mise en place en interne de structures de formation des salariés, en attendant que le système public de formation adapte ses filières aux nouveaux besoins des industriels.
Encadré 3 – ETAT DES LIEUX DES RELOCALISATIONS
La Reshoring Initiative est à ce jour la seule organisation à fournir des estimations du nombre d’emplois relocalisés. Selon cette organisation, les relocalisations sur le territoire américain constituent une réelle tendance et non quelques annonces anecdotiques qui font sensation. L’organisation, dirigée par Harry Moser, estime que 100 000 emplois ont été créés du fait des relocalisations entre 2010 et 2013 (soit environ 15 % des emplois créés dans le secteur manufacturier)27. Elle précise néanmoins que les relocalisations compensent tout juste les délocalisations intervenues sur la même période. Nous ne disposons toutefois pas des données détaillées ni des méthodes d’estimation utilisées par cet institut – ce qui est assez éloigné de la rigueur académique. L’organisation met à disposition des entreprises un comparateur des coûts des différentes localisations d’une activité donnée. Il prend en compte l’ensemble des coûts et adopte une perspective de long terme. La Reshoring Initiative part du constat que les entreprises qui délocalisent ont tendance à faire des erreurs de 20 à 30 % sur le coût de la délocalisation, en raison de l’existence de « coûts cachés ». L’outil de calcul a pour objectif de montrer que la délocalisation n’est pas réellement moins chère.
Dans cette perspective, on peut penser que le mouvement de relocalisation procède d’un changement dans la perception des dirigeants du coût total réel de la délocalisation (problèmes de communication, non-respect de la propriété intellectuelle, décalage horaire, délais de livraison, etc.)28.
Selon le cabinet de conseil A.T. Kearney on trouve le plus de relocalisations dans les secteurs des appareils ménagers et matériels électriques (22 %), matériels de transport (16 %), et produits informatiques et électroniques (11 %). Les relocalisations ne concerneraient donc pas que des activités d’assemblage de produits lourds mais aussi des productions sophistiquées29.
4. L’effet dollar
Après avoir cherché à apprécier la compétitivité de l’industrie américaine selon trois traductions possibles (performance à l’export, profitabilité et attractivité du territoire), nous voulons maintenant qualifier l’influence de trois facteurs de coût fréquemment évoqués.
Le premier est le taux de change du dollar, qui s’est fortement déprécié depuis le début des années 2000. Le graphique 15 indique ainsi une constante amélioration de la compétitivité prix des Etats-Unis, qui a conféré un avantage important pour les industriels exportateurs. Celasun et al. (2014) ont calculé qu’une baisse de 10 % du taux de change effectif réel du dollar30 est associée à une augmentation de la production industrielle d’environ 2 %31.
A première vue, il est troublant de constater que les importations ont bondi sur la même période (cf. Annexe 3). Diez et Gopinath (2014) expliquent que cette faible réaction des importations au taux de change est liée au fait que 90 % des biens importés sont facturés dans la monnaie américaine. Ainsi, une dépréciation du dollar de 10 % se traduit par une hausse de seulement 3 % du prix des biens importés au bout de deux ans.
Notons qu’entre 2008 et 2013 les fluctuations du dollar sont restées très faibles.
Graphique 15 – Evolution du taux de change effectif réel du dollar (base 100 en 2010)
Source : World Development Indicators
5. Les gaz de schistes stimulent davantage la demande qu’ils n’améliorent la compétitivité de l’industrie
L’exploitation du gaz non conventionnel32 est souvent citée comme un facteur déterminant de la réindustrialisation américaine, par le biais de la compétitivité des sites producteurs.
Cette exploitation a connu un essor spectaculaire ces dernières années. Selon l’Agence d’information sur l’énergie (EIA), le gaz de schiste représente aujourd’hui 40 % de la production totale de gaz naturel aux Etats-Unis et devrait continuer sa progression pour atteindre 53 % de la production d’ici à 2040. L’EIA prédit également l’autosuffisance gazière des Etats-Unis, qui pourraient même devenir exportateurs nets d’ici 201633. En revanche, le pic de production de pétrole de schiste devrait être atteint à la fin de la décennie et les Etats-Unis resteront vraisemblablement importateurs de pétrole34.
Cet accroissement de l’offre a induit une très forte baisse du prix du gaz naturel payé par les industriels (-36 % entre 2006 et 2010), cassant la tendance haussière observable jusqu’au milieu des années 2000. Cette chute est telle qu’elle entraîne à la baisse (de 11 %) le prix moyen de l’énergie achetée par les industriels, exprimé en dollars par BTU, malgré le renchérissement de toutes les autres sources d’énergie (cf. Graphique 17)35. Dans le même temps, ce boom de la production gazière aux Etats-Unis a fait diverger, grandement et durablement, les prix du gaz au niveau mondial (cf. Graphique 18) : le million de BTU coûte aujourd’hui 4 dollars aux Etats-Unis contre 10 dollars en Europe et 16 dollars au Japon.
Il ne fait aucun doute que l’essor de l’industrie gazière procure une manne dont bénéficie l’économie américaine à plusieurs titres. Premièrement, cela enrichit les particuliers et crée des emplois directs, indirects, et induits, même si le débat est encore ouvert sur l’appréciation du nombre d’emplois ainsi créés (cf. Encadré 4). Deuxièmement, cela contribue à diminuer le déficit commercial et la dépendance géopolitique vis-à-vis d’autres pays producteurs. Troisièmement, cela augmente le volume d’affaires de nombreux industriels équipementiers. Les secteurs en amont de la filière, fournisseurs, bénéficient en effet de l’augmentation de la demande liée aux investissements des industries extractives. Ce sont « principalement les industries des métaux et des procédés industriels : US Steel pour la production d’acier, Vallourec qui ouvre une nouvelle usine de tubes en acier dans l’Ohio ou encore TMK IPSCO qui développe ses capacités de recherche sur l’extraction du gaz de schiste36, 37. »
Il est en revanche moins évident de savoir dans quelle mesure ce phénomène vient également améliorer la compétitivité de l’industrie, en permettant aux entreprises de réduire leurs coûts. On pense principalement aux coûts énergétiques directs et à ceux de certains intrants (comme les plastiques, par exemple). L’idée, souvent entendue, que le regain de l’industrie américaine s’expliquerait par une amélioration de sa compétitivité, elle-même étant attribuable à l’essor des gaz de schistes, doit être considérée avec discernement : elle est vraie pour certains secteurs mais il est aujourd’hui abusif de la généraliser à toute l’industrie.
D’un côté, les industries gazo-intensives américaines bénéficient d’une baisse très significative de leurs coûts de production. Celle-ci peut atteindre 13 % à 15 % dans certaines activités (engrais, plastiques et résines, chlore). Pour mémoire, cet écart de coût est nettement supérieur au prix du transport par bateau vers l’Europe des produits concernés, et confère donc aux entreprises américaines un gain en compétitivité de nature à concurrencer les producteurs européens sur leurs marchés nationaux38. C’est pour cette raison que l’on assiste à une vague d’investissements dans le secteur de la chimie. L’American Chemistry Council recense 194 projets d’investissements, dont un tiers par des entreprises étrangères, représentant 123 milliards de dollars aux Etats-Unis39. Cet avantage coût menace très sérieusement certaines firmes européennes.
Pour le reste de l’industrie, qui consomme essentiellement de l’électricité (et la sidérurgie qui consomme beaucoup de charbon), il n’y a pas encore d’évaluation consensuelle de l’impact du développement des énergies non conventionnelles sur leur structure de coûts. Un des aspects essentiels de cette question consiste à savoir si le remplacement des centrales à charbon par des centrales au gaz va se traduire, ou non, par une baisse du coût de l’électricité pour les industriels. Certains l’affirment, mais l’EIA ne table pas sur cette hypothèse dans ses scénarios de référence à horizon 2040 (cf. Chapitre 4).
Graphique 16 – Evolution de la production de gaz naturel aux Etats-Unis et projections
Source : U.S. Energy Information Administration.
Traductions : lower 48 = Etats-Unis hors Alaska et Hawaï (le gisement d’Alsaka est isolé sur ce graphique), tight gaz = gaz de réservoir, shale gaz = gaz de roche-mère, coal bed = gaz de houille
Graphique 17 – Prix moyen de l’énergie pour les industriels (en dollars constants de 2005 par million de BTU)
Sources : U.S. Energy Information Administration, Manufacturing Energy Consumption Survey 1998-2010
Graphique 18 – Evolution du prix du gaz naturel (en dollars par million de BTU)
Source : BP Statistical Review of World Energy June 2014
Encadré 4 – LE DÉBAT SUR LES EFFETS MACROÉCONOMIQUES DE L’EXPLOITATION DES GAZ DE SCHISTES
Les prévisions sont par nature hasardeuses, et dépendent principalement de l’ampleur des réserves, de l’évolution de la production et du prix du gaz naturel, et des hypothèses du modélisateur.
D’un côté, IHS40 montre qu’en 2012 le secteur des énergies non conventionnelles employait 360 000 personnes et estime qu’il pourrait en employer 724 000 à la fin de la décennie. En prenant en compte l’ensemble des emplois indirectement générés par ce secteur, il évalue à 1,7 million le nombre de travailleurs qui dépendaient des énergies non conventionnelles en 2012 et prévoit qu’ils seront environ 3 millions en 202041. Le boom énergétique aurait donc permis de limiter les destructions d’emplois pendant la crise et pourrait constituer un véritable moteur de l’emploi dans les années à venir. Dans une seconde étude42, IHS indique que la révolution du gaz et du pétrole non conventionnels devrait bénéficier à la fois aux Etats producteurs43 et non producteurs. Certains tireront des bénéfices liés à une exploitation directe des gisements par les firmes implantées sur le territoire, alors que d’autres constituent le lieu d’implantation de fournisseurs. D’autres encore tireront profit de l’accroissement des flux commerciaux entre les Etats. Selon IHS, les Etats non producteurs comptaient en 2012 plus de 474 000 travailleurs dépendant des énergies non conventionnelles : métaux produits dans l’Illinois, logiciels créés dans le Massachusetts ou encore services financiers et d’assurances du Connecticut.
Le point commun de ces deux études est qu’elles raisonnent, pour le calcul des emplois induits, sur la base de multiplicateurs dont la valeur est jugée trop élevée par la plupart des critiques, qui émettent un doute sur la robustesse de ces prédictions. Une étude publiée par des chercheurs de la Réserve fédérale estime pour sa part que l’exploitation des énergies non conventionnelles induira une progression limitée de la production et de l’emploi industriels, de l’ordre de 2 % à 3 % (cf. Tableau 1).
Par ailleurs, côté offre, plusieurs études considèrent que l’impact de la baisse du prix du gaz sur l’ensemble de l’industrie sera faible, compte tenu de la part modeste que représentent les industries intensives en gaz au sein du secteur manufacturier. Houser et Mohan (2014) constatent ainsi que 92 % de l’emploi manufacturier se trouve dans des secteurs pour lesquels la baisse de coût de production liée aux gaz et pétrole de schiste est inférieure à 1 %. Le FMI44 reconnait que le boom de l’énergie a eu un impact positif sur l’économie
Tableau 1. Effet estimé d’une chute de 50 % du prix du gaz naturel pour les entreprises manufacturières américaines (variations annuelles moyennes entre 1997 et 2012)
américaine puisqu’il a permis à la fois de faire baisser les prix et de faire apparaître une vague d’industries connexes. Néanmoins, il constate que les 100 000 emplois créés dans ce secteur depuis la fin de la crise ne représentent qu’une faible part des 2,2 millions de créations nettes d’emplois pour la seule année 2012. Il prévoit que l’impact de l’augmentation de la production d’énergie sur l’économie sera positif mais modeste. Il estime que, dans les dix prochaines années, la croissance de la production domestique d’énergie permettra une augmentation de moins de 1 % du niveau du PIB. Spencer et al. (2014), considèrent que, même en utilisant des hypothèses optimistes (celles de l’IHS étant jugées trop optimistes), les créations d’emplois générées par le récent boom énergétique sont équivalentes à 0,25 % de la main-d’œuvre totale (400 000 emplois). Le niveau du PIB ne progresserait que de 0,84 % entre 2012 et 2035 grâce à la révolution énergétique car l’impact sera principalement limité aux secteurs intensifs en gaz qui ne représentent qu’une faible part de l’industrie et du PIB américain.
En définitive, le boom de la production de gaz de schiste a aujourd’hui un impact limité sur la structure de coûts de l’ensemble de l’industrie manufacturière. Bordigoni (2013) l’estime à 1,5 % en moyenne. S’il contribue puissamment à l’essor de certains secteurs gazo-intensifs, il ne saurait à lui seul constituer un élément de compétitivité capable d’expliquer le regain industriel constaté.
Les avis d’experts deviennent assez divergents dès lors qu’il s’agit de quantifier l’effet des gaz de schistes sur l’emploi et de tirer des conjectures pour l’avenir. Aucun n’exclut la possibilité que, après un délai d’ajustement ou grâce à des innovations technologiques, certains secteurs aujourd’hui moins dépendants du gaz puissent à leur tour bénéficier de cette source d’énergie abondante et bon marché (le cas du transport par camion est souvent évoqué). L’impact des gaz de schistes n’a peut-être pas encore démontré toute son étendue45.
6. Quid du coût du travail ?
Depuis le début des années 2000, le coût du travail dans l’industrie a augmenté moins rapidement aux Etats-Unis qu’en Europe et en Asie de l’Est, à l’exception du Japon. En 2001, la rémunération horaire (en dollars) dans l’industrie était 25 % plus élevée aux Etats-Unis qu’en France. Onze ans plus tard, elle était 10 % inférieure aux Etats-Unis (cf. Graphique 19).
Graphique 19 – Evolution de la rémunération horaire dans l’industrie manufacturière pour une sélection de pays (en dollars)
Sources : Bureau of Labor Statistics, International Labor Comparisons
Les effets de change sont certes importants mais ils ne modifient pas le constat : la modération salariale a été plus importante aux Etats-Unis qu’en Allemagne entre 2002 et 2011. En effet, le coût unitaire de la main-d’œuvre46 a baissé de 15 % aux Etats-Unis en dollars, alors qu’il augmentait en euros de 4 % en France et de 22 % en Italie et qu’il baissait de 2,5 % en Allemagne. Les salaires ont donc bien été contenus outre-Atlantique par rapport à la croissance de la productivité, cet avantage coût étant encore renforcé par la faiblesse du dollar.
La montée des salaires en Asie, notamment en Chine, et en Europe renforce surtout la compétitivité et l’attractivité des Etats où la main-d’œuvre est peu chère et le droit du travail souple (« right-to-work states ») comme l’Alabama, le Texas, la Louisiane, le Mississipi, la Caroline du Sud ou encore le Tennessee.
Certains auteurs veulent voir dans cette baisse relative du coût du travail un facteur important des décisions de relocalisation depuis l’Asie, citées plus haut. En réalité, cela joue assez peu. On l’a dit, les enquêtes auprès des managers montrent que ces décisions se prennent sur la base de nombreux autres arguments, notamment la qualité des chaînes d’approvisionnement et le besoin de proximité du marché, et plutôt en dépit d’un coût de la main d’œuvre qui reste, à l’évidence, plus élevé aux Etats-Unis qu’en Chine47. Selon George et al. (2014) du cabinet McKinsey, l’effet négatif d’une forte croissance des salaires sur les coûts en Chine est en outre contrebalancé par l’impact favorable de l’augmentation de la demande locale.
En revanche, ces différences de coût du travail, accentuées par les effets de change, jouent davantage vis-à-vis des pays européens. L’ouverture d’usines dans le Sud des Etats-Unis par des constructeurs européens et japonais (Maserati, BMW, Nissan, Toyota, Honda et Kia)48 s’explique en bonne partie par la faiblesse des coûts salariaux unitaires américains par rapport à la zone euro et le Japon.
Il ne faut toutefois pas s’attendre au retour aux Etats-Unis des industries low cost. Les productions intensives en travail peu qualifié et qui ne sont pas particulièrement lourdes se sont déjà orientées vers des zones plus pauvres49 : les pays d’Asie où les salaires sont encore très faibles, le Mexique et certains pays d’Amérique centrale, et probablement l’Afrique subsaharienne dans un futur plus lointain.
Martine Azuelos, professeur émérite à l’université Sorbonne Nouvelle, précise que « la reprise économique des Etats-Unis ne peut pas être distinguée de la dynamique des autres pays de l’Alena (Canada et Mexique). En particulier, la situation dans l’industrie manufacturière étatsunienne est indissociable du dynamisme du Mexique sur des secteurs tels que l’automobile ou l’électronique. Le faible coût de la main d’œuvre mexicaine et la proximité avec le marché américain ont été le moteur du phénomène de near-shoring (délocalisations des pays asiatiques vers le Mexique). »
Graphique 20 – Evolution du coût unitaire de la main-d’œuvre dans l’industrie manufacturière (base 100 en 2002)
Sources : Bureau of Labor Statistics, International Labor Comparisons
- 15 – S’agissant de l’Allemagne, autre pays ayant fortement rebondi après la Grande Récession, la proportion s’inverse rigoureusement : les exportations représentent 70 % de l’output industriel sur la période 2010-2013 (Eurostat, OCDE).
- 16 – OCDE (STAN).
- 17 – Données du Bureau of Economic Analysis non présentées ici.
- 18 – BCG, 2013.
- 19 – Simchi-Levi D., 2012.
- 20 – Sirkin et al., 2012.
- 21 – Western Digital, fabricant de matériel informatique, a été durement touché en 2011 par les inondations en Thaïlande où il concentre environ 60 % de sa production de disques durs (voir notamment : http://lexpansion.lexpress.fr/high-tech-les-inondations-en-thailande-font-monter-les-prix-des-disques-durs_1363677.html).
- 22 – Illustré par le slogan de Chrysler (« imported from Detroit »), et les spots publicitaires emblématiques de la marque pour les finales du Super Bowl, avec Clint Eastwood (« It’s half time, America ») et Bob Dylan (« Detroit made cars, and cars made America »).
- 23 – « Our analysis suggests that there is no clear reshoring trend in the U.S. » (Rice & Stefanelli, 2014).
- 24 – Steve Jobs aurait lancé : « Those jobs aren’t coming back ». Charles Duhigg and Keith Bradsher, How the U.S. lost out on iPhone work. http://www.nytimes.com/2012/01/22/business/apple-america-and-a-squeezed-middle-class.html?pagewanted=all&_r=0
- 25 – Comme le montre Gazaniol (2012), les transferts de valeur ajoutée à l’étranger sont beaucoup moins le fait de délocalisations stricto sensu (fermetures de capacités de production nationales par des entreprises qui les transfèrent ailleurs) que de la perte de parts de marché par les industriels locaux ou leurs fournisseurs.
- 26 – A.T. Kearney, 2014.
- 27 – Moser H., 2013.
- 28 – Reshoring Initiative, 2014.
- 29 – Van den Bossche et al., 2014.
- 30 – Le taux de change effectif prend en compte différentes devises, et il est pondéré selon l’importance des différents partenaires commerciaux. Il est dit « réel » lorsqu’il tient également compte du fait que les prix n’évoluent pas de la même façon dans les différents pays.
- 31 – Malheureusement ce calcul tient compte uniquement des pays du G-7, dont la Chine et le Mexique, respectivement second et troisième marché pour les exportations américaines, ne font pas partie.
- 32 – L’appellation « gaz non conventionnel » fait référence à trois sortes de gaz naturel : le gaz de schiste, le gaz de houille et le gaz de réservoir compact.
- 33 – EIA, 2013a.
- 34 – EIA, 2014.
- 35 – Même si cette baisse fait suite à une hausse exceptionnelle, liée à l’évolution du cours du pétrole entre 2002 et 2006, de sorte que le coût moyen de l’énergie reste globalement en hausse de 35 % entre 2002 et 2010.
- 36 – Bordigoni M., 2013.
- 37 – L’usine de Vallourec est active depuis juin 2013 à Youngstown dans l’Ohio.
- 38 – Bordigoni M., 2013, op. cit.
- 39 – Voir : ACC Comments on University Of Michigan Report On Shale Gas and American Manufacturing.
- 40 – IHS, 2012a.
- 41 – L’étude explique qu’environ 20 % de ces créations d’emplois seront des emplois directs, le reste correspondant à des effets indirects et induits. Les emplois directs sont les emplois dans des secteurs engagés directement dans la production d’énergie non conventionnelle. Les emplois indirects correspondent à la main-d’œuvre employée par les fournisseurs (acier, méthodes d’extraction, etc.). Les emplois induits, créés dans le reste de l’économie, résultent d’un accroissement de la demande induit par une augmentation de l’emploi direct et indirect.
- 42 – IHS, 2012b.
- 43 – Etats producteurs (16) : Arkansas, Californie, Colorado, Kansas, Louisiane, Mississippi, Montana, Nouveau Mexique, Dakota du Nord, Ohio, Oklahoma, Pennsylvanie, Texas, Utah, Virginia-Occidentale, Wyoming.
- 44 – FMI, 2013.
- 45 – Melick (2014) appelle à une poursuite des recherches pour deux raisons : (i) les données sur les dépenses en capital ne sont pas disponibles après 2011, (ii) les effets de la baisse du prix du gaz ne jouent peut-être pas encore à plein.
- 46 – Le coût unitaire de la main-d’œuvre représente le coût moyen de la main-d’œuvre par unité produite. Cette mesure permet de comparer l’évolution de la rémunération par rapport à l’évolution de la productivité. Une augmentation du coût unitaire correspond à une augmentation de coût du travail plus rapide que celle de la productivité.
- 47 – Pour une étude approfondie sur les facteurs influençant les choix de localisation des industriels, voir Ellram et al. (2013).
- 48 – Manning & Napier, 2012.
- 49 – Ibid.
Nicolas de Warren – L’impact du prix de l’énergie sur la compétitivité de l’industrie chimique aux Etats-Unis – COMMENTAIRES
Nicolas de Warren, a poursuivi des études de droit à l’IEP de Paris avant d’intégrer l’ENA en 1984. Il est depuis 2006 directeur des affaires institutionnelles d’Arkema et à ce titre intervient, tant en France qu’en Europe, dans tous les domaines relatifs à la compétitivité industrielle (énergie, environnement, R&D, fiscalité et réglementation).
La question du coût d’accès à l’énergie est centrale dans l’analyse de la compétitivité d’un certain nombre de secteurs industriels et en tout premier lieu de l’industrie chimique. A cet égard, la « révolution énergétique » américaine en cours offre un terrain d’observation privilégié – mais à de nombreux égards atypique – tant les changements y sont rapides50. Cette question ne peut être abordée globalement : une réponse pertinente distingue nécessairement des effets variables sur les différents secteurs industriels.
Pour ce qui concerne l’industrie chimique, il convient d’intégrer le fait que les matières premières chimiques sont aujourd’hui pour plus de 95 % issues de produits énergétiques fossiles primaires (pétrole, gaz, charbon) ou secondaires (électricité). L’enjeu de compétitivité n’est donc pas seulement énergétique mais couvre également les matières premières, ce qui élargit considérablement l’impact économique des changements en cours.
Ensuite, il est nécessaire de segmenter l’industrie chimique en quatre sous-segments, allant de l’amont à l’aval de la chaîne de valeur : (1) la chimie de base et la pétrochimie, (2) la chimie industrielle des grands intermédiaires, (3) la chimie de performance et (4) la chimie fine et la parachimie.
L’énergie-intensivité décroit, de façon générale, de l’amont vers l’aval de la filière. Dans le premier sous-segment sont inclus les procédés où l’énergie primaire est dite « à double usage », à la fois force motrice et matière première (gaz pour les engrais et plus largement pour les réactions d’oxydo-réduction par exemple). Dans ces cas extrêmes, le produit énergétique pèse jusqu’à 25-30 % du coût de production. Dans les autres sous-segments, cette énergie-intensivité décroit sensiblement, jusqu’à 3-4 %.
En moyenne, sur l’ensemble de l’industrie chimique mondiale, et sur la base de parités de change moyennes de longue période, l’énergie pèse de l’ordre de 9 % du coût de production et les matières premières de l’ordre de 50 %.
En analysant l’impact de la révolution énergétique américaine sur la compétitivité de la chimie américaine, deux niveaux sont donc en fait à considérer, pour simplifier :
- les unités pétrochimiques qui ont un accès direct soit au naphta issu du raffinage, soit aux gaz de pétrole liquéfiés (GPL), soit à l’éthane issu du gaz naturel ou au gaz de raffinage, pour les transformer dans leurs unités de vapocraquage en éthylène, propylène et aromatiques ;
- les unités chimiques des sous-segments 2 à 4, qui transforment et démultiplient ces grands intermédiaires de synthèse.
La première catégorie est la grande bénéficiaire de l’effondrement des prix du gaz lié au développement massif des hydrocarbures non conventionnels en Amérique du Nord, et notamment à l’abondance des GPL issus des gaz de schiste qui jouent un rôle de plus en plus important dans la pétrochimie américaine.
Ceci a conduit à une véritable explosion des annonces de projets pétrochimiques, sous plusieurs formes : en premier lieu la conversion de vapocraqueurs qui utilisaient le naphta comme charges de leur fours vers les charges légères et peu coûteuses issues du gaz de schiste (éthane / GPL), mais aussi l’annonce de nouvelles unités de vapocraquage sur base éthane. Ainsi la production américaine d’éthane a-t-elle connu une hausse de près de 45 % entre 2008 et 2014, avec une baisse corrélative de près de 60 % du prix. Et il est prévu qu’elle passe de 500 millions de barils par jour en 2013 à 2 milliards en 2025.
En aval immédiat, des projets majeurs sont également annoncés dans les grands intermédiaires (éthylène glycol, styrène, méthanol…) pour valoriser les excédents d’éthylène, difficilement transportables du fait du coût de transport. De nombreuses unités de polymères vont voir le jour, en particulier celles pour lesquelles la chaîne chimique de transformation est la plus courte et donc les coûts d’investissement additionnels les moins importants (par exemple de l’éthylène au polyéthylène, du styrène au polystyrène, plutôt qu’au PVC). L’effet coût est dans ce cas massif et l’effet « relocalisation » de projets annoncés mais non lancés, au Moyen-Orient par exemple, est réel.
Ainsi, était-il fait état à fin 201451 par la profession de 197 projets – dont 64 % provenant d’acteurs extra-américains – mobilisant 125 milliards de dollars d’ici 2020, générant 91 milliards de dollars de chiffre d’affaires incrémental à partir de 2023 et 703 000 emplois créés dans le seul secteur chimique, dans l’hypothèse d’une disponibilité de gaz à 4 dollars par million de BTU pendant trente ans. Cela entraînerait un doublement de la production chimique américaine d’ici 2020, et une diminution corrélative d’un tiers de la production européenne.
La division par deux sur les six derniers mois du prix du brut, et donc du naphta, mais aussi du gaz américain52, ne devrait pas remettre en cause ce mouvement gigantesque. On assiste certes, à très court terme, à un rééquilibrage partiel des coûts de production53. Mais ce mouvement, à la fois très rapide et d’ampleur relativement limitée en termes relatifs, ne va pas bouleverser les tendances de long terme sur la localisation des investissements ni les stratégies d’investissement. Ceux-ci sont en effet décidés sur des analyses de long terme, sur la base d’une approche multifactorielle (proximité du marché, équilibre offre / demande à terme dans la zone de chalandise, logistique et infrastructures, stratégie d’intégration aval ou non, etc.) et ont une durée de conception puis de réalisation – pas moins de 5 ans pour le cycle complet de projets de montants unitaires compris entre 500 et 2 500 millions de dollars – qui les détachent des cycles de court terme. Par ailleurs, ces projets sont bien évidemment assis sur des contrats de fourniture de matières premières à long terme également largement « décyclicalisés ».
La baisse du cours du brut aura donc un effet de « clarification », au détriment des projets les moins rentables et des simples annonces à visée strictement dissuasive, ou entraînera des rééchelonnements de calendrier mais n’induira pas de changements directionnels. L’on peut ainsi considérer que le montant des projets annoncé ci-dessus va être réduit de 30 % au plus, portant en priorité sur ceux ayant la maturité la plus faible.
Le différentiel de compétitivité, qui était devenu considérable entre l’Europe et l’Asie d’une part et l’Amérique du Nord d’autre part, s’est donc quelque peu amoindri ces derniers mois, mais il demeure significatif. L’on peut ensuite considérer que le brut a atteint sa zone plancher et qu’il devrait même y avoir un raffermissement des prix des bases pétrolières conventionnelles à terme, creusant à nouveau l’écart en faveur d’une Amérique du Nord bénéficiant de ressources pétrochimiques issues des hydrocarbures non conventionnels très abondantes et peu mobiles. Le « New American Chemical Deal » est loin d’être mort-né.
- 50 – Ceci s’oppose d’ailleurs au modèle canonique de développement de l’énergie fossile, historiquement déterminé par des cycles longs qui correspondent à la fois à des contraintes techniques de mobilisation de la ressource, à des configurations géophysiques et surtout à un degré d’intensité capitalistique qui n’existe nulle part ailleurs dans l’économie.
- 51 – American Chemistry Council – Sept. 8, 2014 – Shale gas and new U.S. chemical industry investment: $125 Billion and counting
- 52 – Le NYMEX Natural Gas – Near month est passé de 4,2 à 2,61 dollars par million de BTU de janvier 2014 à janvier 2015.
- 53 – A très court terme en effet, l’on assiste à un certain rééquilibrage des coûts de production. Ainsi, fin 2013, le coût de production (« cash cost ») de l’éthylène était d’environ 420 dollars par tonne en Amérique du Nord et de 250 dollars par tonne au Moyen-Orient (sur base éthane), contre 1 100 dollars par tonne en Europe (sur base naphta), soit un facteur de 2,6 au détriment de l’Europe. Début 2015, le facteur n’est plus que de 2,15 (210 vs. 450 dollars par tonne). Le coût de production au Moyen-Orient reste bien inférieur car cette zone bénéficie d’un prix du gaz, pour les capacités installées, de l’ordre de 0,75 à 3 dollars par million de BTU contre 3 à 4 dollars par million de BTU aux Etats-Unis.
Une reprise hétérogène
1. Biens durables vs. biens non durables : des trajectoires différentes
La reprise dans l’industrie manufacturière s’explique avant tout par une forte croissance de la production de biens durables. Ces secteurs, particulièrement touchés par la Grande Récession, affichent un taux de croissance annuelle moyen de 5,7 % entre 2010 et 2013. A l’inverse, la production de biens non durables (agroalimentaire, produits chimiques, produits pétroliers, etc.) recule à un rythme de 2 % par an depuis 200854.
Les secteurs en plus forte croissance sont l’automobile (32,6 %), les métaux primaires (9,1 %), les machines (5 %), les produits informatiques et électroniques (4,5 %) ainsi que les produits métalliques (4,3 %). Il semble que l’automobile soit véritablement la locomotive de l’industrie américaine sur la période 2010-2013. Ce secteur a eu un effet d’entraînement massif sur le reste de l’industrie en raison de l’importance et la variété de ses consommations intermédiaires (77 % du chiffre d’affaires55). L’industrie automobile emporte dans son sillage la sidérurgie, la métallurgie, les machines, les plastiques, mais aussi quelques sous-secteurs de la chimie, de l’électronique, et du textile. Les machines et les métaux bénéficient en outre du redémarrage de la construction – autre secteur à fort effet d’entraînement – et de la forte croissance des activités extractives du fait du développement des énergies non conventionnelles. Enfin, le secteur du bois et des meubles profite également du redressement du marché de l’immobilier, et l’aéronautique (principale composante du secteur « autres matériels de transport »), tirée par les exportations, repart doucement. Seule ombre au tableau : la production de matériels, d’appareils et de composants électriques a reculé entre 2010 et 2013.
Graphique 21 – Taux de croissance annuel moyen de la valeur ajoutée réelle dans les secteurs des biens durables (2010-2013)
Source : Bureau of Economic Analysis, calculs des auteurs
Les industries produisant des biens non-durables se sont révélées moins dynamiques en sortie de crise. Le plus gros secteur industriel, la chimie, n’a pas encore digéré la Grande Récession et voit ses exportations stagner depuis 2011. Le secteur est dans une phase de transition, la mise en service de capacités de production additionnelles destinées à tirer profit du faible coût du gaz naturel ne débutant, selon l’American Chemistry Council, qu’à partir de 201556. De manière surprenante, la valeur ajoutée réelle des produits du pétrole et du charbon a reculé de pas moins de 5,8 % par an entre 2010 et 2013, alors qu’elle avait progressé tout au long de la dernière décennie et que le secteur est fortement excédentaire. Quelques secteurs résistent, à l’image des produits du plastique et du caoutchouc qui affichent une croissance honorable à la faveur du rebond de l’automobile. Il est intéressant de constater que le vêtement made in USA progresse après une chute libre à partir du début des années 2000. Toutefois, les secteurs du textile et de l’habillement pèsent très peu dans l’industrie manufacturière et ils peinent à retrouver leurs niveaux d’avant-crise.
Graphique 22 – TCAM de la valeur ajoutée réelle dans les secteurs des biens non durables (2010-2013)
Source : Bureau of Economic Analysis, calculs des auteurs
Les principaux gains en emploi entre janvier 2010 et décembre 2013 se font dans quatre secteurs : les matériels de transport (196 000, dont la plupart dans l’automobile), les produits métalliques (186 000), les machines (130 000) et les métaux primaires (51 000). On constate que les secteurs ayant créé le plus d’emplois depuis 2010 sont aussi ceux qui en avaient détruit le plus deux ans auparavant. Malgré ce rebond, aucun de ces secteurs n’a retrouvé un niveau d’emploi semblable à la période d’avant crise. La déconnexion entre emploi et valeur ajoutée est totale dans le secteur de l’informatique et de l’électronique qui, en dépit de sa vigueur, a détruit 34 000 emplois. Enfin, les secteurs du papier et de l’imprimerie souffrent d’un changement structurel : la dématérialisation croissante des supports.
Graphique 23 – Evolution de l’emploi dans le secteur manufacturier entre 2010 et 2013 (en milliers)
Source : Bureau of Labor Statistics, calculs des auteurs
2. Le cas particulier de l’industrie automobile
Le soutien des administrations Bush et Obama à l’industrie automobile et en particulier à Chrysler et General Motors fut décisif pour la santé économique de ce secteur. Leur faillite aurait porté un coup fatal à bon nombre de fournisseurs ; l’écosystème industriel américain tout entier en aurait souffert. Le gouvernement anticipait en effet une perte d’environ 1,1 million d’emplois et 1 point de croissance du PIB en cas de faillite de ces entreprises57. En outre, en raison de la concentration géographique de l’activité, ce choc aurait été subi par un petit nombre d’Etats, les rendant particulièrement vulnérables. Un rapport du Council of Economic Advisers indique que l’industrie automobile a permis la création de plus de 420 000 emplois depuis juin 200958. Même le PDG de Ford, Alan Mulally, se félicitait de cette intervention fédérale destinée à sauver ses concurrents, craignant de voir disparaitre le socle de fournisseurs qu’il partage avec eux et qui représente un moteur de l’innovation dans le secteur59.
L’industrie automobile et en particulier les « Big Three » de Detroit – General Motors, Chrysler et Ford60 – perdaient déjà des parts de marché depuis le début des années 2000. L’OCDE (2010) avance plusieurs explications : « la forte remontée des cours du pétrole jusqu’au milieu de 2008 a renchéri les coûts matières et déplacé la demande vers des véhicules plus petits. Se sont ajoutés à ces difficultés le lourd fardeau de l’endettement, des coûts fixes de capital et de main-d’œuvre colossaux et les engagements non négligeables pris à l’égard des retraités en matière de pensions et d’assurance-maladie. Enfin, l’excellente tenue des ventes automobiles de la décennie écoulée, alimentée par une politique de remises, a entraîné, aux États-Unis en particulier, une saturation du marché. » Ces tendances, combinées à une pénurie de crédit (les achats de véhicules se font principalement à l’aide d’un emprunt) et à une sensibilité particulière de l’industrie automobile au cycle économique, ont précipité l’effondrement du secteur en 2008.
Les ventes de véhicules ont chuté fortement pendant la crise, passant de 16,5 millions d’unités en 2007 à 10,6 millions en 2009. En outre, l’évolution des parts de marché montre que General Motors et Chrysler ont été plus touchés que les autres par les baisses de ventes. Klier et Rubenstein (2012) expliquent que les constructeurs de Detroit ont été particulièrement impactés par la baisse des ventes de véhicules légers (minivans, pickups, SUVs, etc.), segment qui représente une part importante de leur activité.
Graphique 24 – Evolution des ventes et de la production de véhicules américains (en millions)
Source : Ward’s Auto Group
Graphique 25 – Evolution des parts de marché des « Big Three »
Source : Ward’s Auto Group
A l’automne 2008, General Motors et Chrysler demandent le soutien de l’Etat américain mais le Congrès n’approuve pas les mesures proposées par l’administration Bush. Finalement, devant l’extrême fragilité de ces deux constructeurs historiques, l’administration adopte un décret le 19 décembre 2008 pour apporter une première vague de soutien financier à l’automobile dans le cadre du programme TARP61 (injection de 25 milliards de dollars). L’administration Obama, arrivée au pouvoir entretemps, nationalise General Motors au printemps après que ce dernier a fait faillite. Chrysler sera pour sa part sauvé de la banqueroute par la montée au capital de Fiat, qui en prend le contrôle total au 1er janvier 201462.
Au total, l’aide fédérale à General Motors et Chrysler a représenté un montant de 80 milliards de dollars, assorti de conditions visant à garantir la viabilité financière de ces entreprises. A lui seul, General Motors a reçu 50 milliards d’aide de la part du gouvernement, en échange de 60,8 % des parts de la compagnie – revendues par la suite – et de plans de restructurations63. Avec le regain de la demande et du crédit, les ventes de véhicules se sont redressées. Ces firmes sont redevenues rentables, au prix de nombreux licenciements, de fermetures d’usines et de baisses de salaires. David Cole, président de la fondation AutoHarvest, constate que « les capacités de production ont connu une réduction dramatique, celles qui subsistent bénéficient d’une utilisation plus intensive (environ 90 % aujourd’hui contre seulement 60 % avant la crise). »
Les restructurations ont profondément modifié l’industrie automobile, notamment sa géographie64. La crise a accéléré le regroupement de la production automobile dans l’intérieur du pays, entre les Grands Lacs et le Golfe du Mexique65. La restructuration des Big Three a renforcé la concentration de leurs activités dans le nord de cette zone. La proximité entre assembleurs et fournisseurs permet de réduire les coûts de transport. Dans le même temps, le nombre d’Etats comptant une usine des Big Three est passé de 16 à 10 entre 2007 et 2011, ce qui a pu expliquer l’opposition du Congrès au plan de sauvetage de General Motors et Chrysler. A l’inverse, les constructeurs étrangers continuent d’ouvrir des usines dans le Sud de la « Auto Alley », afin de profiter notamment de la faiblesse des salaires et du taux de syndicalisation dans cette zone66.
En outre, le rôle du Mexique est clef pour comprendre les évolutions de l’industrie automobile américaine. « Aujourd’hui, le véhicule moyen des Big Three incorpore plus de 40 % de contenu mexicain »67, déclarait Sean McAlinden du Center for Automotive Research. Selon Klier et Rubenstein (2013), le rôle croissant du Mexique dans la production de l’Alena résulte presque exclusivement de la progression de ses exportations. Ils expliquent ainsi que 83 % de sa production automobile est destinée à l’exportation, principalement vers les Etats-Unis. Ce taux exceptionnellement élevé fait du Mexique le quatrième exportateur mondial d’automobiles derrière l’Allemagne, le Japon et la Corée du Sud. Les constructeurs, étrangers pour la plupart d’entre eux, s’implantent au Mexique afin de bénéficier de bas coûts de production et de sa proximité avec les Etats-Unis. Andes et al. (2013) expliquent que le mouvement de délocalisation vers le Mexique s’est opéré au détriment du Midwest, alors que les Etats du sud des Etats-Unis ont résisté à la pression concurrentielle. L’évolution du poids de la main-d’œuvre mexicaine dans l’ensemble du secteur automobile nord-américain est spectaculaire, y compris depuis 2010 (cf. Tableau 2). Les tendances récentes montrent que ce pays est devenu un concurrent redoutable pour l’attraction de nouveaux sites de production, comme en témoigne l’ouverture de nouvelles usines par trois constructeurs (Nissan, Mazda et Honda) entre 2013 et 2014.
Tableau 2 – Part des emplois par pays dans l’industrie automobile nord-américaine
Source : Brookings Institution
3. Des évolutions contrastées au niveau géographique
L’industrie n’est pas répartie de façon uniforme sur le territoire américain et révèle des spécialisations dans certaines zones68. On trouve ainsi davantage de villes spécialisées dans la chimie dans le Sud du pays, à l’image de Bâton-Rouge ou de Houston. Les activités d’informatique et d’électronique sont quant à elles localisées principalement dans l’Ouest et dans le Nord-Est des Etats-Unis.
Les principaux gains en emploi depuis la reprise, donc entre 2010 et 2013, sont concentrés dans six Etats69. On trouve quatre Etats du Midwest (Michigan, Wisconsin, Indiana, et Ohio), traditionnellement industriels et qui bénéficient du rebond de l’automobile, tandis que le Texas, deuxième Etat industriel du pays, est tiré par une industrie variée ainsi que par les gaz et pétroles de schistes. Enfin, l’Etat de Washington profite du redressement d’une autre composante importante des matériels de transport : l’aéronautique.
Tableau 3 – Six Etats ayant connu les plus forts gains en emplois industriels entre 2010-2013
Source : Bureau of Labor Statistics
- 54 – Notons cependant une embellie en 2013 avec un taux de croissance d’environ 1,1 %.
- 55 – Calcul à partir des données du Bureau of Economic Analysis. A titre de comparaison, les consommations intermédiaires ne représentent qu’un tiers du chiffre d’affaires du secteur des produits informatiques et électroniques.
- 56 – American Chemistry Council, 2014.
- 57 – Voir : Fact Sheet: Financing Assistance to Facilitate the Restructuring of Auto Manufacturers to Attain Financial Viability.
- 58 – Voir : Economic Report of the President, 2014, chapitre 3, page 104.
- 59 – Sperling G., 2013.
- 60 – En 2007, ces trois groupes représentaient 50 % des ventes d’automobiles aux Etats-Unis.
- 61 – Troubled Asset Relief Program ou programme de sauvetage des actifs à risque.
- 62 – Le Monde, 2014.
- 63 – Canis B., Webel B., 2013.
- 64 – Klier T., Rubenstein J., 2012 ; Klier T., 2014.
- 65 – Ibid. Le corridor entre les Grands Lacs et le Golfe du Mexique est appelé « Auto Alley » (l’allée de l’automobile) et traverse les Etats suivants : Wisconsin, Illinois, Michigan, Indiana, Ohio, Kentucky, Tennessee, Mississippi, Alabama, Géorgie et Caroline du Sud.
- 66 – Cette dichotomie Nord-Sud est certes marquée mais pas absolue. D’une part, le système « right-to-work » gagne du terrain dans le Midwest, puisqu’il a été adopté par le Michigan et l’Indiana : en laissant ouverte la possibilité pour les salariés d’adhérer ou non à un syndicat, et de payer les cotisations correspondantes, la législation a affaibli les « unions » (syndicats). D’autre part et à l’inverse, Volkswagen s’est battue pour la création d’un syndicat dans son usine de Chattanooga dans le Tennessee, un Etat du sud.
- 67 – The Washington Post, 2013.
- 68 – Helper et al., 2012.
- 69 – Voir Nicholson et Noonan (2014) pour une description plus détaillée de l’évolution de l’emploi au niveau des Etats depuis 2010.
Bernard Jullien – Le traitement de cheval appliqué à l’industrie automobile américaine : une solution de facilité – COMMENTAIRES
Bernard Jullien est maitre de conférences en économie, directeur du Gerpisa (Groupe d’étude et de recherche permanent sur l’industrie et les salariés de l’automobile) et conseiller scientifique de la chaire de management des réseaux du Groupe Essca. Avec Yannick Lung, il a publié en 2011 l’ouvrage « Industrie automobile – La croisée des chemins » (La Documentation française).
Vue d’Europe, la situation américaine peut, en 2015, paraître plutôt enviable. Des personnalités importantes comme les CEO de Ford et de FCA – Alan Mullaly et Sergio Marchionne – ont très clairement regretté que l’industrie automobile européenne n’ait pas su s’organiser pour obtenir le droit de résorber enfin les surcapacités « structurelles » qui s’y manifestent. Après que deux des Big Three ont été mis en faillite en 2008, on se souvient en effet que l’administration américaine – républicaine puis démocrate – a repris la main. Elle a nationalisé General Motors et bradé Chrysler à Fiat. Elle a laissé aux créanciers et actionnaires leurs yeux pour pleurer. Elle a souligné l’incurie du management en exigeant qu’il s’en aille. Elle a considéré que, pour les deux faillis comme pour Ford, il était impératif d’ajuster très rapidement les capacités à une demande très basse dont rien n’assurait qu’elle reparte dans des délais raisonnables. Ce sont ainsi 11 sites d’assemblage qui ont été fermés, ce qui correspond à une réduction des capacités d’assemblage des Big Three de 2 à 3 millions de véhicules.
Lorsque, après être passé entre 2007 et 2009, de 16,5 millions à 10,6 millions de véhicules, la demande s’est redressée pour revenir dès 2013 à ses niveaux de 2007, les constructeurs américains se sont retrouvés dans une situation très favorable : leurs capacités restantes étaient très bien utilisées ; elles étaient jeunes et de qualité car les sites plus obsolètes avaient été fermés en priorité ; elles étaient localisées là où les conditions étaient les plus favorables (Etats du sud ou Mexique). Ainsi, les constructeurs américains sont redevenus rapidement profitables sur leurs marchés domestiques. Ils ont réinvesti et réembauché. Ils peuvent – en apparence – fourbir chez eux les armes dont ils ont besoin pour investir lourdement dans les pays émergents et singulièrement en Chine où General Motors fait – avec Volkswagen – la course en tête et où Ford peut enfin faire l’effort de rattrapage nécessaire pour tenter de recoller au peloton des poids lourds.
En regard, l’Europe paraît damnée et semble fonctionner comme une machine à perdre de l’argent et à se lancer dans les émergents avec des boulets aux pieds. Si tel est le cas, c’est d’abord parce que la demande n’en finit pas de stagner, très loin de ce qu’elle était en 2007. En 2013, elle était encore calée sur 14 millions de véhicules légers pour les 27 Etats membres, soit 5 millions en deçà du niveau d’avant la crise. C’est ensuite parce que la profitabilité de l’industrie automobile est aussi problématique en Europe qu’elle semble assurée aux Etats Unis : dans la mesure où très peu d’usines ont été fermées, chacun tente de vendre plus que ce que le marché souhaite absorber. On assiste à une exacerbation de la concurrence – déjà plus forte que partout ailleurs dans le monde – qui combine des coûts de développement des produits que l’on ne peut réduire sans se laisser rapidement distancer et une guerre des prix et des remises. Dès lors, nous dit-on, le remède à appliquer s’impose : il faut en finir avec la lâcheté managériale et politique et avoir en Europe, le courage qu’ont eu les Américains. CQFD.
Pourtant, cette manière de voir ne fait pas l’unanimité, y compris parmi les constructeurs et il y a d’assez bonnes raisons à cela.
La première est que les constructeurs européens n’étaient en 2008-2009 – ni ne sont en 2014-2015 – en aussi mauvaise posture que ne l’étaient les Big Three. Ils ne sont pas au bord de la faillite, même si PSA a suscité de très vives inquiétudes en 2012-2013. Ils ont des produits qu’ils renouvellent et qui séduisent en Europe et bien au-delà. Ils ont des technologies et continuent de les accumuler. Ils ont une présence internationale dans l’ensemble des émergents qui est largement à la hauteur de celle de General Motors et de Ford. Ils ont contenu chez eux les effets de l’entrée des constructeurs japonais et coréens bien mieux que n’ont pu le faire les constructeurs américains.
La seconde est que, puisque tel est le cas, il n’y a aucune raison de « socialiser » les pertes et dès lors, si ajustement il doit y avoir, c’est à chaque constructeur d’en supporter le coût. C’est exactement ce dont se plaignent Mullaly ou Marchionne. C’est, symétriquement, la raison pour laquelle chez Volkswagen, et même chez Renault, on voit d’un assez mauvais œil une politique européenne volontariste d’aide aux fermetures : elle favoriserait ceux qui en ont le plus besoin parce qu’ils perdent des parts de marché – c’est-à-dire les moins performants – alors qu’elle défavoriserait, en termes relatifs, les plus convaincants.
La solution américaine ressort ainsi, vue d’Europe, comme une solution de facilité sur le plan industriel. Elle apparaît aussi avoir été une solution de facilité sur le plan technologique comme sur le plan des savoir-faire automobile. En effet, ce qu’ont au fond obtenu les constructeurs américains en 2008-2009, c’est la validation politique – et le passage par profits et pertes – des effets collatéraux de deux tendances longues qu’ils avaient orchestrées et laissé se développer : d’une part, leurs pertes de marché et de savoir-faire sur l’exigeant marché des « cars » abandonné aux Japonais et aux Coréens dès les années 1980 ; d’autre part, leur redéploiement géographique vers les zones à bas salaires et au détriment de la région des Grands Lacs.
Lorsque Barack Obama a, à son arrivée à la Maison Blanche, bouclé la nationalisation de General Motors, il a souhaité que l’industrie automobile américaine prenne « un nouveau départ » et fasse enfin le nécessaire pour que technologiquement elle retrouve le chemin de l’excellence et qu’elle soit en particulier en tête plutôt qu’en queue en matière d’efficience énergétique. Rien de tout cela ne s’est passé. Sans rien faire pour renouveler leurs produits et se réarmer technologiquement, les constructeurs américains ont profité de leurs fermetures de sites pour atteindre des taux d’utilisation de leurs capacités très enviables. Gaz de schistes aidant, ils ont ensuite continué de vendre aux consommateurs américains des véhicules extrêmement gourmands et bien peu exigeants techniquement. Outre le fait qu’ils ne sont adaptés qu’au marché américain, ces produits ne tirent guère les ingénieries américaines vers le haut. Les consommateurs acquièrent des produits fiables, faciles à réparer et assez bien finis. Les constructeurs limitent considérablement leurs coûts de développement, peuvent externaliser assez massivement et maximiser leurs profits. Bref, le marché américain est un marché juteux car facile et, moyennant la gestion de la crise qui s’y est négociée, les constructeurs américains peuvent y « renaitre » sans se réformer et en restant, au fond, d’assez médiocres constructeurs.
Pierre Grandjouan – L’industrie dans les Etats – COMMENTAIRES
Pierre Granjouan, ancien Consul général de France à Houston, est aujourd’hui conseiller économique pour la Serbie et le Monténégro.
D’un Etat à l’autre, les différences sont considérables. Les grands Etats de l’Est (New York, Massachussetts) ont évolué de manière comparable, et connaissent une reprise assez vigoureuse depuis 2010. La Californie semble récupérer le terrain perdu avec une croissance honorable sur la période 2011-2013. Les grands Etats industriels de la zone des Grands Lacs (Illinois, Indiana, Michigan) ont subi la contraction la plus brutale mais ils ont retrouvé le niveau d’activité d’avant-crise (dans le cas du Michigan, pour qui le choc a été le plus rude) ou l’ont dépassé (Illinois et Indiana). Le New Jersey est dans une situation encore différente : il n’a que partiellement compensé la forte contraction causée par la crise. Le Texas, enfin, se distingue fortement, à la fois par le moindre impact de la crise et le retour dès 2010 à une croissance digne d’un pays émergent.
La part de l’industrie dans ces mouvements est également très disparate. Si on se limite à une comparaison entre les grands Etats, la plus mauvaise performance est celle du New Jersey, une situation particulièrement pénalisante dans un Etat très industriel. La meilleure se trouve dans les Etats des Grands Lacs : l’industrie explique un peu plus d’un tiers de la reprise à l’échelle du pays, mais 60 % ou plus pour le Michigan et l’Indiana. Là encore le cas texan est différent, puisqu’à la différence de la Californie et de l’Etat de New York, qui suivent la moyenne nationale, probablement du fait du caractère plus diversifié du tissu économique, le très grand dynamisme économique du Texas est attribué par le Bureau of Economic Analysis pour presque moitié à l’industrie. La différence dans ce cas vient en partie du secteur minier – et donc vraisemblablement de l’extraction du gaz de schiste. La réussite texane est largement une réussite industrielle.
Graphique A – Evolution du PIB réel pour une sélection d’Etats (base 100 en 2007)
Source : Bureau of Economic Analysis
Plusieurs facteurs convergents expliquent le positionnement particulier du Texas : la réglementation y est moins contraignante en matière de droit du travail et de normes environnementales, le recours aux class actions est plus encadré, la pression fiscale un peu moins forte. Les flux migratoires ont également été importants, essentiellement en provenance du Mexique (80 %), ce qui explique largement une croissance démographique deux fois plus rapide que celle du pays entre 2010 et 2013. Cela confère au Texas une main d’œuvre disponible, pas nécessairement très bien formée, mais meilleur marché que dans le reste du pays. Pour autant, le chômage a moins augmenté pendant la crise et a baissé sensiblement plus vite que la moyenne nationale. Les sacrifices consentis notamment en matière de protection sociale ou d’investissement éducatif ont d’autres conséquences : les grands centres de R&D continuent de se développer plutôt en Californie ou sur la côte Est.
En outre, le niveau d’entretien des infrastructures, aspect important des décisions de localisation d’investissements industriels, n’est pas uniforme aux Etats-Unis. Après les grandes grèves qui ont handicapé les ports de Californie, le port de Houston s’est positionné comme une alternative, cherchant également à profiter de l’élargissement du canal de Panama. Dallas a également tiré parti du développement d’infrastructures modernes en matière de fret aérien.
Pour compléter ce tableau, on peut enfin signaler la stratégie des Etats du sud (Alabama, Mississipi) qui s’efforcent d’améliorer leur attractivité grâce à un mélange agressif d’aides de l’Etat et de diminution du poids réglementaire, avec des succès assez relatifs.
Cette diversité de situations transforme le débat sur la politique industrielle. Ainsi de la relocalisation : il ne s’agit pas tant de relocaliser aux Etats-Unis, que de relocaliser (potentiellement) vers des zones qui ont des caractéristiques très différentes, qui peuvent se compléter. On peut ainsi imaginer positionner différemment les étapes de la chaîne de valeur, la R&D autour de Chicago, de San Francisco ou d’Austin, la production dans les zones industrielles du Texas ou des Etats du sud, les sièges à Dallas, New York ou Los Angeles.
Graphique B – Evolution du taux de croissance de la valeur ajoutée réelle dans l’industrie manufacturière
Source : Bureau of Economic Analysis
Perspectives pour 2015 et au-delà
1. Après le processus de rattrapage, un tassement de la croissance est à prévoir
Sept ans après l’ouverture de la crise, l’industrie a légèrement dépassé son niveau de production d’alors et semble bien avoir tourné la page de la Grande Récession. Certains pans de l’industrie manufacturière américaine se situent clairement à la fin d’un processus de rattrapage, et vont donc au-devant d’années moins fastes. « Les besoins de nouvelles capacités et les cycles de remplacement ont convergé pour tous les types de matériels de transport – automobiles, camions, avions, bateaux, et voies ferrées », explique le think tank MAPI70. Selon une récente étude de l’ITIF, « il ne serait pas surprenant de voir la croissance de ces industries stagner quand leurs niveaux pré-récession seront retrouvés et quand l’excès de demande résultant d’achats reportés sera satisfait. »71 L’automobile devrait entrer dans une phase de ralentissement à partir de 2016, après une croissance encore soutenue en 2014 et 201572.
Il subsiste tout de même certains secteurs industriels qui n’ont pas encore achevé leur processus de rattrapage, notamment dans le domaine des biens durables et de la construction. Les mises en chantier, loin d’avoir retrouvé leur niveau de la décennie précédente, sont en progression. Selon MAPI, le durcissement de la politique monétaire ne devrait pas entraver cette timide reprise73. De sorte qu’il y a d’importants gains à attendre dans les secteurs suivants : produits métalliques, produits minéraux non métalliques74, meubles et bois, plastiques et caoutchoucs, machines, et appareils ménagers.
Graphique 26 – Evolution des mises en chantier de logements privés (en milliers)
Source : Federal Reserve Bank of Saint Louis
Toute la question est de comprendre ce qui devrait se passer au-delà de ces effets de rattrapage. Une conjonction de facteurs devrait être favorable à l’industrie manufacturière. Comme l’écrit l’OCDE, « la reprise [de l’économie américaine] devrait donc régulièrement s’affermir, la demande privée bénéficiant de conditions financières favorables, d’un renforcement des bilans des ménages et des entreprises, d’une politique monétaire accommodante et de l’atténuation de l’effet de l’assainissement budgétaire. La réduction des incertitudes et les forces conjoncturelles normales devraient aussi stimuler l’investissement productif »75.
Le taux d’utilisation des capacités de production a retrouvé son niveau d’avant-crise et les firmes affichent une excellente rentabilité. Nous devrions donc assister à un important cycle d’investissement dans l’industrie76, les infrastructures énergétiques et le logement. Ceci devrait soutenir bon nombre d’industries du secteur des biens durables (biens d’équipement, métaux, machines, bois, meubles…).
Graphique 27 – Evolution du taux d’utilisation des capacités de production dans l’industrie manufacturière
Source : Federal Reserve Bank of Saint Louis
En particulier, et selon les prévisions de MAPI, le secteur des produits informatiques et électroniques et plus généralement la composante high-tech de l’industrie devrait afficher une croissance avoisinant 10 % entre 2016 et 201877. Cette perspective est importante car, bien qu’ils ne représentent qu’un cinquième de l’activité manufacturière, ces secteurs sont porteurs d’innovations qui irriguent l’essentiel de l’industrie. Néanmoins, des universitaires comme Suzanne Berger avancent que les Etats-Unis sont en proie à un appauvrissement de leur écosystème industriel, même dans le domaine des hautes technologies cf. infra).
La production de biens non durables devrait progresser à un rythme modeste dans les prochaines années. Notons une bonne progression de la chimie de base à partir de 2017, dynamisée par des investissements étrangers attirés par la faiblesse du coût de l’énergie et la perspective de gains de parts de marché à l’exportation. Le secteur des produits pétroliers et du charbon devrait progresser de manière modeste, les gains à l’export étant contrebalancés par une tendance au recul de la consommation intérieure.
Au bilan donc, après dissipation des effets de rattrapage, l’industrie devrait suivre sur une tendance favorable, grâce à une consommation soutenue et des investissements importants dans l’industrie, la construction et l’extraction. L’emploi devrait progresser régulièrement dans les prochaines années mais pâtir à terme des gains de productivité et du ralentissement dans la croissance de la production de matériels de transport. Le Bureau of Labor Statistics anticipe la perte d’environ 550 000 emplois industriels à l’horizon 2022 par rapport au niveau de 201278.
Par ailleurs, le fait que la croissance soit plus soutenue aux Etats-Unis que dans les autres économies développées79 conduit à penser que la balance commerciale pour les biens manufacturés (hors énergie) devrait se détériorer, les importations augmentant davantage que les exportations. L’annonce de relocalisations et un certain retour en grâce du made in USA ne devraient pas être suffisants pour inverser cette tendance.
Les Etats-Unis ne sont donc probablement pas à la veille d’un mouvement de réindustrialisation durable et généralisée, comme certains ont pu l’écrire. Certes, après une longue période de progression, le poids des importations dans la demande domestique semble se stabiliser, indiquant un regain de la production réalisée sur le territoire américain. Mais, comme nous allons le montrer dans les sections suivantes, les grands secteurs ne suivront pas des trajectoires similaires.
Précisons bien à ce stade que ces questions ne se bornent pas à l’étude du phénomène des relocalisations ; elles englobent au contraire toutes les formes de création d’activité.
2. Un retour limité des activités manufacturières intensives en énergie
La diminution brutale du coût du gaz naturel aux Etats-Unis a eu des répercussions immédiatement visibles sur les soldes commerciaux de certains produits intensifs en gaz. A plus long terme, la dynamique des prix de l’énergie (électricité et gaz) peut avoir des effets sensibles sur la production de biens intensifs en énergie80.
Aux Etats-Unis en effet, l’électricité est depuis longtemps deux fois moins coûteuse pour les industriels qu’en Europe ou au Japon, et le gaz naturel y est donc récemment devenu environ 60 % moins cher81. Qui plus est, les prix de l’énergie devraient augmenter à un rythme modéré d’ici à 2040, et l’efficacité énergétique progresser, également modérément. En Europe, les prix sont sur une dynamique d’augmentation plus soutenue qui n’est que partiellement contenue par les gains en efficacité énergétique. Selon l’Agence internationale de l’énergie82, cet écart entraînera une redistribution mondiale de la production de biens intensifs en énergie.
Encadré 5 – UN RISQUE DE DISPARITION DE LA PÉTROCHIMIE EUROPÉENNE ?
Le boom du gaz de schiste a permis une baisse considérable des coûts de production de certains produits, comme l’éthylène, produit emblématique de la pétrochimie. Cette industrie a vu ses coûts de production chuter entre 2008 et 2012 aux Etats-Unis, alors que le prix de vente de l’éthylène augmentait sur le marché mondial. Sylvie Cornot-Gandolphe83 explique que ces deux facteurs favorables ont permis un accroissement des marges des industriels et des investissements massifs.
Alors que l’on assiste à une renaissance de la pétrochimie aux Etats-Unis, les pétrochimistes européens sont menacés chez eux comme sur les marchés extérieurs. Malgré des restructurations importantes, les surcapacités existent toujours en Europe, la demande est atone et les coûts du gaz, qui sert à la fois de source d’énergie et de matière première, augmentent84. Les industriels du secteur devraient souffrir de l’arrivée des productions américaines à bas coût. Selon Sylvie Cornot-Gandolphe, les produits américains arriveront sur les marchés étrangers après la réalisation des nouveaux investissements, vers 2016-2017, mais on assiste déjà à l’accélération des fermetures de sites en Europe. L’Institut Montaigne85 présente une liste (non exhaustive) des récentes fermetures d’usines dans la pétrochimie européenne : en 2013, des groupes comme Dow Chemical, Sabic, Total, Arkema ou encore Celanese, devraient fermer des sites de production en Europe. Si les pétrochimistes (et les industriels en aval) investissent aux Etats-Unis pour profiter de l’abondance du gaz bon marché, ils semblent également s’orienter vers des produits de niche à haute valeur ajoutée sur le territoire européen, afin de se soustraire à la concurrence américaine.
Des incertitudes demeurent. L’avantage concurrentiel des pétrochimistes américains peut se réduire si le dollar s’apprécie, si l’Amérique exporte une part substantielle de sa production de gaz vers l’Europe ou encore si d’autres pays se lancent dans l’exploitation de leurs propres ressources en gaz de schiste. Cela ne s’applique pas aux pays européens qui, dans les conditions d’exploitation aujourd’hui envisageables, devraient obtenir un gaz pour un prix avoisinant les 9 dollars par million de BTU, encore largement supérieur au prix américain. La Chine, en revanche, dispose des plus grosses réserves mondiales. Elle s’est engagée dans la production de gaz de schiste mais les volumes produits restent encore modestes car les gisements sont dans des zones difficiles d’accès.
Cette recomposition devrait favoriser non seulement les Etats-Unis mais également la Chine et le Moyen-Orient au détriment de l’Union européenne. L’EIA estime que, entre 2011 et 2035, la part de marché de l’UE à l’export passera de 40 à 30 % pour les produits chimiques et de 16 à 7 % pour les métaux non ferreux. La part de marché des Etats-Unis devrait augmenter 13 à 15 % pour les produits chimiques et de 5,25 à 6,5 % pour les métaux non ferreux.
En résumé, la perte pour l’Europe devrait être plus grande que le gain pour les Etats-Unis. Disposer d’une énergie bon marché est un atout concurrentiel indéniable, mais l’Amérique n’est pas la seule dans cette position. Les risques élevés pesant sur les sites européens induiront des gains partagés par les Etats-Unis avec d’autres zones du monde. L’accroissement de la production de biens intensifs en énergie aux Etats-Unis sera réel sans être massif. L’agence américaine de l’énergie table, à l’horizon 2040, sur une croissance de la production réelle des biens intensifs en énergie de l’ordre de 1,3 % par an, contre 2,7 % pour les autres biens. Pour l’ensemble de l’économie américaine, le gain essentiel des ressources en gaz tient bien davantage à la baisse des importations de pétrole et à la hausse des exportations de produits pétroliers et de gaz.
Graphique 28 – Evolution du prix de l’énergie pour les industriels et projections (en dollars de 2012 par MBTU)
Source : US Energy Information Administration
3. La modération salariale, une politique soutenable ?
On a vu plus haut que les industriels américains ont récemment bénéficié d’une faible progression des salaires, considérablement moins rapide que dans la plupart des autres grands pays exportateurs, au point que le BCG a récemment décrit les Etats-Unis comme un pays « low cost » et comme une des « étoiles montantes » de l’industrie mondiale.
Cette amélioration de la compétitivité-coût s’est toutefois faite au prix d’une augmentation des inégalités, ce qui amène certains observateurs à s’interroger sur la capacité des Etats-Unis à poursuivre dans cette voie. Une étude de la Réserve fédérale86 indique que les revenus réels, c’est-à-dire ajustés de l’inflation, des 10 % des Américains les plus riches ont augmenté de 10 % entre 2010 et 2013, alors que ceux des six derniers déciles ont décliné. La répartition des richesses totales, c’est-à-dire des revenus ajoutés au patrimoine, est elle aussi de plus en plus inégalitaire : les 3 % des plus riches concentraient plus de la moitié des richesses en 2013 quand les 90 % des plus pauvres en détenaient moins du quart.
La reprise économique cache donc une grande hétérogénéité des situations individuelles, à même de fragiliser le consensus social. Les ménages les plus aisés, disposant d’un patrimoine immobilier ou d’un portefeuille en Bourse, ont bénéficié d’un effet richesse avec la remontée des cours et des prix des logements qui a suivi l’explosion de la bulle des subprimes et le krach financier. La politique monétaire très accommodante a garanti un accès facile au crédit et a alimenté cette reprise. En revanche, les ménages ne pouvant compter que sur les revenus de leur travail ont subi les effets de la modération salariale. Si le revenu moyen aux Etats-Unis a progressé entre 2010 et 2013, le revenu médian a pour sa part baissé, ce qui indique un creusement des inégalités. Le recul du chômage cache par ailleurs la précarisation d’une partie de la population arrivant en fin de droits et qui n’est plus décomptée dans les statistiques officielles. Le taux de chômage est certes tombé à moins de 6 % en 2014, mais le taux d’emploi peine à dépasser le seuil des 60 %, soit trois points de moins que dans la période d’avant-crise.
4. A la recherche d’un nouvel équilibre avec la Chine
Sortant d’un rôle de pur « pays atelier », notamment du fait de la montée des salaires domestiques, la Chine s’est engagée dans une transition dont l’objectif est de dynamiser la demande interne par le soutien au pouvoir d’achat des ménages, exploitant ainsi l’immense réservoir de croissance que représente son marché national. Son avantage-coût s’amenuisant année après année, l’industrie chinoise n’a d’autre choix que de monter en gamme. La pression concurrentielle croissante exercée par l’étranger, liée à l’ouverture commerciale du pays et en particulier à son accession à l’OMC en 2001, a amené le gouvernement chinois à mettre en place une stratégie d’incitation à l’internationalisation des entreprises afin d’assurer leur développement.
Négligeables au regard des flux mondiaux jusqu’au milieu des années 2000, les investissements chinois à l’étranger ont progressé de manière spectaculaire sur la période récente, si bien que la Chine se situe aujourd’hui à la troisième place des plus grands investisseurs au monde, derrière le Japon et les Etats-Unis. Un rapport de l’Asia Society prédisait en 2011 que les investissements directs chinois à l’étranger devraient atteindre, en cumulé, entre 1 000 et 3 000 milliards de dollars d’ici 202087.
On observe en particulier une montée en puissance des investissements chinois à destination des Etats-Unis à partir de 2009, date à laquelle ils ont dépassé le seuil modeste mais symbolique du milliard de dollars. Ils ont depuis enregistré une progression fulgurante, en se concentrant très largement dans l’industrie (76,2 % des investissements réalisés entre 2002 et 2014).
Ces investissements répondent à plusieurs objectifs bien précis, définis par le gouvernement chinois dans le cadre de sa stratégie « Going global ».
Premièrement, il s’agit d’assurer l’approvisionnement énergétique. L’urbanisation galopante et l’expansion industrielle chinoises ont eu raison de l’autonomie énergétique du pays. Compte tenu de ses énormes besoins en énergie, la sécurisation de l’approvisionnement apparaît comme un enjeu hautement stratégique. Il n’est donc pas étonnant de constater que les premiers projets d’investissements directs à l’étranger (IDE) ont été menés par des entreprises publiques chinoises, à destination de zones telles que l’Australie, l’Afrique ou l’Amérique du Sud où les ressources naturelles sont abondantes.
Graphique 29 – Evolution des investissements directs étrangers chinois aux Etats-Unis (en millions de dollars)
Source : Rhodium Group
Le décollage des IDE chinois aux Etats-Unis a été plus tardif et coïncide avec la mise en exploitation des gisements de gaz et de pétrole non conventionnels. Entre 2002 et 2014, la Chine a investi plus de 12 milliards de dollars dans le secteur énergétique américain. Le pétrolier chinois CNOOC a par exemple pris le contrôle d’activités d’extraction aux Etats-Unis à travers le rachat du canadien Nexen en 2013. De son côté, Sinopec a investi environ un milliard de dollars dans des gisements situés en Oklahoma.
Deuxièmement, l’objectif est de favoriser l’accès à la technologie. La montée en gamme de l’industrie chinoise se nourrit notamment de transferts technologiques. Ces derniers étaient jusqu’à présent réalisés via l’implantation chinoise de firmes étrangères mais ces dernières se montrent de plus en plus réticentes à dévoiler leurs secrets de fabrication à leurs partenaires. La protection de la propriété intellectuelle est d’ailleurs citée comme une motivation majeure dans les projets de relocalisations.
Les investissements chinois à l’étranger peuvent donc aujourd’hui prendre la forme de rachats d’entreprises, afin de mettre la main sur des technologies clés. Si leur part est encore minime par rapport au secteur énergétique, les industries automobile, aéronautique ou des TIC comptent de plus en plus parmi les investissements chinois. Lenovo a, une nouvelle fois, pris le contrôle d’une partie des activités d’IBM en 2014 pour un montant de plus de 2 milliards de dollars, après une première transaction du même ordre en 2005. Le géant chinois de l’informatique a également racheté à Google les activités de Motorola, pour un montant évalué à 2,9 milliards de dollars.
Ces rachats éveillent des craintes chez certains Américains, qui redoutent que des activités ou technologies stratégiques ne soient récupérées par des puissances étrangères. Ces menaces conduisent les Etats-Unis à prendre des mesures de protection de secteurs sensibles ou présentant des enjeux de défense nationale88.
Troisièmement, ces investissements permettent de se rapprocher des marchés et des consommateurs. Les barrières tarifaires et non-tarifaires imposées aux produits chinois finissent par constituer des coûts importants pour les entreprises exportatrices. Certaines d’entre elles peuvent alors décider de s’implanter sur le sol américain afin de contourner ces obstacles. Cela peut d’ailleurs présenter d’autres avantages : comme le décrit Michael M. Woody (cf. page 120), le raccourcissement géographique des chaînes d’approvisionnement permet aux entreprises de s’adapter aux attentes spécifiques de la demande locale, d’économiser des coûts et de gagner en réactivité.
En résumé, il semble que l’industrie américaine soit arrivée aux limites d’un modèle essentiellement fondé sur des délocalisations d’activités de production vers la Chine. Les investissements chinois commencent à affluer aux Etats-Unis et semblent indiquer qu’un nouvel équilibre dans les relations sino-américaines est en train de se dessiner.
Graphique 30 – Investissements directs étrangers chinois aux Etats-Unis par secteur (en millions de dollars)
(*) Le pic enregistré en 2013 s’explique par le rachat du géant de l’agroalimentaire Smithfield par Shanghui International pour un montant de plus de 7 milliards de dollars. Hormis de cette transaction, les investissements chinois dans le secteur ont été modestes (141 millions de dollars entre 2002 et 2014).
Source : Rhodium Group
5. L’industrie high-tech américaine, un leadership menacé ?
On vient de le voir, les économies émergentes à l’image de la Chine ont réalisé d’importants efforts dans le domaine de la R&D et sont aujourd’hui des rivales pour l’industrie américaine. Depuis une quinzaine d’années, l’intensité en R&D, c’est-à-dire le poids des dépenses en R&D dans le PIB, est restée assez stable aux Etats-Unis et dans l’Union européenne. A l’inverse certaines économies, notamment d’Asie de l’Est, accroissent leurs investissements dans la R&D et l’éducation.
Cette situation donne lieu à deux interprétations antagonistes. Pour les uns, la base industrielle américaine se trouve de plus en plus menacée par ses compétiteurs mondiaux, notamment asiatiques, y compris sur les biens de haute technologie qui constituaient jusque là son refuge. Pour les autres, cette lecture souffre d’un biais statistique radical, qui empêche de mesurer toute l’avance prise par les Américains sur la prochaine grande transformation économique, celle du passage de l’industrie à l’ère digitale.
Reprenons. Le déficit commercial américain vis-à-vis des pays asiatiques ne se cantonne plus aux produits à faible valeur ajoutée. Depuis 2002, la balance commerciale américaine pour les produits de technologie avancée affiche un solde négatif. Le déficit a atteint un niveau record en 2011, représentant près de 100 milliards de dollars, soit environ 18 % du déficit total de la balance des biens et services américaine ou encore l’équivalent du déficit commercial de la France sur la même période.
Les catégories « aérospatial », « électronique », « science du vivant » (biopharmaceutique, instruments et appareil médicaux, biosciences, etc.) et « technologies de l’information et de la communication » (TIC), qui représentent plus de 85 % de ces activités de technologie avancée, suivent des dynamiques très différentes. En effet, les Etats-Unis ont une balance commerciale excédentaire dans l’aérospatial et les composants électroniques, mais un très large déficit dans les technologies de l’information et de la communication, sur lesquelles se focalisent donc de nombreuses études et contributions.
On sait, notamment depuis les travaux de l’OCDE et de l’OMC sur le commerce en valeur ajoutée (cf. Annexe 4), que ces chiffres du déséquilibre commercial sont en partie artificiels, traductions du déploiement international des chaînes de valeur.
Graphique 31 – Balance commerciale pour les produits de technologie avancée vis-à-vis du reste du monde (en milliards de dollars)
Source : U.S. Census Bureau
Tableau 4 – Données sur le commerce de produits de technologie avancée pour les quatre principales catégories (en milliards de dollars)
Source : U.S. Census Bureau, Foreign Trade Statistics, Advanced Technology Trade database
Les firmes multinationales ont en effet implanté de nombreuses activités de production intensives en main-d’œuvre dans les pays émergents. Elles se sont organisées sur une base mondiale, en conservant la plupart du temps les activités de conception, de recherche et de marketing dans les pays riches89. Les Etats-Unis se sont donc recentrés sur des segments à haute valeur ajoutée, intensifs en main-d’œuvre très qualifiée. Spence et Hlatshwayo (2012) expliquent qu’à côté des destructions d’emplois dans les produits informatiques et électroniques, on note d’importantes créations dans le secteur de la conception de systèmes informatiques et des services associés.
Concrètement, la valeur ajoutée créée par la Chine lors de l’assemblage d’un iPhone est faible. La Corée du Sud, l’Allemagne, le Japon et les Etats-Unis, concourent bien davantage à la création de la valeur de ce produit. Pourtant, Xing et Detert (2010) montrent que selon les statistiques traditionnelles les Etats-Unis affichaient en 2009 un déficit lié à l’iPhone de presque 2 milliards dollars vis-à-vis de la Chine, qui ne fait qu’assembler les composants fabriqués dans le monde entier. Cela est lié au fait que les statistiques douanières imputent l’ensemble de la valeur à l’exportateur du produit fini.
Il faut donc procéder à deux corrections. D’une part, une initiative conjointe de l’OCDE de l’OMC a développé une nouvelle base de données, TiVA90, qui comptabilise les échanges internationaux non plus en valeur brute mais en valeur ajoutée. Ces données montrent que le déficit commercial sur le segment des produits électroniques et optiques est cinq fois moins important lorsque l’on mesure les échanges en valeur ajoutée. Le déficit à l’égard de la Chine se trouve réduit des deux tiers (plus proche de 30 milliards que de 100 en 2009), ce qui atténue sans l’évacuer l’enjeu d’une éventuelle dépendance américaine sur ces produits clés. Seconde correction : les échanges de biens high-tech sont intimement liés à des échanges correspondants dans les secteurs des services. Les échanges dans les secteurs de pointe doivent donc être mis en balance, notamment avec un excédent commercial de 90 milliards pour les revenus de la propriété intellectuelle en 201491.
Citant notamment une étude de la DGE, Jean-Loup Picard, consultant en stratégie, rappelle que « le marché des produits ne représente qu’un tiers du secteur des TIC, le solde représentant les activités de logiciels et de services. Le premier évolue à peu près au même rythme que le PIB alors que le second progresse 2 à 2,5 fois plus rapidement. Or, la plupart des statistiques utilisées ignorent cette décomposition. Les géants américains du numérique – les fameux GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon) – s’accaparent progressivement des pans entiers d’autres activités économiques : musique, cinéma ou paiement en ligne pour Apple, cloud computing pour Amazon, réalité virtuelle pour Facebook… sans compter les investissements de Google dans la voiture automatique ou la santé avancée. Ce nouveau modèle industriel – caractérisé par une intégration de plus en plus méthodique des produits aux services pour vendre des « usages », une priorité donnée à la capture et à la fidélisation de la clientèle – s’impose rapidement, y compris dans les industries les plus matures. Les Etats-Unis, et notamment la Californie, assurent encore un leadership dans ces transformations. »
Interrogé sur le sujet, un dirigeant américain en charge de la stratégie chez Schneider Electric confie que « même si le groupe conserve toujours des activités dans le manufacturing pur et dur, la société s’oriente de plus en plus vers l’automation et le software, en particulier avec le rachat d’Invensys, implantée en Californie et dans le Massachusetts. Les services et les logiciels représentent les principaux axes de développement du groupe. Le développement de la production industrielle se fera essentiellement en adéquation avec la répartition des ventes par géographies du groupe (tailored supply chain), les pays émergents comptant pour plus de 40 %, en particulier la Chine et l’Inde. »
En suivant ce raisonnement, plusieurs observateurs font explicitement le pari que les Etats-Unis, non contents de rester un pays leader sur les segments à haute technicité, sont même appelés à exercer une domination absolue dès lors que l’industrie manufacturière se sera entièrement digitalisée, grâce à leur avance incontestée dans le domaine du logiciel92. Un des volets de la question est de savoir dans quelle mesure les industriels américains sont mieux préparés que leurs concurrents internationaux à cette grande transformation que sera l’irruption du digital dans leurs modes de production et jusqu’à leurs business models. Les témoignages qui nous parviennent sont contrastés. Certains évoquent la puissance des start-ups conquérantes et prometteuses alliées aux géants du Web (Tesla, Apple, Google…)93. Sébastien Bouchet, enterprise strategy architect chez Microsoft, considère par exemple que « la digitalisation et l’exploitation du big data ne peuvent plus se faire à grande échelle sans recours au cloud computing. Les capacités de traitement nécessaires sont telles que seuls les opétareurs du cloud dotés d’une hyper-taille peuvent offrir ces services. Or, l’immense majorité de ces acteurs (Amazon, Microsoft, Google, etc.) ont leur siège aux Etats-Unis. Je suis convaincu que la présence d’une pépinière de mastodontes du digital outre-Atlantique est de nature à favoriser la compétitivité relative de l’industrie américaine dans les années à venir. » D’autres soulignent à l’inverse que les entreprises manufacturières « pures et dures » sont aussi désemparées que les européennes face au défi du big data.
Cela ne fait aucun doute : les Etats-Unis restent un pays leader dans l’innovation et ont gardé la main sur les activités de conception qui alimentent bon nombre de secteurs industriels. Ils réalisent à eux seuls 30 % des brevets mondiaux, assurent une forte protection des droits de propriété intellectuelle, abritent sept des dix meilleures universités du monde94… Au cours de l’année 2011, y ont été dépensés 428 milliards de dollars en recherche et développement soit plus du tiers du total mondial. Le financement fédéral représente environ un quart de la dépense totale en R&D et constitue le premier financement pour la recherche fondamentale95.
Encadré 6 – TROIS QUESTIONS À PATRICK PÉLATA, VICE-PRÉSIDENT EXÉCUTIF DE SALESFORCE
Quel regard portez-vous sur l’état actuel de l’industrie américaine et sur sa capacité à poursuivre le rebond qu’elle connaît depuis la fin de la crise ?
Nous assistons aujourd’hui à une transformation en profondeur d’une grande partie de l’industrie américaine, comme cela a déjà été le cas entre 1929 et la deuxième guerre mondiale. Il y a mille façons de le voir, mais un aspect majeur des mutations en cours est la convergence de plusieurs révolutions : les smartphones, le cloud, les médias sociaux et l’internet des objets, le tout produisant les big data. Ces technologies ouvrent de nouvelles perspectives en bouleversant les business models et en offrant de nouveaux marchés à de nombreuses activités industrielles. Je rappelle à ce titre le fameux article « Why software is eating the world » de Marc Andreessen publié dans le Wall Street Journal en août 2011.
Avec la transformation en cours, les frontières entre manufacturing et services s’estompent ou méritent a minima un réexamen. Il faut en conséquence faire preuve de prudence dans l’analyse car certaines statistiques telles que les indicateurs physiques de production, qui étaient bons au temps de la CECA des années 1950-60, sont maintenant bien moins pertinents. Pour comprendre ce qu’il se passe aujourd’hui, il faut avoir en tête qu’un iPhone est certes assemblé en Chine et à Taiwan mais que la majorité des coûts et des profits attachés à cet objet sont localisés aux Etats-Unis.
Selon vous, les Etats-Unis n’ont donc rien perdu de leur compétitivité. Comment cela se manifeste-t-il ?
Un indicateur majeur de la compétitivité industrielle est la part de marché dans les exportations mondiales. Je constate (cf. Graphique 9 en page 44 de la note) que les Etats-Unis sont le seul pays, excepté la Chine bien sûr, à progresser sur la dernière année connue. Il faudrait creuser ce point par branches mais c’est en tout état de cause un résultat capital.
La note étudie de manière plus approfondie la question du déficit de la balance commerciale mais, comme le dit Martine Azuelos citée en page 64, « la reprise économique des Etats-Unis ne peut pas être distinguée de la dynamique des autres pays de l’Alena (Canada et Mexique). » Je me souviens, dans la comparaison de l’industrie France-Allemagne faite il y a trois ans96, que le deuxième facteur de succès de l’Allemagne, après sa baisse du coût complet du travail, était l’excellente utilisation qu’elle avait faite dès les années 1990 de l’Europe de l’Est sur les biens intermédiaires et les composants les plus simples à fabriquer, dans l’industrie automobile en particulier. Il me semble que depuis quelques années, l’industrie américaine opère massivement de la même manière avec le Mexique. Ce n’est pas une perte de compétitivité, bien au contraire. Mais le solde commercial, en tout cas temporairement, ne « voit » pas cela si l’on ne le regarde pas de façon très fine.
Vous semblez résolument optimiste quant à la reprise de l’industrie américaine. Identifiez-vous malgré tout des éléments pouvant entraver ces perspectives ?
Il est vrai que l’éducation, la formation des salariés, les infrastructures physiques, le coût des télécommunications, les faibles salaires et la « social imbalance » que cela génère, la pauvreté de la relation syndicats-entreprises par rapport à des pays comme l’Allemagne ou le Japon sont autant de handicaps sérieux que les Etats Unis devront surmonter pour poursuivre sur leur lancée.
Mais au-delà de ces remarques, je pense que la créativité entrepreneuriale des Américains, la puissance de leur R&D publique, privée et mixte, les bijoux comme la Silicon Valley et maintenant Seattle, le North East, Austin, etc. représentent de sérieux atouts, qui fonctionnent à plein régime en ce moment. Cette capacité à innover est toujours un facteur majeur de la compétitivité, et bien plus encore durant les périodes de grandes transformations telles que celle que nous vivons actuellement.
Encadré 7 – LE NATIONAL NETWORK FOR MANUFACTURING INNOVATION (NNMI)
Le National Network for Manufacturing Innovation (NNMI) a pour objectif de combler le fossé entre la recherche appliquée et le développement de produits innovants en réunissant les industriels, les universités et les agences fédérales. Le réseau est constitué de nœuds régionaux, les Institutes for Manufaturing Innovation (IMI). Ces instituts, souvent comparés aux Fraunhofer Institute allemands, ont pour mission de former les étudiants et les travailleurs, conseiller les entreprises et faciliter la création de start-ups, ou encore mettre à disposition des équipements pour développer de nouveaux produits et procédés. Chaque institut doit devenir financièrement indépendant dans les 7 ans après son lancement en générant des revenus à travers des contrats de recherche, des licences de propriété, des droits d’adhésion, etc97. En bref, via un partenariat public-privé permettant de répartir le risque lié à l’investissement dans les nouvelles technologies, ce réseau a pour ambition de construire un ensemble de « communs industriels »98 afin de stimuler l’économie locale et nationale.
Le président Obama a introduit pour la première fois le concept de NNMI dans son discours du 9 mars 2012 en Virginie99. Dans la foulée, plusieurs agences dont le Department of Defense sollicitent la création d’un institut pilote, centré sur la fabrication additive (ou impression 3D). En août 2012 le premier des IMIs, le National Additive Manufacturing Innovation Institute (NAMII ou encore appelé America Makes), est créé à Youngstown dans l’Ohio. L’idée est qu’il est vital d’éviter un sous-investissement dans l’impression 3D car les gains générés par cette technologie seront rapidement diffusés à de nombreuses firmes.
Dans ses discours sur l’état de l’Union de 2013 et 2014, Barack Obama a demandé au Congrès d’autoriser un investissement de 1 milliard de dollars pour la création de 15 instituts et a plaidé pour un réseau comprenant 45 nœuds (IMIs) dans les dix ans à venir. Devant l’inaction du Congrès, le président a annoncé la création de trois autres instituts : le Next Generation Power Electronics Manufacturing Innovation Institute dans l’Université de Caroline du Nord, le Digital Manufacturing and Design Innovation Institute à Chicago et le Lightweight and Modern Metals Manufacturing Innovation Institute dans la région de Detroit. En 2014, il déclare que l’administration procédera à la création de quatre nœuds supplémentaires, dont un consacré au développement d’énergies propres et un autre à la « biofabrication »100.
Avec quatre instituts actifs à ce jour, le NNMI est encore loin de constituer un réseau national. Si quatre instituts supplémentaires sont sur les rails, il reste du chemin à parcourir pour atteindre les objectifs manifestés par le président Obama. En outre, compte tenu de l’immensité du territoire et du poids économique et démographique des Etats-Unis, la création de 15 nœuds pour un budget d’un milliard d’euros ne semble pas relever d’une ambition démesurée. En Allemagne, le pays modèle en la matière, les 67 instituts Fraunhofer (fondés en 1949) représentent 2 milliards d’euros de budget. En France, une poignée d’instituts de recherche technologique (IRT) bénéficie d’un investissement comparable via le Programme d’investissements d’avenir (PIA).
Au final, cette initiative n’est en réalité qu’une pièce qui vient s’insérer dans un écosystème plutôt riche. Les agences fédérales ont déjà une activité de transfert technologique et il existe des programmes fédéraux suivant des ambitions assez similaires. A titre d’exemples, les deux programmes phares dédiés aux PME (SBIR et STTR), représentent une dépense fédérale de 2,2 milliards de dollars par an. De la même manière, le Hollings Manufacturing Extension Partnership, qui vise à peu près les mêmes objectifs que le NNMI avec ciblage sur les entreprises de taille modeste, draine 100 millions d’aide fédérale par an.
Néanmoins, le morcellement des chaînes de valeur peut avoir des effets de long terme négatifs sur la capacité proprement industrielle à innover. Dans son ouvrage « Production in the Innovation Economy », une équipe du MIT101 montre que les délocalisations des capacités de production dégradent la richesse de l’écosystème industriel et sa capacité à innover, les savoir-faire de conception se nourrissant des interactions avec les unités de production, les fournisseurs et les utilisateurs102. Cela ne concerne pas simplement les productions « bas de gamme », mais aussi des secteurs avancés comme les batteries, les cellules photovoltaïques ou l’éolien. Suzanne Berger déclarait ainsi récemment : « ce que nous avons vu disparaître, ce sont des pans entiers de l’industrie. Et cela ne correspond pas seulement à l’industrie traditionnelle, mais aussi à celle qui innove, dans les hautes technologies. »103. Alors qu’Apple est souvent citée en Europe comme un modèle absolu de réussite, il est frappant de constater dans cet ouvrage que la firme de Cupertino représente plutôt l’emblème de la débâcle industrielle : « invented here, made there ».
Le National Research Council104 cite l’exemple des écrans de télévisions et d’ordinateurs pour montrer que la disparition d’un secteur de l’industrie sur un territoire peut empêcher le développement d’un nouveau. Il explique ainsi que l’abandon de la production d’écrans à cristaux liquides au profit des producteurs asiatiques pose de sérieux problèmes pour le développement d’écrans souples aux Etats-Unis, alors que ce sont des firmes américaines qui ont réalisé les développements majeurs dans ce domaine. En effet, l’équipement, l’expertise, les fournisseurs ou encore la technologie nécessaires à la production se situent en Asie. Les Etats-Unis n’ont plus un écosystème industriel adapté à la production d’électronique, capable de toucher rapidement des marchés mondiaux.
Le leadership américain dans l’industrie de haute technologie serait donc peut-être quand même menacé.
6. L’enjeu de l’accès à une main-d’œuvre qualifiée et motivée
La main-d’œuvre américaine est globalement bien formée mais des problèmes d’éducation et de compétence, conduisant à des difficultés de recrutement pour certains postes, pourraient compliquer une possible renaissance industrielle. Ces problèmes ne sont pas nouveaux : en 1989, Philippe Delmas et Geneviève Roy dressaient un état des lieux inquiétant : « la main-d’œuvre américaine, particulièrement celle affectée aux tâches de production, est dans un état lamentable à tous les niveaux ; à la base : 20 % des ouvriers américains sont fonctionnellement illettrés (c’est-à-dire sachant lire un abécédaire mais pas un texte) ; au sommet : la moitié des étudiants de niveau doctoral en sciences de l’ingénieur aux Etats-Unis sont des étrangers. Entre les deux, les entreprises américaines ont un système de formation professionnelle parmi les moins performants de l’OCDE »105. Une enquête de Deloitte et du Manufacturing Institute106 montre que 67 % des industriels indiquent subir un manque modéré ou sévère de travailleurs qualifiés. L’étude montre par ailleurs que ces travailleurs qualifiés (techniciens, opérateurs, artisans, techniciens, etc.) sont précisément ceux qui ont le plus d’impact sur la performance. Les industriels anticipent une aggravation de ce déficit de compétences dans les prochaines années en raison du départ à la retraite de la génération des « baby boomers » américains. Erick Ajax, copropriétaire de la PME EJ Ajax, y est déjà confronté : « avec le départ à la retraite des baby boomers, la société a perdu cette année deux cents ans d’expérience et en perdra la même quantité dans les trois ans qui viennent. »
Toujours selon cette étude, les industriels identifient très bien le problème du manque de compétences mais conservent des méthodes de recrutement et de formation dépassées. Le management de la performance repose trop souvent sur des méthodes informelles et l’investissement dans la formation n’est pas à la hauteur des objectifs, obligeant souvent un recours aux heures supplémentaires. L’étude affirme qu’environ 5 % des postes dans l’industrie manufacturière, soit 600 000 emplois, ne sont pas pourvus en raison d’un manque de compétences. Le BCG estime que le déficit de main-d’œuvre qualifiée est beaucoup plus limité, de l’ordre de 80 000 à 100 000 emplois, et concentré dans un nombre restreint de grands centres industriels (Bâton-Rouge, Charlotte, Miami, San Antonio, et Wichita)107. Si l’étude du BCG diffère sur l’ampleur du phénomène, elle n’est pas moins alarmante sur les conséquences du vieillissement des travailleurs dans l’industrie. En 2020, les Etats-Unis pourraient manquer de 875 000 machinistes, soudeurs, opérateurs et autres professionnels hautement qualifiés.
Dans une autre enquête, Deloitte et le Manufacturing Institute108 s’intéressent à l’image de l’industrie dans la population américaine. L’industrie est considérée comme le secteur le plus important pour assurer la prospérité économique des Etats-Unis. Elle est dans le même temps perçue comme un secteur en stagnation ou en déclin, qui n’offre dès lors pas de carrières stables et sécurisées. Ainsi, seulement 35 % des Américains interrogés déclarent qu’ils encourageraient leurs enfants à poursuivre une carrière dans l’industrie. Comme dans de nombreux pays (dont la France), on observe un hiatus entre le souhait de voir se développer un secteur manufacturier puissant et l’orientation professionnelle des individus. A l’image de Walter Siegenthaler, directeur général de Daetwyler, certains industriels choisissent d’aller directement à la rencontre des jeunes, de leurs parents et de leurs enseignants afin de leurs présenter les opportunités d’emploi que propose l’industrie. A l’occasion d’une récente tournée dans les lycées de sa région, il révèle avoir recueilli des marques d’intérêt de 70 lycéens et constate que, paradoxalement, la Grande Récession a peut-être eu pour effet d’améliorer l’attractivité du secteur : « les gens se rendent compte que passer quatre ans à l’université sans garantie d’emploi est un choix risqué compte tenu du coût des études supérieures aux Etats-Unis. » Contrairement à d’autres secteurs, l’industrie présente ce côté rassurant d’être assimilée à l’économie réelle.
- 70 – Meckstroth D., 2014a.
- 71 – ITIF, 2015.
- 72 – Meckstroth D., 2014a.
- 73 – La baisse des achats de titres adossés à des créances hypothécaires par la Réserve fédérale ne semble pas avoir un effet important sur les taux hypothécaires.
- 74 – Ce secteur regroupe essentiellement la production de céramiques, de verre, de ciment, et de chaux.
- 75 – OCDE, 2014.
- 76 – Rappelons que l’investissement dans l’industrie fournit principalement des débouchés à l’industrie elle-même.
- 77 – Meckstroth D., 2014b.
- 78 – Henderson R., 2013.
- 79 – La croissance de l’économie américaine devrait avoisiner 3 % en 2015 et 2016, contre 1,1 % et 1,7 % en Europe, et 0,8 et 1 % au Japon (voir : OCDE, 2014).
- 80 – Commission européenne, 2014.
- 81 – EIA, 2013a.
- 82 – EIA, 2013b.
- 83 – Cornot-Gandolphe S., 2013.
- 84 – Le gaz est trois plus cher pour les industriels européens que pour leurs concurrents américains.
- 85 – Institut Montaigne, 2014.
- 86 – Board of Governors of the Federal Reserve System, 2014.
- 87 – Rosen D., Hanemann T., 2011.
- 88 – Op. cit. Rosen D., Hanemann T., 2011.
- 89 – Les lignes de partage de l’économie globale se distinguent des frontières nationales. En outre, les distinctions sectorielles traditionnelles (primaire, secondaire, tertiaire) sont de moins en moins pertinentes pour analyser les dynamiques à l’œuvre dans la globalisation. Pierre-Noël Giraud (1996, 2012) préfère ainsi opposer les emplois sédentaires, dont les activités sont nécessairement produites sur le territoire où elles sont consommées (comme la distribution alimentaire de proximité, la restauration, les services à la personne, la production de béton, la distribution d’eau et d’électricité et la collecte des déchets…), et les emplois nomades dont la production peut être réalisée loin du consommateur.
- 90 – La base TiVA, présentant des indicateurs pour 57 pays, sur les années 1995, 2000, 2005, 2008, 2009 et ventilés en 18 secteurs, est accessible sur le portail de l’OCDE.
- 91 – U.S. Census Bureau.
- 92 – Bourdoncle F., 2014. Ludwig H., Spiegel E., 2014.
- 93 – Distinguin S., 2014.
- 94 – Voir : The Times Higher Education World University Ranking 2013-2014.
- 95 – L’essentiel de la R&D est réalisé dans les secteurs de l’informatique et de l’électronique (31 %), de la pharmacie et du médicament (23 %), et de l’aérospatial (13 %). Par ailleurs, l’effort fédéral se concentre sur un nombre restreint d’industries, deux tiers de la dépense fédérale en R&D concerne le secteur aérospatial, 19 % l’informatique et l’électronique. Cette répartition n’est pas difficile à comprendre quand on sait que 40 % de l’investissement fédéral poursuit un objectif de défense nationale. Les dépenses dans l’aérospatial sont principalement financées par le Département de la Défense et l’industrie du transport aérien.
- 96 – Voir le compte-rendu de la conférence « Quel chemin pour la réindustrialisation de la France ? » disponible sur le site de La Fabrique de l’industrie (www.la-fabrique.fr).
- 97 – Sargent J., 2014.
- 98 – Les « communs industriels » désignent les moyens collectifs de R&D, d’ingénierie, et de production qui soutiennent l’innovation (voir : Pisano G.P., Shih W.C., 2009).
- 99 – The White House, 2012.
- 100 – Voir : http://manufacturing.gov/nnmi.html
- 101 – Locke R., Wellhausen R., 2014.
- 102 – Voir notamment : Tassey G., 2014.
- 103 – Voir : Suzanne Berger : « Aux Etats-Unis, le processus de recherche-innovation est bloqué ».
- 104 – National Research Council, op. cit.
- 105 – Delmas P., Roy G., 1989.
- 106 – Deloitte, Manufacturing Institute, 2011.
- 107 – Sirkin et al., 2013.
- 108 – Deloitte, Manufacturing Institute, 2012.
Patrick Artus – Y a-t-il des menaces sur le redressement industriel aux Etats-Unis ? – COMMENTAIRES
Diplômé de l’Ecole Polytechnique, de l’ENSAE et de l’IEP de Paris, Patrick Artus est aujourd’hui le chef économiste de Natixis et membre du Comité exécutif. Il est également professeur d’économie à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne, membre correspondant au Conseil d’analyse économique auprès du Premier ministre et administrateur de Total et Ipsos.
A. Redressement industriel des Etats-Unis
Les Etats-Unis se distinguent nettement des autres pays de l’OCDE (zone euro, Royaume-Uni, Japon) par le redressement de la production industrielle, par le redressement de l’investissement productif (cf. Graphique C), par le début de remontée des parts de marché à l’exportation et par celui de l’emploi industriel.
Quand on regarde les différents secteurs de l’industrie, on voit que la reprise de la production concerne surtout l’automobile, les biens d’équipement et l’énergie. La reprise de l’emploi concerne surtout l’énergie, la métallurgie, le matériel de transport, le plastique, le caoutchouc.
B. Un aspect négatif : il ne s’agit pas d’une montée en gamme de l’économie américaine
L’essor de ces industries correspond à un développement en milieu de gamme de l’économie américaine, pas à une montée en gamme. Dans le même temps, le secteur des nouvelles technologies perd des emplois, la productivité du travail aux Etats-Unis continue à ralentir, ce qui est cohérent avec le niveau faible de compétence de la population active aux Etats-Unis. L’enquête PIAAC de l’OCDE sur les compétences de la population active classe les Etats-Unis en 12e position sur 16 pays.
Graphique C – Evolution de l’investissement productif (en volume, base 100 en janvier 2002)
Sources : Datastream, sources nationales, Natixis
On peut illustrer le fait que ce développement de l’économie américaine se situe en milieu de gamme par la comparaison des niveaux de productivité et des niveaux de salaire des différents secteurs.
L’énergie et la chimie ont des niveaux de productivité et de salaires très élevés.
Mais les autres secteurs en forte croissance (métallurgie, plastique-caoutchouc, automobile) se trouvent bien à mi-chemin entre les nouvelles technologies, les services financiers, d’une part et les services aux particuliers, la construction, la distribution, les restaurants-loisirs d’autre part.
Tableau A – A gauche : productivité par tête en niveau (dollars constants par tête, 2014) ; à droite : salaires par tête (milliers de dollars, 2014)

C. Trois menaces sur la réindustrialisation des Etats-Unis
Regardons maintenant ce qui pourrait menacer ce processus de réindustrialisation des Etats-Unis. Il s’agit d’abord de la perte de l’avantage de compétitivité venant du coût du travail. Les salaires réels et le coût salarial unitaire continuent à augmenter très peu aux Etats-Unis, avec la perte de pouvoir de négociation des salariés. Il n’est pas certain que la faiblesse du chômage (5,9 % en septembre 2014) conduise à une accélération des salaires, la stagnation des salaires réels s’observant depuis le début des années 2000.
Une menace plus forte sur la compétitivité-coût des Etats-Unis est sans doute la réappréciation du dollar, avec les politiques monétaires expansionnistes au Japon et dans la zone euro, avec la réduction des flux de capitaux vers les pays émergents conduisant à la dépréciation de leurs devises.
Il peut s’agir du rejet du modèle social américain. Il faut remarquer que le gain en compétitivité-coût des Etats-Unis est associé à la caractéristique la plus négative du modèle social des Etats-Unis : la stagnation du pouvoir d’achat de la classe moyenne, l’ouverture des inégalités d’où la faiblesse en moyenne des salaires et les gains de compétitivité.
Nous avons dit plus haut que même le plein-emploi n’entrainait plus de hausse plus rapide des salaires réels aux Etats-Unis. Mais il pourrait y avoir dans le futur une contestation du modèle social et de l’ouverture des inégalités.
La perte de l’avantage concernant le coût de l’énergie est aussi une menace importante. Il est possible que, dans le futur, l’avantage des Etats-Unis concernant le prix de l’énergie disparaisse si d’autres pays font l’effort de produire une énergie bon marché. Le tableau F montre la structure par pays des réserves connues de gaz de schiste. On sait que la Chine, l’Argentine, le Royaume-Uni et probablement l’Allemagne vont essayer de développer leur production de gaz de schiste.
Tableau B – Réserves de gaz de schiste (en milliards de mètres cubes)
Source : EIA
D. Conclusion : une menace immédiate, le dollar
La réindustrialisation des Etats-Unis est une réindustrialisation « milieu de gamme » : le premier problème est qu’elle ne conduit pas à une montée en gamme ou à un redressement des gains de productivité aux Etats-Unis. Elle peut être menacée :
- à long terme, par une remise en cause du modèle social des Etats-Unis qui implique la stagnation des salaires d’une majorité d’Américains et est à la source de l’amélioration de la compétitivité ;
- à moyen terme, par la baisse du prix de l’énergie dans d’autres pays, en particulier ceux qui produiront du gaz de schiste ;
- à court terme, par l’appréciation généralisée du dollar, due à l’écart de croissance et de politique monétaire entre les Etats-Unis et les autres pays.
Daniel Atlan – Les Etats-Unis, un rêve qui s’émiette ? – COMMENTAIRES
Après avoir suivi une formation en physique du solide non métallique, Daniel Atlan a effectué sa carrière dans le secteur de la sidérurgie, où il a notamment travaillé dans les ressources humaines chez Arcelor Mittal Mining en tant que DRH d’un segment de 53 000 personnes situées au Brésil, au Québec, en Afrique du Sud ou encore en Sibérie. Il apporte aujourd’hui son concours à quelques patrons opérationnels.
L’Amérique s’est bâtie autour d’un rêve : un pays d’exception construit sur des richesses naturelles extraordinaires par des citoyens libres et égaux, éduqués et capables d’une ascension sociale importante, et par des entreprises innovantes, le tout piloté par un système démocratique fait d’équilibres et de contrôles. Certes, tous n’étaient pas invités à partager le rêve américain. Mais indéniablement ce rêve a été une réalité pour des millions de personnes nées aux Etats-Unis ou immigrées.
A. Comment ce rêve s’est-il construit ?
La forme moderne du rêve américain émerge avec la politique des cinq dollars par jour d’Henri Ford, le 4 janvier 1914. Aucune grandeur d’âme dans ces décisions : Ford a compris qu’en payant mieux ses salariés, il les attacherait à son usine, ce qui leur permettrait de gagner en compétence et en productivité.
La crise de 1929 et surtout la réponse de Franklin D. Roosevelt, le New Deal, vont parachever les fondations du modèle sociotechnique américain. Ce modèle s’appuiera sur le déploiement des innovations du moment : l’automobile, le réfrigérateur, l’air conditionné qui vont faciliter la vie quotidienne d’une classe moyenne occupée à leur production en masse.
L’éducation joue un rôle essentiel. L’appareil scolaire (hors les universités) est financé localement par des impôts et taxes décidés localement. Pour résumer, au XXe siècle, l’appareil de formation initiale américain forme bien et massivement jusqu’au niveau universitaire. La liberté d’entreprendre s’appuie sur un réseau de banques locales très développé et fortement régulé109. Après des débuts violents et chaotiques, le syndicalisme prend sa place dans le cadre du National Labor Relations Act de 1935.
B. Le « traité de Detroit » ou comment le rêve se formalise
L’effort de guerre impose des contraintes et en 1945, le président Truman est soucieux de gérer la sortie du régime de contrôle des prix et des salaires. Le « traité de Detroit »110 est donc une opinion partagée informelle et privée selon laquelle les salaires doivent croître avec la productivité et l’inflation. Le « traité » est formalisé dans un accord entre General Motors et UAW. Ce dispositif est peu à peu étendu, soit par négociation avec les syndicats soit par décision unilatérale des directions111 qui ne souhaitent pas voir de syndicats dans leur entreprise. Pendant trente ans la mécanique tourne parfaitement.
Graphique D – Evolution comparée de la productivité et du revenu annuel médian aux Etats-Unis
Légende : Entre 1947 et 2011, la productivité américaine a plus que quadruplé.
Sources : U.S. Census Bureau, Bureau of Labor Statistics, Federal Reserve Bank of Saint Louis
C. La rupture
Le graphique D montre à la fois l’efficacité du « traité de Detroit » et l’ampleur du décrochage qui s’est produit à partir du début des années 1970. La faible progression du salaire médian à partir de cette date cache en fait une inégalité croissante dans les revenus comme le montre le graphique qui suit. Les salaires bas et moyens ont très peu progressé en termes réels ; seuls les 5 % des salaires les plus élevés ont augmenté fortement, surtout entre 1980 et 2000.
Du fait des vagues de délocalisations puis de la crise, ce sont surtout des emplois relativement bien payés qui ont été détruits, notamment dans l’industrie, et surtout des emplois moins bien payés qui ont été créés, notamment dans les services.
Depuis 1970, le « modèle américain » connaît donc de profonds bouleversements : le pouvoir d’achat de la classe moyenne stagne, les mécanismes de redistribution sont peu efficaces et perçus comme illégitimes, la polarisation sociale, géographique et politique de la population croît considérablement. Dès lors, l’appareil de formation primaire et secondaire n’est plus financé comme il le devrait et sa performance s’érode. Les indicateurs PISA reflètent ces évolutions. On peut observer de même une évolution négative des indicateurs de santé publique112.
Les innovations et les changements techniques continuent certes de faire émerger des produits de grande consommation, mais l’impact en emplois aux Etats-Unis est faible comparé à celui produit au XXe siècle par l’automobile ou l’électrification. En 1955, General Motors était la plus grande entreprise du monde, avec un chiffre d’affaires de 105 milliards de dollars (en dollars de 2011), près de 500 000 salariés aux Etats-Unis et 80 000 à l’étranger. En 2011, Apple a un chiffre d’affaires de 108 milliards de dollars mais moins de 30 000 salariés aux Etats-Unis, 10 000 à l’étranger et plus de 700 000 employés par la sous-traitance pour l’essentiel en Chine et dans des pays émergents.
Graphique E – Evolution des revenus aux Etats-Unis (en dollars de 2012)
Sources : U.S. Census Bureau, Bureau of Labor Statistics, Federal Reserve Bank of Saint Louis
Tableau C – Emplois perdus entre le 1er trimestre 2008 et le 2e trimestre 2014 (les 5 secteurs les plus touchés)
Source : U.S. Census Bureau
Tableau D – Emplois créés entre le 1er trimestre 2008 et le 2e trimestre 2014 (les 5 secteurs les plus actifs)
Source : U.S. Census Bureau
D. Quelles perspectives ?
Souvenons-nous que le paysage social américain des années 1920 était fort semblable à celui d’aujourd’hui. L’émergence d’un nouveau système sociotechnique, comme cela s’est produit au XXe siècle, ne peut être exclue.
Plusieurs leviers sont fréquemment évoqués : les nouveaux modes de production, dans lesquels les Américains investissent beaucoup, l’évolution des techniques en biologie, plus rapide que ce que la loi de Moore décrit pour l’électronique, l’allongement de la durée de la vie, qui ne se résume pas au seul vieillissement de la population et qui demandera des produits et des services nouveaux…
- 109 – En particulier par le Glass Steagall Act de 1933 qui sépare banques d’affaires et banques de détail.
- 110 – Ce nom a été donné en 1949 par un journaliste de la revue Fortune.
- 111 – Ainsi de la société IBM.
- 112 – Les Etats-Unis étaient en 1960 en douzième position pour la mortalité infantile parmi les pays du monde ; en 2004 ils n’occupent plus que la trentième position. En 1990, le taux de mortalité des femmes en couches était de 12,4 pour 100 000 ; il est désormais de 18,5.
Philippe Le Corre – Le rôle de la Chine sur l’évolution de l’industrie américaine – COMMENTAIRES
Philippe Le Corre est chercheur à la Brookings Institution (Washington) et enseigne à Sciences Po depuis 2005. Il a été journaliste, correspondant en Asie de grands médias français pendant dix ans et est l’auteur de plusieurs ouvrages sur le monde chinois. Il a notamment co-écrit avec Alain Sepulchre le livre « L’offensive chinoise en Europe » (Fayard).
Politiquement, les Etats-Unis sont à la croisée des chemins après l’échec des Démocrates lors des mid-term elections en novembre 2014. L’élection présidentielle qui choisira le successeur de Barack Obama à la Maison Blanche aura lieu à l’automne 2016. Sur le plan économique, pourtant, la situation est au beau fixe et personne n’envisage une réduction de la croissance en 2015, ou même l’année suivante. La baisse du prix du pétrole et du gaz naturel est un avantage certain : même la présidente de la Réserve fédérale Janet Yellen y voit un effet positif pour la croissance. Particulièrement nette outre-Atlantique, la baisse du prix du gallon (autour de 2 dollars contre 3,3 dollars début 2014) a toutes les chances de doper la consommation aux Etats-Unis – grâce aux économies réalisées en carburant, les Américains vont pouvoir se reporter sur d’autres achats.
Certes, les régions ayant directement bénéficié du pétrole et du gaz de schiste depuis quelques années risquent de souffrir. Cependant, sur le long terme, elles seront gagnantes et attirent déjà un nombre d’investisseurs croissant. La taille du marché américain le rend toujours aussi attractif aux yeux des pays asiatiques, le Japon depuis les années 1970, la Corée du Sud depuis les années 1990, et la Chine plus récemment. Dans le Sud des Etats-Unis, le niveau des salaires dans l’industrie est inférieur à celui de nombreux pays industrialisés, ce qui fait des Etats-Unis un concurrent redoutable vis-à-vis des autres pays récipiendaires d’investissements directs à l’étranger. Depuis cinq ans, la Chine est le pays asiatique qui s’est le plus intéressé aux Etats-Unis. Selon le Rhodium Group, qui a réalisé une étude sur les investissements chinois à l’international, la Chine y aurait investi 47,5 milliards de dollars entre 2000 et 2014. A titre d’exemple, les investissements chinois sont passés de 750 millions de dollars en 2008 à 14 milliards en 2013 – y compris des acquisitions immobilières importantes comme l’hôtel Waldorf Astoria (acheté pour 1,95 milliard de dollars par un groupe proche de la famille de Deng Xiaoping). Pour le ministère du commerce chinois, la Chine aurait investi 17,5 milliards de dollars au cours de l’année 2012. Selon d’autres experts, le montant réel serait supérieur. Il s’agit d’un retournement de situation, qui démontre s’il en était besoin le poids de la Chine dans l’économie mondiale.
De leur côté, les multinationales américaines ont beaucoup investi en Chine entre 1995 et 2010, appâtées par un « grand marché chinois » qui, dans certains cas, tarde à se matérialiser depuis que les autorités chinoises ont mis en place des outils de protection en faveur des entreprises locales (comme la loi anti-monopole qui vise souvent les firmes étrangères). L’investissement américain cumulé en Chine atteindrait 70 milliards de dollars, soit un chiffre proche de l’investissement chinois aux Etats-Unis113. Chacun sait par ailleurs que le déficit commercial sino-américain atteint 314 milliards de dollars au profit de la Chine. Autant de raisons pour les deux premières puissances économiques mondiales de développer leurs relations, notamment à travers la négociation – un peu laborieuse – d’un traité bilatéral sur les investissements.
Une part non négligeable des investissements chinois se concentre sur le Sud du pays, où certains Etats américains pratiquent une politique fiscale attractive et un droit du travail favorable aux employeurs.
En avril 2014, le Boston Consulting Group publiait une étude démontrant que les Etats-Unis se plaçaient juste derrière la Chine en termes de compétitivité dans le secteur industriel. Harold Sirkin, du BCG, estime que « des Etats américains comme l’Alabama, la Caroline du Sud et le Tennessee sont sur le point de devenir des sites de production parmi les moins chers du monde industrialisé »114. Parmi les cas les plus flagrants de « nouveaux investisseurs », on retrouve Haier (dont le premier investissement aux Etats-Unis remonte à 2001) et Lenovo. Ces deux géants industriels chinois (respectivement dans l’électro-ménager et l’informatique) détiennent des sites de production dans le Sud des Etats-Unis. Cela démontre la montée en puissance des investisseurs chinois aux Etats-Unis, comme dans le reste du monde d’ailleurs115. En août dernier, la revue Southern Business & Development se réjouissait de l’évolution des investissements chinois aux Etats-Unis en 2014 : « Enfin, les entreprises chinoises se trouvent dans l’obligation d’investir aux Etats-Unis » écrit le rédacteur en chef Mike Randle, pour qui 4,3 milliards de dollars (sur un total de 6 milliards pour l’ensemble des Etats-Unis) a été investi par la Chine dans le Sud du pays116.
Parmi les exemples d’investissements chinois dans le Sud des Etats-Unis (1er trimestre 2014), il faut noter :
- La construction par Yuhuang Chemical d’une usine près du fleuve Mississippi, le plus important investissement venu de Chine (1,85 milliard de dollars).
- Le rachat d’une usine Motorola par Lenovo en Caroline du Nord dans le secteur de l’informatique.
- Golden Dragon, un groupe chinois spécialisé dans le cuivre, a ouvert en 2014 une usine pour un montant de 100 millions de dollars.
- Le groupe FI USA de Hong Kong a ouvert une usine de chaussures à Jefferson City, Tennesse.
- Shandong Tranlin Paper, une société spécialisée dans le bois a investi 2 milliards de dollars pour mettre en place une unité de protection à Richmond, Virginie.
- TDC Cutting Tools a ouvert une usine, investissant ainsi 8,2 millions de dollars et recrutant 38 employés.
Tous ces exemples participent d’un rapprochement économique entre les deux pays qui était à l’agenda de la visite de Barack Obama à Pékin en novembre 2014, même si les aspects politico-stratégiques ne sont jamais absents des relations sino-américaines. Outre les accords sur le climat et sur l’immigration, ce rapprochement comprend une réduction du déficit commercial, souhaitée de part et d’autre. De nombreux projets industriels chinois sont à l’étude au niveau des Etats et des municipalités américaines. Dans tous les cas, les investisseurs chinois sont en discussion directe avec les Etats plutôt qu’avec le gouvernement fédéral, ce dernier étant uniquement consulté sur les sujets d’investissements sensibles par exemple dans la défense, l’aéronautique, les télécommunications… Quoi qu’il en soit, la hausse des coûts de production en Chine, associée à une baisse des coûts dans les Etats américains du sud, est de nature à attirer ces investissements, ce qui semble satisfaire l’administration Obama. Le président lui-même n’avait-il pas déclaré en 2007 que la Chine et les Etats-Unis n’étaient « ni des amis, ni des ennemis… mais des concurrents » ?
- 113 – Rosen D., Hanemann T., 2014.
- 114 – Philips M., Bachman J., 2014.
- 115 – Le Corre P., Sepulchre A., 2015.
- 116 – Randle M., 2014.
Michael M. Woody – La renaissance de l’industrie sera portée par le raccourcissement des chaînes d’approvisionnement – COMMENTAIRES
Michael McKeldon Woody est le présentateur de l’émission de télévision « American Dragon » et auteur d’un livre éponyme qui présente des industriels américains parvenant à concurrencer les entreprises implantées à l’étranger. Vous pouvez le joindre via l’adresse mmw@americandragon.us ainsi que sur Facebook et Twitter (@usdragon1).
Selon certaines idées reçues, la renaissance industrielle des Etats-Unis serait largement portée par des facteurs tels que le faible coût de l’énergie, la stagnation du coût du travail ou le soutien du gouvernement à l’économie. Ces facteurs ont certainement participé au rebond, mais ils ne suffisent pas à décrire totalement la situation.
Sur longue période, la renaissance de l’industrie aux Etats-Unis – et dans les autres pays développés – sera portée par la compression géographique des chaînes d’approvisionnement. Pourquoi un tel phénomène apparaît-il et en quoi favorise-t-il le secteur industriel, que ce soit aux Etats-Unis ou en Europe ? On peut relever trois explications, intimement liées.
La première est que l’on produit de moins en moins de vastes volumes de commodités et de plus en plus des volumes ajustés de produits toujours plus personnalisés. La demande des consommateurs se tourne de plus en plus vers des biens et services adaptés à leurs envies et besoins. La décision de Motorola d’assembler son modèle Moto X à Austin (Texas) plutôt qu’en Chine découle ainsi du choix de développer une large gamme offrant de nombreuses possibilités de personnalisation aux clients. La rapidité de la livraison étant jugée primordiale, le raccourcissement de la chaîne d’approvisionnement apparaissait comme une nécessité. La production de la plupart des pièces de ce téléphone est toujours localisée en Asie, mais l’assemblage final est réalisé aux Etats-Unis afin que le modèle personnalisé soit livré au client le plus rapidement possible.
Le deuxième facteur justifiant un raccourcissement des chaînes d’approvisionnement est la nécessité pour les industriels et les distributeurs de minimiser le volume de leurs stocks. Il s’agit ici d’une considération financière de réduction des coûts, suivant les préceptes de méthodes telles que le lean manufacturing. Acheter de grandes quantités de biens à l’étranger, les payer en avance et attendre entre trois et quatre mois avant qu’elles n’arrivent par bateau n’est plus aussi rentable, surtout maintenant que les prix des biens chinois augmentent. Il est certain que Tesla a construit, en partenariat avec Panasonic, une usine de batteries lithium-ion à proximité de ses installations existantes pour réduire les contraintes et les risques liés à une chaîne d’approvisionnement trop longue.
La troisième raison – et certainement la plus importante – de raccourcir les chaînes d’approvisionnement tient au besoin grandissant de réactivité par rapport aux attentes des marchés. Or, avec des chaînes de valeurs étendues, cet impératif entre en contradiction avec l’objectif de réduction des stocks. Un industriel se fournissant en biens intermédiaires à l’étranger doit, pour rester réactif, acheter des quantités considérables afin de se prémunir d’un éventuel épuisement de son stock et donc se doter de capacités de stockage importantes. Seule une chaîne d’approvisionnement courte – en particulier composée de fournisseurs nationaux capables d’assurer des délais de livraison rapides pour des quantités limitées – permet de réconcilier les objectifs de réactivité et de baisse des coûts de stockage. Le principe du « fast fashion », qui permet aux vendeurs de répondre rapidement à une demande très changeante des consommateurs tout en réduisant les stocks, en est un exemple.
Pourquoi ces tendances s’expriment-elles de manière plus aiguë aux Etats-Unis que dans les autres économies développées ? Parce que l’Amérique reste le plus grand marché au monde et que pour y réussir, il est de plus en plus important d’y être implanté. Ceci explique l’augmentation des investissements directs à l’étranger depuis la Chine vers les Etats-Unis. Raymond Cheng, PDG d’un cabinet de consultants basé à Hong-Kong et qui conseille des industriels chinois souhaitant s’implanter aux Etats-Unis, fait remarquer que « pour beaucoup de ces entreprises, leurs plus gros clients sont américains. C’est un avantage d’être juste à côté de votre plus gros client. »
Certes, l’industrie doit toujours lutter à armes inégales contre les importations massives de produits étrangers. Le fait que les pièces du Moto X soient toujours importées d’Asie illustre l’un des deux défis auxquels les industriels doivent faire face si nous voulons que la renaissance se poursuive : la reconstruction d’écosystèmes décimés par plus de vingt-cinq années de délocalisations massives. Le deuxième défi est celui de l’inadéquation des compétences entre les besoins des industriels et les personnes sans emploi. Nous devons améliorer la formation à destination des chômeurs et des jeunes si nous voulons pourvoir les postes qu’offre l’industrie aujourd’hui et ceux qu’elle proposera demain.
Mais ces défis sont à notre portée et ils seront surmontés.
Conclusion
Le redémarrage des Etats-Unis en sortie de crise est impressionnant, en particulier au regard de la dynamique européenne. L’industrie manufacturière, en déclin relatif sur longue période et frappée de plein fouet par les deux récessions de la dernière décennie, semble faire la démonstration d’une vitalité retrouvée. Toutefois, nous considérons qu’il est encore trop tôt pour parler de renaissance de l’industrie américaine. C’est plutôt une dynamique de rattrapage autocentrée, tirée par une demande vigoureuse, qui lui a permis de se relever après la Grande Récession. En particulier, le retour du crédit et de la confiance a incité les consommateurs et les firmes américaines à réaliser d’importants achats de biens durables qu’ils avaient reportés en raison de la crise. Le soutien du gouvernement américain aux constructeurs automobiles fut en cela décisif. La reprise frappe en outre par son caractère hétérogène, tant sur le plan sectoriel que géographique.
Sans nier que l’avantage coût des Etats-Unis a eu un impact positif sur l’emploi et la production, nous constatons que les exportations de produits manufacturés et les relocalisations de sites de production, censés attester du regain de compétitivité américain, ont joué un rôle secondaire depuis 2010. Dans les prochaines années, l’industrie devrait continuer à afficher une croissance soutenue de l’emploi et de la production, puis un ralentissement prévisible dans les matériels de transport viendra freiner cette dynamique. A plus long terme, une controverse oppose ceux qui doutent de la capacité des Etats-Unis à conserver leur leadership dans le domaine des produits de haute technologie à ceux qui considèrent que, berceau des géants du digital, les Etats-Unis sont appelés à exercer une domination sans équivalent sur les futures activités créatrices de valeur, industrielles ou non. De même, on peut se demander si un rééquilibrage des activités de production peut émerger à la faveur d’une régionalisation de l’économie mondiale. Les Etats-Unis ne pourront pas rivaliser avec le coût du travail proposé par certains pays asiatiques, mais des contraintes de réactivité, de logistique, ou de flexibilité, associées à un recentrage de l’économie chinoise sur son marché intérieur, pourraient favoriser un certain retour du made in USA, ou du moins du made in Alena. Les cas anecdotiques de relocalisations seraient dès lors les prémices d’un vaste réarrangement mondial des activités de production.
Il reste des obstacles à surmonter, ayant trait notamment au recrutement et à la formation d’une main-d’œuvre de qualité. D’autres facteurs, extérieurs, (risque de déflation en zone euro et de crise financière dans certains pays émergents, tensions géopolitiques, etc.) pourraient également fragiliser la reprise américaine. Il n’en demeure pas moins que les Etats-Unis vivent quelque chose comme un « moment industriel », porté par un optimisme bénéfique et conquérant.
André Gauron – Renaissance industrielle : quelle définition ? – COMMENTAIRES
Ingénieur (ECP) et économiste de formation, André Gauron est conseiller maître honoraire à la Cour des comptes. Il a travaillé à l’INSEE et au Commissariat général au plan avant d’être conseiller de Pierre Bérégovoy aux affaires sociales et au ministère de l’économie et des finances. Il a été membre du CAE entre 1998 et 2002 et collabore depuis sa création à Lasaire, un laboratoire de recherche sur les questions sociales proche des organisations syndicales.
La note de Thibaut Bidet-Mayer et Philippe Frocrain analyse admirablement les facteurs qui expliquent le rebond actuel de l’industrie américaine. La reprise de la demande des ménages, tirée par celle de l’effet patrimoine, toujours très important aux Etats-Unis, en est le principal facteur. La note souligne aussi très justement la persistance des déséquilibres commerciaux, en dehors de l’aéronautique et des produits pétroliers raffinés, qui ne peut que fragiliser ce rebond. Peut-il être durable au-delà de 2015 ? La note reste prudente. Ce rebond serait-il durable, pourra-t-on pour autant parler de « renaissance » ? Les « obstacles à un renouveau », que pointe la note (déficit de qualifications, mauvaise image de l’industrie, etc.), ne me semblent pas à cet égard décisifs pour répondre à cette question. En réalité, la note ne répond pas totalement à son titre : rebond ou renaissance ? On comprend aisément le « rebond » qui accompagne la sortie de crise et la reprise économique américaine. Mais la note ne définit pas ce que serait une « renaissance ». La question est d’autant plus intéressante qu’elle ne concerne pas seulement l’industrie américaine. Elle se pose en termes similaires pour qualifier en France ce que peut être la réindustrialisation et, à l’inverse en Allemagne, pour savoir si la puissance industrielle actuelle est ou non durable.
On peut être tentés d’expliquer le recul de l’industrie aux Etats-Unis comme en Europe, mesuré par sa part dans la valeur ajoutée et dans l’emploi, par une succession de facteurs conjoncturels. On pense évidemment à la Chine, mais ce facteur ne joue pas avant la décennie 1980. Pour les années 1970, on peut relever la double hausse du prix du pétrole et les mouvements du dollar qui ont propulsé les taux d’intérêt américains à des niveaux records, très largement supérieurs à 10 %, qui ont évidemment pesé sur l’investissement. Ces facteurs sont importants et ne peuvent pas être négligés, mais ils masquent les transformations structurelles qui ont profondément affecté l’industrie dans tous les pays industrialisés.
Le premier facteur, peut-être le plus important, est la déstructuration/recomposition de la chaîne productive. La construction automobile, dont on connait le poids dans l’industrie, est sans doute le meilleur laboratoire de ce phénomène. Si on fait abstraction de l’introduction de l’électronique dans les véhicules, rien ne ressemble plus à une voiture de 1970 qu’une voiture de 2015, évolution des modèles mise à part. En revanche, la façon de produire le même véhicule est totalement différente. Hier, le constructeur produisait une grande partie des pièces assemblées mais, aujourd’hui, son activité se limite à concevoir, assembler et vendre. La chaîne productive a complètement éclaté pour se muer en une chaîne de valeur qui commande le découpage physique de la production. Certains seront tentés d’y voir uniquement le rôle pris par la finance, mais on peut aussi regarder cette évolution comme la poursuite (sans fin) de ce qui fait l’essence même du progrès industriel : la chasse aux temps morts, ou pour le dire autrement, la recherche de l’amélioration de la productivité de chaque segment de la production. Ce mouvement a été la réponse apportée à l’épuisement des effets du taylorisme/fordisme que l’on observe justement dans les années 1970. Les conflits autour de la question des OS qui se multiplient aussi bien en Europe qu’aux Etats-Unis pendant cette période témoignent de la limite atteinte par l’intensification du travail. De même que la crise de la manufacture du XIXe siècle avait donné naissance à la grande industrie, la crise du taylorisme débouche sur une profonde recomposition industrielle.
A partir des années 1980, on parle ainsi d’un mouvement d’externalisation. Celui-ci a une particularité : il est d’entrée un mouvement mondial. C’est le second facteur. Avec la chute drastique des coûts du transport international et la fin des changes fixes, il est possible de produire n’importe où en exploitant les avantages comparatifs de chaque site. La mondialisation c’est d’abord cela : une organisation mondiale évolutive d’une chaîne productive. Mais elle n’est pas identique dans tous les secteurs : l’aéronautique n’est pas l’automobile, et Apple, qui fait tout produire hors des Etats-Unis, n’est pas la machine-outil allemande, fer de lance de l’emploi industriel allemand. Pour saisir le devenir de l’industrie dans un pays, il faut ainsi saisir le mode d’organisation des entreprises et les lieux où elles investissent.
Il n’y aura pas de retour en arrière. Il n’y en a jamais eu. La segmentation de la production est une donnée de longue durée. Mais elle peut donner lieu à différentes localisations géographiques. La note entrevoit ce problème quand les auteurs parlent de la recherche d’une plus grande proximité des fournisseurs et dans le cas américain d’un basculement vers le Mexique. Ce qui manque à cette analyse, c’est la segmentation productive qui est derrière. Si on prend comme indicateur de l’organisation mondiale de la production la part des importations dans la valeur ajoutée d’un produit, l’augmentation de celle-ci ne permet pas de conclure à un mouvement de relocalisation. Au contraire.
Comment dans ce cadre définir la « renaissance » industrielle ? Pour cela, il faut répondre à la question : que veut-on faire ici et faire faire ailleurs ? A moins que l’on préfère l’autre façon de répondre à cette question : quelles sont les industries qui offrent la plus faible externalisation et qu’il devient essentiel de conserver ou d’attirer ? Il est possible d’ailleurs que la réponse ne soit pas identique selon le critère que l’on retient : valeur ajoutée, emploi, investissement (ce grand oublié de la note)… L’économie ne dit pas tout ; la gestion des entreprises dans sa dimension organisationnelle, a aussi beaucoup à nous apprendre.
Bibliographie
American Chemistry Council, 2014, « Year-End 2014 Chemical Industry Situation and Outlook », décembre.
Andes S., Fikri K., Lee J., Marchio N., Muro M., Ross M., Ruiz G., 2013, « Drive ! Moving Tennessee’s Automotive Sector Up the Valve Chain », Advanced Industries Series, n°20, The Brookings Institution.
A.T. Kearney, 2014, « Reshoring Index: Down 20 Basis Points Year-over-Year From 2013. Uncovers What Manufacturers Are Actually Doing ».
Atkinson R., Stewart L., Andes S., Ezell S., 2012, « Worse Than the Great Depression: What Experts Are Missing About American Manufacturing Decline », ITIF, mars.
Atkinson R., Nager A., 2015, « The Myth of America’s Manufacturing Renaissance: The Real State of U.S. Manufacturing », ITIF, janvier.
Autor D., Dorn D., Hanson G., 2011, « The China Syndrome: Local Labor Market Effects of Import Competition in the United States », American Economic Review, 103(6): 2121-68.
Baily M., Bosworth B., 2014, « US Manufactuing: Understanding Its Past and Its Potential Future », Journal of Economic Perspectives, vol. 28, n°1.
BCG, 2013, « Majority of Large Manufacturers Are Now Planning or Considering ‘Reshoring’ from China to the U.S. », Communiqué de presse, 24 septembre.
Berger S., 2013, « Making in America », MIT Press.
Board of Governors of the Federal Reserve System, 2014, « Changes in US family finances from 2010 to 2013: evidence from the survey of consumer finances », Federal reserve Bulletin, vol. 100, n°4, septembre.
Bordigoni M., 2013, « L’impact du coût de l’énergie sur la compétitivité de l’industrie manufacturière », Document de travail, CERNA, Mines ParisTech.
Bourdoncle F., 2014, « La révolution big data », dans L’Industrie, notre avenir, Eyrolles.
Canis B., Webel B., 2013, « The Role of TARP Assistance in the Restructuring of General Motors », Congressional Research Service.
Celasun O., Di Bella G., Mahedy T., Papageorgiou C., 2014, « The U.S. Manufacturing Recovery: Uptick or Renaissance ? », IMF Working Paper, WP/14/28.
Commission européenne, 2014, « Energy prices and costs in Europe », SWD(2014) 20 final/2, mars.
Cornot-Gandolphe S., 2013, « Impact du développement du gaz de schiste aux Etats-Unis sur la pétrochimie européenne », IFRI, octobre.
Daziano L., « La ré-industrialisation américaine : le début d’un nouveau cycle économique ? », Géoéconomie, n°65, Institut Choiseul, été 2013.
Delmas P., Roy G., 1989, « Industrie américaine : la faiblesse au cœur », Stratégies industrielles, Cepii.
Deloitte, Manufacturing Institute, 2011, « Boiling Point? The Skills Gap in U.S. Manufacturing », septembre.
Deloitte, Manufacturing Institute, 2012, « U.S. public opinions on manufacturing », Annual index.
Diez F., Gopinath G., 2014, « The Competitiveness of U.S. Manufacturing », FRB Boston Current Policy Perspectives Series, 14-3.
Distinguin S., 2014, « #Code, une rupture culturelle programmée », dans L’Industrie, notre avenir, Eyrolles.
Durand M., 2013, « Un nouveau regard sur la mondialisation : mesurer les échanges en valeur ajoutée », Problèmes économiques, n° spécial, novembre.
EIA, 2013a, « Annual Energy Outlook 2013 with Projections to 2040 », avril.
EIA, 2013b, « World Energy Outlook 2013 ».
EIA, 2014, « Annual Energy Outlook 2014. Early Release Overview », mai.
Ellram L., Tate W., Petersen K., 2013, « Offshoring and Reshoring: An Update on the Manufacturing Location Decision », Journal of Supply Chain Management, 49: 14-22.
FMI, 2013, « Macroeconomic Implications of the U.S. Energy Boom », IMF Country Report n°13/237, Selected Issues, juillet.
Gazaniol A., 2012, « Internationalisation, performances des entreprises et emploi », La Fabrique de l’industrie.
George K., Ramaswamy S., Rassey L., 2014, « Next Shoring: A CEO’s guide », McKinsey Quarterly, janvier.
Giraud P.-N., 1996, « L’inégalité du monde. Économie du monde contemporain », Gallimard, Paris, Folio essais.
Giraud P.-N., 2012, « La mondialisation. Emergences et fragmentations », Sciences Humaines Editions.
Gray J., Skowronski K., Esenduran G., Rungtusanatham M., 2013, « The Reshoring Phenomenon: What Supply Chain Academics Ought to know and Should Do », Journal of Supply Chain Management, 49(2), 27–33.
Helper S., Krueger T., Wial H., 2012, « Locating American Manufacturing: Trends in the Geography of Production », The Brookings Institution.
Henderson R., 2013, « Industry employment and output projections to 2022 », Bureau of Labor Statistics, décembre.
Houseman et al., 2011, « Offshoring Bias in U.S. Manufacturing », Journal of Economic Perspectives, 25(2): 111-132.
Houseman et al., 2013, « Measuring Manufacturing: Problems of Interpretation and Biases in U.S. Statistics », présentation préparée pour la conférence sur la mesure des effets de la mondialisation, 28-février-1er mars, Washington, DC.
Houseman S., Bartik T., Sturgeon T., 2014, « Measuring Manufacturing: How the Computer and Semiconductor Industries Affect the Numbers and Perceptions », Upjohn Institute Working Paper, 14-209.
Houser T., Mohan S., 2014, « Fueling up: The Economic Implications of America’s Oil and Gas Boom », Peterson Institute for International Economics, janvier.
IHS, 2012a, « America’s New Energy Future: The Unconventional Oil and Gas Revolution and the US Economy », volume 1, octobre.
IHS, 2012b, « America’s New Energy Future: The Unconventional Oil and Gas Revolution and the US Economy », volume 2, décembre.
Institut Montaigne, 2014, « Gaz de schiste : comment avancer ? », juillet.
Klier T., Rubenstein J., 2012, « Detroit back from the brink? Auto industry crisis and restructuring, 2008-11 », Federal Reserve Bank of Chicago, Economic Perspectives, issue Q II, pages 35-54.
Klier T., Rubenstein J., 2013, « The Growing Importance of Mexico in North America’s Auto Production », Chicago Fed Letter, n°310, mai.
Klier T., 2014, « Evolving Geography of Automobile Manufacturing in North America», Global Economic Forum San Antonio, Texas, juin.
Klossa G., Guillon S., 2012, « Le nouvel impératif industriel », Mission Innovation et production en Europe, Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, mai.
Le Corre P., Sepulchre A., 2015, « L’offensive chinoise en Europe », Fayard, janvier.
Le Monde, 2014, « Fiat avale Chrysler et ses 12 milliards de dollars de trésorerie », article du 2 janvier 2014.
Levinson M., 2011a, « “Hollowing Out” in U.S. Manufacturing: Analysis and Issues for Congress», CRS Report R41712, Washington: Congressional Research Service.
Levinson M., 2011b, « U.S. Manufacturing in International Perspective », CRS Report 7-5700. Washington: Congressional Research Service.
Locke R., Wellhausen R., 2014, « Production in the innovation economy », MIT Press.
Ludwig H., Spiegel E., 2014, « La vraie renaissance de l’industrie », L’Expansion Management Review, 2014/4 N°155, p. 50-61.
Manning & Napier, 2012, « The U.S. Manufacturing Renaissance: Silver Lining, Not Silver Bullet », Outlook Series, mai.
Meade D., 2010, « Why Real Value Added Is Not My Favorite Concept », Studies on Russian Economic Development, volume 21, Issue 3, pp 249-262.
Meckstroth D., 2014a, « U.S Industrial Outlook: Growth Mode », Manufacturers Alliance for Productivity and Innovation, septembre.
Meckstroth D., 2014b, « U.S Industrial Outlook : Widespread Growth Ahead », Manufacturers Alliance for Productivity and Innovation, décembre.
Melick W., 2014, « The Energy Boom and Manufacturing in the United States », Board of Governors of the Federal Reserve System, International Finance Discussion Paper, 1108, juin.
National Research Council, 2012, « Rising to the Challenge: U.S. Innovation Policy for the Global Economy », The National Academies Press.
Nicholson J., Noonan R., 2014, « Manufacturing Since the Great Recession », U.S. Department of Commerce, Economics and Statistics Administration, juin.
OCDE, 2009, « L’industrie automobile pendant et après la crise », Perspectives économiques de l’OCDE, 2009/2 (n°86), chapitre 2.
OCDE, 2013, « Interconnected Economies : Benefiting from Global Value Chains », Éditions OCDE, Paris.
OCDE, 2014, « Perspectives économiques de l’OCDE », volume 2014/1, version préliminaire, page 42.
Philips M., Bachman J., 2014, « Made in Memphis », Bloomberg Businessweek, août.
Pisano G.P., Shih W.C., 2009, « Restoring American Competitiveness », Harvard Business Review 87(7-8), 114-125.
Pisano G.P., Shih W.C., 2012, « Producing Prosperity: Why America Needs a Manufacturing Renaissance », Harvard Business Press.
Randle M., 2014, « Chinese investment surfacing in the South? Yes, finally », Southern Business & Development.
Rice J., Stefanelli F., 2014, « Reshoring: New Day, False Dawn, or Something Else? », Industry Week, 19 septembre.
Rosen D., Hanemann T., 2011, « An American Open Door? Maximizing the Benefits of Chinese Foreign Direct Investment », Asia Society, mai.
Rosen D., Hanemann T., 2014, « New realities in the US-China Investment relationship », Rhodium Group.
Sargent J., 2014, « The Obama Administration’s Proposal to Establish a National Network for Manufacturing Innovation », Congressional Research Service, janvier.
Simchi-Levi D., 2012, « U.S Re-shoring: A Turning Point », MIT Forum.
Sirkin H., Zinser M., Hohner D., Rose J., 2012, « U.S. Manufacturing Nears the Tipping Point », Boston Consulting Group study, mars.
Sirkin H., Zinser M., Rose J., 2013, « The U.S. Skills Gap: Could It Threaten a Manufacturing Renaissance? », Boston Consulting Group, août.
Spence M., Hlatshwayo S., 2012, « The Evolving Structure of the American Economy and the Employment Challenge », Comparative Economic Studies, Palgrave Macmillan, vol. 54(4), pages 703-738, décembre.
Sperling G., 2013, « The Case for a Manufacturing Renaissance », The Brookings Institution, juillet.
Tassey G., 2014, « Competing in Advanced Manufacturing: The Need for Improved Growth Models and Policies », Journal of Economic Perspectives, 28(1): 27-48.
The Reshoring Initiative, 2014, « The Reshoring Initiative’s Recommendations for the Federal Government », The Reshoring Initiative Blog, 12 août.
The Washington Post, 2013, « With Mexican auto manufacturing boom, new worries », article du 1er juillet 2013.
The White House, 2012, « President Obama to Announce New Efforts to Support Manufacturing Innovation, Encourage Insourcing », communiqué de presse du 9 mars.
Van den Bossche P., Gupta P., Gutierrez H., Gupta A., 2014, « Solving the Reshoring Dilemma », Supply Chain Management Review, janvier.
Xing Y., Detert N., 2010, « How the iPhone Widens the United States Trade Deficit with the People’s Republic of China. », ADBI Working Paper 257, Tokyo: Asian Development Bank Institute.
Xu Y., 2015, « The Post-Recession State of U.S. Manufacturing », Manufacturers Alliance for Productivity and Innovation, mars.
Annexes
Annexe 1. Eléments de cadrage
Poids des secteurs en pourcentage du PIB de l’industrie manufacturière en 2013
Source : Bureau of Economic Analysis, calculs des auteurs
Composition de l’emploi industriel en 2013
Source : Bureau of Economic Analysis, calculs des auteurs
Taux de croissance annuel moyen de la valeur ajoutée réelle aux Etats-Unis117
Source : Bureau of Economic Analysis, calculs des auteurs
Annexe 2. Incertitudes statistiques sur l’état réel du secteur manufacturier
Entre 2000 et 2007, l’emploi industriel américain a fortement chuté alors même que l’on enregistrait un taux de croissance annuel moyen de la production de 3,3 %. L’explication généralement avancée est celle d’une forte progression de la productivité résultant d’une automatisation croissante. Or, il est possible, en raison de biais statistiques, que la croissance de la productivité et par conséquent la croissance de la valeur ajoutée réelle aient été surestimées.
A. Production, intrants intermédiaires, valeur ajoutée et productivité
Afin de comprendre l’origine des biais nous devons d’abord présenter rapidement les notions de production, d’intrant intermédiaire et de valeur ajoutée.
On utilise le terme de production (output) pour faire référence aux quantités produites, au chiffre d’affaires ou à la valeur ajoutée118. La production est donc dans ce cadre une valeur monétaire. Il est toutefois nécessaire de corriger la valeur de la production des variations de prix (à l’aide d’indices de prix) lorsque l’on veut réaliser des comparaisons inter-temporelles. On parle alors de production réelle.
En plus de ces corrections, les agences officielles américaines réalisent des ajustements afin de prendre en compte les progrès réalisés dans la qualité des produits, qui correspondent globalement à des améliorations technologiques. Une augmentation de la production réelle résulte donc à la fois de l’augmentation du nombre d’unités vendues et d’une meilleure « qualité » du produit.
∆ production réelle = ∆ unités vendues + ∆ qualité (1)
Les intrants intermédiaires sont les biens et services utilisés dans la production d’autres biens et services. Comme pour la production, il est possible de calculer la valeur réelle de ces intrants à l’aide d’indices de prix.
La valeur ajoutée correspond à la différence entre le chiffre d’affaires et la valeur des intrants intermédiaires. La somme des valeurs ajoutées sur un territoire en représente le PIB. Comme dans le cas de la production, la valeur ajoutée réelle prend en compte les changements de prix et de qualité à l’aide d’indices. La fiabilité de ces indices est déterminante. Si, par exemple, la correction de la production est inadaptée, l’estimation de la valeur ajoutée réelle sera d’une qualité douteuse.
∆ valeur ajoutée réelle = ∆ production réelle − ∆ intrants intermédiaires réels (2)
La productivité représente le rendement de tous les facteurs de production. Une croissance de la productivité correspond donc à la croissance de la production qui n’est pas due à une croissance des intrants intermédiaires.
∆ production réelle = ∆ productivité + ∆ intrants intermédiaires réels (3)
En utilisant (3) dans (2) :
∆ valeur ajoutée réelle = ∆ productivité (4)
Ou en combinant (1) et (2) :
∆ valeur ajoutée réelle = ∆ unités vendues + ∆ qualité − ∆ intrants intermédiaires réels
B. Le recours croissant aux biens intermédiaires importés à l’origine de biais
La dynamique des prix des biens intermédiaires s’explique beaucoup par l’expansion de fournisseurs low cost. Or, la part des biens intermédiaires importés est passée de 17 % en 1997 à 25 % en 2007. Les pays en développement, et en particulier la Chine, expliquent la moitié de cette augmentation.
Le Bureau of Labor Statistics construit des indices afin de prendre en compte les changements dans le prix de ces biens. Houseman et al. (2011) avancent cependant que ces indices ne rendent pas compte de l’impact du recours croissant aux fournisseurs meilleur marché. En conséquence, le recours aux biens intermédiaires importés réels est sous-estimé ce qui entraine un gonflement artificiel de la productivité et de la valeur ajoutée réelle.
Illustration
Janvier : L’industriel est le seul producteur pour le secteur considéré et ne produit qu’une seule unité du produit. Ce produit est vendu 50 dollars et incorpore 5 inputs intermédiaires coutant 2 dollars pièce, soit un montant d’inputs intermédiaire mesurée par les autorités de 10 dollars.
Février : Imaginons que l’industriel fasse désormais appel à un fournisseur concurrent proposant des inputs similaires à 1 dollar pièce. Les agences officielles vont constater que le producteur utilise désormais 5 dollars d’inputs pour le même produit qui coûte 50 dollars. Toutefois, elles n’ont pas enregistré la baisse du prix des inputs intermédiaires et considèrent que moins d’inputs ont été utilisés. Conséquence : la productivité et la valeur ajoutée réelle ont apparemment augmenté entre janvier et février. En réalité, la valeur ajoutée réelle n’a pas augmenté : en utilisant un indice de prix approprié on aurait dû rendre compte du changement dans les prix119.
Houseman et al. estiment que la croissance annuelle moyenne de la valeur ajoutée réelle du secteur manufacturier a pu être surestimée de 18 %.
C. Une croissance du secteur de l’informatique et de l’électronique qui reflète des gains en qualité
Selon les statistiques, la valeur ajoutée réelle dans l’informatique et l’électronique a été multipliée par 5,17 entre 2000 et 2010 – soit une augmentation de 417 %. L’ITIF montre que la croissance dans ce secteur explique 15 % de la croissance du PIB américain sur la période. Il souligne également qu’il est difficile de croire qu’on ait produit cinq fois plus d’ordinateurs aux Etats-Unis entre 2000 et 2010 qu’au cours de la précédente décennie, alors même que dans ce secteur l’emploi a diminué de plus de 40 % et qu’une part non négligeable de la production a été délocalisée.
Houseman et al. (2014) avancent que la croissance de la valeur ajoutée réelle de ce secteur s’explique principalement par une augmentation de la qualité des produits. L’ITIF montre en effet que les ventes en valeur ont diminué de 65 % entre 1992 et 2011 et que le nombre d’unités exportées n’a pas augmenté.
Typiquement, un accroissement dans la qualité correspond pour un ordinateur à une augmentation de la puissance de calcul à prix inchangé. Si l’on peut comprendre que, du point de vue du consommateur, ces progrès dans la qualité soient très importants, ils ont tendance à fausser les interprétations sur l’état du secteur manufacturier. En effet, l’essentiel de la croissance de la valeur ajoutée réelle de l’industrie est générée par ce secteur. Par conséquent, la croissance de l’industrie s’explique principalement par des gains de qualité dans un secteur bien particulier et non par une croissance des volumes produits.
En corrigeant ces deux biais, l’ITIF suggère que le PIB industriel a reculé de 11 % entre 2000 et 2010, alors que les données officielles montrent une progression de 15,5 %120. Le secteur de l’informatique et de l’électronique se voit appliquer les corrections les plus importantes : la croissance dans ce secteur passe de 417 à 28 % pour la période (ce qui en fait encore un secteur très dynamique). Le biais lié à l’importation de biens intermédiaires est prévalent dans les machines, les métaux primaires et l’automobile.
D. Conclusion
En conclusion, la globalisation génère des changements rapides et difficiles à mesurer. Les biais sont connus par les agences officielles mais elles doivent réaliser des arbitrages méthodologiques, et les corrections demandent du temps et des moyens. L’aspect le plus problématique est que ces bais peuvent fausser significativement l’analyse du secteur manufacturier. C’est un axe de travail très important car ces données représentent la matière première de nombreuses études. Gardons cependant garder à l’esprit qu’on ne peut pas avoir une mesure parfaite.
Annexe 3. Analyse de la balance commerciale
Solde de la balance des biens et services (en milliards de dollars)
Source : Bureau of Economic Analysis
Les années 2000 ont été caractérisées par un accroissement du déficit commercial américain. En décomposant, on observe que la balance des services présente un excédent croissant au fil des années : il s’élevait en 2014 à plus de 230 milliards de dollars. Celui-ci ne compense néanmoins pas l’immense déficit de la balance des biens (736 milliards de dollars en 2014). La facture énergétique, et plus précisément les importations de pétrole, explique à elle seule environ un quart du déficit de la balance des biens. On voit donc bien que, même sans cette facture pétrolière colossale, les Etats-Unis seraient largement déficitaire sur le plan commercial du fait d’un très large déficit dans les biens manufacturés.
Balance commerciale des biens manufacturés (en milliards de dollars)
Source: OCDE (STAN)
Cette situation n’est pas nouvelle : le solde de la balance des biens manufacturés est systématiquement déficitaire depuis 1990. A partir de la fin des années 1990, les importations ont augmenté à un rythme beaucoup plus soutenu que les exportations, ce qui a creusé le déficit. En 2006, le déficit des échanges de biens manufacturés a atteint un niveau record de 618 milliards de dollars.
Les réalités sont néanmoins différentes selon les secteurs. L’industrie textile, l’informatique et l’électronique ou encore l’automobile pèsent fortement sur le solde commercial américain. Le développement du commerce avec les pays en développement, et plus particulièrement l’entrée de la Chine dans l’OMC, a eu un impact direct sur l’accroissement des déficits dans le textile et les TIC. Parallèlement, on assiste à une augmentation des excédents dans l’aéronautique, la chimie, et plus récemment dans les produits raffinés.
Entre 2010 et 2014, les exportations ont augmenté plus rapidement que les importations mais le déficit s’est en réalité creusé puisqu’elles partaient d’un niveau largement inférieur. Alors que les activités de cokéfaction et de raffinage ont boosté les exportations, les Etats-Unis ont notamment augmenté leurs importations de véhicules automobiles, d’ordinateurs, produits électroniques et optiques.
Variation des exportations et des importations entre 2010 et 2014 (en milliards de dollars et en %)
Source: OCDE (STAN)
Variation des exportations et des importations par secteur (en milliards de dollars et en %)
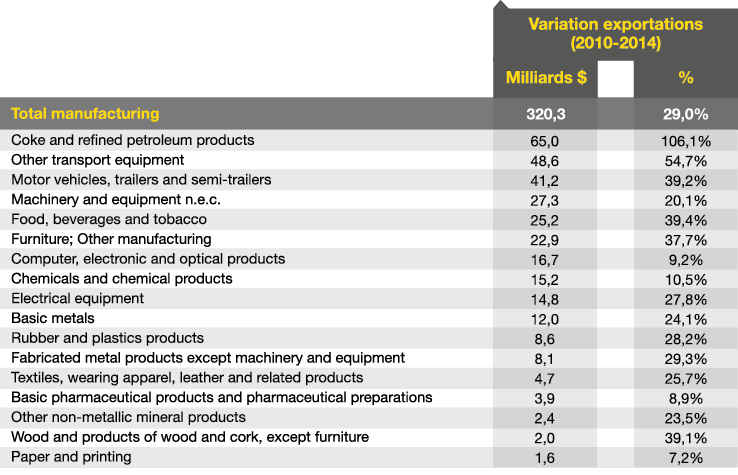
Source: OCDE (STAN)
Annexe 4. Mieux comptabiliser les échanges commerciaux : l’analyse du commerce en valeur ajoutée
L’OCDE et l’OMC ont créé une base de données permettant de mieux analyser les échanges commerciaux en proposant une comptabilisation en valeur ajoutée. L’analyse du commerce international a en effet été bouleversée par l’émergence de chaînes de valeur mondiales. La fragmentation géographique du processus de production a engendré une croissance des échanges de biens intermédiaires. Au cours de son processus de transformation, un produit traverse ainsi bien souvent un grand nombre de frontières. Les données traditionnelles, mesurant les mouvements transfrontaliers, peuvent donc donner une image trompeuse de la nature du commerce international et amplifier l’importance des économies spécialisées en aval des chaînes de valeur. Ce phénomène est illustré par le schéma suivant :
Source: OCDE (2013)
La comptabilité traditionnelle enregistre un excédent commercial de 100 du pays A vis-à-vis du pays B (et donc un déficit de 100 de B vis-à-vis de A), et un déficit de 110 du pays C vis-à-vis du pays B (et donc un excédent de 110 de B vis-à-vis de C). La comptabilité proposée par l’OCDE enregistre les flux en termes de valeur ajoutée de sorte que la relation (indirecte) entre A et C apparaît très clairement. Elle permet donc d’identifier qui est à l’origine de la valeur ajoutée et d’éviter un double comptage.
La mesure du commerce en valeur ajoutée ne modifie pas la balance commerciale globale mais la répartition des excédents et déficits entre les différents partenaires et secteurs. Les données permettent par ailleurs d’identifier le contenu domestique et étranger dans les importations et les exportations. Ainsi on trouvera :
- de la valeur ajoutée étrangère dans les exportations, car des biens intermédiaires produits à l’étranger seront inclus dans le produit vendu ;
- de la valeur ajoutée domestique dans les importations car des biens intermédiaires produits sur le territoire auront été assemblés à l’étranger et réimportés dans le produit final.
Ces données sont encore imparfaites et ne couvrent que les années 1995, 2000, 2005, 2008 et 2009 mais on peut déjà en tirer un certain nombre d’enseignements.
On constate d’abord que le contenu en valeur ajoutée domestique des exportations varie dans le temps et selon les pays (cf. graphique suivant). La tendance à la baisse de la part domestique, observée depuis 1995, s’explique par le recours croissant aux biens intermédiaires étrangers. Même si les Etats-Unis sont concernés par cette tendance, la part domestique de la valeur ajoutée de leurs exportations (89 % en 2009) est sensiblement plus élevée que celle de la France (75 %), de l’Allemagne (73 %) ou du Japon (85 %). La part plus faible de valeur ajoutée domestique dans les exportations de la Chine ou de la Corée s’explique par leur positionnement dans les chaînes de valeur mondiales. Martine Durand, chef statisticien et directrice des statistiques à l’OCDE, explique ainsi qu’« un tiers de l’ensemble des exportations chinoises en 2009 contenaient des produits étrangers, contre 12 % en 1995, du fait, dans une large mesure, de la spécialisation du pays dans l’assemblage et la fabrication de composants électroniques »121. Les positions dans la chaîne de valeur peuvent changer, ceci semble être le cas pour la Chine depuis 2005, « témoignant d’un déplacement vers le haut dans la chaîne de valeur, comme c’est le cas aussi pour d’autres pays à faibles coûts de main-d’œuvre comme le Cambodge par exemple »122.
Les données montrent que le déficit commercial des Etats-Unis vis-à-vis de la Chine est moins important lorsqu’on le mesure en termes de valeur ajoutée. En 2008, l’écart entre le solde brut et le solde en valeur ajoutée était de 75 milliards de dollars. Le déficit américain vis-à-vis de la Chine se réduit donc de 30 % avec la nouvelle mesure. Ceci s’explique en partie par l’augmentation de la part de la valeur ajoutée réalisée aux Etats-Unis dans la consommation chinoise. La raison principale est l’important contenu en biens étrangers des exportations chinoises par rapport au contenu en biens étrangers des exportations américaines vers la Chine. A l’inverse, le déficit commercial américain augmente de 14 milliards vis-à-vis du Japon et de 39 milliards vis-à-vis de l’Union européenne.
Part de la valeur ajoutée domestique contenue dans les exportations pour une sélection de pays
Source : OCDE-OMC (TiVA)
Solde de la balance commerciale américaine vis-à-vis des principaux partenaires en 2008 (en milliards de dollars)
Note : Nous étudions ici l’année 2008 car 2009 est marquée par une chute brutale du commerce international.
Source : OCDE-OMC (TiVA)
Solde de la balance commerciale selon les secteurs en 2008 (en milliards de dollars)
Source : OCDE-OMC (TiVA)
Conclusion
La nouvelle comptabilité en valeur ajoutée donne une image différente des déséquilibres américains. Le rôle de la Chine, même s’il reste majeur, se réduit, alors que celui du Japon et de l’Union européenne grandit. Les données de l’OCDE mettent également en lumière le rôle majeur des services dans le commerce international. Une part importante de la valeur des biens manufacturés est en effet attribuable au secteur des services, preuve que la distinction entre industrie et service n’a véritablement plus aucun sens.
Quoi qu’il en soit, les Américains consomment plus qu’ils ne produisent, et la baisse du dollar au cours des années 2000 n’a pas enrayé cette dynamique. Le déficit ne devrait pas se résorber très rapidement, il pourrait même s’accroître en raison de la vigueur relative de l’économie américaine123. Un recentrage des économies asiatiques sur leur marché intérieur pourrait permettre un rééquilibrage « en douceur » de la balance commerciale américaine. Ce déficit chronique, financé par des excédents commerciaux étrangers, fait régulièrement resurgir les prédictions d’un effondrement du dollar. On aurait pu s’attendre à une fragilisation de la monnaie américaine en raison de l’accumulation des déficits commerciaux et de la crise des subprimes. Il n’en est rien, le dollar reste une valeur refuge.
- 117 – Rappelons que le PIB peut être considéré comme la somme des valeurs ajoutées (brutes). La valeur ajoutée réelle ne prend pas en compte les variations de prix (inflation ou déflation).
- 118 – Dans la suite, la production correspond au chiffre d’affaires.
- 119 – En revanche, la valeur ajoutée nominale a augmenté : elle est passée de 40 à 45 dollars. Toutes choses égales par ailleurs, la baisse du prix des biens intermédiaires a bénéficié à l’industriel qui a vu sa marge augmenter.
- 120 – L’ITIF souligne également que la croissance de la valeur ajoutée réelle est surestimée pour le secteur de la cokéfaction et des produits pétroliers raffinés. Ce biais est corrigé dans l’étude. Toutefois nous ne le présenterons pas car l’origine de ce biais est incertaine.
- 121 – Durand M., 2013.
- 122 – Ibid.
- 123 – La demande aux Etats-Unis est notamment plus dynamique qu’en zone euro. Les importations américaines ont ainsi tendance à augmenter plus rapidement que les importations européennes.
Thibaut Bidet-Mayer et Philippe Frocrain, Lʼindustrie américaine : simple rebond ou renaissance ?, Paris, Presses des MINES, 2015.
ISBN : 978-2-35671-215-8
© Presses des MINES – TRANSVALOR, 2015
60, boulevard Saint-Michel – 75272 Paris Cedex 06 – France presses@mines-paristech.fr
www.pressesdesmines.com
© La Fabrique de lʼindustrie
81, boulevard Saint-Michel -75005 Paris – France info@la-fabrique.fr
www.la-fabrique.fr