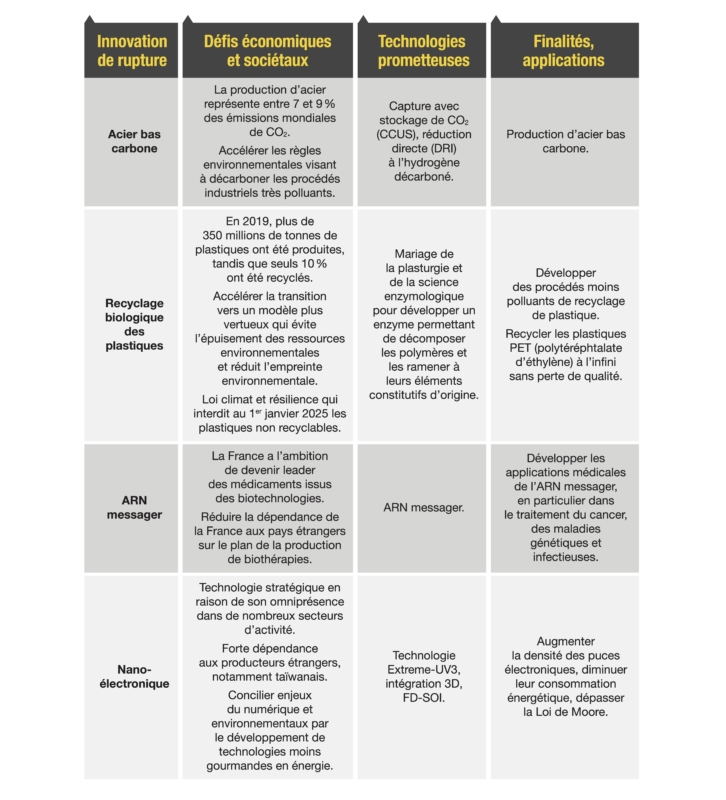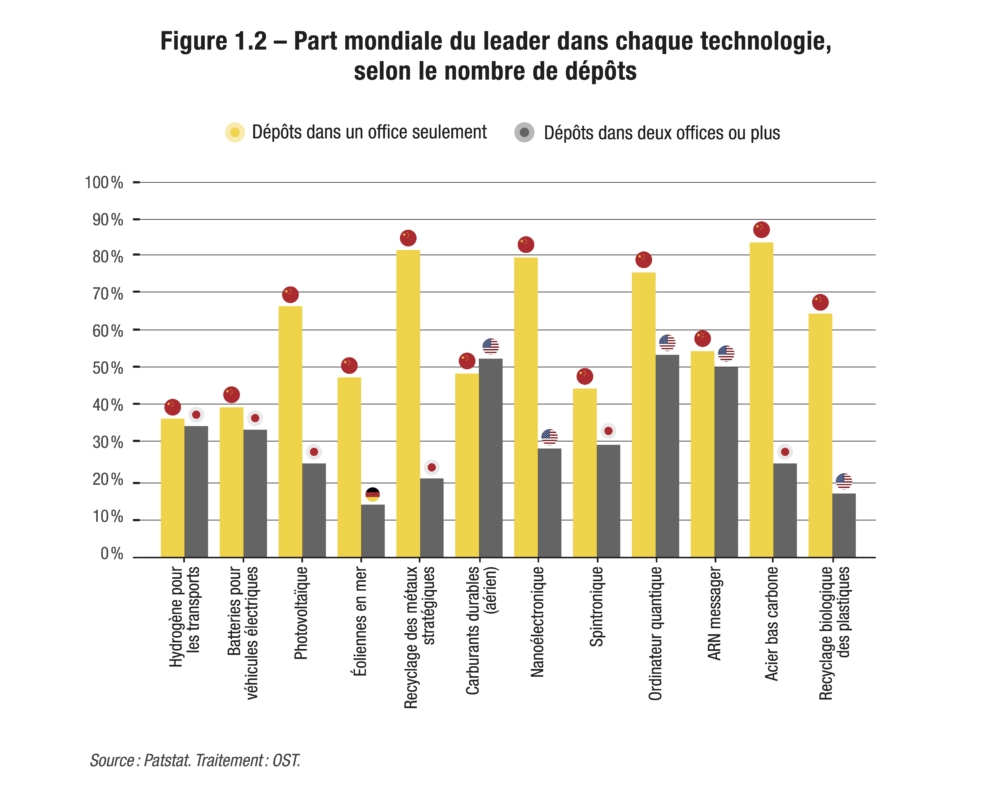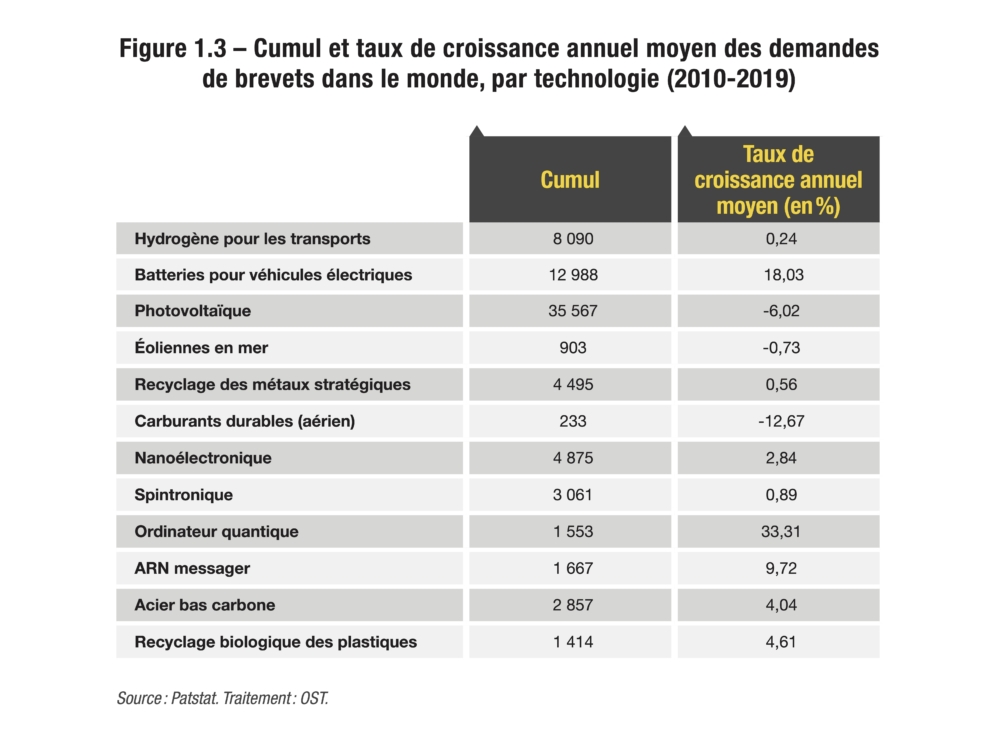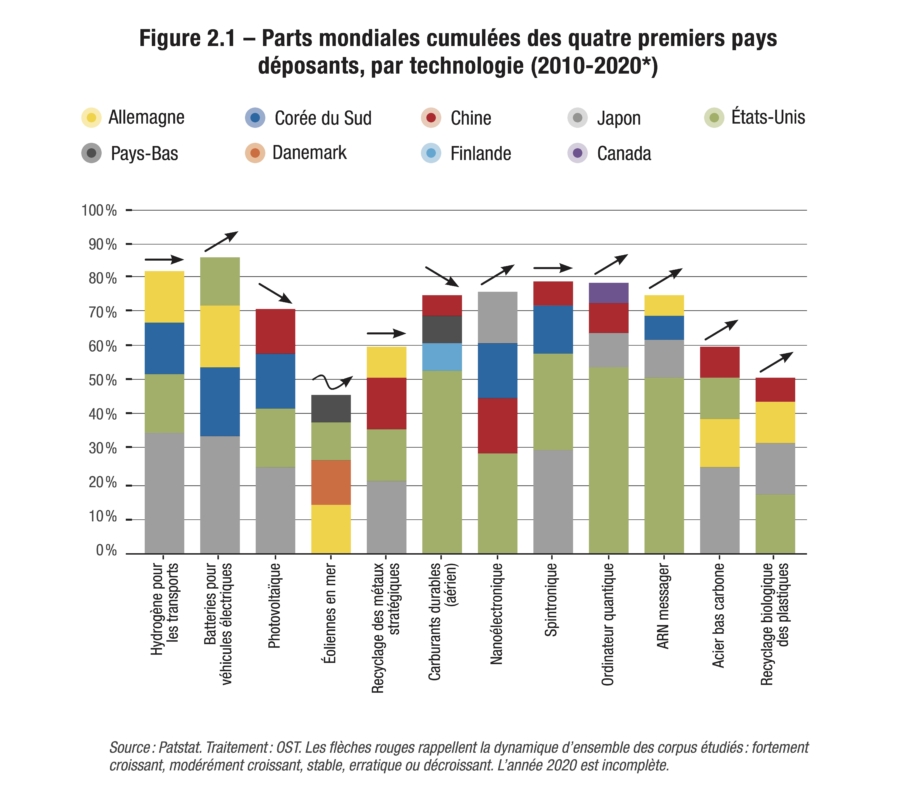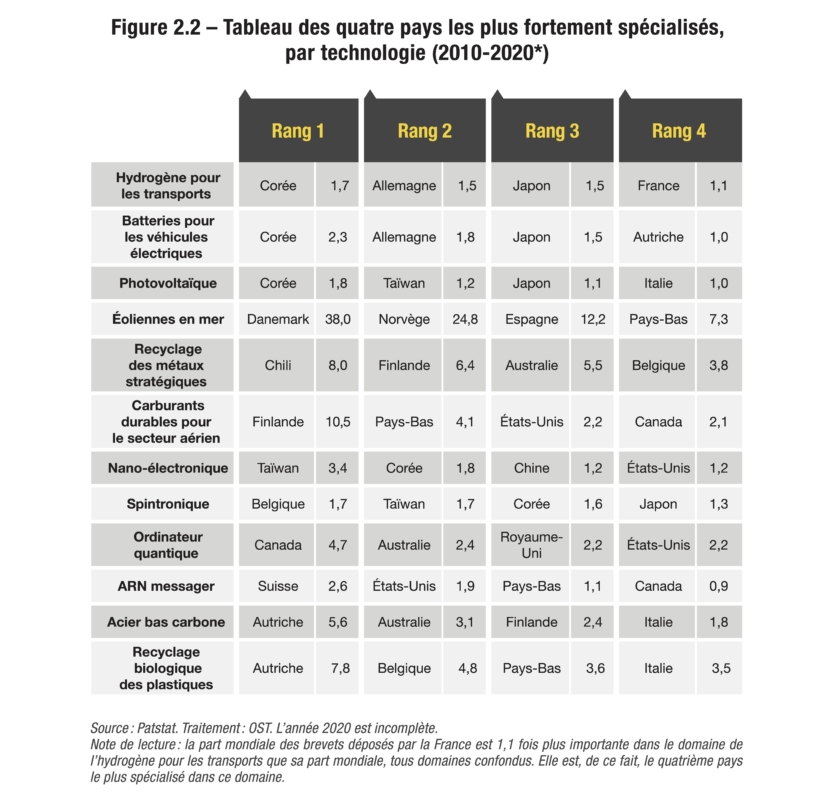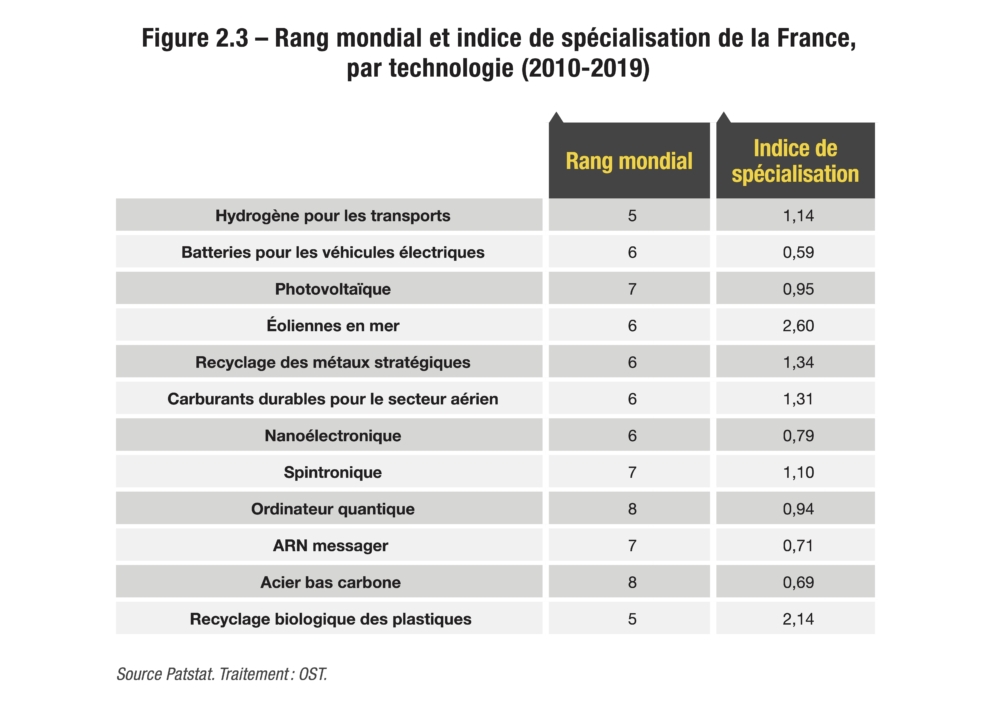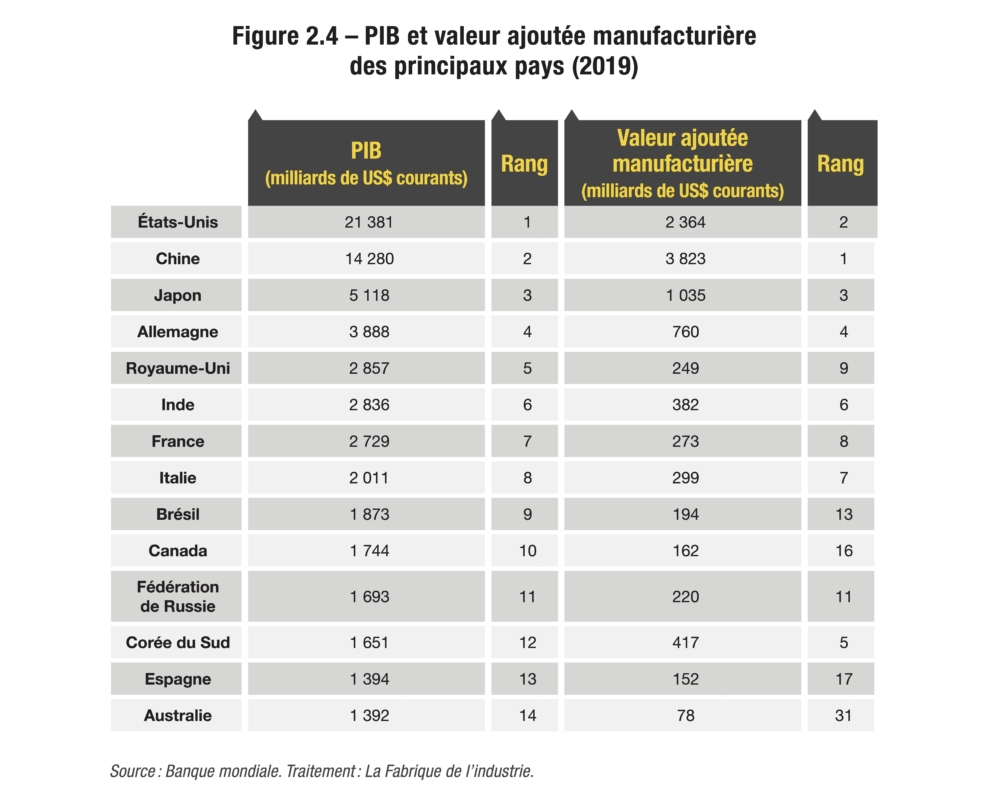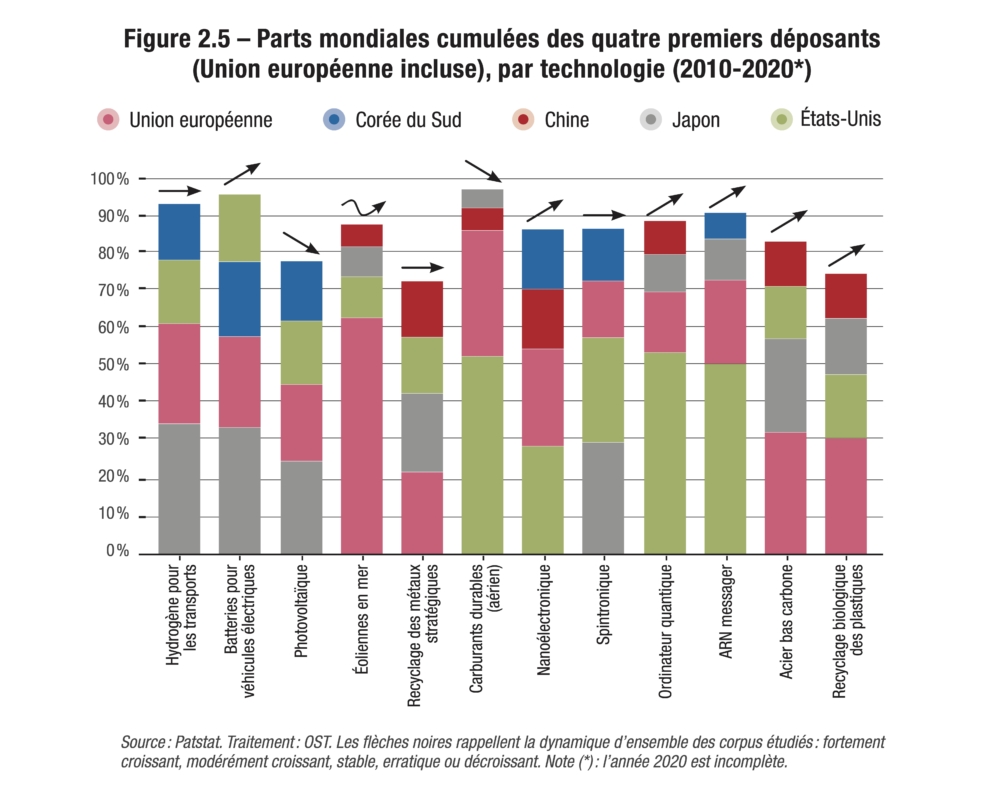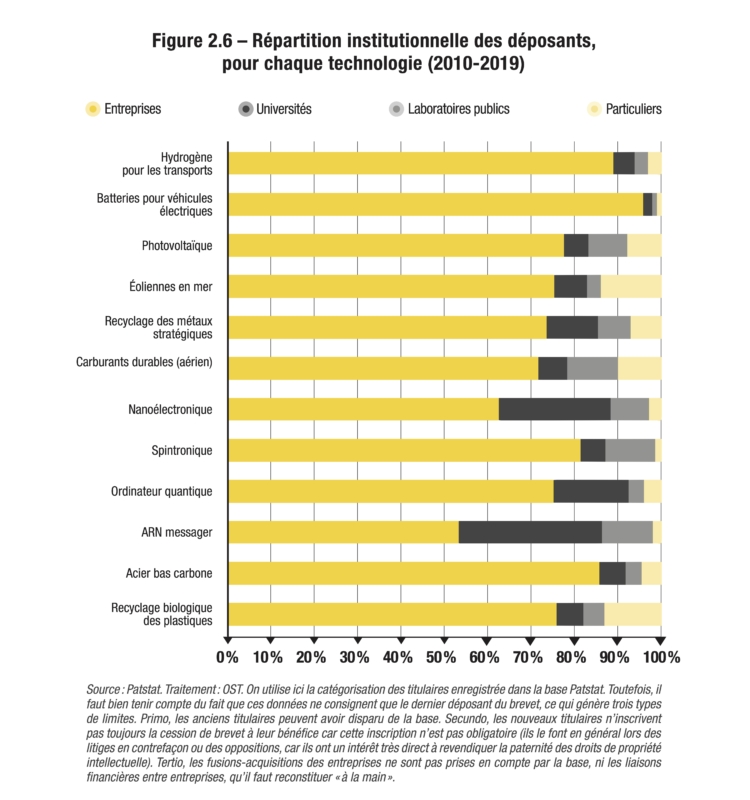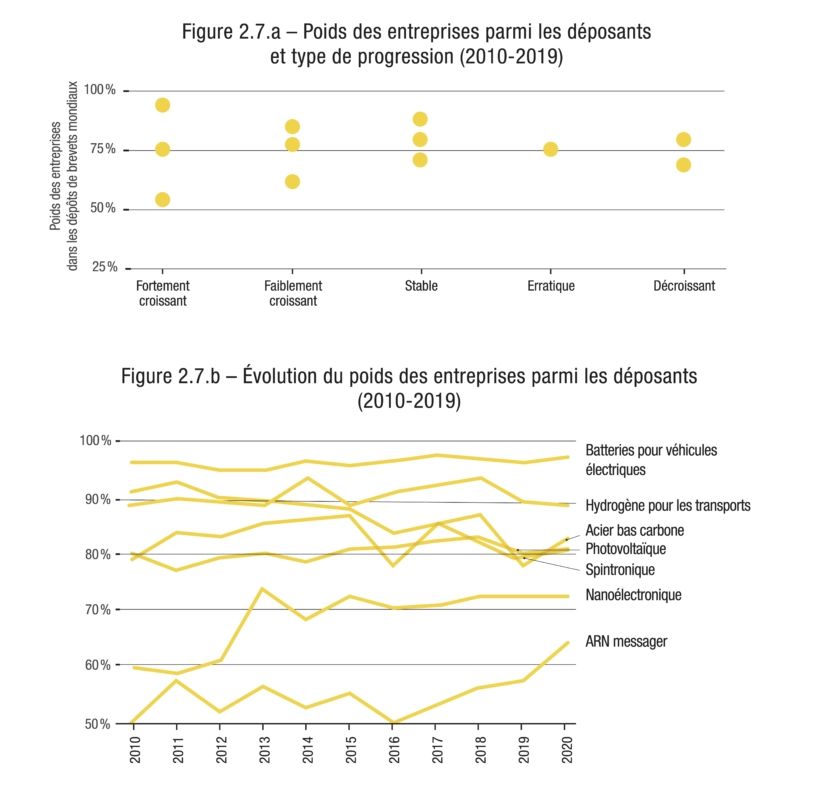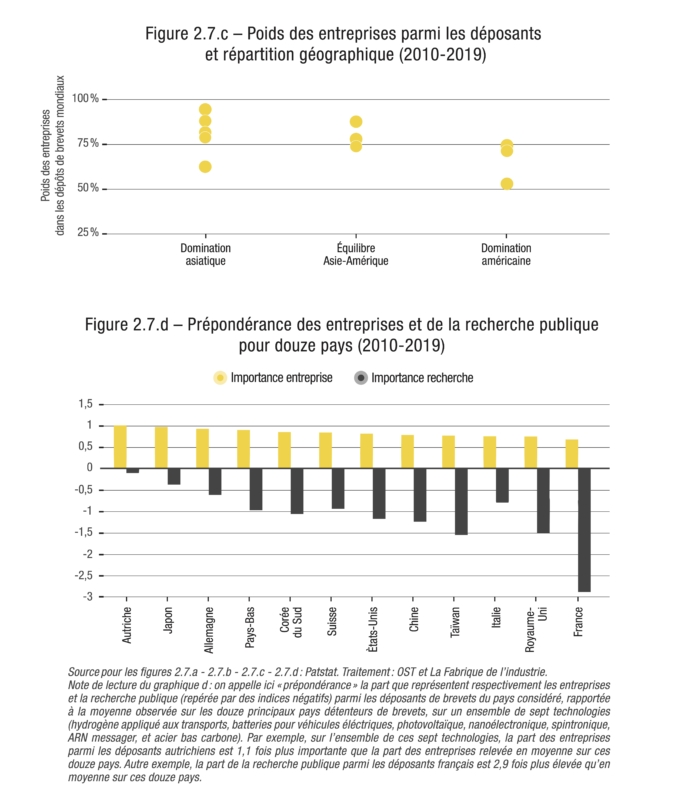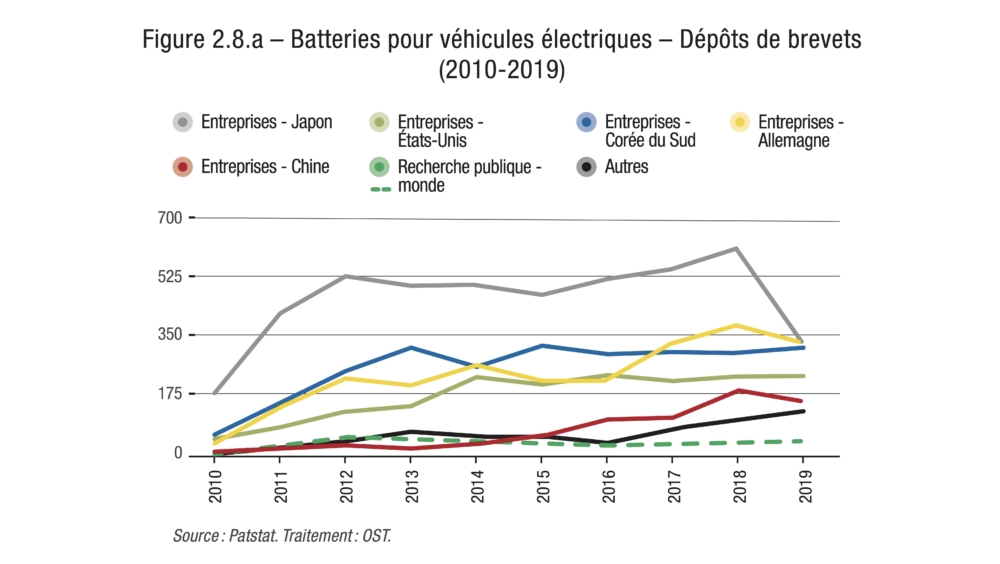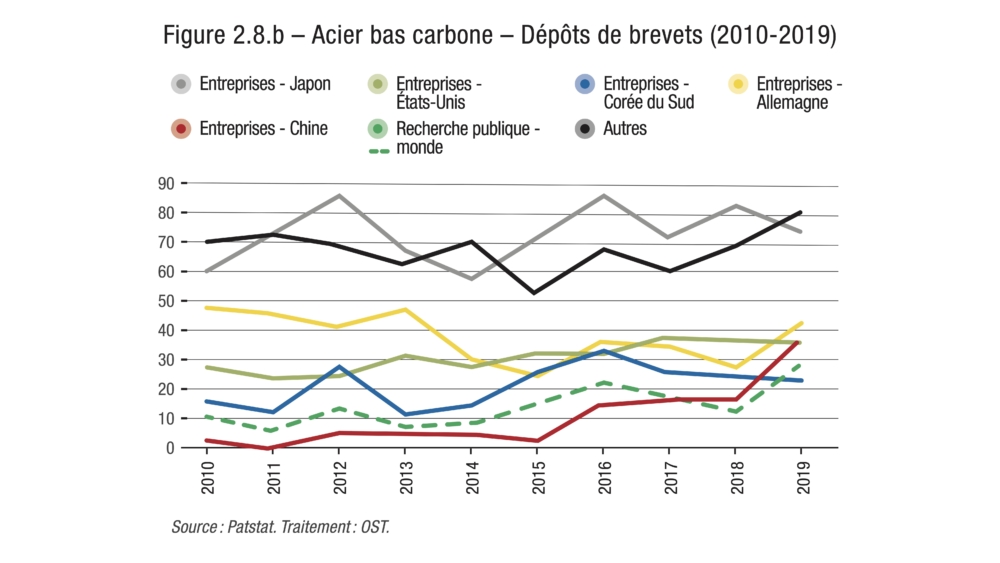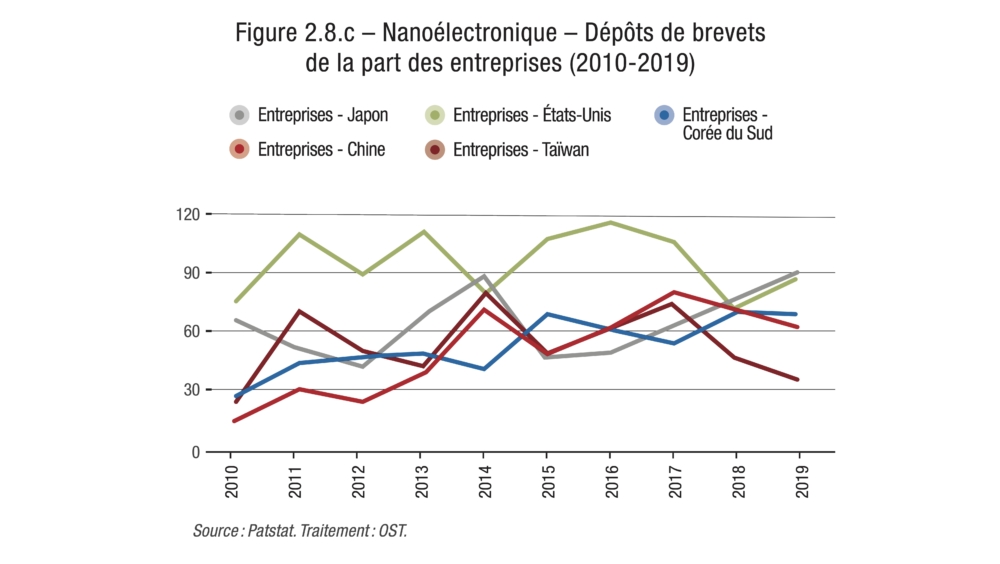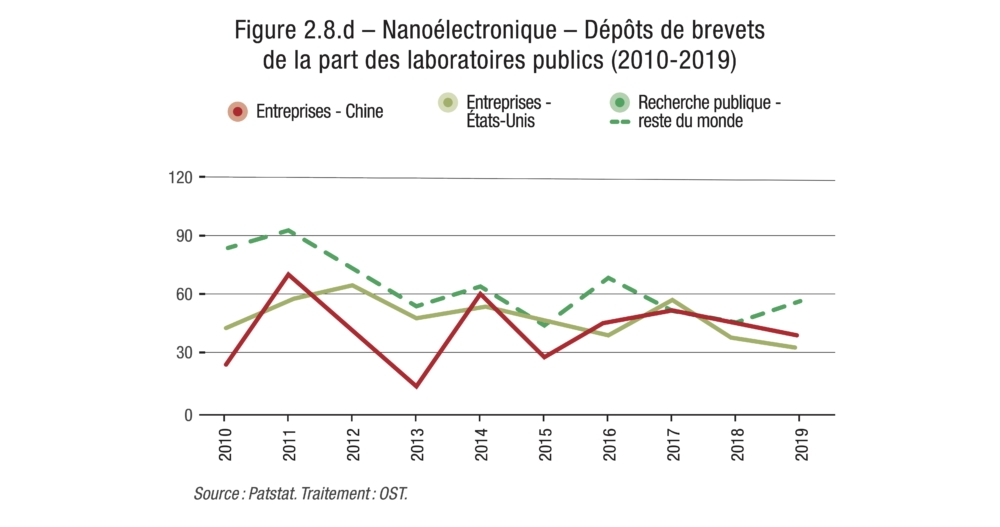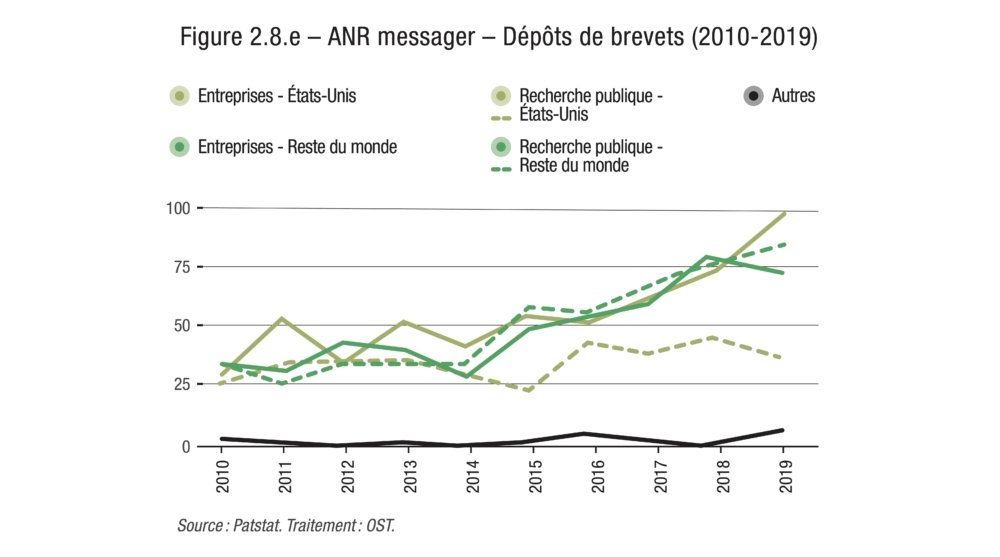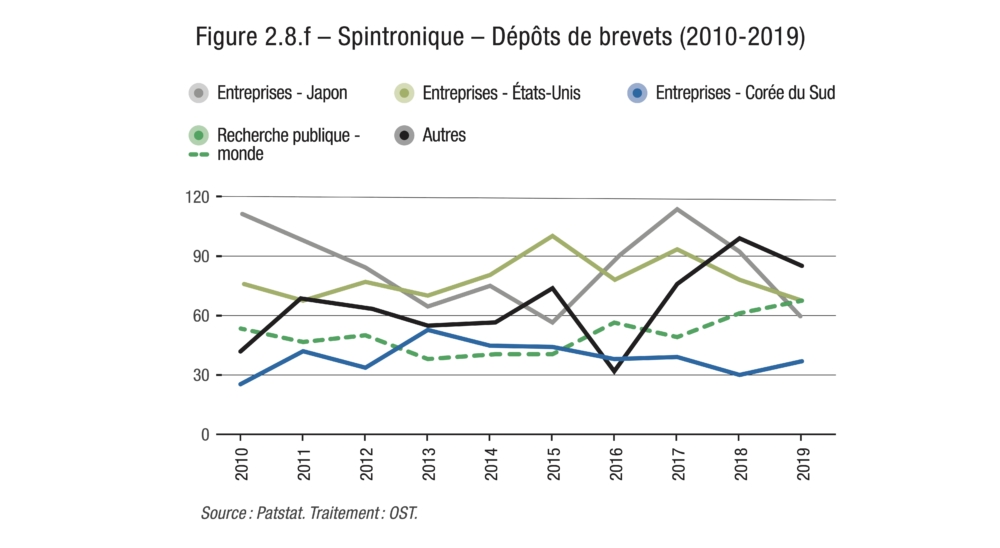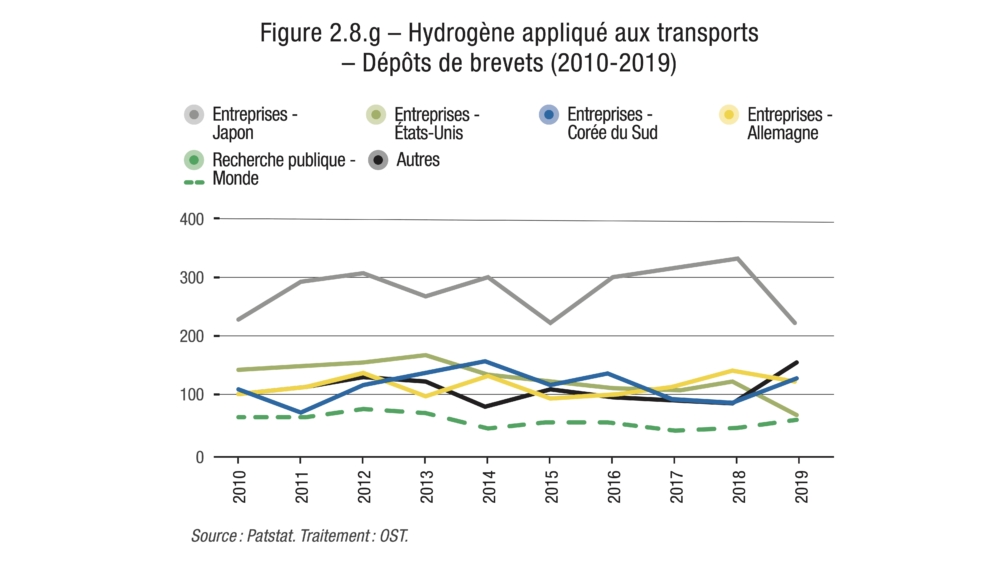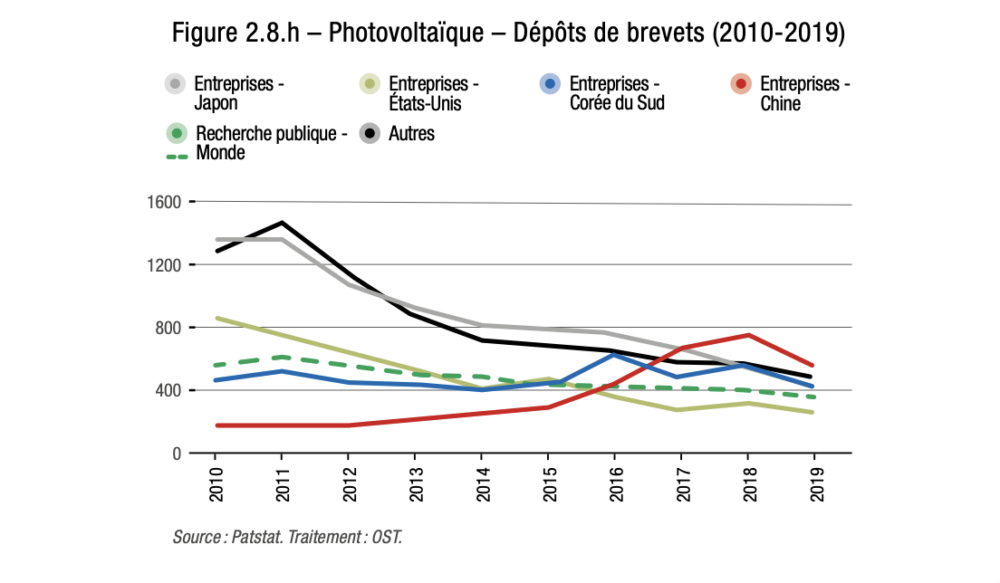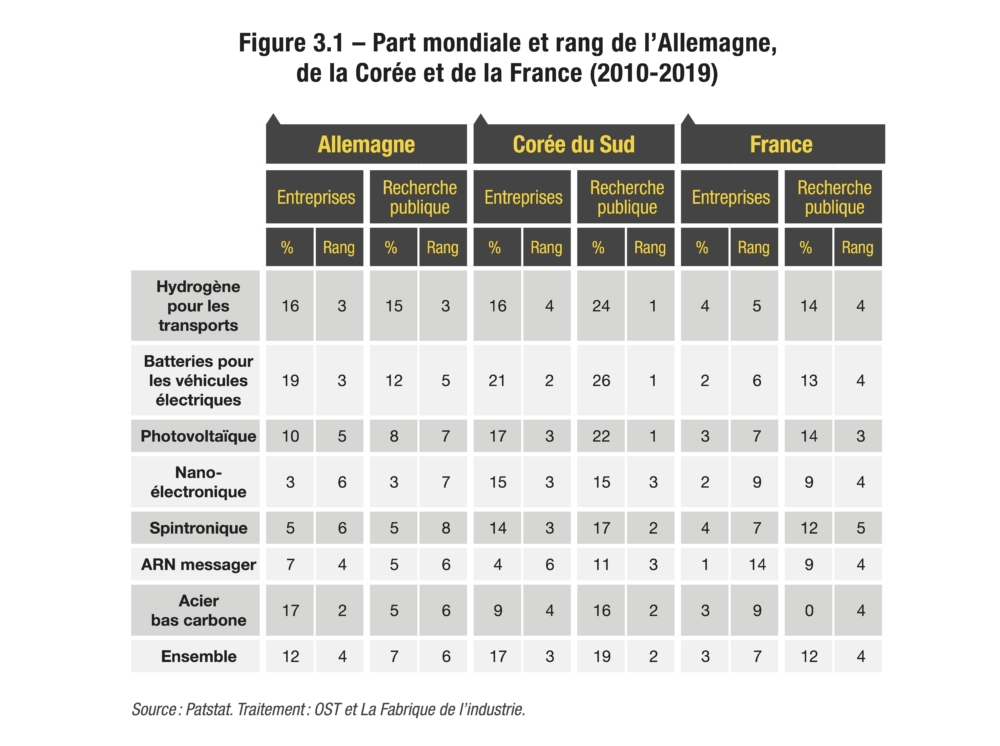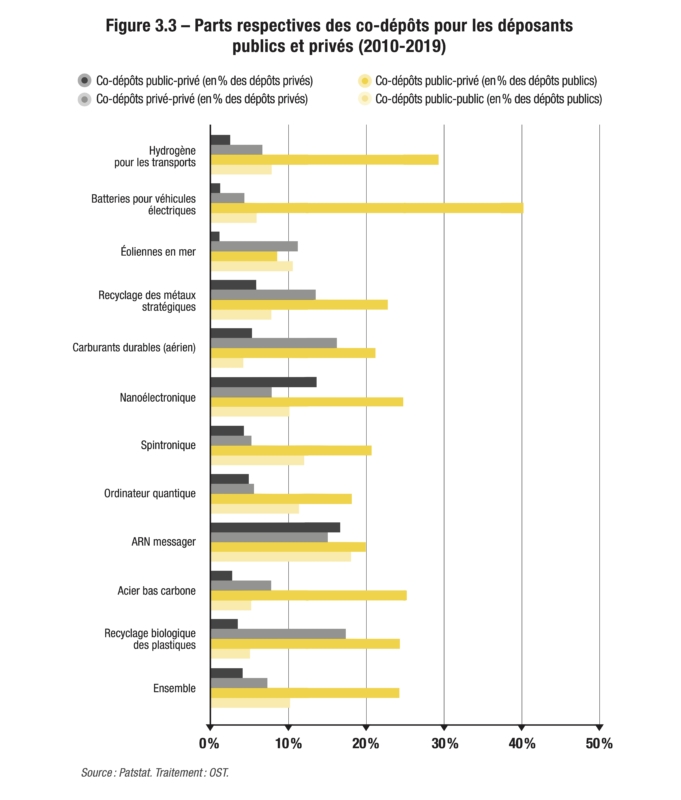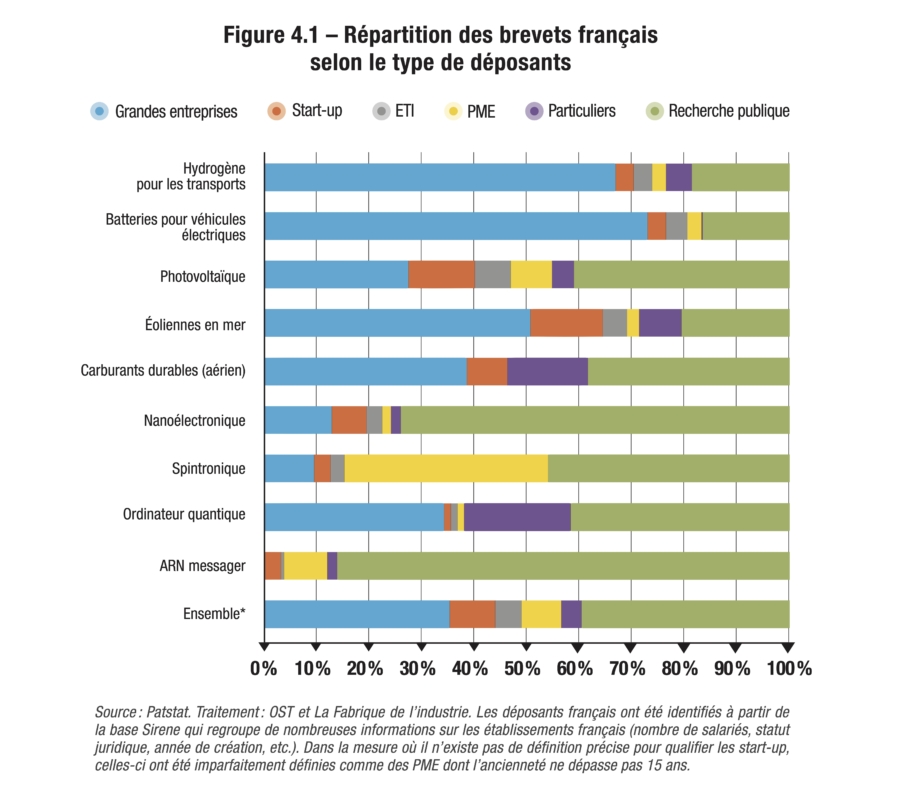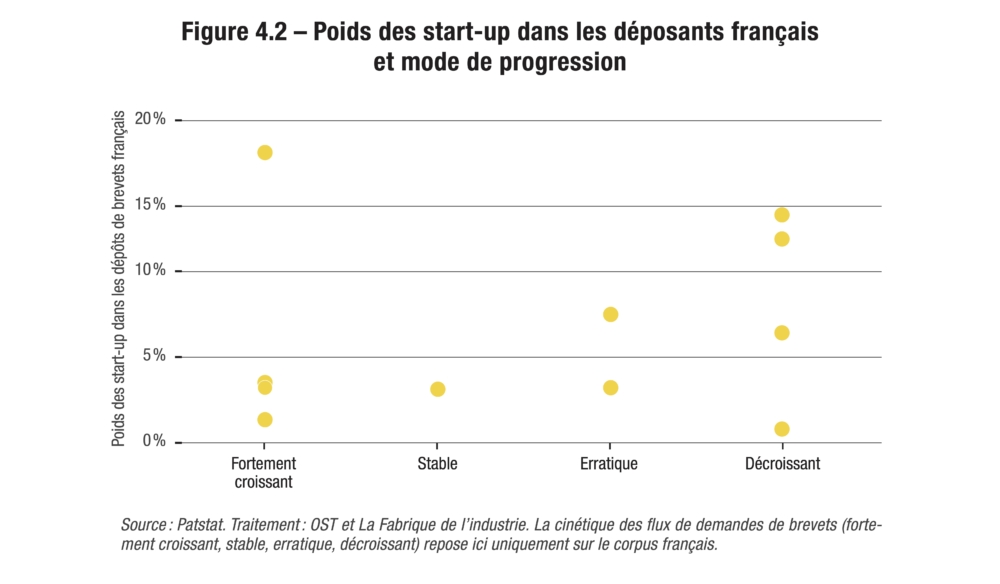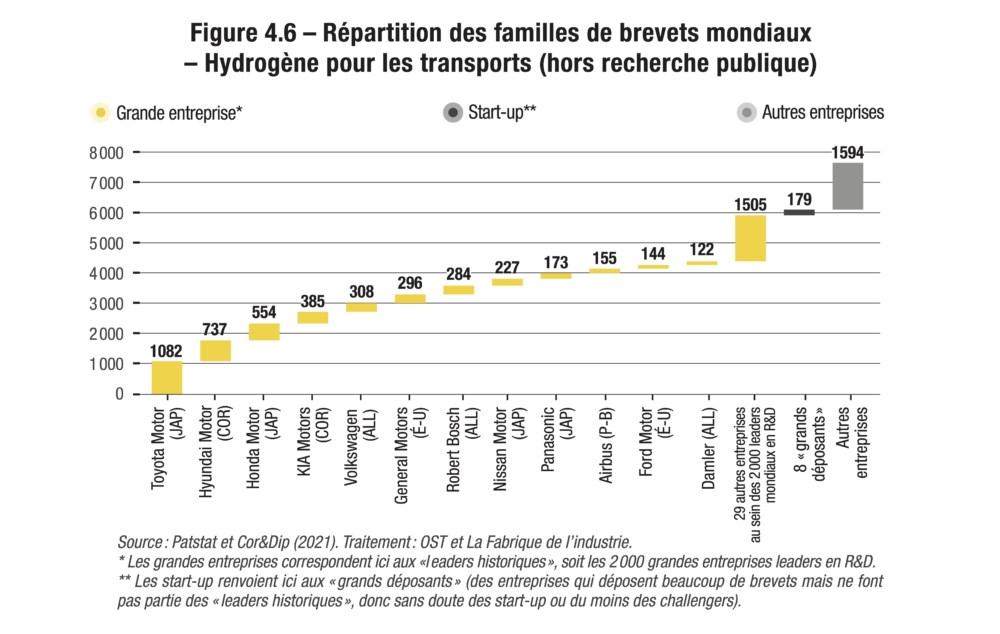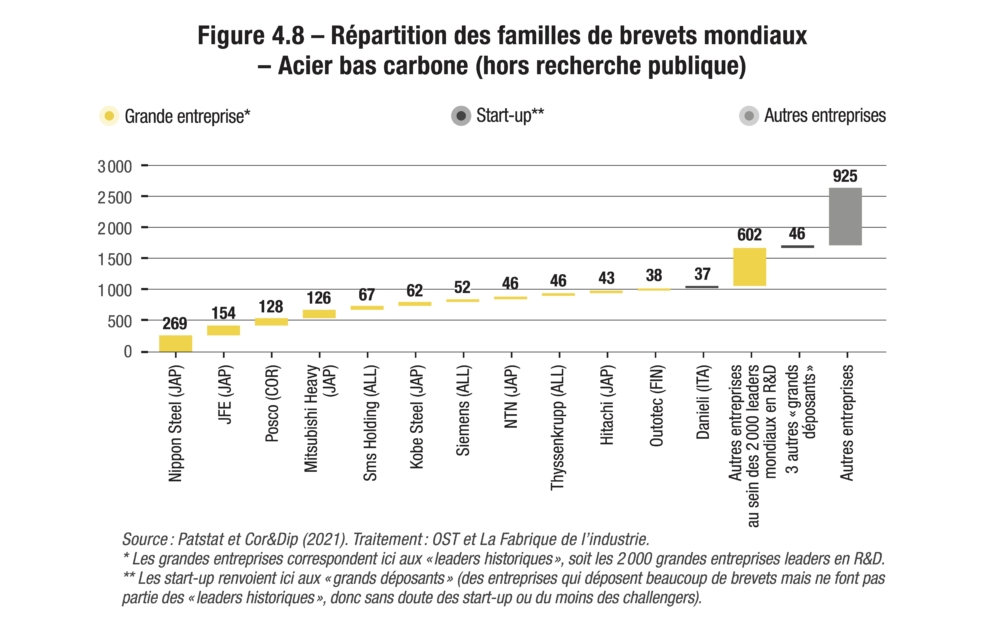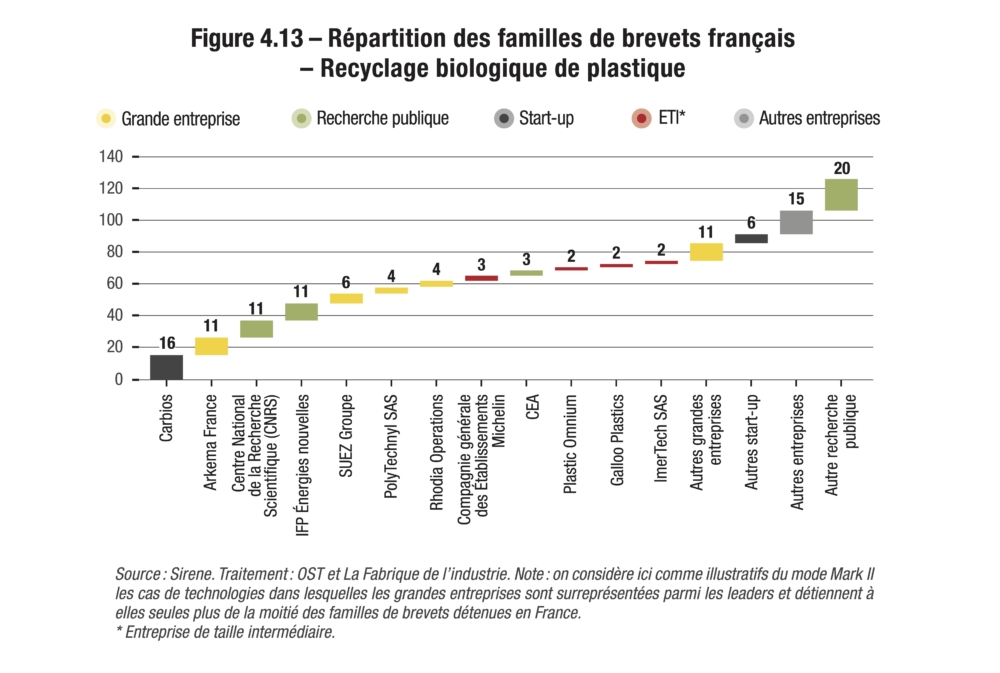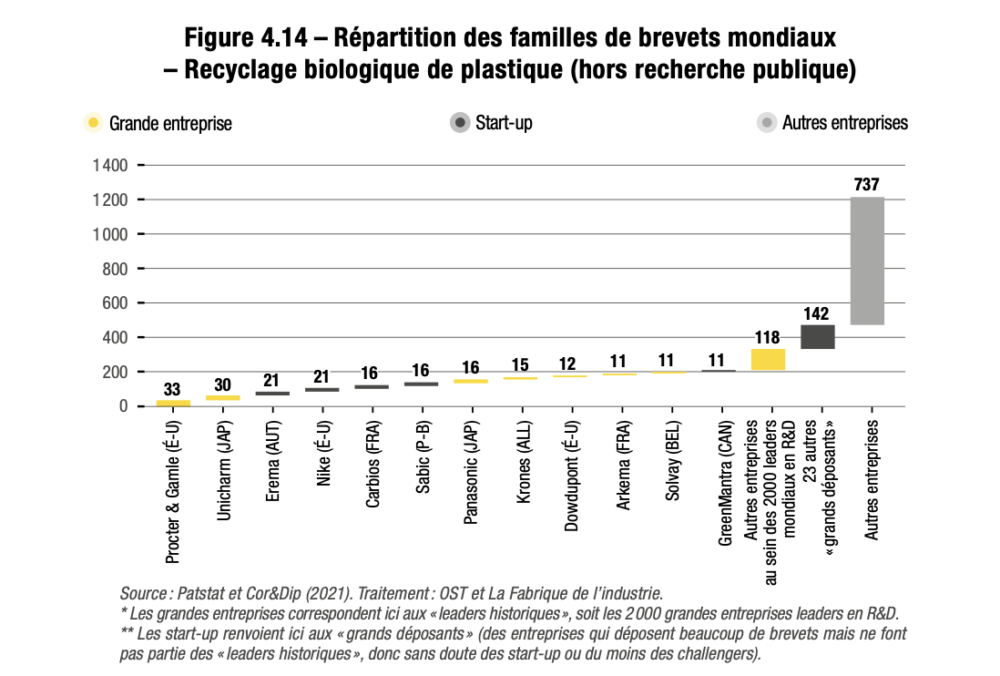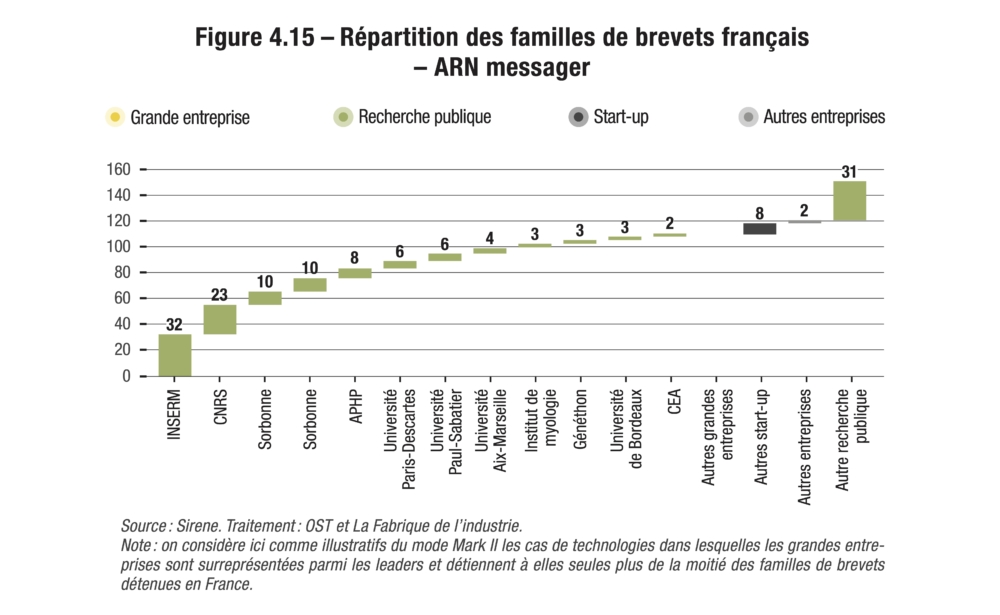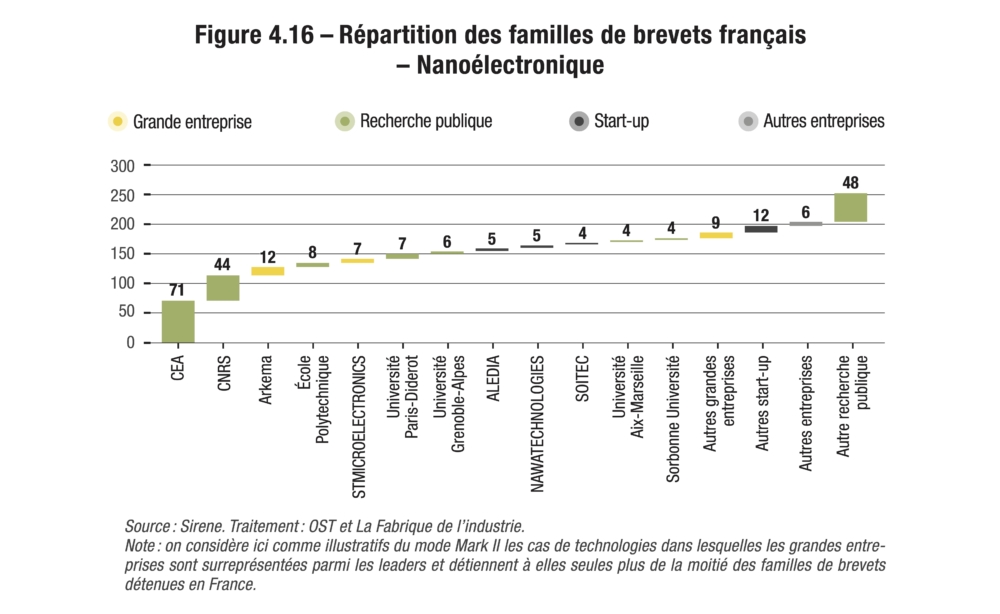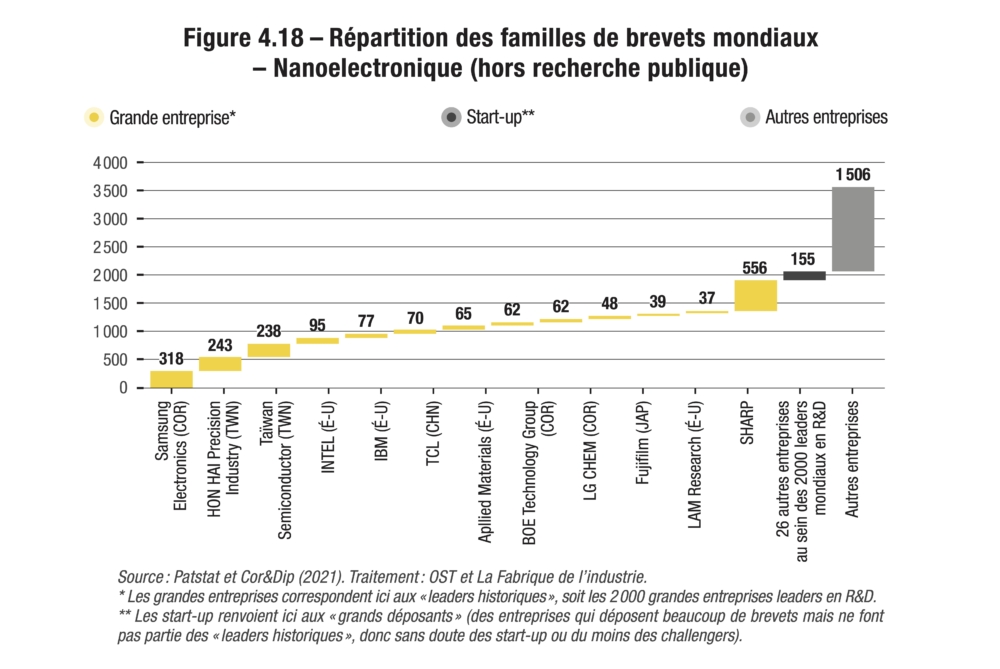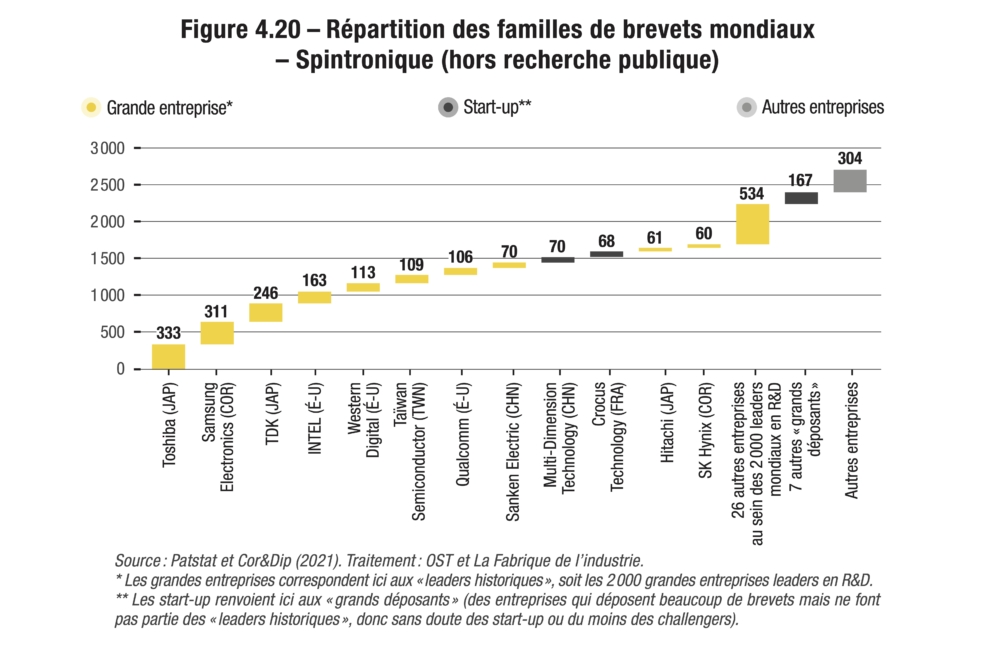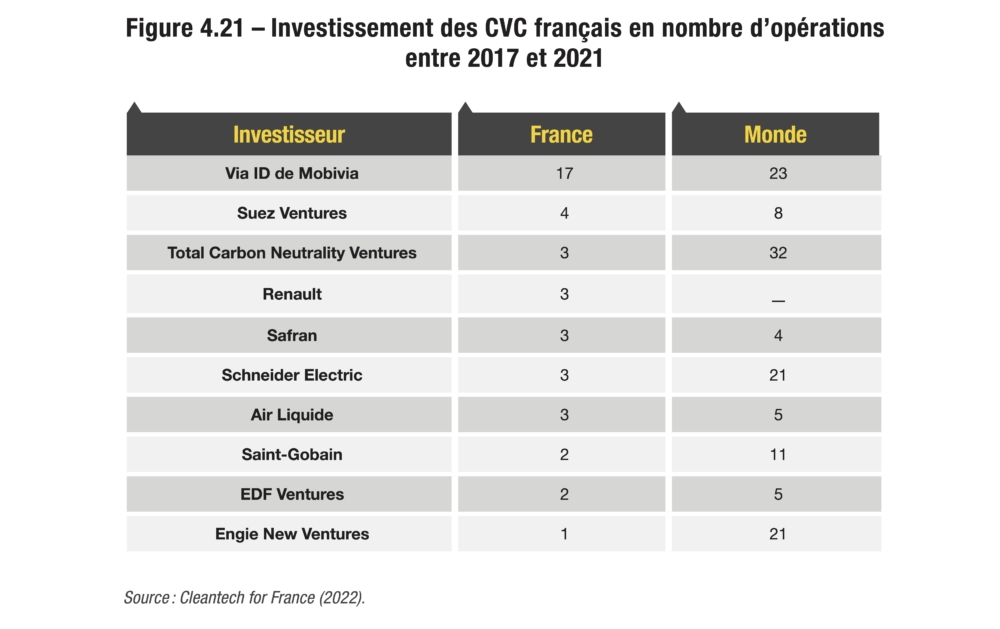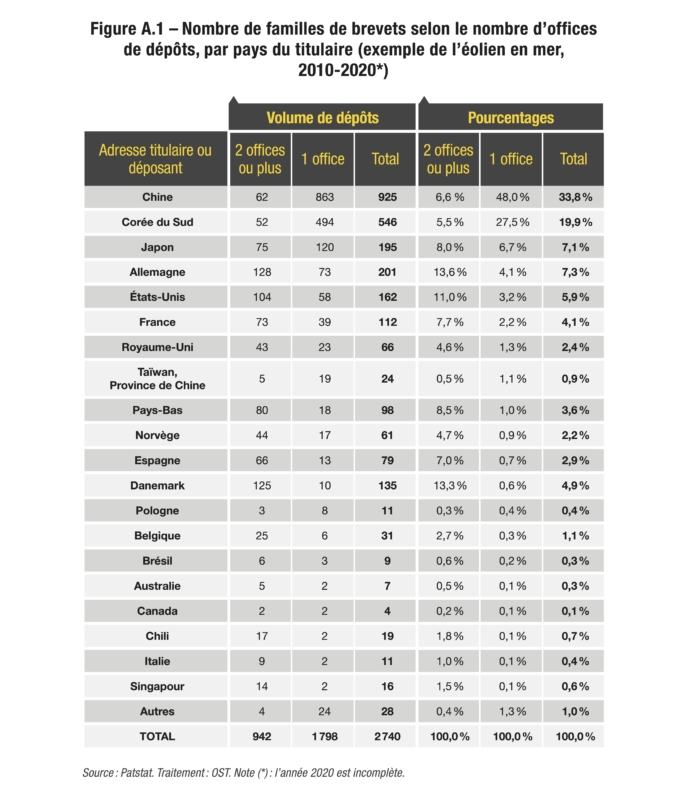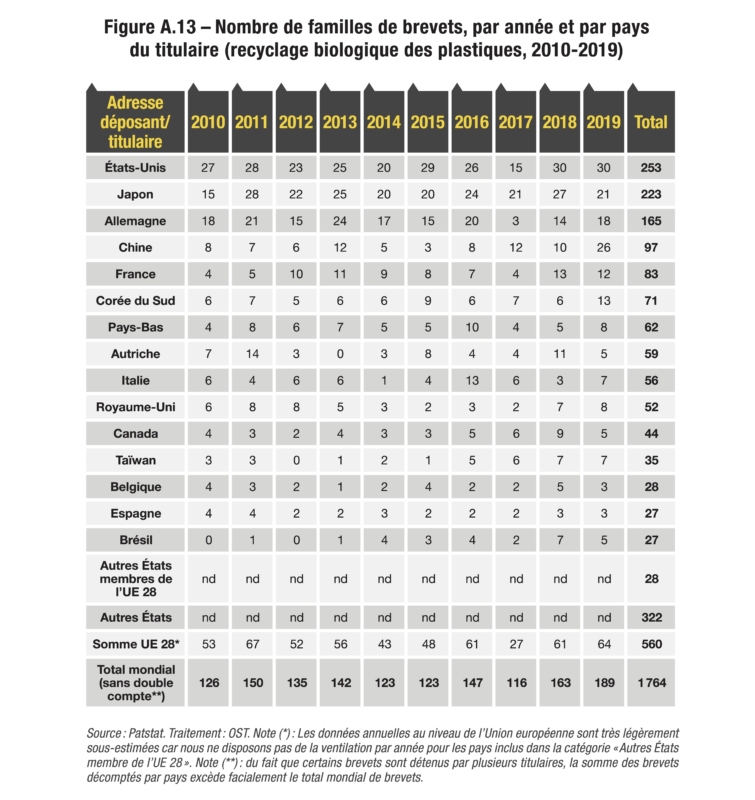L’innovation de rupture, terrain de jeu exclusif des start-up ? L’industrie française face aux technologies-clés

Préface
C’est avec grand plaisir que j’ai accepté, en ma qualité de président de l’Académie des technologies mais en m’exprimant à titre personnel, de préfacer cette étude de La Fabrique de l’industrie sur les innovations de rupture.
L’ouvrage examine la position des acteurs mondiaux et des pays correspondants vis-à-vis de douze technologies clés, dites de rupture, à partir des dépôts de brevet, ce qui est une approche originale et très pertinente. Après avoir cerné le caractère disruptif, soit technologique, soit lié aux usages et au marché, l’étude se focalise à juste titre sur le seul secteur industriel, vecteur de déploiement de ces technologies dans la société.
Sans surprise, ces innovations de rupture se concentrent sur les deux plus grands défis auxquels nos entreprises et notre société sont confrontées : la transition écologique et la révolution numérique. L’évolution dramatique de l’environnement mondial nous fait prendre conscience que ces transitions doivent s’accompagner d’une reprise en main de notre destin industriel et technologique, pour mieux assurer la résilience de notre économie et de notre système social, face aux multiples menaces militaires, sécuritaires, économiques, sanitaires, alimentaires… du fait desquelles l’inattendu est devenu la règle, et la crise l’ordinaire.
Dans ce contexte seule une industrie forte, couplée à une recherche forte, permet de se prémunir, à court, moyen et long terme, des aléas de l’histoire et de pérenniser le modèle démocratique et social de notre pays et de notre Europe. Les révolutions énergétiques et numériques sont à cet égard aussi bien des défis que des opportunités.
Bien entendu, cet enjeu ne repose pas seulement sur les technologies et les innovations ; notre académie, fidèle à sa devise « Pour un progrès raisonné, choisi et partagé » a récemment souligné, dans un avis sur la « Sobriété » que si les technologies sont indispensables pour relever ces défis, elles n’y suffiront pas et doivent être accompagnées de changements de comportements et de valeurs.
Il n’empêche qu’un certain niveau de maîtrise des technologies clefs, qui constituent le vecteur de ces transitions, est un socle indispensable pour assurer notre avenir de société développée ; et c’est tout l’intérêt de cet ouvrage que de situer notre pays et notre continent par rapport à cet enjeu.
Bien entendu, le dépôt de brevet n’est pas le seul indicateur de performance d’un laboratoire ou d’une entreprise. Pour observer une réalité récente, les auteurs se sont fondés sur l’analyse des dépôts de brevets, car celle des brevets acceptés et de leur extension aurait retardé l’observation de plusieurs années ; il est certain que ces brevets déposés n’ont pas tous la même valeur et que beaucoup se trouveront ultérieurement refusés ou contournés. De plus la valeur des brevets n’est pas le seul critère de réussite d’une innovation : l’excellence opérationnelle et l’accès au marché sont également des déterminants du succès. Mais, face à la multiplicité des situations et des paramètres, le choix fait par les auteurs est solidement fondé et réellement éclairant.
Le constat ainsi obtenu est très intéressant mais quelque peu inquiétant.
La France, contrairement aux États-Unis, Chine, Japon Corée et Allemagne, n’apparaît jamais parmi les quatre premiers pays dans chacun des douze segments étudiés. Notre pays occupe les rangs 5 à 9, avec une concentration autour de 6 ou 7.
Ceci est évidemment préoccupant mais peut être relativisé en relevant qu’il est aussi la 7e économie mondiale et la 8e puissance industrielle. Ainsi, l’ouvrage sort de l’image d’Épinal d’une France devenue un nain industriel pour le redressement de laquelle il serait trop tard pour agir. Mais il faut agir ! La performance, soulignée par l’étude, de la Corée du Sud est instructive à cet égard.
L’Europe se positionne bien mieux, étant dans les 4 premiers pour 11 technologies ; seule manque la nanoélectronique. Ce second constat, aussi consolant qu’il soit, n’est pas totalement rassurant car notre Europe n’est pas une entité intégrée, et encore moins souveraine, et ne peut donc pas user de cette force à l’instar des autres puissances.
Une analyse fort pertinente est celle relative au degré de spécialisation des différents pays ; autant on peut comprendre que de très grands pays comme les États-Unis et la Chine sont présents dans tous les segments, autant on peut être surpris de voir la France, puissance moyenne, comme étant peu spécialisée, contrairement à la Corée ou au Japon, qui trouvent là une clef de leur performance. Sans doute retrouve-t-on ici l’héritage historique d’une France gaullienne ne voulant dépendre de personne, mais s’essoufflant aujourd’hui dans un contexte de mondialisation et de multiplication des technologies : on ne peut plus ambitionner d’être bon partout. Une dépendance européenne étant aujourd’hui bien plus acceptable, une stratégie optimale, quoiqu’un peu simplificatrice, serait d’ambitionner pour notre continent un positionnement de premier plan dans tous les secteurs, s’appuyant sur une spécialisation par pays, faisant du nôtre un leader dans un nombre suffisant de segments.
Dans l’ensemble du monde, les dépôts de brevets sont très majoritairement le fait des entreprises, par rapport aux laboratoires publics. La France présente ici une singularité : la part des laboratoires, tout en restant minoritaire, y est beaucoup plus importante que dans les autres pays. Ceci traduit à la fois la bonne performance relative des laboratoires publics français, par rapport à la recherche publique mondiale, sur le plan des dépôts de brevets et la sous-performance des industriels français… lorsqu’il en existe dans le domaine considéré. Ce constat peut trouver son origine dans la puissance de nos grands organismes de recherche technologique ; peut-être aussi dans leur politique de conservation de la propriété de leur brevet, même après transfert de leur exploitation à une entreprise, nouvelle ou existante.
Contrairement à l’idée très répandue que les start-up ont pris le pas sur les grandes entreprises en matière d’innovations de rupture, cette étude montre que celles-ci sont majoritairement le fait d’entreprises établies, surtout parmi les plus grandes, fortement soutenues par leur État. En fait les mécanismes de développement des innovations de rupture sont très différents d’un domaine à l’autre (rôles respectifs des grands groupes, des start-up, et de la recherche publique…). Il faut donc adapter les outils à cette diversité, et encourager chaque écosystème à travailler en réseau.
L’étude présente pour chaque technologie une analyse des positions mondiales et des catégories d’acteur dominantes, qui est très éclairante pour élaborer une stratégie de redéveloppement de l’industrie adaptée à chaque domaine. Enrichie par des éclairages d’experts très pertinents, elle montre combien les rôles des divers acteurs diffèrent selon les domaines technologiques, mais évoque aussi les instruments utilisés pour aider ces acteurs (laboratoires publics, start-up, PME, grands groupes) à mieux travailler ensemble.
Basé sur des observations juste antérieures au lancement du grand plan France 2030, auquel notre académie apporte son éclairage, cet ouvrage fournit ainsi des analyses précieuses pour aider la puissance publique à adapter les objectifs et les modes d’action de ce plan, pour chaque domaine. La prise de conscience de la position médiocre de la France et de sa relative dispersion devrait sans doute nous inciter à focaliser davantage cet effort sur les secteurs où notre retard relatif a le plus de chances d’être comblé.
À sa place, l’Académie des technologies doit tenter d’y contribuer et pourra utilement s’appuyer sur les analyses présentées ici.
Dernière remarque : à l’inverse de la tendance de certains pays, relevée dans le rapport, un tel ciblage de ce (nouveau) mode d’action publique ne signifie pas pour autant qu’il faille abandonner les soutiens « horizontaux » tels que le crédit impôt recherche ou les pôles de compétitivité, en France. Ces derniers s’adressent au tissu existant d’entreprises industrielles de tous ordres, dont le maintien et le développement sont tout aussi nécessaires que les percées dans des domaines nouveaux, objet de cet ouvrage.
Certaines, hors du champ de cette étude, se situent au tout premier plan mondial (aéronautique, espace, défense, transports terrestres, nucléaire, etc.). Leur réussite est un encouragement à nous positionner résolument, et à rattraper notre retard, dans les nouveaux secteurs « de rupture », objets de ce remarquable ouvrage.
Denis Ranque Président de l’Académie des technologies
Remerciements
Cette étude doit beaucoup aux données de l’Observatoire des sciences et techniques, et à leur exploitation rendue possible grâce à un lourd travail de bibliométrie de brevets réalisé par son équipe. Nos remerciements les plus chaleureux vont à Luis Miotti et à Mounir Amdaoud, ainsi qu’à Frédérique Sachwald et à Dominique Guellec pour leur implication et la qualité de leurs conseils.
Cette étude a par ailleurs bénéficié du soutien généreux de la fondation Breakthrough Energy, représentée par Julia Reinaud et Pénélope Le Menestrel, auxquelles nous exprimons toute notre gratitude pour leur intérêt pour notre travail et leur appui.
D’autres encore nous ont aidés tout au long de ce travail : Cleantech for France, les représentants des entreprises entendus en entretien et, bien sûr, l’équipe interne de La Fabrique de l’industrie.
Toute étude est un travail collectif et nous vous savons gré de vos apports, nombreux et décisifs.
Résumé
Cet ouvrage s’attache dans un premier temps, sur la base d’une recherche documentaire et d’entretiens avec des experts, à définir l’innovation de rupture dans le secteur industriel. Nous considérons comme telles les activités qui relèvent à la fois d’une performance technologique, y compris lorsqu’elle est incrémentale, et d’un usage radicalement nouveau sur le marché. Sont donc exclues de notre champ d’analyse des entreprises réputées disruptives comme Doctolib, Facebook ou BlaBlaCar qui n’appartiennent pas au secteur industriel et qui, surtout, ont transformé le marché sans être à l’origine d’une innovation au sens technologique du terme.
Partant de cette définition, nous identifions douze innovations de rupture, toutes mentionnées dans des rapports d’experts de haut niveau, et dont huit sont directement liées à la préservation de l’environnement et à la lutte contre le dérèglement climatique. Dans le secteur industriel, il existe en effet une myriade de solutions aux problèmes posés par la transition énergétique, parmi lesquelles figurent notamment l’hydrogène décarboné, les batteries pour véhicules électriques ou encore l’acier bas carbone.
Où naissent ces innovations de rupture aujourd’hui, sur quels continents et dans quels types d’institutions ? C’est la question centrale à laquelle nous essayons de répondre dans cet ouvrage, sur la base d’un travail de bibliométrie de brevets et d’entretiens. L’enjeu pour les États est non seulement de répondre aux grands défis sociétaux mais aussi de ne pas prendre de retard face à leurs homologues, dont certains n’hésitent pas à soutenir lourdement « leurs » entreprises pour dominer des secteurs clés. Il apparaît en effet clairement que la maîtrise des technologies est nécessaire, sinon suffisante, à la défense des intérêts nationaux sur la nouvelle scène mondiale.
De ce point de vue, les pays européens accusent un retard important vis-à-vis des champions mondiaux, selon nos observations : hormis l’Allemagne, qui figure parmi les quatre premiers déposants mondiaux de brevets dans la moitié des domaines technologiques étudiés, les autres pays européens comptent rarement parmi les leaders. La France n’apparaît pour ainsi dire jamais parmi les pays les plus actifs dans les douze domaines de notre échantillon. Face à l’Europe, une poignée de quatre pays, États-Unis, Chine, Japon et Corée du Sud, occupent très souvent les premières places du podium. Leur domination est d’autant plus frappante qu’ils concentrent systématiquement au moins la moitié des brevets déposés dans le monde et parfois jusqu’aux trois quarts (on ne tient compte ici que des brevets déposés dans au moins deux offices nationaux, autrement dit ceux qui ont une portée inventive reconnue et ne se limitent pas à un rôle purement défensif).
Lorsqu’on raisonne à l’échelle de l’Union européenne, on obtient des résultats plus encourageants : dans la quasi-intégralité des domaines technologiques étudiés, le rang mondial de l’Union européenne varie entre la première et la deuxième place du podium. Elle se distingue particulièrement dans le domaine des éoliennes en mer avec près des deux tiers des brevets déposés au cours de la décennie étudiée. Dans les autres domaines, l’Union européenne ne détient jamais plus de la moitié des brevets, contrairement aux États-Unis qui conservent une large avance dans les domaines de l’ordinateur quantique et de l’ARN messager. Il convient, par ailleurs, de souligner que le leadership de l’Union européenne tient essentiellement à celui de quelques pays, dont l’Allemagne qui tient le haut du pavé. La France ne joue pas de rôle significatif en la matière. En outre, on rappelle que la Corée ou le Japon peuvent parfois faire jeu égal à l’Union européenne toute entière.
L’ouvrage étudie aussi les apports respectifs des acteurs publics et privés. Chaque année, la grande majorité des brevets relatifs aux innovations de rupture sont déposés par des entreprises. La recherche publique occupe très souvent une place modeste, où qu’elle soit dans le monde. Les cas les plus emblématiques de cette domination quasi exclusive des entreprises sont les batteries pour véhicules électriques et l’hydrogène décarboné : elles sont à l’origine de plus de 90 % des dépôts de brevets tout au long de la période étudiée, entre 2010 et 2019. À l’inverse, la recherche publique fait parfois figure de pionnière, à l’instar du domaine de l’ARN messager, où elle était à l’origine de la moitié des dépôts de brevets en 2010, pour n’en représenter plus qu’un tiers en 2019. Il est par ailleurs intéressant de noter que la recherche publique est relativement plus représentée parmi les déposants américains, chinois et, bien plus encore, parmi les déposants français.
Ainsi, la recherche publique peut jouer un rôle incontournable dans l’initiation des innovations de rupture. Le cas français est particulièrement saisissant dans la mesure où le rang tenu par les laboratoires publics et les universités est nettement plus honorable que celui des entreprises. Parmi les sept technologies pour lesquelles nous disposons de données détaillées, les laboratoires français représentent entre 9 et 14 % de l’ensemble des brevets issus de la recherche publique dans le monde, ce qui les place le plus souvent au quatrième rang mondial, au troisième rang pour le photovoltaïque et au cinquième pour la spintronique. Il faut dire que la recherche publique française peut s’appuyer sur des établissements comme le CNRS ou le CEA, qui apparaissent souvent dans le trio de tête des déposants français, le CEA ayant la spécificité de réaliser une activité de recherche fondamentale tout en développant des liens étroits avec les entreprises. Pour autant, et c’est là que le bât blesse, la transmission de connaissances entre laboratoires publics et entreprises n’est pas suffisante. Par exemple, dans les domaines de l’ARN messager, de la nanoélectronique et de la spintronique, les dépôts de brevets en France sont quasi exclusivement le fait des laboratoires publics et des universités. L’objectif des pouvoirs publics est alors de trouver les meilleurs moyens d’encourager l’effort privé de R&D : renforcement de la recherche fondamentale, développement de nouveaux instruments visant à rapprocher les laboratoires des entreprises, encouragement à l’essaimage…
Cet ouvrage porte, pour finir, un regard sur les rôles respectifs des start-up et des grandes entreprises dans l’avènement des innovations de rupture. Depuis que la planète entière s’en est remise aux vaccins à ARN messager, il n’est en effet plus un seul secteur d’activité qui ne redoute de se faire tôt ou tard « désintermédier » par des start-up triomphantes. L’analyse bibliométrique montre en réalité que, d’un domaine technologique à l’autre, la dynamique d’innovation n’obéit pas aux mêmes schémas, et qu’elle ne se résume pas à une alternative entre les archétypes schumpétériens « Mark I » (dans lequel les innovations de rupture sont apportées par des nouveaux entrants de petite taille acceptant de prendre de gros risques) et « Mark II » (dans lequel les entreprises historiques maintiennent leur avance technologique en capitalisant sur leurs connaissances antérieures). En France, comme à l’international, les start-up comptent rarement parmi les principaux déposants de brevets sur les douze domaines ici étudiés. Certes, elles peuvent se distinguer dans certains domaines. Mais cela reste une situation assez minoritaire, qui ne s’observe d’ailleurs qu’aux États-Unis, en Chine et – bien plus modestement – en France, mais jamais en Corée, au Japon ni en Allemagne. Les grandes entreprises figurent donc très souvent comme les pourvoyeuses leaders d’innovations de rupture, dans tous les domaines et dans tous les pays… sauf en France.
Introduction
Pendant près de vingt ans, entre 1990 et 2010 environ, on a appelé « paradoxe européen » la difficulté manifeste avec laquelle les économies européennes tentaient de rattraper leur retard en matière de développement technologique et d’innovation au regard du leader historique américain, tandis que les laboratoires de recherche du Vieux Continent contribuaient honorablement à l’avancement des connaissances.
Cette idée selon laquelle nos performances technologiques ne seraient pas à la hauteur des capacités contributives de nos équipes scientifiques, toute controversée qu’elle soit, est un schème ancien que l’on retrouve non seulement comme pierre angulaire des politiques communautaires de R&D1 depuis le début des années 1990, mais aussi dans des déclarations politiques françaises bien antérieures encore (voir par exemple le discours de François Mitterrand en clôture des journées de travail sur la politique industrielle en novembre 19822).
Cela fait, par conséquent, au moins cinquante ans que les politiques européennes, et particulièrement françaises, reposent sur cette idée d’un retard par rapport aux grandes puissances mondiales en matière d’innovation. Par effet de vases communicants, plus la recherche publique est tenue pour excellente, plus la capacité des entreprises européennes à proposer au marché des solutions innovantes est jugée décevante au regard du poids économique de nos pays.
On notera que ce complexe d’infériorité se manifestait déjà bien avant l’entrée de la Chine dans l’OMC et son accès au statut de nouvelle superpuissance mondiale, et également avant la chute du bloc soviétique et la fin de la guerre froide, pendant laquelle les efforts publics de R&D étaient pourtant lourdement déterminés par des objectifs régaliens et, moins qu’aujourd’hui, par la recherche de débouchés économiques. À l’évidence, ce complexe n’a fait que se renforcer depuis. L’incapacité chronique à se doter d’un écosystème de start-up « à la bonne échelle » et, plus encore, l’inaptitude à faire émerger un « Google français » ou un « GAFAM européen » en sont restées les formulations les plus célèbres et les plus récurrentes.
Dans les mois qui ont suivi la pandémie de Covid-19, le triomphe planétaire de la société Moderna et du vaccin à ARN messager qui l’a propulsée, ajouté au succès, plus ancien et à peine moins rapide, de Tesla en matière de mobilité décarbonée, ont réactivé ce questionnement, en des termes légèrement renouvelés. Où donc les innovations de rupture naissent-elles aujourd’hui ? Et que peut-on dire des capacités respectives des grandes entreprises, des start-up et de la recherche publique, tout particulièrement en France, à apporter au marché les innovations de rupture dont il a besoin, face à l’urgence pressante de trouver des solutions industrielles aux problèmes posés par les transitions énergétique et numérique ?
Telles sont les questions auxquelles tente de répondre le présent ouvrage, sur la base d’un travail approfondi de bibliométrie de brevets et d’entretiens. Le premier chapitre est consacré à la constitution d’un échantillon de douze technologies témoins. Le chapitre 2 dresse une cartographie des principaux pays dans lesquels ces technologies de rupture sont développées, illustrant au passage un retard manifeste des pays européens. Le chapitre 3 se penche sur le rôle discret mais déterminant de la recherche publique dans l’émergence de ces technologies de rupture. Le chapitre 4, enfin, étudie les rôles respectifs des grandes entreprises et des start-up en la matière.
- 1. Green Paper on innovation. Document drawn up on the basis of COM(95) 688 final. Bulletin of the European Union Supplement 5/95.
- 2. Mitterrand (1982).
Les innovations de rupture : un ensemble hétérogène
Les ruptures peuvent survenir dans les technologies ou dans les usages
Technologie et innovation ne se recoupent que partiellement
L’objet de cet ouvrage est de comprendre où naissent les grandes disruptions technologiques3 de la décennie. La première étape consiste ainsi à se doter d’un échantillon témoin, pertinent et représentatif, de technologies qui pourront ensuite être analysées dans le détail.
Technologie et innovation ne sont certes pas synonymes. On appelle « technologies de rupture » des technologies ou des combinaisons de technologies qui se démarquent radicalement des technologies existantes, reposant souvent sur des investissements importants pour des marchés encore incertains et en début de développement4. L’innovation de rupture recouvre quant à elle un périmètre plus large, parce qu’elle ne se fonde pas nécessairement sur des technologies complexes : elle englobe à la fois des innovations de produit, de procédé et d’organisation qui bouleversent les usages et créent de nouveaux marchés5. Ainsi, des entreprises telles que Facebook ou Twitter ont transformé le marché sans être à l’origine d’une innovation technologique : elles ont au contraire tiré parti de technologies disponibles, quitte à intensifier leur effort de R&D par la suite. Réciproquement et par définition, une invention fût-elle technologique ou radicalement novatrice n’est appelée « innovation » qu’au moment où elle rencontre son marché, ce qui ne se produit pas toujours. Il n’y a donc pas de relation biunivoque entre les deux termes.
Pourtant, force est d’admettre que dans le secteur industriel, et plus encore dans l’industrie lourde, la performance technologique est souvent un préalable à l’innovation de rupture. Rappelons à cet égard que le secteur manufacturier français est à l’origine de l’essentiel des dépenses intérieures de R&D des entreprises (68 % en 20206), que la moitié de cet effort repose sur quatre branches seulement : les industries automobile (12 ٪), aéronautique et spatiale (10 ٪), pharmaceutique (8 ٪) et chimique (5 ٪). En particulier, les solutions industrielles innovantes qui concernent la transition énergétique (hydrogène vert, stockage d’énergie, acier bas carbone, etc.) requièrent souvent une longue phase de recherche et développement avant d’entrer sur le marché – bien plus longue que pour les solutions des services numériques purs.
C’est pourquoi étudier la dynamique des innovations de rupture émanant du secteur industriel revient à combiner les approches technology push et market pull. En d’autres termes, il s’agit de porter un intérêt aux produits qui relèvent à la fois d’une performance technologique, y compris lorsqu’elle n’est pas radicale, et d’un nouvel usage sur le marché7.
Une frontière ténue entre les innovations de rupture et les autres
Dans tous les cas, l’innovation dite « de rupture » s’oppose par définition même à l’innovation incrémentale. On peut avoir l’impression que la rupture a un caractère soudain, tandis que l’innovation incrémentale se produirait par amélioration continue de technologies ou de produits existants. Pourtant, comme le souligne Benjamin Cabanes, chercheur en sciences de gestion à Mines Paris – PSL, « la frontière est ténue entre innovation radicale et incrémentale » : un assemblage d’innovations incrémentales peut donner lieu à une rupture et, à l’inverse, l’innovation de rupture peut provoquer à sa suite une série d’innovations incrémentales.
Dans l’industrie plus que dans les autres secteurs, l’innovation est en effet souvent le fruit d’une lente accumulation graduelle de connaissances et implique une amélioration continue de produits avant que ceux-ci ne viennent disrupter le marché. Ainsi, le GPS (Global Positioning System) qui équipe aujourd’hui les téléphones et les voitures résulte de l’amélioration continue d’un système de positionnement par satellite utilisé initialement dans les premiers sous-marins nucléaires aux États-Unis. De même, dans le secteur automobile, certains systèmes d’aide à la conduite comme la technologie du start and stop, mécanisme d’arrêt et de redémarrage automatique du véhicule, ont bouleversé les habitudes de conduite et peuvent en cela être considérés comme une rupture. Aussi radicale soit-elle, l’innovation ne saurait donc être réduite à un « éclair de génie ».
Le caractère radical d’une innovation peut aussi naître du croisement de plusieurs domaines. Selon le rapport Génération Deeptech de Bpifrance (2019)8, la maîtrise de l’interdisciplinarité est propice à l’émergence de nouveaux produits en rupture avec ceux du marché. À titre d’exemple, l’entreprise Carbios, seule entreprise au monde à faire du recyclage enzymatique de plastique, est, selon son dirigeant Emmanuel Ladent, « le mariage de deux sciences qui n’étaient pas destinées à se rencontrer : la biologie et la plasturgie ». Selon lui, « il fallait marier ces deux sciences pour que ça fonctionne ». Ainsi, on voit souvent émerger l’innovation de rupture à partir de projets pluridisciplinaires, organisés dans le cadre de partenariats entre laboratoires de recherche et entreprises.
Les politiques publiques de plus en plus guidées par les grands défis humains
La deuxième grande question soulevée au moment de constituer un échantillon de technologies témoins est de déterminer leur objet, leurs finalités. Depuis qu’elles existent sous leur forme contemporaine et institutionnalisée, soit à partir des années 1940, les politiques publiques de recherche et d’innovation sont réparties entre la poursuite d’objectifs régaliens, le soutien à la compétitivité des entreprises et la résolution de grands défis sociétaux (en plus naturellement de l’avancement général des connaissances et de la formation par la recherche)9. La liste de ces grands défis sociétaux a évolué d’une décennie à l’autre, mais on y retrouve depuis plusieurs années les transitions écologique et numérique, la santé, la sécurité alimentaire et la souveraineté technologique.
La conception des outils proprement dits permettant d’atteindre ces objectifs de manière sûre ou efficace a fait l’objet d’une très abondante littérature et de nombreux arrangements institutionnels : organismes généralistes, agences dédiées, grands programmes finançant des filières industrielles ou directement des opérateurs privés, soutien à la recherche fondamentale d’excellence, encouragement à l’essaimage de start-up à partir de laboratoires publics… Tout ou presque a été envisagé et défendu, dans tous les pays de l’OCDE, pour accélérer l’avènement d’innovations de rupture.
Ces modulations ont découlé à la fois de considérations endogènes sur la nature des connaissances et du progrès technique (cf. encadré ci-contre), et également d’une pression extérieure plus ou moins forte, de la part des autorités législatives ou de régulation, sur les dépenses publiques considérées comme acceptables10. Elles ont aussi été l’objet d’un débat qui n’a pas perdu en vigueur depuis : qui, des grandes entreprises, des start-up ou des laboratoires publics, doit être particulièrement soutenu pour sa contribution au développement de nouveaux marchés innovants ?
Tous les pays qui, il y a peu encore, rivalisaient de soutien à leur écosystème de venture capitalism dans l’espoir qu’émerge enfin un Google national sont en train de revoir leur panoplie d’outils de soutien à la recherche et à l’innovation, devant l’urgence des réactions attendues face au dérèglement climatique ou encore pour tirer les leçons de la pandémie mondiale de Covid-19. Ce n’est pas seulement qu’ils renoncent à privilégier les dispositifs neutres et transversaux comme le CIR ou les pôles de compétitivité ; c’est aussi qu’ils s’affranchissent graduellement de la contrainte, jusque-là impérative, de cantonner leurs interventions au cadre précompétitif pour ne surtout pas créer de distorsion sur les marchés. Les mêmes agences et ministères publics qui s’évertuaient à ne pas se rendre coupables de cherry-picking11 cherchent aujourd’hui par tous les moyens à relever le niveau d’ambition des programmes qu’ils subventionnent, quitte à aider les répondants à s’organiser de sorte que les transformations attendues adviennent « pour de vrai » et le moins tard possible.
C’est ainsi que des stratégies d’accélération ont été mises en place récemment dans de nombreux pays, y compris à l’échelle de l’Union européenne à travers les projets importants d’intérêt européen commun (PIIEC). En France, les cinq grands défis lancés en 2018 par le Conseil européen de l’innovation (CEI) illustrent eux aussi cette orientation politique : faire émerger de nouveaux marchés (market pull) en aidant les technologies – de rupture ou non – à répondre à des besoins (technology push). Plus important encore, la dernière version du programme d’investissements d’avenir (PIA4) comporte désormais une action « innovation dirigée », visant à accélérer l’innovation dans des secteurs et technologies jugés prioritaires (Larrue, 2023).
À la recherche des politiques d’innovation efficaces et sur mesure
À la fin des années 1980, c’est-à-dire à l’approche de la fin de la guerre froide et à l’aube de la révolution des technologies de l’information, Henry Ergas (1986) a ouvert la voie à la promotion des politiques de «diffusion», dont il a constaté qu’elles étaient plus efficaces et plus génératrices de richesse que les politiques orientées «mission» traditionnelles, dédiées aux grands objectifs régaliens. À cette époque, il n’était pas rare en effet de lire que des pays comme la France ou le Royaume-Uni dépensaient inutilement leurs ressources en entretenant des grands programmes technologiques militaires ou aérospatiaux, aux retombées économiques très incertaines, tandis que le Japon et l’Allemagne, que l’histoire avait privés de ces objectifs politiques, tiraient pleinement parti des effets diffusants de technologies transversales comme les TIC ou encore des révolutions attendues dans le domaine du vivant (Autret, 2001). En France, le développement de politiques d’innovation volontairement non ciblées comme le crédit impôt recherche (déplafonné en 2008) ou les pôles de compétitivité (2005) a découlé directement de cette réflexion. On notera que les débats en cours aujourd’hui sur le rétablissement nécessaire de notre souveraineté technologique et sur la mobilisation des politiques d’innovation pour faire face au dérèglement climatique consistent peu ou prou à refaire le chemin en sens inverse.
Voulant dépasser une formulation trop manichéenne de cette réflexion, Dosi (1982) puis Pavitt (1984) ont posé les bases de taxonomies sectorielles montrant que le changement technique évoluait à des rythmes et sous des formes spécifiques dans chaque secteur d’activité, notamment en raison d’arrangements institutionnels propres qui conditionnaient la génération, la circulation et l’appropriation des connaissances. Breschi, Malerba et Orsenigo (2000) ont complété ce travail en proposant l’idée de «régimes technologiques». Chacun de ces régimes, dont les spécificités tiennent notamment à des caractéristiques intrinsèques des sciences et des industries qu’il englobe, a vocation à être soutenu selon des modalités institutionnelles préférentielles : l’essaimage de start-up pour le logiciel et la pharmacie, les grands programmes verticaux pour le spatial, etc. Ces régimes technologiques se distinguent au premier ordre selon qu’ils se rapprochent de l’un ou l’autre des deux grands archétypes schumpétériens « Mark I » (celui où les outsiders jouent un rôle pionnier dans l’innovation, via le mécanisme de destruction créatrice) et « Mark II » (où ce sont au contraire les entreprises établies qui sont les plus innovantes, via le mécanisme d’accumulation de connaissances).
Un échantillon de douze innovations de rupture, représentatives de cette diversité
Douze innovations de rupture identifiées dans la littérature
C’est donc sur les innovations industrielles de rupture ainsi définies, et plus particulièrement les innovations orientées vers la résolution des transitions énergétique et numérique, que porte cette étude. Il s’agit de comprendre où elles naissent, par qui elles sont développées et appropriées, afin notamment de mesurer dans quelle mesure les grandes entreprises industrielles françaises y jouent toujours un rôle moteur.
Partant, la première étape a consisté à identifier, sur la base de documents stratégiques12 et d’auditions d’experts, un échantillon d’innovations de rupture qui présentaient de forts enjeux à la fois sociétaux et technologiques. Dans le secteur industriel, il existe une myriade de solutions qui répondent à ces deux critères et dont le caractère disruptif est déjà bien documenté, sinon avéré. Cette étude se concentre volontairement sur douze innovations de rupture, dont huit sont directement liées à la préservation de l’environnement et à la transition énergétique. En matière de transition bas carbone, certaines ont un caractère disruptif – puisqu’elles offrent un tout nouveau service – bien qu’elles ne s’appuient pas sur des technologies de pointe mais plutôt sur l’assemblage ou l’optimisation de technologies existantes. Par exemple, le développement de l’hydrogène vert dépend largement de l’optimisation de l’électrolyse, même s’il constitue une rupture dans les secteurs de l’énergie et de la mobilité, et qu’il mérite pour cette raison d’être suivi avec attention.
Chacune de ces douze innovations de rupture a fait l’objet d’une évaluation des enjeux économiques et sociétaux, des technologies prometteuses et des applications possibles (cf. figure 1.1).

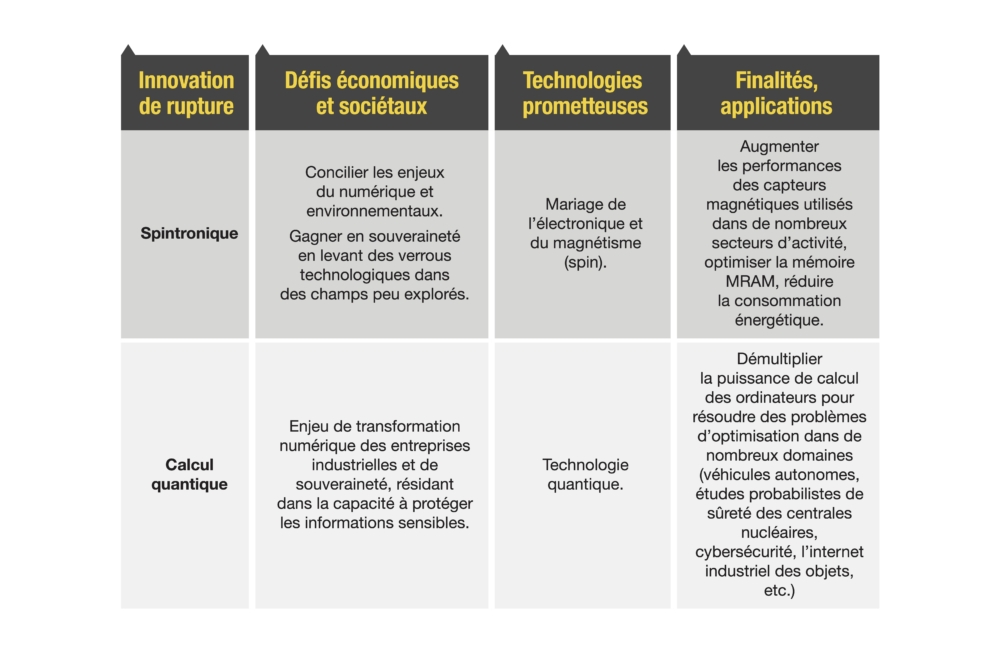
Une première mise en évidence des différents régimes technologiques
Sur chacune de ces douze innovations de rupture, un travail de bibliométrie de brevets a été réalisé par l’Observatoire des sciences et techniques (cf. méthode détaillée en annexe). Il est important de noter, pour la bonne compréhension des éléments à suivre, que ne sont comptabilisées ici que les familles de brevets13 ayant été déposées dans au moins deux offices nationaux ou internationaux. L’application de ce filtre permet d’écarter les brevets principalement défensifs (très abondants en Chine notamment), dont l’objet est surtout d’ériger une barrière juridique à l’entrée du marché même quand l’innovation est de faible valeur, et de ne considérer que les brevets offensifs, qui prétendent effectivement préparer la diffusion internationale d’une technologie importante. C’est une première précaution adoptée pour traiter de statistiques significatives. En pratique, la Chine, qui domine très largement le classement mondial des dépôts de brevets dans un office seulement, quelle que soit la technologie étudiée, s’efface au profit de pays de l’OCDE si l’on applique ce filtre qualitatif (cf. figure 1.2).
La deuxième précaution, qui s’ajoute à la première, consiste à sélectionner scrupuleusement des corpus de brevets qui portent effectivement sur les douze innovations de rupture retenues au sein de l’échantillon. Cette sélection est réalisée par la combinaison de filtres sur les classes de brevets (voir annexe 1) et par l’application de mots-clés. Cela représente un lourd travail d’expertise, revenant pratiquement à constituer « à la main » les corpus de brevets pertinents, de manière à ne traiter effectivement que de ruptures technologiques. C’est une des plus-values scientifiques de la présente contribution.
Il n’en reste pas moins que le choix de recourir à la bibliométrie de brevets pour apprécier le développement d’un petit nombre de technologies est un parti-pris méthodologique, qui emporte avec lui plusieurs hypothèses qu’il faut avoir présentes à l’esprit. Depuis les premiers pas de cet outil de mesure (Narin et al., 1984), la bibliométrie de brevets a connu d’amples développements et raffinements, toujours accompagnés d’une discussion sur ses possibilités et ses limites, comme le résume la bibliomètre Yoshiko Okubo (1997) dans un rapport de synthèse publié par l’OCDE (cf. encadré ci-dessous).
De l’usage de la bibliométrie de brevets (Okubo, 1997)
Utilité
«On peut utiliser le comptage des brevets pour identifier la place d’une invention et le rôle de chaque inventeur dans la mise au point de nouvelles techniques ; c’est donc une mesure de l’activité novatrice et de la capacité technologique à l’échelle des nations et des branches et entreprises industrielles. Les premiers travaux d’utilisation des statistiques sur les brevets, en tant qu’indicateurs de la S-T, ont porté sur des objets bien identifiés, des molécules par exemple. Par la suite, on a mesuré des technologies en compétition les unes avec les autres, ainsi que le niveau d’invention de pays en compétition autour d’une invention majeure.»
Limites
« La propension des industriels à breveter leurs inventions varie selon la branche industrielle et d’une entreprise à l’autre; un certain nombre d’améliorations technologiques majeures n’aboutissent pas à des brevets. De même, la “qualité” des brevets n’est pas systématiquement du même niveau; les brevets n’ont pas la même signification en termes d’innovation technique et d’avenir économique. Il n’est donc pas recommandé de comparer des dépôts de brevets pour diverses technologies ou différents secteurs industriels. Cependant, dans un domaine macroscopique bien déterminé, celui des pays par exemple, on peut entreprendre des comparaisons. En dépit des limites qu’ils présentent, les brevets sont et seront de plus en plus utiles comme source d’informations pour une mesure approximative de l’innovation. »
En résumé, cet outil de mesure n’aurait pas été pertinent dans certains domaines techniques (notamment le logiciel) mais il s’applique bien aux douze technologies de notre échantillon. Ajoutons que les résultats de la recherche publique ne se traduisent pas nécessairement par des dépôts de brevets. Le décompte de brevets est donc, par construction, un outil de mesure partiel et partial qui surpondère le poids des entreprises dans l’émergence des innovations. Par ailleurs, il faut se garder de comparaisons hâtives entre technologies, qui ont chacune leurs caractéristiques propres, aussi bien dans le développement général des connaissances que dans l’appropriation de certaines d’entre elles sous forme de brevets : les écarts relevés dans les volumes de brevets ne traduisent pas exclusivement les importances respectives, ni même les potentialités de transformation des technologies, mais également des différences intrinsèques de manifestation du progrès technique dans ces champs d’activité.
Précisément, et en toute première observation, la mesure des flux annuels de demandes de brevets14 dans le monde permet de confirmer l’existence de régimes technologiques très différents. D’une part, le nombre de brevets déposés par les acteurs économiques pour chacune de ces technologies varie grandement : de 23 par an en moyenne pour les carburants aériens durables à plus de 3 500 par an pour le photovoltaïque, sur la période 2010-2019 (cf. figure 1.3).
D’autre part, la cinétique de ces flux de demandes est elle aussi très variable (cf. figures 1.4). Certaines de ces technologies ont connu, au cours de la décennie 2010- 2019, une croissance très forte ; d’autres une croissance plus modeste à la limite de la stabilité ; d’autres encore des fluctuations plus saccadées ; et d’autres enfin une réduction, voire une quasi-extinction du flux de demandes.
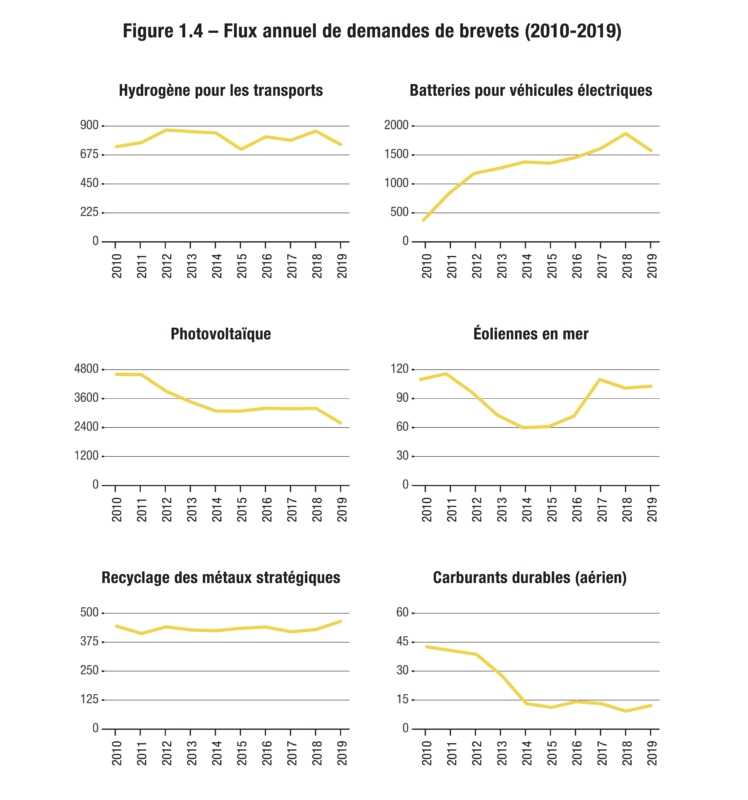
- 3. Tout au long de cette étude, les termes » innovation de rupture », « innovation radicale » ou encore « disruption technologique » seront utilisés de façon indifférenciée.
- 4. Source : Conseil de l’innovation.
- 5. Dans son livre publié en 1997, The Innovator’s Dilemma, Christensen distingue deux types d’innovation : l’innovation de rupture vers le bas du marché et l’innovation de rupture vers de nouveaux marchés. Nous nous concentrons ici sur la seconde. Plus tard, dans son ouvrage publié en 2013, The Innovator’s Solution, il considère que c’est moins la technologie que l’usage qui a un effet de rupture.
- 6. Source : ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, DGRI-DGESIP (2023).
- 7. Partant de cette définition, les innovations de rupture issues du numérique (Facebook, Doctolib, BlaBlaCar, etc.) sont exclues du champ d’analyse puisqu’elles ne sont pas à l’origine d’une innovation au sens technologique du terme.
- 8. Disponible en ligne sur le site de Bpifrance.
- 9. Larédo et Mustar (1994).
- 10. Voir, par exemple, les débats parlementaires périodiques sur les limites à imposer au crédit impôt recherche (CIR) pour stimuler l’innovation tout en limitant les effets d’aubaine, ou encore la pression de la Commission européenne pour encadrer très strictement les aides de l’Agence de l’innovation industrielle créée en 2005 (Djelalian et Neale-Besson, 2006).
- 11. Le principal reproche adressé aux politiques d’innovation verticales trop volontaristes (comme aux politiques industrielles d’ailleurs) est qu’elles demandent au décideur de se substituer à la «main invisible du marché» et de décider par avance des entreprises et des solutions techniques que le marché devrait privilégier. Cette décision nécessairement prise en situation d’information imparfaite est à la source de distorsions. Au mieux, selon les détracteurs de ces politiques, la solution retenue par les autorités s’avère sous-optimale (Concorde, Minitel…) ; au pire, elle se conclut assez vite par un échec et un gâchis d’argent public (Landier et Thesmar, 2014).
- 12. Notamment le rapport dit rapport Potier publié en février 2020 (Faire de la France une économie de rupture technologique) et le rapport de la Direction générale des entreprises (DGE) (Technologies clés 2020).
- 13. Une famille de brevets est une collection de demandes de brevets qui couvrent le même contenu technique ou un contenu technique similaire. Au sein d’une famille, les demandes sont reliées entre elles par des revendications de priorité. Source : epo. org.
- 14. Il peut s’écouler de cinq à huit ans entre la demande de brevet déposée par un acteur économique et sa délivrance définitive par l’office sollicité. Pour traiter des données aussi actuelles que possible, la bibliométrie porte usuellement sur les statistiques des demandes et non sur les brevets effectivement délivrés.
L’Asie et les États-Unis dominent les dépôts de brevets de manière écrasante
La France et les autres pays européens largement absents du palmarès
S’il est une caractéristique commune à toutes ces technologies, c’est que les dépôts de brevets sont très concentrés dans un petit nombre de pays. Si l’on fait exception du domaine des éoliennes en mer (on verra que ce secteur diffère du reste de l’échantillon en de nombreux points), les quatre premiers déposants détiennent toujours au moins la moitié des brevets déposés dans le monde. Dans six cas sur douze, ils en détiennent même au moins les trois quarts (cf. figure 2.1).
Il est encore plus frappant de constater que ce sont souvent les mêmes pays qui occupent les premières places du podium. Dans trois cas, plus de la moitié des brevets mondiaux sont détenus par un déposant américain, conférant aux États-Unis une très large avance sur tous les autres pays : il s’agit des agrocarburants pour l’aviation, de l’ordinateur quantique et de l’ARN messager. Dans ces deux derniers cas, la domination américaine est d’autant plus frappante qu’elle concerne des secteurs en très forte expansion (au sens où le nombre de brevets déposés croît très vite d’une année sur l’autre).
Pour quatre autres technologies, ce sont au contraire des déposants localisés en Asie, et plus précisément au Japon, en Corée et en Chine (ces trois pays étant de toute façon omniprésents sur 11 des 12 podiums), qui détiennent au moins la moitié des brevets mondiaux déposés dans la décennie étudiée : il s’agit de l’hydrogène pour les transports, des batteries pour véhicules électriques, du photovoltaïque et de la spintronique. À un point de pourcentage près, on pourrait également le dire de la nanoélectronique.
Si les États-Unis, le Japon, la Corée et la Chine figurent systématiquement parmi les quatre pays les plus représentés pour chacune de ces douze technologies de rupture, ce n’est pas le cas des pays d’Europe : ceux-ci n’apparaissent dans le top 4 que dans huit cas sur douze, dont six où l’Europe est représentée uniquement par l’Allemagne. Il n’y a que dans les domaines des éoliennes en mer et des carburants durables pour le secteur aérien, soit les deux plus « petits » de notre échantillon au sens du nombre total de brevets déposés, que trois autres pays européens se distinguent parmi les quatre premiers déposants : le Danemark, la Finlande et les Pays-Bas.
La France, quant à elle, est totalement absente de ce tableau.
Un regard complémentaire par le biais des indices de spécialisation
Tous les pays n’ont évidemment pas la possibilité de figurer aux premiers rangs des palmarès mondiaux de déposants de brevets, pour la simple raison qu’ils n’ont pas tous la même taille et donc pas la même capacité économique et humaine à produire de nouvelles connaissances. C’est pourquoi on complète usuellement le raisonnement quantitatif précédent par une approche en matière de niveau de spécialisation.
L’indice de spécialisation (cf. figure 2.2) est le rapport entre la part mondiale d’un pays dans une technologie donnée et sa part mondiale tous domaines confondus. Ce ratio est le même, par construction arithmétique, que celui de la part nationale de la technologie considérée sur la part mondiale de cette même technologie. Ainsi, par exemple, si l’on considère la première case en haut à gauche du tableau ci-dessous, la part mondiale des brevets déposés par la Corée du Sud est 1,7 fois plus importante dans l’activité « hydrogène pour les transports » qu’elle ne l’est en général, tous domaines confondus. Cette technologie est également 1,7 fois plus présente dans l’ensemble des brevets déposés par la Corée du Sud qu’elle ne l’est dans le monde.
Ce tableau livre plusieurs enseignements. Premièrement, on y voit effectivement apparaître des « petits » pays, qui ne peuvent pas occuper une position de leaders dans un grand nombre de domaines mais qui peuvent exprimer des spécialisations marquées dans certains d’entre eux. C’est le cas de plusieurs pays européens pour la technologie des éoliennes en mer, du Chili pour le recyclage de métaux stratégiques ou encore de Taïwan pour la nanoélectronique et la spintronique.
Deuxième enseignement, plusieurs des grands pays leaders repérés précédemment figurent à nouveau dans ce tableau des pays les plus spécialisés. Par exemple, la Corée et le Japon confirment leur position dominante dans les secteurs de l’hydrogène pour les transports, des batteries pour véhicules électriques ou encore du photovoltaïque. C’est aussi le cas des États-Unis dans le secteur de la nanoélectronique et de l’ordinateur quantique.
Un décrochage français ?
Le troisième enseignement livré par le tableau précédent est que, à une exception près (au quatrième rang dans le domaine de l’hydrogène pour les transports), la France n’apparaît toujours pas parmi les pays les plus actifs dans tout ou partie de ces technologies.
Un pays qui, à l’instar de la France, ne témoigne pas d’un indice de spécialisation élevé dans quelque domaine que ce soit est un pays dont l’effort de recherche est très polyvalent, au sens où il se conforme à la moyenne mondiale dans la répartition thématique de ses productions. Cela n’est pas une faiblesse en soi. Une autre manière de le dire est que, par construction même des indicateurs, tout pays qui témoigne de points forts les compense nécessairement par des points faibles, puisque chaque pays a par définition un indice de spécialisation moyen, tous domaines confondus, égal à un.
Cela étant, il reste frappant que, sur un échantillon de douze technologies volontairement identifiées comme étant de rupture, dont les deux tiers sont liés à la transition énergétique face au changement climatique, la France n’apparaisse jamais comme un pays ni leader ni spécialisé.
Le tableau suivant précise le rang mondial et l’indice de spécialisation de la France dans chacune de ces douze technologies (cf. figure 2.3). Son rang mondial varie de la cinquième à la huitième place.
À titre de comparaison, il faut savoir que, tous domaines confondus, et sans appliquer le filtre qualitatif d’un dépôt dans au moins deux pays, la France apparaît au huitième rang mondial des déposants de brevets auprès de l’office américain, selon les indicateurs de la National Science Foundation (Robbins, 2022) et, selon l’INPI, au cinquième rang mondial des déposants auprès de l’office européen (2023). Cette affinité géographique en faveur de l’office le plus proche est un phénomène connu des statisticiens. Cela étant, et tout bien considéré, il paraît quand même difficile de s’enthousiasmer, comme le fait ce communiqué de presse de l’INPI, à l’idée que la France serait «le deuxième déposant européen et le cinquième mondial » : replacées dans un cadre mondial, la position de la France dans le monde et celle de l’Europe en général font davantage penser à une situation de décrochage technologique15.
Un autre critère de comparaison permet de s’en convaincre. La France représente en effet, en 2022, la septième économie mondiale à l’aune de son PIB16. Le Royaume-Uni et l’Inde, qui la devancent dans ce classement, sont tout aussi absents qu’elle des palmarès précédents de déposants de brevets. À l’inverse, la Corée du Sud, incontestablement l’un des leaders dans cet échantillon de douze technologies de rupture, n’est qu’au douzième rang mondial en matière de PIB, son économie étant en volume 13 fois plus réduite que celle des États-Unis et 1,6 fois plus réduite que celle de la France (cf. figure 2.4).
La France fait donc bien figure, certes avec deux autres, de pays comparativement peu engagé dans la compétition technologique mondiale, tandis que la Corée apparaît au contraire comme farouche et déterminée.
Bien sûr, le caractère plus ou moins désindustrialisé des différents pays est l’une des explications de ce paradoxe, mais il n’explique pas entièrement cette différence d’implication : si la France possède effectivement la huitième industrie mondiale mesurée en valeur ajoutée, l’industrie coréenne, au cinquième rang, est bien plus proche en volume de l’industrie indienne que de l’industrie allemande, pratiquement deux fois plus importante qu’elle. Sa place parmi les déposants mondiaux de brevets reste donc remarquable et, plus généralement, il demeure, toutes choses égales par ailleurs, une différence d’implication de ces différents États dans le développement de nouvelles technologies.
L’Union fait la force ?
Face à deux superpuissances comme les États-Unis et la Chine, il paraît cohérent de comparer préférentiellement l’Union européenne tout entière. Les pays européens considérés séparément peuvent en effet difficilement rivaliser avec leurs concurrents chinois et américain, qui s’appuient en partie sur leurs vastes marchés intérieurs.
Il est intéressant de constater que l’Union européenne figure systématiquement parmi les quatre premiers déposants mondiaux (cf. figure 2.5). Elle occupe même la première place du podium dans quatre domaines : il s’agit des éoliennes en mer, du recyclage de métaux stratégiques, de l’acier bas carbone et du recyclage biologique des plastiques. Dans le domaine des éoliennes en mer, l’Union européenne détient près des deux tiers des brevets. Son leadership est toutefois moins marqué ailleurs puisqu’elle ne détient jamais plus de la moitié des brevets.
À l’inverse, les États-Unis confirment leur forte domination face à l’UE dans les domaines de l’ordinateur quantique et de l’ARN messager, du fait qu’ils y concentrent plus de la moitié des brevets. Il en va de même pour le Japon qui reste leader dans les domaines de l’hydrogène pour les transports et des batteries pour véhicules électriques. L’Union européenne y occupe, quant à elle, la deuxième place et devance ainsi les États-Unis et la Corée.
Quels enseignements tirer de ces résultats ?
D’abord, l’Europe considérée dans son ensemble apparaît comme une concurrente sérieuse face aux grandes puissances que sont les États-Unis et la Chine. Si l’on fait exception de la spintronique, son rang mondial varie entre la première et la deuxième place des déposants de brevets. L’Union européenne a donc incontestablement une carte à jouer dans l’avènement des innovations de rupture, notamment celles liées à la lutte contre le dérèglement climatique.
Cela étant, la mise en perspective de ces résultats avec le tableau désagrégée proposé dans la figure 2.1 nous impose d’émettre quelques réserves. D’abord, une poignée de pays européens, au premier rang de laquelle l’Allemagne, figurait déjà parmi les leaders dans huit technologies sur douze. Autrement dit, le leadership de l’Union européenne s’explique essentiellement par celui de l’Allemagne et plus marginalement par les performances d’autres pays européens à l’instar du Danemark, de la Finlande et des Pays-Bas. Inversement, la France ne joue aucun rôle significatif en la matière, ce qui est une confirmation douloureuse de sa position défavorable dans la compétition technologique non seulement mondiale mais aussi européenne. Par ailleurs, à l’exception des éoliennes en mer, l’Union européenne ne domine jamais un domaine technologique au point de conserver assurément son avance dans les années à venir. À l’inverse, la domination des États-Unis reste intacte dans les domaines en forte expansion que sont l’ordinateur quantique et l’ARN messager.
Ensuite, comparer l’ensemble des pays européens, d’un côté, à des pays « isolés » comme le Japon ou la Corée, de l’autre, paraît peu équitable. Pour le dire autrement, agréger les scores des pays européens en un seul ne fait que renforcer, par comparaison, l’impression d’engagement déterminé dans la course technologique que renvoient le Japon et la Corée.
Il paraît enfin difficile de se réjouir du leadership européen dans la mesure où l’Union européenne reste minée par des dissensions internes qui l’empêchent de se doter d’une véritable politique industrielle coordonnée entre les États. Si chaque pays préfère défendre ses propres intérêts plutôt que de construire une stratégie commune, alors les performances technologiques de l’Union européenne tout entière s’apparentent davantage à un mirage qu’à une réalité.
Entre public et privé, une répartition propre à chaque technologie
Les entreprises prépondérantes parmi les déposants de brevets
Après avoir examiné l’origine géographique des brevets dans les parties précédentes, on étudie ici les apports respectifs des acteurs publics et privés. Dans l’ensemble (cf. figure 2.6), on note au premier regard que les brevets issus des entreprises sont largement prépondérants.
Il existe toutefois deux exceptions : pour la nanoélectronique et l’ARN messager, la part des brevets déposés par des universités et des organismes publics de recherche est sensiblement plus élevée que pour les dix autres technologies. Ce constat ouvre un questionnement important sur le lieu de naissance de ces innovations de rupture et sur les rôles respectifs de la recherche publique et des entreprises en la matière. Est-ce d’abord une question de technologie (hypothèse 1 : selon les domaines, il faut parfois plus de connaissances universitaires pour produire une innovation de rupture, notamment dans le domaine de la santé), ou une question de cinétique (hypothèse 2 : plus une technologie est « jeune », plus la recherche publique joue un rôle essentiel dans son émergence), ou encore une question d’avantages comparatifs (hypothèse 3 : la puissance innovante des universités de tel ou tel pays leur confère un avantage mécanique dans les technologies qu’ils investissent)… ?
Les quatres figures 2.7.a à 2.7.d (voir pages 48 et 49) livrent un premier jeu de réponses à ces questions. D’abord, la figure 2.7.a permet d’évacuer l’idée d’une possible corrélation avec le mode de progression des dépôts mondiaux de brevets : le poids des entreprises parmi les déposants peut être très élevé ou, au contraire, relativement en retrait pour des innovations en phase de forte expansion, que l’on peut donc considérer comme « jeunes ». Inversement, ce poids des entreprises est assez invariant, que les innovations suivent des tendances croissantes, décroissantes, stables ou même erratiques. La figure 2.7.b confirme ce constat, en montrant l’évolution du poids des entreprises année après année, en ce qui concerne les sept cas de technologies pour lesquelles l’information est disponible : certaines ont une part des entreprises parfaitement stable (par exemple pour les batteries), pour d’autres cette part croît subitement à partir d’un moment précis (ANR messager), pour d’autres encore elle tend à décliner. Ce n’est donc pas l’âge d’une technologie qui semble déterminer, au premier chef, la répartition des rôles entre déposants publics et déposants privés.
En revanche, la figure 2.7.c suggère que la part des entreprises est globalement plus élevée pour les innovations caractérisées par une domination des pays asiatiques (Chine, Japon, Corée) et qu’elle est au contraire plus proche de 50 % pour les innova- tions marquées par un leadership américain. On peut donc suspecter l’influence partielle d’avantages comparatifs. La figure 2.7.d confirme cette hypothèse, en montrant à quel point les pays peuvent être marqués par des prépondérances plus ou moins fortes de l’une ou l’autre catégorie de déposants. Au Japon et en Allemagne, par exemple, les déposants publics comptent relativement moins que pour l’ensemble des pays étudiés, alors qu’ils sont comparativement plus représentés parmi les déposants américains, chinois et, bien plus encore, parmi les déposants français.
Il existe donc des cinétiques internes à chaque corpus qu’il importe de regarder de plus près pour comprendre ce qui se joue.
Batteries
Comme on l’a vu précédemment, le domaine des batteries pour véhicules électriques fait partie des technologies à croissance forte, avec quatre pays leaders (Japon, Corée, Allemagne et États-Unis) à l’origine de près de 90 % des brevets déposés dans la décennie étudiée. La figure 2.7.b précédente enseigne également que les entreprises n’ont fait que confirmer leur domination quasi exclusive, puisqu’elles sont à l’origine de plus de 95 % des demandes de brevets.
Le graphique 2.8.a nous confirme que la recherche publique, tous pays confondus, n’occupe qu’un rôle mineur dans ce domaine. L’essentiel de la bataille technologique se joue plutôt entre les entreprises japonaises (nettement dominantes au début mais qui semblent s’être heurtées à un plafond de verre puis, peut-être, s’essouffler en fin de période), allemandes (parties en retard mais avec le plus fort taux de progression de l’échantillon et qui pourraient rapidement prendre la place de leader), coréennes (au coude à coude avec les entreprises allemandes) et américaines (en progression dynamique elles aussi, mais pas assez pour prendre l’ascendant sur les précédentes, et peut-être bientôt dépassées par les entreprises chinoises). La catégorie « autres », qui semble bénéficier d’un réveil tardif à partir de 2016, comprend quasi exclusivement des entreprises européennes (françaises, britanniques et autrichiennes).
Acier bas carbone
Le développement d’acier bas carbone fait l’objet d’un flux de brevets en croissance modérée, mené par le Japon, l’Allemagne, les États-Unis et la Chine. La part des entreprises y apparaît en repli progressif, ce que confirme et explique le graphique 2.8.b.
En effet, les entreprises japonaises, qui déposent entre 60 et 85 brevets par an, dominent assez nettement cette technologie. Leurs concurrentes allemandes faisaient presque jeu égal avec elles en 2010, mais ont tendanciellement réduit leur effort, rattrapées en outre par les Américaines et les Coréennes, parties de plus bas mais plus dynamiques dans la durée.
Fait doublement exceptionnel : non seulement la recherche publique a accentué significativement son effort d’innovation à partir de 2014, mais cet effort, qui plus est, se répartit à peu près à parité entre les laboratoires chinois et ceux du reste du monde, qui suivent des dynamiques très proches. Faut-il croire qu’une nouvelle génération de technologies est sur le point de survenir, sous leadership chinois ?
Nanoélectronique
La nanoélectronique est un domaine marqué par des dépôts de brevets en croissance modérée, dominé par quatre pays : États-Unis, Chine, Corée et Japon. C’est aussi un des rares secteurs où la recherche publique représente une part importante des brevets déposés. Du côté des entreprises, majoritaires, le graphique 2.8.c ci-dessous montre que les entreprises américaines tiennent, de manière stable, la première marche du podium. Elles sont toutefois de plus en plus contestées dans leur leadership par leurs concurrentes japonaises, coréennes et chinoises, qui suivent une progression dynamique. On pourrait également le dire des entreprises taïwanaises, si ce n’était un mouvement de décrue en fin de période.
Du côté de la recherche publique (cf. graphique 2.8.d), la Chine, les États-Unis et le reste du monde se partagent aujourd’hui les dépôts de brevets en trois tiers égaux, à l’issue d’une décennie marquée par l’ascension de la recherche chinoise et le repli des deux autres. Dans l’ensemble, le flux de brevets issus de la recherche publique a quasiment été divisé par deux en dix ans, passant de près de 200 brevets par an à presque 100 par an. La part de la recherche publique dans le flux total s’est donc repliée de plus d’un tiers en début de période à un quart aujourd’hui.
ARN messager
La technologie de l’ANR messager se distingue du reste de l’échantillon à plus d’un titre. Primo, le volume mondial de brevets suit une croissance très forte, qui n’a pas encore marqué de point d’inflexion. Secundo, la domination américaine y est particulièrement prononcée. Tertio, la recherche publique y occupe une plus large place que dans toutes les autres technologies de l’échantillon.
Le graphique 2.8.e ci-dessous nous permet de comprendre comment ces spécificités se conjuguent. En effet, la recherche publique américaine a une activité de dépôt de brevets soutenue, en légère croissance sur la décennie. Elle représentait la moitié des dépôts issus de la recherche mondiale en début de période mais, après le « réveil » des autres laboratoires du monde (en Asie et en France principalement), elle s’est fait distancer de sorte à ne plus en représenter qu’un tiers. Cet effacement devrait se poursuivre encore quelques années, à en juger par l’allure des courbes. Les entreprises ont suivi la même tendance très soutenue : d’abord les entreprises américaines puis les entreprises du reste du monde, qui pèsent toujours autant mais sans parvenir à les distancer. Finalement, la recherche publique, qui était à l’origine de la moitié des dépôts en 2010, n’en représente plus qu’un tiers en 2019, et par le jeu du relais public-privé, les États-Unis sont toujours à l’origine de 50 %, voire de 60 % des dépôts chaque année.
Spintronique
Le domaine de la spintronique fait l’objet d’un flux de brevets légèrement croissant, à la limite de la stabilité, emmené par le leadership prépondérant des Japonais et des Américains. Le graphique 2.8.f ci-dessous le confirme, les entreprises américaines et japonaises occupant alternativement la première et la deuxième place du podium. La recherche publique mondiale, toutes origines confondues, occupait initialement un rôle secondaire mais elle a vu son poids se confirmer au cours de la décennie, ce qui est assez rare en fin de période. Les entreprises coréennes, quant à elles, avaient entamé la décennie de manière très volontariste ; elles suivent depuis 2013 une tendance décroissante.
Hydrogène
On a vu au paragraphe précédent que les technologies dédiées à l’usage de l’hydrogène dans les transports se caractérisent par une grande stabilité des dépôts de brevets dans le temps, une situation oligopolistique avancée (Japon, États-Unis, Corée et Allemagne détiennent 83 % du flux mondial sur la décennie) et une part des entreprises établie de manière très stable à 90 % environ des déposants mondiaux. Le graphique 2.8.g confirme cette stabilité : la recherche publique, d’où qu’elle soit dans le monde, occupe la même place modeste tout au long de la décennie, quand les entreprises coréennes, allemandes et américaines déposent respectivement entre 100 et 150 brevets par an (on note tout de même un repli tendanciel des dépôts américains) et que les entreprises japonaises dominent nettement ce palmarès, puisqu’elles déposent entre 250 et 300 brevets par an.
Photovoltaïque
Le photovoltaïque, on l’a vu, est un domaine marqué par un reflux important des dépôts annuels de brevets, que les entreprises représentent de manière stable autour de 80 %. Le graphique 2.8.h nous confirme que les entreprises japonaises et américaines, leaders historiques, ont drastiquement réduit leur activité inventive, tout comme l’ont fait les entreprises des autres pays du monde impliqués (Allemagne, Taïwan, France, Royaume-Uni, Suisse et Italie) et les laboratoires de recherche publique.
Hormis le cas particulier des entreprises coréennes, qui maintiennent une activité stable, tout se passe comme si, aux yeux des entreprises occidentales, la lutte pour la domination technologique appartenait maintenant au passé. Seules les entreprises chinoises ont connu un rythme ascendant toute cette décennie, au point de devenir leaders mondiales. Il faudra vérifier dans quelques années, avec un meilleur recul statistique, si le repli enregistré en 2019 en Chine est conjoncturel (en raison notamment de la crise du Covid-19) ou si les entreprises chinoises considèrent elles aussi que l’épisode de rupture technologique est maintenant refermé.
À noter : des recherches sur des mots-clés tels que « Perovskite » confirment que l’activité inventive se poursuit sur des technologies photovoltaïques de nouvelle génération, cependant le flux de brevets concernés, quoique croissant, reste encore confidentiel.
Proposition de synthèse
En résumé, les dépôts de brevets relatifs aux innovations de rupture de notre échantillon sont, dans leur immense majorité, issus d’entreprises. La plupart des technologies se caractérisent en outre par une grande stabilité de cette part des brevets déposés chaque année par les entreprises, que le volume total de brevets soit plutôt en croissance, stable ou en décroissance. Autrement dit, il n’arrive jamais que les entreprises cèdent collectivement la place à la recherche publique : quand les entreprises réduisent le volume de brevets déposés, comme dans le cas du photovoltaïque, la recherche publique fait de même.
En sens contraire, il peut arriver que la recherche publique fasse figure de pionnière – semblant ouvrir la voie avant de céder le terrain aux entreprises qui prendraient le relais (nanoélectronique et ARN messager) –, ou qu’elle reprenne de la vigueur alors même que les entreprises semblent avoir installé une activité de dépôt de brevets plutôt régulière (spintronique et acier bas carbone).
En outre, il n’y a pas de cas dans notre échantillon où la recherche publique coréenne ou japonaise exprimerait une forme de leadership. Quand des laboratoires et des universités d’un pays sont tellement en avance sur leurs homologues qu’ils font presque jeu égal avec les entreprises, c’est qu’ils sont soit américains (nanoélectronique et ARN messager) soit chinois (acier bas carbone et nanoélectronique). Inversement, le leadership de la Corée et du Japon, ou plus occasionnellement de l’Allemagne, s’exprime exclusivement par le truchement de leurs entreprises.
- 15. Toutes les données exploitées et présentées dans cet ouvrage sont tirées de Patstat, une base de données produite par l’Office européen des brevets (OEB), qui contient des données exhaustives de dépôts de brevets réalisés auprès des principaux offices nationaux et de deux grands offices régionaux, l’Office européen de brevets et l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI, ou WIPO, pour World Intellectual Property Organization).
- 16. Source : Banque mondiale (indicateurs).
Point de vue – Les trajectoires de l’innovation
Chercheur au Centre for Science, Technology & Innovation Policy de l’université de Cambridge, Martin Ho étudie l’émergence des technologies sur le long terme. À ce titre, il contribue régulièrement aux exercices nationaux de prospective technologique au Royaume-Uni.
L’étude des trajectoires technologiques
Un débat important se déroule en ce moment au sein des pays industrialisés pour savoir s’ils devraient accorder plus de poids aux politiques « orientées mission », c’est-à-dire aux politiques qui visent des objectifs décidés par le gouvernement et se concentrent sur un petit nombre de technologies radicales – par opposition aux politiques « orientées diffusion », qui financent des infrastructures de recherche et des programmes initiés par les chercheurs. La DARPA américaine a été abondamment saluée comme l’archétype d’une agence capable d’initier de nouvelles trajectoires technologiques. Or, avant de répliquer ce modèle au Royaume-Uni, certains parlementaires ont demandé que la preuve de son efficacité soit faite. C’est à cette question que mes travaux tentent de répondre.
Mon travail consiste à représenter l’enchaînement déterministe aboutissant à l’émergence d’une technologie donnée, depuis la recherche fondamentale jusqu’à la commercialisation. J’ai notamment appliqué cette méthode à huit vaccins, y compris deux vaccins à ARNm développés contre le COVID-19.
En pratique, je travaille sur des réseaux de citations multicouches, liant entre eux publications académiques, brevets, essais cliniques et approbations réglementaires, correspondant respectivement aux diverses étapes de l’innovation : recherche, développement, production et commercialisation. Le plus long chemin au sein d’un réseau de citations est comparable au chemin critique de la recherche opérationnelle ; je le considère comme la meilleure représentation d’une trajectoire technologique, ponctuée d’événements qui constituent les « goulots d’étranglement » du progrès technique< (en l’occurrence ici en vue du développement d’un vaccin).
Les réseaux concourant à une innovation donnée sont extrêmement vastes
Pour chacun des huit vaccins – donc des huit réseaux de citations – que j’étudie, un nœud représente un événement d’innovation unique (par exemple une recherche appliquée) et une flèche représente la diffusion de connaissances entre deux événements. La taille médiane de ces huit réseaux correspond à 62 793 nœuds et 357 320 flèches. Dans le cas particulier du vaccin Moderna Spikevax, il aura fallu 112 858 événements d’innovation et 786 561 mouvements de diffusion de connaissance pour aboutir.
Naturellement, cette taille des réseaux de citations dépend directement de la méthode et de la profondeur de l’échantillonnage. J’utilise l’approbation des agences européenne et américaine du médicament (EMA et FDA) comme points de départ, cherche ensuite les essais cliniques cités par ces agences, puis recherche les articles cités par les brevets de vaccins, etc. Votre Note adopte une approche différente, à savoir un échantillonnage par mots-clés et codes de classification des brevets (CPC), pour chacune des douze innovations de rupture. Cela aboutit, de manière naturelle, à des échantillons de tailles très différentes.
Dans les réseaux que j’étudie, je peux en outre observer les bailleurs de fonds associés à chaque nœud. Au sein du réseau « Biontech/Pfizer Comirnaty », 49 pays apparaissent. Les entités domiciliées aux États-Unis financent 67 % des événements liés à ce vaccin particulier, au Royaume-Uni 10 %, au Canada 2,8 %, en Belgique 2,7 %, au Japon 2,5 %, en Chine 2,1 %, en Allemagne 1,6 %, et en France 1,4 %. On obtient des résultats similaires pour le réseau « Moderna Spikevax » : 48 pays, dont les États-Unis (73 %), le Royaume-Uni (5,6 %), le Japon (3,3 %), la Belgique (2,7 %) et la France (1,9 %). L’ordre d’apparition des pays concorde de manière générale avec vos résultats, mais j’observe une pondération plus importante que vous des États-Unis et du Royaume-Uni, parce que je tiens compte des publications académiques et des essais cliniques et non pas seulement des brevets (nota bene : je parle ici de la nationalité des bailleurs de fonds, tandis que vous identifiez celle des entités qui exécutent les travaux de R&D).
Je constate que les entreprises n’ont financé respectivement que 4,6 % et 2,7 % des événements des réseaux Comirnaty et Spikevax. Les publications académiques représentent en effet la plus grande part des nœuds au sein de chaque réseau d’innovation.
Je souhaite ajouter que, le plus souvent, les applications futures des premières innovations sont inconnues ex ante. En d’autres termes, la plupart des contributions à l’innovation sont non intentionnelles, motivées par d’autres objectifs que ceux qui les justifieront a posteriori, ou par pure curiosité. Les interventions intentionnelles, en particulier celles des agences « orientées mission », sont nettement plus rares.
Enfin, le recul temporel d’un réseau d’innovation dépend du nombre d’itérations utilisées dans l’échantillonnage. Si je prends pour critère la plus longue chaîne de citations, j’observe qu’il aura fallu environ 60 ans entre le premier goulot d’étranglement (découverte de l’ARNm) et le dernier (première autorisation d’urgence), autrement dit pour amener le vaccin du niveau scientifique fondamental à son entrée sur le marché. La croissance du réseau, plus précisément du nombre d’événements ainsi interreliés, suit une courbe en S caractéristique : à 20 ans d’amorçage ou de pré-rupture, succèdent 30 ans de croissance vive puis 10 ans de saturation.
Quel poids et quel rôle pour chaque institution ?
Cela fait longtemps que l’on essaie, mais en vain, d’imputer à une décision politique l’émergence d’une innovation donnée. Il est difficile de décrire la contribution d’une agence ou d’un laboratoire autrement que de manière anecdotique et qualitative, que soit au cours des comités d’évaluation ou plus généralement d’études de cas. Sur un plan quantitatif, les outils demeurent assez classiques : les organisations de grande taille et « orientées diffusion » auront tendance à comptabiliser des mesures de popularité ou de volume (citations de publications, nombre de brevets…), tandis que les agences « orientées mission » comme la DARPA mesurent plutôt les effets de levier financiers ou le nombre de start-up issues de leurs programmes.
Je tente pour ma part d’apprécier la « criticité » de chaque contribution. Fondamentalement, il s’agit de sa distance avec le chemin critique, c’est-à-dire avec le plus long réseau de citations. Plus un événement est proche du chemin critique, plus il est susceptible de constituer un goulot d’étranglement en matière d’innovation. C’est ainsi que je mets en lumière une différence, parmi les bailleurs de fonds, entre les plus généreux et les plus décisifs. Par exemple, pour le vaccin Shingrix développé par GSK, les National Institutes for Health (NIH) dominent en tant que plus grand contributeur, mais ce sont la DARPA, le Conseil suédois de la recherche et GSK qui ont financé les innovations les plus critiques.
Ces réseaux suivent dans l’ensemble un schéma linéaire, progressant des publications vers les brevets, essais cliniques et enfin les approbations réglementaires. Les mouvements contraires sont plus rares mais non négligeables, par exemple des brevets vers de nouvelles publications. Plus précisément, 18 % des flèches vont de l’amont vers l’aval, quand 7,5 % font l’inverse. Le reste des liens, qui sont donc majoritaires, sont internes à chaque phase du processus.
Il est généralement admis que les agences « orientées diffusion » soutiennent sans distinction la recherche fondamentale à un stade précoce, tandis que les entités « orientées mission » (DARPA, BARDA et NCATS) comblent le fossé séparant l’innovation amont de l’innovation aval. Dans le cas du vaccin Novavax, l’activité médiane des NIH se situe 12 ans avant l’autorisation de la FDA, tandis que les agences « orientées mission » se situent entre 2 et 8 ans en amont. Les données sont moins concluantes pour les grandes entreprises du secteur pharmaceutique mais celles-ci se situent quelque part entre les deux.
Ultimes remarques
L’innovation de rupture est définie dans votre rapport comme un ensemble de technologies radicales à l’origine de nouvelles activités innovantes et d’un investissement important pour un marché incertain. Le rapport invoque à juste titre la définition originale de Christensen (1997) de « l’innovation de rupture ». Un point important souligné par Christensen est que les entités qui recherchent une innovation de rupture obtiennent initialement des performances inférieures aux produits établis sur le marché grand public et ciblent pour cette raison des segments de niche. Cela leur permet une amélioration rapide des performances, qui finissent par atteindre et dépasser les performances exigées par le marché grand public. Christensen suggère que les grandes entreprises historiques ne peuvent se concentrer que sur leurs clients traditionnels et donc attaquer le marché « par le haut », en raison de leur nécessité de conserver des flux de trésorerie importants. Cela offre aux startups la possibilité de l’attaquer « par le bas », toujours en ciblant des segments de niche. Pour les douze technologies analysées dans ce rapport (figure 4.3), cela pourrait impliquer que les technologies plus jeunes pourraient bénéficier d’une plus grande présence de start-up. Pour autant, vos résultats soulignent qu’il existe de nombreuses configurations possibles et que la maturité d’une technologie n’est sans doute pas la seule variable explicative des rôles respectifs des start-up et des grandes entreprises.
En ce qui concerne l’origine géographique des brevets de rupture et la domination des grands pays industrialisés tels que les États-Unis, la Chine et le Japon, il convient de noter les effets possibles de la loi américaine Bayh Dole (et de son équivalent chinois), qui incite les universitaires à essaimer. Il convient également de noter les vastes marchés intérieurs dont bénéficient les États-Unis, la Chine et le Japon. La Chine dispose en particulier de chaînes de valeur et d’approvisionnement domestiques très complètes.
Concernant l’origine institutionnelle des brevets, le rapport montre que la part des brevets issue du secteur public est, au fil du temps, de plus en plus remplacée ceux du secteur privé, mais que celle-ci semble toutefois, saturer à environ 90 %. Là encore, cela suggère que les brevets constituent l’activité prédominante des entreprises pour protéger leur propriété intellectuelle, alors que les entités publiques sont moins incitées à le faire. Une autre explication plausible est qu’un certain niveau de dépôt de brevets déclenche l’implication des acteurs publics ; il pourrait à ce titre être intéressant de caractériser ces 10 % de brevets restants.
Le rôle discret mais déterminant de la recherche publique
Une intervention publique nécessaire
Le fait que les entreprises soient à l’origine de la grande majorité des dépôts de brevets (cf. chapitre 2), y compris dans les innovations de rupture, n’évacue pas la question du rôle joué par les laboratoires publics dans leur émergence. L’analyse fine des données nous a même suggéré qu’ils étaient parfois incontournables.
En fait, les économistes ont établi depuis les années 1960 – d’abord d’un point de vue théorique (Nelson, 1959 ; Arrow, 1962) puis par de multiples confirmations empiriques (Levin et al., 1987 ; Mansfield et al., 1981 ; Hall, 2002) – que les entreprises et autres détenteurs de capitaux agissant sur un marché parfaitement libre avaient tendance à sous-investir dans la connaissance, pourtant moteur de la croissance, et que cette « défaillance de marché » réclamait une intervention publique. Cela provient du fait que la connaissance est un bien non rival (le fait de disposer d’un savoir n’empêche pas autrui d’en disposer également) et qu’elle génère des externalités positives. Pour cette raison, tout acteur économique doit se prémunir contre d’éventuels passagers clandestins, qui s’approprieraient à moindres frais les connaissances qu’il s’évertue à développer, tout en étant lui-même tenté d’en faire autant.
On peut ajouter que plus la connaissance est partageable moins elle est appropriable, et plus le financement public est nécessaire. De là découle une répartition des rôles assez schématique, où les entreprises investissent préférentiellement dans le développement technologique appliqué et l’innovation (toutes choses qu’il est plus facile de protéger par le secret ou par des brevets, et qui présentent par ailleurs des temps de retour sur investissement plus courts), tandis que la puissance publique se charge de financer l’avancement général des connaissances.
Par extension, on comprend rapidement que, dans le cas particulier des technologies de rupture, l’impulsion et la prise de risque scientifique ont toutes les chances d’échoir dans un premier temps à la recherche publique. En pratique, dans les secteurs d’activité peu capitalistiques où les générations technologiques se succèdent rapidement (typiquement, dans le numérique), ou encore quand on parle de révolution dans les usages, il peut advenir que des innovations de rupture soient totalement développées en interne par des entreprises innovantes, grandes ou petites. Mais, dans le monde industriel, ce processus requiert un temps de maturation structurellement plus long. Cette différence explique en grande partie le rôle joué par la recherche académique dans l’émergence des grands domaines technologiques ici étudiés, tels que la nanoélectronique, l’hydrogène décarboné, le calcul quantique, les nouvelles générations de cellules photovoltaïques, etc. On a vu toutefois au chapitre précédent que l’observation empirique n’obéissait pas à des schémas universels ou immuables.
Quoi qu’il en soit, la recherche publique – fondamentale ou appliquée – offre un environnement favorable aux innovations de rupture. Elle s’appuie sur des compétences pointues et est moins soumise aux contraintes de délai ou de retour sur investissement que les directions R&D des entreprises. La recherche fondamentale elle-même, qui a pour objectif d’étendre la connaissance sur un sujet donné, et pas forcément de déboucher sur des applications concrètes ou marchandes, peut donner lieu par le fruit de la sérendipité à des découvertes inattendues. À titre d’exemple, Pascal Boulanger, fondateur de la deeptech Nawatechnologies17, explique que son entreprise est née des travaux de recherche fondamentale conduits au CEA18 dans les années 2000 sur les nanotubes de carbone19. Le matériau en question a de multiples applications : le défi a alors été de démontrer la possible application de ces recherches dans le domaine le plus attractif. Parmi les domaines identifiés dans le cadre d’une étude de marché, celui du stockage d’énergie a été retenu20.
À cet égard, l’un des premiers enjeux de la poursuite des innovations de rupture tient donc au niveau de financement et d’excellence de la recherche publique – qui ne se révèle pas toujours suffisant – et au ralentissement général de la découverte de connaissances disruptives, partout dans le monde et dans tous les domaines d’activité (cf. encadré ci-contre).
La recherche et la technologie de moins en moins disruptives (synthèse d’article)
Park, Leahey et Funk (2023) partent d’un constat paradoxal. Après plus d’un siècle d’observation, l’hypothèse d’une croissance endogène des connaissances est largement privilégiée : la science et la technologie sont des phénomènes cumulatifs. Le stock de connaissances accumulées par le passé favorise ainsi d’autant plus la production de connaissances nouvelles. Pourtant, plusieurs observations empiriques récentes laissent craindre un ralentissement de cette production, qui resterait à expliquer.
Les auteurs apportent une contribution majeure à ce débat, au moyen d’une analyse extensive menée sur 45 millions d’articles scientifiques et près de 4 millions de brevets, dans tous les domaines et tous les pays, sur plusieurs décennies. Leur outil central est un indice statistique, basé sur les citations, qui mesure la capacité d’une publication scientifique ou d’un brevet à disrupter, c’est-à-dire à ouvrir une nouvelle voie. En pratique, plus les publications et brevets ultérieurs qui le citeront auront tendance à « oublier » les contributions qui le précédaient, plus un brevet sera considéré comme disruptif (indice = 1). Au contraire, plus il sera cité en compagnie des publications antérieures sur lesquelles lui-même s’appuyait, plus il sera considéré comme cumulatif (indice = –1).
Les résultats de ce travail de recherche, très remarqué, sont sans appel. Dans tous les domaines de la connaissance, l’indice moyen de disruptivité des articles scientifiques s’est effondré de 0,3, voire de 0,5 dans l’immédiat après-guerre, à quasiment 0 aujourd’hui. Pour les brevets, ce déclin de 0,4 à 0 s’observe sur une période encore plus courte, entre les années 1980 et aujourd’hui.
Cet effacement des sciences et des technologies de rupture se mesure également par d’autres critères, comme l’appauvrissement sémantique des articles et des brevets, qui partagent de plus en plus un même vocabulaire réduit.
En réalité, le nombre absolu de contributions disruptives se révèle stable dans le temps, mais de plus en plus dilué dans un nombre sans cesse croissant de publications de moindre intérêt. Toutefois, observant également que ce flux de publications disruptives connaît des reports importants entre domaines scientifiques et technologiques, les auteurs estiment que l’humanité est bien loin d’avoir épuisé la liste des connaissances nouvelles à découvrir et à exploiter (« les fruits mûrs à portée de main »), et qu’elle passe plus sûrement d’une science à l’autre au gré des modes politiques et des financements.
Les auteurs remarquent encore que ce déclin ne doit pas être confondu avec un appauvrissement de la qualité de la science et la technologie. En effet, cette réduction de la part des articles pionniers ou séminaux s’observe même lorsqu’ils se restreignent aux revues les plus prestigieuses. C’est donc que le mode de fabrication de la science et la technologie a intrinsèquement changé.
Pour eux, c’est plus précisément la nature du rapport aux connaissances antérieures qui a évolué. Il existe toujours une relation positive entre le volume du stock de connaissances accumulées dans un domaine particulier et la propension des publications du moment à ouvrir de nouvelles voies à partir de ce domaine. En revanche, cette relation est négative en ce qui concerne les brevets.
Les auteurs estiment que les chercheurs et les ingénieurs qui publient des articles et des brevets ont de plus en plus tendance à se focaliser sur une «tranche» étroite des connaissances antérieures: ils citent de plus en plus un petit nombre d’articles très reconnus, ils se citent de plus en plus eux-mêmes et ils ont de plus en plus de mal à se tenir à jour des nouvelles connaissances produites, se référant de plus en plus à de mêmes sources anciennes.
Les auteurs concluent en affirmant que, si la science reste un processus cumulatif, la pratique quotidienne de la recherche et de la technologie est sans doute en train de s’essouffler à cet égard. Réaliser de nouvelles découvertes exige de rester connecté avec la production scientifique mondiale, ce qui s’avère de plus en plus compliqué. Au contraire, se reposer sur un champ toujours plus étroit et plus ancien de la connaissance n’est pas forcément un mauvais calcul pour la carrière individuelle, même si l’avancement de la science mondiale en pâtit.
Au total, ces travaux accréditent l’idée d’un ralentissement général de la science et de la technologie.
À la recherche des courroies de transmission efficaces
Un lien cassé en France entre laboratoires et entreprises
À ce stade de l énonce simplement : les entreprises accélèrent la création de richesse ainsi que la résolution des grands défis sociétaux en proposant au marché des innovations dis ruptives
Aussi s’agit-il de trouver des moyens efficaces de faire collaborer celles-ci et celle-là. Et c’est là que la situation se complique : comment inciter les laboratoires publics de recherche à se tenir à l’écoute des besoins des marchés, et comment s’assurer que l’appropriation de leurs résultats par les entreprises soit non seulement efficace mais qu’elle se déroule au maximum sur le même territoire, celui dont les pouvoirs publics financeurs de la recherche publique ont la charge ?
On prend toute la mesure de cet enjeu en se penchant sur le cas français. On a eu l’occasion de montrer dans les pages précédentes que la France ne jouait qu’un rôle modeste dans les dépôts de brevets relatifs aux douze technologies de rupture étudiées. Or, comme le montre le tableau 3.1 ci-dessous, le rang tenu par les laboratoires publics de recherche est nettement plus honorable. Pour les sept technologies au sujet desquelles nous disposons de données détaillées, les laboratoires français représentent entre 9 et 14 % de l’ensemble des brevets issus de la recherche publique dans le monde, ce qui les place le plus souvent au quatrième rang mondial, au troisième rang pour le photovoltaïque et au cinquième pour la spintronique.
C’est certes plus modeste que le positionnement de la recherche coréenne, placée au deuxième rang mondial, derrière les États-Unis et devant la Chine, et détentrice de 19 % des brevets issus de la recherche publique dans le monde. Mais c’est plus important que la contribution de la recherche publique allemande ou que celle du Japon (non représentée dans le tableau).
De cette comparaison volontairement centrée sur des pays analogues, on peut donc retenir que la recherche publique française pourrait certes progresser encore si elle s’inspirait du modèle coréen mais qu’elle tient globalement son rang dans la bataille mondiale pour la détention de technologies de rupture. A contrario, c’est bien avant tout du côté des entreprises que le bât blesse en France.
On a déjà vu dans la figure 2.7.d que les entreprises détiennent une part des brevets déposés en France nettement inférieure à ce que l’on relève en moyenne pour les autres pays. On voit ici qu’elles ne sont à l’origine que de 3 ٪ en moyenne des brevets issus d’entreprises dans le monde sur ces sept technologies de rupture, contre 12 % pour les entreprises allemandes et 17 % pour les entreprises coréennes. La capacité contributive de la France au progrès technique apparaît donc particulièrement déséquilibrée, et l’industrie française sous-dimensionnée pour tirer parti de l’offre technologique permise par la recherche publique de notre pays.
Ce diagnostic d’une activité industrielle insuffisante en France au regard de l’offre scientifique a été maintes fois posé. Rappelons que, en Allemagne ou en Corée du Sud, les entreprises représentent entre 8 et 12 % du financement de la recherche publique ; en France, ce taux n’a jamais dépassé 5 % au cours de la dernière décennie (Binois, 2022). Ce volume d’activité de recherche financée par les entreprises représente seulement 713 millions d’euros en France, contre plus de 4,1 milliards d’euros en Allemagne : un montant 5,8 fois supérieur quand la valeur ajoutée industrielle n’est que 2,8 fois plus importante qu’en France.
Combiner le souci d’une recherche appliquée avec la culture d’excellence scientifique
Historiquement, la première réponse institutionnelle apportée à ce besoin de rapprocher les entreprises de la recherche publique a consisté à doter certains établissements d’une mission explicite de développement des technologies et de soutien aux entreprises, que ce soit dans des technologies de pointe (le CEA dans les technologies de l’information, par exemple) ou non (on pense notamment à l’appui du CETIM en direction d’un vaste tissu d’entreprises de la mécanique).
À la différence de la recherche académique, l’essence même de la recherche appliquée est de répondre à des problèmes soulevés par des usagers, qu’il s’agisse de la société civile ou des entreprises. Comme mentionné plus haut, le CEA fait partie de ces organisations qui, en France, cumulent une mission de service aux politiques publiques (d’abord dans le domaine du nucléaire et aujourd’hui dans d’autres domaines stratégiques tels que l’électronique, le médical ou encore les énergies renouvelables), une activité de recherche fondamentale (indispensable au développement de nouvelles découvertes) et des liens étroits avec les entreprises.
Le CEA a un statut d’établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), comme onze autres EPIC menant, dans leurs domaines respectifs, des activités de recherche21. Cela a des incidences concrètes sur leur aptitude administrative à établir des contrats avec des entreprises ou encore sur leur encadrement des personnels de recherche, salariés sous contrat de droit privé (Ottmann, 2021). De plus, dans le domaine civil, le financement du CEA repose à hauteur de 30 % (en 2020) sur des ressources externes, dont plus de la moitié vient des industriels22. Le fait que la dotation initiale de l’État soit structurellement insuffisante pour couvrir tous les coûts fixes de l’établissement agit naturellement comme une incitation forte à développer des contrats avec des partenaires publics et privés, et donc à se tenir à l’écoute de leurs besoins.
La recherche publique, ainsi adossée à une connaissance régulièrement mise à jour du marché, débouche plus facilement sur des innovations. Voilà ce qui peut expliquer que le CEA compte parmi les cinq plus gros déposants de brevets français (sur l’ensemble des technologies, et pas seulement sur les technologies de rupture), après Safran, Stellantis et le groupe Valeo, selon le dernier rapport de l’Institut national de la propriété intellectuelle (INPI, 2021). Il occupe par voie de conséquence la première place parmi les organismes de recherche publique, devant le CNRS et l’IFP Énergies nouvelles.
Compte tenu du rôle prépondérant qu’elles occupent dans la dépense privée de R&D en France, les grandes entreprises sont les principales concernées par les collaborations avec la recherche publique. Elles disposent certes, le plus souvent, de centres de recherche en interne mais peuvent également sous-traiter une partie de leurs activités aux laboratoires publics. Plus précisément, et comme on l’a déjà vu dans les statistiques sur les dépôts de brevets, les rôles respectifs des entreprises et des laboratoires varient selon les thématiques. David Sadek, vice-président Recherche, technologie et innovation chez Thales, en témoigne : « Le domaine de la physique quantique est né dans les laboratoires de recherche, mais ce sont aujourd’hui des start-up, françaises notamment, telles que par exemple Pasqal, Quadela ou Alice&Bob, ou des grandes entreprises du numérique comme IBM ou Google, qui travaillent à la conception et à la fabrication d’ordinateurs quantiques. De la même façon, si l’Intelligence Artificielle avait été initiée dans des laboratoires de recherche académiques, la puissance de calcul et la disponibilité de grandes masses de données a permis à des acteurs comme Facebook, Google ou Microsoft de réaliser de véritables percées dans le domaine de l’apprentissage automatique, et notamment du deep learning. En me référant à ma propre expérience de chercheur en IA dans le monde industriel, la plupart des doctorants que j’ai encadrés faisait davantage leur recherche au sein de l’entreprise que dans leur laboratoire académique de rattachement. »
Il en va de même pour STMicroelectronics dont les relations bien établies avec le CEA ont favorisé un modèle de coproduction de connaissances, comme le souligne Benjamin Cabanes : « Souvent, quand on fait référence à la recherche fondamentale et à la recherche appliquée, on pense que le public produit de la connaissance puis la transfère aux entreprises. Ce modèle de transfert de connaissance existe mais il y a aussi un autre modèle qui est la coproduction de connaissances : les deux acteurs produisent de la connaissance en même temps avec des prismes un peu différents. Il n’y a pas un transfert mais une production commune. »
Ce mode de collaboration serait, selon Benjamin Cabanes, particulièrement adapté aux innovations de rupture, car celles-ci supposent la production de connaissances fondamentales, tout en faisant la démonstration de potentiels applicatifs. Il l’a constaté dans le cadre de ses travaux de recherche : « Généralement, l’entreprise a des intuitions ou une vision et propose ensuite à un laboratoire de travailler avec elle pour produire de la connaissance. » Cette « connivence » entre les grandes entreprises et les laboratoires de recherche se traduit également par une proximité géographique, consistant parfois à exercer dans les mêmes locaux. Par exemple, dans les années 1990, une partie des équipes du CEA s’est déplacée dans les locaux de STMicro-electronics pour se rapprocher des sites de production de l’entreprise et ainsi faciliter le transfert de technologie. Une enquête récente, réalisée par des chercheurs de Mines Paris – PSL auprès d’un échantillon de 373 entreprises (octobre 2022) sur leur vision de la recherche publique, nous apprend que les grandes entreprises ont, en moyenne, un intérêt plus grand pour les recherches collaboratives que les ETI ou les plus petites entreprises.
Parfois, cet intérêt pour la recherche publique se décline sur les différentes entités nouvelles dont la recherche publique a été dotée, précisément pour favoriser les partenariats. C’est le cas d’Airbus, qui choisit de collaborer avec des écoles, des instituts ou des centres de recherche sur tous les sujets en phase d’exploration ou périphériques à l’entreprise : « Les IRT23 sont un “bon endroit” : chacun y met une petite cotisation et cela forme un pot commun où l’on trouve en “propriété collective” des solutions, des compétences, des moyens d’essai… qui ne coûtent finalement pas très cher. C’est un bon système. Par exemple, récemment, nous avons eu une discussion sur la 5G pour l’aviation et le spatial. C’est un sujet qu’on ne regardait pas, nous ne nous sentions pas concernés. Or, nous avons découvert que nous pourrions l’être si des flottes de satellites à basse altitude peuvent relayer la 5G et servir les avions et hélicoptères », >explique Alain De Zotti, responsable de l’architecture et de l’intégration des avions chez Airbus.
À la recherche de nouvelles passerelles : l’encouragement à l’essaimage
Cependant, dans tous les cas, la recherche publique s’arrête à la frontière du marché. L’objectif des pouvoirs publics est alors de trouver les moyens de transmettre aux entreprises les résultats innovants obtenus en laboratoire, afin d’améliorer le rendement social de la dépense publique sans susciter pour autant de distorsions de marché. Parmi les instruments possibles figure la pratique de l’essaimage, c’est-à-dire la création d’une nouvelle entreprise directement à partir d’un laboratoire (appelée « spin-off»), aux fins d’exploiter, par le biais d’une activité commerciale, les connaissances et technologies qui y ont été développées.
La loi Pacte (Plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises) du 22 mai 2019 a ainsi renforcé le statut de chercheur-entrepreneur24 en créant un certain nombre de dispositions favorables aux chercheurs désireux de créer leur entreprise, parmi lesquelles le maintien de l’avancement de grade et la possibilité de continuer à travailler partiellement dans leur organisme de recherche. Selon François Breniaux, partner chez Supernova Invest, une société de gestion en capital-risque spécialisée dans les deeptech, « la technologie doit être bien maîtrisée pour se lancer dans l’aventure de la création d’une deeptech ». C’est tout l’avantage du chercheur que de bénéficier d’une vision approfondie des technologies existantes ou prometteuses, sans laquelle les déconvenues peuvent être nombreuses, car « le plus difficile est d’identifier le moment auquel se lancer dans l’aventure. Il n’est pas rare que les start-up se lancent dans un domaine déjà investi par des concurrentes étrangères. Les chercheurs, qui ont une connaissance fine des technologies existantes, évitent plus facilement ces écueils », souligne M. Breniaux.
Si elles sont indispensables, les compétences techniques ne sont toutefois pas suffisantes. L’intérêt des chercheurs pour l’entrepreneuriat est en effet un autre facteur décisif dans la réussite de l’essaimage. Le parcours de Pascal Boulanger, fondateur de Nawatechnologies, illustre bien cette double appétence pour la recherche et l’entrepreneuriat : « Après avoir travaillé dans le nucléaire puis dans le solaire, j’ai eu une expérience de conseiller technologique au sein de l’Anvar25, devenue aujourd’hui Bpifrance, puis de manager de retour au CEA, sur le site de Saclay […]. J’ai également fait une formation à HEC parce que j’étais intéressé par les entreprises et plus précisément par la gestion d’entreprise. Je voulais comprendre leur fonctionnement mais aussi la spécificité d’une start-up par rapport à une grande entreprise. J’ai ainsi touché du doigt les mécanismes de financement de l’innovation. Et c’est en retournant au CEA de Saclay que j’ai pris connaissance d’un matériau un peu particulier […]. Et puis, à un moment donné, le puzzle s’est fait. »
Ainsi, de nombreux programmes de promotion de l’entrepreneuriat ont été créés dans des établissements publics, à l’instar du CNRS, qui a passé le cap des 1 500 spin-off fin 2020 (CNRS, 2020). Du point de vue des chercheurs, la création d’une entreprise directement issue d’un laboratoire de recherche présente de nombreux avantages, aux premiers rangs desquels le soutien financier et la possibilité de retrouver son emploi initial en cas d’échec. Gilles Moreau, cofondateur de Verkor, une start-up spécialisée dans la production de batteries bas carbone, n’a pas eu « la chance de pouvoir être soutenu par le CEA ». Les risques généralement encourus en phase d’amorçage et de démarrage de la start-up en sont réduits d’autant selon lui : « Les porteurs de projets issus du CEA sont aidés pendant une bonne année et demie, tout en maintenant leur statut de salarié au sein de l’organisme. Ensuite, ils ont deux ans de retour possible au sein du laboratoire, renouvelable une fois. Au total, on peut être protégé pendant cinq à six ans. Donc ce n’est pas tout à fait le même mode d’entrepreneuriat. Quand on n’a pas cette chance, le chômage est une option beaucoup plus rapide. Le niveau de stress et d’engagement n’est pas tout à fait le même. »
Au-delà des spin-off : les collaborations entre laboratoires et deeptech
Outre les entreprises établies et les spin-off, l’exploitation des résultats de la recherche publique concerne bien sûr également toutes les jeunes entreprises innovantes. En effet, même sans émaner directement d’un laboratoire, les start-up26 peuvent s’appuyer sur les compétences, les expertises, les découvertes scientifiques et les moyens matériels mis à disposition par les laboratoires. C’est le cas de la start-up Carbios, dont le dirigeant, Emmanuel Ladent, souligne « qu’aucune entreprise n’aurait eu les moyens de faire les recherches initiales, de même que le monde académique n’aurait jamais eu les moyens en levée de fonds qu’a eus Carbios pour aller à l’étape industrielle » (cf. encadré).
Carbios, un exemple de valorisation de la recherche publique par une start-up
Fondée en 2011 à Clermont-Ferrand, Carbios est une entreprise de biotechnologie qui développe et industrialise des solutions biologiques pour réinventer le cycle de vie des plastiques et des textiles. Plus précisément, elle a recours à des organismes naturels – des enzymes – pour dégrader toute forme de plastique à base de PET (polytéréphtalate d’éthylène) et les ramener à leurs éléments constitutifs d’origine. Les matériaux de qualité équivalente au vierge ainsi reconstitués peuvent dès lors être recyclés de nombreuses fois.
L’activité principale de Carbios repose sur l’exploitation industrielle de plusieurs années de recherche académique consacrée à la découverte et à l’optimisation d’enzymes de dégradation de polymères. Dès sa création, l’entreprise a ainsi noué des partenariats stratégiques, d’abord avec l’université de Poitiers puis avec le laboratoire public TBI (Toulouse Biotechnology Institute), qui est une émanation du CNRS, de l’Insa et de l’Inrae. Ces collaborations public-privé ont permis des avancées scientifiques nombreuses dans le domaine du recyclage enzymatique. Elles ont en effet abouti non seulement à des dépôts de brevets mais aussi à la publication, en 2020, d’un article dans la revue scientifique de référence Nature. Cette même année, Carbios a intensifié son alliance avec la recherche publique en créant, avec l’Insa, un centre de recherche d’ingénierie enzymatique dédié au recyclage des plastiques.
Aujourd’hui, Carbios est la seule entreprise au monde à avoir développé un procédé de recyclage enzymatique du PET à échelle industrielle. Celui-ci a d’ailleurs été validé par un démonstrateur industriel, ce qui préfigure l’installation de futurs sites industriels, d’abord dans le nord-est de la France puis partout dans le monde.
Cela étant, dans le cas particulier des innovations de rupture à fort contenu technologique ou industriel, les start-up correspondent à ce qu’on appelle aujourd’hui les deeptech, dont Bpifrance indique dans une étude récente (2019) que la plupart sont issues des laboratoires publics ou du moins portées par une équipe ayant de forts liens avec la recherche publique. Cela nous ramène donc peu ou prou à l’essaimage abordé au paragraphe précédent.
Bpifrance a même fait de cette proximité originelle avec la recherche un des quatre critères distinctifs de son référentiel deeptech. Les trois autres sont l’existence de verrous technologiques difficiles à lever, un avantage fortement différenciateur par rapport à la concurrence et un go-to-market long et complexe.
Selon Philippe Mutricy, directeur des études de Bpifrance, il est aujourd’hui admis que la start-up est bon vecteur pour exploiter les résultats de la recherche publique, d’une part, en raison de l’existence de nombreux financements dédiés et, d’autre part, parce qu’elle serait, par son indépendance, un bon moyen de développer une technologie à un niveau de maturité plus avancé.
La gestion délicate de la propriété intellectuelle
Dans tous les cas de figure (entreprise établie, spin-off ou deeptech non directement issue du laboratoire), le transfert de technologie recouvre souvent l’exploitation d’éléments de propriété intellectuelle développés par l’équipe de recherche publique. Ce point est à l’origine d’une littérature très abondante sur les meilleurs moyens de gérer les actifs de propriété intellectuelle, et aussi de nombreux débats et même d’innovations réglementaires, à la suite du célèbre Bayh-Dole Act américaine (cf. encadré).
Un premier enjeu concerne le niveau de maturité de la technologie concernée. Si une entreprise, et tout particulièrement une start-up, peut faire valoir une technologie mûre auprès de ses investisseurs, alors elle augmente ses chances de convaincre que son exploitation permettra de créer de la valeur et de se démarquer de la concurrence. À l’inverse, une technologie restée à l’état de preuve de concept (PoC, pour Proof of Concept) risque grandement de compromettre le développement de la start-up. De ce point de vue, les sociétés d’accélération du transfert de technologies (SATT), dotées de moyens de maturation importants, permettent à une technologie donnée d’atteindre un niveau d’avancement suffisant avant son transfert vers une entreprise.
Paradoxalement, un second enjeu consiste pour l’entreprise à rester indépendante du laboratoire public ou à défaut à le redevenir le plus rapidement possible. En effet, l’exploitation de brevets issus de la recherche publique devient rapidement coûteuse pour l’entreprise, pour ne pas dire une servitude qui finit par en diminuer la valeur du point de vue des actionnaires. Le niveau de rémunération exigé par les laboratoires de recherche est souvent jugé excessif par les dirigeants de start-up et les investisseurs, qui doivent de leur côté maîtriser les coûts dans la perspective d’une forte croissance de l’activité.
D’après les entretiens conduits dans le cadre de cette étude, il n’est ainsi pas rare que les entreprises mettent fin à des collaborations ou cherchent à développer leurs propres brevets, pour s’affranchir de telles contraintes. Pascal Boulanger, ancien salarié du CEA et fondateur de la start-up Nawatechnologies, revendique cette stratégie : « Dès le départ, mon objectif en termes de propriété intellectuelle, c’était : comment je peux me rendre le plus indépendant possible de cette licence du CEA, qui va coûter cher à l’entreprise. On est partis avec quatre brevets du CEA en 2013. On a signé une extension de la licence en 2019, à l’occasion de laquelle on a retiré un brevet dont nous n’avions plus l’utilité. Nous avons élargi notre portefeuille technologique avec des licences auprès du MIT et de l’université de Dayton aux États-Unis. Et aujourd’hui, la technologie est protégée par 26 brevets […]. Donc, voilà, nous ne sommes plus dépendants du CEA et la majorité de notre portefeuille de brevets est détenue à 100 ٪ par Nawatechnologies. »
Le Bayh-Dole Act
Le Bayh-Dole Act ou Patent and Trademark Law Amendments Act est une législation promulguée en 1980 aux États-Unis, dont le nom provient des deux sénateurs qui en ont parrainé le projet, et qui traite des inventions issues de projets de recherche financés par des fonds fédéraux.
Auparavant, les agences gouvernementales détenaient la propriété des inventions réalisées grâce à leur soutien. Le gouvernement a donc fini par se retrouver titulaire de dizaines de milliers de brevets, très rarement commercialisés. Face à ce constat, le Bayh-Dole Act entendait stimuler l’innovation en conférant par défaut aux petites entreprises et aux organismes à but non lucratif, comprenant notamment les universités et les autres laboratoires publics, les droits de propriété intellectuelle. L’idée sous-jacente est que ces acteurs non administratifs seraient plus à même d’en tirer parti sous la forme de produits commerciaux.
À noter: le bénéficiaire du financement peut choisir de ne pas conserver ces titres de propriété. Si l’organisme gouvernemental les refuse également, ils reviennent aux inventeurs originaux. Les bénéficiaires du financement doivent en outre suivre un certain nombre de directives. En particulier, l’organisme gouvernemental qui parraine doit recevoir une licence non exclusive et non transférable. En outre, toute invention utilisée ou vendue aux États-Unis doit faire l’objet d’efforts raisonnables pour y être substantiellement fabriquée. Le non-respect de l’une de ces exigences donne à l’organisme gouvernemental le droit de prendre le titre de propriété à l’entrepreneur, qui perd alors tous ses droits, même le droit de mise en pratique.
Le gouvernement a également des droits «d’intervention» dans certaines situations (ils n’ont jamais été exercés). Ils peuvent être déclenchés si un entrepreneur titulaire n’applique pas l’invention dans un délai raisonnable, si la santé ou la sécurité de la nation sont en jeu, ou si le produit résultant n’est pas fabriqué principalement aux États-Unis. Dans ces cas, le gouvernement accorderait une licence à une tierce partie de confiance pour mener à bien l’action nécessaire.
On attribue aujourd’hui à cette loi d’avoir aidé à la mise au point de centaines de nouveaux médicaments, au développement de milliers de jeunes entreprises, et à la création de centaines de milliards en valeur économique.
Source : Service des délégués commerciaux du Canada.
Le même constat vaut pour les brevets détenus en copropriété entre une entreprise et un laboratoire, situation considérée comme étant encore plus contraignante pour l’entreprise. Gilles Moreau, cofondateur de Verkor, juge « gênante » la copropriété au moment des levées de fonds, puisque les investisseurs déplorent que l’entreprise n’ait pas la complète maîtrise de sa propriété intellectuelle.
La figure 3.2 confirme cette faible appétence pour la copropriété des brevets, y compris quand la recherche publique joue un rôle important. Dans l’ensemble, les brevets en co-dépôt représentent 11,6 % du total (24 % pour les déposants français), dont moins de 4 % pour les co-dépôts public-privé (8 % dans le cas français). Cette activité de co-dépôts public-privé est d’autant plus marginale que l’activité innovante est déjà largement dominée par les entreprises (batteries, hydrogène et acier bas carbone), alors qu’elle franchit le seuil des 10 % dans les technologies où la recherche publique joue encore un large rôle (ARN messager et nanotechnologies).
On peut comprendre que les entreprises éprouvent le besoin, quand la technologie se stabilise, de s’affranchir de la recherche publique dont elles ont pourtant eu besoin au début. Cela étant, il reste alors à expliquer pourquoi elles établissent plus volontiers des co-dépôts entre partenaires privés qu’avec la recherche publique (respectivement 6 % et 4 % du total mondial).
En outre, la figure 3.3 met en lumière un fait arithmétiquement intuitif compte tenu du déséquilibre entre les volumes de brevets respectivement détenus par des acteurs publics et des acteurs privés : si les co-dépôts public-privé ne représentent que 4 % des brevets privés, ils constituent 24 % des brevets publics. Il semble donc que la recherche publique soit moins réticente que les entreprises à partager un même titre de propriété intellectuelle, alors que l’inconfort de la gestion partagée d’un actif commun est sensiblement le même pour les deux parties. Étrangement, les entreprises concèdent plus volontiers des copropriétés avec d’autres entreprises qu’avec des partenaires publics, tandis que les laboratoires partagent plus volontiers leurs brevets avec des partenaires privés qu’avec leurs homologues.
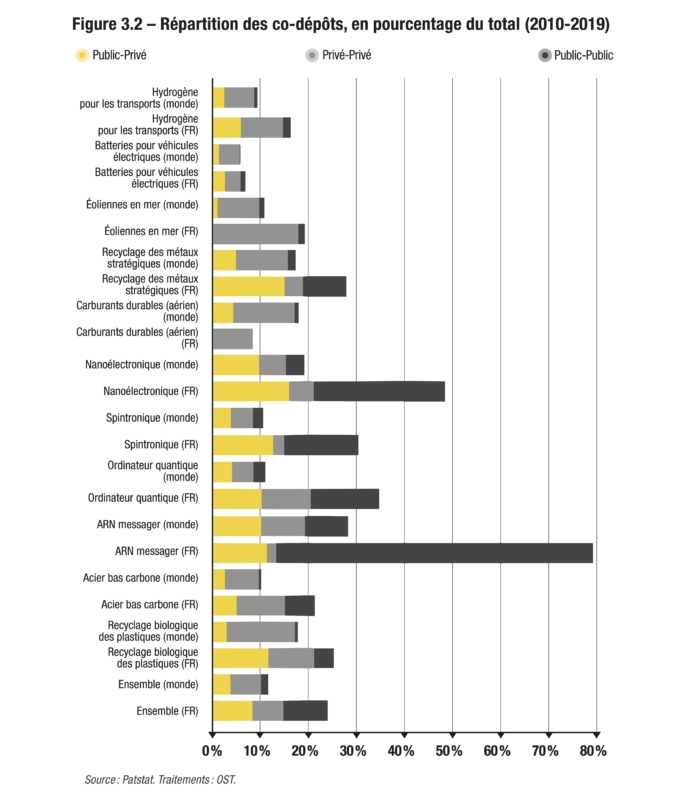
- 17. Nawatechnologies fabrique des batteries à recharge rapide et à forte autonomie. Elles contiennent des supercondensa- teurs à nanotubes de carbone qui augmentent considérablement la puissance et la densité d’énergie, en comparaison des supercondensateurs à base de charbon.
- 18. Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives.
- 19. Les nanotubes de carbone ont été découverts au Japon en 1991 par Sumio Iijima. Ils sont l’aboutissement de longues recherches, stimulées par la découverte des fullerènes en 1985 par Harold Kroto, Robert Curl et Richard Smalley. Source : CNRS Images (2008).
- 20. Ce choix a été effectué en 2012, soit un an avant la création de Nawatechnologies.
- 21. ANDRA (Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs), BRGM (Bureau de recherches géologiques et minières), CIRAD (Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement), CNES (Centre national d’études spatiales), CSTB (Centre scientifique et technique du bâtiment), IFPEN (IFP Énergies nouvelles), IFREMER (Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer), INERIS (Institut national de l’environnement industriel et des risques), IRSN (Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire), LNE (Laboratoire national de métrologie et d’essais), ONERA (Office national d’études et de recherches aérospatiales).
- 22. Source : rapport financier du CEA (2020).
- 23. Instituts de recherche technologique.
- 24. Statut instauré par la loi Allègre du 12 juillet 1999 sur l’innovation et la recherche.
- 25. Agence nationale de valorisation de la recherche. Fondée en 1967, elle a fusionné en 2005 avec d’autres organismes d’aide à l’investissement dans les PME, pour intégrer le groupe Oséo au sein de Bpifrance.
- 26. Bien que le terme start-up soit souvent associé au secteur des technologies numériques, il est utilisé dans cette étude pour qualifier les jeunes entreprises innovantes qui relèvent davantage du secteur industriel.
Point de vue – L’innovation ouverte au service du secteur de la Défense
Massis Sirapian a été chef de pôle adjoint « Innovation ouverte » à l’Agence de l’innovation de défense (AID). Il est aujourd’hui directeur du pôle « Nouvelles frontières » au sein du Secrétariat général pour l’investissement (SGPI).
Pourquoi l’innovation ouverte est-elle incontournable pour explorer l’innovation de rupture ?
Le rythme du développement technologique s’accélère, le nombre des General Purpose Technologies (GPT, ou technologies polyvalentes) explose lui aussi. Alors qu’on en comptait seulement deux au début du xxe siècle, l’automobile et l’électricité, on peut aujourd’hui citer, sans être exhaustif, le téléphone puis le smartphone, l’informatique, l’intelligence artificielle, l’énergie renouvelable, les biotechnologies, la blockchain et la fabrication additive.
Or, l’esprit humain s’adapte mal aux évolutions exponentielles car il est linéaire. De la même façon, les institutions et les organisations ont du mal à suivre cette accélération du fait de leur inertie. Pour s’en convaincre, pensons à la difficulté de réguler les GAFAM en matière de diffusion de l’information ou aux différentes vagues d’« ubérisations ».
Cette accélération constitue une menace mortelle pour les grandes organisations. Ces dernières ont pourtant bien une parade pour tenter de survivre, qui s’apparente à celle que Clayton Christensen préconisait déjà lorsqu’il décrivait le phénomène de disruption : pour ne pas boire le bouillon, il faut que l’organisation elle-même surfe sur la vague.
Mais pourquoi aussi peu de grands groupes s’y risquent-ils ? C’est la question que nous nous sommes posée à la création de l’Agence de l’innovation de défense (AID) en 2018.
Comment travailler efficacement avec les start-up ?
En créant une agence d’innovation dans la défense en 2018, nous n’avions pas le droit d’ignorer les lacunes constatées depuis l’explosion du phénomène start-up en France (disons, en 2013) concernant les collaborations entre ces dernières et les grands groupes. Seulement 2 % des innovations détectées par les grandes entreprises sont intégrées dans leur processus. Pour expliquer cet échec patent, notre analyse était que les grands groupes traitent les start-up comme des PME. Or une start-up est un acteur économique radicalement différent d’une PME ou d’une ETI.
On peut la définir ainsi : une start-up est une organisation (éventuellement) temporaire dont l’objectif est de répondre à un besoin par la création d’un produit ou d’un service, et de trouver un modèle économique cohérent, répétable et si possible scalable (rendements d’échelle croissants). Cette différence par rapport à une entreprise qui connaît son modèle économique, serait-elle de petite taille, a des conséquences majeures sur le développement dans le temps d’une start-up.
Dans un premier temps et jusqu’à une certaine maturité, la start-up est relativement indifférenciée en termes de segment de marché. Elle développe son produit ou service. Passé ce stade, elle commence à envisager les segments de marché où elle pourrait se développer. Elle explore alors différents segments possibles.
Une fois son premier segment de marché choisi, la start-up a pour priorité de servir ce marché cible pour tester son hypothèse (souvenez-vous : elle ne connaît pas son modèle économique). Lorsqu’elle va gagner en maturité, elle va à nouveau considérer un autre segment de marché pour continuer son développement : il s’agit de la phase de diversification.
Pourquoi le problème persiste depuis une dizaine d’années ?
Ce mode de développement typique des start-up explique en partie la difficulté rencontrée par la plupart des grandes organisations, tous secteurs confondus, pour passer à l’échelle après une phase de maquettage. En effet, deux écueils majeurs sont possibles : voir la start-up trop tôt, ou la voir trop tard. Si la start-up est approchée lorsqu’elle est en train de sortir de sa phase d’indifférenciation, passer à l’échelle sur le segment défense, par exemple, signifie alors pour elle de choisir la défense comme son premier segment de marché.
Pour cela, elle a besoin d’avancer très vite et demandera au ministère un développement et un passage en production éclairs, alors que celui-ci est simplement dans une phase d’évaluation ou de démonstration de l’intérêt du concept. Aucune suite d’ampleur ne sera donnée dans un délai raisonnable et la start-up cherchera alors un autre segment. Si la start-up est approchée au moment où elle a déjà servi un segment et considère une diversification, l’effort à fournir à ce stade sera probablement trop important pour choisir la défense comme deuxième segment de marché, surtout si ce secteur a été ignoré, voire écarté, lors des premières orientations de la société. Quelles conséquences en tirer ?
La première est la nécessité de détecter très tôt puis de suivre des start-up qui n’affichent pas un segment de marché « sécurité nationale » ou « défense » et qui pourtant développent des solutions d’intérêt pour le secteur. La deuxième est de considérer qu’une start-up ne se diversifiera vers la défense que si l’effort à fournir est plus faible ou la rentabilité attendue sensiblement plus importante que pour un segment alternatif. Par ailleurs, la vitesse à laquelle une start-up passe de cette phase d’indifférenciation à celle de la diversification signifie que les seuls coups de sonde périodiques (appels à projets, par exemple) sont relativement inefficaces.
Quels enseignements en matière d’innovation ouverte ?
Pour ces raisons, l’Agence de l’innovation de défense est attentive à prendre en compte trois niveaux de maturité : la maturité technologique, la maturité de l’acteur économique vis-à-vis de sa cible initiale et prioritaire, et enfin la maturité de l’utilisateur final (interne). La logique d’accélération des projets d’innovation ouverte, promue par la cellule détection et captation de l’AID, s’inscrit dans cette vision : financer la maturation sur tous ces axes, et non le seul axe technique, pour déployer le plus rapidement possible l’innovation détectée. Il était en effet indispensable de développer un nouvel outil, au sein de la toute nouvelle AID, permettant de rechercher, de suivre, voire d’influencer le développement de nouveaux acteurs peu habitués à l’écosystème de défense.
Plus généralement, pour tenir compte des éléments de contexte exposés, la mission d’une agence d’innovation (ouverte) devrait donc consister dans les éléments suivants : détecter et suivre des innovations (dont les start-up) qui ne s’adressent pas nécessairement à son secteur et lancer au bon moment des projets de codéveloppement (maquettes, démonstrateurs et prototypes). Le liant entre ces deux activités (veille et projets) sera l’acculturation, autrement dit la circulation permanente des innovations au sein de l’organisation. Par une irrigation continue, l’objectif de cette diffusion sera d’influencer les feuilles de route internes et celles des entreprises identifiées, afin de réussir une prise de greffe non prévue.
Les rôles complémentaires des start-up et des grands groupes
Deux régimes d’innovation opposés coexistent
Un vieux débat sur les mérites respectifs des entreprises jeunes
et des entreprises établies
Le débat sur les rôles respectifs des start-up et des grandes entreprises dans l’avènement des innovations de rupture figure maintenant au rang des vieilles controverses, pour ne pas dire des serpents de mer. Ce débat a été réactivé récemment en France, quand plusieurs faits d’actualité a priori indépendants sont venus mettre en lumière le rôle parfois décisif de certaines start-up : non seulement les succès planétaires d’entreprises comme Tesla et Moderna, éclairant comme en contre-jour les difficultés de groupes plus établis dans l’automobile et la pharmacie face à des défis tels que la transition énergétique ou la lutte contre la pandémie de Covid-19, mais aussi les résultats encourageants des nouvelles licornes françaises, l’engouement partagé jusqu’au gouvernement pour les nouvelles deeptech, etc.
Pour saisir la réalité complexe des dynamiques d’innovation, il faut toutefois sortir des présupposés et des querelles de doctrines qui chercheraient à ne reconnaître qu’un modèle de référence au détriment de l’autre. Sur la base des recherches et des entretiens conduits dans le cadre de cette étude, il apparaît en effet que la capacité d’une entreprise à disrupter, à taille et ancienneté données, dépend beaucoup des dynamiques sectorielles et technologiques dans lesquelles elle évolue.
Ce résultat renvoie à la notion de régime technologique, exposée dans les chapitres précédents, et plus simplement aux deux paradigmes schumpétériens qu’il est convenu d’appeler « Mark I » et « Mark II ». Ceux-ci désignent, sur la base d’observations empiriques de l’économiste, deux régimes d’innovation différents27. Le premier découle de l’érosion des avantages compétitifs et technologiques des entreprises établies, favorisant l’arrivée de nouveaux entrants plus innovants et souvent de petite taille (Malerba et Orsenigo, 1995). Le second se caractérise au contraire par la domination d’un petit nombre de grandes entreprises historiques qui, grâce à l’accumulation de connaissances et à leur expertise, sont capables de maîtriser efficacement un domaine technologique au point que leur avance technologique constitue alors une véritable barrière à l’entrée, et ce d’autant plus qu’elles consacrent des sommes importantes dans la recherche et développement.
Si ces deux archétypes ne suffisent pas à représenter l’ensemble des schémas d’innovation possibles (voir le point de vue de Christophe Deshayes en fin de chapitre), ils offrent toutefois une grille de lecture intéressante pour saisir les rôles respectifs des différents types d’entreprises et comprendre ce qui les favorise et, au contraire, ce qui contrarie leur développement. Il est capital de comprendre que ces deux régimes coexistent, et que la confirmation empirique de l’un n’est en rien une réfutation de l’autre.
Il n’y a donc rien de contradictoire à ce qu’une « vieille » entreprise conserve non seulement une activité d’innovation importante mais même un rôle de leader technologique sur son marché. Un groupe historique comme Thales, par exemple, qui dispose de plusieurs centres de recherche à travers le monde, explore continûment de nouvelles voies technologiques. Chaque année, le groupe investit en moyenne 3,5 milliards d’euros en R&D, soit 20 % de son chiffre d’affaires28, car c’est une condition de sa pérennité. Plus encore, comme le souligne David Sadek, vice-président Recherche, technologie et innovation du groupe, le maintien d’une dynamique d’innovation répond à des enjeux de souveraineté : « Il faut absolument qu’une entreprise stratégique comme Thales maîtrise l’informatique quantique, qui sera un vrai « game changer » dans les années à venir. En la matière, Thales ambitionne d’être pionnière dans le développement des applications à l’échelle à base d’algorithmes et de calcul quantiques, dans ses secteurs d’activité, aussi bien dans le domaine civil que défense. » Dans les domaines hautement technologiques, les entreprises établies qui ne prennent pas part aux disruptions sont donc vouées à disparaître ou à compromettre les intérêts du pays. Elles ont conscience qu’aucune position n’est jamais définitivement acquise, en particulier dans un monde globalisé où certains États, à l’instar de la Chine, n’hésitent pas à subventionner massivement les entreprises nationales pour obérer la concurrence.
Elles doivent ainsi maintenir et développer leur capacité à rechercher, anticiper les grandes ruptures et relever les défis technologiques auxquels elles sont confrontées, voire qu’elles ont elles-mêmes imaginés. Par exemple, le projet d’avion « zéro émission » d’Airbus fait suite à un courrier rédigé par la direction de la stratégie, demandant aux équipes d’« imaginer » l’avion zéro émission : « Les équipes ont démarré en mode start-up, en phosphorant puis en convergeant progressivement vers deux technologies – les SAF et l’hydrogène –, allant chercher des compétences puis carrément des collaborations institutionnelles à l’extérieur de l’entreprise », souligne Alain De Zotti, responsable de l’architecture et de l’intégration des avions chez Airbus. Certaines grandes entreprises se posent constamment des questions pour anticiper les prochaines innovations de rupture et explorer des alternatives : « Nous ne nous endormons pas sur nos lauriers […]. On est tout le temps en veille active », constate Alain De Zotti.
Quelques cas d’« accumulation créatrice » (Schumpeter Mark II)
Les grandes entreprises historiques peuvent donc être résolument leaders dans toutes les catégories d’innovation, y compris les plus radicales. Dans leur ouvrage, Marc Giget et Véronique Hillen (2021) en font le constat sur de nombreux secteurs. Les entreprises étudiées par les auteurs, à l’instar de Saint-Gobain, Schneider Electric ou Veolia, n’ont jamais cessé d’innover et ont même intensifié cette dynamique au cours des quinze dernières années. Pour preuve, selon une étude récurrente de Derwent-Clarivate Analytics citée par les auteurs, la plupart sinon l’intégralité des entreprises françaises qui figurent chaque année au classement des 100 entreprises mondiales les plus innovantes29 sont des grandes entreprises historiques. Dans le classement 2022, les entreprises françaises représentées sont Airbus, Alstom, Michelin, Safran, Thales, Valeo… et aucune start-up. Ce résultat montre à quel point certaines grandes entreprises bien établies disposent d’un positionnement solide grâce à une culture de l’innovation durablement ancrée.
Les start-up apparaissent donc minoritaires ou sous-critiques dans les domaines où l’accumulation continue de connaissances, les investissements massifs en R&D et les capacités industrielles sont un préalable à l’innovation. Cela ne signifie nullement que les start-up n’y aient pas un rôle à jouer. Dans le monde aéronautique, il existe des initiatives intéressantes menées par des acteurs émergents, comme la conception de petits avions électriques. À titre d’exemple, la start-up toulousaine Aura Aero a signé 330 intentions d’achat de son futur avion de transport électrique régional de 19 places auprès de plusieurs compagnies aériennes (Sommazi, 2022). Mais de là à concurrencer les constructeurs historiques sur les avions de grande taille, il reste un pas difficile à franchir : « Avant que quelqu’un ne vienne perturber le marché, nous aurons eu le temps de le voir venir. Ces nouveaux acteurs ne constituent pas un risque pour Airbus. Au contraire, ils animent le secteur et développent l’écosystème », estime Alain De Zotti. Selon lui, le risque est plutôt à craindre du côté chinois. Airbus est en effet conscient que la Chine, à travers son plan China 2025, développe actuellement une filière aéronautique, et en particulier son propre avionneur, Comac, destiné à concurrencer le duopole qu’Airbus forme avec Boeing. Fin 2022, l’avion phare de Comac, le C919, a atteint un cap en obtenant sa certification par les autorités chinoises. Le retard pris par la Chine dans ce domaine ne permet pas encore au C919 de constituer une menace sérieuse pour les acteurs occidentaux. Toutefois, la stratégie de « conquête du monde » mise en place depuis l’arrivée au pouvoir de Xi Jinping, en 2013, semble avoir porté ses fruits dans de nombreux domaines (Mabille et Neveu, 2021), au premier rang desquels le secteur du numérique ; il serait donc naïf de ne pas anticiper le même type de bouleversement dans le secteur aéronautique.
Quelques cas de destruction créatrice (Schumpeter Mark I)
Si certains domaines d’innovation se caractérisent par la place centrale de la capitalisation des connaissances et de la transmission des savoirs, ceux de type Mark I voient au contraire les nouveaux entrants sur le marché jouer un rôle dominant. La littérature a abondamment montré les raisons d’un tel phénomène. Dans son ouvrage, Christensen (1997) met ainsi en évidence le « dilemme de l’innovateur » propre aux entreprises historiques : si la disruption risque de compromettre le modèle d’affaires de l’entreprise, l’ignorer peut aboutir au mieux à une perte de leadership, au pire à une disparition de l’activité. On a beaucoup entendu parler de Nokia ou de Kodak, entreprises mortes d’avoir négocié trop tard le virage de l’innovation de rupture (Silberzahn, 2015), ou de Blackberry, victime au contraire de s’être entêté sur son système avant-gardiste, sans parler d’Apple, ressuscitée pour avoir apporté la bonne disruption au bon moment.
Les réticences de certaines grandes entreprises à se lancer dans des domaines nouveaux ou à fort enjeu technologique trouvent leur origine dans ce qu’il est convenu d’appeler la legacy (i.e. l’héritage du passé). En effet, la rupture impose le renouvellement de tout ce qui a fait le succès d’une entreprise historique : son organisation, sa culture, son processus de production, les compétences de ses salariés, son image de marque.
Dans certains domaines, il n’est donc pas étonnant que l’innovation de rupture soit devenue le terrain de jeu privilégié des start-up. De son expérience, Gilles Moreau, cofondateur de Verkor, retire un enseignement : « Quand on veut créer une start-up et amener une innovation sur le marché, le seul cas de figure possible et viable est de se lancer dans une activité qui semble être une mauvaise idée pour les entreprises existantes mais qui n’en est pas une en réalité. Pourquoi ? Parce qu’elles ne prendront pas le risque d’y aller et laisseront le champ libre aux start-up. À l’inverse, se lancer dans une activité considérée par tous comme une bonne idée est suicidaire pour une start-up qui dispose de peu de moyens face à un grand groupe. »
Pour le dire autrement, les start-up viendraient combler l’absence d’initiative dans les activités jugées risquées ou sans intérêt par les grands groupes. C’est pourquoi d’ailleurs nombre de start-up se distinguent dans des domaines nouveaux, à l’image des cleantech – terme désignant les start-up visant la décarbonation de l’industrie, des bâtiments et des transports. À partir d’une cartographie réalisée en 2021, une étude réalisée conjointement par Bpifrance et France Digitale (2021) recense 727 start-up françaises à impact30, dont plus de la moitié (53 %) dans le secteur de l’environnement.
Le domaine du véhicule électrique est un cas d’école intéressant pour comprendre le retard pris par les constructeurs historiques. Face à eux, Tesla, un nouveau venu à l’échelle de l’histoire, affiche une capitalisation boursière stratosphérique de plus de 1 000 milliards de dollars fin 2021, soit cent fois celle de Renault (Dupont-Calbo, 2021). Dans le domaine du véhicule électrique, ce dernier est pourtant un pionnier puisqu’il s’est lancé sur ce marché dès 2009. Cela s’est traduit par la sortie des modèles Kangoo en 2011 et Zoe en 2012. Pourtant, durant cette période « pré-Tesla », Renault n’a pas tiré un grand potentiel de son avance dans l’électrique. Selon un cadre de l’entreprise interrogé, « Renault n’a pas donné le sentiment de croire à un basculement complet vers l’électrique, ni à un équipement de l’ensemble des foyers en électrique. Une frange de l’entreprise n’y croyait pas et a opposé une résistance. » De surcroît, il y avait à l’époque une divergence de vues entre l’hybride prôné par Stellantis (ex-PSA) et le tout-électrique soutenu par Renault, sans compter que la fin des véhicules thermiques était encore loin d’être entérinée.
Ainsi, les premières ventes de la Zoe ont été loin d’atteindre les objectifs fixés : quand Renault prévoyait d’écouler 50000 unités au cours de l’année 2013, le seuil des 10 000 immatriculations était tout juste atteint fin décembre (Doche, 2013) de la même année. Au même moment, Tesla se lançait sur le segment très spécifique des voitures électriques premium avec une politique de prix très élevés : le premier modèle, la Tesla Roadster, était commercialisé entre 2008 et 2012 au prix de 128 000 dollars (Martinage, 2022). Là où Renault a décidé de produire une voiture de masse avec une technologie qui émergeait à peine, Tesla a fait le choix de s’attaquer à ce marché par le haut puis d’entrer progressivement dans un marché plus massif.
Surtout, la force de Tesla réside dans la culture d’entreprise impulsée par son dirigeant, Elon Musk. Celui-ci a en effet adopté une stratégie de différenciation par l’innovation en investissant massivement, et dès le départ, dans la R&D : « Là où Renault a plutôt une culture administrative un peu ronronnante, Tesla a placé l’innovation et la remise en cause de tous ses processus comme culture d’entreprise », reconnaît un cadre de Renault. Il en a résulté que Tesla a été non seulement précurseur dans la production de sa propre batterie aux spécifications uniques31 mais aussi dans le déploiement à grande échelle de bornes de recharge.
Comme le souligne Jean-Louis Beffa, dans son ouvrage Se transformer ou mourir (2017), les entreprises traditionnelles rencontrent bien des difficultés à affronter cette concurrence d’un nouveau genre. Ces nouveaux entrants, qu’incarne parfaitement Tesla, sont dans une recherche incessante de créativité et de nouveauté, quitte à prendre des risques inconsidérés. Mais c’est là que réside leur force : inscrire la disruption au cœur de leur activité, en commençant souvent par un marché de niche puis en l’élargissant progressivement.
Si la réussite de Tesla est une belle illustration du phénomène de disruption décrit par Christensen (1997), il n’en reste pas moins que le secteur automobile comporte de nombreuses barrières à l’entrée qui confèrent encore certains avantages aux constructeurs traditionnels.
De la théorie à la pratique : sans grande entreprise, pas de start-up
À la recherche des régimes Mark I et Mark II dans les données
Dans cette partie, nous proposons, à partir de nos données, d’étudier les places respectives des start-up et des grandes entreprises pour les douze technologies de notre échantillon. Il faut garder à l’esprit que nous nous heurtons à l’absence de définition précise du terme start-up (voir Annexe). Pour des raisons évidentes d’accès aux données, les start-up françaises ont été toutefois plus facilement identifiées que leurs homologues étrangères. De surcroît, les données individuelles au niveau mondial ne permettent pas de prendre en compte les déposants issus de la recherche publique32. Ainsi, nous nous focaliserons ici volontairement sur les déposants français, tout en proposant par endroits une mise en perspective internationale de ces résultats.
À la lecture de la figure 4.1, un constat s’impose : le faible poids des start-up parmi les déposants de brevets en France. À l’inverse, les brevets des grandes entreprises sont très majoritaires parmi tous ceux déposés par des entreprises françaises dans la majorité des technologies étudiées. Il existe toutefois quelques exceptions : l’ARN messager, où le poids des grandes entreprises est réduit à néant, la nanoélectronique, la spintronique et, dans une moindre mesure, le photovoltaïque. Le retrait relatif des grandes entreprises se traduit alors essentiellement par une forte domination de la recherche publique, qui, à titre illustratif, détient près de 90 % des dépôts de brevets français dans le domaine de l’ARN messager.
Si le poids des start-up reste globalement faible parmi les déposants français, il est comparativement plus élevé dans des domaines en expansion, à l’instar du recyclage biologique de plastique, mais aussi dans des technologies plus mûres – au sens où le nombre de brevets est décroissant d’une année sur l’autre (figure 4.2). Dans les domaines du photovoltaïque et de l’éolienne en mer, les start-up représentent respectivement 13 % et 14 % des dépôts de brevets français.
Nous analysons maintenant plus finement la répartition des rôles entre start-up et entreprises au sein des différentes domaines technologiques.
– Quand les grandes entreprises établies se taillent la part du lion : hydrogène pour les transports et batteries pour véhicules électriques
En France, et plus largement dans le monde, les domaines des batteries pour véhicules électriques et de l’hydrogène pour les trans- ports sont de belles illustrations du régime Schumpeter Mark II : de fortes barrières à l’entrée favorisent le maintien d’un petit nombre d’entreprises innovantes, de grande taille et stables dans le temps. Les figures 4.3 et 4.4 confirment le rôle prépondérant des grandes entreprises dans ces deux domaines. Si on exclut la recherche publique, on constate que seules les grandes entreprises françaises occupent les premières marches du podium et que ces quelques leaders détiennent plus de 50 % des brevets déposés par l’ensemble des entreprises (respectivement 67 % pour les batteries électriques et 62 % pour l’hydrogène dans les transports). Il en va de même au niveau mondial : les grandes entreprises historiques dominent les deux classements (figures 4.5 et 4.6), et notamment la douzaine de leaders mondiaux qui concentrent approximativement la moitié des brevets déposés dans le monde. Cette absence des start-up souligne comment, face aux impératifs écologiques et aux exigences réglementaires, à travers notamment les politiques climatiques mises en place en Europe visant la réduction des émissions de carbone à l’horizon 2050, les entreprises établies se mettent en ordre de marche pour embrasser cette bifurcation technologique majeure qu’est l’électrification des véhicules. Les start-up françaises sont, quant à elles, quasiment absentes, étant à l’origine de seulement 4 % des dépôts français de brevets dans chacun des domaines. Enfin, les figures 4.3 et 4.4 enseignent également que la recherche publique, à travers le CEA et le CNRS, occupe en France une place notable en matière d’innovation dans ces deux domaines. En particulier, le CEA apparaît à chaque fois dans le trio de tête et y détient plus de 11 % de l’ensemble des brevets français.
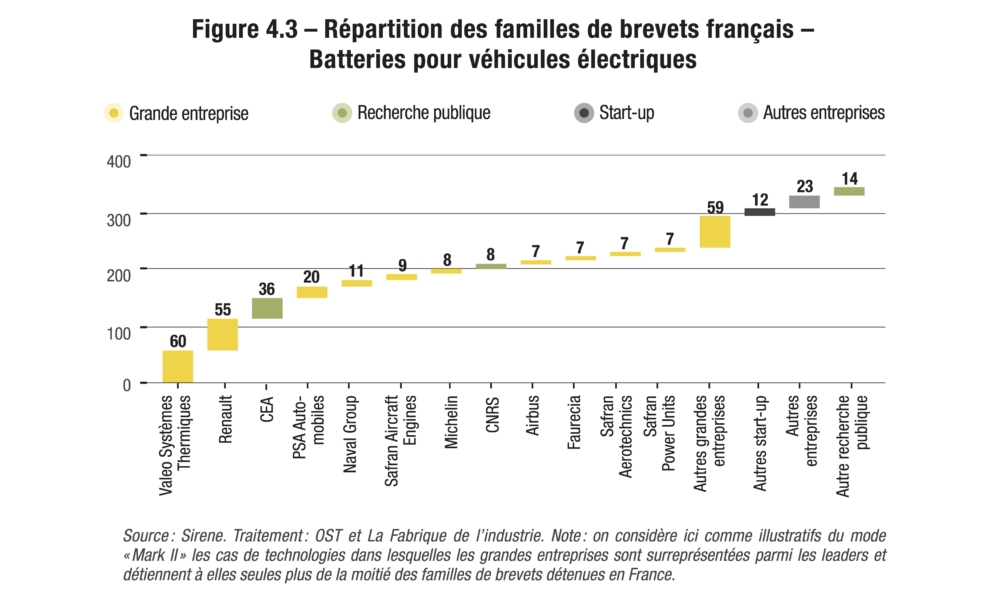
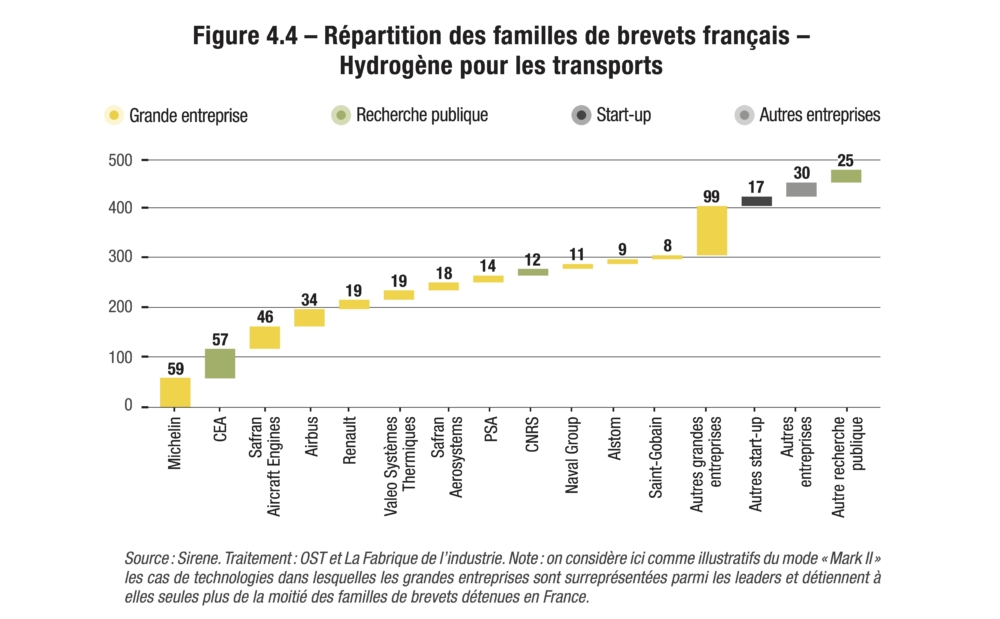
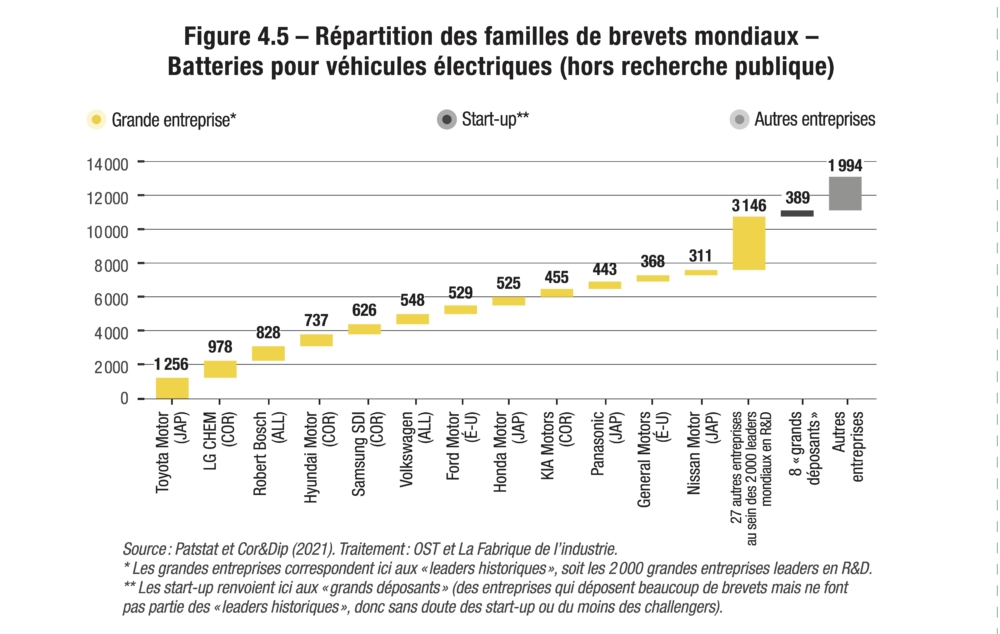
Dans le domaine de l’acier bas carbone, la répartition des rôles entre les différentes parties prenantes n’est pas claire en France (figure 4.7). En revanche, les données au niveau mondial (figure 4.8) sont très illustratives des luttes d’influence propres au régime Mark II. En effet, les grands groupes sont, de loin, les plus gros pourvoyeurs de brevets. La production d’acier suppose des investissements colossaux, qui procurent de facto un avantage aux grandes entreprises. Il n’est donc pas surprenant qu’elles soient à l’avant-garde de la décarbonation de l’acier, d’autant plus si la législation les contraint de plus en plus à réduire les émissions de CO2 dans les prochaines années.
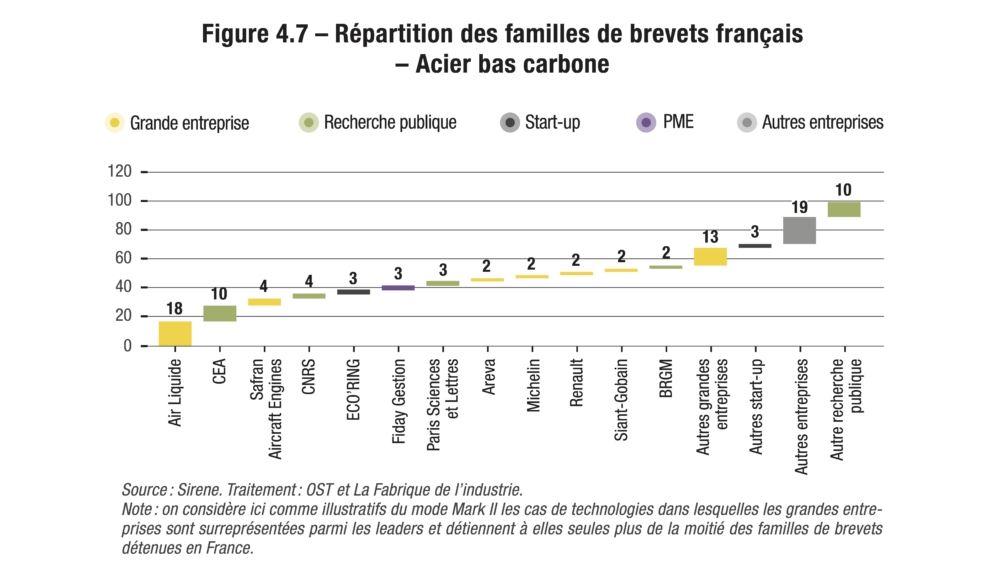
– Quand les petites entreprises s’invitent à la table des grandes : photovoltaïque, éoliennes en mer, recyclage biologique de plastique
Les graphiques 4.9, 4.10 et 4.13 soulignent qu’un domaine peut être dominé par un petit nombre d’entreprises parmi lesquelles on trouve déjà des start-up. Ainsi, en France, dans les domaines du photovoltaïque, de l’éolien en mer et du recyclage biologique de plastique, plusieurs start-up font figure de leaders à côté d’autres entreprises historiques et de grande taille comme Total, Naval Energies ou encore le groupe Suez.
Ce résultat vient nuancer la représentation schématique schumpétérienne selon laquelle les marchés de type Mark II sont dominés par des entreprises en petit nombre et de grande taille, qui y entretiennent de fortes barrières à l’entrée. En France, la situation oligopolistique des dépôts de brevets dans ces domaines n’a pas empêché que de petites entreprises innovantes s’y fassent toute leur place. Au total, les start-up représentent respectivement 23 %, 19 % et 18 % des brevets déposés par les entreprises dans le photovoltaïque, l’éolien en mer et le recyclage biologique de plastique.
Dans ce dernier domaine, en forte expansion, Carbios est la seule start-up à compter parmi les leaders et occupe, de surcroît, la première place du podium français (figure 4.13). Son poids se confirme à l’échelle internationale puisqu’elle apparaît, là encore, parmi les entreprises les plus actives dans le domaine (figure 4.14). Ce domaine en émergence a nécessité de nombreuses années de recherche initiale, sans laquelle le procédé de recyclage enzymatique n’aurait pu être mis au point. Il n’est donc pas étonnant que Carbios ait pu se distinguer grâce à une longue et fructueuse collaboration avec le CNRS, l’Inrae et l’Insa. Cette prise de risque scientifique a probablement dissuadé les grandes entreprises de s’y lancer.
Dans les deux autres cas, au contraire, il semble que les start-up françaises se démarquent par leur activité inventive dans des domaines délaissés par les grandes entreprises. Ainsi, comme on l’a vu précédemment, les entreprises françaises et leurs homologues étrangères ont drastiquement réduit leur activité innovante dans le domaine du photovoltaïque. Elles sont, par ailleurs, peu présentes dans le domaine de l’éolien en mer. Qui plus est, elles ne sont pas du tout représentées parmi les principaux déposants au niveau mondial (figures 4.11 et 4.12) où les grandes entreprises règnent sans partage (même si l’on ne retrouve pas le même niveau de concentration des brevets aux mains d’une douzaine de leaders que dans les deux exemples précédents). Là encore, on peut faire l’hypothèse que les start-up ne figurent pas parmi les leaders parce que les grandes entreprises américaines, japonaises et chinoises ne leur en laissent pas la possibilité.
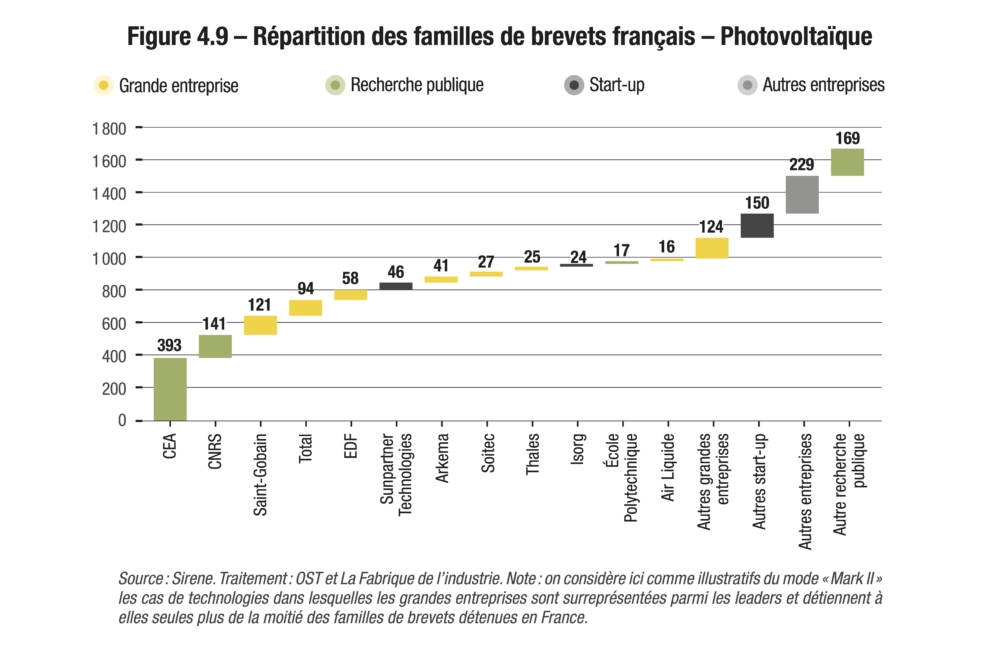
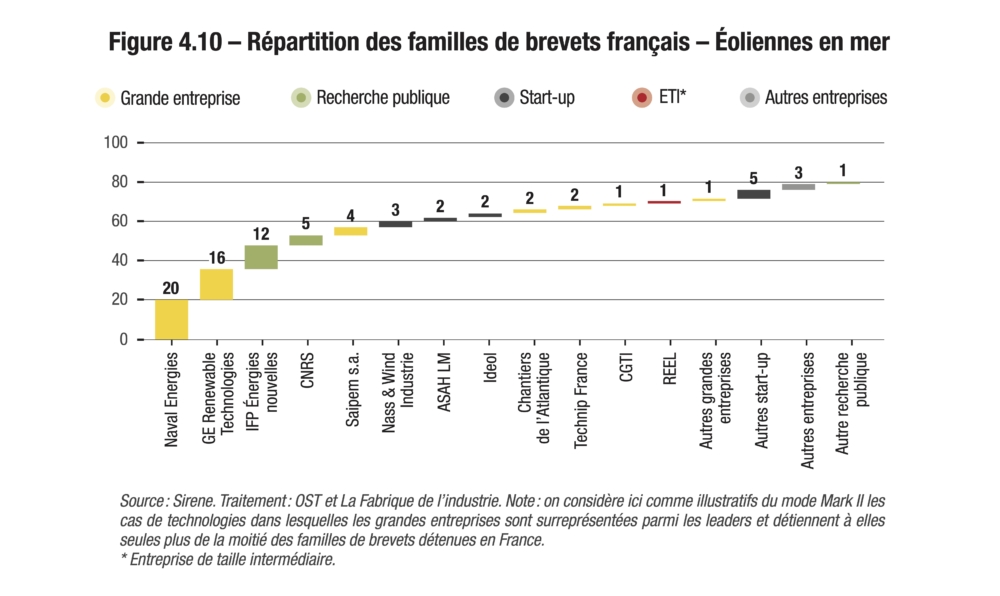
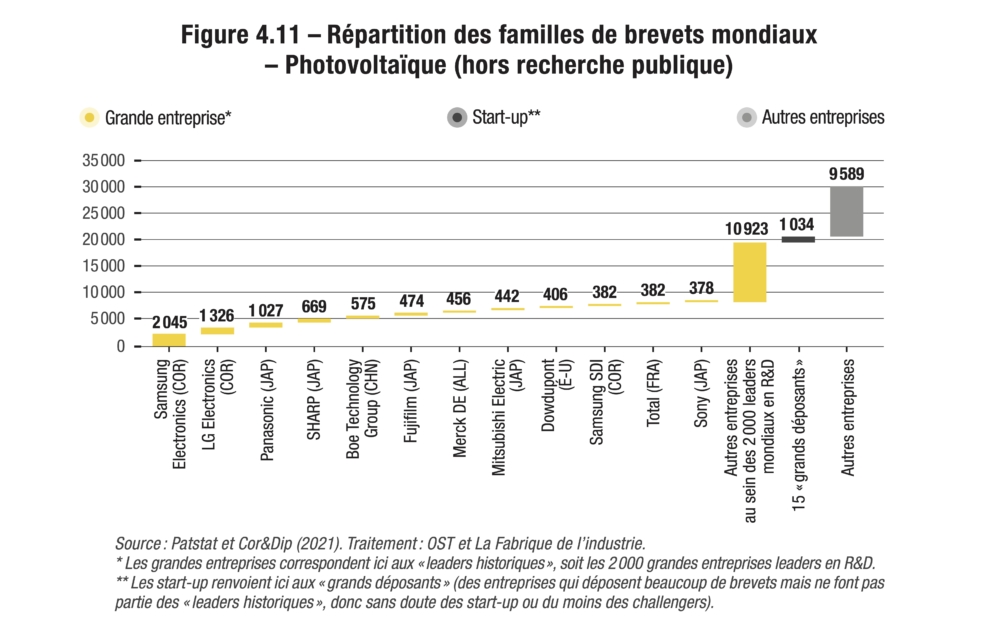
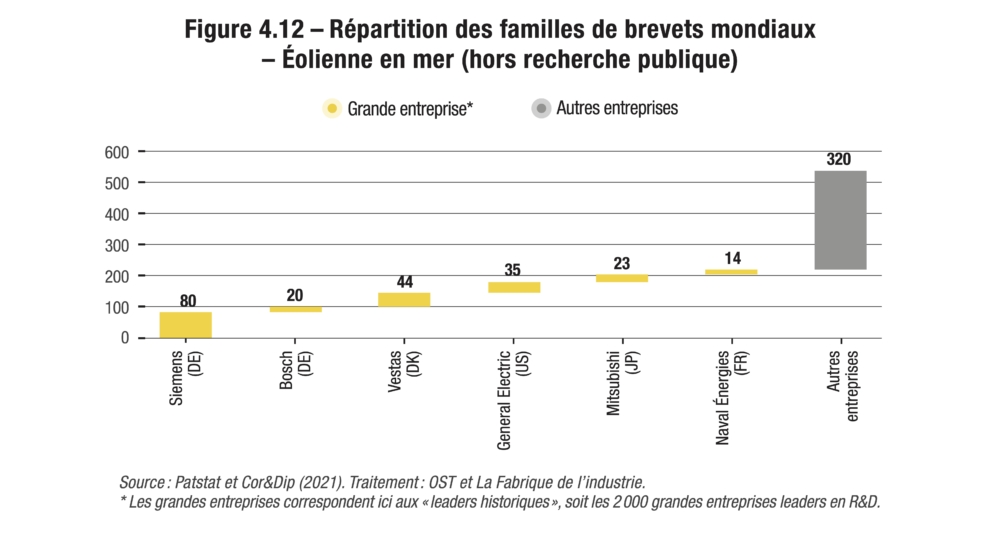
– Quand une fraction notable des brevets ne vient ni des start-up, ni des grands leaders historiques : ARN messager, nanoélectronique
En France, plus qu’ailleurs, la recherche publique occupe une position de leader dans un certain nombre de domaines. Sa position dominante est particulièrement frappante dans le domaine de l’ARN messager puisqu’elle occupe les douze premières places au classement des déposants français et détient globalement plus de 90 % des brevets déposés en France (figure 4.15). Voici donc une seconde nuance apportée aux deux grands archétypes schumpétériens : là encore, nous ne sommes ni dans Mark I ni dans Mark II : la faible activité innovante des grandes entreprises ne signifie pas nécessairement la présence en masse de start-up, tant s’en faut. Il en va de même dans le domaine de la nanoélectronique, où les deux premiers déposants, le CEA et le CNRS, sont à l’origine de près de la moitié des dépôts de brevets en France (figure 4.16). Si l’on élargit l’analyse à l’ensemble des universités et des laboratoires français, la recherche publique représente alors les trois quarts des dépôts de brevets.
Nous l’avons vu précédemment : les États-Unis sont leaders dans ces deux domaines et ont vu, par ailleurs, le poids de leurs laboratoires et universités se réduire fortement au profit des entreprises au cours des dix dernières années. Ce n’est pas du tout ce que l’on observe en France, où l’inertie propre aux entreprises hexagonales s’exprime ici de manière flagrante. Dans le domaine de la nanoélectronique, les grandes entreprises apparaissent bien timides face à des géants américains et asiatiques dont la domination a été cruellement mise en lumière lors de la pénurie des semi-conducteurs survenue au premier semestre 2021. Quant au domaine de l’ARN messager, le palmarès à l’échelle mondiale (figure 4.17) suggère que la France peine à faire grandir ses start-up.
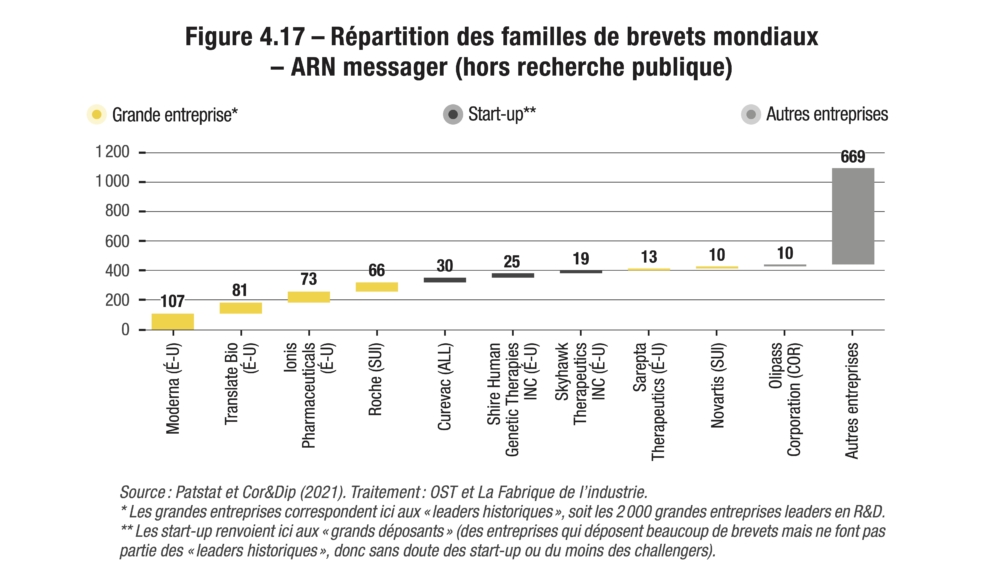
– Quand les start-up et la recherche publique jouent de concert : spintronique
Les graphiques 4.19 et 4.20 montrent que, dans le domaine de la spintronique, la physionomie des dépôts de brevets en France est en fort décalage avec celle que l’on observe au niveau mondial. Alors que les grandes entreprises japonaises, coréennes et américaines occupent les premières places du podium au niveau mondial, le domaine de la spintronique est dominé en France par un petit nombre de start-up, tandis que les grandes entreprises ne représentent qu’une part très modeste des dépôts de brevets (9 %). La start-up française Crocus Technology est à elle seule détentrice de 35 % de l’ensemble des brevets français. La recherche publique française occupe également un rôle important puisque, là encore, le CEA et le CNRS figurent dans le top 3 et sont, eux aussi, à l’origine de 35 % des dépôts de brevets dans le domaine. Surtout, lorsqu’on se penche sur l’origine des deux premières start-up du classement (Crocus Technology et Antaios), on constate qu’elles ont toutes deux été fondées par essaimage du laboratoire public français Spintec. Il est ainsi frappant de remarquer que la recherche publique non seulement détient une part importante de brevets mais qu’elle est aussi à l’origine des rares start-up présentes dans le domaine. Autrement dit, en matière de spintronique en France, la recherche publique fait figure de pionnière, cédant progressivement la place à des entreprises qui en sont directement issues. L’activité mondiale, quant à elle, est plutôt dominée par des grandes entreprises, parmi lesquelles on trouve deux start-up.
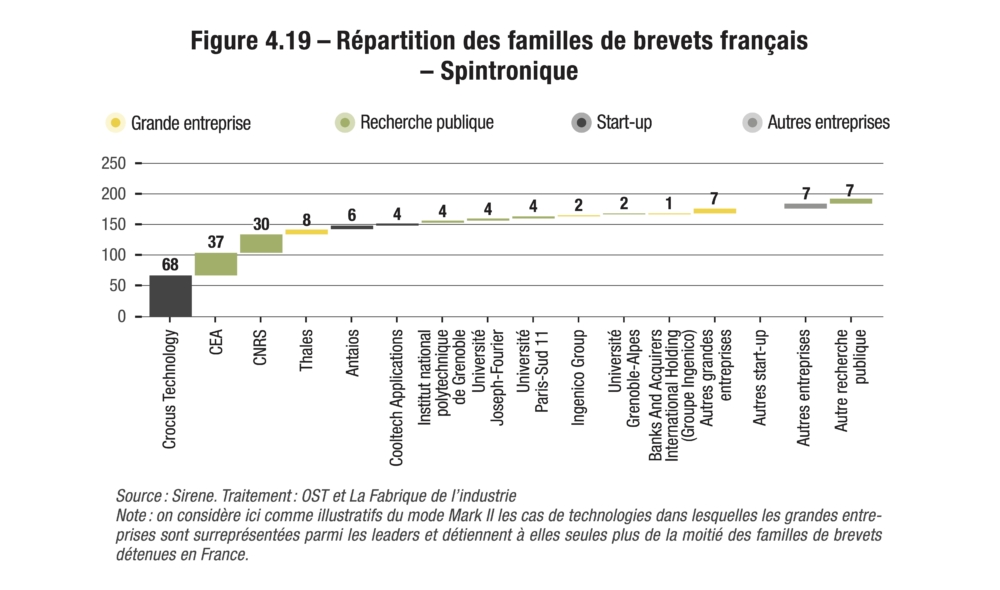
Proposition de synthèse
En France comme à l’international, les start-up figurent rarement parmi les principaux déposants de brevets relatifs aux innovations de rupture. Lorsqu’elles apparaissent parmi les leaders, elles se trouvent au côté soit des grandes entreprises soit de la recherche publique, dont elles sont même parfois directement issues.
L’ANR messager serait sans doute la seule exception relevée à cette « règle », les start-up américaines étant aujourd’hui très présentes parmi les premiers déposants. C’est toutefois, pour l’instant encore, une spécificité américaine : la France, pas plus que les autres pays d’Europe ou d’Asie, ne semble capable de propulser ainsi des start-up au sommet de l’innovation mondiale.
Les grandes entreprises françaises occupent souvent les premières places du podium français des dépôts de brevets. Mais leurs efforts restent timides à l’échelle mondiale, de sorte qu’elles y apparaissent dépassées par des « géants » beaucoup plus actifs qu’elles.
Par ailleurs, la recherche publique compte, en France, au moins autant que les grandes entreprises dans les éléments moteurs à l’origine des innovations de rupture. En effet, le CEA ou le CNRS (parfois les deux) apparaissent souvent dans le trio de tête des déposants français de brevets. La recherche publique est même parfois seule maîtresse à bord : dans les domaines de l’ARN messager, de la nanoélectronique et de la spintronique, l’innovation est quasi exclusivement le fruit de l’activité de recherche des laboratoires publics et des universités.
Réussir l’appariement des « locomotives » et des « wagons »
Acquérir ou investir : deux voies possibles pour rapprocher start-up et grandes entreprises
La répartition des rôles entre start-up et grandes entreprises, dans des domaines identifiés comme étant des innovations de rupture, n’est donc pas aussi schématique que le suggèrent les modèles théoriques Mark I et Mark II. Entre un premier archétype où des challengers impétueux finissent par renverser des leaders vieillissants et un autre où ils n’ont pas droit de cité, existent en réalité de nombreuses configurations hybrides. Les start-up ne sont pas toujours les vecteurs privilégiés pour apporter les innovations de rupture aux marchés, ni même aux grandes entreprises, mais elles ont en tout état de cause presque toujours besoin de ces dernières pour jouer un rôle significatif. Les grandes entreprises, elles aussi, ont sauf exception tout intérêt à collaborer.
Le rachat d’une start-up par une grande entreprise est sans doute la forme canonique d’une telle association. Les grandes entreprises s’inscrivent en effet dans un schéma d’observation des jeunes pousses, pour racheter les plus prometteuses à un moment jugé opportun. Cette tactique opportuniste est largement assumée dans le secteur pharmaceutique. En particulier dans le domaine de la Medtech33, les grandes entreprises mettent les start-up au cœur de leur stratégie d’innovation. Ces dernières sont souvent issues de la recherche publique, afin d’en valoriser les résultats et de mettre en place les phases suivantes, notamment les essais cliniques. Elles sont in fine rachetées par les grandes entreprises qui disposent de moyens financiers importants pour déployer leurs solutions à grande échelle. Selon François Breniaux, partner chez Supernova Invest, « dans le domaine de la Medtech, la grande entreprise est en mesure de racheter une start-up à un prix très élevé puisque le produit, déjà validé par les essais cliniques, lui offre des débouchés quasi-certains sur des marchés qu’elle connaît bien ».
L’avènement de la biotechnologie a d’ailleurs profondément modifié la façon dont les médicaments et les vaccins sont aujourd’hui développés, par rapport à une époque antérieure où l’innovation pharmaceutique était fondée sur la chimie. Alors que les connaissances pouvaient alors aisément être internalisées au sein de grands groupes pharmaceutiques, le développement de molécules, bien plus complexes, issues de procédés biologiques a favorisé le recours en masse aux start-up créées à partir des résultats de la recherche publique. Pour des raisons à la fois financières et de disponibilité, les grandes entreprises ne peuvent pas explorer la multitude de molécules susceptibles de donner lieu à un futur médicament. Elles préfèrent laisser les start-up se spécialiser dans cette exploration puis sélectionner celles qui se seront démarquées.
Symétriquement, en raison des exigences accrues des autorités de santé, les start-up ne peuvent pas réaliser seules les essais cliniques, dont les coûts sont extrêmement élevés. Dès lors, elles essaient très souvent d’être rachetées quand elles en sont encore à un stade de développement amont. Selon Clotilde Jolivet, directrice des Affaires Gouvernementales et Publiques France de Sanofi, « les dirigeants des biotech ont eux-mêmes prévu l’achat dans leur modèle économique. Certains d’entre eux sont des serial entrepreneurs qui créent une nouvelle biotech dès lors que la précédente a fait l’objet d’une acquisition par un grand groupe. »
Cet état d’esprit n’est pas circonscrit au secteur pharmaceutique. Les entretiens réalisés dans le cadre de cette étude confirment que le but d’une start-up est soit d’entrer en Bourse, ce qui est rarissime, soit d’<être rachetée par une grande entreprise. Les fonds d’investissement en capital risque exercent souvent eux-mêmes une pression sur les fondateurs pour les pousser à vendre leur entreprise. Dans la plupart des cas, cet acquéreur est une grande entreprise (Revol et Piet, 2021).
Moins engageante que le rachat pur et simple, la montée au capital via notamment un fonds de capital risque d’entreprise (Corporate Venture Capital ou CVC) permet aux grands groupes une prise de participation directe dans des start-up innovantes (Granier, 2021). Une étude récente du Boston Consulting Group (2022), distingue trois types de CVC : ceux qui relèvent d’une relation commerciale de long terme, à l’instar des synergies commerciales et opérationnelles opérées entre Verkor et Renault, ceux qui relèvent d’un investissement purement capitalistique et ceux plus stratégiques destinés à suivre l’évolution des grandes tendances.
Pour une start-up, la présence d’un grand groupe au capital comporte des avantages, le principal étant de pouvoir bénéficier de la force de frappe de son réseau pour se développer. C’est le cas de la start-up Carbios, pionnière dans le recyclage enzymatique de plastique, qui, grâce aux fonds d’investissement de grands groupes (notamment L’Oréal et L’Occitane), a bénéficié non seulement d’un appui financier important pour industrialiser et commercialiser son procédé mais également de débouchés commerciaux, en répondant notamment aux besoins croissants en emballages durables des grandes entreprises de biens de consommation. En juin 2021, L’Oréal a ainsi annoncé la réalisation du premier flacon en plastique, entièrement recyclé grâce à la technologie de Carbios, dont elle envisage la mise en production en 2025 (L’Oréal, 2021). Il en va de même pour la start-up Verkor, dans laquelle le groupe Renault détient une participation de plus 20 %. Bien plus qu’un actionnaire, Renault Group permet à Verkor, via un contrat d’achat, d’atteindre les volumes suffisants pour construire une Gigafactory à Dunkerque, avec à la clé la création de 1 200 emplois directs et 3 000 emplois indirects (Hamon-Beugin, 2022).
La stratégie de Sanofi pour revenir dans la compétition de l’ARN messager
Alors que Sanofi est spécialisé dans la protéine recombinante, le groupe décide en 2018 d’engager une collaboration exclusive avec la biotech américaine Translate Bio, spécialiste des technologies à ARN messager. Initialement tournée vers des maladies respiratoires graves telles que la mucoviscidose, Translate Bio s’est saisie de ce contrat d’un montant susceptible d’atteindre 805 millions de dollars, en cas de réussite complète, pour développer des vaccins à ARN messager pour lutter contre différentes maladies infectieuses. Selon le groupe Sanofi lui-même, cette collaboration avec Translate Bio vise à mutualiser les savoir-faire et les compétences des deux parties, la première ayant acquis un leadership dans le domaine des vaccins et la seconde en matière de recherche et développement en vue de produire des médicaments à base d’ARN messager.
À la faveur de la pandémie de coronavirus en 2019, le périmètre de l’accord a été encore élargi, moyennant un engagement financier potentiel porté à 1,9 milliard de dollars pour le développement d’un vaccin contre le Covid-19. Fruits de cette collaboration, deux essais cliniques sont en cours, l’un contre le Covid et l’autre contre la grippe saisonnière.
Afin d’accélérer l’application de la technologie de l’ARN messager au développement des vaccins, Sanofi a finalement acquis Translate Bio pour 2,7 milliards d’euros fin 2021. Cet achat s’inscrit dans une stratégie plus large de l’entreprise, qui souhaite rattraper son retard, voire devenir leader dans les technologies de l’ARN messager, alors que Pfizer et Moderna semblent avoir pris un avantage certain pendant la crise sanitaire. Ainsi, Sanofi a non seulement créé d’autres synergies avec la biotech américaine Tidal Therapeutics, spécialisée dans la recherche fondée sur l’ARN messager appliqué aux traitements du cancer, mais a également décidé de financer dès 2021 un centre spécialisé dans les vaccins à base d’ARN messager sur ses deux sites de Cambridge et de Marcy-l’Étoile. Cet investissement représente 400 millions d’euros par an jusqu’en 2025.
Des difficultés peuvent toutefois surgir lorsque les grands groupes entretiennent une confusion entre leurs différentes stratégies. D’après les entretiens que nous avons réalisés, certaines grandes entreprises attendent en effet des start-up dans lesquelles elles investissent, non pas seulement un retour sur investissement mais une sorte de clause de non-concurrence qui obligerait ces dernières à leur réserver certains contrats ou à se priver d’opportunités d’affaires. Sur la base d’une enquête auprès de trente interlocuteurs issus de grands groupes, l’étude de BCG (Boston Consulting Group) précitée montre que les deux tiers des grands groupes interrogés attendent de leur collaboration avec les start-up des synergies commerciales. Si le retour sur investissement est également mentionné parmi les attentes principales, il représente une moindre proportion (54 %). Ces attentes complémentaires, qui s’ajoutent à celles des investisseurs « classiques », peuvent parfois entraver la croissance espérée de la start-up en l’empêchant de s’adresser à de nouveaux marchés.
Des grandes entreprises frileuses dans leur rapport aux start-up françaises
Un rapport de l’association Cleantech for France (2022) souligne le rôle modeste des fonds de CVC français dans l’investissement auprès de start-up innovantes concourant à la décarbonation de l’industrie (ou cleantech). D’une part, les auteurs soulignent qu’aucun fonds de capital risque d’entreprise n’est présent parmi les quinze premiers investisseurs au sein des cleantech françaises, et ce toutes origines confondues. D’autre part, et en sens contraire, parmi les CVC français, seul le fonds d’investissement Via ID de Mobivia – qui regroupe Norauto, Midas et ATU – se démarque avec dix-sept transactions réalisées en France et vingt-trois dans le reste du monde sur la période 2017-2021 (figure 4.21). Les autres CVC français ont réalisé moins de cinq opérations au cours des cinq dernières années, tandis qu’ils investissent majoritairement à l’étranger.
Cette réticence des grands groupes français à monter au capital de start-up françaises, Pascal Boulanger, fondateur de la start-up Nawatechnologies, la constate également dans son domaine : dans le stockage d’énergie, les grandes entreprises françaises et européennes ont préféré investir dans les start-up américaines alors que des entreprises comme Nawatechnologies « n’ont rien à leur envier sur le plan technologique ». Selon lui, cette préférence tiendrait principalement à deux facteurs. D’une part, les CVC, qui se rémunèrent sur la plus-value du capital investi, auraient plus de chances de voir la valeur du capital d’une start-up américaine croître grâce à un accès plus aisé aux marchés boursiers. D’autre part, les rigidités françaises et européennes en matière de droit de licenciement, et en particulier le différentiel de coûts de restructuration entre la France et les États-Unis, constitueraient un frein important aux investissements dans les start-up hexagonales. Une récente note de l’Institut Montaigne (Babinet et Coste, 2022) appuie cette hypothèse en observant, parmi les facteurs pénalisant l’Europe en matière de développement numérique, le rôle des coûts de restructuration, qui atteindraient 200 k€ par personne pour une équipe de R&D en Europe continentale, tandis que ces coûts sont quasi nuls aux États-Unis, en Chine et en Inde. Selon les auteurs, ces coûts n’inciteraient pas les grands groupes à investir dans la Tech en Europe et empêcheraient ainsi les start-up européennes d’atteindre une taille comparable à celle des leaders américains ou chinois.
Quoi qu’il en soit, la collaboration entre une grande entreprise et une start-up ne va pas de soi, tant les organisations, les process de gouvernance, les cultures et les rapports de force diffèrent (Deshayes, 2021). C’est aussi sur ce terrain que des avancées doivent être réalisées.
- 27. D’autres travaux de recherche (voir notamment Crifo, 1999) mettent en évidence deux formes d’incitation à l’innovation desquelles découlent des structures de marché très différentes. La première incitation est la menace concurrentielle qui donne lieu à un marché de type monopolistique. La seconde incitation est la recherche de profit et débouche sur un marché plus concurrentiel.
- 28. Source : « La R&D chez Thales », sur thalesgroup.com.
- 29. Les 100 entreprises mondiales les plus innovantes sont classées sur la base de plusieurs critères : le volume de brevets déposés auprès des organismes de propriété intellectuelle, le nombre de citations des brevets par d’autres entreprises et organisations, et l’extension ou non de la protection des inventions auprès des brevets des principaux marchés mondiaux.
- 30. Les start-up à impact sont des start-up dont l’activité a été spécifiquement conçue pour répondre à un enjeu social, sociétal ou environnemental.
- 31. Lancée en septembre 2020 lors du Tesla Battery Day, la nouvelle cellule de batterie, conçue et fabriquée par Tesla, a des caractéristiques uniques, parmi lesquelles un design dit tabless (absence d’un connecteur) et un format de cellule plus important. Cette nouvelle batterie devrait permettre à Tesla d’augmenter l’autonomie de ses véhicules et aussi de réduire les coûts de production.
- 32. Il peut ainsi arriver que des organismes de recherche soient très bien positionnés parmi les déposants français mais ne se retrouvent pas sur les graphiques au niveau mondial.
- 33. Selon la définition de Bpifrance, la Medtech « regroupe toutes les technologies destinées à l’environnement de soin et désigne aussi bien un site de prise de rendez-vous en ligne qu’un organe artificiel ou un robot chirurgical ».
Point de vue – L’innovation entrepreneuriale : une nouvelle frontière ?
Christophe Deshayes est chercheur à l’École de Paris du management où il anime le séminaire Transformations numériques et entrepreneuriales. Il est également codirecteur de la chaire Phénix – Grandes entreprises d’avenir (Mines Paris – PSL).
Tout le monde parle d’innovation comme d’une évidence, or cette notion est l’une des plus ambiguës de la sphère économique. Distinguer la rupture de l’incrémental ou la technologie de l’usage ne suffit pas à faire le tour de la question. On peut en effet énumérer plusieurs dizaines de types différents d’innovation. Il en émerge régulièrement, parfois avec un pouvoir de transformation qui n’a rien à envier aux innovations technologiques de rupture. Par exemple Orange, comme deux de ses concurrents présents en Afrique, a réussi dans les années 2010 à détourner la norme USSD pour créer une industrie nouvelle : la mobile money. À cette occasion, Orange a attiré sur son nouveau service plus de 40 millions de clients africains. Il s’agissait d’une innovation frugale, d’un usage détourné, d’un réseau de distribution innovant qui, articulés ensemble, ont abouti à une puissante disruption du marché bancaire.
Les grandes entreprises ne sont pas seulement les championnes incontestées du dépôt de brevet, elles sont actives dans toutes les formes d’innovation. Alors non, l’innovation n’est pas l’apanage exclusif des start-up. D’ailleurs, l’intensité de l’innovation de certaines start-up digitales pourrait mériter d’être interrogée quand leur présentation se résume à la formule : « Nous sommes le Uber ou le Airbnb de tel domaine… », ou que les investisseurs se positionnent en priorité sur le « dernier kilomètre » de l’innovation dont l’essentiel du chemin a été financé par d’autres.
Mais il existe bien cependant un type d’innovation qui est consubstantiel à la start-up et non à la grande entreprise, c’est l’innovation entrepreneuriale, c’est-à-dire celle qui nécessite un pilote à l’esprit d’entrepreneur et une structure juridique spécifique et isolée pour s’épanouir (spin-off, start-up intrapreneuriale, filiale excubée…).
Quand les grandes entreprises retrouvent leurs racines entrepreneuriales fondatrices
De nombreuses grandes entreprises se sont lancées dans des actions d’acculturation à cette innovation entrepreneuriale via des hackathons, des learning expeditions, des fab labs… Elles investissent aussi dans des start-up ou en achètent, ce qui les conduit souvent à constituer des équipes de financiers issus du capital risque, un genre nouveau pour elles. D’autres, ou les mêmes, ont lancé des programmes d’intrapreneuriat, dans lesquels des volontaires sélectionnés, souvent jeunes, s’impliquent pendant quelques mois dans un projet innovant d’esprit entrepreneurial, au risque financier personnel près. Ils développent leur projet dans des incubateurs où ils voisinent parfois avec des créateurs de start-up soutenus par l’entreprise. En réalité, les grandes entreprises ont lancé tellement de dispositifs qu’elles les ont structurés pour les rendre visibles aussi bien de l’intérieur que de l’extérieur. Ces portes d’entrée s’appellent désormais ENGIE Fab (Engie), Gardens (Orange), NOVA (Saint-Gobain), Leonard (Vinci), VIA (Veolia), Village by CA (Crédit agricole)…
Les grandes entreprises essaient ainsi de s’approprier les méthodes et l’imaginaire des start-up, mais leurs enjeux et les rythmes diffèrent encore. Dans l’écosystème des start-up, on prétend qu’il faut réussir en neuf mois ou mourir. C’est totalement illusoire dans les grandes entreprises ; d’ailleurs, les réussites intrapreneuriales présentées comme telles sont, toutes, vieilles de plus de trois ans. Une start-up doit se faire une place pour justifier de son existence, tandis qu’une grande entreprise doit se réinventer pour rester au top ; ce sont deux logiques très différentes.
Alors que la start-up part de l’idée initiale, la page blanche (méthode type 1), l’innovation en entreprise part souvent d’une connaissance du marché ou d’une volonté de réagencer des actifs existants pour apporter une valeur supplémentaire aux clients et donc aux actifs en question (méthode type 2). Ce type de projet revient non pas à faire pousser un arbre à partir d’une graine plantée dans le sol, comme le suggère le principe schumpétérien de destruction créatrice, mais à faire pousser un deuxième étage d’arbres sur un arbre existant, comme dans la technique séculaire du Daisugi (taille des cèdres du Japon).
Presque toutes les grandes entreprises peuvent désormais afficher des exemples de start-up intrapreneuriales viables qui ont souvent rejoint leurs business units (type 1). Elles peinent cependant à les passer à l’échelle. Ces succès encore modestes ont modifié sensiblement leur culture managériale mais pas encore leur donne stratégique. En revanche, quelques grandes entreprises affichent des réussites de type 2 plus importantes, comme Danone, avec sa marque bio Les deux vaches, ou le groupe Casino, qui a partiellement cédé à l’été 2022 sa filiale intrapreneuriale GreenYellow, laquelle installe et exploite sur tous les continents des panneaux photovoltaïques sur les toits des magasins du groupe et ceux de concurrents, tout en optimisant leur consommation d’énergie. Le prix de cession de cette dernière, de 1,4 milliard d’euros, en fait à notre connaissance la première start-up entrepreneuriale à atteindre la valorisation d’une licorne.
Les grandes entreprises ont donc, pour se réinventer par la voie de l’innovation entrepreneuriale, deux méthodes à disposition : transposer en leur sein la méthode start-up (type 1) ou développer une méthode propre, s’appuyant sur une opportunité identifiée par l’entreprise elle-même, et développée par un intrapreneur sélectionné pour ses capacités et capable d’articuler autrement des actifs existants (type 2). Pour ces grandes entreprises innovantes, le terme phénix serait aussi mérité que celui de licorne pour les start-up à haut potentiel.
Conclusion
Ces dernières années ont fait la part belle à l’idée de reconquête de notre souveraineté technologique et de réindustrialisation du pays. Ces deux objectifs résonnent aujourd’hui dans de nombreux discours politiques à l’échelle française et européenne. Mais cette volonté de faire « une Europe puissante dans le monde, pleinement souveraine et maître de son destin »34 semble relever de l’incantation tant la position de la France et de l’Europe dans le monde révèle un retard dans la maîtrise des grandes évolutions technologiques, voire une situation de décrochage. Face à elles, l’Asie et les États-Unis apparaissent bien plus déterminés dans la bataille technologique.
C’est en tout cas le premier enseignement que nous tirons de l’analyse de brevets menée dans cette étude. Dans les domaines technologiques concourant à la transition énergétique et numérique, la France et l’Europe font pâle figure lorsqu’on les place dans un cadre de compétition mondiale. Certes, quelques pays européens se distinguent, à l’instar de l’Allemagne, qui figure parmi les leaders dans la moitié des domaines étudiés. De même, le Danemark, la Finlande et les Pays-Bas sont bien positionnés dans les domaines des carburants durables pour le secteur aérien et des éoliennes en mer. Mais on ne s’aurait s’en satisfaire, puisque les premières places du podium sont systématiquement occupées par les mêmes pays : États-Unis, Chine, Japon et Corée du Sud.
Certes encore, une fois son périmètre statistique reconstitué, l’Union européenne apparaît volontiers en situation de leader mondial ces technologies. Mais, d’une part, elle ne parvient pratiquement jamais à détenir plus de la moitié des brevets sur un domaine donné, contrairement aux États-Unis. Deuxièmement, on ne peut oublier que l’UE compte faiblement sur les apports des innovateurs français, dont on vient de rappeler l’effacement des premières places du podium. Troisièmement, il faut ici rappeler que, dans certains domaines, la Corée ou la Japon parviennent à faire jeu égal avec l’Union européenne entière : c’est bien que leur stratégie technologique est autrement plus pugnace que celles des 27 États-membres. Enfin, et pour finir, cette agrégation statistique n’a réellement de sens que dans la mesure où les politiques publiques associées sont elles aussi conçues à l’échelle communautaire, ce qui n’est pas pleinement le cas.
Alors que l’Europe se dit particulièrement engagée, voire précurseuse dans la lutte contre le réchauffement climatique, avec notamment la mise en place d’un certain nombre de politiques visant la réduction des émissions de carbone à l’horizon 2050, elle apparaît ainsi peu impliquée dans le développement des nouvelles technologies, lesquelles sont pourtant les piliers de la transition énergétique bas carbone.
Un autre résultat fort de cette étude est la prépondérance des entreprises parmi les déposants de brevets relatifs aux innovations de rupture. Par voie de conséquence, le retard des pays européens, considérés séparément, viendrait d’abord de la difficulté de leurs entreprises à proposer des solutions innovantes au marché. Une analyse plus fine des données au niveau français suggère d’ailleurs que la recherche publique est parfois la seule à déposer des brevets, tandis que les entreprises peinent à prendre le relais.
Alors qu’on a beaucoup écrit sur l’incapacité de la France à faire émerger des start-up innovantes, l’idée d’un rôle décisif qu’elles joueraient dans l’émergence des innovations de rupture est battue en brèche par les données : elles figurent rarement parmi les principaux déposants de brevets. Bien sûr, les start-up se distinguent dans certains domaines, parmi lesquels le photovoltaïque, le recyclage biologique de plastique ou l’ARN messager. Leur réussite est d’ailleurs souvent le fruit d’une fructueuse collaboration avec la recherche publique, dont elles sont même parfois directement issues.
Il peut exister des cas de figure (dans certains pays ou dans certains domaines) où les grandes entreprises maintiennent leur effort d’innovation sans être aiguillonnées par la concurrence des start-up. Il peut également en exister d’autres où ces dernières entrent en concurrence directe avec elles. Mais on ne trouve pas de cas significatif où les start-up réussiraient à dominer une course technologique que les grandes entreprises n’auraient pas décidé de mener. Quand les grandes entreprises renoncent, l’écosystème se fragilise et les start-up sont les premières à en pâtir. Ainsi, leur stratégie semble parfois se résumer davantage à mobiliser les technologies existantes de façon à (re)constituer au plus vite une offre capable de rivaliser avec les concurrents asiatiques et américains plutôt qu’à développer leurs propres technologies. Seule la recherche publique peut alors survivre en apesanteur, ce qui ne signifie pas que cela soit une situation opportune.
Pour finir, les constats dressés dans cette Note rappellent, si besoin était, l’importance des politiques d’innovation ambitieuses visant certains domaines jugés stratégiques. En effet, les économies, pour rester ou revenir à la frontière technologique tout en relevant les défis planétaires du moment, doivent anticiper les nouvelles technologies ou les produits les plus prometteurs, et donc compléter les mesures transversales de soutien à l’innovation qui s’adressent à l’ensemble des secteurs. Le quatrième programme d’investissement d’avenir (PIA 4) s’inscrit dans cette démarche. À la différence des précédentes versions du PIA, il adopte une logique d’innovation dite « dirigée », visant à accélérer l’innovation dans des secteurs et technologies prioritaires grâce à des financements « exceptionnels » d’un montant de 12,5 milliards d’euros sur 5 ans (sur les 54 milliards prévus). Il est difficile de prédire aujourd’hui les retombées de cet effort, en termes de parts de marché sur de nouveaux produits par exemple, ou même de dépôts de brevets. Mais on ne peut pas escompter que les entreprises, seules, investissent au bon moment et avec une intensité suffisante dans des domaines hautement technologiques et aux barrières à l’entrée importantes. Dans un monde animé par des acteurs très puissants, où une montée en gamme insuffisamment rapide se paie au prix d’un déclassement industriel et technologique, l’État est au centre du jeu.
- 34. Discours tenu par Emmanuel Macron lors de la conférence de presse sur la présidence française de l’Union européenne, le 9 décembre 2021.
Bibliographie
Arrow, K. J. (1962). Economic welfare and the allocation of resources for invention. In The Rate and Direction of Inventive Activity. Economic and Social Factors. National Bureau of Economic Research. Princeton University Press (pp. 609626). https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9781400879762-024/html?lang=en
Autret, F. (2001). L’innovation technologique en Allemagne : performances et limites d’un système. In I. Bourgeois (dir.), Allemagne 2001. Regards sur une économie en mutation (pp. 3958). CIRAC. http://books.openedition.org/cirac/845
Babinet, G., & Coste, O. (2022). Technologies numériques : comprendre le retard croissant de l’Europe en huit graphiques
Beffa, J.-L. (2017). Se transformer ou mourir. Les grands groupes face aux start-up. Éditions du Seuil.
Bellit, S. (2021). Politique industrielle en réponse à la crise : Le retour de l’État pilote. Les Synthèses de La Fabrique, Le Cube, vol. 11.
Binois, É. (2022). Recherche publique et entreprises : une coopération à renforcer. Les Synthèses de La Fabrique, Le Cube, vol. 20.
Boston Consulting Group (2022). Corporate Venture Capital et startups : comment prolonger le coup de foudre ? Les clés d’une association réussie. BCG – RaiseLab.
Bpifrance (2019). Génération Deeptech. https://www.slideshare.net/Bpifrance/generation-deeptech
Bpifrance & France Digitale (2021). Mapping des start-up à impact [Carte].
Breschi, S., Malerba, F., & Orsenigo, L. (2000). Technological regimes and schumpeterian patterns of innovation. The Economic Journal , vol. 110, n° 463, pp. 388-410.
CEA (2020). Rapport financier 2020 . CEA.
Christensen, C. M. (1997). The Innovator’s Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail . Boston: Harvard Business School Press.
Christensen, C. M., & Raynor, M. E. (2003). The Innovator’s Solution: Creating and Sustaining Successful Growth .
Cleantech for France (2022). Décarbonation, réindustrialisation et souveraineté verte en France. Zoom sur 13 domaines technologiques d’avenir.
CNRS Images (2008). Nanotubes de carbone. Notice n° 1967. https://images.cnrs.fr/video/1967
CNRS (2020). « La création d’entreprises, au CNRS, ça fonctionne ». https://www.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/la-creation-dentreprise-au-cnrs-ca-fonctionne
Crifo-Tillet, P. (1999). L’analyse de l’innovation dans les modèles de croissance endogène. 142, 189221.
Deshayes, C. (2021). Réconcilier David et Goliath à l’heure de la start-up nation. La Gazette de la société et des techniques, vol. 112.
Djelalian, J.-C., & Neale-Besson, I. (2006). La Commission autorise le régime de soutien français en faveur des programmes mobilisateurs pour l’innovation industrielle géré par l’Agence de l’innovation industrielle. Competition Policy Newsletter, n° 3, pp. 77-79.
Doche, A. (2013). Renault : la Zoe très en dessous des objectifs de vente de 2013 ? Caradisiac. https://www.caradisiac.com/Renault-la-Zoe-tres-en-dessous-des-objectifs-de-vente-en-2013-90163.htm
Dosi, G. (1982). Technological paradigms and technological trajectories: A suggested interpretation of the determinants and directions of technical change. Research Policy , vol. 11, n° 3, pp. 147-162. https://doi.org/10.1016/0048-7333(82)90016-6
Dupont-Calbo, J. (2021). Les Echos
Ergas, H. (1986). Does Technology Policy Matter? (SSRN Scholarly Paper 1428246). https://doi.org/10.2139/ssrn.1428246
Francois, V. (2015). Les dynamiques entrepreneuriales d’une spin-off universitaire en phase d’émergence et lauréate du concours BPI. Revue de l’entrepreneuriat, vol. 14, pp. 41-72.
Giget, M., & Hillen, V. (2021). Pérennité, innovation et résilience des entreprises. Panorama mondial des entreprises historiques innovantes. EICSI. https://www.decitre.fr/livres/perennite-innovation-et-resilience-des-entreprises-9782956461135.html
Granier, C. (2021). Industrie et start-up : des destins liés ? Les Docs de La Fabrique, vol. 14. Presses des Mines.
Hall, B. H. (2002). The financing of research and development. Oxford Review of Economic Policy , vol. 18, n° 1, pp. 35-51. https://doi.org/10.1093/oxrep/18.1.35
Hamon-Beugin, V. (2022, février). Verkor choisit Dunkerque pour implanter sa méga-usine de batteries, 1 200 emplois à la clé. L’Usine nouvelle. https://www.usinenouvelle.com/editorial/verkor-choisit-dunkerque-pour-implanter-sa-mega-usine-de-batteries-1-200-emplois-a-la-cle.N1780032
INPI (2021). Rapport annuel 2021. INPI.
INPI (2023). Baromètre OEB 2022 : la France reste le deuxième pays le plus innovant d’Europe.
https://www.inpi.fr/barometre-oeb-2022-france-deuxieme-pays-innovant-europe#
Landier, A., & Thesmar, D. (2014). 10 idées qui coulent la France (nouvelle édition augmentée). Flammarion.
Larédo, P., & Mustar, P. (1994). Les institutions face aux stratégies des laboratoires de recherche. Politiques et Management Public, vol. 12, n° 2, pp. 99-114.
Larrue, P. (2023). Répondre aux défis sociétaux : le retour en grâce des politiques « orientées mission » ? Les Docs de La Fabrique. Presses des Mines.
Levin, R. C., Klevorick, A. K., Nelson, R. R., Winter, S. G., Gilbert, R., & Griliches, Z. (1987). Appropriating the returns from industrial research and development. Brookings Papers on Economic Activity, vol. 1987, n° 3, pp. 783-831. The Johns Hopkins University Press. https://doi.org/10.2307/2534454
L’Oréal (2021). Le premier flacon cosmétique en plastique issu du recyclage enzymatique. Loreal.com. https://www.loreal.com/fr/news/commitments/loreal-launches-the-first-cosmetic-bottle-made-from-recycled-plastic-with-carbios/
Mabille, V., & Neveu, A. (2021). Demain, la Chine ouverte ? Les Docs de La Fabrique. Presses des Mines.
Malerba, F., & Orsenigo, L. (1995). Schumpeterian patterns of innovation. Cambridge Journal of Economics , vol. 19, n° 1, pp. 47-65.
Mansfield, E., Schwartz, M., & Wagner, S. (1981). Imitation costs and patents: An empirical study. The Economic Journal , vol. 91, n° 364, pp. 907-918. https://doi.org/10.2307/2232499
Martinage, X. (2022). Capital
https://www.capital.fr/auto/tesla-les-roadster-se-vendent-a-des-prix-record-1425200
Mines Paris – PSL (2022, octobre). Quelles relations entre recherche publique et entreprises ? Les résultats d’une enquête nationale.
Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche, DGRI-DGESIP (2023). L’État de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation en France, n° 16. Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche, Direction générale de la recherche et de l’innovation, Direction générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle. https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/l-etat-de-l-enseignement-superieur-de-la-recherche-et-de-l-innovation-en-france-90566
Mitterrand, F. (1982). Discours de M. François Mitterrand, Président de la République, clôturant les journées de travail sur la politique industrielle de la France, Paris, Maison de la chimie, 16 novembre 1982. https://www.elysee.fr/francois-mitterrand/1982/11/16/discours-de-m-francois-mitterrand-president-de-la-republique-cloturant-les-journees-de-travail-sur-la-politique-industrielle-de-la-france-paris-maison-de-la-chimie-mardi-16-novembre-1982
Narin, F., Carpenter, M. P., & Woolf, P. (1984). Technological performance assessments based on patents and patent citations. IEEE Transactions on Engineering Management , vol. EM-31, n° 4, pp. 172-183. https://doi.org/10.1109/TEM.1984.6447534
Nelson, R. (1959). The Simple Economics of Basic Scientific Research. Journal of Political Economy , vol. 67. https://econpapers.repec.org/article/ucpjpolec/v_3a67_3ay_3a1959_3ap_3a297.htm
Okubo, Y. (1997). Indicateurs bibliométriques et analyse des systèmes de recherche : méthodes et exemples. OCDE, n° 1997/01. Éditions OCDE. https://doi.org/10.1787/233811774611
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (2021). Propriété intellectuelle : faits et chiffres de l’OMPI 2021. OMPI. https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/fr/wipo-pub-943-2021-fr-wipo-ip-facts-and-figures-2021.pdf
Ottmann, J.-Y. (2021). Manager la recherche publique : défendre l’indépendance, assurer la pérennité. Annales des Mines – Gérer et comprendre, vol. 145, n° 3, pp. 13-25. Cairn.info. https://doi.org/10.3917/geco1.145.0013
Park, M., Leahey, E., & Funk, R. J. (2023). Papers and patents are becoming less disruptive over time. Nature https://doi.org/10.1038/s41586-022-05543-x
Pavitt, K. (1984). Sectoral patterns of technical change: Towards a taxonomy and a theory. Research Policy , vol. 13, n° 6, pp. 343373. https://doi.org/10.1016/0048-7333(84)90018-0
Potier, B. (2020). Faire de la France une économie de rupture technologique. Soutenir les marchés émergents à forts enjeux de compétitivité. Rapport aux ministre de l’Économie et des Finances et ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.
Revol, M., & Piet, J. (2021). Rachat des start-up : des racines françaises, des ailes étrangères. Les Docs de La Fabrique, vol. 15. Presses des Mines.
Robbins, C. (2022). Invention, Knowledge Transfer, and Innovation. National Science Foundation. https://ncses.nsf.gov/pubs/nsb20224
Silberzahn, P. (2015). Relever le défi de l’innovation de rupture. Pearson.
Sommazi, A. (2022). Pas encore né, l’avion régional 100 % électrique d’Aura Aero séduit déjà. Le Monde. https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/10/16/pas-encore-ne-l-avion-regional-100-electrique-d-aura-aero-seduit-deja_6145988_3234.html
Annexe 1 : Méthode d’analyse de brevets sur l’échantillon de douze innovations de rupture
Données mobilisées
La première étape de ce travail a consisté à construire une base de données recensant les brevets déposés entre 2010 et 2019 par des inventeurs issus de douze pays européens et non européens.
Pour ce faire, l’Observatoire des sciences et techniques (OST) s’est appuyé sur Patstat, une base de données produite par l’Office européen des brevets (OEB, ou EPO pour European Patent Office), qui contient des données exhaustives de dépôts de brevets réalisés auprès des principaux offices nationaux et de deux grands offices régionaux, l’Office européen des brevets et l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI, ou WIPO pour World Intellectual Property Organization). Outre son large périmètre géographique, l’intérêt de la base Patstat réside dans le regroupement des brevets en familles, qui rassemblent les brevets déposés par un même déposant autour d’une même technologie ou invention. Il est en effet fréquent que des dépôts de brevets soient réalisés dans plusieurs pays pour une seule invention. De même, il arrive qu’un premier dépôt de brevet, dit brevet prioritaire, soit complété par des extensions. La comptabilisation des familles de brevets35 plutôt que des brevets isolés permet ainsi d’éviter les duplications.
Ensuite, ont été écartées des corpus les familles de brevets déposées dans un seul office, pour ne garder que les familles disposant d’extensions dans au moins deux offices – en incluant les familles déposées uniquement auprès de l’EPO ou du WIPO, portes d’entrée vers une sélection d’offices. Cette distinction repose sur l’hypothèse que les familles de brevets soumises à plus d’un office ont une valeur supérieure, tant sur le plan économique (un marché élargi) que technologique (davantage d’expertise dans l’examen d’innovativité), aux familles qui ne sont présentées que dans un office, l’objectif étant souvent de protéger un marché par une barrière juridique ad hoc.
Identification des déposants
Afin de caractériser les déposants de familles de brevets (entreprises, administration publique, universités, individus), l’OST s’est appuyé sur la typologie issue de la base de données Patstat. Toutefois, les données publiées par celle-ci ne consignent que le dernier déposant du brevet. Ainsi l’exploitation des données présente trois limites principales. Premièrement, les titulaires originels du brevet peuvent avoir disparu de la base. Deuxièmement, les nouveaux titulaires n’inscrivent pas toujours le rachat de brevet car cette inscription n’est pas obligatoire (elle est généralement effectuée lors de litiges en contrefaçon)36.
Les fusions ou acquisitions des entreprises ne sont pas prises en compte par la base de données, ni les liaisons financières entre entreprises37. En outre, le manque d’homogénéité orthographique amène à unifier le nom de certains déposants38.
Afin d’identifier l’activité des grands groupes dans le cadre de chacune des douze technologies étudiées, l’OST a, dans un premier temps, additionné les familles déposées par chaque maison mère et ses filiales. Il est possible qu’un certain nombre de fusions et acquisitions, non rendues publiques, échappent à cette comptabilisation. Les grands groupes ainsi détectés ont ensuite été confrontés à la base Cor&Dip (2021), qui fournit des informations sur l’activité de R&D, les brevets et les marques des 2 000 entreprises les plus performantes en R&D dans le monde.
Enfin, pour mieux caractériser les déposants français, les familles de brevets qui leur sont associées ont été appariées à la base Sirene39, laquelle recense de nombreuses informations sur les établissements français telles que la raison sociale de l’établissement, sa taille, son statut juridique, son année de création et son code NAF (nomenclature d’activités française). Le principal objectif de cet appariement était de distinguer les grandes entreprises des start-up, ces dernières étant imparfaitement définies comme des entreprises dont l’ancienneté n’excède pas 15 ans40.
Construction d’un corpus de brevets associé à une innovation de rupture
Pour chacune des innovations de rupture de l’échantillon, les familles de brevets ont d’abord été repérées sur la base de leurs codes CPC (Cooperative Patent Classification, ou Classification coopérative des brevets). Chaque demande de brevet est en effet rattachée à un ou plusieurs domaines technologiques, définis par les experts des offices de brevets et structurés au sein d’une classification arborescente incluant des sections, des classes, des sous-classes, des groupes, et des sous-groupes. Cette classification représente ainsi une arborescence très fine, qui atteint aujourd’hui plus de 250 000 catégories.
À noter : une nouvelle sous-classe Y٠٢ a été créée pour identifier les technologies et applications d’atténuation ou d’adaptation au changement climatique. Cela a aidé au repérage des familles de brevets correspondant aux innovations de rupture en lien avec la transition écologique (éolien en mer, par exemple).
Dans tous les cas, le corpus a été défini d’une manière stricte : les familles de brevets sont sélectionnées si au moins l’un de leurs membres est désigné par le code du domaine en question. Afin de repérer les technologies prometteuses, les mots-clés signalés par La Fabrique de l’industrie (cf. figure 1.1) ont ensuite été recherchés à l’intérieur du corpus ainsi défini.
Le cas particulier des brevets chinois
Dans sa stratégie d’innovation, la Chine use depuis longtemps du transfert de technologie par l’intermédiaire des joint-ventures, qui imposent aux entreprises étrangères désireuses de s’implanter en Chine de s’associer à un partenaire chinois (Mabille et Neveu, 2021). De cette façon, les entreprises chinoises disposent d’un arsenal juridique leur permettant de copier gracieusement la propriété intellectuelle des entreprises occidentales. Cette pratique a été le moteur du développement de l’économie chinoise dans les années 2000.
Dans de nombreux secteurs, les entreprises chinoises ont atteint le même niveau de maturité industrielle que leurs concurrentes étrangères. De ce fait, l’économie chinoise est aujourd’hui moins basée sur l’imitation de produits que sur l’innovation. Elle s’est donc dotée en quelques années d’un cadre juridique visant à protéger la propriété intellectuelle, lequel incite fortement les entreprises chinoises à déposer des brevets.
La Chine se positionne désormais en tête de nombreux classements statistiques de dépôts de brevets, comme celui de l’OMPI (Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, 2021). Faut-il en déduire qu’elle est devenue le leader mondial de l’innovation ? À travers l’exemple de l’éolien en mer, on constate que la place de la Chine varie considérablement selon les critères de classement appliqués (cf. figure ci-dessous).
En effet, selon que les familles de brevets ont été déposées auprès d’un seul office ou au moins deux, la hiérarchie des titulaires change. Dans le premier cas, les pays asiatiques, au premier rang desquels figure la Chine, sont surreprésentés : les adresses chinoises, coréennes et japonaises représentent plus de 82 % des demandes mondiales de dépôts de brevets dans le domaine. Les adresses chinoises représentent à elles seules 48 % des demandes. Dans le second cas, ce sont les Allemands, les Danois et les Américains qui apparaissent comme leaders technologiques du domaine.
Si on considère que les brevets déposés dans au moins deux offices ont une valeur économique et technologique plus importante que ceux qui ont été déposés dans un seul office, on en conclut que les déposants chinois s’inscrivent davantage dans une stratégie de protection de leur marché que dans une réelle situation de leader technologique, ce qui tend à surévaluer leur activité inventive.
- 35. L’OST a utilisé les familles docdb comme unité d’analyse des brevets. La famille docdb est construite par les experts de l’Office européen des brevets pour Patstat et elle est non reproductible.
- 36. Bien que ce cas de figure soit marginal, il arrive ainsi qu’un organisme financier soit titulaire d’un brevet à la suite d’un rachat d’entreprise.
- 37. Ainsi, par exemple, dans le cas de la France, apparaissent des brevets dont le titulaire est Alstom, alors que General Electric a pris le contrôle de ses activités d’énergie et de réseaux en 2015.
- 38. Par exemple, des brevets de DCSN et DCNS Energy peuvent apparaître alors que la firme a changé de nom pour Naval Energy. Par conséquent, on trouvera des brevets détenus par la totalité des variantes de noms.
- 39. Système informatisé du répertoire national des entreprises et des établissements.
- 40. Comme le souligne un précédent Doc de La Fabrique de l’industrie (Granier, 2021), il n’existe pas de définition précise ou statistique du terme « start-up ».
Annexe 1 : Nombre de familles de brevets par année et par adresse du titulaire
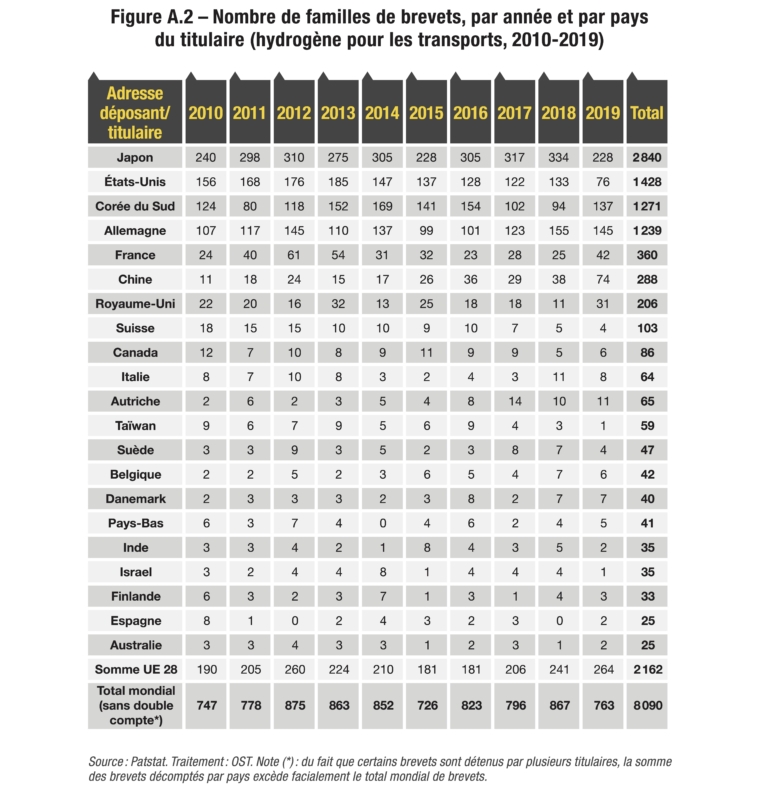
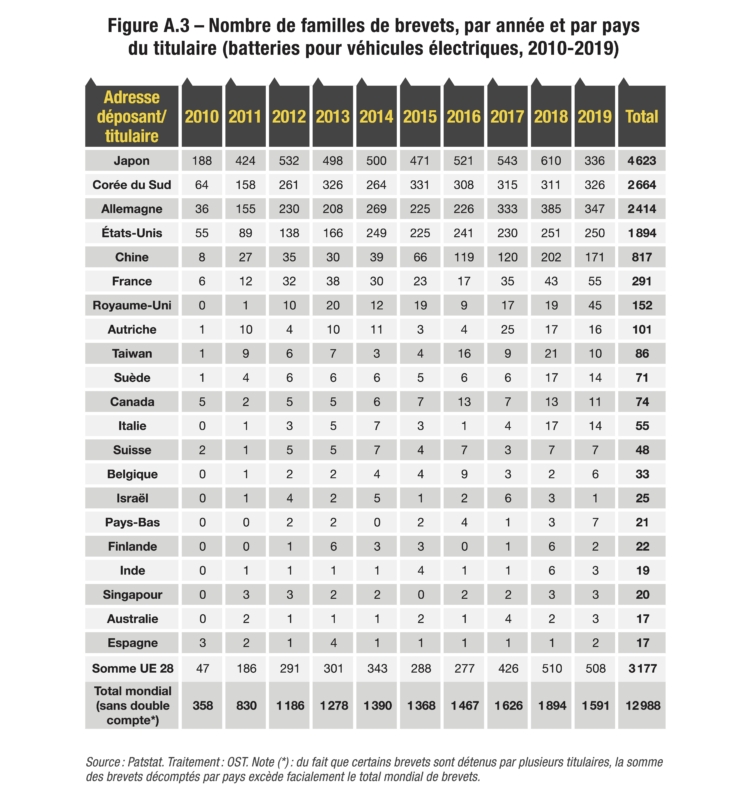
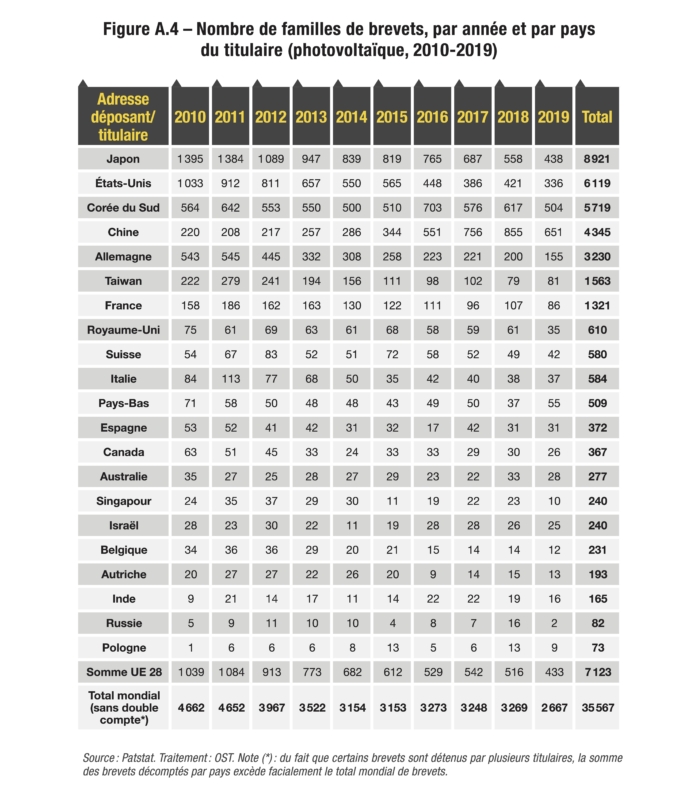
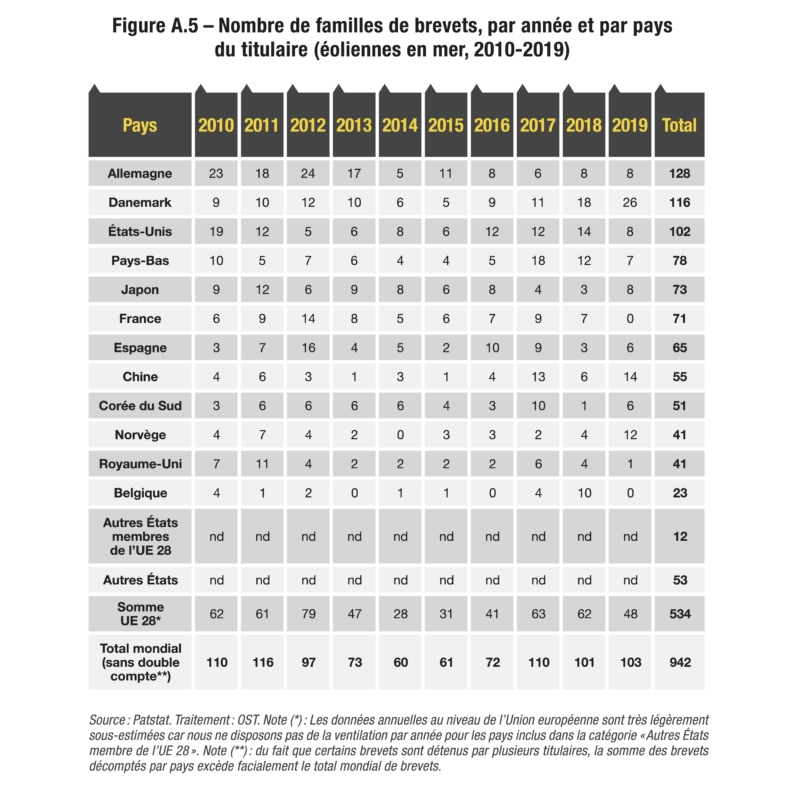
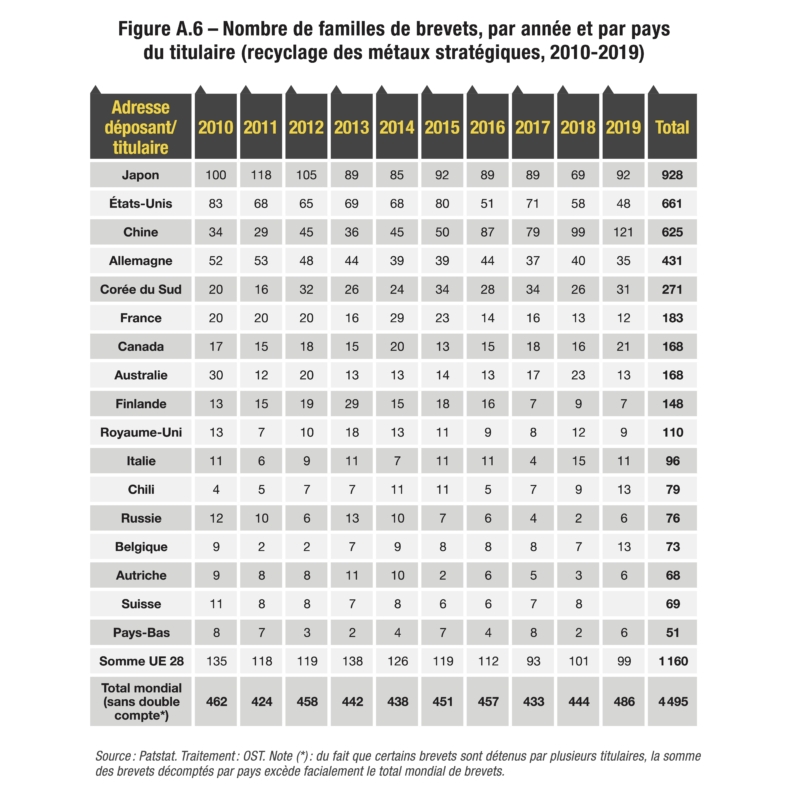
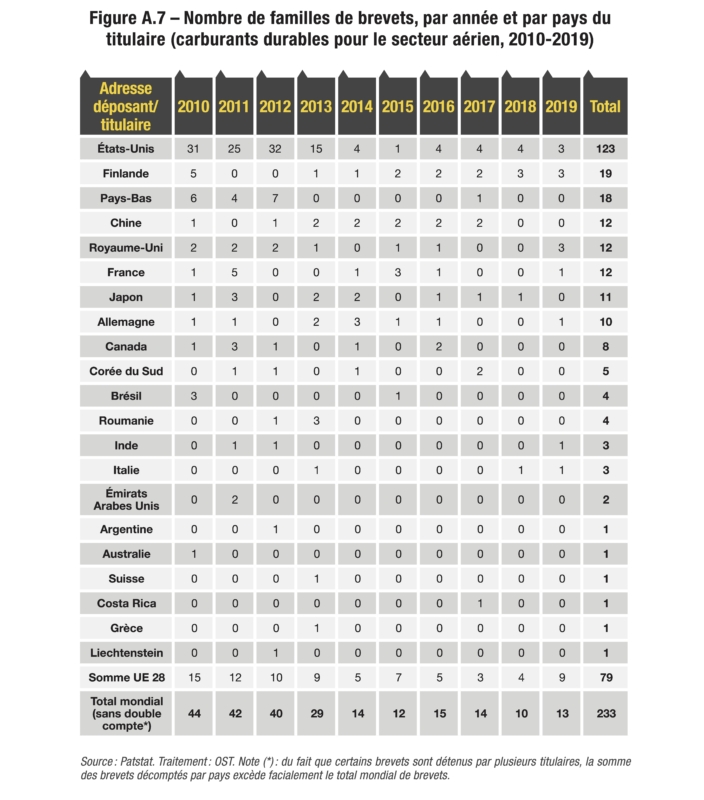
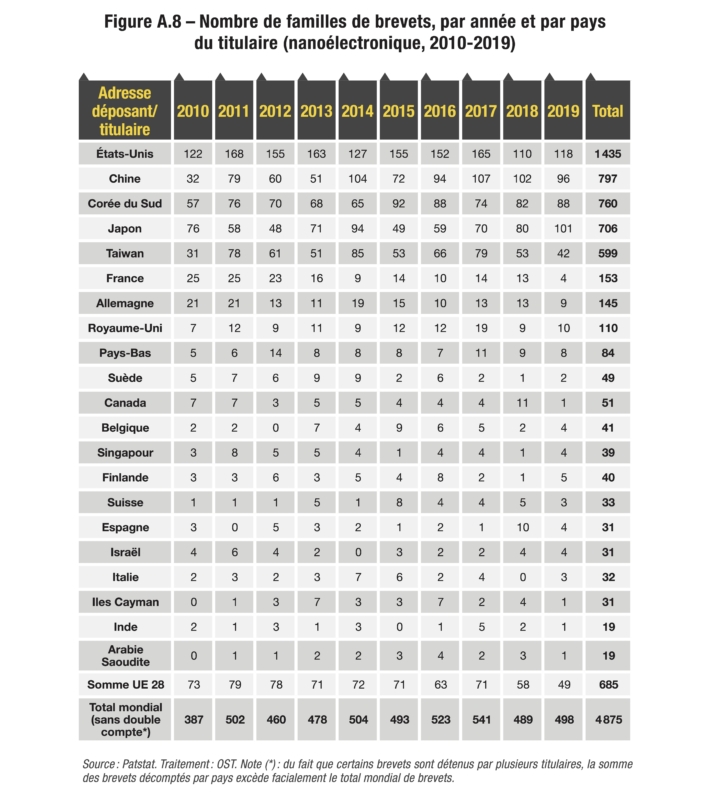
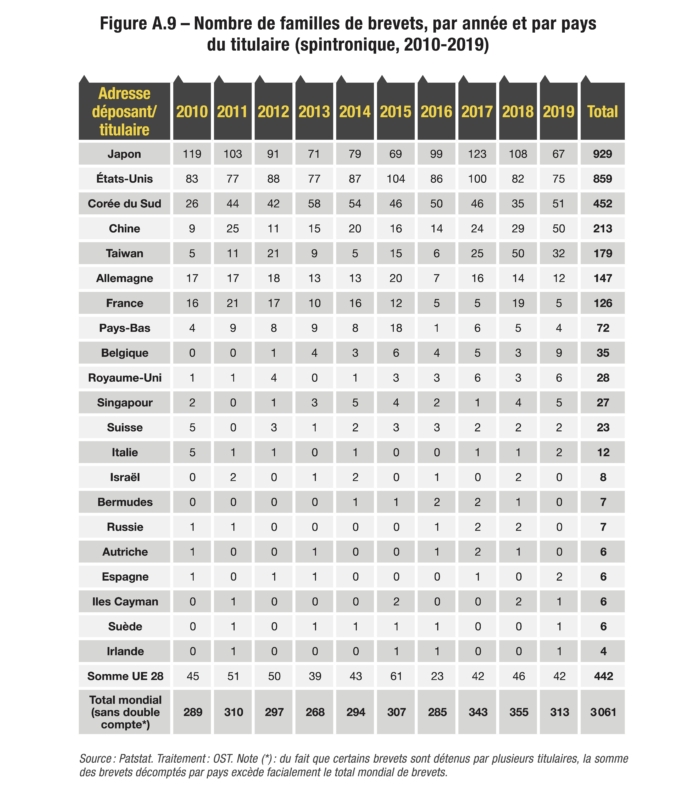
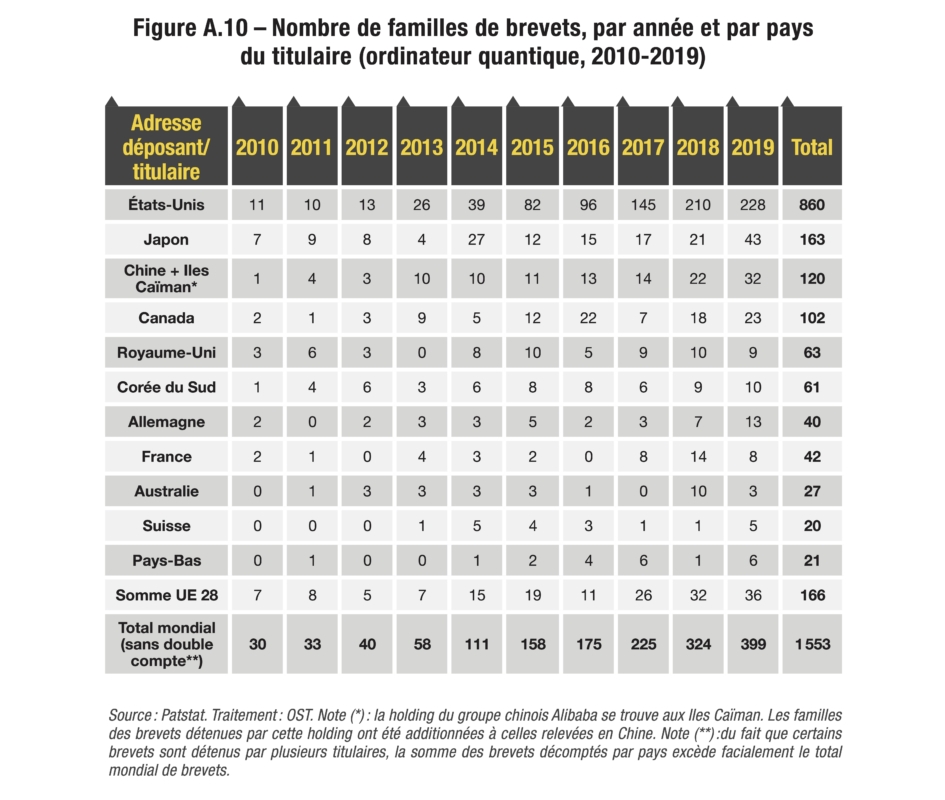
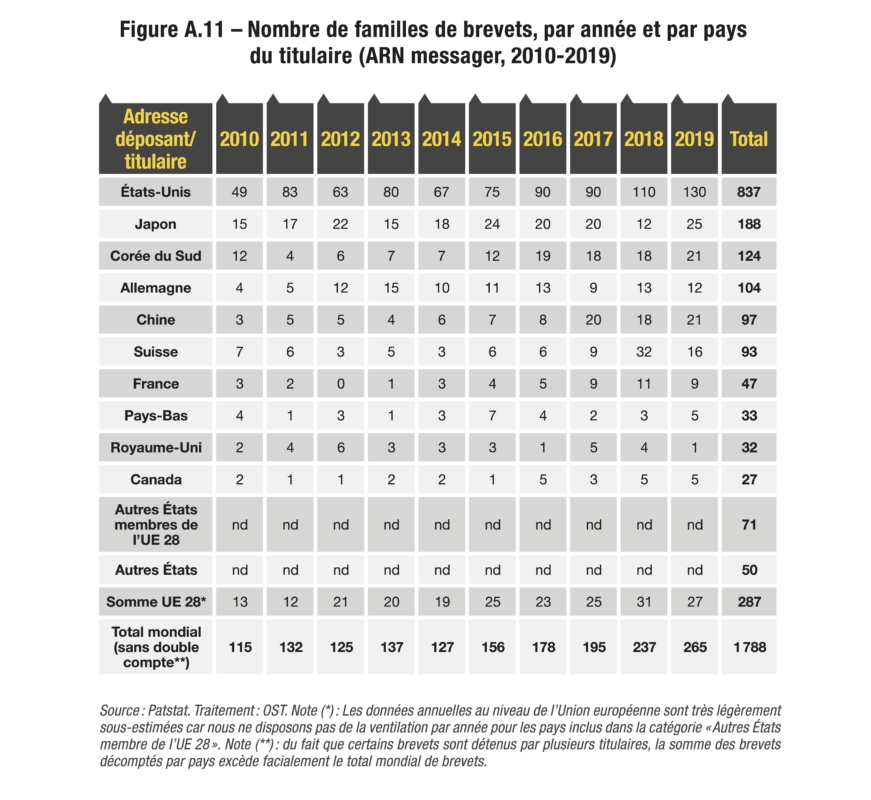
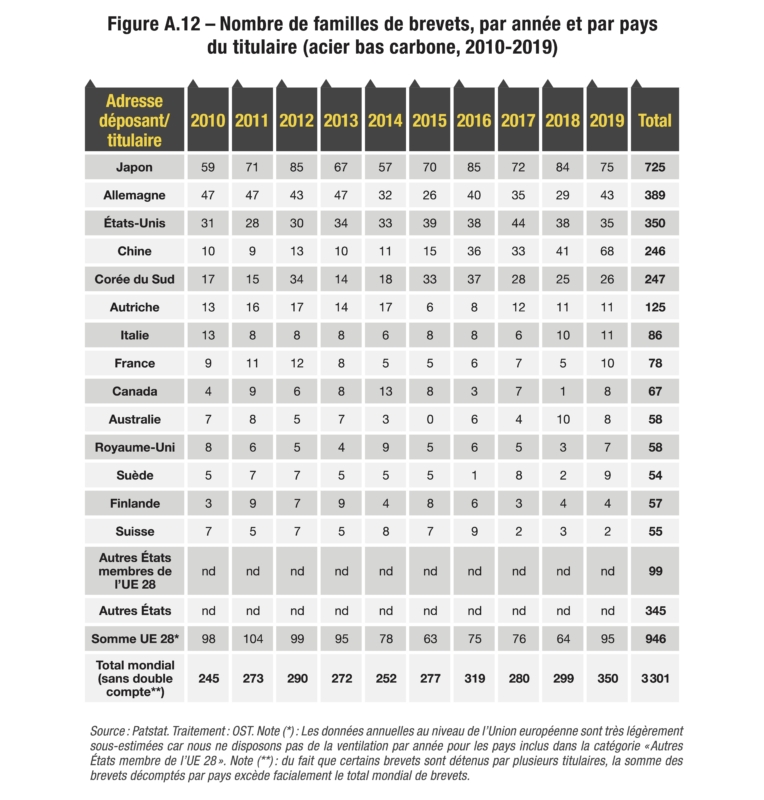
Sonia Bellit, Vincent Charlet, L’innovation de rupture, terrain de jeu exclusif des start-up ?, Les Notes de La Fabrique, Paris, Presses des Mines, 2023.
ISBN : 978-2-38542-122-9 ISSN : 2495-1706
© Presses des Mines – Transvalor, 2023
60, boulevard Saint-Michel – 75272 Paris Cedex 06 – France presses@mines-paristech.fr
www.pressesdesmines.com
© La Fabrique de l’industrie
81, boulevard Saint-Michel – 75005 Paris – France info@la-fabrique.fr
www.la-fabrique.fr