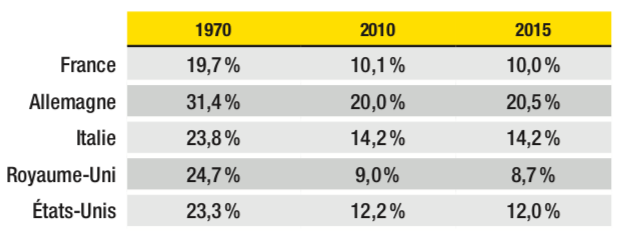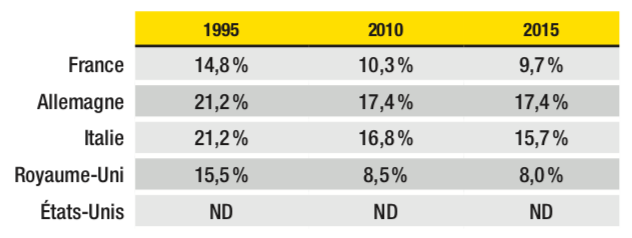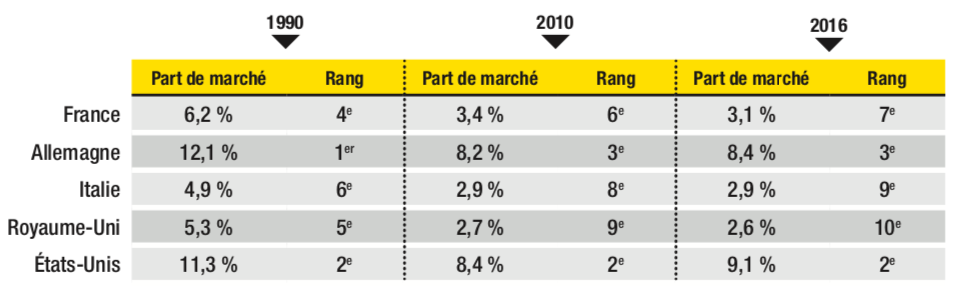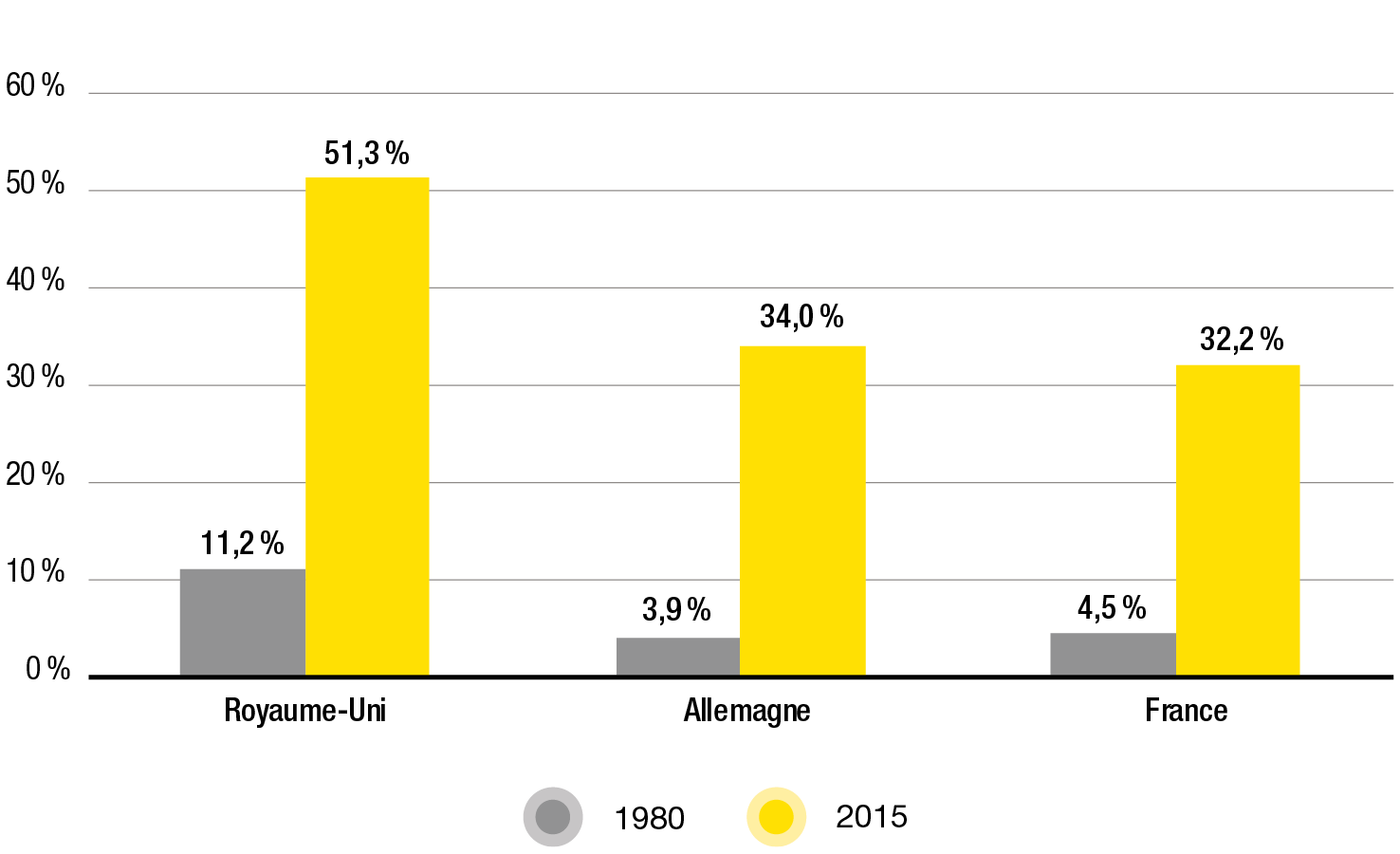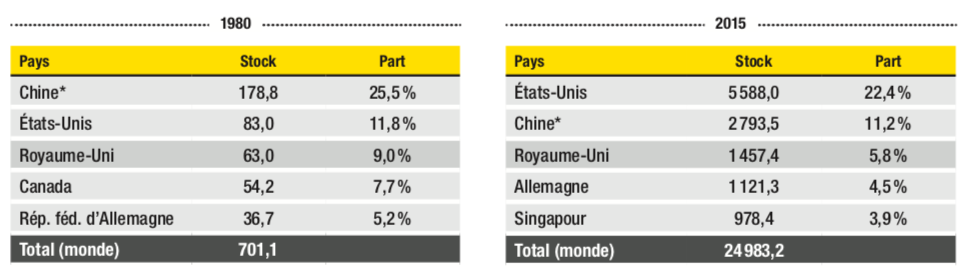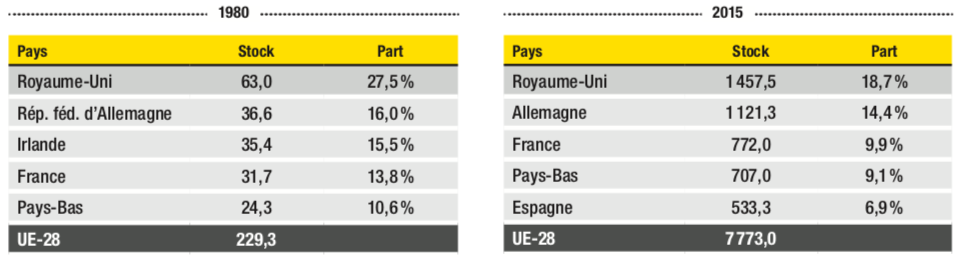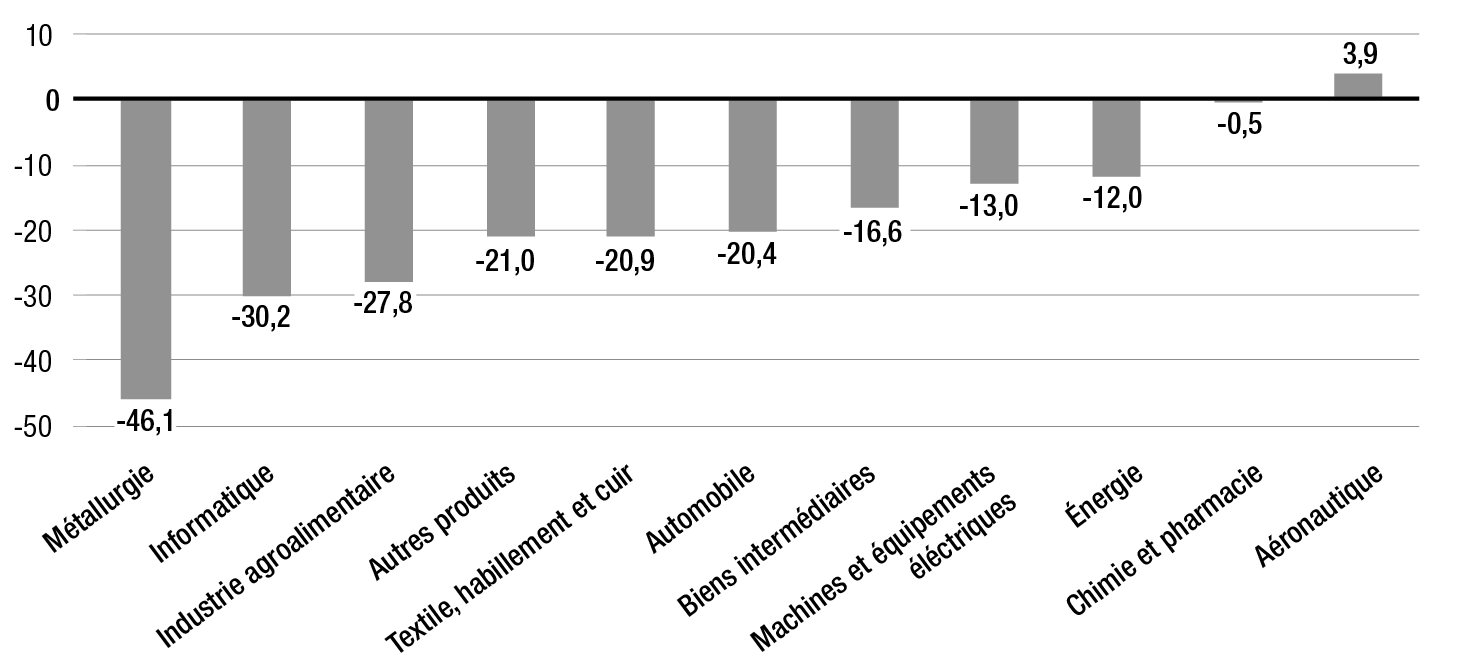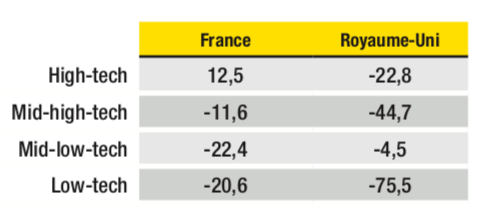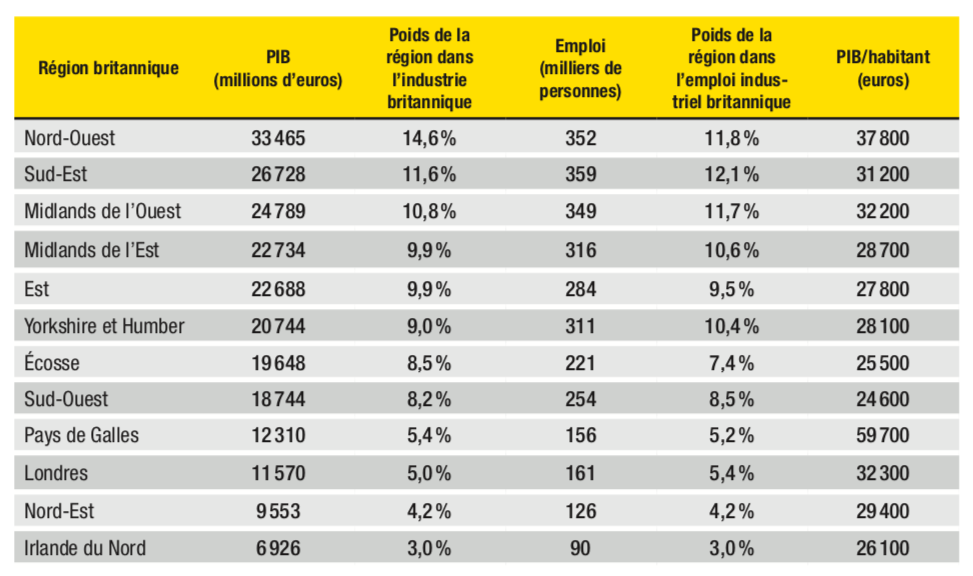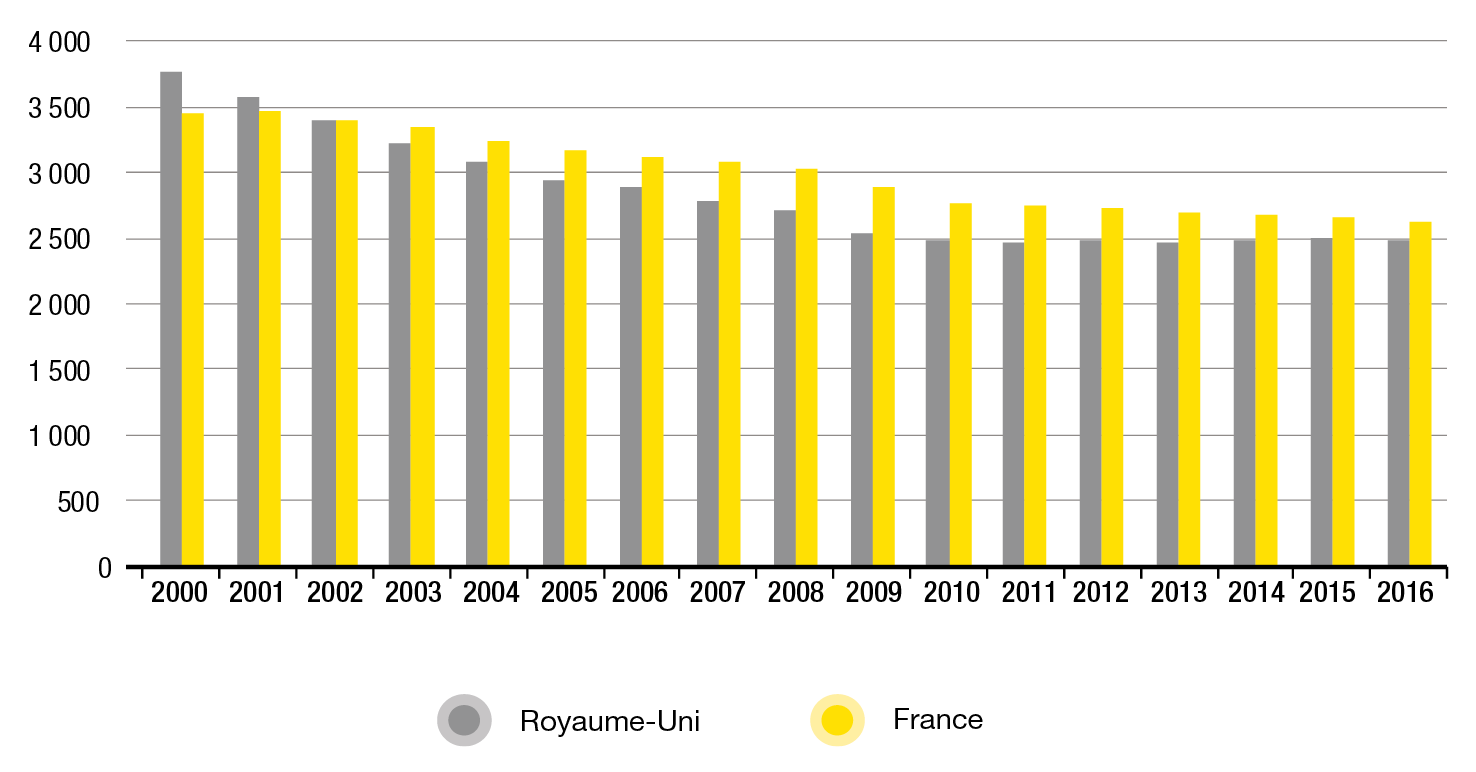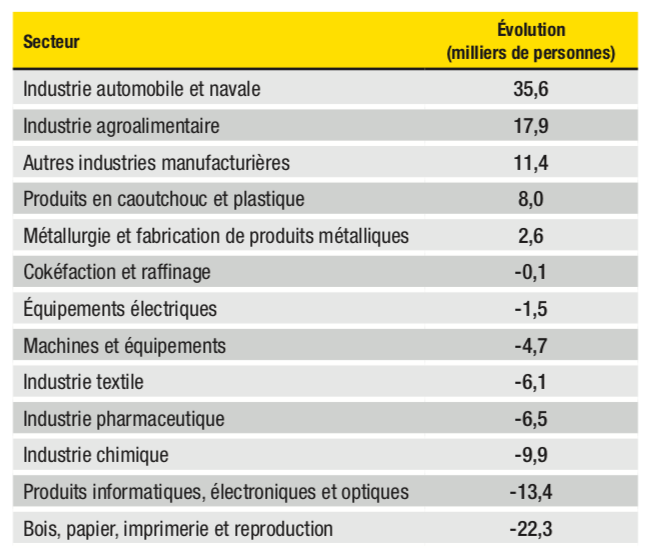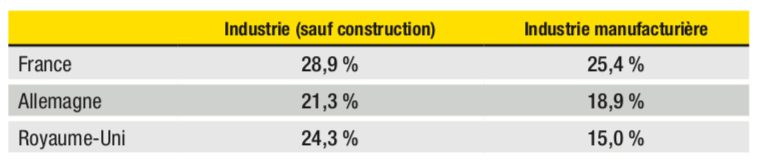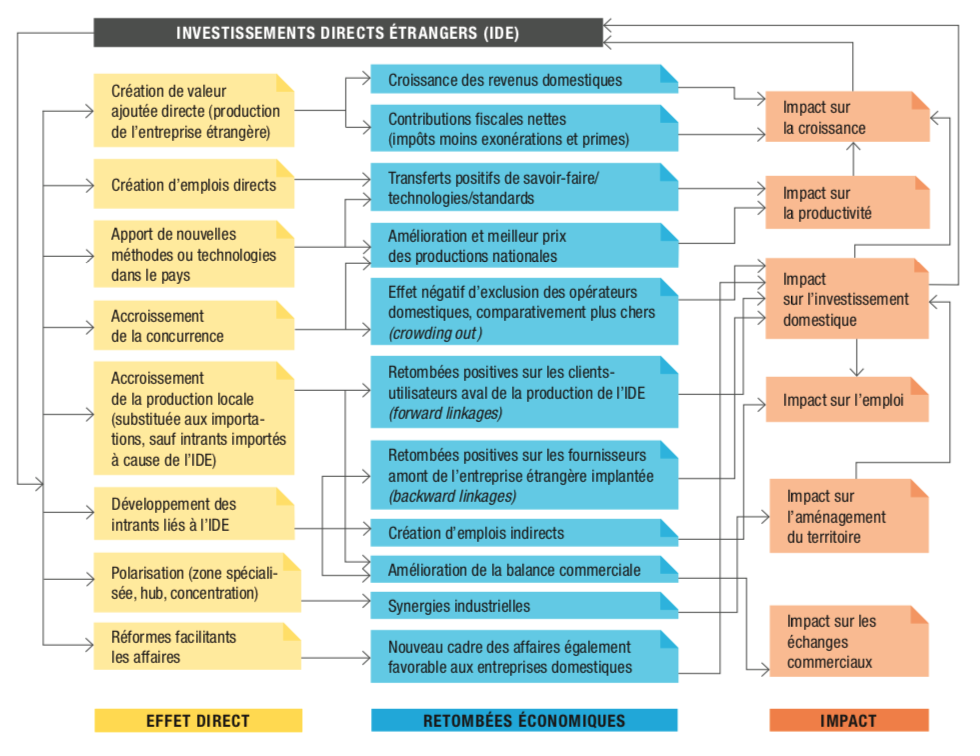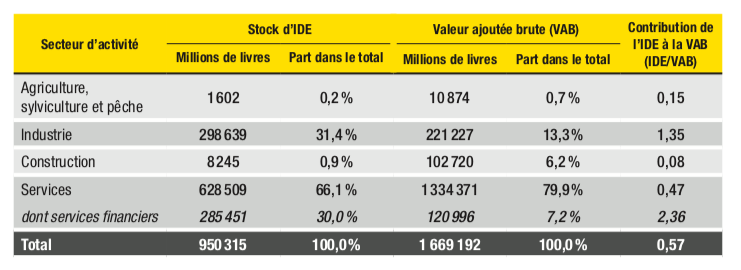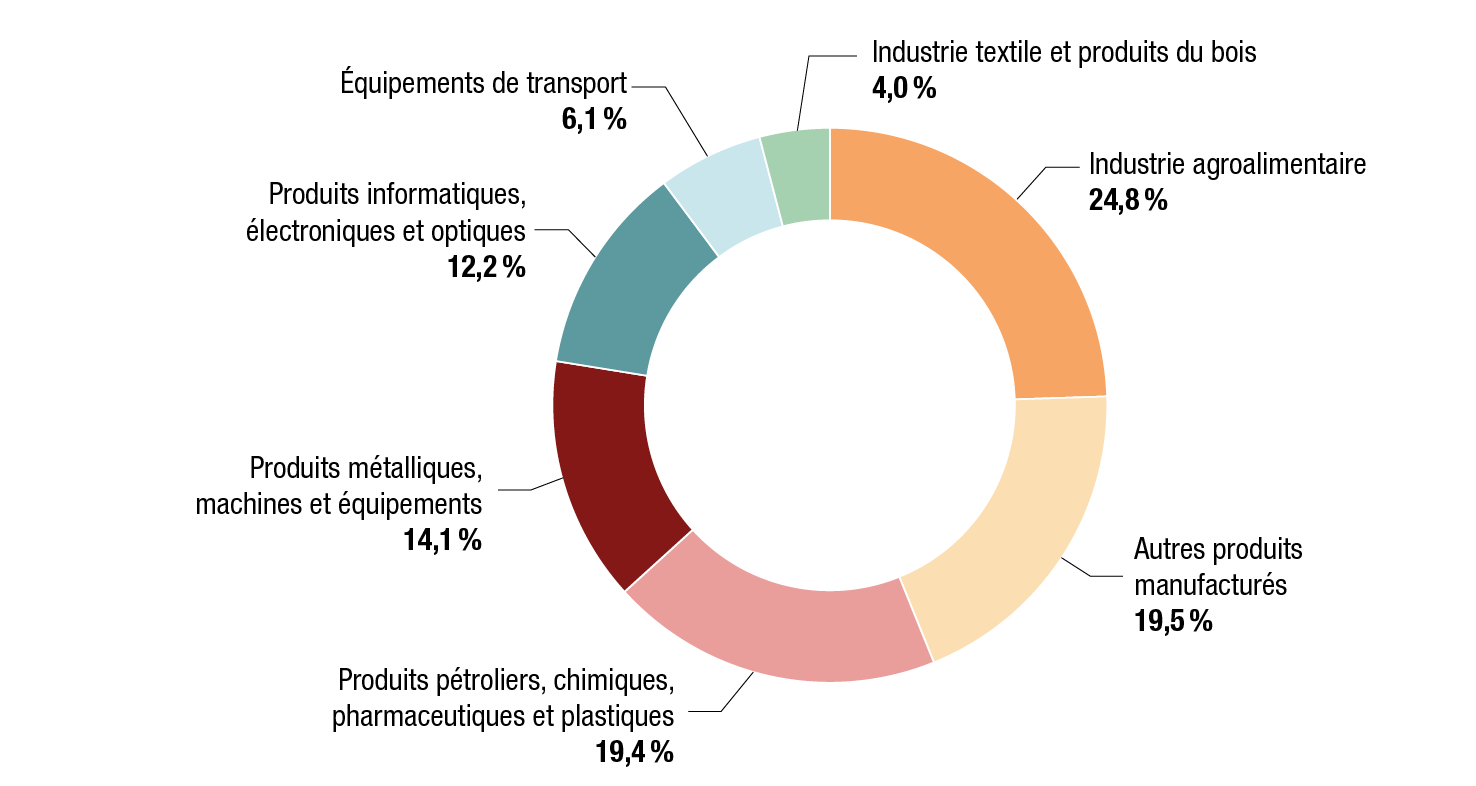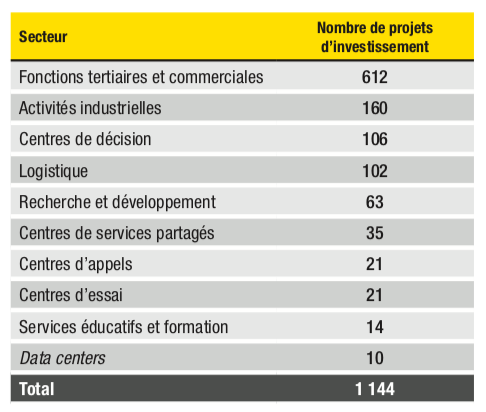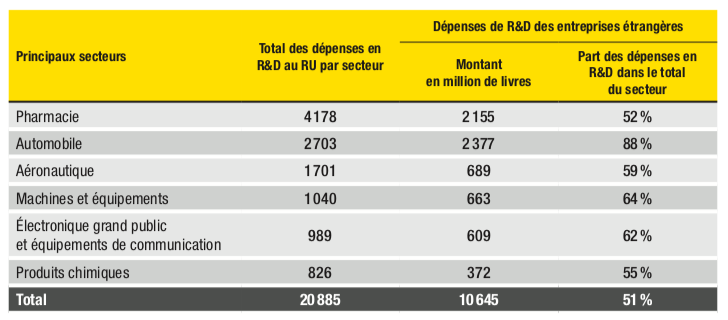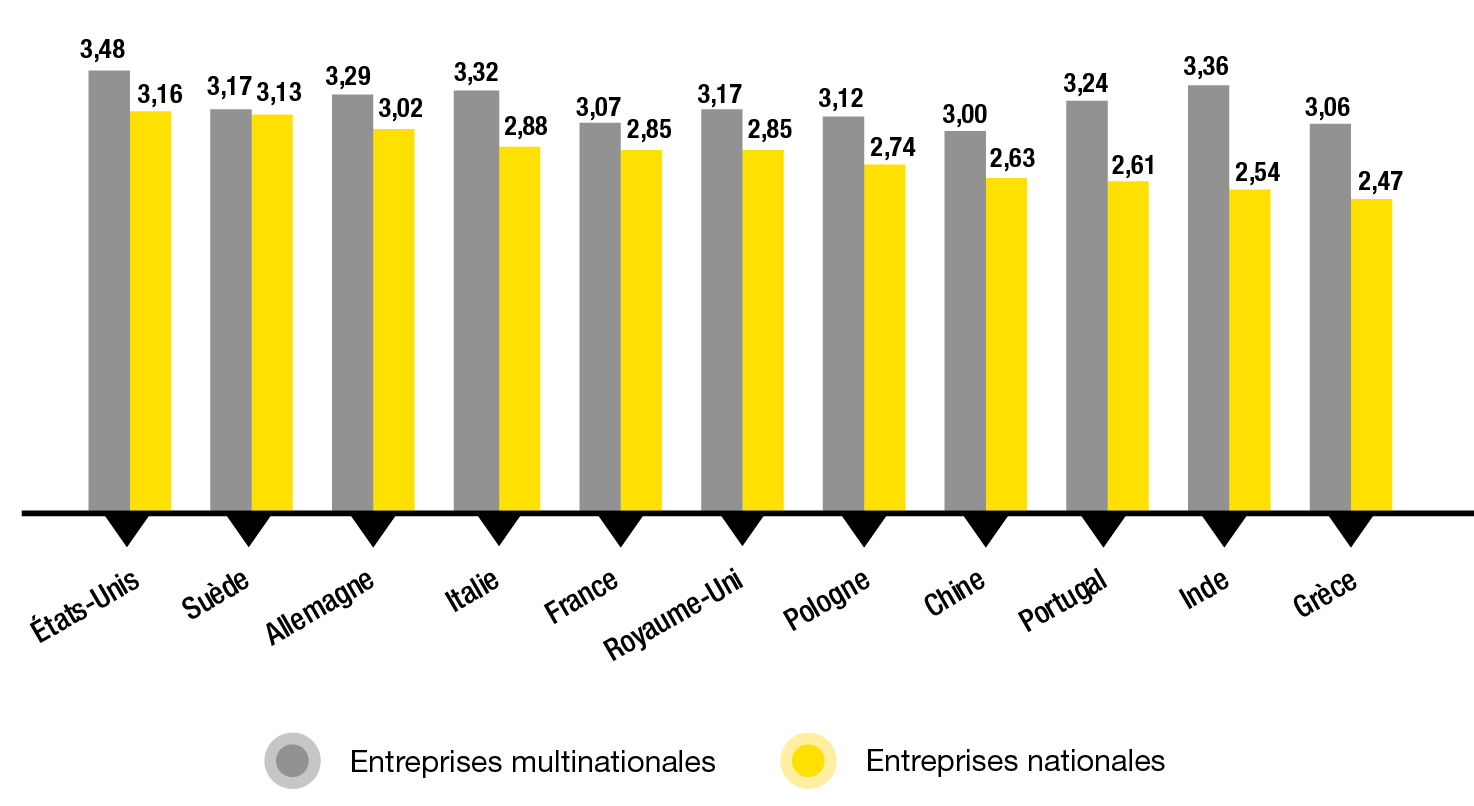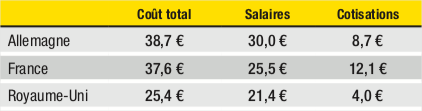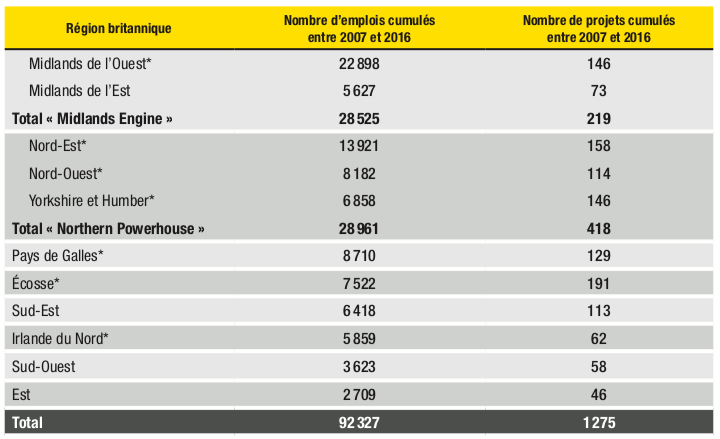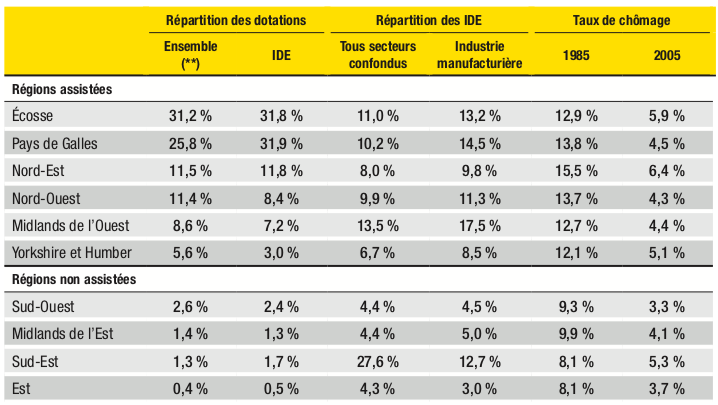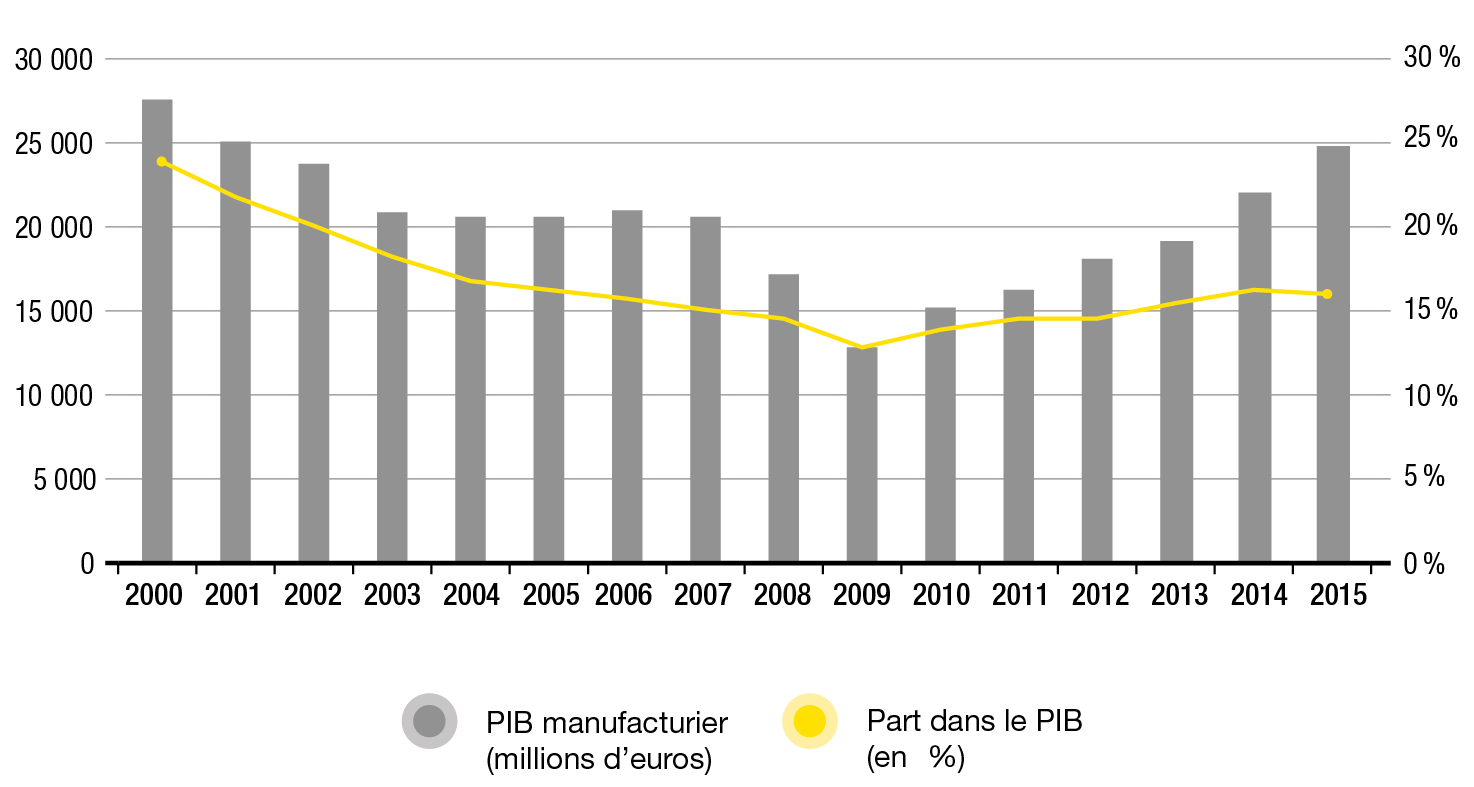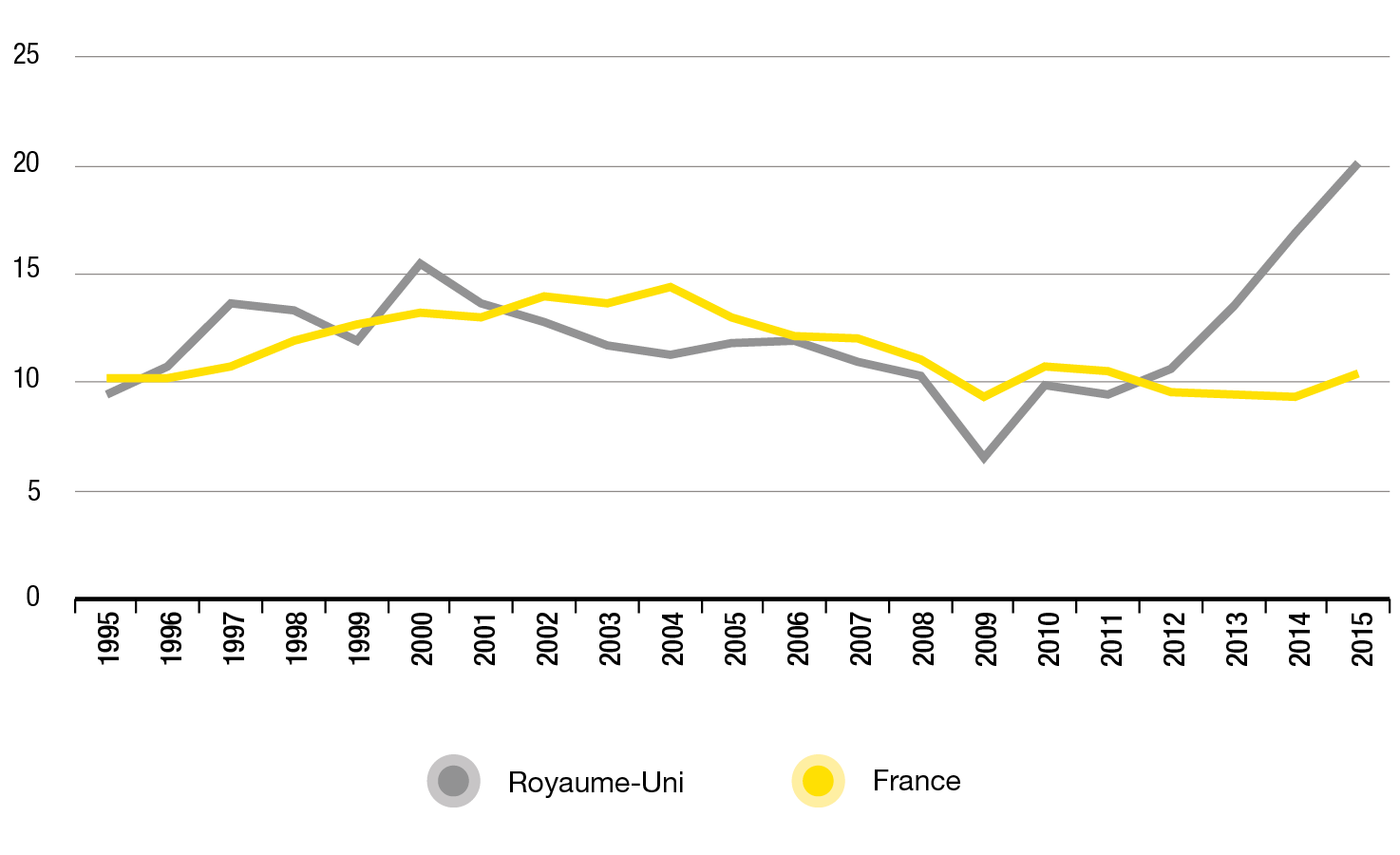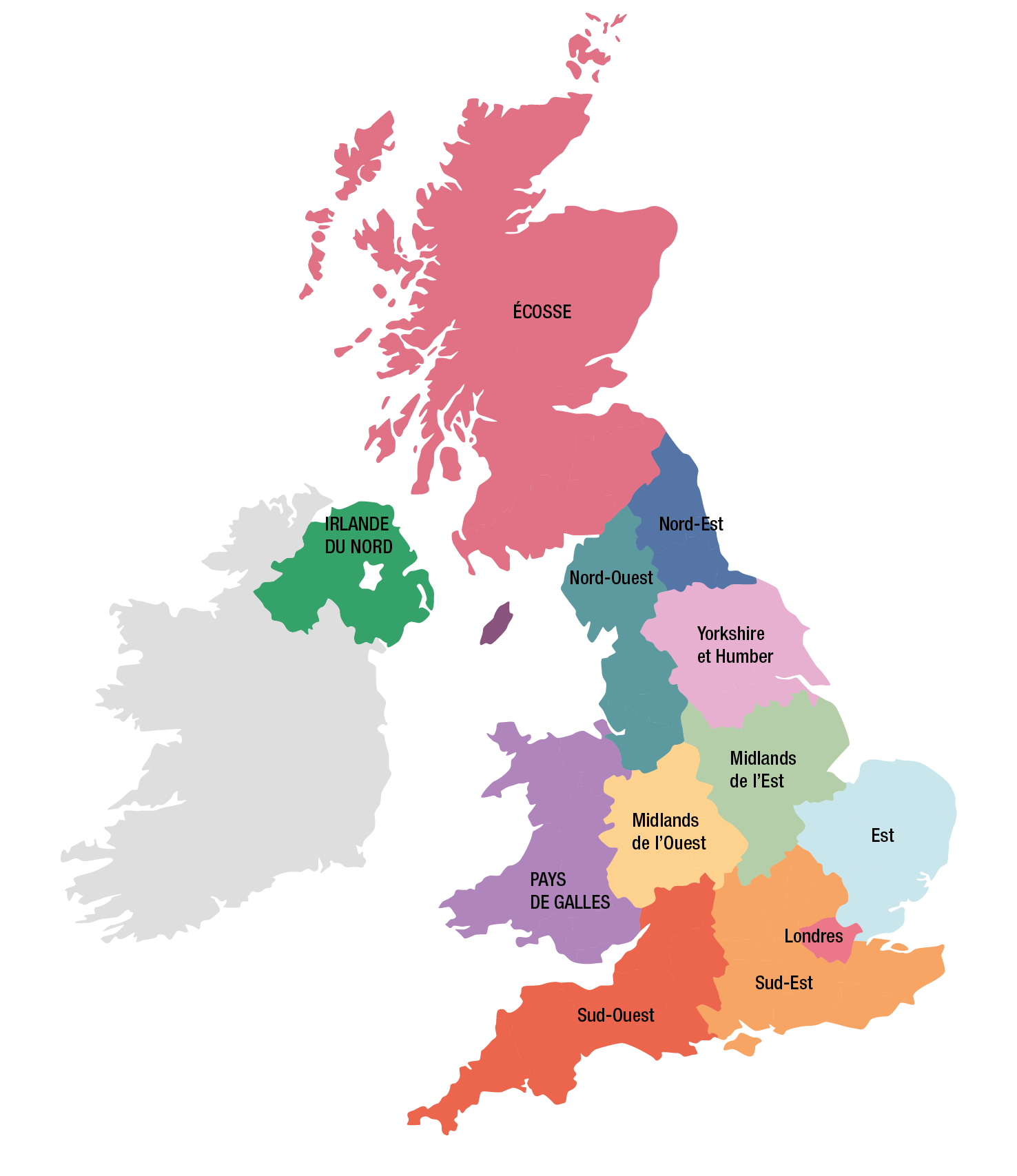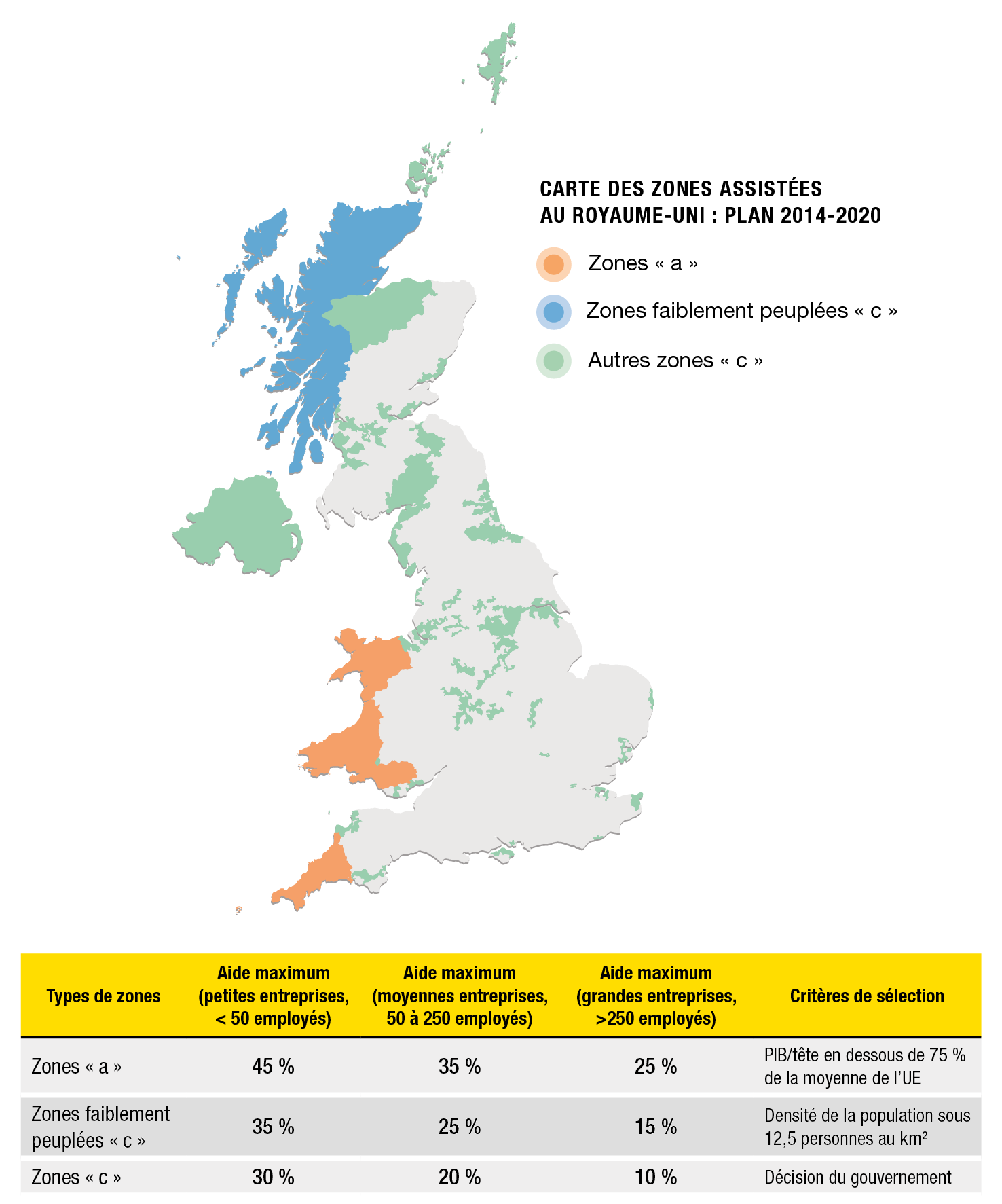L’investissement étranger, moteur de la réindustrialisation au Royaume-Uni ?

© Cheoh Wee Keat Gettyimages
Résumé
Depuis des décennies, le Royaume-Uni fait de l’attraction d’entreprises étrangères un élément-clé de sa politique industrielle. Les pouvoirs publics ont en effet eu très tôt la conviction que la pénétration des capitaux étrangers se traduisait par des retombées positives sur le tissu économique national. L’économie britannique montre, à ce titre, que l’on peut soutenir l’industrie nationale sans chercher à préserver coûte que coûte les champions locaux. Il serait cependant naïf de penser que cette ouverture internationale suffit à elle seule à garantir une industrie dynamique et résiliente. Les investissements directs étrangers (IDE) ne sont qu’un des ingrédients nécessaires à la réindustrialisation des territoires. Pour produire des effets durables, la politique de promotion des IDE doit s’accompagner de mesures de développement économique local (infrastructures, soutien aux entreprises et aux compétences, etc.).
Par ailleurs, la renaissance du secteur automobile au Royaume-Uni ou la timide reprise de l’emploi industriel ne doivent pas occulter une réalité nationale plus contrastée, sur fond de paupérisation des actifs et d’accroissement des disparités régionales. Si le Royaume-Uni a prouvé par le passé sa forte capacité de rebond, son avenir dépendra beaucoup de l’issue des négociations sur sa sortie de l’Union européenne (UE).
Une désindustrialisation rapide mais qui semble endiguée depuis 2011
Beaucoup d’observateurs considèrent que le Royaume-Uni n’est plus une grande nation industrielle mais un pays qui a « fait le choix des services » et notamment des services financiers1. De nombreux champions industriels britanniques ont disparu ou été rachetés par des concurrents étrangers. Le déclin a été rapide : en 1970, le secteur manufacturier contribuait à hauteur de 25 % à la richesse nationale mais, en 2015, il n’en représentait plus que 8,7 %. En France, sur la même période, cette part est passée de 20 % à 10 %2 . De même, la part de l’emploi manufacturier britannique s’est presque réduite de moitié, passant de 15,5 % en 1995 à 8 % en 2015 et de 14,8 % à 9,7 % en France sur la même période.
Pour autant, le Royaume-Uni n’est pas seulement une économie de services. Le pays a su conserver de nombreux atouts dans des secteurs tels que la pharmacie, l’automobile ou encore l’aéronautique. De plus, depuis 2011, l’industrie britannique semble connaître une période moins sombre : les destructions d’emplois dans le secteur ont cessé, à l’inverse de notre pays ; 23 000 emplois manufacturiers ont même été créés entre 2011 et 2016, donnant l’espoir d’une reprise industrielle.
Les investissements directs étrangers au service du développement des territoires industriels
À l’inverse de ses concurrents, le Royaume-Uni s’est ouvert très tôt aux investissements directs étrangers (IDE), les dirigeants britanniques étant convaincus de l’apport positif de ces derniers à l’économie. L’attractivité du pays pour les IDE s’appuyait sur sa tradition marchande, sa langue et ses relations commerciales historiques avec les États-Unis. La mise en place dans les années 1980 de politiques de libéralisation et de dérégulation massives par le gouvernement Thatcher a renforcé cette attractivité au moment où une politique favorable au développement des services contribuait surtout à la prospérité de Londres. Les pouvoirs régionaux et locaux ont attiré les IDE par des incitations, parfois conditionnées à la création d’emplois dans les régions d’implantation.
Résultat : en 2016, le Royaume-Uni est la destination privilégiée, tous secteurs confondus, des investisseurs en Europe et se classe au deuxième rang européen pour l’accueil de projets industriels. Les IDE ont contribué au développement économique des régions et limité le déclin de certains vieux territoires industriels. Le rachat d’entreprises emblématiques (comme Jaguar et Land Rover) par des entreprises étrangères a permis la survie d’entreprises qui semblaient condamnées et le maintien d’une partie de l’emploi industriel.
Un tournant idéologique majeur : le retour de la politique industrielle
La crise financière de 2008 a suscité une inflexion majeure des politiques publiques. Sans explicitement parler de politique industrielle, le gouvernement Cameron a affiché, dès son arrivée au pouvoir, la volonté de « rééquilibrer l’économie au profit de l’industrie et des régions »3. Outre une politique d’austérité drastique, il a déployé des actions ciblées sur onze filières stratégiques4 et lancé un plan de mesures horizontales (flexibilité du marché du travail, allégement fiscal et réglementaire, etc.). Avec l’arrivée de Theresa May, la politique industrielle n’est plus un tabou. Une stratégie économique et industrielle a été définie, visant, dans le contexte du Brexit, à « exploiter l’économie tout entière » sans se limiter au secteur des services. Des mesures ont ainsi été prises pour aider les industries les plus prometteuses en misant particulièrement sur l’innovation technologique et sur un plan d’aménagement du territoire (infrastructures, fonds de croissance régionale, etc.) pour rendre les régions sinistrées compétitives sur la scène mondiale. Ces politiques rompent ainsi avec une longue tradition de laisser-faire et de réduction du rôle de l’État dans l’économie. C’est un véritable revirement idéologique pour un pays qui n’avait pas eu à proprement parler de politique industrielle depuis les années 1960.
Un bilan mitigé, des perspectives incertaines
Certes, les subventions fournies par l’État et les organismes publics ont été utiles, dans un premier temps, pour attirer les investisseurs dans les régions industrielles sinistrées et ralentir le mouvement de polarisation entre Londres et le reste du pays. Toutefois, ces investissements représentent évidemment des volumes insuffisants pour suffire à inverser le cours défavorable des économies locales. Pire, la tendance générale des entreprises étrangères est de choisir logiquement les régions les mieux dotées en compétences et en écosystèmes dynamiques. Cela renforce donc naturellement les inégalités spatiales au sein même des zones éligibles. Parfois, c’est un seul « méga-projet » qui capte localement l’essentiel des aides en raison des attentes qu’il suscite. Les avantages que procurent les IDE ne se répartissent donc pas équitablement au sein des territoires ni des secteurs. Le rebond de l’industrie dans les Midlands de l’Ouest masque par exemple de fortes disparités dans la région. De même, si la création en 1986 de l’usine Nissan à Sunderland, dans le Nord-Est de l’Angleterre, contribue aujourd’hui au dynamisme global du secteur automobile, elle accentue aussi la polarisation des entreprises dans la zone et par conséquent les soutiens publics : financement d’infrastructures, de clusters, etc.
Par ailleurs, l’implantation d’entreprises étrangères s’est traduite par des créations d’emplois, largement facilitées par une flexibilité accrue du marché du travail britannique. L’adoption d’une stratégie de sortie de crise reposant sur des réformes du marché du travail (contrat « zéro heure », baisse des salaires réels, etc.) a favorisé la progression des emplois peu qualifiés. Cette reprise de l’emploi manufacturier depuis 2011 est donc indépendante de la montée en gamme que certains secteurs, tels l’automobile, ont incontestablement réussie. Tous secteurs confondus, le Royaume-Uni reste marqué par des années de désindustrialisation. Le manque de qualification et de compétences demeure un défi majeur. De plus, l’inclusion des entreprises nationales dans la chaîne d’approvisionnement des firmes étrangères reste encore trop faible, et ce n’est que depuis peu de temps que le gouvernement conditionne son soutien financier à cet enjeu.
Par ailleurs, le Brexit soulève de nombreuses inquiétudes : d’une part, le Royaume-Uni risque de se priver de talents étrangers indispensables au pays dans le contexte où les jeunes Britanniques les plus qualifiés privilégient des carrières dans le secteur de la finance. D’autre part, l’accès au marché commun reste un déterminant essentiel de la décision d’implantation des investisseurs.
Que retenir de la stratégie britannique en matière de politique industrielle et d’IDE ?
Compte tenu de la tradition non interventionniste du pays, la politique industrielle britannique n’a pas pris la forme d’un plan d’urgence pour l’industrie, qui aurait soutenu les entreprises dans leurs projets d’investissement, comme cela a pu s’observer dans la plupart des pays d’Europe continentale.
La politique industrielle a mobilisé des mesures horizontales – allégement de la fiscalité des entreprises et de la réglementation, accès au financement des PME, développement d’une main-d’œuvre qualifiée et flexible, attribution de marchés publics aux PME et développement des supply chains – et un appui à quelques secteurs où le pays disposait d’atouts majeurs, mais cette politique reste d’une ampleur encore modeste. L’État, de manière pragmatique et opportuniste, abonde financièrement différentes initiatives portées par des acteurs privés au niveau local dès lors que celles-ci sont bénéfiques pour l’économie. À titre d’exemple, dans le secteur automobile, l’État encourage, accompagne et abonde l’investissement d’entreprises étrangères emblématiques comme Nissan ou encore Jaguar Land Rover (maintenant propriété de Tata) dans le développement de leur activité locale et celui de l’écosystème (centres de R&D, clusters). Les pouvoirs publics considèrent, en effet, que plus l’entreprise étrangère aura noué des liens étroits avec son territoire, plus il sera coûteux pour elle de délocaliser ses activités.
Les autorités locales, qui ont vu depuis 2010 l’État leur transférer budget et compétences, n’ont pas ménagé leurs efforts. Leur approche semble pragmatique, déterminée par la compréhension des besoins des entreprises dans une logique ascendante (bottom-up), et n’impose pas, comme dans le cas des pôles de compétitivité français par exemple, que tous les secteurs et tous les territoires aidés répondent aux mêmes critères d’éligibilité définis par l’État.
La mobilisation des pouvoirs publics reste déterminante pour exploiter au mieux les gains liés à l’implantation étrangère. Il ne suffit pas d’attirer des IDE en valorisant les atouts du territoire, il faut simultanément les accompagner par une politique de développement économique et d’aménagement afin de renforcer leurs effets d’entraînement sur le long terme.
- 1 – Le président Sarkozy, dans un discours télévisé le 5 février 2009, avait heurté le gouvernement britannique en déclarant : « La Grande-Bretagne n’a plus d’industrie, à la différence de la France. Parce que l’Angleterre, il y a vingt-cinq ans, a fait le choix des services, et notamment des services financiers. »
- 2 – Le Royaume-Uni est toujours derrière la France si l’on inclut le secteur énergétique et les industries extractives dans l’industrie. Le secteur industriel, dans cette acception élargie, représentait 11,8 % du PIB britannique en 2015 et 12,6 % en France.
- 3 – Department for Business, Innovation & Skills (2010).
- 4 – L’aérospatiale, les technologies agricoles, l’automobile, la construction, l’économie de l’information, l’éducation internationale, les sciences de la vie, le nucléaire, l’éolien en mer, le pétrole et le gaz, les services professionnels et d’affaires.
INTRODUCTION
Alors qu’il a dominé l’industrie mondiale tout au long du XIXe siècle, le Royaume-Uni a connu une désindustrialisation très rapide par rapport à ses concurrents étrangers. Dès 1979, il a fait le choix de devenir une économie extrêmement ouverte et fondée sur les services. Sa politique industrielle s’est longtemps résumée à l’attraction d’investisseurs étrangers pour enrayer le déclin des vieux territoires industriels. Cette politique a obtenu un succès certain : le Royaume-Uni restait de loin le pays européen attirant le plus d’IDE en 2016. Cette stratégie tranche avec celle de ses voisins continentaux comme l’Allemagne et la France, qui se sont montrés plus méfiants à l’égard des investisseurs étrangers.
Depuis 2008 et la crise financière, le gouvernement britannique affiche une volonté de rééquilibrer son économie en faveur de l’industrie et des exportations. Il a par ailleurs défini une stratégie pour favoriser la transition vers l’industrie du futur. En 2017, Theresa May a dévoilé son « livre vert », intitulé Building our Industrial Strategy, visant à réindustrialiser le Royaume-Uni dans le contexte de l’après-Brexit. L’objectif est notamment de redevenir une puissance industrielle de tout premier plan, spécialisée dans la fabrication de biens à haute valeur ajoutée. Dégagé des règles européennes, l’État souhaite intervenir dans l’économie nationale, en fonction de choix sectoriels assumés, et mener une politique d’aménagement du territoire pour rendre emploi et prospérité aux régions sinistrées.
Compte tenu de la tradition non interventionniste du pays, le retour d’une politique industrielle britannique est un signe fort du rôle de ce secteur pour asseoir une croissance économique de long terme.
La place prépondérante des investisseurs étrangers leur confère de facto un rôle à jouer dans cette nouvelle stratégie industrielle et dans le rééquilibrage de l’économie. Les rachats de nombreux fleurons nationaux contribuent en effet à renforcer l’idée qu’il n’y a plus d’industrie au Royaume-Uni. Pourtant, les investissements directs étrangers (IDE) ont permis de reconstituer certains secteurs donnés pour morts comme l’automobile. Le maintien d’une industrie forte dans un pays passe-t-il par la préservation de ses champions nationaux ou par l’implantation d’entreprises étrangères ? Sous quelles conditions les investisseurs étrangers peuvent-ils participer à la croissance économique d’un pays ou d’un territoire ? Quelles sont les meilleures pratiques pour attirer et retenir des IDE ?
Désindustrialisation et choix politiques britanniques
L’industrie demeure un secteur important de l’économie britannique mais, comme en France, sa contribution à la valeur ajoutée ou à l’emploi a fortement baissé. Ce mouvement de désindustrialisation a toutefois été plus important outre-Manche, traduisant les choix politiques menés depuis des décennies. La crise financière de 2008 a conduit le gouvernement Cameron à prendre conscience que les services financiers ne sauraient être le seul moteur de l’économie. Le Premier ministre alors promu une politique volontariste pour « rééquilibrer l’économie » en faveur du secteur manufacturier et des exportations. Cette stratégie se poursuit aujourd’hui avec l’arrivée au pouvoir de Theresa May.
Ce chapitre présente les principaux défis auxquels fait face l’économie britannique et revient sur les réponses apportées par les pouvoirs publics.
Un choix politique : une économie fondée sur les services et très ouverte au monde
Un phénomène de désindustrialisation plus rapide qu’ailleurs
Berceau de la première révolution industrielle, le Royaume-Uni a tout au long du XIXe siècle dominé l’industrie mondiale. Son avance industrielle lui assurait alors une suprématie sur le commerce de la planète. Le Royaume-Uni représentait encore une grande puissance industrielle en 1970 : le secteur manufacturier contribuait à hauteur de 25 % à la richesse nationale, contre 20 % en France. Malgré cette longue tradition, le Royaume-Uni voit, depuis plusieurs décennies, le poids de sa base industrielle s’éroder, et ce plus rapidement que les autres pays industrialisés. Le secteur manufacturier ne représente aujourd’hui plus que 8,7 % du PIB britannique, contre 10 % pour la France5. Ce phénomène s’est traduit par de nombreuses pertes d’emplois industriels et un recul de la part de marché à l’export (cf. tableaux 1 à 3).
La désindustrialisation s’observe dans la plupart des pays développés. Elle est schématiquement liée à deux phénomènes6 : l’entrée dans le jeu du commerce mondial de nouveaux acteurs (notamment les BRIC) et une transformation du pays en une économie de services. Le Royaume-Uni se distingue toutefois des autres pays car le phénomène de désindustrialisation y a été beaucoup plus rapide, compte tenu des choix politiques pris par les gouvernements successifs.
Tableau 1 – Part de l’industrie manufacturière dans le PIB
Source : ONU
Tableau 2 – Part de l’emploi manufacturier dans l’emploi total
Source : Eurostat
Tableau 3 – Part de marché et rang à l’exportation (total des marchandises)
Source : OMC
Margaret Thatcher et l’abandon du secteur industriel
L’arrivée au pouvoir de Margaret Thatcher en 1979 marque un tournant décisif pour l’industrie britannique. Depuis les années 1960, le secteur cumule des handicaps structurels : taille insuffisante des entreprises ne permettant pas des économies d’échelle, rigidité des syndicats pour faire évoluer les conditions de production, faiblesse des investissements industriels, faible productivité, etc7. Ces handicaps se confirment dans les années 1970 : le nombre d’emplois industriels passe de 8,5 millions en 1966 à 7,4 millions en 1979. La Grande-Bretagne fait face à une inflation galopante (+25 %) et est contrainte de solliciter l’aide du Fonds monétaire international (FMI).
C’est dans ce contexte que Margaret Thatcher, qui dirige le Parti conservateur depuis 1975, gagne les élections. De 1979 à 1990, ses orientations politiques vont poser les bases d’une économie britannique extrêmement ouverte et fondée sur les services.
Dès son arrivée au pouvoir, elle met son programme en application : réduction des dépenses publiques, forte hausse des taux d’intérêt de la Banque d’Angleterre pour comprimer l’inflation, surévaluation de la livre, retrait de l’État-providence et vagues de privatisations, suppression des aides à l’industrie. Elle engage par ailleurs un bras de fer avec les syndicats en limitant le monopole syndical sur les embauches et les salaires, en encadrant le droit de grève et en réprimant des grèves « sauvages ».
Encadré 1 – Orientations économiques et impact sur la productivité britannique
De nombreux observateurs ont tenté de dresser un bilan des choix politiques menés par Margaret Thatcher. Selon les travaux de deux économistes de l’université de Cambridge, Ken Coutts et Graham Gudgin8, les réformes conduisant notamment à l’abandon du secteur industriel ont contribué au décrochage de la productivité britannique relativement à ses concurrents. Rappelons qu’en 2015, la productivité horaire britannique est de 18 points inférieure à la moyenne des pays du G7.
Certains économistes9 montrent qu’il est difficile d’augmenter la productivité dans de très nombreuses activités de service, à moins de réduire sensiblement la « qualité » du service (coiffeur, musicien). D’autres10 indiquent que la réduction des effectifs du secteur industriel a naturellement incité à ne garder que les éléments les plus productifs, alors que l’élargissement du secteur des services conduit à inclure des personnes de moindre qualification. En effet, la désindustrialisation libère en premier les travailleurs de l’industrie les moins productifs. Leur arrivée dans les services exerce une pression à la baisse à la fois sur le niveau et sur la croissance de la productivité du secteur.
Enfin, la croissance du secteur financier dans les années 2000 a pu avoir une influence sur la productivité. Les travaux de Stephen Cecchetti et Enisse Kharroubi11 montrent qu’à partir d’un certain seuil, le développement du secteur financier nuit à la croissance de la productivité d’autres secteurs de l’économie. Une des raisons évoquées est la propension de ce secteur à attirer les diplômés les plus qualifiés. Docteurs en physique ou en ingénierie peuvent ainsi préférer élaborer de complexes modèles mathématiques au sein de banques ou de fonds d’investissement plutôt que d’entreprises industrielles où ils seront moins payés. Les auteurs notent ainsi que ce sont les sociétés les plus intensives en recherche qui souffriraient le plus de l’essor de la finance.
Cette politique restrictive menée de 1979 à 1981 conduit à sacrifier une partie de l’industrie. Le secteur souffre particulièrement de sa faible rentabilité, accentuée par la hausse des coûts de production et le vieillissement de l’appareil productif, lui-même conséquence d’un faible taux d’investissement. Le développement de produits nouveaux est handicapé par les rigidités de l’offre : faute de restructurations et d’adaptations suffisantes, les industriels sont de moins en moins capables de s’adapter aux mutations des marchés internationaux. Les fermetures d’entreprises et les réductions d’effectifs sont massives au début des années 1980, puis à nouveau au début des années 1990, notamment dans les secteurs traditionnels comme l’automobile, l’acier, les charbonnages, la construction navale ou le textile.
Dans le même temps, le gouvernement Thatcher accompagne la spécialisation de l’économie britannique dans les services et la finance. La réforme des marchés financiers britanniques est rapide et radicale. Les banques ne sont plus obligées de déposer une partie de leurs avoirs auprès de la banque centrale, les mouvements de capitaux sont libérés, et les commissions fixes dont il fallait s’acquitter pour échanger des actions, des obligations et autres titres sont supprimées. C’est ce qu’on appelle le « Big Bang de la finance » de 1986. La révolution est aussi technologique, avec l’introduction d’un système électronique de cotation et de salles de marché. Très rapidement le coût des échanges diminue, leur nombre et leurs montants augmentent.
L’internationalisation de l’économie britannique s’accélère, et la City renforce sa position de principale place boursière dans le monde. La mutation progressive de l’économie britannique de l’industrie vers les services se caractérise par une croissance spectaculaire du secteur, portée par le rachat de nombreuses banques et de fonds britanniques par des entreprises nationales ou étrangères (notamment des banques d’investissements américaines). En 2016, le secteur financier contribuait à hauteur de 6,5 % à la richesse nationale, contre 4 % en France et 3,7 % en Allemagne. Comme nous le verrons dans le chapitre II, la taille du secteur financier est un puissant facteur d’attractivité des IDE.
Une ouverture importante de l’économie britannique aux investisseurs étrangers
Cette libéralisation de l’économie s’est accompagnée d’un renforcement de la politique d’attraction des investisseurs étrangers. L’ouverture aux IDE est une priorité de longue date pour les dirigeants politiques britanniques. Elle débute au moment des premières crises industrielles de l’entre-deux-guerres, et le gouvernement Thatcher ne fait qu’accélérer ce mouvement. Il autorise les groupes étrangers à racheter 100 % des actions d’entreprises cotées britanniques car il considère qu’ils sont essentiels pour moderniser l’industrie du pays, créer des emplois et donc développer l’économie. Le retrait de l’État initié à la fin des années 1970 se traduit par la diminution des aides aux territoires en difficulté, et les investisseurs étrangers doivent servir à enrayer le processus de désindustrialisation particulièrement brutal dans certaines régions. Depuis, les politiques libérales des gouvernements successifs ont intensifié ce processus. Témoin de ces évolutions : le nombre de fleurons nationaux rachetés par des entreprises à capitaux étrangers. De nombreuses marques emblématiques sont ainsi passées sous le contrôle d’entreprises étrangères, comme Cadbury cédé à l’américain Kraft Foods, Jaguar et Land Rover rachetés par le groupe indien Tata, Rolls-Royce par BMW ou encore plus récemment le groupe AstraZeneca acquis par le laboratoire américain Pfizer.
Indifférent au patriotisme économique, le pays a ainsi fait le choix de miser sur l’attractivité de son territoire en faisant fi de la nationalité des investisseurs. Sa stratégie consiste à favoriser l’industrie en Grande-Bretagne plutôt qu’à aider les industriels britanniques12. Le pays se distingue ainsi de ses voisins d’Europe continentale comme l’Allemagne et la France. Ces derniers se sont montrés plus méfiants à l’égard de la concurrence étrangère : en pourcentage du PIB, le Royaume-Uni attire ainsi davantage d’IDE que l’Allemagne et la France (cf. graphique 1).
Graphique 1 – Poids des IDE entrants dans différentes économies (% du PIB)
Source : Cnuced
Aujourd’hui encore, le Royaume-Uni reste la destination privilégiée des IDE en Europe13. En 2015, il détenait à lui seul près de 19 % des stocks d’IDE accueillis dans l’Union européenne. Au niveau mondial, le Royaume-Uni est le troisième pays d’accueil derrière les États-Unis et la Chine (Hong Kong inclus). Selon la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (Cnuced), le stock des investissements directs étrangers y était de 1 458 milliards de dollars, soit près de deux fois le stock de la France (cf. tableaux 4 à 7).
Tableaux 4 et 5 – Stock d’IDE dans le monde et classement par pays (milliards de dollars)
(*) y compris Hong Kong
Source : Cnuced
Tableaux 6 et 7 – Stock d’IDE en Europe et classement par pays (milliards de dollars)
Source : Cnuced
La nationalité des investisseurs a beaucoup évolué au cours du temps. Dès les années 1960, les relations privilégiées avec les États-Unis, en partie dues à une proximité culturelle et à une longue histoire de relations financières et économiques, ont fait du continent américain le plus grand contributeur de projets d’investissement au Royaume-Uni. En 2015, les investisseurs américains représentaient près de 35 % du stock d’IDE entrant au Royaume-Uni, ces investissements s’orientant notamment dans le secteur financier. À partir des années 1980, c’est au tour des Japonais de s’implanter au Royaume-Uni. D’une part, le pays cherche à cette époque de nouveaux relais de croissance, compte tenu notamment de l’arrivée à maturité sur son marché domestique de ses industries électronique et automobile. D’autre part, Margaret Thatcher soutient activement l’arrivée de ces investisseurs, afin qu’ils rachètent notamment de vieilles marques automobiles britanniques (MG, Austin, Morris, Rover, Triumph…) victimes d’un manque de productivité, d’une technologie dépassée et d’une qualité insuffisante. Les investisseurs japonais ont davantage opté pour des participations à 100 % que pour des joint-ventures en créant de nouvelles usines (« greenfield sites »), afin d’importer leurs propres processus techniques et managériaux. À la vague japonaise ont ensuite succédé les IDE des « nouveaux pays industriels », c’est-à-dire des entreprises hongkongaises puis taïwanaises. Depuis 2000, le Royaume-Uni est, pour les pays émergents, la destination la plus prisée en Europe. Ainsi, le Royaume-Uni voit 57 % des implantations productives provenir d’Asie ou des États-Unis, alors que la France attire la majorité de ses investissements manufacturiers d’Europe.
Bien sûr, l’adhésion britannique à la Communauté économique européenne a fait de cette région le premier investisseur au Royaume-Uni (45,4 % du stock total entrant). Les Pays-Bas, la France et l’Allemagne sont les pays européens qui investissent le plus outre-Manche.
Les conséquences de la désindustrialisation
Une balance commerciale structurellement déficitaire
Le Royaume-Uni est l’un des pays les plus ouverts et les plus intégrés au monde extérieur. L’affaiblissement de son secteur manufacturier s’est traduit par l’accroissement du déficit de sa balance commerciale, et ce depuis plus de trente ans. La longue tradition favorable au libre-échange et à l’ouverture économique aux capitaux étrangers a permis la forte pénétration des importations étrangères, qu’il s’agisse des biens de consommation, des biens d’équipement ou des biens intermédiaires.
En 2016, il est le cinquième importateur du monde et son déficit commercial s’élève à 204 milliards d’euros, soit plus de trois fois le déficit français (66,3 milliards). Les importations et exportations sont réalisées pour moitié avec l’Union européenne, qui compte approximativement pour moitié dans le déficit commercial14. On note que si le secteur des services britannique est excédentaire de 112 milliards d’euros, tiré notamment par les services financiers15, ce dernier ne permet pas de compenser le déficit sur les biens. De plus, cet excédent sur le commerce des services est aujourd’hui menacé si une partie de l’activité financière de Londres se délocalise en raison du Brexit. En effet, la possible perte du « passeport européen »16, qui assure l’accès aux marchés de l’Union européenne, contraindrait les sociétés régulées à Londres à obtenir un agrément dans chaque pays de l’Union. Le géant bancaire HSBC a par exemple annoncé qu’il allait déplacer de Londres vers Paris ses activités de banque d’investissement sur les marchés mondiaux d’ici 2019. Plusieurs pays européens se sont déjà positionnés pour renforcer le poids de leur place financière. C’est notamment le cas de la France : la région Île-de-France, en partenariat avec Business France et la Chambre de commerce et d’industrie Paris Île-de-France, a lancé dès le mois de novembre 2016 un guichet unique, « Choose Paris Region », pour faciliter l’implantation d’investisseurs étrangers plus particulièrement dans le secteur financier.
Le déficit commercial britannique s’explique par plusieurs facteurs, qui rappellent de façon marquante les problématiques auxquelles est confrontée la France. En premier lieu, on retrouve la mauvaise orientation des échanges : ces derniers ne sont pas suffisamment dirigés vers les pays émergents offrant les meilleures perspectives de croissance. La spécialisation sectorielle du Royaume-Uni est très proche de celle de la France (agroalimentaire, aéronautique, automobile, construction navale, pharmacie…). Le pays importe massivement des produits métallurgiques, de l’industrie agroalimentaire, du textile, de l’automobile, etc., qui affichent les déficits les plus importants (cf. graphique 2, p. 28).
Graphique 2 – Soldes des échanges du Royaume-Uni en 2016 par secteur, en milliards d’euros
Source : Douanes françaises
Par ailleurs, la France et le Royaume-Uni se positionnent sur des segments d’un niveau technologique moyen. Ils se trouvent ainsi confrontés, d’une part, à la concurrence par les prix opérée par les nouveaux pays industriels sur des gammes moyennes et, d’autre part, à une concurrence hors prix, liée à des facteurs de compétitivité hors coûts (réputation, services connexes, innovation, qualité) des pays spécialisés dans le haut de gamme. Les Britanniques se distinguent toutefois par des soldes commerciaux déficitaires sur l’ensemble des segments de haute, moyenne et basse technologie (cf. tableaux 8 et 9).
Tableau 8 – Répartition des exportations en 2015 et croissance depuis 2000, par niveau d’intensité technologique
Source : OCDE
Tableau 9 – Solde commercial en 2015, par niveau d’intensité technologique (en milliards de dollars)
Source : OCDE
Ces chiffres indiquent que le Royaume-Uni a des difficultés à exploiter à l’export sa spécialisation dans plusieurs secteurs intensifs en R&D comme la pharmacie, l’aéronautique, etc. La désindustrialisation du Royaume-Uni a en effet entraîné, dans tous les autres secteurs manufacturiers, la perte de nombreux savoir-faire et l’érosion du tissu local de sous-traitants, à même de répondre aux besoins du marché domestique. En outre, la présence de nombreux groupes étrangers pèse sur la balance commerciale, car ils importent des biens intermédiaires ou des compléments de gamme que le territoire national n’est pas à même de fournir. Dans le secteur automobile par exemple, 59 % des composants sont importés contre environ 40 % en France et en Allemagne, selon la Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) en 201517.
De fortes disparités régionales
On observe au Royaume-Uni un clivage entre les régions du Nord désindustrialisées et celles du Sud « tertiaires ». Une étude réalisée par Natixis en 2012 met en exergue la désindustrialisation des territoires et revient sur les principaux mouvements de délocalisation18 : les Midlands de l’Est et de l’Ouest ont vu leur secteur textile se redéployer en Bulgarie, en Italie et en Grèce. Les régions des Midlands de l’Ouest et le Yorkshire ont également été affectées par le recul de la métallurgie. Une partie de l’industrie chimique a migré du Cheshire, du Derbyshire et de Londres vers l’Allemagne. Aujourd’hui, le Sud-Est, le Nord-Ouest et les Midlands de l’Ouest sont les principales régions industrielles (cf. tableau 10 et carte des régions en annexe 3).
Tableau 10 – Répartition de l’industrie manufacturière britannique par région en 2015
Sources : Eurostat, Office for National Statistics
Ce déséquilibre entre le Nord et le Sud du pays (le North-South divide) s’est systématiquement renforcé à l’occasion des différentes crises, et ce en dépit des nombreux plans de reconversion mis en place dans les anciennes zones industrielles.
Selon Mark Bailoni, géographe et membre du Laboratoire d’observation des territoires (Loterr), « dans les années 1980 et 1990, les vieux territoires industriels britanniques élaborent différentes stratégies pour attirer les IDE et plus particulièrement les firmes étrangères de haute technologie, afin de pallier le déclin industriel en remplaçant les vieux secteurs traditionnels voués à disparaître. Les firmes décident librement du site et de la région qui leur conviennent, en fonction notamment des incitations proposées par les pouvoirs locaux et régionaux. La perspective d’attirer des firmes américaines ou asiatiques a conduit à une véritable mise en concurrence des vieux territoires industriels britanniques. Toutes les régions n’ont pas eu la même capacité à attirer des IDE, cela a creusé les disparités socio-économiques en Angleterre. En effet, ce sont les régions bénéficiant d’une meilleure connectivité et d’une concentration de services très performants, comme Londres et les régions du Sud-Est, qui ont attiré davantage les investisseurs étrangers, alors que ce sont des territoires déjà favorisés. »19
La fermeture de sites industriels dans les années 2000 a aussi fortement joué sur la richesse des territoires. Un exemple parlant est celui de MG Rover. En 2005, l’entreprise a fermé son usine à Longbridge dans les Midlands. Le site a été rasé. Environ 6 300 salariés ont perdu leur emploi. Quatre universitaires20 ont suivi ce qui est arrivé à plus de 200 d’entre eux, les interrogeant régulièrement pendant trois ans. Selon leur enquête, 90 % des ex-salariés de MG ont retrouvé un emploi, dont 30 % dans le secteur manufacturier. Plus de 60 % de ces anciens salariés occupent des postes mobilisant des compétences totalement différentes de celles accumulées chez MG Rover. Par exemple, un peu plus de 60 % des répondants qui occupaient le poste de manager ont subi une déqualification. En revanche, la plupart des répondants qui exerçaient surtout des tâches élémentaires ont bénéficié d’une certaine forme de perfectionnement professionnel en évoluant vers des tâches d’administration ou de secrétariat dans les services. Toutefois, l’étude montre qu’en moyenne, les personnes interrogées gagnaient 5 640 livres de moins par an. Et un quart d’entre elles connaissaient des difficultés financières importantes trois ans après leur licenciement.
Ce mouvement des travailleurs vers des emplois en partie moins bien payés a accru les disparités entre le Nord et le Sud du Royaume-Uni. Aujourd’hui, Londres et sa région sont toujours beaucoup plus riches que les territoires périphériques. Comparé à ses voisins européens, le Royaume-Uni est l’un des pays les plus inégalitaires en termes de répartition géographique des richesses. On constate par exemple que la richesse des ménages est deux fois plus élevée dans la capitale que dans le Nord. Les pertes d’emplois dans les vieilles régions industrielles se sont notamment traduites par un accroissement des demandes de prestations sociales. À titre d’exemple, le taux de demande de l’allocation d’incapacité est près de trois fois plus élevé dans le Nord que dans les régions prospères du Sud de l’Angleterre. Ces régions ont aussi souffert des coupes drastiques de budgets liées aux réformes du système de protection sociale de 2010 et 201521.
Encadré 2 – Désindustrialisation et vote pro-Brexit
Plusieurs travaux académiques22 confirment le lien de corrélation entre la désindustrialisation et le vote pour la sortie de l’Union européenne. Ils montrent que les régions du Royaume-Uni caractérisées par une diminution de l’emploi manufacturier, une baisse de la croissance des salaires réels et une augmentation de l’inégalité des revenus ont voté systématiquement davantage pour quitter l’UE.
Selon Patrick Manon, directeur de Business France au Royaume-Uni, « les fermetures d’usines dans certaines régions ont conduit à une paupérisation assez forte des ménages, compte tenu du fait qu’il n’y a pas de véritable indemnisation de l’assurance chômage. » Louise Dalingwater, Maître de conférences à l’université de la Sorbonne Nouvelle, explique également que « les ouvriers qui ont eu la chance de pouvoir faire une reconversion après la fermeture de leurs usines ont souvent dû accepter des emplois dans les services moins bien payés et peu qualifiés. Ce processus a pu alimenter des frustrations, les habitants des régions sinistrées étant bien conscients de l’attractivité des autres territoires, plus riches en termes d’emplois qualifiés et proposant donc des salaires plus élevés. Ceci a pu jouer en faveur d’un vote pro-Brexit. Florence Faucher23, professeure à Sciences Po au Centre d’études européennes, explique ainsi que « le gouvernement travailliste s’est principalement adressé aux classes moyennes, ils n’ont pas vu venir l’érosion de l’adhésion de leurs électeurs ouvriers. Les circonscriptions rurales, périurbaines, très marquées par la désindustrialisation, ont voté massivement pour le Brexit. La précarité liée notamment à la création des “contrats zéro heure”24 et la concurrence sur des postes peu qualifiés avec des immigrés venant notamment des pays de l’Est ont fortement pesé dans ce choix ».
Le retour de la politique industrielle suite à la crise de 2008 et au Brexit
Un objectif après 2008 : « rééquilibrer » l’économie au profit du secteur industriel
L’économie britannique a été particulièrement touchée par la crise de 2008, qui a mis en évidence la trop forte dépendance du pays à l’égard du secteur financier. Pour sortir de l’impasse, David Cameron, alors Premier ministre, affiche dès 2010 sa volonté de « rééquilibrer » l’économie en faveur de l’industrie et des exportations. Cette stratégie rompt avec la longue tradition de laisser-faire et de réduction de l’influence de l’État dans l’économie.
Le Royaume-Uni, qui n’avait pas explicitement de politique industrielle depuis les années 1960, a ainsi présenté en 2009 et 2011 des plans de mesures horizontales (allégement de la fiscalité des entreprises et de la réglementation, accès au financement des PME, développement d’une main-d’œuvre qualifiée et flexible, attribution de marchés publics aux PME et développement des supply chains) mais aussi sectorielles (soutien à onze filières stratégiques25 et aux technologies émergentes). On peut souligner les similitudes avec les mesures prises en France suite aux États généraux de l’industrie en 2009. L’exécutif britannique a par ailleurs défini une stratégie pour favoriser la transition vers l’industrie du futur. Des programmes comme le réseau de centres Catapult ont ainsi été mis en place pour favoriser la coopération entre le monde de la recherche et celui de l’entreprise, à l’image des instituts Fraunhofer en Allemagne ou Carnot en France.
Le nouvel impératif industriel ne signifie pas l’abandon de la stratégie d’hégémonie de la place financière de Londres, bien au contraire. Cette dernière a fait l’objet d’un plan de sauvetage d’envergure. Pour l’essentiel (1 029 milliards de livres), il s’agissait principalement de schémas de garantie publique des dettes bancaires et de garantie d’un outil de financement mis en œuvre par la Banque d’Angleterre. Les trois principaux mécanismes de garantie ont été clôturés en 2012 ; il ne restait de cette aide publique aux banques que l’équivalent de 9 milliards au printemps 2016. Les financements publics ont quant à eux représenté 133 milliards de livres, soit sous forme de prêts à des banques temporairement insolvables, soit pour la recapitalisation de Lloyds et Royal Bank of Scotland. Au printemps 2016, ce soutien public net des remboursements perçus représentait encore 76 milliards de livres.
Le retour d’une stratégie industrielle au Royaume-Uni est, en soi, un événement. S’il est encore trop tôt pour évaluer la portée de ces mesures prises depuis 2010, on observe que le redémarrage de la croissance après 2008, censé venir de l’investissement des entreprises et des exportations, ne s’est produit que marginalement grâce au redémarrage des activités productives. Selon l’OFCE, « depuis 2008, la croissance britannique est impulsée en partie par un service public épargné par l’austérité budgétaire et par des services immobiliers soutenus par la politique monétaire ultra-active »26. En 2016, le Royaume-Uni affiche ainsi un taux de croissance du PIB de 2 % et un taux de chômage de 4,9 %, mais de nombreux observateurs doutent de la soutenabilité de cette tendance. Le niveau de productivité, qui détermine l’évolution du niveau de vie global d’un pays, reste en effet inférieur à son niveau d’avant-crise.
Encadré 3 – Royaume-Uni et France : des stratégies de sortie de crise différentes
Contrairement aux Français, les Britanniques semblent avoir fait le choix de soutenir l’emploi, quitte à grever leur productivité, en flexibilisant au maximum leur marché du travail. Les réformes du marché du travail ont pesé sur la productivité du pays. Selon une étude de l’Insee27, la baisse des salaires réels britanniques entre 2008 et 2014, accentuée par une augmentation de la population active, a en effet orienté les entreprises vers des processus plus économes en capital et moins en travail. En particulier, elles n’ont pas réduit leurs effectifs pendant la crise ni après celle-ci. Ce phénomène est appelé « l’énigme de la productivité » (productivity puzzle). L’étude note en effet que les réformes structurelles ont porté sur les règles de départ à la retraite et d’éligibilité aux minima sociaux. La progression des emplois a par conséquent concerné en priorité des personnes peu qualifiées, ayant une productivité inférieure à la moyenne. A contrario, selon l’Insee, le développement de la proportion de non-salariés et de contrats à temps partiel n’explique que marginalement la baisse de productivité.
En France, hormis la poursuite des exonérations de charges sociales sur les bas salaires, il n’y a pas eu, à ce jour, de réforme d’ampleur équivalente pour diminuer le chômage des non qualifiés. Les minima sociaux sont restés élevés, le droit du travail n’a pas été notablement assoupli et les réformes du système des retraites restent incrémentales. En toute logique, l’économie française reste caractérisée par un niveau de productivité élevé, un niveau de chômage important et un taux de pauvreté qui demeure relativement contenu, après redistribution. D’après les données d’Eurostat, le taux de pauvreté au Royaume-Uni s’élève à 16,8 % en 2014, contre 13,3 % en France. On note qu’en Allemagne, il est de 16,7 %.
Le Brexit et la stratégie industrielle de Theresa May
En 2017, Theresa May, nouvelle Première ministre, dévoile dans son « livre vert », intitulé Building our Industrial Strategy, un plan d’investissement et de soutien à l’industrie. Dans le contexte de l’après-Brexit, elle souhaite renforcer la compétitivité du secteur industriel pour permettre au pays de se développer sur les marchés mondiaux. Cette stratégie vise à attirer les investisseurs selon d’autres critères que l’accès au marché unique, notamment l’innovation technologique.
La direction du Trésor britannique (HM Treasury) s’est ainsi engagée à porter les investissements dans le domaine de la science et de l’innovation à 4,7 milliards de livres, soit environ 5,6 milliards d’euros d’ici 2020-2021. Un « Fonds pour le défi de la stratégie industrielle » (Industrial Strategy Challenge Fund, ISCF) a été créé pour favoriser quelques secteurs à fort potentiel : l’énergie intelligente, la robotique et l’intelligence artificielle, le réseau mobile 5G. Un investissement initial de 270 millions de livres en 2017-2018 lancera le soutien au développement de ces technologies disruptives. Les mesures ciblent également des investissements dans l’éducation, facteur-clé pour soutenir la R&D et créer au Royaume-Uni des emplois hautement qualifiés et bien payés.
Pour favoriser l’installation et le développement des entreprises nationales et étrangères, le gouvernement a annoncé vouloir réduire d’ici 2020 l’impôt sur les sociétés à 17 %, contre 20 % actuellement, ce qui en fera le plus faible de tous les pays du G20. On note par ailleurs que Theresa May souhaite soutenir le made in Britain.
Enfin, sur le plan régional, Theresa May confirme la stratégie menée par son prédécesseur pour développer l’emploi et la croissance des régions sinistrées. À ce titre, elle poursuit les plans d’investissement visant à maximiser le potentiel économique du « Northern Powerhouse » (cf. encadré 4) et lance la « Midlands Engine Strategy » afin que ces territoires puissent rivaliser avec d’autres places mondiales. Les IDE sont une composante essentielle au succès de cette démarche, et de nombreux outils ont été mis en place au service de la promotion de l’attractivité des territoires (cf. chapitre II). Avec cette stratégie, le gouvernement table par exemple sur la création de 300 000 emplois dans les Midlands au cours des quinze prochaines années.
Encadré 4 – The Northern Powerhouse, Midlands Engine
En 1997, Tony Blair a introduit un modèle de décentralisation (la « dévolution ») qui a profondément modifié les relations de l’État britannique avec ses entités nationales, le Pays de Galles et l’Écosse. La dévolution est plus qu’une décentralisation au sens du droit français, puisqu’elle permet d’aller au-delà de la délégation de pouvoirs administratifs. Les régions peuvent adopter des lois régionales sur des sujets ayant trait aux transports, à la santé ou encore à l’éducation ; la politique étrangère et la défense demeurent l’unique compétence du Parlement de Westminster, à Londres.
George Osborne a lancé en 2014 une nouvelle vague de dévolution en créant le « Northern Powerhouse », un grand chantier de revalorisation économique du Nord de l’Angleterre à travers l’attraction d’investissements notamment étrangers, visant à réduire les inégalités avec le Sud. Ce projet est centré autour des trois villes de Liverpool, Manchester et Newcastle-upon-Tyne. Ces aires métropolitaines obtiennent la maîtrise de certaines compétences – transport, logement, taux d’imposition sur les entreprises, liste négociable de services –, et le Trésor assortit le transfert d’une aide pour développer les infrastructures locales. Un plan spécifique de 556 millions de livres a ainsi été mis en place. Il s’est traduit par la création d’une plateforme intermodale fluviale, maritime, ferroviaire et routière à Goole, dans le Yorkshire, entre Leeds et Hull, d’un fonds pour soutenir le secteur des biotechnologies dans la région de Manchester et du Cheshire, mais aussi d’une zone industrielle près de Sunderland, dans le Tyne and Wear.
Ce projet a eu un effet d’entraînement pour d’autres régions de l’Angleterre. Des grandes villes du centre de l’Angleterre (Sheffield, Nottingham, Birmingham…) se sont regroupées pour former le « Midlands Engine » afin de bénéficier du soutien des pouvoirs publics. Les Midlands ont bénéficié en 2016 d’un investissement de 392 millions de livres, injecté dans les compétences, les transports et la croissance locale. Plusieurs projets ont vu le jour, comme le train à grande vitesse « HS2 » qui reliera le Nord à Londres et au Sud-Est, ou encore le développement d’un hub mondial des technologies spatiales à Leicester.
On note que le principe de dévolution reste facultatif et que les compétences et les moyens financiers restent bien moins importants que ceux qui ont été accordés par Tony Blair aux parlements régionaux écossais et gallois.
Premiers résultats et critiques
L’évaluation des politiques mises en place reste difficile, du fait notamment du caractère récent des réformes. On observe néanmoins qu’entre 2007 et 2015, le Royaume-Uni a détruit 146 000 emplois manufacturiers de moins que la France. La chute de l’emploi manufacturier a été plus rapide au Royaume-Uni (-34 %) qu’en France (-20 %) entre 2000 et 2010. Mais ces destructions d’emplois ont cessé à partir de 2011. Entre 2011 et 2016, 23 000 emplois manufacturiers ont même été créés ; un chiffre certes modeste relativement aux destructions antérieures, mais qui se distingue des contre-performances françaises (112 000 emplois détruits sur la même période) (cf. graphique 3).
Graphique 3 – Évolution de l’emploi manufacturier au Royaume-Uni et en France
Source : Eurostat
Une étude de Craig Berry, chercheur à l’université de Sheffield, appelle à juger ces résultats avec prudence28. La reprise de l’emploi manufacturier doit certes être saluée, mais elle relève davantage de créations dans des secteurs très peu intensifs en technologie. Selon ce chercheur, les mesures du gouvernement en faveur de l’industrie du futur n’ont pas encore produit leurs effets. La nature des emplois créés ne traduit pas une relance du secteur manufacturier ni une montée en gamme : les emplois créés restent peu qualifiés et n’augmentent pas les capacités de production du secteur. Autrement dit, l’emploi se crée davantage dans l’industrie agroalimentaire, pour des tâches élémentaires liées à l’atelier de fabrication plutôt que pour des fonctions à plus forte valeur ajoutée dans des secteurs high-tech comme la pharmacie ou encore la chimie. (cf. tableau 11).
Tableau 11 – Évolution de l’emploi dans l’industrie manufacturière au Royaume-Uni entre 2009 et 2016, par secteur
Source : Eurostat
La Chambre des communes29 a de son côté évalué la stratégie industrielle portée par Theresa May. Elle salue globalement la volonté du gouvernement de porter une répartition plus équitable des richesses et soutenir la croissance de long terme. Elle souligne néanmoins que les défis restent nombreux pour que le Royaume-Uni redevienne une grande nation industrielle. Elle rappelle que si ce livre vert « contient un nombre important de nouveaux engagements (64 sur un total de 106 actions citées), une bonne part d’entre eux avaient d’ores et déjà été formulés par le gouvernement de la coalition ou résultent de la mise en œuvre de mesures antérieures ».
Selon Christian Fatras, conseiller au service économique de l’ambassade de France à Londres, « il faut rester prudent, il peut y avoir un décalage entre les annonces immédiates et les actions qui seront réellement engagées à terme, notamment dans le contexte du Brexit ». Contrairement aux politiques français, les Britanniques communiquent très peu sur les montants alloués pour soutenir leur stratégie industrielle. Une étude note qu’en 2006, « 60 % des aides d’État ont bénéficié à l’industrie manufacturière. »30 Ceci doit être mis en perspective avec le fait que les aides publiques au Royaume-Uni sont relativement plus faibles que chez ses voisins européens. Selon Eurostat, les aides d’État britanniques représentaient 0,35 % du PIB en 2015, contre 0,62 % pour la France et 1,22 % pour l’Allemagne.
Hugh Pemberton, professeur d’histoire contemporaine britannique à l’université de Bristol, souligne ainsi que « les engagements pris en termes de montants à allouer à la stratégie industrielle restent faibles. Il est clair que cela est lié au “programme d’austérité”, c’est-à-dire à l’engagement d’éliminer le déficit budgétaire, mais c’est aussi le signe que le gouvernement a de réelles inquiétudes concernant ses recettes en cas d’échec du Brexit ». Il faut rappeler que, dans le cas d’un Brexit « hard », le pays pourrait pâtir d’une moindre ouverture commerciale et donc voir sa productivité entravée par une moindre diffusion des technologies, des savoir-faire, des bonnes pratiques managériales, ou encore des résultats de R&D. Une étude de l’OCDE montre ainsi qu’une baisse de 4 points de l’ouverture commerciale réduirait la productivité des facteurs de 0,8 % après cinq ans et de 1,2 % après dix ans31.
D’autres experts expriment des doutes concernant la politique fiscale agressive. Selon l’organisme patronal Institute of Directors, la division par deux du taux de l’impôt sur les sociétés pourrait coûter au budget entre 10 et 15 milliards de livres de recettes fiscales. Ceci amenuise la capacité de l’État à investir dans les industries à haute valeur ajoutée.
Plus globalement, compte tenu de la tradition non interventionniste du pays, la politique industrielle britannique menée depuis 2008 n’a pas pris la forme d’un plan d’urgence pour l’industrie qui aurait soutenu les entreprises dans leurs projets d’investissement, comme cela a pu s’observer dans la plupart des pays d’Europe continentale. Selon Christian Fatras, « la politique industrielle reste suspecte en Grande-Bretagne car elle est associée à des tentatives de l’État de privilégier les secteurs ‛stratégiques’ ou ‘porteurs d’avenir’ aux dépens de la logique du marché. » Il n’en demeure pas moins que, politique sectorielle ou non, selon Patrick Manon, directeur de Business France au Royaume-Uni, « le Royaume-Uni a une approche pragmatique, une culture du résultat. Traditionnellement, l’accent est mis sur ce qui fonctionne. Si la Première ministre souhaite garder des accès libres aux marchés dans certains domaines où le pays a des avantages compétitifs, elle n’hésitera pas à sacrifier des secteurs comme l’agroalimentaire qu’elle ne considère pas stratégiques d’un point de vue économique, politique ou même d’aménagement du territoire. »
Défis à venir
Un faible niveau d’investissement
La contribution de l’investissement des entreprises à la croissance reste faible en 2015, ce qui pèse sur la productivité. Tous secteurs confondus, le taux d’investissement des entreprises britanniques était de 19 % contre 24,1 % pour la France et 22,9 % pour l’Allemagne32. Dans l’industrie manufacturière plus spécifiquement, le taux d’investissement des entreprises britanniques en 2015 est relativement faible par rapport à ceux que l’on observe dans d’autres pays européens (cf. tableau 12).
Tableau 12 – Taux d’investissement comparé des entreprises industrielles en 2015 (*)
(*) Le taux d’investissement est calculé en rapportant la formation brute de capital fixe (FBCF) à la valeur ajoutée brute.
Source : Eurostat
On note que le Royaume-Uni souffre de la faible pénétration de robots, qui permettraient d’améliorer la productivité industrielle. Selon l’International Federation of Robotics, on comptait en effet 71 robots pour 10 000 salariés en 2013, contre 125 en France et 282 en Allemagne. Les entreprises industrielles ont aussi souffert d’un accès plus difficile aux financements après la crise. Le processus de désendettement du secteur financier, couplé à une gestion plus prudente du risque, explique une croissance atone du crédit, dont pâtissent avant tout les PME.
Pour pallier ces difficultés, le gouvernement de la coalition a mis en place plusieurs programmes visant à soutenir le crédit au secteur privé, comme le Funding for Lending Scheme (FLS)33, couplés à des dispositifs de déduction d’impôt en faveur de l’investissement productif. Mais les incertitudes entourant la question du Brexit pèsent sur les comportements des chefs d’entreprises. De plus, le développement de l’automatisation et de la robotique ne fait pas l’objet de mesures transversales dédiées ; les industriels britanniques34 déplorent que les financements soient focalisés sur les programmes de recherche de quelques secteurs comme l’automobile et l’aéronautique.
Un manque de qualification et de compétences
Un autre enjeu majeur pèse sur la capacité du pays à se réindustrialiser et à diminuer son déficit vis-à-vis de ses partenaires : le manque de main d’œuvre qualifiée. Le secteur industriel au Royaume-Uni souffre tout particulièrement d’un manque d’attractivité auprès des jeunes qui préfèrent se diriger vers des carrières dans la finance et plus globalement dans les services.
Cette difficulté s’accentue sous l’effet de la croissance, qui augmente la demande de travail, d’autant que le pays a durci sa politique d’immigration. Selon le rapport 2015 de The UK Commission for Employment and Skills (UKCES)35, 30 % des postes vacants dans le secteur manufacturier seraient liés à un manque de compétences, notamment pour des fonctions d’opérateurs qualifiés (fabricants d’outils, machinistes, etc.), d’ingénieurs (professionnels de l’informatique, chimistes, chercheurs scientifiques…) et de managers (directeurs d’usine, chefs de département, etc.), autant de postes-clés pour réussir la transition vers l’industrie du futur. L’enquête de l’UKCES révèle également que la part des employés ne disposant que partiellement des compétences requises pour leur poste est passée de 5,9 % en 2013 à 7,2 % en 2015.
Les enquêtes de l’OCDE permettent d’approfondir l’analyse sur cette question. L’enquête PISA (Programme international pour le suivi des acquis des élèves) montre en effet que, si le taux de formation supérieure36 est largement au-dessus de la moyenne de l’OCDE, le niveau moyen des élèves britanniques du secondaire (évalué sur trois compétences : écrit, mathématiques et sciences) se situe juste au-dessus, soit à un plus faible niveau que celui de la France pour l’écriture et les mathématiques. L’enquête PIAAC (Programme pour l’évaluation internationale des compétences des adultes)37, qui regarde le niveau de compétence des jeunes actifs récemment sortis du système scolaire, révèle un niveau très faible en lecture et en calcul auprès des 25-34 ans. La France affiche de plus mauvaises performances encore.
Différentes mesures prises par le gouvernement visent à adapter le système de formation aux besoins des entreprises. Parmi les moyens identifiés, on trouve la réforme du système d’apprentissage38 (amélioration du système de financement, élévation de la qualité de l’enseignement professionnel avec un accent porté sur l’acquisition de solides bases en mathématiques et en anglais), le développement des formations industrielles dans l’enseignement supérieur, des financements dédiés au rapprochement entre l’offre et les besoins de formations (Employer Ownership of Skills Programme). On note également que le département Business Innovation and Skills encourage les carrières dans l’industrie à travers des programmes tels que Make it Britain, lancé en novembre 2011, et See Inside Manufacturing.
Patrick Manon, directeur de Business France au Royaume-Uni, rappelle toutefois que « les grandes universités britanniques forment moins d’ingénieurs mais davantage de juristes, de communicants, de main-d’œuvre pour le secteur des services. Avec le Brexit, les secteurs industriels qui dépendent très fortement de l’intégration de talents étrangers vont devoir lutter pour maintenir le développement et la production de produits existants. Il y aura certainement une adaptation entre le discours et la réalité concernant la politique migratoire. » Florence Faucher, professeure à Sciences Po au Centre d’études européennes, ajoute par ailleurs, que « les restrictions sur l’immigration de main-d’œuvre faiblement qualifiée risquent aussi de faire monter le coût du travail et de peser sur l’attractivité du pays. »
- 5 – Le Royaume-Uni est toujours derrière la France si l’on inclut le secteur énergétique et les industries extractives dans l’industrie. Le secteur industriel, dans cette acception élargie, représentait 11,8 % du PIB britannique en 2015 et 12,6 % en France.
- 6 – Demmou (2010).
- 7 – Barou (1978).
- 8 – Coutts, Gudgin (2015).
- 9 – Voir les travaux de W. Baumol présentant dès 1965 «The cost disease of services ».
- 10 – Young (2014).
- 11 – Cecchetti, Kharroubi (2012) ; Cecchetti, Kharroubi (2015).
- 12 – Buigues, Cohen (2014).
- 13 – Le leadership du Royaume-Uni s’explique par le fait qu’il s’est ouvert très tôt aux IDE et qu’il a capitalisé sur cet avantage au cours des dernières décennies. On note toutefois que sa position tend aujourd’hui à s’effriter, traduisant un effet de rattrapage des autres pays.
- 14 – Direction générale des douanes et droits indirects (2017).
- 15 – Les données récentes ne sont pas disponibles, mais les services financiers et d’assurances représentaient en moyenne 82 % de l’excédent de la balance des services dans les années 2000.
- 16 – Le passeport européen permet à une société de gestion ayant obtenu un agrément par l’autorité de son pays d’origine d’exercer ses activités dans toute l’Union européenne ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE).
- 17 – Society of Motor Manufacturers and Traders (2016).
- 18 – Natixis (2012).
- 19 – Bailoni (2011).
- 20 – Bailey et al. (2008).
- 21 – Beatty, Fothergill (2016).
- 22 – Becker et al. (2017) ; Bell, Machin (2016).
- 23 – Faucher, Le Galès (2010).
- 24 – Les contrats « zéro heure » où l’employeur n’est plus tenu de garantir un temps de travail minimum à ses employés.
- 25 – L’aérospatiale, les technologies agricoles, l’automobile, la construction, l’économie de l’information, l’éducation internationale, les sciences de la vie, le nucléaire, l’éolien en mer, le pétrole et le gaz, les services professionnels et d’affaires.
- 26 – Mathieu (2013).
- 27 – Jess et al. (2013) ; Jones (2016).
- 28 – Berry (2016).
- 29 – House of Commons (2017).
- 30 – Thibault (2008).
- 31 – Égert, Gal (2016).
- 32 – Cela contredit l’idée que la France est un pays qui investit moins que ses voisins dans son outil industriel. Ce paradoxe fait l’objet de travaux en cours à La Fabrique de l’industrie : voir Bidet-Mayer (2017).
- 33 – Le FLS permet aux établissements financiers qui augmentent leurs prêts à l’économie d’emprunter des bons du Trésor à des taux privilégiés auprès de la Banque d’Angleterre. Il a été créé en juillet 2012, initialement pour une durée de deux ans, et sera prolongé jusqu’en janvier 2018. Il concernait à l’origine les prêts aux ménages et aux entreprises mais ce champ a été réduit, d’abord aux seuls prêts aux entreprises, puis aux seules PME. Le FLS a permis d’accorder pour 63,6 Md£ de prêts à l’économie depuis sa création.
- 34 – Rigby (2015).
- 35 – UKCES (2016). Notons que cet organisme est fermé depuis mars 2017.
- 36 – En 2015, 41,6 % de la population âgée de 25 à 64 ans est diplômée de l’enseignement supérieur au Royaume-Uni, contre seulement 34,1 % en France.
- 37 – OCDE (2016).
- 38 – Le nombre d’apprentis est passé de 500 000 à plus de 800 000 depuis 2009. Cette augmentation est en grande partie constatée chez les plus de 25 ans. Un rapport de l’IPPR (2016) critique ainsi la pertinence de cette réforme qui a conduit un nombre important d’employeurs à inscrire leur personnel dans des formations par apprentissage afin de bénéficier de financement public.
Désindustrialisation et politiques publiques : France et Royaume-Uni, deux modèles opposés ? – COMMENTAIRE
par Pierre Buigues, professeur à la Toulouse Business School et ancien conseiller économique à la Commission européenne.
Le Royaume-Uni et la France privilégient deux modèles très différents d’intervention des pouvoirs publics en faveur des entreprises. La question est de savoir si le maintien d’une industrie forte sur le territoire national passe par la préservation de champions nationaux, leur soutien par les pouvoirs publics ou par la capacité à construire des avantages comparatifs solides qui valorisent l’implantation d’usines sur le sol national.
L’industrie britannique se caractérise par des coûts horaires de main-d’œuvre bien plus bas qu’en France : 26 euros fin 2016, contre 37,6 euros en France, différence explicable en partie par les charges sociales. Les charges sociales sur le coût de la main-d’œuvre sont en effet plus élevées en France39. De plus, l’impôt sur les sociétés est d’environ 20 % au Royaume-Uni contre 33,33 % en France, et la taxation sur le capital y est aussi bien plus faible. Le Royaume-Uni se caractérise aussi par une bien plus grande flexibilité du marché du travail qu’en France.
L’industrie française bénéficie d’aides publiques plus nombreuses. L’État français est actionnaire dans nombre de champions nationaux ; il est même le plus puissant actionnaire de la place boursière parisienne. Le portefeuille de l’État actionnaire valait à fin avril 2015 quelque 110 milliards d’euros, ce qui n’a pas d’équivalent au Royaume-Uni. De plus, le montant des aides d’État aux entreprises, exprimé en pourcentage du PIB, est plus de deux fois supérieur en France à ce qu’il est au Royaume-Uni40. Enfin, l’État s’implique dans le sauvetage de champions nationaux : il est ainsi entré dans le capital de PSA à hauteur de 14 %, et le sauvetage d’Areva pourrait coûter 2,5 milliards d’euros. Cela ne veut pas dire que les pouvoirs publics britanniques n’interviennent pas, mais qu’ils le font très rarement pour sauver un grand groupe. En revanche, grâce à des exonérations fiscales importantes, le nombre de business angels au Royaume-Uni est six fois plus élevé qu’en France et l’investissement par business angel et par projet y est cinq fois supérieur.
L’attractivité d’un pays, mesurée par le nombre de projets ou par le montant d’investissements étrangers, montre que la France est aujourd’hui largement distancée par le Royaume-Uni. En 2016, on dénombrait 779 projets d’investissement étrangers en France contre 1 144 au Royaume-Uni (enquête EY)41 et ces données sont confirmées par le World Investment Report. Pour les années 2014 à 2016, le montant des investissements directs étrangers en France ne représentait que le quart du montant réalisé au Royaume-Uni. L’écart est donc considérable. Le Global Competitiveness Index, qui est une mesure de l’attractivité d’un pays vue par des investisseurs étrangers, classe la France au 22e rang et le Royaume-Uni au 10e.
Cependant, deux changements peuvent modifier l’attractivité relative de la France. D’abord, la volonté affichée du nouveau président français d’améliorer la flexibilité du marché du travail et de réduire la fiscalité sur les entreprises peut accroître sensiblement l’attractivité du pays. Ensuite, le Brexit, en augmentant le niveau des barrières à l’entrée sur le marché de l’UE pour les entreprises britanniques, peut sensiblement diminuer l’attractivité du Royaume-Uni aux yeux des investisseurs étrangers.
- 39 – Les contributions sociales payées par les employeurs représentaient 3,5 % du PIB au Royaume-Uni et 11,6 % du PIB en France.
- 40 – Voir à ce sujet : Buigues, Sekkat (2009).
- 41 – Business France attribue cet écart à la méthodologie utilisée par EY (voir annexe 2).
Les IDE, moteur des transformations de l’économie britannique ?
Les IDE sont intégrés à la politique de développement régional. Face à la désindustrialisation des années 1970-1980, ils deviennent un outil pour reconvertir et relancer l’économie des anciennes régions industrielles qui connaissent un chômage structurel. Aujourd’hui, dans le contexte du Brexit, la revitalisation de ces territoires est de nouveau au cœur des débats. Attirer et retenir des investisseurs étrangers devient un enjeu majeur pour soutenir la stratégie de développement économique local. Après plusieurs décennies d’efforts soutenus, le pays est devenu la destination privilégiée, tous secteurs confondus, des investisseurs en Europe et se classe au deuxième rang européen pour l’accueil de projets industriels.
Ce second chapitre rappelle les principaux enseignements de la littérature économique sur les effets des IDE et mobilise des études de cas pour aider à spécifier leurs effets positifs et/ou négatifs sur l’économie britannique.
L’impact des IDE sur l’industrie britannique
Les effets positifs et négatifs des IDE
La politique volontariste menée au Royaume-Uni depuis les années 1980 à destination des investisseurs étrangers repose sur la conviction que la pénétration des capitaux étrangers se traduit par des retombées positives sur le tissu économique national. Une riche littérature académique42 présente les nombreux gains liés à la présence d’investisseurs étrangers dans un pays hôte : les IDE permettent l’apport de capitaux et engendrent des bénéfices qui contribuent à l’amélioration des recettes fiscales du pays bénéficiaire ; ils impliquent des transferts d’idées, de technologies et de compétences qui sont de véritables atouts pour la compétitivité des entreprises installées sur le marché intérieur du pays récepteur. A titre d’exemple, l’IDE s’accompagne souvent de programmes de formation du personnel dans les entreprises acquises ou créées, ce qui contribue au développement des ressources humaines locales. L’IDE augmente également les exportations du pays d’accueil à travers différentes stratégies (faire du pays d’implantation une plateforme de réexportation vers le pays d’origine ou vers des pays tiers, ou encore conquérir de nouveaux marchés proches géographiquement). L’ensemble de ces effets – transferts de technologie, accumulation du capital humain et intensification du commerce international – stimule la croissance par la création d’avantages comparatifs dynamiques conduisant à des effets d’entraînement (« spillover effect ») sur l’ensemble de l’économie (cf. figure 1).
Ces travaux précisent que les IDE constituent un indicateur de l’attractivité d’un pays en même temps qu’une source de richesse, lorsque certaines conditions sont remplies : réinvestissement des bénéfices, intégration suffisante des fournisseurs locaux dans la chaîne d’approvisionnement de l’entreprise étrangère, capacité des entreprises nationales à résister à la concurrence de ces nouveaux entrants. La littérature économique et les études empiriques43 indiquent toutefois que les IDE peuvent générer des externalités négatives. L’implantation d’une firme étrangère dans un pays hôte peut notamment affecter négativement les firmes locales si elle dispose d’une avance technologique trop importante. De même, si les firmes étrangères ont tendance à payer des salaires plus élevés, elles peuvent réduire l’attractivité des entreprises nationales auprès des travailleurs locaux, etc.
Figure 1 – Les principaux gains directs et indirects liés aux investissements directs étrangers dans un pays hôte
Source : Anima Investment Network (2010)
L’industrie manufacturière, cible des investisseurs étrangers au Royaume-Uni
Relativement à sa taille dans l’économie britannique, le secteur industriel est une cible importante pour les investisseurs étrangers, même si le stock d’IDE dans les services est deux fois plus important en volume (cf. tableau 13). Ce phénomène, que l’on observe dans le cas français, s’explique en partie du fait que toutes les activités tertiaires ne sont pas exposées à la mondialisation.
Tableau 13 – Répartition du stock d’IDE entrants par secteur et contribution à la valeur ajoutée brute en 2015
Montant en million de livres et part en %
NB : Les sources diffèrent entre le tableau et le graphique 1 « Poids des IDE entrants dans différentes économies » et les résultats peuvent donc fluctuer.
Source : Office for National Statistics
Au sein du secteur manufacturier, les investisseurs étrangers sont particulièrement présents dans le l’agroalimentaire, la pharmacie et la chimie, les équipements TIC et l’industrie des transports en général, l’automobile en particulier (cf. graphique 4).
Graphique 4 – Répartition du stock d’IDE entrant dans l’industrie manufacturière en 2015
Source : Office for National Statistics
Au total, selon le cabinet EY, le Royaume-Uni a accueilli en 2016 sur son territoire, tous secteurs confondus, 1 144 projets d’investissement, générant 43 165 emplois44 (cf. tableau 14). Le cabinet d’audit et de conseil recense 160 projets d’investissement dans l’industrie45, ayant créé 8 291 emplois. Le Royaume-Uni se classe ainsi au deuxième rang des pays européens pour l’accueil de projets industriels, derrière la France (212 projets générant 5 724 emplois dans le secteur)46. Entre 2007 et 2016, on constate que, si le nombre de projets d’investissements industriels dans l’automobile a davantage augmenté en France (+8) qu’au Royaume-Uni (+4), le nombre d’emplois générés a été divisé par deux dans notre pays alors qu’il a été multiplié par quatre outre-Manche.
Tableau 14 – Répartition des projets d’investissement au Royaume-Uni par type d’activité en 2016
Source : EY
Des entreprises étrangères plus performantes que les entreprises nationales
Selon la littérature économique et les études empiriques47, les firmes étrangères ont tendance à racheter des entreprises plus productives que la moyenne ; elles sélectionnent celles qui présentent le plus fort potentiel (« cherry picking »). Ainsi, du fait de cette sélection, les entreprises étrangères affichent des performances supérieures aux entreprises nationales.
Le lien entre l’IDE et la performance des entreprises peut aussi s’expliquer par un effet de structure : les investisseurs ciblent en priorité des grandes entreprises, dont l’effort de R&D est plus important. En 2015, les entreprises détenues par des groupes étrangers étaient près de 35 fois moins nombreuses que les entreprises nationales, mais représentaient 61 % des entreprises industrielles de plus de 500 salariés. Ces mêmes entreprises étrangères contribuaient à 48,3 % de la richesse produite par le secteur et représentaient 51 % des dépenses en R&D du secteur privé britannique, cette part pouvant monter jusqu’à 88 % dans le secteur automobile (cf. tableau 15). À titre de comparaison, un rapport de la Commission européenne indique qu’elles représentaient entre 20 % et 25 % des dépenses de R&D en France et en Allemagne48.
La dépense globale privée de R&D est assez faible au Royaume-Uni : elle ne représente que 1,1 % du PIB, contre 1,5 % en France et 2 % en Allemagne en 2015. Le Royaume-Uni est en effet spécialisé dans des domaines d’activité traditionnellement moins actifs en R&D, comme les industries extractives ou les services.
Tableau 15 – Contribution des entreprises étrangères aux dépenses en R&D par principaux secteurs
En 2015, millions de livres et part en %
Source : Office for National Statistics
Graphique 5 – Évaluation des pratiques managériales par pays, en 2007
L’évaluation des pratiques managériales est réalisée à partir de 18 dimensions ayant trait à (i) la capacité du management à évaluer et à superviser la performance et à améliorer les procédés existants, (ii) la capacité à fixer des objectifs adéquats, à les respecter et à modifier la stratégie en cas d’incohérence entre objectifs et résultats, (iii) la capacité d’utiliser au mieux les ressources humaines en mettant en place des systèmes d’incitation à la performance et de promotion des talents.
NB : le Japon est exclu de l’analyse faute d’échantillon significatif.
Source : Centre for Economic Performance
Une étude de la London School of Economics (LSE) et de KPMG49 avance un autre type d’argument pour expliquer les performances des entreprises à capitaux étrangers. Celles-ci se distinguent en effet par leur capacité à insuffler de meilleures pratiques de management que les entreprises locales. On constate cet écart dans tous les pays, et plus particulièrement dans le cas britannique50 (cf. graphique 5). Ce point est important puisque les chercheurs de la LSE ajoutent par ailleurs qu’il existe un lien de corrélation entre la qualité du management apportée par les firmes étrangères et la productivité. Autrement dit, la qualité du management insufflée par les entreprises étrangères augmenterait la performance de l’entreprise, notamment en termes de chiffre d’affaires et de gains de part de marché.
Les facteurs d’attractivité des IDE
L’attraction de centres de décision par la place financière de Londres
L’attractivité du secteur industriel s’explique en partie par la taille du secteur financier britannique. Les firmes multinationales sont attirées par la place financière de Londres et la possibilité d’accéder à de nouvelles sources de financement. De nombreux chercheurs51 ont en effet montré que le développement du secteur financier était positivement corrélé à la croissance de la valeur ajoutée de l’industrie. Jean-Luc Di Paola-Galloni, directeur du développement de Valeo, ajoute que « l’industrie automobile est très financiarisée, les grands acteurs sont cotés en bourse, les liens avec la City sont très forts et la place financière de Londres a joué un rôle important dans la renaissance du secteur au Royaume-Uni. »
La taille du secteur financier britannique conjuguée à l’ouverture du pays aux IDE a favorisé l’implantation de nombreux centres de décision sur le territoire britannique, liés aux activités industrielles comme de services. Ces sièges de filiales regroupent l’ensemble des fonctions stratégiques (directions de la stratégie, financière, marketing, commerciale, achats, etc.) essentielles au développement des activités industrielles.
Parmi les pays européens, le Royaume-Uni affiche un leadership sur ce segment avec 106 implantations de centres de décision en 2016, contre 35 en Allemagne et 16 en France. L’implantation de centres de décision sur un territoire permet d’attirer des professionnels hautement qualifiés, et par conséquent des contribuables et consommateurs à revenus élevés. Elle est aussi stratégique car ces centres constituent habituellement le lieu où est déterminée l’affectation des ressources de l’entreprise. Étant donnée l’importance de ces décisions, certains chercheurs52 affirment que le bien-être économique d’un pays est directement lié à sa capacité d’attirer ou de conserver ces centres de décision.
Le défi du Royaume-Uni sera maintenant de fixer leur ancrage sur son territoire, dans le contexte du Brexit. Le Centre for Economic Performance de la LSE53 estime par exemple que le Royaume-Uni pourrait perdre 22 % des flux d’IDE entrants au cours de la prochaine décennie. Les effets du Brexit se font d’ores et déjà sentir puisqu’en 2016, selon EY, le Royaume-Uni a connu une diminution du nombre de projets d’implantations de centres de décision de 31,6 % par rapport à 2015, alors que le nombre de ces projets baissait de 9,5 % dans toute l’Europe.
Le soutien public à l’innovation et la capacité à produire des connaissances scientifiques
Selon les données d’EY, en 2016, le Royaume-Uni est le 2e pays d’accueil de centres de R&D en Europe avec 63 implantations contre 66 en Allemagne et 51 en France. Entre 2007 et 2016, le Royaume-Uni a accueilli 633 centres de R&D. La France et l’Allemagne ont chacun accueilli 356 centres de R&D. Ces projets ont engendré 24 200 emplois contre près de 10 000 en France et 9 000 outre-Rhin.
De nombreux dispositifs d’aide aux entreprises mis en place par les pouvoirs publics ont favorisé ces implantations. On peut citer des incitations comme le R&D Tax Credits ou encore la Patent Box, une loi entrée en vigueur en avril 2013. Cette dernière réduit de 21 % à 10 % le taux d’imposition sur les bénéfices tirés de l’usage des droits de propriété intellectuelle dûment reconnus, dont les brevets. Ceci a largement profité au secteur pharmaceutique, qui est le secteur qui investit le plus en R&D (il représente 25 % des dépenses totales).
La capacité du Royaume-Uni à produire des connaissances scientifiques et technologiques joue un rôle important pour l’implantation de centres de R&D étrangers. Selon le rapport sur l’innovation publiée en 2016 par la DGE et la DGRI54, le Royaume-Uni se classe parmi les premiers pays pour son poids dans le taux de publications scientifiques les plus citées au monde (plus de 14 % contre près de 11 % en France). L’étude précise qu’« une recherche à fort impact rend la communauté scientifique nationale attractive pour des coopérations et représente un potentiel élevé de nouvelles connaissances qui peuvent irriguer l’ensemble de l’économie et servir de ressources pour l’innovation. »
Ainsi, les entreprises étrangères tendent à localiser leurs centres de R&D au Royaume-Uni près de clusters intégrant des universités de renom, afin de bénéficier de la qualité de l’environnement scientifique et des écosystèmes d’innovation. Selon l’étude menée par la présidente de la Royal Academy of Engineering, Dame Ann Dowling55, les deux tiers des 40 entreprises ayant le plus grand nombre de collaborations avec des universités du Royaume-Uni sont des entreprises étrangères. Ces collaborations ont des retombées économiques importantes pour le territoire en termes de financement, de formation, de création d’emplois qualifiés.
Par ailleurs, plus ces centres de R&D seront intégrés à un écosystème d’innovation dynamique, plus il sera coûteux pour l’entreprise de délocaliser ces activités. Cet ancrage dans le contexte du Brexit est un point essentiel, car il est possible que le flux de nouvelles implantations de centres de R&D se tarisse à l’avenir. EY constate déjà qu’en 2016, elles ont diminué de 37 % par rapport à 2015, reflétant les préoccupations des investisseurs internationaux. Christian Fatras, conseiller au service économique de l’ambassade de France à Londres, rappelle également qu’en quittant l’UE « les Britanniques risquent de se priver des fonds mais aussi des programmes communautaires. Dans la recherche, d’importantes inquiétudes émergent concernant notamment les programmes d’Horizon 2020. Ce n’est pas simplement l’aspect financier qui compte, c’est aussi le fait de se priver de ce réseau et des compétences qui y sont associées. »
Plus globalement, le tableau de bord européen de l’innovation, qui dresse un état des lieux comparatif des performances des États membres de l’Union européenne en matière de recherche et d’innovation, classe le Royaume-Uni au 5e rang et la France au 11e. Frédérique Sachwald, directrice de l’Observatoire des sciences et techniques du Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (OST-Hcéres), précise cependant que ce type de classement est à analyser avec précaution : « il convient de toujours conserver un esprit critique quant aux interprétations faites à partir des indicateurs synthétiques. Il faut en effet tenir compte des spécificités de chaque pays et ne pas se contenter de l’indicateur synthétique. Le rapport sur l’innovation publié en 2016 permet de souligner les points forts des différents systèmes nationaux. Le Royaume-Uni a ainsi des atouts en termes de production de connaissances scientifiques, dans les domaines des biotechnologies et pour déposer des brevets par de jeunes entreprises. La France, elle, présente des points forts notamment dans les technologies environnementales, la part des brevets déposés par la recherche publique et la diffusion des TIC dans les entreprises. »
La création d’un environnement compétitif et attractif
Les enquêtes d’EY réalisées auprès des investisseurs étrangers implantés outre-Manche montrent que leurs motivations sont très diverses. Elles sont en grande partie liées à la langue anglaise (83 % des répondants), aux technologies et aux infrastructures (80 %), à l’existence d’un grand marché domestique (73 %), à la flexibilité du marché du travail (67 %), à la présence d’universités mondiales (66 %) et à la recherche d’économies fiscales (64 %)56. L’annonce du gouvernement britannique, suite au Brexit, d’aller encore plus loin en ramenant l’impôt sur les sociétés de 20 % à 17 % à l’horizon 2020 pourrait accentuer cette attractivité. Toutefois, Alain Trannoy, directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales, estime que « cette course au moins-disant fiscal et social, qui vise à attirer des investissements, peut se révéler coûteuse pour les finances publiques. »57
Au-delà de ces motivations pour s’implanter au Royaume-Uni, les projets d’IDE accueillis sont particulièrement riches en emploi. Selon Marc Lhermitte, associé chez EY, « les atouts britanniques en termes de fiscalité, de simplification administrative et de flexibilité du marché du travail expliquent cette situation. » Il note que, sur ces points précis, « la France conserve des handicaps structurels de compétitivité. » Les décideurs internationaux sondés en 2016 dans l’enquête EY sur l’attractivité du « site France » plaident en effet en faveur d’un allégement de leurs charges fiscales (55 %), d’une simplification de leur quotidien (46 %) et d’une réforme du marché et du droit du travail (39 %) (cf. encadré 5).
Encadré 5 – Environnement des affaires : les atouts britanniques sont le reflet des handicaps français
Une main-d’œuvre flexible et peu onéreuse
La flexibilité du marché du travail repose sur une culture sociale relativement restreinte et sur l’absence de code du travail, remplacé à l’avantage des employeurs par le droit coutumier et jurisprudentiel de la common law. Seulement un tiers des ouvriers est syndiqué, et l’employeur s’avère rarement contraint de négocier avec les syndicats.
Coût horaire de la main-d’œuvre dans l’industrie manufacturière en 2016 (en euros)
Source : Eurostat
Un système de taxes avantageux
L’impôt sur les sociétés (IS) britannique ne cesse de diminuer depuis 2008. Avant la crise, il était de 30 %. En 2017, l’IS est de 20 % et devrait passer à 17 % en 2020, soit le taux le plus bas de tous les pays du G20. Cette tendance baissière entamée par le gouvernement Cameron est à l’époque sans ambiguïté : il s’agit d’attirer des multinationales au Royaume-Uni et de s’assurer qu’elles paient des impôts sur le territoire. À titre de comparaison, en France, l’IS s’établit à 33,33 % en 2017, les PME bénéficiant d’une imposition moindre (28 %). D’ici 2020, toutes les sociétés bénéficieront d’une imposition au taux de 28 %.
Par ailleurs, la pression des charges sociales sur les salaires est beaucoup moins élevée outre-Manche qu’en France : d’après les données de l’OCDE, en France, pour un célibataire sans enfants rémunéré au salaire moyen, le poids de ces prélèvements a représenté 48,1% du coût du travail en 2016. C’est moins que la Belgique (54 %) qui se place en tête du podium, suivie de l’Allemagne (49,4 %), mais bien plus que le Royaume-Uni (31 %). De même, pour un couple marié avec deux enfants et ne disposant que d’un seul salaire moyen, le poids de ces prélèvements a représenté 40 % du coût du travail, soit le plus fort taux des pays de l’OCDE. En bas du classement, on retrouve le Royaume-Uni avec un impôt sur les salaires de 26 %.
Un environnement d’affaires peu contraignant
Selon le dernier classement sur l’attractivité de l’environnement des affaires de la Banque mondiale (“Doing Business”), le Royaume-Uni se classe au 7e rang et la France au 29e. À titre d’exemple, en matière de procédures pour créer une entreprise (délais et coûts nécessaires), le Royaume-Uni se classe au 16e rang et la France au 27e. Business France rappelle toutefois que ce type de classement est à analyser avec précaution, tant la mesure de l’attractivité reste difficile58. Comme le souligne Sylvie Montout, chef économiste chez Business France, « nous constatons un décalage entre l’image du pays renvoyée par les classements et la réalité, beaucoup moins négative. Ces classements favorables au droit anglo-saxon ne proposent qu’un aperçu limité d’un des aspects de la compétitivité des pays. L’environnement des affaires ne peut se limiter aux procédures administratives et à l’environnement réglementaire. Il doit s’apprécier sur l’ensemble de l’écosystème, à l’aune de la stabilité et de la pérennité des activités, et de l’environnement réglementaire et fiscal. Le Doing Business ne mesure pas tous les paramètres constitutifs de la compétitivité, il ne couvre ni la sécurité, ni la stabilité économique, ni la corruption, ni la qualité des infrastructures, ni l’éducation et la formation de la main-d’œuvre. Il n’évalue pas la solidité du système financier ni de sa régulation, pourtant deux facteurs importants dans la compréhension des causes de la crise financière et qui affecte l’environnement des affaires. »
On note par ailleurs que, comme les États-Unis et l’Allemagne, la France dispose d’outils pour se prémunir contre des investissements étrangers hostiles et elle a, ces dernières années, renforcé ses moyens de défense concernant les prises de participation venant de l’étranger. Au Royaume-Uni, il n’existe pas de législation sur les investissements directs étrangers. Cela étant, d’autres dispositifs permettent un contrôle. L’Enterprise Act (2003) introduit une application spécifique du contrôle des concentrations dans les secteurs affectant les intérêts publics, sans que ceux-ci ne soient listés. Depuis l’arrivée de Theresa May au pouvoir, le Royaume-Uni mène une réflexion pour adopter un nouveau régime d’investissement étranger qui donnera au gouvernement plus de pouvoirs d’intervention. Il s’agit notamment de renforcer les outils juridiques visant à protéger les infrastructures critiques.
La création de structures d’appui aux investisseurs étrangers, aux échelles nationale et régionale, a également joué un rôle majeur pour créer un écosystème attrayant et favoriser les « effets de déversement » des IDE sur le territoire. Au niveau national, UK Trade & Investment (UKTI) a longtemps été l’agence gouvernementale britannique aidant les entreprises étrangères à s’implanter au Royaume-Uni et à y développer rapidement leurs activités. L’agence a remporté en 2014 un prix des Nations unies pour l’efficacité de ses pratiques en termes de promotion de l’investissement étranger. Depuis juillet 2016, l’agence a été intégrée au sein du Department for International Trade, devenant un service ministériel directement administré par le gouvernement. Un autre service a été créé. Il s’agit de l’agence Britain Open for Business. Cette dernière est dédiée à l’attractivité de projets d’investissement dans des secteurs intensifs en R&D et à haute valeur ajoutée. Les besoins des investisseurs pour les projets de taille importante sont ainsi discutés directement avec les services du gouvernement pour financer notamment les infrastructures qui conviennent.
Les autorités locales participent également à l’effort de prospection des investisseurs étrangers. Les Regional Development Agencies (RDA) ont tenu ce rôle entre 1998 et 2012. Avec la politique d’austérité, ces structures ont été remplacées en 2012 par les Local Enterprises Partnerships (LEP). Ces dernières sont un partenaire contractuel de l’UKTI. Elles présentent la particularité de ne pas avoir de modèle structurel uniforme, sinon qu’elles doivent être dirigées par un acteur du secteur privé. Les 39 LEP en Angleterre ont pour mission de promouvoir les interactions entre les différents acteurs du territoire et les entreprises étrangères. L’efficacité de ces structures encore récentes varie en fonction des territoires ; on constate toutefois qu’elles ont en commun de ne pas se limiter à la simple attraction d’IDE en fonction des avantages comparatifs de leur territoire. Ces structures définissent également une stratégie pour les retenir et surtout les encourager à investir davantage dans le développement économique local. Certaines se coordonnent avec l’ensemble des acteurs locaux afin de développer des écosystèmes intégrant des entreprises étrangères, capables de renforcer la position du territoire.
Intégration de l’IDE dans l’économie régionale britannique : une réalité hétérogène
La politique de développement régional et la localisation des IDE
Comme dans de nombreux pays européens59, les pouvoirs publics ont joué un rôle central dans la localisation des firmes étrangères au Royaume-Uni. En effet, le pays s’est doté d’un dispositif d’aides et de subventions élaboré (incitations fiscales, subventions, zones d’entreprise, appui d’agences locales, etc.) pour attirer des investisseurs étrangers dans des zones économiques défavorisées ou en restructuration, comme les anciens bassins de l’industrie lourde (les « zones assistées »). Les subventions ont pendant longtemps été conditionnées à plusieurs critères relatifs, notamment à la viabilité des projets d’investissement et aux bénéfices que pouvait en tirer l’économie nationale et régionale, en particulier en termes de création d’emplois60. En vertu des règles relatives aux aides d’État de l’Union européenne, la carte des zones éligibles est établie et validée par la Commission européenne.
Aujourd’hui, d’après les données du cabinet EY relatives aux décisions d’investissement industriel, les régions qui ont attiré le plus grand nombre de projets et créé le plus d’emplois au cours de la dernière décennie sont pour la plupart celles qui ont été définies comme des « zones assistées » dans les années 1980 (cf. tableau 16).
Tableau 16 – Nombre de projets industriels et d’emplois générés entre 2007 et 2016
(*) Régions désignées comme assistées dans les années 1980
Source : EY
De nombreux travaux académiques se sont attachés à évaluer l’impact de cette politique en termes d’attractivité d’IDE et de retombées économiques pour le territoire. Ces travaux sont riches d’enseignements. À titre d’exemple, des chercheurs du Spatial Economic Research Centre ont décomposé les effets de cette politique sur le long terme61. Leurs travaux confirment le lien de corrélation entre le montant des aides et l’accueil d’IDE : dans le secteur manufacturier par exemple, les six régions assistées ont capté 75 % des IDE entrants au Royaume-Uni entre 1985 et 2005. Comme le montre le tableau 17, l’accueil d’IDE semble également leur avoir permis de créer ou sauvegarder des emplois, donc de diminuer le taux de chômage. Parmi les régions non assistées, seul le Sud-Est affiche des performances élevées alors qu’il a perçu très peu de subventions62. Cela s’explique par la spécialisation historique de la région dans des secteurs industriels de pointe (pharmacie, aéronautique et automobile).
Les auteurs concluent toutefois que l’effet de ces aides sur les choix de localisation des firmes – et par conséquent leurs retombées économiques – s’atténue avec le temps. L’étude montre en effet que la part des projets d’IDE dans le secteur industriel allant aux régions assistées a commencé à décliner, passant de 90 % en 1990 à 50 % en 2005. La poursuite de cette politique est restée cependant essentielle car c’est le seul dispositif financier de promotion de l’investissement étranger qui soit accepté par la Commission européenne. Jean-Luc Di Paola-Galloni, directeur du développement de Valeo, précise ainsi que « les aides régionales allouées au Royaume-Uni restent aujourd’hui d’un montant très faible relativement à des pays comme l’Allemagne ou même la France, même si l’efficacité de leur allocation n’est pas à remettre en cause. » Il rappelle également que « la carte des zones éligibles a fait l’objet de plusieurs révisions et qu’elle ne concerne plus beaucoup de territoires » (cf. annexe 4).
L’un des enseignements de ces évolutions est que les subventions fournies par l’État et les organismes publics ont été utiles, dans un premier temps, pour attirer les investisseurs dans ces régions ; mais la décision de localisation des entreprises étrangères ne peut être résumée à cette seule motivation63. Comme nous le verrons plus loin dans ce chapitre, l’incitation financière, à elle seule, ne peut être durablement efficace si elle n’est pas prolongée par le déploiement d’une politique de développement local. L’expérience montre même qu’attirer des entreprises étrangères sur la seule base des aides financières peut s’avérer contreproductif pour le territoire (cf. encadré 6).
Tableau 17 – Répartition des IDE par région et par secteur en fonction des aides perçues et impact sur le taux de chômage en 1985 et 2005
(*) Les dotations sont en valeur et les IDE sont ici définis en nombre de projets.
(**) Les projets d’IDE et des entreprises nationales.
Source : Spatial Economic Research Centre
Encadré 6 – Des stratégies opportunistes
L’installation de LG, groupe coréen, au pays de Galles est un exemple des risques d’inefficacité des aides financières à l’installation d’entreprises étrangères. En 1996, LG annonce son installation à Newport avec une promesse d’investissement record pour la région de 1,7 milliard de livres. L’implantation du groupe électronique devait créer 6 100 nouveaux emplois et des milliers d’autres emplois indirects. La région envisageait même le développement d’un cluster dédié à l’électronique. Ainsi, l’État et la Welsh Development Agency ont encouragé LG à investir dans la région à travers des subventions directes, la mise à disposition gratuite du site, des programmes de formation, etc. L’enveloppe totale des aides publiques représentait 200 millions de livres. Malheureusement, en 1998, une crise financière touche durement la Corée du Sud et d’autres pays asiatiques. Une partie de l’usine ne fonctionnera jamais, le site emploiera 2 000 personnes au maximum et fermera définitivement en 2006. Les sites de production ont été transférés en Chine et en Pologne64. Cet exemple illustre la fragilité que peuvent avoir les investissements étrangers dans un pays hôte. Lorsque le cycle économique se dégrade, les investisseurs ont tendance à rapatrier les fonds dans le pays d’origine et à couper les flux de capitaux vers les filiales étrangères.
Dans l’agroalimentaire, en février 2010, Kraft obtient le contrôle de Cadbury à la suite d’une offre d’achat hostile de 11,5 milliards de livres. Le groupe américain s’était engagé à ne pas fermer l’usine de Somerdale, qui était pourtant en souffrance, afin de convaincre les autorités du bienfait de cette acquisition. Kraft fermera tout de même l’usine, qui employait 400 personnes, en janvier 2011, transférant sa production en Pologne. Suite à cette mésaventure, The Takeover Panel, organisme en charge de superviser les offres publiques d’achat, a modifié la loi britannique en 2011. L’acheteur potentiel doit dorénavant être plus transparent concernant les motivations de la prise de contrôle et les intentions suite à l’achat, particulièrement pour ce qui est des suppressions d’emplois65 et de la localisation du siège social.
L’arrivée au pouvoir de Theresa May conforte cette volonté d’être plus prudent : la Première ministre avait critiqué le rachat du fabricant de chocolat Cadbury par Kraft en 2010, accusant le groupe américain de n’avoir pas respecté sa promesse de maintenir ouverte une usine dans le Sud-Ouest de l’Angleterre. Sa nouvelle stratégie industrielle met l’accent sur la défense du tissu industriel contre des offensives financières étrangères. Certains secteurs stratégiques pourront ainsi faire l’objet d’une attention plus forte du gouvernement britannique avant de tomber dans les mains d’investisseurs étrangers.
La polarisation des firmes étrangères sur quelques territoires et secteurs
James Selka, président de la Manufacturing Technologies Association, rappelle que « les entreprises étrangères souhaitent profiter des zones où des compétences-clés sont disponibles, et toutes les régions ou même les bassins d’emploi n’ont pas le même pouvoir d’attractivité ». Si l’action des gouvernements successifs pour attirer des IDE dans le Northern Powerhouse et le Midlands Engine, via par exemple des programmes de financement de nouvelles infrastructures, semble porter ses fruits, Louise Dalingwater, maître de conférences à l’université de la Sorbonne Nouvelle, souligne que « ces mesures sont focalisées sur les grandes villes et moins sur les périphéries. Dans ce contexte, les bassins d’emploi en déclin ne peuvent attirer des entreprises nationales ou étrangères car ils manquent de main-d’œuvre qualifiée, d’un tissu local attractif en termes de loisirs, d’universités de renom, d’infrastructures de transports, etc. ». L’enquête d’EY, en 2016, qui permet de sonder les investisseurs sur leurs motivations à choisir une région britannique plutôt qu’une autre, confirme ces propos. Les compétences et la qualité des infrastructures sont les deux premiers moteurs de la décision d’investissement (respectivement 28 % et 26 % des entreprises interrogées). Vient ensuite la disponibilité des partenaires commerciaux et des fournisseurs (22 % des répondants).
Ceci révèle toute la difficulté à mener de front des politiques industrielle et d’aménagement du territoire efficaces. La littérature économique montre que la tendance générale des capitaux étrangers est de choisir logiquement les localisations les « plus sûres », les régions capitales ou encore les pôles dotés d’un écosystème déjà dynamique. Cela renforce naturellement les inégalités spatiales au profit des territoires qui bénéficient d’une attractivité cumulative. Ces disparités s’accentuent tout particulièrement du fait de la polarisation des firmes étrangères sur quelques secteurs stratégiques et donc sur quelques zones bien déterminées. Dans son rapport évaluant la stratégie industrielle portée par Theresa May, la Chambre des communes attirait l’attention sur cette situation. Selon elle, les politiques menées depuis 201066 ont conduit à privilégier les intérêts de grandes entreprises et des opérateurs historiques des secteurs comme l’automobile et l’aérospatiale, au détriment du reste de l’écosystème. En d’autres termes, le soutien aux entreprises étrangères et aux régions les plus productives a accru le fossé avec les PMI nationales sur le territoire.
La répartition des fonds régionaux dans le Nord de l’Angleterre au profit du groupe Nissan montre à quel point les arbitrages sont complexes et consistent le plus souvent à privilégier les « gagnants » (cf. encadré 7).
Encadré 7 – Des fonds régionaux inégalement répartis : le cas du Nord
En novembre 2016, le chancelier de l’Échiquier déclare allouer 1,8 milliard de livres au « Fonds de croissance local » à travers le pays : 556 millions de livres pour le Northern Powerhouse, 492 millions de livres pour Londres et le Sud-Est, 392 millions de livres pour les Midlands, 191 millions de livres pour le Sud-Ouest et 151 millions de livres pour l’Est.
En janvier 2017, Theresa May précisait la répartition de ce Fonds de croissance locale entre les 11 partenariats locaux d’entreprise (LEP) du Northern Powerhouse. Ces LEP sont des partenariats volontaires entre les autorités locales et les entreprises, créés en 2011 par le Département des affaires, de l’innovation et des compétences afin de déterminer les priorités économiques locales ainsi que de favoriser la croissance économique et la création d’emplois dans les régions.
Le Nord-Est se voit ainsi attribuer une enveloppe financière de 49,7 millions de livres, dont la part du lion de 42,2 millions de livres a été affectée à un seul projet : le développement de l’International Advanced Manufacturing Park (IAMP), se situant à côté de l’usine de Nissan. Ceci fait suite à l’annonce récente de Nissan de fabriquer, à partir de 2020, ses nouveaux modèles Qashqai et X-Trail sur son site de Sunderland.
Le parc dédié aux industries de haute technologie devrait attirer plus de 5 000 emplois et apporter plus de 300 millions de dollars d’investissements du secteur privé au cours de la prochaine décennie. Nissan ne sera pas le seul bénéficiaire ; le financement de l’IAMP répond à la volonté du gouvernement britannique d’engager l’entreprise à accroître l’utilisation des entreprises britanniques dans la chaîne d’approvisionnement automobile.
Cet investissement ne laisse donc que 7,5 millions de livres pour le reste de la zone. Les représentants du LEP du Nord-Est considèrent que la répartition des financements provenant du Fonds de croissance locale est préjudiciable au plan stratégique de la région, qui visait à créer 100 000 emplois au cours d’une décennie. Le Nord-Est a le taux de chômage le plus élevé au Royaume-Uni. L’enveloppe financière laisse donc très peu de marge de manœuvre pour financer une gamme de projets favorisant le développement des entreprises.
Par ailleurs, la répartition des fonds se fait également en faveur des grandes villes. Au nord, le Grand Manchester a reçu la plus importante allocation avec 130 millions de livres, soit presque le double de financement attribué à la métropole de Leeds (67,5 millions de livres). Certains observateurs locaux s’inquiètent de l’accroissement des disparités entre le Nord-Est et l’Ouest en matière d’investissement public.
Source : La Fabrique de l’industrie, d’après le Financial Times.
Études de cas : impacts géographiques et sectoriels des IDE
Nous avons choisi de nous intéresser à deux études de cas. La première porte sur les Midlands de l’Ouest. Cette région, plus fortement touchée par la désindustrialisation que les autres territoires britanniques, semble aujourd’hui voir son secteur industriel renaître, notamment grâce à l’implantation progressive d’investisseurs étrangers. Le cas des Midlands de l’Ouest illustre bien comment les IDE peuvent devenir un vecteur de la revitalisation d’un territoire. Il montre également que l’attraction d’investisseurs étrangers ne peut à elle seule résorber des années de désindustrialisation et de désengagement des pouvoirs publics. Les Midlands de l’Ouest ont par ailleurs été placés au cœur de la nouvelle stratégie industrielle portée par Theresa May depuis 2016 (cf. chapitre 1, encadré 4). Cette région mérite, à ce titre, une attention toute particulière pour évaluer les défis à venir.
La seconde étude de cas porte sur l’industrie automobile britannique. Après une longue période de déclin, ce secteur a renoué avec des performances exceptionnelles. Les investisseurs étrangers qui réalisent plus de 80 % de la valeur ajoutée du secteur ont permis de réorienter la production vers le haut de gamme. L’exemple de Nissan à Sunderland est particulièrement emblématique de la renaissance de l’industrie automobile au Royaume-Uni. Cette usine, mise en service en 1986, est aujourd’hui l’une des plus compétitives au monde. Elle a permis de revitaliser la région du Nord-Est de l’Angleterre en créant des emplois directs et indirects (création d’un tissu de fournisseurs, développement de centres de recherche et de formation, etc.) et contribue au dynamisme économique du pays.
De l’atelier du monde à l’émergence d’une industrie de pointe : quel rôle des IDE dans les Midlands de l’Ouest ?
Les signes de rebond de l’industrie
Selon le cabinet EY, les régions composant le Northern Powerhouse et les Midlands Engine ont vu le nombre de leurs projets d’investissement industriel plus que doubler sur la dernière décennie, tandis que celui d’autres territoires britanniques n’a quasiment pas évolué. Parmi ces régions, les Midlands de l’Ouest se distinguent : selon les données du cabinet EY, 165 projets industriels ont vu le jour depuis 2009, générant 21 724 emplois (soit respectivement 15,6 % et 26,3 % du total du Royaume-Uni).
L’afflux massif d’investisseurs étrangers dans les Midlands de l’Ouest semble avoir revitalisé l’économie de la région. Il y a quelques décennies, la région était qualifiée « d’atelier du monde ». Spécialisée historiquement dans les secteurs de l’automobile, de l’ingénierie, de la machine-outil, de la céramique et des composants, elle a été particulièrement frappée par la désindustrialisation, et ce jusqu’à une période récente. Parmi les régions britanniques, les Midlands de l’Ouest ont en effet connu le recul de l’industrie manufacturière le plus important entre 2000 et 2009 : le PIB manufacturier s’est effondré de 53,2 % contre 35,7 % en moyenne au Royaume-Uni, et plus de 200 000 emplois manufacturiers ont été détruits. Pourtant, depuis la fin de la crise de 2009, cette région montre des signes de rebond industriel. Entre 2009 et 2015, le PIB manufacturier a quasiment doublé, passant de 12,9 à 24,8 milliards d’euros (+92,4 %). Il a ainsi retrouvé les niveaux enregistrés au début des années 2000. La part de l’industrie est même remontée, passant de 10,7 % du PIB en 2009 à 13,4 % en 2015 (cf. graphique 6). Plus de 10 000 emplois ont été créés dans l’industrie manufacturière au cours de la même période.
Graphique 6 – Évolution de l’industrie manufacturière des Midlands de l’Ouest
Source : Eurostat
Aujourd’hui, les industries de pointe comme l’aéronautique, la robotique, l’électronique grand public et les télécommunications occupent une place de plus en plus importante dans l’économie régionale. Les Midlands de l’Ouest sont ainsi considérés comme un territoire à haut potentiel pour développer des produits haut de gamme et à fort contenu technologique.
Les années 2000 avaient été marquées par de nombreuses fermetures d’usines dans la région, notamment celle de MG Rover. Le rachat par Tata des marques Jaguar et Land Rover en 2008 a fortement contribué à redynamiser le territoire. Le groupe a conservé son siège social à Coventry et possède des installations d’assemblage à Birmingham (Castle Bromwich) et Solihull, une usine de production de moteurs à Wolverhampton ainsi que des centres de recherche à Whitley et à Warwick. En 2016, le constructeur a annoncé sa volonté de doubler sa production d’ici 2020, en mettant l’accent sur les véhicules électriques, ce qui pourrait, selon la presse, permettre de créer 10 000 emplois dans le pays. Dans ce cadre, il souhaite développer son centre d’ingénierie et de design à Coventry. Il a également créé le National Automotive Innovation Centre, pour disposer des compétences dont il aura besoin pour mener à bien son projet. La stratégie de JLR rejoint la volonté du gouvernement britannique de développer la production de voitures électriques afin d’en faire l’un des piliers de sa stratégie industrielle. Selon le Financial Times, ce projet nécessiterait un investissement de 450 millions de livres (530 millions d’euros) des autorités publiques, notamment pour le prolongement de routes et des lignes électriques (cf. encadré 8, p. 70).
La région des Midlands de l’Ouest accueille aujourd’hui des marques comme Aston Martin, Dennis Eagle, MG Motors, Morgan, Geely, JLR, Lear, Changan, Magna, Johnson Controls, Caterpillar et BMW ; c’est celle qui concentre le plus de fournisseurs de rangs 1 et 2 au Royaume-Uni. D’autres projets d’investissement créant chacun plus de 300 emplois ont été recensés en 2015 par EY : le chinois Geely, qui a racheté LTC en 2013 et qui est également propriétaire de Volvo, réalise son premier investissement dans la région. De même, Brose Fahrzeugteile, fabricant allemand de composants et de systèmes mécatroniques pour les portes, les sièges et le corps des véhicules, a créé une nouvelle usine dans la région.
Encadré 8 – Jaguar : une reprise emblématique
En acquérant des marques aussi célèbres que Jaguar et Land Rover, le groupe indien Tata a pris possession d’un outil industriel restructuré par Ford. Il a aussi profité d’un savoir-faire de pointe et de fortes capacités d’innovation liés à la spécialisation historique de la région, notamment dans la métallurgie.
Depuis 2009, la production dans ses trois usines situées à Castle Bromwich, Halewood et Solihull a augmenté de 240 %, JLR produit ainsi 544 401 véhicules au Royaume-Uni en 2016 (soit 30 % de la production sur le sol britannique). Les trois sites emploient aujourd’hui près de 20 000 personnes. Le constructeur a investi des milliards de livres dans la création de nouveaux produits et dans la modernisation de ses usines de production. Une localité comme Solihull a par exemple accueilli plus de 1,5 milliard de livres d’investissements de la part de Tata pour moderniser son usine. Ceci lui a permis de voir son PIB manufacturier bondir de 253 % entre 2009 et 2015. En 2014, le groupe a ouvert un nouveau centre de production de moteurs au Nord-Ouest de Birmingham, près de Wolverhampton, créant 750 postes d’ingénieurs et responsables techniques et plus de 1 000 postes d’ouvriers. Birmingham, le grand centre urbain et universitaire des Midlands de l’Ouest, a pour sa part bénéficié à la fois des emplois créés dans cette usine et des nombreux postes liés aux activités de recherche. Son PIB manufacturier a progressé de 61,7 % et 16 700 emplois ont été créés dans le secteur depuis la fin de la crise.
Avec le rachat par Tata de Jaguar et Land Rover, le secteur est aujourd’hui largement tributaire de la production de véhicules de luxe. Une chaîne de fournisseurs spécialisés dans des technologies liées à cette niche s’est développée. JLR a mécaniquement permis l’essor d’un tissu de sous-traitants réalisant des éléments de voitures, du moulage aux pièces électroniques. Un exemple illustrant ce phénomène est l’implantation de l’américain BorgWarner près de Bradford pour fournir des turbocompresseurs à l’usine de moteurs de Wolverhampton.
Les investissements de JLR dans les usines de la marque et la stratégie orientée vers l’innovation ont nourri de nombreuses collaborations avec les universités de la région. Un exemple emblématique de ces collaborations est le lancement du National Automotive Innovation Centre (NAIC) en 2016. Ce projet, d’un coût de 160 millions de livres (189 millions d’euros), est financé à hauteur de 50 millions de livres (59 millions d’euros) par le constructeur britannique. Les fonds restants seront apportés par le Centre technique européen de sa maison-mère, Tata Motors, le Warwick Manufacturing Group et le gouvernement britannique. Ce campus développera de nouvelles technologies, notamment pour les véhicules électriques et les véhicules connectés. Il sera situé dans l’université de Warwick et emploiera un millier de chercheurs et d’ingénieurs. Les équipes de R&D académiques et industrielles travailleront ensemble pour développer des technologies et des procédés innovants. Le campus aura pour vocation de pallier la pénurie de talents en formant du personnel qualifié en R&D pour l’écosystème de fournisseurs. Il s’attachera également à développer les compétences des ingénieurs futurs.
La région peut aussi compter sur l’implantation du géant Rolls-Royce, deuxième fabricant mondial de moteurs d’avions, basé à Derby dans les Midlands de l’Est. Avec deux hubs mondiaux, les Midlands accueillent un quart des industries aéronautiques présentes au Royaume-Uni, qui emploient 40 000 personnes. Le hub des Midlands de l’Ouest, moins important que son voisin de l’Est, est spécialisé dans les systèmes électromécaniques pour le contrôle des pièces mobiles. Il est organisé autour des entreprises Aero Engine Controls, Meggitt, Moog et UTC Aerospace Systems dans les régions de Birmingham, Wolverhampton et Coventry.
Le développement de clusters dans l’automobile et l’aérospatial a notamment permis à la région de voir ses exportations croître de 55,9 % entre 2010 et 2015 et de se positionner sur les techniques de fabrication du futur. Les Midlands de l’Ouest sont d’ailleurs la seule région au Royaume-Uni à afficher un excédent commercial avec la Chine.
La relance du secteur manufacturier dans les Midlands de l’Ouest contribue progressivement à diversifier le tissu économique du territoire. On observe le développement d’une offre de services qui viennent en appui des activités industrielles (juristes, études de marché et spécialistes du logiciel, etc.). À titre d’exemple, 42 % des professionnels liés aux activités scientifiques et techniques dans les Midlands de l’Ouest servent le secteur manufacturier.
Plusieurs facteurs à l’origine de la renaissance du secteur industriel
Malgré la désindustrialisation, les Midlands de l’Ouest ont su conserver une main-d’œuvre qualifiée dans des domaines industriels pointus. La région dispose de deux universités de classe mondiale, Warwick et Birmingham. Elle a aussi une forte culture de formation par apprentissage, liée à son passé industriel, et d’importantes compétences en ingénierie mécanique qui lui permettent d’attirer de nombreuses activités de R&D. La région peut également compter sur une longue tradition de collaboration entre le monde universitaire et celui de l’industrie. Le Warwick Manufacturing Group, créé en 1980 pour soutenir la revitalisation du secteur industriel, en est un exemple parlant. Son fondateur, le professeur indien Kumar Bhattacharyya, a convaincu les acteurs locaux de lui accorder des fonds pour construire un centre où les universitaires pourraient collaborer avec des industriels pour le développement de leurs produits dans l’aéronautique et l’automobile. Le WMG a été un précurseur dans la conception de programmes de formation en collaboration étroite avec des industriels locaux, permettant le maintien sur le territoire de générations de cadres et de techniciens. Aujourd’hui, le Warwick Manufacturing Group est un acteur majeur de la recherche en ingénierie et technologie du futur et fait à ce titre partie du National Automotive Innovation Centre.
Par ailleurs, il faut aussi souligner le rôle joué par les structures de promotion des IDE. Dans les Midlands, les autorités locales ont vu, depuis 2010, l’État leur transférer budget et compétences : elles n’ont pas ménagé leurs efforts pour valoriser les atouts de la région auprès des entreprises étrangères. Elles ont su tisser des liens étroits avec l’ensemble des acteurs du territoire afin d’attirer et de retenir ces investisseurs étrangers. À titre d’exemple, l’université de Birmingham a créé City REDI, un institut d’analyse chargé d’identifier les secteurs de croissance de la région et de guider le conseil municipal dans ses choix pour cibler les entreprises étrangères. Ces structures d’appui veillent également à orienter les investisseurs vers des sites d’implantation qui contribueront le plus au développement de l’économie locale. En collaboration étroite avec les acteurs du secteur privé, la ville de Birmingham a par exemple défini six zones économiques prioritaires. L’une d’elles abrite notamment l’Advanced Manufacturing Hub. Ce site a été sélectionné pour capitaliser sur le savoir-faire de la région et la présence de grands comptes mondiaux dans l’automobile et l’aéronautique. Avec la création de ces zones franches, la municipalité espère attirer 2,1 milliards d’euros d’investissement et créer 50 000 emplois.
Une relation complexe entre les IDE et le développement économique local
Les IDE ont joué un rôle majeur dans la relance du secteur manufacturier dans les Midlands de l’Ouest. Ils ont permis de revitaliser en partie le territoire, et par conséquent de renforcer son attractivité auprès d’autres entreprises internationales et nationales. Toutefois, les effets sur l’emploi sont contrastés. Les chiffres de l’Office for National Statistics (ONS) montrent que ces transformations ont permis de faire passer le taux de chômage des Midlands de l’Ouest de 9,7 % en 2009 à 5,7 % en 2016. Ce dernier reste cependant supérieur à la moyenne britannique, à 4,9 % en 2016, témoignant de la persistance des disparités au sein du territoire. Celles-ci sont même visibles entre les sept métropoles urbaines67 des Midlands de l’Ouest. Au total, elles affichent un taux de chômage de 9,3 % en 2016, en raison de facteurs multiples.
Birmingham affiche les moins bonnes performances des Midlands de l’Ouest avec un taux de chômage de 10,7 % en 2016. Principales causes évoquées : 40 % de la population a moins de 25 ans, et une forte proportion de la population en âge de travailler ne détient pas les compétences nécessaires pour répondre aux exigences des employeurs. Elle est suivie par la ville de Wolverhampton (10,5 % de chômage) où l’investissement dans l’enseignement supérieur n’a guère contribué à affecter le chômage chez les jeunes. Les districts de Sandwell et le voisin Dudley affichent quant à eux un taux de chômage respectif de 7,2 % et 6,4 %, reflétant des décennies de manque d’investissements privés ou de soutien gouvernemental.
Les acteurs locaux et think tanks68 soulignent que la région des Midlands de l’Ouest et ses métropoles urbaines ont été, pendant des années, ignorées des pouvoirs publics. Selon eux, les gouvernements précédents ont concentré leurs moyens pour faire de Londres une capitale financière mondiale et de Manchester une « puissance centrale du Nord ». Dans les Midlands de l’Ouest, la présence d’entreprises étrangères a certes permis la création d’écosystèmes dynamiques, et la région a su conserver des emplois industriels qualifiés dans quelques domaines aux savoir-faire pointus. Mais depuis la reprise du marché du travail en 2011, 28 % des emplois créés dans la région sont liés à des emplois précaires : des emplois indépendants peu rémunérés, des contrats « zéro heure », etc. Les travailleurs des Midlands de l’Ouest gagnent environ 900 livres de moins en 2016 qu’en 2008.
Marqué par des années de désindustrialisation, ce territoire doit relever plusieurs défis. La région a la plus forte proportion de personnes sans qualification (13 %, soit un habitant sur huit). L’image de ce territoire industriel dissuade également les jeunes et particulièrement les plus qualifiés de venir travailler dans la région. Ainsi, 44,6 % des jeunes diplômés en poste six mois après leurs études le sont hors de la région. Des tensions se font ainsi sentir sur le marché du travail : 250 000 emplois devraient être créés d’ici à 2025 et la main-d’œuvre locale n’est, pour l’heure, pas suffisamment diplômée pour répondre aux besoins des entreprises, qui vont chercher à Londres et en Europe les ingénieurs et les cadres dont elles ont besoin. Par ailleurs, le déclin industriel a pesé sur l’esprit d’entreprise et le dynamisme économique. En 2015, le nombre d’entreprises créées pour 100 000 personnes à Londres était deux fois supérieur à celui enregistré dans les Midlands.
Selon Richard Harris, « pour capter l’ensemble des retombées positives des IDE, il convient de veiller à développer les capacités d’absorption des entreprises nationales. Cela revient à promouvoir simultanément les incitations à l’investissement des firmes étrangères et à améliorer les conditions d’apprentissage des savoirs et des technologies des entreprises nationales. Or le capital humain, à savoir tous les aspects liés à l’instruction, à l’éducation, à la formation et à la santé des individus, est considéré comme l’élément central de la capacité d’absorption et est le point faible de beaucoup de territoires industriels britanniques. » Le rôle des pouvoirs publics nationaux et régionaux apparaît ainsi comme essentiel pour conjuguer une politique d’attractivité des IDE et une politique d’aménagement favorisant le développement endogène du territoire.
De nombreuses mesures (investissement dans la formation secondaire et supérieure, développement de l’apprentissage)69 ont été prises pour renforcer les compétences dans la région, mais il faudra du temps pour que les stratégies portées par le gouvernement se traduisent par une croissance réelle du territoire dans son ensemble. De même, la construction de la ligne à grande vitesse HS2 favorisera certes la mobilité des travailleurs, mais elle ne verra le jour qu’en 2026. À moyen terme, les autorités locales souhaitent une plus forte coordination avec les politiques économiques nationales : le West Midlands Combined Authority (WMCA, en charge des sept métropoles urbaines de la région), rappelle en effet que « la volonté du gouvernement de faire des Midlands une “région monde” est un objectif extrêmement louable mais ne pourra être atteinte si elle repose uniquement sur les autorités déconcentrées. » Les autorités locales plaident en faveur d’une stratégie industrielle plus agressive, avec une augmentation des moyens accordés pour soutenir le développement des technologies du futur et donc la création d’emplois qualifiés qui stimuleront la productivité et produiront des retombées pour les non-diplômés locaux. Ces politiques de développement économique et d’aménagement du territoire sont essentielles pour inscrire le territoire dans une dynamique vertueuse.
La contribution des IDE à la renaissance du secteur automobile
Le miracle automobile britannique
L’industrie automobile anglaise connaît depuis la fin de la crise financière une renaissance spectaculaire. Comme le montre le graphique 7, le secteur a connu une évolution semblable en France et au Royaume-Uni entre 1995 et la fin des années 2000. L’année 2011 marque une rupture avec l’envolée de l’industrie automobile outre-Manche : la valeur ajoutée brute a plus que doublé (+111,8 %) entre 2011 et 2015, alors qu’elle est restée quasi stable en France. Selon l’Association britannique des constructeurs et des vendeurs d’automobiles (SMMT)70, le pays a produit 1,7 million de véhicules en 2016, soit son plus haut niveau depuis 17 ans. Le Royaume-Uni se positionne ainsi comme le troisième producteur de voitures au niveau européen, derrière l’Allemagne et l’Espagne. Les exportations, qui absorbent plus de 80 % de la production britannique, ont également atteint un niveau record en 2016 en s’établissant à 48 milliards d’euros. La filière emploie 814 000 personnes et la productivité par travailleur a plus que doublé depuis 2009.
Graphique 7 – Évolution comparée de l’industrie automobile britannique et française (milliards d’euros de valeur ajoutée brute)
Source : Eurostat
Le secteur automobile est un exemple parlant du rôle majeur joué par les investisseurs étrangers au Royaume-Uni. Depuis la fermeture de MG Rover en 2005, la Grande-Bretagne ne compte presque plus de constructeurs nationaux hormis quelques petits assembleurs de roadsters (cf. encadré 9). La production repose donc essentiellement sur les constructeurs étrangers venus pour la plupart s’installer dans le pays dans les années 1980. Les entreprises sous contrôle étranger représentent ainsi 84 % de la valeur ajoutée du secteur en 201371.
Encadré 9 – Secteur automobile britannique : les acteurs en présence
Les Japonais (Nissan, Honda, Toyota)
Les constructeurs japonais, implantés en Grande-Bretagne depuis le milieu des années 1980, assurent la moitié de la production britannique. Associant la flexibilité du travail et la baisse du cours de la livre aux processus de production japonais, Nissan Sunderland, dans le Nord-Est de l’Angleterre, est l’une des usines les plus productives d’Europe. Honda et Toyota ont adopté les mêmes méthodes de production, avec une implantation proche de la mer pour faciliter la logistique.
Les Britanniques rachetés (Jaguar Land Rover, Bentley, Rolls-Royce, Mini, MG Motors, Lotus, Aston Martin, Caterham)
Les grandes signatures sont presque toutes passées sous pavillon étranger : Mini a été racheté en 1994 par BMW, Bentley a intégré Volkswagen et JLR a été repris par Tata Motors en 2008. Les groupes internationaux ont su s’appuyer sur les compétences anglaises et resserrer les modèles économiques, tout en injectant des fonds.
Les indépendants (McLaren Automotive, Morgan Motor)
McLaren est passé du statut d’artisan à celui de constructeur en série, en tirant profit de la présence en Grande-Bretagne de huit écuries de Formule 1 et d’un réseau de sous-traitants à fort potentiel technologique dans ce domaine. Morgan est le dernier constructeur automobile anglais indépendant. Créée en 1909, cette entreprise familiale produit toujours dans les Midlands de l’Ouest.
Les Américains
Les sites de Ford et General Motors sont plus anciens que les usines japonaises, mais ont connu de nombreuses restructurations : Ford a par exemple fermé dès 2013. L’usine d’assemblage de Southampton et l’atelier d’emboutissage de Dagenham, supprimant 1 400 emplois. GM a quant à lui cédé Opel (marque Opel Vauxhall au Royaume-Uni) à PSA en 2017.
Les IDE, moteurs de la réorientation du secteur vers le haut de gamme
La persistance d’une forte culture automobile, en dépit des différentes crises et des nombreuses fermetures d’usine qu’a traversées le Royaume-Uni, a été déterminante pour permettre le rebond du secteur. Elle lui a permis de conserver une main-d’œuvre de qualité, de développer une ingénierie de premier plan et des technologies de pointe. Jean-Luc Di Paola-Galloni, directeur du développement de Valeo, explique ainsi que « le secteur a su conserver des techniciens qualifiés qui ont fait, pendant les crises, le choix de la mobilité internationale ou encore de se reconvertir dans d’autres secteurs de l’économie. En période de rebond, cette main-d’œuvre a pu être mobilisée. Par ailleurs, la présence sur le territoire d’un fournisseur mondial de technologie comme le conglomérat Ricardo PLC, qui fait des tests et des recherches avancées aussi bien pour les constructeurs que pour les équipementiers, a aussi été un facteur de maintien d’une expertise forte dans le pays. Enfin, l’implication du gouvernement britannique, avec notamment la création en 2009 de l’Automotive Council, a joué un rôle majeur dans la restructuration de la filière en mettant autour de la table les industriels, les universités et les banques aux cotés des différentes agences et institutions d’aides publiques. »
Ces facteurs ont été décisifs pour attirer les investisseurs étrangers et porter leur stratégie de montée en gamme. Les entreprises étrangères ont réorienté la production vers une offre premium tournée vers l’exportation, notamment sur des marchés émergents à la demande dynamique (Chine, Russie). Elles ont pu renforcer progressivement leurs liens avec les universités et faire de plus en plus appel aux laboratoires universitaires pour leurs activités de R&D (financements de programmes de recherche, prestations plus ponctuelles telles que le redimensionnement d’une pièce ou l’amélioration d’un processus de production, etc.). Le tout est encouragé par le gouvernement via des subventions aux différents établissements et une politique d’exonération d’impôts, notamment sur les revenus de brevets72. Les dépenses privées de R&D dans le secteur automobile ont ainsi été multipliées par trois entre 2000 et 2016 et le pays est le second producteur de voitures haut de gamme en Europe en 2016.
On note que cette stratégie de différenciation et de positionnement sur le haut de gamme se poursuit avec le développement de technologies liées au « bas carbone ». Le gouvernement britannique a affiché très tôt sa volonté de faire du Royaume-Uni le leader dans la lutte contre les émissions de CO2. Il est le premier pays, en 2008, à s’engager via le Climate Change Act à réduire de 80 % son niveau d’émissions de 1990 d’ici 205073. Dans cette optique, il a multiplié les soutiens à l’industrie automobile, qui est un secteur-clé de la transition énergétique. À titre d’exemple, il a lancé un centre de recherche sur les moteurs (Advanced Propulsion Centre – APC) en 2013. Il regroupe et met en collaboration les innovateurs et les producteurs de systèmes de propulsion à faibles émissions en carbone. Il facilite les partenariats entre ceux qui ont des idées nouvelles et ceux qui peuvent les amener sur le marché. Le centre s’est engagé à financer à hauteur d’un milliard de livres les projets sur 10 ans, la moitié des fonds provenant du secteur privé, l’autre moitié du gouvernement. APC s’engage à financer les projets autour d’un consortium de trois partenaires : une entreprise qui développe la technologie (souvent une PME), un fournisseur qui l’industrialise et un client qui l’utilise dans un véhicule74. La politique britannique volontariste a permis d’attirer et de retenir des investisseurs étrangers. Des groupes comme Nissan ou Tata ont notamment noué des partenariats de long terme avec l’État et les universités afin de développer une expertise dans ce domaine. Aujourd’hui, le marché britannique des voitures à très faibles émissions est le deuxième d’Europe en termes de croissance, juste derrière l’Espagne.
Enfin, comme nous l’avons vu précédemment, le droit du travail britannique, moins contraignant qu’en France, a permis d’attirer et de retenir des investisseurs dans ce secteur fortement consommateur de main-d’œuvre.
L’avenir du secteur automobile britannique dans le contexte du Brexit
La forte dépendance de l’industrie britannique aux investisseurs étrangers suscite de nombreuses inquiétudes dans le contexte du Brexit. En effet, il faut rappeler que l’accès facile au marché européen est essentiel pour le pays dont la production automobile est aujourd’hui complètement intégrée au marché européen : plus de la moitié des exportations du secteur vont vers l’Europe en 2016. Dans ce contexte, Patrick Manon, directeur de Business France au Royaume-Uni, indique qu’« une sortie de l’UE risque de porter directement atteinte à la capacité d’exportation du pays, que ce soit sur le plan tarifaire (droits de douane), sur les normes d’homologation ou sur la libre circulation des travailleurs. »
Le Brexit a par ailleurs mis en lumière une fragilité majeure de l’industrie automobile britannique : la faiblesse de son tissu de fournisseurs. Selon les chiffres de la SMMT75, 59 % des 30 000 composants qui permettent de fabriquer une voiture au Royaume-Uni sont importés, et les deux tiers de ces importations proviennent d’Europe. Le coût du Brexit risque donc d’être élevé pour les constructeurs automobiles s’ils doivent faire face à l’instauration de barrières tarifaires. Cela conduit Jean-Luc Di Paola-Galloni à s’interroger sur la capacité du secteur à rester performant à terme. Selon lui, « le Royaume-Uni n’a pas les fondamentaux d’échelle qui lui permettent de rivaliser avec le niveau atteint par des pôles incontournables de l’automobile comme l’Espagne ou la Turquie : l’Angleterre dispose d’un faible nombre d’équipementiers de premier rang. L’importance de la chaîne d’approvisionnement locale et de sa bonne santé est essentielle pour maintenir la compétitivité à long terme du secteur. »
La presse britannique76 relève également que, sous la pression des constructeurs étrangers, le gouvernement est contraint de négocier des accords de compensation. À titre d’exemple, Carlos Ghosn, le PDG de l’alliance Renault-Nissan, a rencontré Theresa May en octobre 2016, ce qui a donné lieu à une assurance écrite par le gouvernement que la société bénéficierait des conditions commerciales qui prévalaient avant le Brexit. L’acquisition de Vauxhall par PSA en 2017 aurait donné lieu au même type d’accord. Nissan, qui avait pour sa part réussi à attirer un nombre croissant de sous-traitants autour de son usine de Sunderland et à maintenir plus d’une dizaine de milliers d’emplois dans la région, souhaite par ailleurs que le gouvernement injecte 100 à 140 millions de livres pour le développement d’un fonds de soutien à la recomposition d’une chaîne d’approvisionnement locale au Royaume-Uni. Environ 40 millions de livres devraient être utilisés pour attirer des fournisseurs dans le Nord-Est77. Ces différentes mesures de soutien, conjuguées aux réformes fiscales, risquent de peser fortement sur les finances publiques. Cette situation soulève des questions quant à la capacité du pays à retenir ces investisseurs dans le temps.
Le cas Nissan Sunderland
L’implantation de Nissan dans les années 1980 dans le Nord-Est de l’Angleterre est un exemple de réussite pour l’industrie britannique. Nissan annonce, en 1984, son intention d’effectuer un investissement « greenfield » en installant un site de production à Sunderland. L’usine a débuté sa production en 1986, elle employait alors 450 personnes. Trente ans plus tard, elle en compte plus de 7 00078. Après avoir effectué plusieurs phases d’investissements, le site qui était initialement une simple usine d’assemblage est devenu, selon la Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT), l’un des plus productifs d’Europe avec 500 000 unités produites annuellement (ce qui représente un véhicule sur trois fabriqué au Royaume-Uni). Depuis son implantation, Nissan a investi plus de 3,7 milliards de livres à Sunderland79.
Les atouts du territoire britannique
Si l’implantation de Nissan en Europe a été principalement motivée par l’accès au marché unique pour contourner les barrières tarifaires, le constructeur asiatique a aussi choisi le Nord-Est de l’Angleterre car la région offrait des infrastructures avantageuses (axes routiers, voies ferrées et port en eau profonde) facilitant l’approvisionnement en matériaux et la distribution des biens finaux80.
Nissan a pu bénéficier d’une main-d’œuvre qualifiée et inoccupée. En effet, le Nord-Est de l’Angleterre jouit d’un héritage industriel important (dans la sidérurgie et les chantiers navals). La fermeture en 1980 de la Consett Iron Company, fabrique de fer et d’acier faisant partie de la British Steel Corporation, a laissé 3 700 personnes sans emploi, et le dernier chantier naval de la région a fermé en 1988. Il y a eu 25 000 postulants pour les 450 premiers postes proposés dans l’usine81. Le constructeur automobile japonais a recruté des ouvriers qualifiés mais sans expérience du secteur pour pouvoir les former à ses propres méthodes de production82. Les managers ont, quant à eux, été recrutés sur la base de leur expérience dans le secteur automobile. Ils ont ainsi été débauchés d’entreprises comme Ford, Austin, Rover et Rolls-Royce.
Organisation du travail et productivité
Le succès de Nissan Sunderland s’explique par l’importation du savoir-faire japonais en matière d’organisation de la production et de technique de management.
Le modèle nippon, méconnu à l’époque, repose sur la production « juste à temps » pour éviter tout gaspillage et faire baisser le niveau des stocks : ce dernier a diminué de 45 % entre 2001 et 2012 dans l’usine de Sunderland83. Ces méthodes sont adoptées par les fournisseurs avec qui Nissan travaille étroitement. Nissan forme ses salariés au minimum à trois tâches différentes afin de permettre des rotations de postes. Cela permet de faciliter les remplacements, d’éviter les tâches répétitives et d’augmenter les compétences des ouvriers. Chaque ligne de production permet de fabriquer tous les modèles (Qashqai, Leaf, Note…) et styles (trois portes, cinq portes…) de voitures. Plusieurs lignes de montage tournent en parallèle, à plein régime et sans jamais s’arrêter, avec une rapidité inédite : à titre d’exemple, depuis le début de sa production en 2014, un Qashqai seconde génération est construit toutes les 62 secondes. Cette flexibilité permet à l’usine de s’adapter rapidement à la demande. On note par ailleurs que le constructeur automobile japonais a négocié lors de son implantation de ne travailler qu’avec un seul syndicat, The Amalgamated Union of Engineering Workers. Ce dernier représente tous les groupes d’employés (manuels et non-manuels) afin d’éviter les blocages et d’avoir une main-d’œuvre flexible avec des objectifs de productivité élevés84. En effet, au début des années 1980, l’industrie automobile au Royaume-Uni a été marquée par un fort taux de grève (environ dix fois plus élevé que la moyenne nationale).
L’usine de Sunderland applique également le Kaizen, une philosophie qui consiste à impliquer tous les salariés (directeurs comme ouvriers) dans une démarche d’amélioration continue. À travers ce système, les travailleurs apportent constamment de nouvelles idées et des innovations afin d’être plus efficients. Avec des salaires en moyenne plus élevés que dans la région, Nissan a un taux d’absentéisme et de turn-over extrêmement faible, respectivement 1,3 % et 2,3 %85.
Les effets d’entraînement sur le tissu de fournisseurs
Le tissu de fournisseurs présent autour de Nissan permet de maintenir plus d’une dizaine de milliers d’emplois dans la région, 28 000 au total dans tout le Royaume-Uni. Ces dernières années, un nombre croissant de sous-traitants, 33 en 2013, se sont implantés dans le site de l’usine, tout en restant des entreprises indépendantes. Par ailleurs, un groupe de travail de l’université de Sunderland, The Automotive & Manufacturing Advanced Practice, cherche à créer un réseau entre les acteurs de l’industrie automobile dans la région. Il participe aux transferts de connaissances, à la formation de la main-d’œuvre et à la relation entre fournisseurs et producteurs. Par exemple, cet institut a délivré 600 formations pour les fournisseurs de Nissan. Elles sont accréditées par la suite du label Alliance New Product Quality Procedure (ANPQP). Cette procédure créée par Nissan lui permet de s’assurer de la qualité de la chaîne de valeur. Ainsi, les fournisseurs comprennent les attentes et exigences de la multinationale à toutes les étapes de production.
Une forte mobilisation des pouvoirs publics nationaux et locaux pour capitaliser sur cette implantation
Le gouvernement britannique a mené une politique active pour attirer l’investisseur et l’inciter à continuer d’investir dans le pays et la région.
Il n’a ainsi pas hésité à revoir sa politique fiscale : en 1984, la réforme sur les taxes aux entreprises a réduit les prélèvements de 52 % à 35 %86. Cette même année, le gouvernement s’est engagé à financer à hauteur de 10 % (environ 35 millions de livres) la deuxième phase d’investissement du groupe japonais87. En effet, la première phase d’un montant de 50 millions de livres était un projet pilote et ne garantissait la création que de 450 emplois. La deuxième phase, menée en 1987, devait valider l’implantation de Nissan au Royaume-Uni. Elle a représenté un investissement de 394 millions de livres et a permis de faire passer le nombre d’employés à 2 70088. Ce phasage des aides a permis au gouvernement de s’assurer que l’investisseur étranger entraînerait davantage de créations d’emplois dans la région.
Le soutien public ne s’est pas démenti depuis. La décision d’installer à Sunderland la plus grande usine de voitures électriques d’Europe en 2010, avec la production de la Nissan Leaf, a été particulièrement favorisée par plusieurs aides publiques. Sur les 420 millions de livres du coût de l’investissement, 20,7 millions de livres ont été investis par le gouvernement britannique, sous le nom de Grant for Business Investment, et 197,3 millions de livres ont été amenés par la Banque européenne d’investissement via l’accord d’un prêt, au titre d’un soutien à la lutte contre les émissions de carbone89. En outre, le gouvernement propose depuis avril 2015 une subvention de 5 000 livres, soit 6 750 euros pour l’acquisition d’un véhicule propre dans la limite de 35 % du prix d’achat.
Dans le même temps, One North East, l’ancienne agence régionale de développement, s’est engagée à soutenir la création d’un centre d’expertise et de formation en lien avec le Gateshead College, Skills Academy for Sustainable Manufacturing, Productivity & Innovation, sur le site d’usine de Nissan. Créé en 2011, ce centre est le premier, au Royaume-Uni, à être dédié à la formation pour les activités « bas carbone » industrielles. Par ailleurs, l’agence a développé un réseau de bornes de recharge dans le Nord-Est de l’Angleterre.
L’engagement régional pour créer un écosystème autour des véhicules électriques a influencé le groupe automobile asiatique dans le choix du site de production européen de la Leaf. Cette décision a entraîné la construction d’une nouvelle installation. Nissan a en effet annoncé en 2016 qu’il produirait sa nouvelle génération de batteries pour véhicules électriques à Sunderland. Le projet permettra de préserver 300 emplois qualifiés. Il représente un investissement de 26,5 millions de livres, dont 9,7 millions de livres ont été avancés par le Advanced Propulsion Centre90. Les autres membres du projet sont le fournisseur de pièces détachées pour batteries Hyperdrive Innovation, l’institut de recherche Warwick Manufacturing Group, les universités de Warwick et de Newcastle ainsi que le cabinet de conseil Zero Carbon Futures, spécialisé dans les technologies à faibles émissions. À travers ce nouvel investissement, Nissan confirme son implication régionale à long terme dans la production de véhicules électriques en travaillant étroitement avec des partenaires locaux.
- 42 – Voir par exemple : Harris (2009) ; Girma, Greenaway, Wakelin (2001) ; Driffield et al. (2012) ; Fontagné, Toubal (2010).
- 43 – Voir par exemple : Kumar, Pradhan (2002); OCDE (2008).
- 44 – Voir en annexe la méthodologie utilisée par EY.
- 45 – Voir annexe 2 ; les données d’EY ne sont pas comparables avec celles de l’ONS (tableau 13). Dans le tableau 13, on parle de stock d’IDE, sachant que le cabinet EY recense à une date « t » les annonces de décisions d’investissements (un flux). De plus, les projets industriels sont ceux qui sont liés stricto sensu à la fabrication (certains projets peuvent donc être liés à une activité industrielle, comme le numérique, mais être comptabilisés dans d’autres catégories).
- 46 – Business France attribue cet écart en termes de création d’emplois industriels à la méthodologie utilisée par EY (voir annexe 1).
- 47 – Fontagné, Toubal (2010).
- 48 – Commission européenne (2013).
- 49 – Bloom et al. (2007).
- 50 – On observe dans ce graphique que les firmes multinationales françaises affichent de moins bonnes performances en termes de pratiques de management que celles de leurs principaux concurrents. France stratégie (2016), qui compare les performances de l’ensemble des entreprises françaises à celles de leurs homologues étrangères, évoque notamment parmi les raisons expliquant cet écart des facteurs d’ordre culturel : la mauvaise qualité des relations sociales et l’incapacité à se faire confiance limiteraient fortement les possibilités de coopération et donc la mise en œuvre de meilleures pratiques managériales.
- 51 – Rajan, Zingales (1998).
- 52 – Toubal, Trannoy (2016).
- 53 – Dhingra et al. (2016).
- 54 – DGE, DGRI (2016).
- 55 – Dowling (2015).
- 56 – EY (2017).
- 57 – Charrel (2016).
- 58 – Business France (2017).
- 59 – Pain, Hubert (2002).
- 60 – National Audit Office (2003).
- 61 – Jones, Wren (2008).
- 62 – A partir de 1993, une partie de cette région est devenue éligible aux aides liées aux zones assistées.
- 63 – Taylor (2002).
- 64 – BBC News (2006), BBC News (2007), Bailoni (2011).
- 65 – Morris (2014).
- 66 – Pour rappel : le soutien à onze filières stratégiques.
- 67 – Ce territoire renvoie à ce que les urbanistes appellent depuis les années 1950 la city-region c’est-à-dire une région et son arrière-pays, disposant souvent d’une administration partagée. En règle générale, il s’agit d’une ville, d’une agglomération ou d’une zone urbaine avec plusieurs districts administratifs, mais partageant des ressources comme un quartier central des affaires, du marché du travail et des transports, de sorte qu’il fonctionne comme une entité unique. Dans les Midlands de l’Ouest, les autorités combinées des Midlands de l’Ouest (West Midlands Combined Authority, WMCA) regroupent les sept métropoles urbaines de la région ; elles ont signé un accord de dévolution avec le gouvernement britannique pour définir les politiques de développement économique, de services publics et d’aménagement.
- 68 – D’Arcy (2016).
- 69 – Department for Communities and Local Government (2017).
- 70 – Society of Motor Manufacturers and Traders (2017).
- 71 – Office for National Statistics (2015).
- 72 – Voir page 56.
- 73 – Voir le Climate Change Act voté en 2008.
- 74 – Site officiel de l’Advanced Propulsion Centre UK.
- 75 – Society of Motor Manufacturers and Traders, op. cit ., p. 25.
- 76 – Campbell (2017).
- 77 – Campbell, Inagaki (2017).
- 78 – Society of Motor Manufacturers and Traders, KPMG (2014).
- 79 – Site officiel de Nissan.
- 80 – A noter également, le prix du site d’implantation a été estimé en tant que terrain agricole, c’est-à-dire sous-estimé, afin de le rendre plus attractif pour Nissan.
- 81 – Lohr (1987).
- 82 – Conte-Helm (2012).
- 83 – Szwejczewski, Jones (2013).
- 84 – Krieger (1999).
- 85 – Ducamp (2013).
- 86 – Devereux (1988).
- 87 – Discours du secrétaire d’État pour le commerce et l’industrie (N. Tebbit), 1er février 1984.
- 88 – Site officiel de Nissan.
- 89 – Willis (2011).
- 90 – Site officiel de Nissan.
Une expérience française d’accueil d’investissements étrangers : Toyota à Valenciennes – COMMENTAIRE
Ce texte a été réalisé à partir d’un entretien avec M. Régis Dormoy, ex-directeur général adjoint du pôle Economie & emploi, Valenciennes Métropole. Des éléments externes ont été ajoutés à cet entretien.
L’implantation de Toyota à Valenciennes
Au début des années 1990, Toyota annonce qu’il souhaite s’implanter sur le marché européen pour produire une gamme de petits véhicules. Ce choix représente un revirement de stratégie pour le constructeur asiatique, qui avait jusqu’à présent misé sur la production de véhicules à forte valeur ajoutée. En 1995, la direction de Toyota est encore divisée sur la localisation de la nouvelle usine du groupe. Avec son marché national faisant la part belle à ce type de véhicule (Clio, etc.), la France dispose d’un avantage par rapport à ses voisins européens pour attirer cet investisseur. Valenciennes n’est toutefois qu’une ville candidate parmi 70 autres sites en Europe. L’Angleterre et la Pologne semblent au départ emporter les faveurs du groupe asiatique. Finalement, en 1998, Toyota portera son choix sur Onnaing, dans la banlieue de Valenciennes. Trois ans plus tard, Toyota Motor Manufacturing France (TMMF) démarre la production en France de la Yaris, une petite voiture particulièrement adaptée au marché européen.
L’arrivée du constructeur japonais a servi de catalyseur au développement régional, et Toyota est aujourd’hui le premier employeur industriel du Valenciennois. Depuis une décennie, la ville a entamé une modernisation urbaine et se veut à la pointe de l’innovation en matière de transports durables. Fort de la présence de grandes entreprises, elle a développé de nombreuses formations en technologie, en ingénierie et dans le numérique.
Les conditions de l’implantation : une forte mobilisation des acteurs nationaux et locaux
La décision de Toyota de s’implanter à Onnaing, au nord de Valenciennes, est très fortement liée à la mobilisation de l’État, des acteurs locaux (Chambre de commerce et d’industrie de Valenciennes, Communauté d’agglomération de Valenciennes, Conseil général du Nord, Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais, Pôle emploi, etc.) et de Jean-Louis Borloo, alors maire de Valenciennes. Ces derniers ont collaboré de façon très étroite afin de répondre aux attentes du groupe japonais.
Pour les pouvoirs publics, le projet Toyota représentait à l’époque un enjeu majeur à double titre : d’une part, il s’agissait de revitaliser un territoire très marqué par le déclin d’activités industrielles traditionnelles. La région des Hauts-de-France91, qui vivait jusque dans les années 1970 de la sidérurgie, des mines et du textile, avait en effet été fortement touchée par la désindustrialisation. D’autre part, la renommée de cet investisseur, alors premier constructeur automobile japonais et troisième constructeur mondial, était considérée comme un moyen d’attirer des membres de la communauté d’affaires japonaise ainsi que d’autres investisseurs internationaux.
Les attentes de retombées économiques se sont traduites par la mise en place d’une organisation spécifique des services de l’État. Pour la première fois, le gouvernement a nommé en 1998 un « préfet Toyota », qui avait pour unique dossier l’accompagnement de l’entreprise japonaise dans ses démarches administratives. Cette initiative a permis de respecter le délai de 18 mois fixé par la direction du groupe pour créer l’usine92.
D’autres facteurs propres à la région ont influencé la décision du constructeur japonais. La région des Hauts-de-France est dotée d’excellentes infrastructures tant routières et ferroviaires que fluviales, permettant de distribuer les produits très facilement dans les pays limitrophes. Autre atout : la présence d’un écosystème de fournisseurs spécialisés dans la fabrication de moyens de transports. L’implantation de groupes comme Renault, PSA, Bombardier et Alstom garantissait à Toyota la proximité directe de PME spécialistes de mécanique liée à l’automobile, d’une main-d’œuvre qualifiée et de filières de formation à tous niveaux.
Des aides ont par ailleurs été accordées, mais il est intéressant de constater qu’elles n’ont pas été le critère déterminant pour les Japonais : les autres sites en compétition leur offraient l’équivalent, voire davantage.
Impacts sur le territoire : des effets en plusieurs temps
L’implantation du groupe a permis dès sa création de générer 1 000 emplois directs dans l’automobile. Les Hauts-de-France ont été le premier bénéficiaire de ce recrutement massif. Soutenu financièrement par les pouvoirs publics (340 millions de francs sur cinq ans), le groupe Toyota s’était engagé à y recruter au minimum 75 % de son personnel. La région a finalement fourni en 2001 plus de 90 % des salariés : les deux tiers des cadres et 92 % des opérateurs. Selon le préfet Laurent Fiscus93, près de 40 % des recrues étaient d’anciens demandeurs d’emploi, 200 d’entre eux étaient en situation difficile (chômeurs de longue durée, RMIstes), et 30 % occupaient auparavant un emploi précaire. La construction de l’usine a par ailleurs apporté un important volume d’activité temporaire dans le BTP.
Dans un premier temps toutefois, l’ensemble du personnel d’encadrement avait été envoyé du Japon. Des programmes de logement avaient aussi été mis en place avant les années 2000 pour accueillir les managers et les cadres japonais. La région avait même créé des classes en anglais pour accueillir leurs enfants. En termes de sourcing, la direction du groupe avait également fait le choix de faire venir des entreprises sœurs ou filles du Japon.
Presque vingt ans plus tard, le constructeur japonais a développé des interactions très fortes avec le territoire. Régis Dormoy constate que le système est beaucoup plus imbriqué : le groupe a progressivement formé des cadres locaux et, depuis le 1er janvier 2017, le président de TMMF est français.
Toyota a également fait appel de manière croissante à des sous-traitants français. En 2012, la Yaris s’est même vu décerner le label Origine France Garantie par l’organisme certificateur Bureau Veritas, car 54 % de la valeur ajoutée de ce modèle provient de France94. TMMF est aussi engagé dans l’écosystème local à travers son implication dans l’antenne du pôle de compétitivité « i-Trans », ses liens avec les universités locales et les laboratoires de recherche sur le transport terrestre, etc. Tout ceci a permis de renforcer la filière automobile régionale : les Hauts-de-France sont, en 2016, la première région française en production de véhicules, la deuxième en termes d’effectifs.
Une implantation qui ne résout pas toutes les difficultés du territoire
Les effets de cet investissement sur l’emploi ont été importants : en 2016, Toyota emploie 4 000 personnes dont 3 000 en CDI. Le groupe est le premier employeur industriel du Valenciennois (sur un bassin d’emplois de 100 000 personnes). Toutefois, le taux de chômage du territoire reste très élevé (15 %), au-dessus de celui de la région (12 %) et du taux national (10 %).
Régis Dormoy explique cette situation par plusieurs facteurs : « On retrouve en premier lieu l’héritage industriel d’un territoire qui a connu le triple choc de la crise des mines95, de la sidérurgie et du textile. Le déclin de ces industries reposant sur une main-d’œuvre difficile à reconvertir, du fait du manque de qualifications, explique que l’implantation de Toyota n’ait pu, à elle seule, redonner un emploi à tous. Une partie de la population ne disposait pas de compétences de base et ne bénéficiait pas d’une espérance de vie très longue du fait de conditions de travail préalables difficiles. » Il ajoute que « pendant des décennies, les politiques de gestion des différentes crises ont découragé certains individus de retrouver un emploi : il y a eu une volonté de prendre en charge le coût social lié aux fermetures de sites industriels. À titre d’exemple, comme le prix du charbon et de l’acier était devenu trop élevé par rapport aux prix mondiaux, l’État et les entreprises ont fermé les sites, et l’État a compensé par des prestations ce qu’il ne donnait pas au soutien du coût de production de l’acier et du charbon. Ceci explique en grande partie que le territoire soit constitué par une population qui, pendant longtemps, n’a eu ni les qualifications ni les incitations financières à retrouver un emploi. »
Le territoire fait ainsi face à un paradoxe : parallèlement à ce niveau de chômage élevé, de nombreuses entreprises – dont Toyota – éprouvent des difficultés de recrutement. La particularité de Toyota consiste à proposer un recrutement qui ne repose ni sur le diplôme, ni sur l’expérience. Les candidats doivent passer des tests en situation pour vérifier leurs capacités d’adaptation et leurs aptitudes. Ensuite, chaque nouvelle recrue suit une formation adaptée de trois à quatre semaines avant la prise de poste définitive. En dépit de cette politique, le constructeur japonais est contraint d’effectuer des recrutements en dehors du bassin d’emploi du Valenciennois. Seul 53 % de l’effectif du site d’Onnaing vit ainsi à moins de 10 kilomètres de l’entreprise, ce qui peut poser des problèmes en termes d’organisation du travail, notamment la nuit. Régis Dormoy rappelle en effet que « les méthodes de production dans le secteur automobile ont beaucoup évolué et les attentes sont beaucoup plus exigeantes pour un opérateur. Au-delà de la qualification technique, il faut avoir un savoir-être, des notions d’anglais, etc. »
Par ailleurs, il ajoute que « l’image du constructeur japonais n’est également pas sans lien avec ces difficultés. Son implantation dans les années 1990 a été une véritable révolution culturelle dans la mesure où les méthodes d’organisation du groupe (ligne hiérarchique moins nombreuse, procédures jugées plus efficaces et donc à suivre à la lettre, etc.) étaient peu connues en France. » Ce mélange de rigidité et de souplesse a peut-être contribué à rendre le constructeur asiatique moins attractif au début de son implantation.
Quelles leçons tirer de cette implantation ?
Selon Régis Dormoy, l’arrivée de Toyota en France en 1998 est un fait marquant de l’histoire industrielle française : d’une part, c’est le premier constructeur automobile asiatique à s’installer en France et à ouvrir une unité de production. Cette implantation a contribué à introduire une philosophie et une organisation du travail très spécifiques96, une véritable révolution culturelle pour le secteur automobile. D’autre part, il faut rappeler que la France n’avait à l’époque pas la même position à l’égard des investisseurs étrangers : dans les années 1970 et 1980, il existait une très forte réticence à s’ouvrir aux implantations étrangères, car les constructeurs français avaient peur de faire face à des nouveaux concurrents sur leur territoire, avec la pression à la hausse des salaires qui pouvait en découler. Avec l’accroissement du chômage dans les années 1990, la France affiche une volonté de s’insérer davantage dans la mondialisation afin d’en tirer les bénéfices. L’ouverture aux IDE s’accélère et, dès les années 2000, on constate que les processus de production de l’industrie automobile sont beaucoup plus fragmentés. Les constructeurs européens profitent ensuite du processus d’élargissement de l’Union européenne aux pays de l’Est pour y implanter des unités de production en bénéficiant de moindres coûts97.
La décision d’implantation de Toyota pour construire des petits véhicules destinés au marché européen a été controversée. Les constructeurs français Renault et PSA ont pendant longtemps affirmé qu’il était difficile de produire une petite voiture en France, en raison des coûts trop élevés98. Le succès de la Yaris prouve qu’il est possible de produire en France et d’être rentable grâce à une nouvelle organisation des process de production et en basant la réflexion sur le coût total de production (produire en France évite des coûts de transports de réimportation). En 2016, l’usine Toyota Motor Manufacturing France a vu sa production croître de 4 %, à 237 800 unités. La direction s’est fixé pour objectif d’atteindre les 300 000 véhicules d’ici 2020.
- 91 – Issue de la fusion des régions Nord-Pas-de-Calais et Picardie.
- 92 – Régis Dormoy note qu’il existe aujourd’hui une certaine « jurisprudence Toyota », c’est-à-dire que lorsqu’un projet d’implantation dépasse une certaine taille, la ville a une procédure coordonnée avec les services de l’État.
- 93 – Jacquier (2001).
- 94 – Régi par l’association Pro France, ce label a pour objectif de donner une information claire et transparente aux consommateurs sur l’origine d’un produit ; il garantit que les produits en bénéficiant sont fabriqués en France. Deux critères cumulatifs sont nécessaires à l’obtention du label : le produit prend ses caractéristiques essentielles en France ; entre 50 % et 100 % du prix de revient unitaire de ce produit doivent être acquis en France.
- 95 – La dernière mine a fermé en 1990.
- 96 – Liker (2006).
- 97 – Bohan (2009).
- 98 – Notons la production de la Smart en Lorraine depuis 1998.
Pourquoi et comment attirer des centres de décision ? – COMMENTAIRE
par Farid Toubal, conseiller scientifique au CEPII et professeur d’économie à l’ENS de Paris-Saclay
L’attractivité de la France et du Royaume-Uni pour les centres de décision des entreprises étrangères
Ces dernières décennies ont été les témoins d’une forte intégration des économies au travers du commerce et de l’investissement. Cette globalisation a un effet profond sur l’activité économique. Elle offre aux entreprises la possibilité de bénéficier de la division internationale du travail en séparant géographiquement les activités de production de celles des centres de décision. Un centre de décision se définit comme le lieu où sont localisées les fonctions stratégiques (direction financière, marketing, communication, R&D, etc.)99. Le centre de décision est distinct du siège social dont la localisation répond à une finalité fiscale via une holding par exemple. Néanmoins, il est compliqué d’objectiver complètement les critères permettant de bien définir les centres de décision. Selon la définition de Business France (2016), on appelle « centre de décision » une « structure interne à l’entreprise dont le dirigeant et les équipes participent aux prises de décisions stratégiques, engageant l’avenir de toute ou d’une partie de l’entreprise, notamment en matière d’investissement et d’emploi ».
La localisation des sièges sociaux et plus globalement des centres de décision fait aujourd’hui l’objet d’une vive concurrence entre les États. Il s’agit en effet d’activités à forte valeur ajoutée, dont on espère des effets d’entraînement importants pour l’économie locale et la demande de services qualifiés (conseil, audit, services bancaires).
Dans une note récente du Conseil d’analyse économique coécrite avec Alain Trannoy100 nous analysons la localisation de près de 285 736 centres de décision étrangers en Europe et tentons d’identifier les facteurs pour les attirer.
Gains économiques liés à l’implantation de centres de décision
La localisation d’un centre de décision permet de nombreux gains potentiels. D’une part, elle stimule l’activité économique puisque cette localisation entraîne des emplois induits dans les services à haute valeur ajoutée (avocats, conseil, audit, etc.) et dans les services à la personne (garde d’enfants, alimentation, etc.). Une étude de Moretti (2010)101 menée sur les États-Unis montre que la création d’un emploi qualifié supplémentaire entraîne en moyenne la création de 2,5 emplois locaux. Appliquée aux autres pays, l’ampleur de cet « effet création » est bien entendu fonction de la rigidité du marché du travail. D’autre part, la localisation d’un centre de décision est un enjeu pour les finances publiques nationales et locales puisqu’elle induit l’implantation de cadres de haut niveau, représentant une base taxable importante.
Facteurs d’attractivité des centres de décision
Différents enseignements peuvent être tirés de la littérature et des estimations économétriques présentées dans notre note du CAE d’avril 2016. La concentration géographique des centres de décision dans un petit nombre de grandes régions métropolitaines s’explique par plusieurs facteurs. Les entreprises localisent leurs centres de décision en fonction de la taille du marché et de la facilité d’accès à l’information au sujet de ce dernier. Ceci permet d’optimiser les coûts et de mieux apprécier les conditions d’implantation. Les grandes régions métropolitaines telles que Londres ou, dans une moindre mesure, l’Île-de-France, offrent par exemple une grande diversité d’entreprises d’intermédiation financière et de services qui rendent les opérations des centres de décision plus efficaces.
La qualité du réseau de transport (infrastructures aéroportuaires et ferroviaires) est aussi un facteur positif de localisation. Tout comme la présence d’universités de renommée mondiale (disponibilité de jeunes diplômés, coopérations possibles avec des professeurs de droit, de finance, de géopolitique…) et de lycées internationaux permettant l’accueil d’enfants non francophones.
Les coûts de congestion, la taxation des bénéfices et des salaires jouent quant à eux le rôle de forces de dispersion (Strauss-Kahn et Vives, 2009)102. Une étude d’Egger et al. (2013)103 montre que la fiscalité sur les revenus du travail est notamment un frein important à la localisation des centres de décision. En particulier, elle démontre qu’une plus grande progressivité du système de taxation du travail, corrélée à des contributions sociales et patronales élevées, limite la localisation des centres de décision car ces derniers sont plus intensifs en main-d’œuvre qualifiée.
Positionnement de la France relativement à ses partenaires et notamment au Royaume-Uni
L’exploitation de notre base de données104 nous permet de retenir quatre faits importants.
1. Un match à quatre. En 2012, l’Allemagne, la Belgique, le Royaume-Uni et la France concentraient à eux seuls 72 % des centres de décision des quinze pays européens étudiés. Entre 1980 et 2012, la France a reculé de la première à la quatrième place en termes d’attractivité des centres de décision de groupes étrangers, tandis que l’Allemagne est passée de la quatrième à la première place. La France concentre 20 % des centres de décision en 1980 et 15 % en 2012. Le Royaume-Uni, quant à lui, passe du deuxième rang en 1980 au troisième en 2012, en concentrant près de 18 % du nombre total de centres de décision. Toutefois, lorsqu’on prend en compte la taille des centres de décision, le Royaume-Uni est clairement premier sur toute la période, même si, depuis la mise en place de l’euro, Londres est devenue moins attractive que Bruxelles.
2. Une forte concentration spatiale. Près de 30% des centres de décision sont concentrés en Flandre, en Île-de-France et à Londres. La région de Londres concentre près de 8 % du nombre total de centres de décision détenus par des étrangers, et plus de 18 % en pondérant par l’actif. L’Île-de-France est légère- ment devant pour le nombre de centres, mais loin derrière (moins de 5 %) lorsque l’on pondère par l’actif : Paris attire de nombreux centres mais de taille relativement modeste. C’est la région de Bruxelles-Capitale qui tire son épingle du jeu dans les années récentes et tend à attirer de plus en plus de centres de décision.
3. Une forte concentration sectorielle. L’Île-de-France attire davantage de centres de décision dans des secteurs plus traditionnels du commerce de gros, de l’électricité, de l’hôtellerie et de l’hébergement, alors que Bruxelles et Londres se positionnent dans les activités de services plus dynamiques (conseil, promotion immobilière).
4. La France attire relativement peu d’investisseurs des pays émergents. La France attire une vaste majorité de centres de décision détenus par des investisseurs en provenance des pays développés, les États-Unis se plaçant au premier rang (15 % du nombre total, 22 % de l’actif) devant l’Allemagne et le Luxembourg. La Chine arrive seulement en 17e position. La plupart des pays émergents localisent leurs activités au Royaume-Uni.
Notre étude permet en ce sens de déterminer que la baisse d’attractivité de la France et de la région parisienne tiendrait à une spécialisation sectorielle (avec notamment l’importance du commerce de gros) et géographique (tournée vers les États-Unis et les pays européens plutôt que les pays émergents) défavorable plus qu’à un déficit d’attractivité « pure ».
Pour attirer de nouveaux centres de décision, la France doit néanmoins chercher à améliorer le climat des affaires. Aujourd’hui, le taux de l’impôt sur les sociétés est moins pénalisant que le manque de visibilité sur le front de la fiscalité. Il est donc essentiel d’accompagner les entreprises sur cet aspect. De son côté, le Royaume-Uni a bien compris cela : l’administration fiscale fournit des services aux entreprises, dans le cadre d’une véritable stratégie favorable à l’implantation des entreprises étrangères. Au niveau local, l’Île-de-France dispose encore de nombreux atouts, comme des infrastructures de transport aérien et la présence d’une main-d’œuvre qualifiée (sur ce point, Paris domine Londres, par exemple). La région doit préserver et améliorer le hub de Roissy-Charles-de-Gaulle, qui est la deuxième plateforme aéroportuaire d’Europe pour le trafic passager derrière Londres (Heathrow). L’aéroport ne dispose pas d’une liaison rapide le reliant à Paris. Il convient également d’investir dans quelques universités pour les hisser à un rang mondial et d’augmenter le nombre de lycées disposant de sections internationales.
- 99 – La définition adoptée pour l’étude économétrique combine un critère actionnarial (le fait de détenir des filiales) et un critère de consolidation comptable (le fait de pouvoir présenter des comptes consolidés). Ainsi dans nos travaux, les localisations purement fiscales via les activités de holding n’apparaissent pas comme des centres de décision. L’Irlande, le Luxembourg ou les Pays-Bas n’apparaissent quasiment pas en tant que pays de destination. Le critère de localisation considéré est donc plus économique ou stratégique que fiscal.
- 100 – Toubal, Trannoy (2016).
- 101 – Moretti (2010) .
- 102 – Strauss-Kahn, Vives (2009).
- 103 – Egger et al. (2013).
- 104 – À partir d’une base de données (Amadeus – Bureau Van Dijk) recensant 260 000 centres de décision localisés en Europe et appartenant à des groupes étrangers originaires de 78 pays, nous nous intéressons à la localisation des centres de décision détenus par des groupes étrangers dans quinze pays d’Europe, dont la France, sur la période 1980-2012.
Le Royaume-Uni restera-t-il une destination privilégiée pour les investisseurs étrangers ? – COMMENTAIRE
par Marc Lhermitte, associé chez EY
En dépit de la volatilité du contexte économique et politique mondial, les investissements directs étrangers restent l’un des moteurs persistants de l’économie européenne : le nombre d’implantations et d’extensions internationales y a même fortement augmenté entre 2015 et 2016 (+15%) créant 260 000 emplois. Le Royaume-Uni, malgré les conséquences du référendum de juin 2016, n’échappe pas à cette confiance retrouvée des entreprises internationales : avec 1 144 projets recensés par EY en 2016, il reste de loin la première destination en Europe, devant l’Allemagne et la France.
Cette dynamique ne saurait éluder les premiers signes d’infléchissement de l’attractivité britannique : la tendance 2015-2016 des projets d’implantation vers « Destination UK » n’était que de 7 %, soit la moitié du rythme européen. En un an, le nombre de projets industriels a même chuté (-13 %), tout comme le nombre de centres de R&D (-37 %).
Les investisseurs se crispent : seraient-ce les prémices d’un recul plus net à venir ? Selon l’étude EY Plan B…for Brexit parue en janvier 2017, 14 % des entreprises internationales implantées au Royaume-Uni envisageraient de transférer tout ou partie de leur activité. Le spectre de la disparition du passeport financier européen a évidemment des impacts sur les choix de l’industrie bancaire et financière, mais aussi sur les entreprises à dominante technologique ou industrielle, qu’elles soient d’origine européenne, américaine ou asiatique, qui avaient massivement choisi le Royaume-Uni comme tête de pont en Europe.
Les entreprises implantées au Royaume-Uni qui se fournissent en pièces ou composants en Europe devront revoir leurs supply chains afin d’éviter la montée des coûts et la complexification de leurs opérations. Alors que les modalités de sortie du marché unique sont encore au stade des scénarios, les décisions prennent forme dès maintenant : rester ou partir ? Où investir et recruter ? Plus généralement, comment s’organiser en Europe, face au besoin toujours plus pressant de mobilité des capitaux, des technologies et des talents ?
La France peut être au rendez-vous des investisseurs, mais la concurrence reste forte et notre pays devra se battre pour continuer à les attirer et les retenir. Il lui faudra le faire en sachant s’adapter non seulement au Brexit, mais également à un contexte mondial sans précédent : géopolitique américaine, russe ou chinoise, instabilité aux frontières de l’Europe, force des mouvements migratoires, mais aussi émergence de nouveaux modes de vie et de consommation. Et il lui faudra le faire en ouvrant franchement ses portes aux impératifs de compétitivité et d’innovation que les dirigeants interrogés par EY appellent de leurs vœux.
Conclusion
Contrairement aux idées reçues, l’industrie demeure un secteur important de l’économie britannique. Sa contribution à la richesse nationale est d’ailleurs assez proche de celle de la France. En comparaison avec notre pays toutefois, le mouvement de désindustrialisation au Royaume-Uni a été plus rapide et beaucoup plus marqué. D’aucuns ont pu en retenir l’image d’un pays « qui ne produit plus », perception renforcée par deux caractéristiques : le pays est largement porté par les services (notamment financiers), et la plupart des grands groupes nationaux ont été rachetés par des investisseurs étrangers. Cette image est d’autant plus abusive que, depuis la crise de 2008 et dans le contexte de préparation du Brexit, le pays connaît un tournant majeur dans l’orientation de ses politiques publiques. Les gouvernements de David Cameron puis de Theresa May ont mis fin à une longue tradition de « laisser-faire » en prônant un retour à une politique industrielle aux objectifs bien définis : rééquilibrer l’économie britannique au profit de l’industrie et des régions afin d’asseoir une croissance de long terme dans le pays.
La présence de longue date de nombreuses entreprises étrangères sur le territoire britannique est un atout important pour mener à bien cette nouvelle stratégie industrielle. À l’inverse de ses concurrents, le Royaume-Uni s’est en effet ouvert aux IDE dès le début des années 1980, les dirigeants britanniques étant convaincus des vertus de ces derniers pour la croissance du pays (gains en termes de créations d’emplois, de transferts de connaissances, de productivité, de recettes fiscales, etc.). La politique industrielle s’est ainsi longtemps appuyée sur l’attraction d’investisseurs étrangers pour enrayer le déclin des vieux territoires industriels. Comme le montre cette note, cette stratégie a été suffisamment efficace pour faire du Royaume-Uni la première destination européenne d’IDE et la deuxième pour les projets industriels. Cet afflux d’investissements n’a naturellement pas suffi à lui seul à enrayer un phénomène progressif de désindustrialisation, même si les IDE ciblent fréquemment les grandes entreprises industrielles qui, au passage, améliorent généralement leur performance.
La crise financière de 2008 a posé aux Britanniques une difficulté d’une ampleur et d’une brutalité inédites. La mobilisation des pouvoirs publics a été très forte pour capitaliser sur ces implantations étrangères et les inciter à investir davantage dans le territoire. Le gouvernement n’a par exemple pas hésité à revoir sa politique fiscale pour soutenir notamment le développement de la R&D. Les IDE ont progressivement permis à certains secteurs comme l’automobile de réorienter avec succès leur production vers des activités à plus forte valeur ajoutée, dans un contexte de flexibilité sociale sur laquelle le pays a partiellement fondé sa croissance. De même, certaines régions comme les Midlands de l’Ouest sont, depuis, entrées dans une phrase de réindustrialisation.
La politique à la fois volontariste et pragmatique des autorités, tant nationales que locales, a donc obtenu un succès certain. À partir de 2011, les mesures d’austérité, couplées à une flexibilisation accrue du marché du travail, ont également permis une reprise de l’emploi manufacturier. Certes, celle-ci reste modeste, mais elle tranche avec les contre-performances affichées par notre pays qui continue à connaître des destructions d’emplois. D’ailleurs, à montant équivalent, les IDE engendrent davantage d’emplois au Royaume-Uni qu’en France. Il faut toutefois préciser que ces emplois créés outre-Manche ne découlent pas de la montée en gamme observable pour certains secteurs : ce sont des emplois peu qualifiés, créés dans des secteurs peu intensifs en technologie.
L’étude du cas britannique illustre également très clairement que l’attraction d’IDE est une condition nécessaire mais non suffisante au développement économique d’un territoire. En effet, si la principale motivation des investisseurs étrangers reste l’accès à un grand marché, la tendance générale de ces derniers est de choisir logiquement les régions les mieux dotées en compétences et en écosystèmes dynamiques. En conséquence, les études de cas illustrent bien la limite des politiques de promotion des IDE. Ces derniers ne contribuent qu’à la croissance de quelques secteurs stratégiques, donc de quelques zones bien déterminées. L’essentiel pour les pouvoirs publics, qu’ils soient locaux ou nationaux, est de s’assurer que les ressources (naturelles, fiscales, foncières, humaines) qu’ils consacrent aux investisseurs étrangers soient affectées aux projets dont le potentiel de faisabilité et de retombées locales a été maximisé. Le gouvernement britannique doit donc veiller à se focaliser sur les grands chantiers que constituent l’éducation et la modernisation des infrastructures, car la nouvelle économie et les secteurs de pointe vont nécessiter cadres et ingénieurs en nombre. Il pourra ainsi enrayer la dégradation inquiétante de la productivité de son territoire.
Relever ces défis est d’autant plus important dans le contexte du Brexit. Si l’économie britannique présente encore aujourd’hui de nombreux atouts aux yeux des investisseurs en termes de fiscalité, de simplicité administrative et de flexibilité du marché du travail, une sortie de l’Union européenne risque de peser fortement sur l’attractivité du Royaume-Uni. La forte dépendance du pays aux IDE contraint également le gouvernement britannique à négocier avec les grands groupes étrangers des accords de compensation en cas de Brexit « dur » et à mettre en place une politique fiscale agressive afin de les retenir. Ces mesures risquent d’être très coûteuses pour les finances publiques. Elles soulèvent des questions sur la capacité du Royaume-Uni à poursuivre à long terme une stratégie industrielle reposant sur l’innovation technologique, cap fixé par Theresa May pour garantir au pays une sortie de l’UE par le haut.
Bibliographie
Algan Y., Cahuc P., Zylberberg A., 2012, La Fabrique de la défiance, Albin Michel.
Dowling A., 2015, The Dowling Review of Business-University Research Collaborations, juillet.
Bailey D., Chapain C., Mahdon M., Fauth R., 2008, Life after Longbridge: three years on pathways to re-employment in a restructuring economy, ESRC, novembre.
Bailoni M., 2011, « Les investissements étrangers au Royaume-Uni : recomposition des territoires, rivalités géopolitiques et contrecoups identitaires », L’Espace politique, n° 15, mars.
Barou Y., 1978, « Contrainte extérieure et déclin industriel au Royaume-Uni », Économie et Statistique, Vol. 97 n° 1, février.
BBC News, 2006, « 315 jobs to go as LG plant closes ».
BBC News, 2007, « ’Lessons learnt’ from LG failure ».
Beatty C., Fothergill S., 2016, Jobs, Welfare and Austerity. How the destruction of industrial Britain casts a shadow over present-day public finances, Centre for Regional Economic and Social Research, novembre.
Becker S O, Fetzer F., Novy D., 2017, Who voted for Brexit? A comprehensive district-level analysis, Centre for Economic Performance, CEP Discussion Papers, n° 1480, avril.
Bell B., Machin S., 2016, « Brexit and wage inequality », VOX (www.voxeu.org).
Berry C., 2016, UK manufacturing decline since the crisis in historical perspective. SPERI British Political Economy Brief n° 25, octobre.
Bidet-Mayer T., 2017, L’énigme de l’investissement, Les Synthèses de La Fabrique, n° 13, mai.
Bloom N., Dorgan S., Dowdy J., Sadun R., Van Reenen J., 2007, Management Practice & Productivity: Why they matter, Centre For Economic Performance et Mc Kinsey & Company, juillet.
Bohan C., 2009, « Les stratégies des firmes multinationales de l’automobile dans l’Europe élargie : le modèle centre-périphérie à l’épreuve », Géocarrefour, Vol. 84/3.
Buigues P.-A., Sekkat K., 2009, Industrial Policy in Europe, Japan and the USA Amounts, Mechanisms and Effectiveness, Palgrave Macmillan.
Buigues P.-A., Cohen E., 2014, Le Décrochage industriel, Fayard, octobre.
Business France, 2017, Livre blanc des classements internationaux, pour se repérer entre réalités et perceptions.
Campbell P., 2017, « Nissan asks for £100m supplier fund to safeguard UK car industry », Financial Times, 28 février.
Campbell P., Inagaki K., 2017, « Toyota and Nissan take different roads to Brexit », Financial Times, 16 mars.
Cecchetti S. G., Kharroubi E., 2012, « Reassessing the impact of finance on growth, Bank for International Settlements », BIS Working Papers, n° 381.
Cecchetti S. G., Kharroubi E., 2015, « Why does financial sector growth crowd out real economic growth? », BIS Working Papers, n° 490.
Charrel M., 2016, « La concurrence fiscale entre les pays industrialisés est réamorcée », Le Monde, 22 novembre.
Commission européenne, 2013, « Internationalisation of business investments in R&D », Innovation Union Competitiveness papers, n° 2013/1.
Conte-Helm M., 2012, Japan and the North East: From 1862 to the Present Day, Bloomsbury Academic.
Coutts K., Gudgin G., 2015, The Macroeconomic Impact of Liberal Economic Policies in the UK, Centre For Business Research, Judge Business School, University of Cambridge, avril.
D’Arcy C., 2016, Midlands engine trouble. The challenges facing the West Midlands combined authority, Resolution Foundation, décembre.
De Saint-Laurent B., 2010, L’impact des IDE sur le développement économique des pays. État de l’art et application à la région MED, Anima Investment Network, décembre.
Demmou L., 2010, « La désindustrialisation en France », Documents de travail de la DG Trésor, n° 2010/01, juin.
Department for Business, Innovation & Skills, 2010, Local growth: realising every place’s potential, octobre.
Department for Communities and Local Government, 2017, Midlands Engine Strategy, mars.
Devereux M., 1988, « Corporation Tax: The Effect of the 1984 Reforms on the Incentive to Invest », Fiscal Studies, février.
DGE, DGRI, 2016, L’innovation en France. Indicateurs de positionnement international, Coordination interministérielle de l’Innovation et du Transfert.
DG Trésor, 2015, Nouvelle hausse du nombre de projets d’investissement étranger en France en 2014 (+18 %), selon le « baromètre 2015 de l’attractivité de la France » d’Ernst & Young, mai.
Dhingra S., Ottaviano G., Sampson T., Van Reenen J., 2016, «The impact of Brexit on foreign investment in the UK », CEP Brexit Analysis, n°2, Centre for Economic Performance, LSE, avril.
Direction générale des douanes et droits indirects, 2017, « Données de cadrage sur les échanges internationaux de biens du Royaume-Uni avant le Brexit », Études et éclairages, n° 74, avril.
Driffield N., Lancheros S., Temouri Y., Zhou Y., 2012, Inward FDI in the United Kingdom and its policy context, Vale Columbia Center on Sustainable International Investment, juillet.
Ducamp P., 2013, « Comment Sunderland est devenue l’usine auto la plus productive d’Europe », Usine Nouvelle, 1er avril.
Égert B., Gal P., 2016, The quantification of structural reforms: A new framework, OECD Economics Departement Working Papers, n° 1354, décembre.
Egger P., Radulescu D., Strecker N., (2013). « Effective labor taxation and the international location of headquarters », International Tax and Public Finance, Vol. 20, Issue 4, pp. 631–652.
EY, 2017, EY’s Attractiveness Survey. UK 2017: Time to act, mai.
Faucher F., Le Galès P., 2010, L’expérience New Labour, 1997-2009, Presses de Sciences Po.
Fontagné L., Toubal F., 2010, Investissement direct étranger et performances des entreprises, Conseil d’analyse économique, mars.
Girma S., Greenaway D., Wakelin K., 2001, Wages, Productivity and Foreign Ownership in UK Manufacturing, Centre for Research on Globalisation and Labour Markets, Research Paper 99/14.
Harris R., 2009, Spillover and Backward Linkage Effects of FDI: Empirical Evidence for the UK, SERC Discussion Paper 16, mars.
House of Commons, 2017, Industrial Strategy: First Review, Business, Energy and Industrial Strategy Committee, Second Report of Session 2016–17.
Jacquier J.-F., 2001, « L’électrochoc Toyota », Le Point, 26 janvier.
Jess N., Pramil J., Roucher D., 2013, À la recherche de la productivité britannique perdue, Insee, Note de conjoncture, décembre.
Jones R., 2016, Innovation, research and development, and the UK’s productivity crisis, University of Sheffield, avril.
Jones J., Wren C., 2008, FDI Location Across British Regions and Inward Investment Policy, SERC, Discussion Paper 13, décembre.
Krieger J., 1999, British Politics in the Global Age: Can Social Democracy Survive?, Oxford University Press, novembre.
Kumar N. and Pradhan J.P. (2002) Foreign direct investment, externality and economic growth in developing countries : Some empirical explorations and implications for WTO negotiations on investment’ Research and information system, New Delhi India.
Liker J., 2006, Le modèle Toyota : 14 principes qui feront la réussite de votre entreprise, Pearson.
Lohr S., 1987, « Nissan’s revolution in Britain », The New York Times, 2 juin.
Mathieu C., 2013, « Retour de la croissance au Royaume-Uni en 2013 : effets en trompe-l’œil », Blog de l’OFCE, 2 décembre.
Morris B., 2014, « The Cadbury deal: How it changed takeovers », BBC News.
Moretti E., 2010, « Local Multipliers », American Economic Review Papers and Proceedings, n° 100, pp. 1-7.
National Audit Office, 2003, The Department of Trade and Industry: Regional Grants in England, Report by the Comptroller and Auditor General, juin.
Natixis, 2012, Les migrations de l’industrie européenne, février.
OCDE, 2008, L’impact de l’investissement direct étranger sur les salaires et les conditions de travail, Rapport pour la Conférence OCDE-OIT sur la responsabilité sociale des entreprises des 23 et 24 juin 2008, Paris.
OCDE, 2016, L’importance des compétences : Nouveaux résultats de l’évaluation des compétences des adultes, Études de l’OCDE sur les compétences, décembre.
Office for National Statistics, 2015, « The economic performance of the UK’s motor vehicle manufacturing industry », septembre.
Pain N., Hubert F., 2002, « Aides à l’investissement, intégration européenne et localisation de l’investissement direct allemand », Économie & prévision, Vol. 152-153, n° 1.
Pullen C. et Clifton J., 2016, England’s apprenticeships: Assessing the new system, Institute for Public Policy Research, août.
Rajan R. G., Zingales L., 1998, « Financial Dependence and Growth », The American Economic Review, Vol. 88, n° 3, juin.
Rigby M., 2015, Future-proofing UK manufacturing, novembre, Barclays.
Sode A., 2016, « Comprendre le ralentissement de la productivité en France », La note d’analyse, n° 38, France Stratégie, janvier.
Society of Motor Manufacturers and Traders, KPMG, 2014, The UK Automotive Industry and the EU, avril.
Society of Motor Manufacturers and Traders, 2016, UK automotive sustainability report, 17e édition.
Society of Motor Manufacturers and Traders, 2017, UK automotive sustainability report, 18e édition.
Strauss-Kahn V., Vives X., 2009, « Why and where do headquarters move? », Regional Science and Urban Economics, Vol. 39, Issue 2, pp. 168-186, mars.
Szwejczewski M., Jones M., 2013, Learning From World Class Manufacturers, Palgrave Macmillan, décembre.
Taylor J., 2002, Geographical income disparities within countries: is regional development policy the answer?, Lancaster University.
Thibault G., 2008, Quelle stratégie industrielle pour la France face à la mondialisation ?, Éditions Technip, septembre.
Toubal F., Trannoy A., 2016, L’attractivité de la France pour les centres de décision des entreprises, Les notes du Conseil d’analyse économique, n°30, avril.
UKCES, 2016, UK Employer Skills Survey 2015: UK results, Evidence Report 97, mai.
2011, Royaume-Uni : La BEI va prêter 220 millions d’EUR à Nissan pour la production de sa voiture électrique et de batteries lithium-ion sur le site de Sunderland, communiqué de presse de la BEI, 9 novembre.
Young A., 2014, « Structural Transformation, the Mismeasurement of Productivity Growth, and the Cost Disease of Services », American Economic Review, Vol. 104, n° 11, pp. 3635-67, novembre.
Remerciements
Nous tenons à remercier Thomas Aubrey, directeur du Centre for Progressive Capitalism ; Amelie Galatry, déléguée de Promosalons UK ; Pierre Grandjouan, chef du service économique auprès de l’ambassade de Tel Aviv (DG Trésor) ; Richard Harris, professeur d’économie à l’université de Durham ; et Constance Legallais, consultante senior chez EY, qui nous ont transmis de précieuses informations et des contacts utiles à la réalisation de cette publication.
Un grand merci également à Quentin Bruley, stagiaire à la Fabrique de l’industrie, pour sa participation à l’élaboration de cette note.
Annexes
Annexe 1. Définition des IDE
Les investissements directs à l’étranger (IDE) désignent les investissements par lesquels des entités résidentes d’une économie acquièrent ou ont acquis un intérêt durable dans une entité résidente d’une économie étrangère. La notion d’intérêt durable implique l’existence d’une relation à long terme entre l’investisseur direct et la société investie ainsi que l’exercice d’une influence notable du premier sur la gestion de la seconde. Par convention, on considère qu’il y a intérêt durable et donc investissement direct lorsqu’une entreprise détient au moins 10 % du capital ou des droits de vote d’une entreprise résidente d’un pays autre que le sien.
L’investissement direct comprend à la fois l’opération initiale entre les deux entités et toutes les opérations financières ultérieures entre elles ainsi qu’entre les entreprises du même groupe international.
Ces prises de participation peuvent prendre différentes formes, les principales étant la création de sociétés ou d’établissements (investissements dits « greenfield »), les acquisitions (« brownfields ») et fusions, et enfin le réinvestissement dans les filiales étrangères des bénéfices que celles-ci réalisent (« bénéfices réinvestis »).
D’autres formes d’IDE sont apparues récemment pour répondre aux impératifs de collaboration entre firmes : sous-traitance à l’étranger, joint-ventures contractuelles ou co-entreprises, etc.
Nous privilégions un raisonnement sur les stocks d’IDE qui correspondent à la valeur, à un moment donné, des capitaux étrangers dans un pays ou, symétriquement, des capitaux qu’un pays possède à l’étranger. Les flux d’IDE représentent les mouvements de capitaux émis entre un pays (d’origine ou d’accueil) et l’étranger sur une période donnée.
Dans cette note, nous raisonnons avant tout en valeur, manière la plus traditionnelle de traiter des investissements. Ces analyses sont confortées par des études réalisées notamment par le cabinet EY où le raisonnement est mené en termes de nombre de projets.
Annexe 2. Le recensement des implantations internationales et des créations d’emplois
Nous nous sommes largement appuyés dans cette note sur les données et les études produites par le cabinet EY. Depuis 1997, EY European Investment Monitor (EIM) recense le nombre de projets d’investisseurs étrangers dans une quarantaine de pays européens, y compris en Russie et en Turquie. Le cabinet d’audit est le seul à ce jour à fournir des comparaisons internationales sur le nombre de projets d’investissement et d’emplois.
Il prend en compte et vérifie les annonces publiques et fermes d’investissements porteurs de créations d’emplois. D’autres méthodes peuvent être utilisées pour le recensement de ce type de projets. Ainsi, celle de Business France intègre, en plus des emplois créés, les emplois maintenus par les investisseurs étrangers en France, ainsi que les créations et les sauvegardes d’emplois projetées sur trois ans. À l’inverse, EY European Investment Monitor se concentre sur les données au démarrage des projets, et ce de la même manière dans tous les pays européens (43 en 2016). La validation croisée des investissements par Business France avec les partenaires territoriaux permet en outre de recenser les décisions fermes d’investissement qui n’ont pas fait l’objet d’une annonce publique (soit plus du quart des investissements recensés).
Selon la DG Trésor105, le recensement d’EY présente plusieurs limites méthodologiques.
- Il ne comporte aucune indication de montant des investissements, indicateur qui permettrait une comparaison plus pertinente que le seul nombre de projets. Le nombre d’emplois créés peut certes fournir une estimation de l’ampleur des opérations, mais il n’est disponible que pour une partie des projets recensés (c’est-à-dire qu’il n’est pris en compte que lorsqu’il a été annoncé publiquement).
- Le rapport procède à une comptabilisation en brut, c’est-à-dire sans déduction des désinvestissements ou délocalisations réalisés par des investisseurs étrangers (et donc sans prise en compte des suppressions d’emplois correspondantes).
- En sens inverse, le champ des opérations recensées par le rapport est large mais exclut certaines natures d’opérations (reprises de sites en difficulté, reprises-extensions) ainsi que les opérations n’ayant pas fait l’objet d’une annonce publique.
Ces différences de champ, notamment, expliquent pourquoi Business France estime qu’EY ne recense que les deux tiers de l’ensemble des projets d’investissement et un tiers des emplois créés en France.
Il n’existe pas à ce jour de classement labellisé qui fasse consensus. L’avantage des données d’EY est leur large couverture géographique, qui permet des comparaisons intéressantes.
Annexe 3. Carte des régions britanniques
Annexe 4. Zones assistées
Annexe 5. Liste des personnes auditionnées
Mark Bailoni, géographe et membre du Laboratoire d’observation des territoires (LOTERR)
Pierres Buigues, professeur à l’université de Toulouse (Toulouse Business School) et ancien conseiller économique à la Commission européenne
Louise Dalingwater, maître de conférences à l’université de la Sorbonne Nouvelle – Paris 3 (laboratoire CERVEPAS/CREW)
Régis Dormoy, ex-directeur général adjoint du pôle Economie & emploi, Valenciennes Métropole
Jean-Luc Di Paola-Galloni, directeur du développement de Valeo
Florence Faucher, professeure à Sciences Po au Centre d’études européennes
Christian Fatras, conseiller au service économique de l’ambassade de France à Londres
Marc Lhermitte, associé chez EY
Patrick Manon, directeur de Business France au Royaume-Uni
Sylvie Montout, chef économiste, chef du département Analyses et prospectives économiques de Business France
Hugh Pemberton, professeur d’histoire contemporaine britannique à l’université de Bristol
Frédérique Sachwald, directrice de l’Observatoire des sciences et techniques du Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES)
James Selka, président de la Manufacturing Technologies Association
Farid Toubal, conseiller scientifique au CEPII et professeur d’économie à l’ENS de Paris-Saclay
- 105 – DG Tresor (2015).
Louisa Toubal, L’investissement étranger, moteur de la réindustrialisation au Royaume- Uni ?, Paris, Presses des Mines, 2018.
ISBN : 978-2-35671-498-5
© Presses des MINES – TRANSVALOR, 2016
60, boulevard Saint-Michel – 75272 Paris Cedex 06 – France presses@mines-paristech.fr
www.pressesdesmines.com
© La Fabrique de l’industrie
81, boulevard Saint-Michel – 75005 Paris – France info@la-fabrique.fr
www.la-fabrique.fr