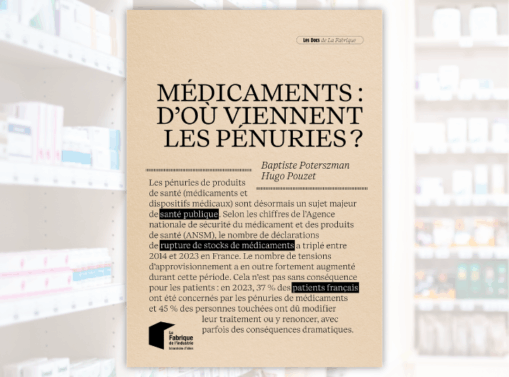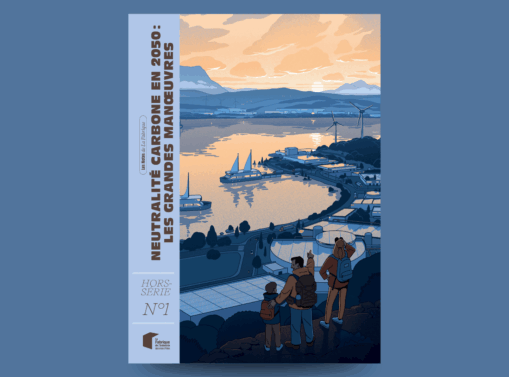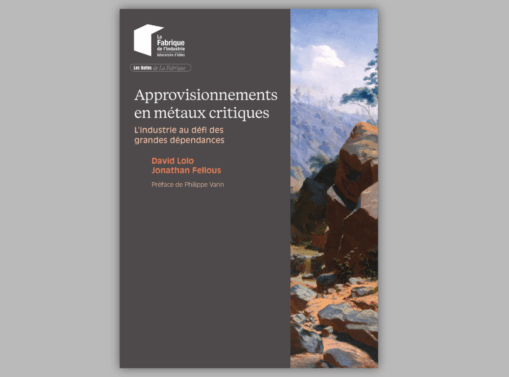Les modèles circulaires dans l’industrie à l’épreuve de la mise à l’échelle
Fruit d’une enquête auprès de dix-huit entreprises en 2024, la dernière étude de la Fabrique de l’industrie met en évidence les défis auxquels doivent faire face les entreprises industrielles quand elles décident de faire de l’écoconception, du remanufacturing ou du reconditionnement. Les modèles circulaires sont déjà une réalité pour des entreprises industrielles des secteurs agroalimentaire, métallurgique, automobile, ou encore des machines industrielles. Et si certaines entreprises sont nées circulaires, tandis que d’autres ont intégré ce processus en cours de route, toutes font face à un passage à échelle qui bute encore et toujours sur les difficultés d’approvisionnement, de recrutement ou de construction d’un
écosystème.
Appréhender la diversité des objectifs
Sur le terrain, les motivations guidant la mise en œuvre de projets circulaires sont multiples : considérations environnementales, volonté de réaliser des économies sur les intrants, être plus compétitif ou indépendant en matières premières, création d’emplois… Ainsi, tandis que Saint-Gobain produit désormais du plâtre avec du gypse recyclé, permettant une économie de près de 800 kg de CO₂eq par tonne de calcin utilisée , Renault a transformé son site historique de Flins en Refactory pour reconditionner des véhicules, avec à la clé des métiers nouveaux.
Approvisionnement et recrutement : le nerf de la guerre
Comme pour tout modèle économique dans l’industrie, tout commence – et peut se compliquer – dès l’amont. Produire en étant circulaire exige de sécuriser un flux suffisant de matières premières secondaires. Or ces dernières ont sujettes à une « variabilité » structurelle. En quantité d’abord : l’industrie circulaire est dépendante de ce que produit l’industrie non circulaire – les « déchets » – et des coûts de transport liés au lieu d’approvisionnement. par exemple, l’entreprise Maximum, qui fabriquait des tabourets à partir de déchets plastiques industriels, a dû cesser cette activité après la délocalisation de son fournisseur et se tourner vers la production d’autres types de biens, nécessitant une main d’oeuvre capable de gérer cette variabilité. À ce propos, le recrutement s’impose également comme un sujet épineux. Si l’industrie « de première main » peine déjà à recruter par manque d’attractivité, les entreprises qui mettent en oeuvre des modèles circulaires souffrent en plus d’une image moins « noble ». En chiffre, l’économie circulaire ne représente que 1,8 % de l’emploi total en France en 2021, encore en dessous de la moyenne européenne (2,1 % en 2021). Ensuite, la qualité des matériaux varie d’un lot à l’autre : couleur, forme, propriétés techniques.. . Tout l’enjeu réside alors dans la production à grande échelle d’un produit dont chaque unité doit respecter un cahier des hcharges très précis.
Le district industriel du Prato en Italie : un modèle de cluster renouvelé
La mise en oeuvre d’un nouveau modèle économique suppose toujours la construction d’un système d’acteurs qui réponde aux besoins des industriels en matière de compétences, d’approvisionnement ou encore de financement. C’est le cas du district industriel du Prato, dont l’organisation industrielle a été mise en lumière dans les années 1970-1980 et a servi de modèle à la politique de cluster française. Prato s’est appuyé sur son savoir-faire ancestral, le recyclage du fil de laine, pour se renouveler suite à la montée en puissance de la fast fashion dans les années 1990. Depuis, un nouveau projet territorial autour de la circularité se met progressivement en place avec l’émergence de nouvelles activités économiques et culturelles, ainsi qu’une nouvelle gouvernance entre acteurs privés et publics.