À la recherche de la résilience industrielle. Les pouvoirs publics face à la crise
Préface
Les politiques économiques mises en œuvre lors de la crise du Covid-19 ont été inédites, à la mesure de la situation. Dans ces derniers mois, l’État, les entreprises et les ménages ont adapté leur comportement dans une situation d’incertitude radicale. Les choix de politique économique, dont les effets vont se faire sentir sur la dynamique de la reprise, mais aussi les générations à venir, doivent être placés dans le contexte d’un tâtonnement prudent, afin que la contrainte sanitaire légitime ne conduise pas à des effets économiques et sociaux irréversibles. Il faut se méfier de l’illusion rétrospective, au moment où ces lignes sont écrites et où une quatrième vague épidémique est possible, qui conduit à débattre des options économiques du début de la pandémie, avec l’information disponible aujourd’hui. Face à cette incertitude, le terme de résilience industrielle dans le titre souligne le changement de paradigme auquel on assiste en matière de politique industrielle. L’industrie n’est plus simplement perçue comme une fraction importante de la R&D et de la balance commerciale, elle devient un socle qui permet d’absorber les grands chocs économiques, lorsque le commerce international est désorganisé. Dans cette crise, l’économie a été vue différemment, comme capacité à produire les infrastructures des besoins essentiels : pro- duire du matériel de santé, assurer la mobilité, la communication, l’éducation. Nous sommes encore au début des implications de ce changement qui nous amène de la croissance, même transformée par les contraintes environnementales, à la résilience, qui est la gestion des risques extrêmes.
C’est l’intérêt de cette note que de mettre les politiques économiques françaises depuis le début de la crise sanitaire en perspective. Sonia Bellit reprend cette chronique sous trois angles complémentaires. Le premier présente les nouveaux outils budgétaires mobilisés par l’État, comme le fonds de solidarité ou du plan de relance. Le second angle est celui des entreprises avec la discussion du chômage partiel et des accords d’entreprises. Le troisième angle est la vision des acteurs eux-mêmes, sous forme d’encadrés. La parole est donnée aux syndicalistes, aux chefs d’entreprise, aux économistes pour une analyse personnelle et contextualisée des choix possibles, des difficultés des négociations et d’analyse.
Ces trois plans amènent à revenir sur des débats essentiels pour la politique économique : quelle taille pour le plan de relance ? Quel est l’effet des accords d’entreprises sur les salaires et l’emploi ? Quelle est l’utilité des outils fiscaux, comme le suramortissement ou la prime à la casse pour le secteur automobile. L’auteure résume la compréhension des économistes sur chacun des points et, de manière pertinente, n’hésite pas à souligner les inconnues sur l’efficacité et les effets des outils mentionnés. C’est salutaire et essentiel. Les choix de politique économique en période de Covid ont été réalisés dans une grande incertitude, tant sur l’état de l’économie (par exemple, les perspectives de faillites d’entreprises sont toujours objets de débats), mais aussi sur l’efficacité des outils choisis. Le premier chapitre s’arrête sur le débat sur le montant et les modalités du plan de relance. Ces deux qualités, diversité des approches, et regards lucides sur l’incertitude des outils en place font de cet ouvrage une contribution importante pour faire le bilan de ce que l’on a fait pendant la période de la crise Covid.
Quelles leçons en tirer ? C’est l’objet de la dernière partie de l’ouvrage sur la politique industrielle, sur laquelle il faut s’arrêter. La crise Covid-19 marque une insertion sans précédent de l’État dans l’économie. L’État a assuré le revenu des salariés, et des indépendants dans un premier temps, puis il a contribué à payer les coûts fixes des entreprises avec l’évolution du fonds de solidarité. Il a fourni des liquidités aux entreprises avec le prêt garanti par l’État, pour ne parler que des principaux dispositifs. En septembre 2020, une partie de ces mesures, en plus un soutien à la transition énergétique et à la numérisation des entreprises, a été regroupée dans le plan de relance.
Ces éléments de gestion de crise doivent maintenant évoluer en fonction d’objectifs clairement identifiés. De l’urgence, il faut passer à la construction de l’économie française pour les générations à venir. La transition énergétique, la digitalisation, la réindustrialisation de la France sont des objectifs presque consensuels pour la politique industrielle. Le débat devrait être maintenant sur les meilleurs instruments pour atteindre ces objectifs. Le programme d’investissement d’avenir est justement mentionné pour stimuler l’innovation, à la gouvernance maintenant bien connue. Outil utile, il ne suffira pas pour la transformation industrielle nécessaire. Il faut penser la politique industrielle comme la construction d’un environnement favorable à l’investissement et à l’efficacité productive (dont la condition est un dialogue social renouvelé), au sein duquel l’investissement public permet la construction des infrastructures physique et numérique, mais aussi l’accélération des transformations sectorielles.
Xavier Ragot Directeur de recherche au CNRS, Professeur à Sciences Po Paris et Président de l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE).
Résumé
Les pouvoirs publics en temps de crise : d’abord éteindre l’incendie, ensuite préparer l’avenir
Inédite par sa nature et son ampleur, la crise économique déclenchée par la pandémie de Covid-19 a eu un impact considérable sur le secteur industriel. Confrontés à des ruptures d’approvisionnement en provenance de la Chine, certains secteurs étaient en situation de quasi-rupture d’offre dès le début du mois de mars 2020. Les mesures sanitaires, décrétées le 17 mars 2020, auront définitivement mis à l’arrêt de nombreux industriels français déjà fragilisés par un double choc négatif d’offre et de demande.
On a ainsi vu se réaffirmer le rôle des pouvoirs publics en période de crise économique. Ces derniers procèdent généralement en deux temps : instaurer des mesures d ’urgence pour atténuer les effets de la crise et élaborer un plan de relance pour faciliter la reprise. Ainsi, les premières mesures annoncées par le gouvernement visaient principalement à éviter les faillites d’entreprises plombées par une chute brutale de leur chiffre d’affaires et à maintenir les revenus et les compétences des salariés. Ce n’est qu’après cette phase de sauvetage, représentant près de 460 milliards d’euros, que les pouvoirs publics ont mis en œuvre un plan de relance visant à accompagner et à accélérer le redémarrage de l’économie.
Même en période de crise, les politiques de relance budgétaire font l’objet de nombreux débats. L’un d’entre eux porte sur la finalité d’un plan de relance : si sa nécessité fait consensus chez les économistes, la nature de ses priorités divise ceux qui, d’un côté, considèrent qu’il doit agir en premier lieu sur le court terme et d’autres qui pensent, au contraire, qu’il doit préparer « le monde de demain ». De même, le risque de multiplication des entreprises « zombies » qui, sous l’effet des aides publiques, resteraient artificiellement en vie et dégraderaient la productivité agrégée, agite les économistes à chaque nouvelle crise. Enfin, dans un contexte d’endettement massif des États auprès de leur banque centrale, la question de la soutenabilité de la dette publique revient invariablement dans le débat public. Toutefois, à l’occasion de la crise sanitaire, le débat a moins porté sur la soutenabilité de la « dette Covid » que sur son éventuelle annulation.
Adapter le niveau de production à la situation économique
En cette période où les entreprises affrontent une baisse de leur activité, elles n’ont d’autre choix que de réduire instantanément leur demande de travail. Dans un pays marqué par une faible protection de l’emploi, la baisse de l’activité se traduit rapidement par des licenciements, comme le reflète l’explosion du taux de chômage américain à la suite de la crise du Covid-19. En France et dans de nombreux pays européens, caractérisés par des rigidités institutionnelles du marché du travail, les gouvernements préfèrent mettre en place des dispositifs de flexibilité interne afin de permettre aux entreprises d’adapter leur niveau de production à la situation économique. Parmi les instruments mobilisables, le chômage partiel a été en 2020, et de loin, le plus plébiscité tant par les entreprises que par les syndicats de salariés. Il présente en effet le double avantage de maintenir le tissu productif et de soutenir le pouvoir d’achat des salariés. À chaque crise économique, le dispositif de chômage partiel est ainsi largement assoupli par les pouvoirs publics de façon à mutualiser le coût économique et social de la crise. Il est encore trop tôt pour évaluer si son déploiement pendant la présente crise sanitaire aura eu globalement plus d’effets positifs que d’effets négatifs à long terme sur l’emploi (il facilite une reprise accélérée mais peut dégrader la productivité). Néanmoins, il a déjà fait ses preuves par le passé : nombre d’études ont montré que le chômage partiel expliquait en partie le « miracle de l’emploi » allemand dans le contexte de la Grande Récession qui a suivi la crise des subprimes en 2008.
En France, un autre outil de flexibilité interne connaît un succès croissant en cette période de crise sanitaire et économique : les accords de performance collective (APC). Créé par les « ordonnances Macron » du 22 septembre 2017, cet outil permet aux entreprises de modifier leur organisation du travail – de façon temporaire ou durable – pour s’ajuster à la conjoncture ou développer leur compétitivité. On n’a pas encore pu évaluer l’impact de ce dispositif en temps de crise conjoncturelle, pour la simple et bonne raison que sa création est ultérieure à la crise précédente. Les rares études sur les APC soulèvent néanmoins quelques inquiétudes, notamment sur le risque de faire porter tout le poids des difficultés économiques d’une entreprise sur les salariés. Si certains y voient un instrument de « chantage à l’emploi », d’autres le considèrent au contraire comme un instrument idoine pour traverser une crise. Les expériences passées et étrangères montrent que le meilleur usage de ce type d’instrument alternatif au licenciement se fonde nécessairement sur un dialogue social de qualité.
La nécessité des politiques industrielles volontaristes en temps de crise
En France et ailleurs, la pandémie de Covid-19 a douloureusement rappelé le poids du handicap laissé par cinquante années de désindustrialisation, mettant en évidence non seulement l’incapacité des acteurs publics et privés à fournir à la population du matériel médical et de protection mais également leur forte dépendance aux approvisionnements étrangers. La réponse gouvernementale à la crise a ainsi réaffirmé, par contraste, le rôle de la politique industrielle. Sur les 100 milliards du plan de relance français, plus d’un tiers s’adressent à l’industrie. Ce regain d’intérêt pour la question industrielle n’est pas totalement nouveau. Les crises servent souvent de déclencheur à des politiques industrielles volontaristes, dont la justification économique repose sur l’existence d’effets d’entraînement importants de l’industrie sur le reste de l’économie et sur sa forte contribution aux gains de productivité. L’État peut ainsi intervenir en encourageant la création de fonds visant à renforcer les fonds propres des entreprises industrielles, voire par des prises de participation dans les secteurs les plus sinistrés. Ce type de mesures publiques est particulièrement nécessaire en temps de crise pour soutenir les financements de projets rentables mais jugés risqués au moment de la reprise.
Les pouvoirs publics peuvent également intervenir via des programmes verticaux de R&D à forte composante industrielle et technologique. En effet, pour rester ou revenir à la frontière technologique, les économies doivent anticiper les nouvelles technologies ou les produits les plus prometteurs. À ce titre, un dispositif comme le programme d’investissements d’avenir (PIA) peut offrir un cadre favorable et une gouvernance adaptée au développement de projets technologiques ambitieux.
Si ces mesures n’ont rien d’une nouveauté, la crise du Covid-19 a mis en avant un autre type de mesures, plus transversales : les aides à la relocalisation d’activités industrielles. Parmi les principaux arguments avancés pour les justifier figure la volonté de réindustrialiser le pays. Si on définit la réindustrialisation comme l’augmentation de la part relative des emplois industriels dans l’emploi total, alors la relocalisation stricto sensu n’apparaît pas comme un moyen efficace de reconstituer le tissu industriel français. De nombreuses études ont montré que les quelques relocalisations plausibles concernent des activités qui sont automatisables et créent donc peu d’emplois directs. Dans ce contexte, le premier rôle des pouvoirs publics est d’assurer un cadre favorable aux entreprises industrielles, en améliorant leurs facteurs de compétitivité. En revanche, la relocalisation d’activités stratégiques ou de certains maillons de la chaîne de valeur constitue l’une des solutions à la vulnérabilité des chaînes de valeur mondiales.
Remerciements
Je tiens à remercier toutes les personnes qui, par leur relecture attentive ou leur contribution écrite, m’ont permis de mener à bien ce travail.
Je remercie plus particulièrement Bernard Jullien (université de Bordeaux), Christian Pellet (Sextant), Philippe Portier (CFDT) et Joseph Puzo (Axon’Cable).
Un grand merci également à Vincent Charlet, délégué général de La Fabrique de l’industrie, et Thierry Weil, conseiller à La Fabrique de l’industrie, pour la richesse de nos échanges et leurs commentaires avisés.
Introduction
D’aussi loin que l’on s’en souvienne, la crise économique et sociale faisant suite à la pandémie de Covid-19 est inédite en temps de paix, par sa nature et son ampleur. Depuis plus d’un an, les effets sanitaires et économiques de cette crise se font ressentir dans de nombreux pays. Elle a mis à mal des pans entiers de l’économie conduisant de nombreuses entreprises à une situation de quasi-arrêt et à une chute brutale de leur chiffre d’affaires. Avant même l’expansion de la crise sanitaire en Europe, le tissu industriel français s’est trouvé fragilisé, dès janvier 2020, par le délitement de ses chaînes d’approvisionnement. Très dépendantes des importations chinoises, certaines entreprises industrielles ont dû faire face à des ruptures d’approvisionnement qui ont affecté leur activité de production. Les mesures sanitaires, annoncées à la mi-mars 2020, auront totalement mis à l’arrêt la majorité des industriels français. Ces mêmes mesures ont conduit à une restriction des débouchés pour de nombreux secteurs industriels, au premier rang desquels figure le secteur aéronautique. Alors que l’histoire est ponctuée par des crises économiques liées à un choc d’offre ou de demande, la particularité de la pandémie de Covid-19 est de conjuguer ces deux phénomènes.
Qu’elle soit financière, économique, sanitaire ou climatique, chaque crise affirme et légitime le rôle des pouvoirs publics. L’interventionnisme devient alors une évidence : qui oserait contester le bien-fondé du soutien aux entreprises en temps de crise ? Les mesures publiques engagées doivent répondre à un double défi : combattre la crise, en atténuant ses effets, et préparer l’avenir, en offrant les conditions de la reprise. La pandémie de Covid-19 a induit les mêmes obligations, comme en témoignent les plans d’urgence et de relance mis en œuvre en France. Face à l’ampleur de la crise économique et à la nécessité du confinement, des mesures de soutien ont été déployées dès le printemps 2020, parmi lesquelles l’activité partielle, les fonds de solidarité, les prêts garantis par l’État et les reports de cotisations sociales. Puis, le 3 septembre 2020, le Premier ministre Jean Castex appelait à la « consolidation et l’offensive » à travers un plan de relance économique baptisé France Relance. Cette seconde étape est cruciale pour éviter, d’une part, qu’un choc initialement transitoire ait des effets persistants et, d’autre part, que le pays ne se retrouve dans un choc asymétrique qui bénéficierait aux économies étrangères mieux soutenues. À la différence du plan de relance élaboré durant la Grande Récession de 2008-2009, France Relance présente la particularité de poursuivre des objectifs à la fois conjoncturels et structurels. Parmi les mesures structurelles annoncées, une grande partie s’adresse au secteur industriel.
La pandémie de Covid-19, plus encore que les crises précédentes, a fait brutalement prendre conscience de la désindustrialisation de la France, pourtant entamée depuis une cinquantaine d’années. Si elle est en partie une tendance historique liée aux gains de productivité, plus importants dans l’industrie qu’ailleurs, et à l’externalisation de certains services, la désindustrialisation est aussi la conséquence d’un problème de compétitivité. Ainsi, cette crise a provoqué des problèmes d’approvisionnement d’entreprises françaises fortement dépendantes des intrants étrangers et s’est traduite par une incapacité des acteurs publics et privés à fournir à la population des biens pourtant essentiels, comme les masques, les réactifs pour les tests PCR ou les respirateurs. En faisant de l’industrie l’un des piliers de son plan de relance, le gouvernement français a affiché sa volonté de rééquilibrer sa politique économique en faveur de ce secteur. Les mesures déployées couvrent des champs aussi vastes que le soutien à l’investissement, au développement des technologies vertes, à la numérisation des entreprises industrielles et à leur relocalisation.
L’objectif de cette note est de dresser un état des lieux des politiques publiques mises en œuvre en temps de crise, avec pour toile de fond la pandémie de Covid-19. Il s’agit en particulier de comprendre dans quelle mesure l’intervention publique est sollicitée pour surmonter une crise, quelle que soit l’appétence pour l’interventionnisme économique du gouvernement en place. Acteurs contracycliques, les pouvoirs publics sont en effet les seuls en mesure de sauver des pans entiers de l’économie des conséquences d’un choc transitoire. Plus encore, ils disposent, à travers une série d’instruments mis à la disposition des entreprises, d’une capacité de redressement et d’entraînement de l’économie. À cet égard, les politiques industrielles jouent un rôle majeur en influant directement sur les stratégies de développement des entreprises.
La présente note met globalement en lumière le fait que la France et ses partenaires européens ont su tirer des enseignements de la crise précédente. Elle est organisée en trois chapitres. Après avoir décrit l’impact de la pandémie de Covid-19 sur les entreprises industrielles, le premier chapitre analyse la politique économique mise en œuvre dans un contexte de crise économique, en distinguant deux temps bien distincts : d’abord éteindre l’incendie en instaurant des mesures d’urgence, ensuite préparer l’avenir à travers un plan de relance adapté. Le deuxième chapitre s’intéresse plus particulièrement aux outils de flexibilité interne que les entreprises peuvent mobiliser en cas de choc transitoire, parmi lesquels le chômage partiel et les accords de performance collective, dont la littérature économique permet de discuter l’efficacité. Enfin, le troisième chapitre montre comment la crise actuelle a provoqué, en France, un regain d’intérêt pour la politique industrielle, à travers le déploiement de mesures structurelles de soutien au secteur.
Deux impératifs en temps de crise : sauver ce qui peut l’être et préparer l’avenir
La crise du Covid-19 et les mesures de confinement qui en ont découlé ont eu un impact considérable sur le tissu industriel français. Il a été fragilisé par un choc inédit, à la fois d’offre et de demande, et différencié selon les secteurs d’activité. Avant les premières mesures de confinement, certains secteurs très exposés à la Chine faisaient déjà face au délitement des chaînes d’approvisionnement. Les mesures sanitaires, annoncées mi-mars 2020, auront totalement mis à l’arrêt la majorité des industriels français.
Si la crise du Covid-19 ne ressemble à aucune autre, les plans d’urgence puis de relance mis en œuvre à cette occasion ont un air de déjà-vu. En effet, une crise économique exige souvent de procéder en deux temps. Des mesures d’urgence sont d’abord instaurées par les pouvoirs publics pour éteindre l’incendie et éviter ainsi qu’il ne se propage à l’ensemble de l’économie. Ce n’est qu’après cette phase de sauvetage qu’il s’agit de prendre la mesure des conséquences de la crise, et d’y apporter les réponses les plus adaptées à travers un plan de relance.
La crise du Covid-19 : inédite par sa nature et son ampleur
L’histoire est ponctuée de crises économiques, liées à un choc d’offre ou de demande. La crise du Covid-19 conjugue ces deux phénomènes.
Pour l’industrie française, les premiers effets du Covid-19 se sont fait ressentir dès le début de l’année 2020. En effet, les mesures sanitaires instaurées en janvier en Chine n’ont pas été sans conséquences sur les entreprises industrielles françaises. Selon les douanes françaises, la Chine est le deuxième fournisseur de la France avec un total de 49,9 milliards d’importations en 2018, soit 9,1 % du total des importations. La France importe des produits chinois principalement dans les secteurs des composants informatiques et électroniques (30 %), du textile (20 %) et des équipements électriques et ménagers (11 %). Les conséquences du choc d’offre chinois sur l’économie française s’expliquent moins par les tensions sur les produits finis que par celles qui impactent les intrants. Selon une étude de l’Institut des politiques publiques (IPP), les pays ont été exposés au ralentissement chinois, à la fois directement via leurs importations de produits intermédiaires et indirectement via la valeur ajoutée chinoise contenue dans d’autres intrants (Gerschel et al., 2020). La perturbation des chaînes de valeur est à la mesure du poids que représente la Chine dans certains secteurs. La filière électronique a particulièrement été mise à mal par la pandémie. Très dépendante des importations chinoises, elle a dû faire face à des ruptures d’approvisionnement et était en situation de quasi-rupture d’offre dès le début du mois de mars 20201. Selon une enquête du Snese (Syndicat national des entreprises de sous-traitance électronique) menée auprès de ses adhérents, 91 % d’entre eux ont rencontré des problèmes d’approvisionnement au début de l’année 2020 et 30 % envisageaient un arrêt de production2. Une rupture de la chaîne logistique dans la filière électronique peut avoir des conséquences sur l’ensemble de l’industrie. L’électronique est présente dans de nombreux produits, des voitures aux appareils médicaux, en passant par les lignes de production, les avions ou encore les grues autonomes dans les chantiers. Dans une économie mondialisée et fragmentée, toute perturbation dans la chaîne de production affecte mécaniquement les étapes suivantes du processus de production, par un effet de cascade. La pénurie des semi-conducteurs, survenue début 2021 dans un contexte d’explosion de la demande pour les produits électroniques, a ainsi directement frappé les constructeurs automobiles français. Taïwan est le leader incontesté de toute la chaîne de valeur des semi-conducteurs. Très dépendants de l’entreprise TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) – à l’origine de 70 % des circuits intégrés utilisés dans le secteur automobile3 – Renault et PSA ont été contraints de stopper temporairement plusieurs chaînes de montage dans leurs usines, causant jusqu’à l’interruption totale de production de certains sites. Ainsi, l’intensité du choc dépend beaucoup de la capacité des entreprises à substituer d’autres fournisseurs aux producteurs chinois et à mobiliser des stocks. Lorsque le fournisseur est une filiale du même groupe que le client, cela réduit également les possibilités de substitution. Le cas de l’équipementier automobile Novares en offre une bonne illustration. La fermeture de ses sites de production de pièces en Chine a mis sous tension les autres sites européens. « Quand il manque une pièce d’un fournisseur, on ne sait pas l’acheter ailleurs », résume le patron de l’équipementier français4.
Outre la perturbation des chaînes d’approvisionnement, le confinement décrété le 17 mars 2020 en France a entraîné l’arrêt de nombreuses entreprises industrielles. Elles ont en effet rencontré des difficultés à poursuivre leur activité dans le respect des mesures d’endiguement de l’épidémie. L’arrêt de la production chez les grands donneurs d’ordre a bloqué celle de leurs sous-traitants, et inversement. Ce sont donc des filières entières qui ont été affectées directement ou indirectement par les mesures sanitaires. C’est le cas, par exemple, de la filière automobile : Michelin ouvre le bal le 16 mars en fermant tous ses sites français, italiens et espagnols, suivi par PSA, Renault, Toyota et l’équipementier Valeo, qui ferment un à un leurs principaux sites de production5. Le 28 octobre 2020, un deuxième confinement est annoncé, avec des règles assouplies par rapport au précédent afin d’atténuer son impact sur l’activité des entreprises. Dans l’ensemble, les entreprises ont appris du premier confinement, notamment en matière d’organisation du travail : des protocoles ont été repensés, améliorés ou renforcés, pour que les entreprises soient mieux armées en cas de nouvelle vague ou de nouveau virus.
La Chine est davantage un fournisseur qu’un client pour l’industrie française ; la balance commerciale de la France vers la Chine est en effet structurellement déficitaire (voir figure 1.1). La Chine est malgré tout le septième client de la France avec 20,8 milliards d’exportations en 2018, soit 4,2 % de l’ensemble des exportations6. Le ralentissement de l’économie chinoise s’est donc matérialisé également, en France, par un choc négatif de demande. Certains secteurs industriels sont particulièrement dépendants de la demande chinoise. La France y exporte principalement des biens issus des secteurs de l’aéronautique (40 %), du matériel électronique (17 %), de la chimie (11 %), des biens agricoles et agroalimentaires (11 %). Les mesures de confinement imposées en Chine, et la baisse du tourisme qui en a découlé, ont eu des effets importants sur le secteur aéronautique. Leurs avions restant cloués au sol, les compagnies aériennes du monde entier ont accusé des pertes importantes : selon l’Association internationale du transport aérien (IATA), le trafic mondial a baissé de moitié entre 2019 et 2020 et les pertes devraient atteindre 100 milliards d’euros en 20207. Par ricochet, les constructeurs aéronautiques ont fait face à de nombreux reports de livraison d’avions de la part des compagnies aériennes. C’est le cas d’Airbus, qui a annoncé, dès le mois d’avril, l’arrêt temporaire de trois usines situées en Allemagne et aux États-Unis8. À moyen terme, les avions géants devraient être de moins en moins sollicités par les compagnies aériennes, qui ont besoin de flexibilité pour s’adapter à la demande. D’autres activités industrielles, à l’instar de la maintenance et de la réparation, ont également été fortement impactées par la baisse du trafic aérien et le retrait prématuré de vieux avions dont il est coûteux d’assurer l’entretien. L’arrivée de l’épidémie en Europe et aux États-Unis et la mise en place de mesures sanitaires n’auront fait que renforcer le choc de demande négatif déjà à l’œuvre. En France, la fermeture de la plupart des lieux de commerce n’a pas été sans conséquences sur l’activité de production. De nombreux secteurs ont souffert d’une restriction de leurs débouchés. Dans le secteur automobile, la fermeture des concessionnaires lors du premier confinement a provoqué l’arrêt des lignes de production. Dans un système à flux tendu où seules les voitures commandées sont produites, il devient difficile de maintenir la production sans augmenter les stocks. Durant le deuxième confinement, le gouvernement français a donc autorisé le click and collect dans les concessions automobiles pour limiter le risque de mise à l’arrêt de l’appareil de production9. À l’inverse, d’autres secteurs, au premier rang desquels figure l’agroalimentaire, ont été contraints d’ajouter des lignes de production ou de réduire leurs gammes pour répondre au surplus de demande survenu lors des deux confinements.
Face à ce double choc d’offre et demande, l’industrie a donc été mise à rude épreuve en 2020. Selon une étude de l’Insee (Duc et Souquet, 2020), 26 % des entreprises industrielles10 ont suspendu leur activité lors du premier confinement11. Selon l’Insee (2020), la production industrielle du quatrième trimestre 2020 est inférieure de 3,8 % à celle du même trimestre 2019. Au total, ce sont 57 500 emplois industriels qui ont été détruits entre 2019 et 2020, soit près de 2 % des emplois du secteur. L’industrie a cependant été moins violemment affectée que certains secteurs des services, en particulier le tourisme, la restauration, l’hôtellerie et la culture.
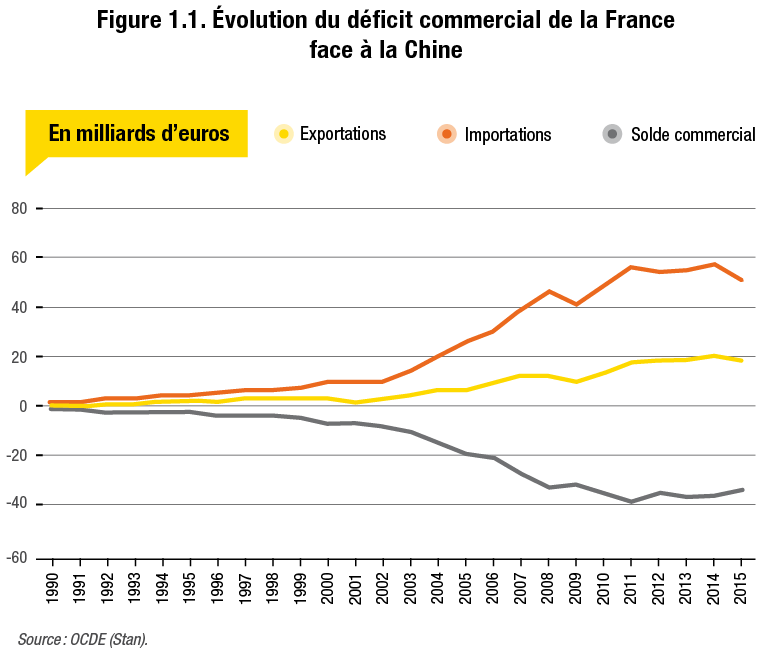
Entre mesures d’urgence et plan de relance : le rôle central de l’État
Au plus fort d’une crise économique, marquée par l’incertitude, la politique économique doit procéder en deux temps bien distincts. Il convient d’abord de prendre des mesures d’urgence visant à maintenir la base industrielle et les revenus des salariés (voir figure 1.2). La seconde étape consiste ensuite à élaborer un plan de relance visant à accompagner et à accélérer le redémarrage de l’économie. La crise du Covid-19 en fournit une illustration particulièrement éclairante.
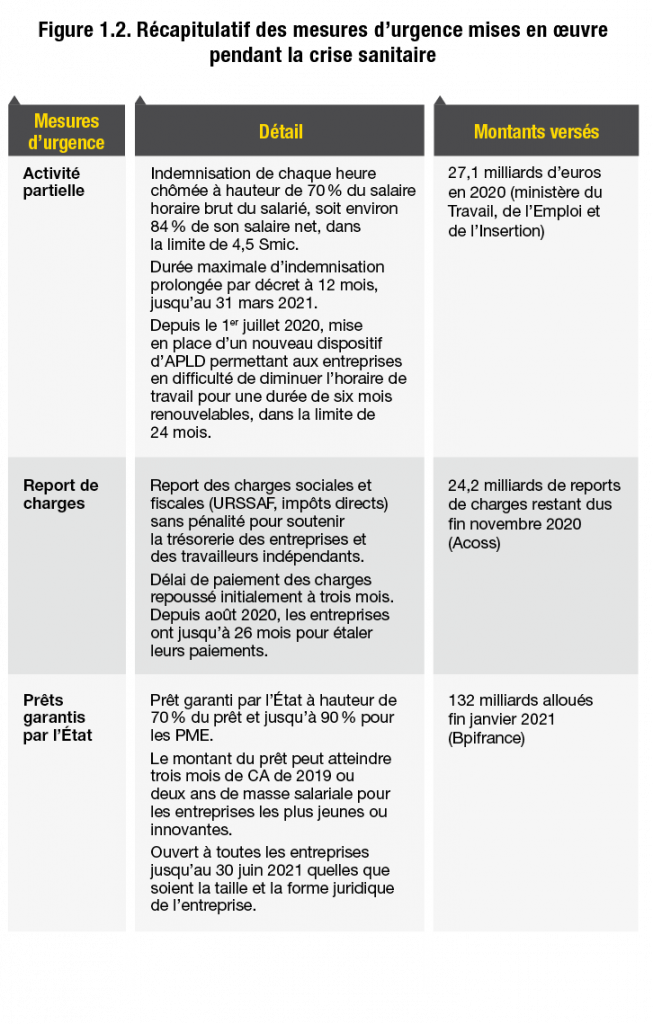
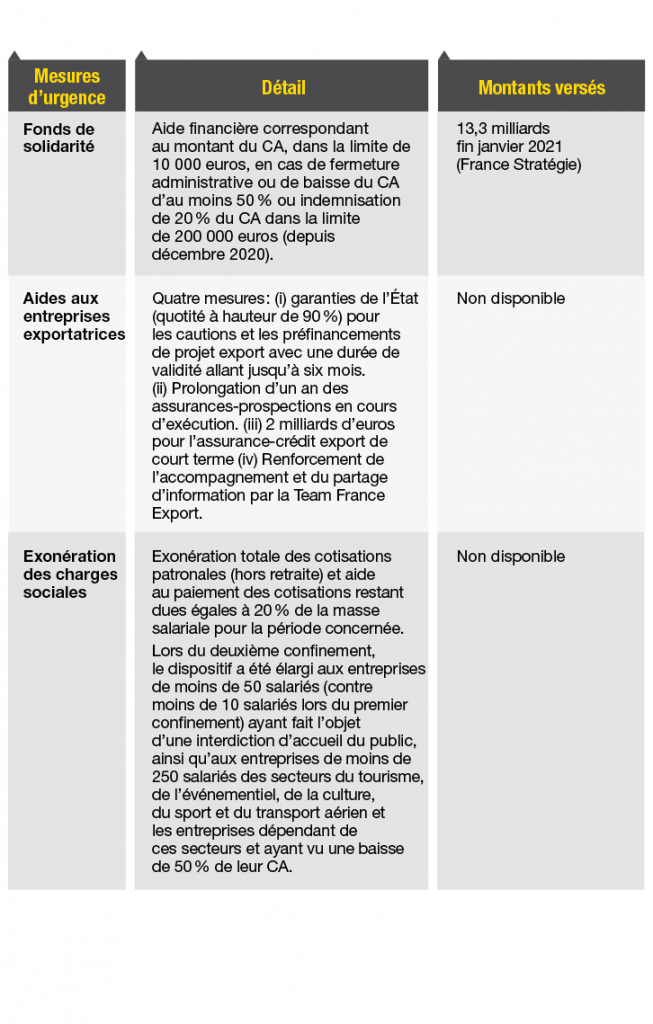
Les mesures d’urgence pendant la période de stop
Les mesures de confinement instaurées en France en réponse à la pandémie, conjuguées aux chocs négatifs d’offre et de demande, ont mené à une situation de quasi-arrêt – dite de stop – de nombreuses entreprises. La stratégie mise en place par le gouvernement a surtout consisté à éviter les faillites d’entreprises plombées par une chute brutale de leurs revenus. La France, comme la plupart des grands pays développés (Allemagne, Espagne, États-Unis, Royaume-Uni, etc.), a ainsi cherché à renforcer la trésorerie des entreprises pendant cette période. Les premières mesures d’urgence ont consisté à mettre en place des prêts garantis par l’État (PGE)12, avec un plafond alors fixé à 300 milliards d’euros. Fin novembre 2020, environ 125 milliards d’euros de PGE avaient été accordés en France, soit le montant le plus élevé parmi les grands pays européens13. L’industrie manufacturière est l’un des principaux secteurs demandeurs de PGE, avec 17% des montants mobilisés. D’autres outils de soutien à la liquidité des entreprises ont été mis en place, parmi lesquels le report de certaines échéances sociales et fiscales, la création d’un fonds de solidarité destiné aux TPE et aux indépendants des secteurs les plus touchés et un soutien de rééchelonnement des charges. Si les objectifs étaient similaires, les outils et les montants mobilisés ont pu différer d’un pays à l’autre. Par exemple, le gouvernement allemand a prévu un fonds de stabilisation de 600 milliards d’euros visant, entre autres, à fournir des aides directes ou à acquérir des participations dans les entreprises en difficulté pour éviter tout rachat hostile par des investisseurs étrangers. Au plus fort de la crise, un autre outil est apparu crucial pour les entreprises industrielles : le chômage partiel. Dans une économie à l’arrêt, les entreprises n’ont d’autre choix que de réduire instantanément leur demande de travail. Afin de maintenir le tissu productif et de soutenir le pouvoir d’achat, les gouvernements européens ont mis en place des mesures de chômage partiel (ou d’activité partielle) pour mutualiser le coût économique et social de la crise. Grâce à un taux de remplacement particulièrement généreux en France (84%, contre seulement 60 à 67% en Allemagne), les ménages français n’ont vu leur revenu chuter que de 5% durant les huit semaines de confinement alors que le revenu national baissait de près d’un tiers (Martin et al., 2020). Selon l’Insee (2020), cette mesure a par ailleurs été la plus sollicitée par les entreprises françaises au cours du premier confinement (70% des entreprises).
Plus de quatre entreprises sur cinq déclarent avoir fait appel à une ou plusieurs de ces mesures d’urgence, encore dites de sauvetage, qui visent à placer l’industrie, et plus généralement l’ensemble de l’économie dans un choc aussi transitoire que possible. Au total, ce sont 460 milliards d’euros que le gouvernement français a mis sur la table pour faire face à la crise et offrir aux entreprises les conditions de la reprise. Selon une étude du Trésor (Hadjibeyli et al., 2021), ces mesures d’urgence ont été particulièrement efficaces. À partir d’un modèle de microsimulation permettant d’étudier l’évolution financière de près de 2 millions d’entreprises françaises en réponse au choc d’activité, les auteurs de l’étude montrent que ce soutien public a réduit de 8,3 points de pourcentage la part d’entreprises devenant insolvables en 2020 par rapport à une année sans crise.
Une articulation entre mesures d’urgence et de relance pour éviter un choc asymétrique
« Après l’indispensable sauvegarde de l’ économie » par les mesures d’urgence, sonnait l’heure de la « consolidation et l ’offensive » avec le plan France Relance, déclarait le Premier ministre Jean Castex, le 3 septembre 2020. Le redémarrage des activités productives (situation de go ) est en effet une étape cruciale pour éviter que le choc transitoire ne devienne persistant : dans un contexte de mondialisation, les gouvernements doivent à tout prix éviter que leur économie ne redémarre en retard par rapport aux autres, au risque de se retrouver dans un état de « choc d’offre asymétrique »
à l’issue de la crise, qui conduirait à une récession, des faillites d’entreprises et une perte de marché au profit d’autres pays proposant des produits similaires. En France, le plan de relance prévoit un montant de 100 milliards sur deux ans, quasiment réparti en trois tiers entre la compétitivité (35 milliards), la cohésion territoriale et sociale (35 milliards) et la transition écologique (30 milliards). Le soutien à l’industrie y occupe une place importante avec des mesures principalement axées sur la relance par l’offre. En effet, 20 milliards sur deux ans sont consacrés à la baisse des impôts de production14 qui, selon les calculs du gouvernement, seront davantage orientés vers l’industrie (37 % du gain) que vers le commerce (15 % ). Dans un rapport de 2019 (Martin et Trannoy, 2019), le Conseil d’analyse économique (CAE) jugeait nocifs ces impôts pesant sur les facteurs de production, dans la mesure où ils ne sont pas assis sur les profits et frappent donc « aveuglément » les entreprises, c’est- à-dire sans tenir compte de leur santé financière. Parmi les différentes taxes sur la production, c’est la C3S (contribution sociale de solidarité des sociétés) qui était pointée du doigt par le CAE et considérée comme une « taxe sur la taxe à chaque étape de production ». C’est pourtant la CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) qui a été réduite dans le cadre de France Relance afin d’ éviter que la mesure ne profite qu’aux plus grandes entreprises15 . Selon le gouvernement, cette mesure profiterait en premier lieu aux ETI (42 % ), puis aux TPE-PME (32 % ) et enfin aux grandes entreprises (26 % ).
La baisse des impôts de production est incontestablement la mesure phare du plan de relance français. Comme de nombreuses mesures avant elle, parmi lesquelles le CICE (crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi), son objectif est de renforcer la compétitivité des entreprises françaises. Sur le plan de l’offre, d’autres mesures visant à soutenir les capacités de financement des entreprises, les relocalisations, la décarbonation de l’industrie ou encore la filière hydrogène ont été mises en œuvre par France relance. Mais un plan de relance est un jeu d’ équilibre entre l ’offre et la demande. Il ne s’agit pas de choisir entre production et consommation mais de poursuivre ces deux objectifs de façon coordonnée via des instruments de soutien à l’offre et d’aide aux ménages les plus vulnérables ou d’incitation à la consommation. Pour comparaison, l’Allemagne a mis en place un chèque de 300 euros par enfant et fait le choix de baisser la TVA de trois points pendant six mois. Les États-Unis ont, quant à eux, mis en place un dispositif d’ helicopter money, via le versement d’un chèque de 1 000 dollars à chaque Américain. Si le plan de relance français semble soutenir majoritairement l’offre, il convient de rappeler que le secteur automobile a bénéficié, dès le mois de juin 2020, d’un soutien massif à la demande d’un montant estimé à plus de 1 milliard d’euros, via des primes à la conversion et des hausses de bonus16. De même, le secteur aéronautique a bénéficié d’un plan de soutien de 15 milliards d’euros comprenant une accélération des com mandes publiques dans le secteur militaire. Sur le plan de la consommation, le gouvernement a privilégié un discours visant à rassurer les Français d’une future hausse d’impôts17 , avant de prendre des mesures en faveur des commerces en augmentant le plafond de défiscalisation des chèques- cadeaux et en prolongeant la durée de validité des Tickets-Restaurants.
Un plan de relance, deux approches
« Ce plan [de relance] ne se contente pas de panser les plaies de la crise. Il prépare l’avenir », défendait Jean Castex lors de son discours du 3 septembre 2020. Cette déclaration tranche avec les recommandations adressées par la Banque centrale européenne (BCE) et la Commission européenne lors de la crise de 2008 : pour être efficace, un plan de relance doit répondre à une triple exigence appelée « règle des 3T » (timely, temporary, targeted). Selon cette règle, les mesures de relance doivent être mises en œuvre au bon moment (timely), temporaires (temporary) et ciblées sur les secteurs et les ménages les plus touchés par la crise (targeted). Si la nécessité d’un plan de relance fait consensus chez les économistes, la nature de ses priorités divise ceux qui considèrent, au même titre que la BCE et la Commission européenne, qu’il doit agir en premier lieu sur le court terme et ceux qui pensent, au contraire, qu’il doit préparer le monde de demain. Les premiers, à l’image de l’Institut Montaigne ou de l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE), estiment que le plan de relance français est exagérément fondé sur une stratégie de long terme, au détriment du soutien de l’activité économique à court terme. Selon eux, les mesures conjoncturelles sont trop peu nombreuses alors que les entreprises essuient des pertes immédiates. Ils mettent notamment en évidence la faiblesse de l’effort financier du gouvernement pour garantir la solvabilité des entreprises : le plan de relance prévoit 3 milliards d’euros de soutien aux fonds propres, en supposant qu’un effet de levier du secteur bancaire aboutisse à 15 milliards d’euros. Sur ce point, Éric Heyer, directeur de l’analyse de l’OFCE, estime notamment que les 3 milliards de soutien aux fonds propres des entreprises ne sont pas à la hauteur des faillites annoncées18 et que l’effet de levier de 15 milliards relève avant tout d’un pari. Rien ne garantit en effet que les banques soutiennent les entreprises dans de telles proportions ni qu’elles orientent leurs prêts vers les entreprises en difficulté. À la suite à ces critiques, le gouvernement a décidé de revoir sa copie et de consacrer 20 milliards d’euros au renforcement des fonds propres des entreprises, via des prêts participatifs distribués par les banques19.
Pour les défenseurs du temps long, un plan de relance représente au contraire l’opportunité d’accélérer les transformations en cours (écologique, sociale, numérique, etc.) et de réexaminer les priorités à l ’aune de la crise. Selon cette approche, l’ État doit soutenir les investissements dans les domaines associés aux nouvelles priorités, au risque de faire disparaître les activités irréconciliables avec ces objectifs. De ce point de vue, le plan de relance français contient de nombreuses mesures en lien avec les nouveaux défis révélés par la crise. Il s’agit notamment des dépenses publiques pour la transition énergétique (30 milliards), la réduction des impôts de production (20 milliards) ou encore le prochain programme d’investissements d’avenir (11 milliards). De plus, dans sa proposition de plan de relance européen, la Commission a réaffirmé le cap fixé par le Green Deal à travers notamment le main tien de la réduction des émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030 et la rénovation des bâtiments. Cela ne fait pas taire pour autant toutes les critiques, même parmi les tenants du long terme. Ainsi, l’Institut Veblen déplore le manque de cohérence des plans de relance français et européen, en particulier l’incompatibilité entre les mesures de relance d’activités fortement émettrices de gaz à effet de serre et les mesures favorables à la décarbonation des transports et des bâtiments20. Selon cet institut, certaines des mesures adoptées pourraient principalement bénéficier à des activités polluantes ou émettrices, ce qui irait à l’encontre de l’objectif de transition écologique revendi qué dans le plan de relance. Une façon de remédier à ces conséquences indésirables serait de réclamer des contreparties aux entreprises bénéficiaires de fonds publics, mais on sait que ce type de dispositif risque de ralentir le déploiement des mesures, quand les entreprises sont en situation d’urgence.
Avec des mesures à la fois conjoncturelles et structurelles, France Relance symbolise donc cette dualité d’objectifs combinant l’atténuation de la crise à court terme et la transformation de l’ économie à plus long terme. Il prend ainsi le risque de courir deux lièvres à la fois et de ne satisfaire pleinement aucun des protagonistes du débat.
Les politiques de relance budgétaire : débats et controverses
La doctrine du « quoi qu’il en coûte » prononcée par Emmanuel Macron, le 12 mars 2020, n’est pas nouvelle. Elle fut aussi celle de Mario Draghi (« whatever it takes »), à l’été 2012, alors que la zone euro était au bord de l’implosion. Depuis quelques années, les périodes de crise remettent au goût du jour les remèdes d’inspiration keynésienne et, par là même, l’idée que les dépenses publiques ont un rôle majeur à jouer pour préserver les équilibres économiques. La crise du Covid-19 n’a pas dérogé à la règle : les États du monde se sont endettés massivement pour sauver puis relancer la machine économique. Cette politique a même fait l’objet d’un large consensus chez les économistes, y compris parmi les grands défenseurs de l’austérité avant mars 2020. Ainsi, l’Allemagne, chantre de l’orthodoxie budgétaire, a contracté, dès le mois de mars, un emprunt de 156 milliards d’euros, suivi d’un plan de relance très ambitieux de 130 milliards. « C’est vraiment le moment keynésien par excellence », défendait l’économiste Esther Duflo, prix Nobel d’économie 201921. En effet, la relance budgétaire – par l’augmentation des dépenses publiques – a un effet multiplicateur sur l’économie, permettant un accroissement de la demande plus que proportionnel aux injections publiques initiales. Par ailleurs, les multiplicateurs budgétaires sont particulièrement élevés en temps de crise (Blanchard et Leigh, 2013) .
Pour autant, ces dépenses de l’État d’une ampleur exceptionnelle et allouées sans contrepartie ont soulevé plusieurs questionnements dans le débat public français – nous n’abordons volontairement ici que les controverses relatives aux instruments ciblant les entreprises. Le premier questionnement a porté sur le risque de multiplication des entreprises « zombies » depuis le début de la crise sanitaire. L’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) définit les entreprises zombies comme des entreprises ayant au moins dix ans d’existence et dont le revenu, pendant au moins trois années consécutives, est insuffisant pour couvrir les intérêts suscités par leur endettement. Selon un rapport de France Stratégie, la part des entreprises zombies au sens de l’OCDE était relativement faible en France : sur la période 2013-2016, elle variait entre 3,9% et 4,6% de l’ensemble des entreprises, contre 5% en moyenne dans les pays de l’OCDE (France Stratégie, 2019). Dans le contexte de la crise sanitaire, le soutien public inconditionnel aux entreprises (PGE, chômage partiel, report de charges, subventions, etc.) risque de renforcer le phénomène de « zombification ». Une proportion trop importante d’entreprises zombies dans l’économie traduit un ralentissement du renouvellement du tissu productif, autrement dit une mauvaise allocation des ressources productives, en bloquant du capital qui pourrait être mobilisé dans le développement d’entreprises plus performantes. Or, une étude récente du Trésor (David et al., 2020) montre que le phénomène schumpetérien de destruction créatrice – l’entrée et la sortie d’entreprises du marché – est le principal moteur des gains de productivité en France depuis la crise de 2008. De ce point de vue, l’État aurait donc tort de sauver indifféremment toutes les entreprises, y compris les moins productives, sous peine d’effets pervers sur l’économie. Pour certaines entreprises zombies en effet, les aides publiques ne font que retarder la faillite de quelques mois ; mais pour d’autres, elles maintiennent un état de fait qui peut durablement affecter l’activité économique. Une étude de la Banque des règlements internationaux (Banerjee et Hofmann, 2020) montre en effet que les entreprises « survivantes » (soit 60% des entreprises zombies) sont généralement peu dynamiques en matière d’emploi et d’investissement productif. Il n’est donc pas étonnant que la pandémie de Covid-19 ait remis ce débat sur le devant de la scène : l’État doit-il soutenir massivement toutes les entreprises ou, au contraire, laisser opérer le processus de « destruction créatrice » cher à l’économiste Schumpeter ? Il n’est pas facile de trancher ce débat, d’autant moins que le tri ex ante entre les entreprises qui deviendront zombies et celles qui retrouveront le chemin de la rentabilité est un exercice impossible. Toutefois, dans un récent rapport d’étape, le comité chargé de l’évaluation des mesures de soutien financier aux entreprises confrontées à l’épidémie de Covid-1922 s’est montré rassurant : les entreprises repérées ex post comme défaillantes et comme « zombies » n’ont pas mobilisé les mesures de soutien financier au-delà de leur part dans l’économie (soit respectivement 4% et 3%).
En période de crise, une autre question revient invariablement dans le débat public : celle de la soutenabilité de la dette publique. Il est vrai que l’ampleur des mesures mises en œuvre pendant la crise sanitaire a conduit les États européens à s’endetter massivement auprès de la BCE. Selon les derniers chiffres de l’Insee, la dette publique française n’a cessé d’augmenter au cours de l’année 2020, bien au-delà du seuil symbolique de 100% du PIB : au troisième trimestre, la dette publique a atteint 116,4% du PIB, contre 98,1% fin 2019. Sous la présidence de Jean Arthuis, ancien ministre des Finances de Jacques Chirac, une commission d’experts visant à réduire la « dette Covid » a ainsi été mise en place dès le mois de décembre 2020. La commission s’est donné comme objectifs la stabilisation puis la réduction progressive de la dette publique française. Pourtant, de nombreux économistes – à l’instar de l’ancien chef économiste du Fonds monétaire international (FMI), Olivier Blanchard – jugent que la question de la dette publique ne doit pas intervenir trop tôt dans le débat, sous peine de produire les effets inverses de ceux qui étaient escomptés23. De ce point de vue, la gestion de la crise de 2008 dans la zone euro offre un cadre d’analyse intéressant. En effet, les politiques d’austérité alors mises en œuvre dans les pays d’Europe du Sud se fondaient sur l’idée d’un multiplicateur budgétaire particulièrement faible, autour de 0,5. En clair, les plans d’austérité seraient faiblement récessifs à court terme, et donc d’autant plus efficaces à long terme. Toutefois, la récession observée dans la zone euro dès 2010 a jeté le discrédit sur cette analyse et conduit les économistes à de nouvelles évaluations. Ainsi, les économistes Olivier Blanchard et Daniel Leigh (2013) ont montré que les effets négatifs des politiques d’austérité avaient été sous-estimés car, selon leur analyse, le multiplicateur budgétaire se situerait plutôt entre 0,9 et 1,7. Ce résultat ne signifie pas qu’une politique de consolidation budgétaire ne soit pas souhaitable mais qu’elle doit intervenir au bon moment, une fois la crise passée. Par ailleurs, la contraction de la « dette Covid » s’inscrit dans un contexte particulier dans lequel la BCE a fait passer les taux d’intérêt directeurs en territoire négatif. Dit autrement, plus la dette est élevée, moins son coût est important. Il n’est donc pas étonnant que le débat qui agite les économistes, dans le contexte de la crise sanitaire, porte moins sur l’opportunité d’augmenter ou non la dette publique que sur celle de son annulation24. En effet, l’accumulation de la dette publique et la crainte que celle-ci pèse à long terme sur la croissance poussent certains économistes à militer en ce sens. Ces derniers, à l’image de Jézabel Couppey-Soubeyran, considèrent que l’amoncellement de la dette publique est une épée de Damoclès sur la tête des États qui fera prématurément ressurgir les politiques d’austérité. En revanche, selon Agnès Bénassy-Quéré, cheffe économiste du Trésor, l’annulation de la dette a pour conséquence la perte de confiance des investisseurs en la monnaie. De plus, elle n’est pas utile dans un contexte de taux d’intérêt bas. Pour les tenants de l’annulation, rien ne garantit que la BCE poursuivra sa politique de rachats de titres de dettes, ni que les taux ne remonteront pas à moyen terme. Autre argument de poids : la politique monétaire expansionniste de la BCE enrichit les détenteurs d’actifs financiers25 et accroît ainsi les inégalités. Ce débat d’experts pourrait ressurgir à l’occasion de l’élection présidentielle de 2022.
- 1. https://www.usinenouvelle.com/article/le-coronavirus-met-les-chaines-d-approvisionnement-des-industriels-sous-haute-tension.N936044
- 2. https://www.usinenouvelle.com/editorial/face-au-coronavirus-la-filiere-electronique-francaise-veut-sortir-de-sa-dependance-vis-a-vis-de-la-chine.N934694
- 3. https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/renault-frappe-a-son-tour-par-la-penurie-de-semi-conducteurs-dans-lautomobile-1287923#xtor=CS1-3046
- 4. https://www.ouest-france.fr/economie/le-stress-d-un-equipementier-automobile-face-au-coronavirus-6780564
- 5. https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/en-direct-michelin-ouvre-le-bal-des-fermetures-dusines-a-cause-du-coronavirus-1185646
- 6. Douanes françaises.
- 7. https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/11/25/covid-19-les-compagnies-aeriennes-essuient-100-milliards-d-euros-de-pertes-en-2020_6061058_3234.html
- 8. https://www.usinenouvelle.com/article/touche-de-plein-fouet-par-la-crise-du-covid-19-airbus-reduit-d-un-tiers-sa-production-d-avions.N951761
- 9. https://www.usinenouvelle.com/article/exclusif-le-gouvernement-va-autoriser-le-click-and-collect-dans-les-concessions-automobiles.N1022234
- 10. Ensemble de l’industrie, hors construction.
- 11. Ce taux est toutefois bien plus élevé encore dans les secteurs frappés par les mesures administratives (interdictions ou restrictions d’accueil du public). Les arrêts ont ainsi surtout affecté les entreprises de la restauration (87 % ), de l’hébergement (68 % ), des services à la personne (56 % ) et des activités culturelles et récréatives (56 % ).
- 12. Un prêt garanti par l’État est un prêt octroyé à une entreprise par une banque, en période de crise, grâce à la garantie apportée par l’État sur une partie significative du prêt. Dans le contexte de la crise sanitaire, les entreprises peuvent emprunter jusqu’à 25 % de leur chiffre d’affaires. L’État garantit entre 70 % et 80 % des prêts pour les entreprises de plus de 5 000 salariés et jusqu’à 90 % pour les autres.
- 13. https://www.francetvinfo.fr/economie/plan-de-relance/covid-19-le-gouvernement-prend-il-trop-de-risques-avec-les-prets-garantis-par-l-etat-pour-faire-face-a-la-crise_4193527.html
- 14. Les principaux impôts de production sont la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S), la cotisation foncière des entreprises (CFE) et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).
- 15. Réformée à plusieurs reprises sous le quinquennat Hollande, la C3S ne concerne plus que les grandes entreprises, au-delà de 19 millions de chiffre d’affaires.
- 16. https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/automobile-un-plan-historique-de-relance-a-8-milliards-deuros-1205928
- 17. https://www.lefigaro.fr/flash-eco/non-pas-de-hausse-d-impots-selon-bruno-le-maire-20201129
- 18. https://www.usinenouvelle.com/editorial/il-faut-une-politique-de-l-offre-de-court-terme-selon-l-economiste-eric-heyer.N1012564
- 19. Le prêt participatif est destiné au financement à long terme des entreprises, tout particulièrement des PME. À l’origine, son remboursement est subordonné au remboursement intégral par l’emprunteur de toutes ses autres créances bancaires. Il ne confère aucun droit de vote au prêteur et il est accordé moyennant le service d’un intérêt fixe, généralement majoré d’une participation au bénéfice net de l’emprunteur. Ces caractéristiques lui valent d’être présenté comme un produit de fonds propres, contribuant à améliorer la structure financière des entreprises, et à ne pas être inclus dans l’endettement. La qualification de « quasi-fonds propres » entraîne, pour la société qui y recourt, une amélioration de sa structure financière sans qu’il soit procédé à une augmentation de capital. Après avoir été délaissé dans les années 1990, le prêt participatif a refait son apparition en 2008, ayant servi de support aux prêts de l’État en faveur des entreprises en difficulté, notamment les constructeurs automobiles, et aux interventions d’Oseo devenu Bpifrance. (tiré de : https://entreprises.banque-france.fr/sites/default/files/bdf_reffin_chap4_411.pdf)
- 20. Institut Veblen (2020), « Pour une relance européenne fidèle au “serment vert” », mai.
- 21. https://www.latribune.fr/economie/france/coronavirus-l-economiste-esther-duflo-encourage-la-depense-publique-843910.html
- 22. France Stratégie, « Comité de suivi et d ’évaluation des mesures de soutien financier aux entreprises confrontées à l ’épidémie de Covid-19 », rapport d ’étape, avril 2021.
- 23. https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/04/27/olivier-blanchard-cette-crise-va-renforcer-la-deglobalisation_6037836_3234.html
- 24. https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/12/24/annuler-la-dette-publique-le-ton-monte-entre-les-economistes_6064430_3234.html#xtor=AL-32280270
- 25. La politique expansionniste de la BCE induit une baisse des rendements sur les obligations d’État et pousse ainsi les investisseurs à chercher des rendements plus élevés, causant une envolée du prix des actifs financiers.
Tirer parti des outils de flexibilité
Face aux rigidités institutionnelles du marché de l’emploi, les outils de flexibilité interne représentent pour les entreprises une ressource essentielle pour adapter leur niveau de production à la situation économique. Parmi les instruments mobilisables, le chômage partiel est de loin le plus plébiscité tant par les entreprises que par les syndicats de salariés. En période de crise conjoncturelle, il constitue pour les premières un soutien public aux stratégies de flexibilisation de l’emploi et, pour les seconds, un substitut – partiel ou total – à la baisse des revenus. Mais, cette mesure de soutien vient en complément d’autres dispositifs visant à éviter les licenciements. En France, les accords d’entreprise, à l’instar des APC (accords de performance collective), semblent avoir été un outil privilégié par les entreprises pendant la crise du Covid-19. Si certains veulent y voir un instrument adapté pour traverser la crise en minimisant son impact sur les salariés, d’autres suggèrent au contraire qu’il est un instrument de « chantage à l’emploi ». L’exemple allemand, lors de la crise de 2008, montre que l’usage de ce type de mécanismes alternatifs au licenciement se fonde nécessairement sur un dialogue social de qualité.
Le chômage partiel : une politique efficace de sauvegarde de l’emploi en temps de crise
L’activité partielle, plus connue sous le nom de chômage partiel, est un dispositif qui permet aux entreprises confrontées à des difficultés temporaires de diminuer ou de suspendre provisoirement l’activité de tout ou partie de leurs salariés (voir encadré 1). Grâce à la prise en charge par l’État, partielle ou totale, des heures non travaillées, ce dispositif atténue le coût de la réduction d’activité aussi bien pour le salarié que pour l’employeur. En effet, il permet au premier de conserver son emploi et une partie, voire l’intégralité de sa rémunération. Pour le second, le recours au chômage partiel constitue un instrument de flexibilité interne lui permettant d’ajuster la main-d’œuvre à l’activité économique. Enfin, du point de vue de l’État, il permet de soutenir le pouvoir d’achat et de maintenir la structure productive de l’économie, en mutualisant le coût économique et social de la crise. Le chômage partiel a donc une double dimension, individuelle et collective.
Encadré 1 : L’activité partielle en France (hors dispositif exceptionnel)
Selon l’article R5122-1 du Code du travail, l’activité partielle s’adresse à tous les établissements du secteur privé confrontés à une réduction ou une suspension d’activité imputable aux motifs suivants :
• conjoncture économique,
• difficultés d’approvisionnement,
• transformation, restructuration ou modernisation de l’entreprise,
• sinistres,
• toute autre circonstance à caractère exceptionnel.
Chaque établissement peut avoir recours à l’activité partielle pour une durée maximale de six mois et un nombre d’heures chômées n’excédant pas 1 000 heures par salarié et par an. Chaque heure chômée au titre de l’activité partielle est indemnisée à hauteur de 70 % du salaire horaire brut du salarié, soit environ 84 % de son salaire net – dans la limite du salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic)26. Si cette allocation est d’abord prise en charge par l’établissement, celui-ci se voit ensuite remboursé par l’État et l’Unédic d’une subvention horaire de 7,23 euros ou 7,74 euros selon qu’il a plus ou moins de 250 salariés. Si la rémunération du salarié, après versement, est inférieure au Smic net, alors l’employeur verse au salarié une indemnité complémentaire de façon à maintenir l’intégralité de sa rémunération nette.
Pour recourir à l’activité partielle, un établissement doit transmettre à l’unité territoriale de la Direccte27 dont il relève une demande d’autorisation préalable. L’unité territoriale instruit cette demande et rend sa décision sous quinzaine. En cas d’autorisation, l’administration spécifie le nombre d’heures, l’effectif et les montants autorisés au titre de l’activité partielle ainsi que la période au cours de laquelle le dispositif peut être utilisé.
Le recours au chômage partiel, d’une ampleur inégalée depuis la Grande Récession
À chaque crise économique, le dispositif de chômage partiel connaît un regain d’in térêt. Lors de la Grande Récession de 2008-2009, il avait été encouragé dans de nombreux pays de l’OCDE. Ainsi, la France avait créé en mai 2009 un dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD) qui venait compléter l’activité partielle « classique ». Il permettait une meilleure indemnisation des salariés et pouvait en outre la prolonger jusqu’à 12 mois, en contrepartie de nouvelles obligations légales pour l’employeur, parmi lesquelles le maintien en emploi des salariés pendant le double de la durée de la convention APLD et l’organisation avec eux d’entretiens individuels consacrés aux possibilités de formation. Pour autant, en France, la part des salariés concernés par ces dispositifs au plus fort de la crise de 2008 n’avait que timidement excédé 1 % de l’emploi total. C’est en Allemagne que le recours au chômage partiel (Kurzarbeit) avait été particulièrement im portant : jusqu’à 1,5 million de salariés en avaient bénéficié, soit 4 % de l’emploi total. Ainsi, alors que le PIB du pays s’était effondré de 5,7 % en 2009, le taux de chômage n’avait quasiment pas augmenté. Conséquence de son degré d’ouverture au commerce extérieur, l’industrie manufacturière allemande avait été considérablement touchée par la crise. Entre 2008 et 2009, elle avait enregistré un recul de 17 % de sa production. Mais l’emploi manufacturier, quant à lui, était resté remarquablement stable (–180 000 emplois). Ce « miracle de l’emploi», selon le terme consacré par la presse allemande28, contrastait alors avec la très forte dégradation de l’emploi manu facturier observée dans la plupart des pays européens (voir figure 2.1).
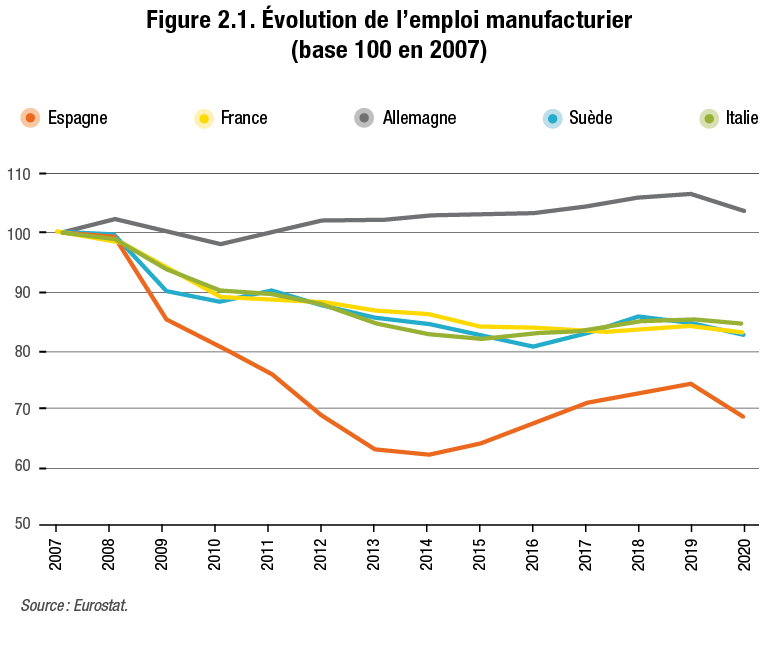
Afin d’endiguer la propagation du Covid-19, les gouvernements européens ont imposé, dès la mi-mars 2020, des restrictions entraînant l’arrêt d’une grande partie de l’économie. Ces mesures d’urgence sanitaire ont très fortement impacté les marchés du travail européens, alors contraints de s’ajuster à la chute d’activité. Afin de maintenir les revenus des salariés et de préserver le tissu économique, les gouvernements ont réformé le dispositif de chômage partiel ou l’ont créé, de façon à en favoriser le recours par les entreprises29. En France, le recours à l’activité partielle a atteint des sommets : en avril 2020, 8,4 millions de personnes représentant 29 % des salariés du privé étaient concernées (voir figure 2.2), à comparer à un maximum de 273 400 salariés durant la Grande Récession et à un taux de recours juste avant crise, en fé-vrier 2020, de 1 % de l’emploi salarié30. Lors du deuxième confinement, en novembre 2020, ce recours au chômage partiel était bien moindre (8 %) mais concernait encore un peu plus de 3 millions de salariés. Cette forte mobilisation du dispositif au cours de la crise sanitaire n’aurait pas été possible sans son assouplissement temporaire. En effet, le gouvernement français a apporté plusieurs modifications. D’une part, l’allocation de chômage partiel à hauteur de 70 % du salaire brut est prise en charge, depuis mars 2020, jusqu’à 4,5 Smic. D’autre part, la durée maximale d’indemnisation, initialement fixée à six mois, a été prolongée par décret à 12 mois jusqu’au 31 mars 202131. Enfin, depuis le 1er juillet 2020, un nouveau dispositif spécifique d’APLD a été mis en œuvre, dans le cadre du plan de relance, pour permettre aux entreprises confrontées à une réduction d’activité durable de diminuer l’horaire de travail des salariés pour une durée de six mois renouvelables, dans la limite de 24 mois et en contrepartie d’engagements en matière de maintien de l’emploi notamment32. Ces mesures temporaires montrent comment le chômage partiel est devenu un instrument central dans la gestion de la crise sanitaire en France.

Selon les estimations de la Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares), les trois secteurs d’activité ayant eu le plus grand nombre de salariés en activité partielle, en avril 2020, étaient le commerce (1 530 000), les services aux entreprises (1 356 000) et l’industrie manufacturière (1 224 000). Si toutefois on analyse ces chiffres avec une maille plus fine, on constate que la situation est très contrastée au sein même de l’industrie manufacturière. La fabrication des matériels de transport, comprenant principalement les secteurs automobile et aéronautique, compte parmi les secteurs ayant eu le plus fort taux de recours à l’activité partielle. En mars 2020, 35 % des salariés du secteur étaient en activité partielle, contre 19 % dans l’industrie agroalimentaire (voir figure 2.3). Au cours du deuxième confinement, la fabrication des matériels de transport faisait partie des cinq secteurs ayant le plus fort taux de recours à ce dispositif. Dans l’ensemble toutefois, le rebond lié au deuxième confinement a été plus contenu dans l’industrie manufacturière que dans d’autres secteurs : dans l’industrie, en novembre 2020, 302 000 salariés étaient en activité partielle, après 248 000 en octobre, soit 22 % d’augmentation. Pour comparaison, au même moment, ce nombre a plus que doublé dans le secteur du commerce et augmenté de 41 % dans l’hébergement et la restauration.
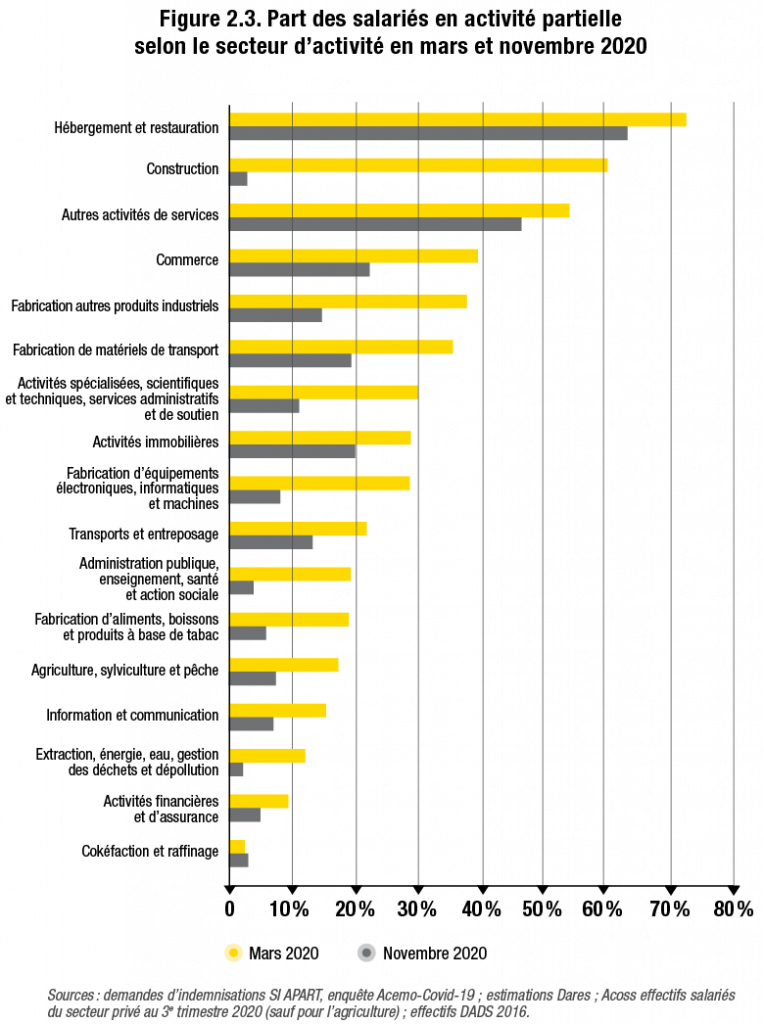
Un amortisseur social en temps de crise
Dans le contexte de la crise sanitaire, le chômage partiel a été un instrument efficace, au moins transitoirement, pour éviter les destructions d’emploi. L’OFCE a évalué l’impact des restrictions sanitaires sur l’emploi dans cinq grands pays de l’Union européenne – l’Allemagne, la France, l’Italie, l’Espagne et le Royaume-Uni – ainsi qu’aux États-Unis (OFCE, 2020). Selon leur analyse, réalisée à partir des matrices entrées-sorties au niveau mondial, les destructions d’emplois potentielles auraient pu atteindre 25 à 36 % de l’emploi salarié total au cours du mois d’avril 2020 quand, dans les faits, elles n’en ont représenté qu’environ 1 % en France et en Italie, 3 % en Espagne et au Royaume-Uni et un peu plus de 4 % en Allemagne. Pour cette dernière, les pertes sèches d’emplois ont été plus importantes en raison du poids élevé des minijobs qui, faute d’être couverts par l’assurance chômage, sont exclus du dispositif de chômage partiel. La comparaison avec les États-Unis permet d’apprécier le rôle d’amortisseur du dispositif. En effet, la mutualisation des salaires n’existant pas ou quasiment pas aux États-Unis33, les entreprises n’ont d’autre choix que de licencier ou de subir le coût financier du maintien en emploi des salariés. Selon les données du Bureau international du travail (BIT) et les calculs de l’OFCE, les 22,4 millions d’emplois détruits aux États-Unis ont représenté 48 % de la baisse de la demande de travail par les entreprises américaines (voir figure 2.4). Ce résultat exprime tout à la fois la flexibilité qui caractérise le marché du travail américain mais aussi la forte rétention de main-d’œuvre par les entreprises américaines pourtant dépourvues d’un mécanisme de chômage partiel. Pour comparaison, le chômage partiel a couvert 77 % des salariés concernés par la baisse de la demande de travail en France, 82 % au Royaume-Uni, 75 % en Italie, 72 % en Espagne et 58 % en Allemagne.
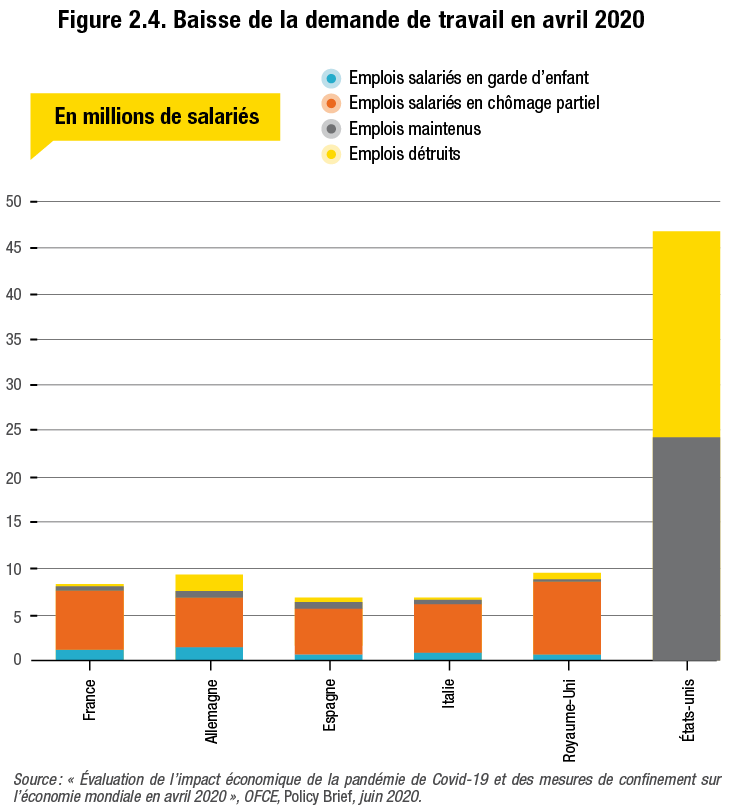
Un dispositif efficace durant la Grande Récession de 2008-2009
Si le chômage partiel constitue un avantage manifeste en période de crise économique, tant pour l’emploi que pour la capacité des entreprises à reconstituer rapidement leur force de travail, il lui est souvent reproché d’encourager la rétention excessive de main-d’œuvre et de n’avoir ainsi pour seul effet que de retarder les licenciements. D’autres effets pervers lui sont également associés. Le chômage partiel peut donner lieu à des effets d’aubaine dans la mesure où certains établissements peuvent y recourir alors même qu’ils auraient maintenu le niveau d’emploi en l’absence du dispositif. A contrario, il peut maintenir artificiellement en vie des entreprises confrontées à des difficultés structurelles et ainsi empêcher la réallocation de la main-d’œuvre vers des secteurs d’activité plus productifs.
Il est encore trop tôt pour évaluer si le déploiement du chômage partiel pendant la présente crise sanitaire aura eu globalement plus d’effets positifs que négatifs à long terme sur l’emploi. L’évaluation du dispositif a toutefois fait l’objet de nombreux travaux empiriques, particulièrement en Allemagne après 2009. Les études macroéconomiques> mettent globalement en évidence un impact positif du chômage partiel sur l’emploi dans un contexte de crise économique. Dans les Perspectives de l’emploi 2010, l’OCDE développe un modèle empirique et estime que « les dispositifs de chômage partiel auraient permis de préserver, au 3e trimestre 2009, plus de 220 000 emplois en Allemagne ». Selon Hijzen et Venn (2011), le chômage partiel a permis de sauvegarder environ 230 000 emplois, soit 0,8 % de l’emploi total. Dans le même pays et sur la même période, Balleer et al. (2016) montrent que ce dispositif a évité une augmentation du chômage allemand de 1,29 point de pourcentage, soit la destruction de 466 000 emplois environ. Il apparaît ainsi clairement qu’il a aidé à la préservation d’emplois pendant la crise.
Qui plus est, cet effet bénéfique semble avoir été durable, ce qui n’était pas évident a priori. En effet, le chômage partiel aurait pu en théorie provoquer une baisse temporaire de la productivité, qui se serait réajustée « naturellement » à moyen terme par le biais de destructions d’emploi. Or, ce phénomène ne s’est nullement produit en Allemagne : dans les années qui ont suivi la crise, le niveau d’emploi dans le secteur manufacturier a augmenté (voir figure 2.1). Alors qu’on pouvait craindre que le rattrapage de la productivité aurait pesé sur l’emploi à moyen terme, la reprise de la croissance a permis de le compenser. Sur données françaises, une étude récente cosignée par Cahuc, Kramarz et Nevoux (2018) montre que l’activité partielle a non seulement permis de sauver 30 000 emplois entre 2008 et 2009, au sein des établissements confrontés à une baisse considérable de leur chiffre d’affaires, mais également de contribuer à la survie d’établissements structurellement viables à long terme. Dans les années qui ont suivi la crise, la croissance de l’emploi dans les établissements qui ont recouru à l’activité partielle en 2009 s’est ainsi révélée plus rapide que celle des établissements confrontés à un choc similaire mais qui n’ont pas eu recours au dispositif. En revanche, pour les établissements exposés à une baisse modérée de leur chiffre d’affaires, le recours à l’activité partielle s’est traduit par une réduction des heures travaillées sans effet positif sur l’emploi. Dit autrement, ces établissements auraient maintenu leur niveau d’emploi même en l’absence du dispositif d’activité partielle. Selon les auteurs, ces effets d’aubaine seraient toutefois négligeables par rapport à ceux d’autres politiques de l’emploi, parmi lesquelles les subventions salariales ou à l’embauche.
Du point de vue des entreprises, la stratégie de thésaurisation de la main-d’œuvre leur permet de faire des économies substantielles, notamment sur les coûts de transaction. En l’absence de chômage partiel, elles doivent prendre en charge les coûts de licenciement économique, puis les coûts liés à la recherche et à la formation de nouveaux salariés. Sur données allemandes, Bosch (2010) estime que le licenciement d’un million de salariés durant la crise de 2008 suivi du réembauchage d’un même nombre de salariés après la crise aurait coûté 44 milliards d’euros aux entreprises. Pour comparaison, le coût du chômage partiel pour les entreprises allemandes est estimé à 5 milliards d’euros (Bach et Spitznagel, 2009). Cette thésaurisation de la main-d’œuvre apparaît ainsi comme un investissement très rentable pour les entreprises.
Au cours des dernières années, la plupart des études économétriques ont souligné les effets bénéfiques du chômage partiel en période de crise. Son usage particulièrement important en Allemagne, pendant la crise de 2008, a coïncidé avec la forte résilience de son marché du travail. Au lendemain de la Grande Récession, certains pays, au premier rang desquels figure la France34, ont ainsi mis en place des réformes visant à accroître la générosité de leur dispositif. Il n’est donc pas étonnant que le chômage partiel ait constitué la mesure phare des gouvernements européens au cours de la crise sanitaire actuelle.
Les accords d’entreprise, outils de gestion de crise ou de chantage à l’emploi ?
En cette période de baisse d’activité et de forte incertitude, les accords de performance collective (APC) connaissent un succès croissant. Les exemples médiatiques ne manquent pas : Valeo, Derichebourg, Lisi, Aéroports de Paris, etc. Les petites et moyennes entreprises ne sont pas en reste. Sur les 371 APC conclus jusqu’en juin 2020, la majorité l’a été au sein de TPE et PME (France Stratégie, juillet 2020).
L’accord de performance collective est l’héritier des accords de maintien de l’emploi (AME) et des accords en faveur de la préservation et du développement de l’emploi (APDE). Alors que ces deux dispositifs ont eu très peu de succès – seulement dix AME ont été signés au total alors que leur existence est prévue depuis juin 2013 – les APC se démarquent par leur plus grande attractivité auprès des dirigeants d’entreprise. Il faut dire que ce dispositif est beaucoup plus souple que les précédents. Créé par les « ordonnances Macron » du 22 septembre 2017, l’accord de performance collective peut être conclu35 pour « répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise ou en vue de préserver, ou de développer l’emploi » (article L2254-2). Sa légitimité ne repose donc plus exclusivement sur la défense de l’emploi, contrairement à ses prédécesseurs. Par ailleurs, l’APC peut porter sur des domaines variés, tels que l’aménagement du temps de travail, la rémunération des salariés et les conditions de la mobilité géographique et professionnelle interne à l’entreprise. Une autre particularité de l’APC est de pouvoir être mobilisé en toutes circonstances, que l’entreprise doive faire face à des difficultés économiques ou qu’elle souhaite développer sa compétitivité. Enfin, l’accord peut être conclu pour une durée tant déterminée qu’indéterminée. En pratique, le refus du salarié l’expose à être licencié pour cause réelle et sérieuse. Dans l’ensemble, l’APC accorde une grande marge de manœuvre aux employeurs, au détriment des accords de branche36, au point même de brouiller la frontière entre gestion de crise et gestion normale de l’entreprise.
Les APC : une alternative au licenciement ?
Lors de son allocution du 14 juillet 2020, Emmanuel Macron a présenté l’accord de performance collective comme un bouclier anti-licenciement. Il a dit préférer « qu’il y ait des salaires que l’on accepte de baisser momentanément plutôt qu’il y ait des licenciements ». Précisons que les plans de sauvegarde de l’emploi (PSE) ont été nombreux en 2020. La crise sanitaire a entraîné une série de licenciements collectifs, en particulier dans les filières aéronautique et automobile. Au total, entre mars et décembre 2020, près de 80 400 ruptures de contrats de travail ont été envisagées dans le cadre de PSE, soit trois fois plus qu’en 2019 sur la même période37. Le secteur de l’industrie manufacturière a concentré 37 % des ruptures, suivi par les secteurs du commerce et de la réparation (19 %), puis du transport et de l’entreposage (9 %) et de l’hébergement-restauration (9 %). Les accords de performance collective auraient donc vocation à éviter le coût social des procédures collectives de licenciement et à limiter les fermetures d’établissements. L’exemple récent de Derichebourg Aeronautics Services, sous-traitant d’Airbus, va dans ce sens. L’entreprise, qui prévoyait un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) de 700 licenciements, s’est engagée à ne procéder à aucun licenciement en échange d’efforts consentis par les salariés sur leur rémunération38. Mais si certains veulent y voir une alternative aux PSE, d’autres considèrent que l’accord de performance collective est un instrument de chantage à l’emploi, faisant porter tout le poids de la crise sur les salariés. Dès lors, quel rôle peut jouer ce type d’accord dans un contexte de crise conjoncturelle ?
Il n’est pas aisé de répondre à cette question car, pour des raisons évidentes de disponibilité de données, les rares travaux sur le sujet portent sur la période 2017-2019, donc avant la crise. Les travaux d’Hélène Cavat (2020), doctorante en droit, donnent un éclairage intéressant sur l’usage et le contenu des APC avant la pandémie de Covid-19. À partir d’un échantillon de 119 accords de performance collective conclus en 2018, elle montre que les APC sont essentiellement négociés dans l’industrie (37 %) et dans le commerce (20 %). Le sujet du temps de travail est prépondérant dans ces accords : deux tiers d’entre eux portent sur ce thème. Ils prévoient notamment d’augmenter le temps de travail (37,6 %), de le flexibiliser (19 %) ou encore d’organiser des variations ponctuelles ou définitives du lieu de travail (33 %). La rémunération est aussi au cœur de ces accords : pour la moitié d’entre eux, la rémunération est diminuée ou sa part variable augmentée. Par ailleurs, Cavat montre que, en 2018, 76 % des APC ont été conclus au nom du fonctionnement de l’entreprise, pour améliorer la compétitivité, contre seulement 30 % conclus au nom de la préservation de l’emploi et 11 % pour son développement39. Enfin, les accords offrent peu de contreparties puisque l’auteur montre que seulement 3 % des APC prévoient des efforts de la part des dirigeants d’entreprise ou des actionnaires. De même, seuls 10 % des accords contiennent des contreparties chiffrées en matière d’investissements ou de maintien de l’emploi.
Un rapport intermédiaire de France Stratégie visant à évaluer les « ordonnances Macron » du 22 septembre 2017 (France Stratégie, juillet 2020) confirme les analyses précédentes. Sur les 371 APC conclus jusqu’à juin 2020, les thèmes du temps de travail et de la rémunération sont prépondérants dans les négociations (voir figure 2.5). Le rapport montre également que les trois quarts des accords de performance collective sont conclus pour une durée indéterminée, suggérant qu’ils sont moins utilisés pour répondre à des besoins conjoncturels ou faire face à une période défavorable que pour modifier durablement les conditions de travail. Le rapport de France Stratégie pointe ainsi les risques de détournement de ce type d’accord, notamment dans un contexte de crise économique où le rapport de force défavorable aux salariés sur le marché de l’emploi risque de créer des effets d’aubaine pour les employeurs. Dans un contexte de forte pression sur l’emploi, l’accord de performance collective ne risque-t-il pas en effet de faire porter le poids des difficultés économiques, jusqu’à la fermeture d’une usine, sur les salariés ? La fermeture récente de l’usine Bridgestone à Béthune avait été précédée par le rejet massif d’un projet d’APC40. Mais quand la fermeture d’une usine est évitée, au prix de conditions de travail dégradées, est-ce un moindre mal ? Gilbert Cette, économiste, et Jacques Barthélémy, avocat-conseil en droit social, répondent en tout cas par l’affirmative, déclarant dans une tribune au Monde du 29 août 202041, que les accords de performance collective font « primer l’intérêt de la collectivité de travail sur celui du travailleur individuel ». De ce point de vue, le dispositif inciterait le salarié à se montrer, en quelque sorte, solidaire des difficultés de l’entreprise, tout en le dissuadant de se faire licencier s’il refusait les termes de l’APC (l’indemnisation de son licenciement étant plus limitée que lors d’un plan de sauvegarde de l’emploi, ou PSE). Mais cette analyse selon laquelle l’usage des APC fait primer l’intérêt collectif sur l’intérêt individuel suppose, au minimum, un équilibre des pouvoirs entre les deux parties. Or, les conditions d’un accord équilibré ne sont pas toujours réunies. La crise du Covid-19 et ses répercussions économiques majeures appellent à d’autres travaux sur l’usage des APC en période de retournement conjoncturel.
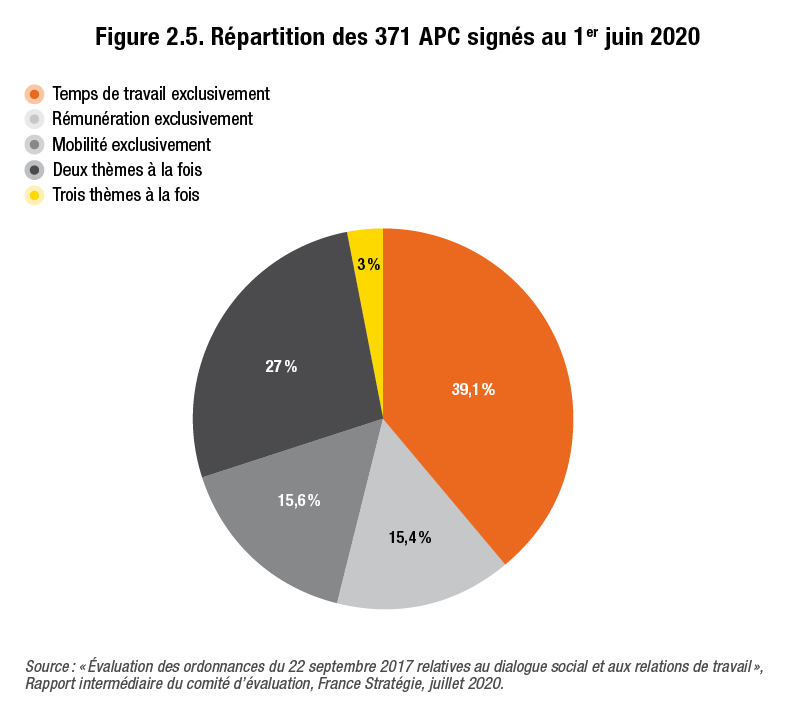
L’efficacité des accords d’entreprise dépend de la qualité du dialogue social : l’exemple allemand lors de la Grande Récession
Lors de la crise de 2008, le chômage partiel n’a pas été l’unique outil de flexibilité mobilisé par les entreprises allemandes, loin s’en faut (Fréhaut, 2012 ; Zapf, 2011). De nombreux outils de flexibilisation du temps de travail coexistent en Allemagne, parmi lesquels les comptes épargne-temps (CET), les baisses transitoires du temps de travail42, les droits à congé ou d’autres mesures en lien avec la souplesse de la convention collective ou des accords d’entreprise (baisse de salaire, reconversion, mutation, etc.). Ces mesures doivent être déterminées par un accord collectif, signé au niveau de la branche ou de l’entreprise. Dans cet éventail d’outils à la disposition des entreprises, les CET et les baisses transitoires du temps de travail ont été particulièrement plébiscités en Allemagne (voir figure 2.6). Les premiers permettent aux entreprises de gérer au mieux le temps de travail réellement effectué par les salariés. Lorsque le temps de travail excède le niveau convenu, le différentiel est inscrit à l’actif du CET ; lorsqu’il est en deçà, le différentiel est inscrit au passif du CET. Le second dispositif est de plus en plus répandu dans les conventions collectives et les accords d’entreprise. En Allemagne, il existe en effet des « corridors de temps de travail » qui consistent à définir des plages d’évolution possible du temps de travail entre une limite minimale (plancher) et une limite maximale (plafond). Ces variations possibles et transitoires de la durée conventionnelle du temps de travail permettent de s’adapter au niveau d’activité de l’entreprise et ainsi d’éviter le coûteux recours aux heures supplémentaires et au chômage partiel (Fréhaut, 2012). La loi allemande incite d’ailleurs les entreprises à mobiliser ces dispositifs en première instance pour retarder le plus possible le recours au chômage partiel. Selon une enquête menée par l’Institut de recherches économiques et sociales WSI43, une part importante des entreprises allemandes (33,9 %) a d’abord opté pour la liquidation des actifs du CET entre le 3e trimestre 2008 et le 3e trimestre 2009 (Zapf, 2011). La crise a conduit à une liquidation particulièrement importante des actifs dans le secteur industriel : les entreprises industrielles ont liquidé 50 heures d’actif par salarié, en moyenne, contre environ 38 heures dans les entreprises de services. Dès lors, certains ont fait valoir, à la suite de la crise de 2008, le caractère « protecteur » des accords d’entreprise, quand bien même il reste l’expression d’un rapport de force entre employeurs et salariés, en opposant « la flexibilité transitoire et conventionnellement décidée des salaires et de la durée du travail associée au maintien de l’emploi observée en Allemagne et les destructions d’emplois associées à la rigidité à la baisse des salaires observées en France » (Gilbert Cette, CAE, 2012). Néanmoins, se pose en Allemagne le problème des « minijobbers » qui subissent plus brutalement les ajustements de besoins en main-d’œuvre.
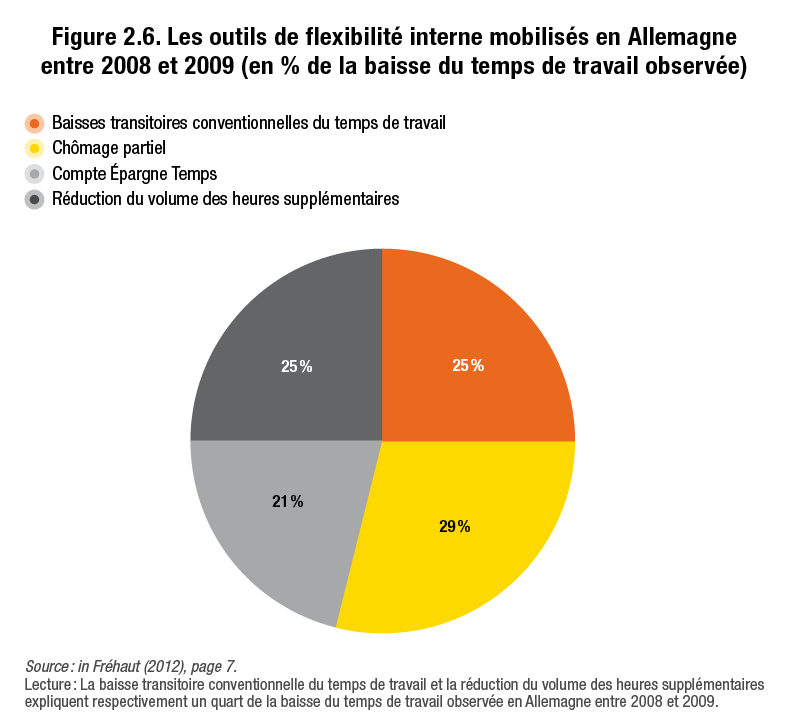
En temps de crise, les mécanismes alternatifs aux licenciements sont essentiels car ils permettent, d’une part, d’éviter les conséquences sociales lourdes des suppressions d’emplois et, d’autre part, d’offrir aux entreprises les conditions de la reprise. Mais, on le voit, cette possible conciliation entre protection du travailleur et efficacité économique suppose un dialogue social de qualité, que ce soit à travers la négociation collective, les échanges formels ou informels entre la direction de l’entreprise et les représentants du personnel, ou encore la consultation des salariés. Une étude de la Dares parue en 2020 (Tall, 2020) a analysé le lien entre différentes formes de dialogue social – formelles ou informelles – et la performance des entreprises françaises, contrôlée par la valeur ajoutée par salarié et l’évolution perçue du volume de l’activité. Les résultats du modèle économétrique estimé montrent un effet positif du dialogue social « formel sans conflits », « informel » ou « très actif » sur la productivité, par rapport à une négociation formalisée mais réalisée dans un climat de défiance. Cette analyse souligne, si besoin était, le rôle central joué par les partenaires sociaux dans le fonctionnement de l’entreprise et sa capacité à s’adapter à un nouvel environnement économique. Quand les accords d’entreprise s’inscrivent dans un contexte tendu, marqué par un rapport de force inégal, les chances d’aboutir à un accord équilibré sont faibles. C’est notamment le cas dans les PME ou les TPE où les représentants du personnel sont souvent peu armés et moins organisés pour construire des revendications et exiger des contreparties. Dans ces conditions, une dynamique de « moins-disant social » risque de s’installer dans l’entreprise, mettant ainsi à mal le caractère « donnant-donnant » supposé guider ce type d’accord. Au législateur d’offrir les conditions d’exercice d’un dialogue social de qualité, au plus près des réalités vécues par les entreprises et leurs salariés. Dans certains cas, les accords d’entreprise peuvent en effet dégager des compromis fructueux, tant pour les salariés que pour l’entreprise.
- 26. Cette limite a été levée pendant la crise du Covid-19. Le nouveau plafond en vigueur est de 4,5 Smic.
- 27. Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.
- 28. Nous verrons plus loin que les économistes attribuent également ce « miracle de l’emploi » à d’autres outils de flexibilité (compte épargne-temps, entre autres).
- 29. La Commission européenne a notamment annoncé, le 2 avril 2020, la création d’une enveloppe de 100 milliards d’euros pour financer, sous forme de prêts octroyés à des conditions favorables, la création ou l’extension des régimes nationaux de chômage partiel.
- 30. Source : DSN (déclaration sociale nominative).
- 31. À partir du 1er avril 2021, la durée d’indemnisation est réduite à trois mois et renouvelable dans la limite de six mois, sur une période de référence de douze mois consécutifs.
- 32. Le régime d’APLD est défini par le décret 2020-926 du 28 juillet 2020.
- 33. Le programme de protection des salaires (Paycheck Protection Program ) peut s’apparenter, au moins dans l’esprit, à un dispositif de chômage partiel. Il s’agit d’un dispositif de prêt aux plus petites entreprises qui se transforme en subvention si l’entreprise s’engage à maintenir les niveaux d’emploi et de rémunération.
- 34. La loi du 14 juin 2013 a fortement simplifié les dispositifs antérieurs en créant une seule allocation d’activité partielle versée à l’employeur, via la fusion du chômage partiel classique et de l’APLD. Selon un rapport de la Cour des comptes (2015), la fusion des dispositifs antérieurs a notamment permis de supprimer les cas dans lesquels le reste à charge pour l’employeur était particulièrement élevé.
- 35. Un accord de performance doit être conclu en présence d’au moins un délégué syndical. L’accord doit être conclu selon les modalités prévues par l’article L.2232-12 du Code du travail (signé par les organisations syndicales ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en faveur des organisations syndicales représentatives ou 30 % et être validés par référendum). Tiré de https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/accompagnement-des-mutations-economiques/article/accords-de-performance-collective.
- 36. L’APC ne peut néanmoins pas déroger à certaines règles légales, comme le Smic, les durées maximales de travail, le temps de pause, la majoration des heures supplémentaires au-delà de 35 heures, etc.
- 37. Source : Dares.
- 38. https://www.usinenouvelle.com/editorial/ce-que-dit-l-accord-de-performance-collective-signe-chez-derichebourg-aeronautics-
services-pour-sauver-700-emplois.N974921 - 39. Dans un même accord de performance collective, les entreprises peuvent invoquer plusieurs objectifs à la fois.
- 40. https://www.lavoixdunord.fr/593543/article/2019-06-04/nous-tout-ce-qu-veut-c-est-que-l-usine-tourne-assure-l-intersyndicale-de
- 41. https://www.lemonde.fr/emploi/article/2020/08/29/les-accords-de-performance-collective-s-inscrivent-dans-une-logique-de-
mieux-disant-social_6050281_1698637.html - 42. Hors du cadre du chômage partiel.
- 43. Enquête réalisée auprès d’un échantillon représentatif d’entreprises de 20 salariés ou plus, disposant d’un conseil d’établissement.
Les dérives des accords de performance collective (APC) – Point de vue
Par Philippe Portier, Secrétaire National de la confédération CFDT au sein de la Commission Exécutive. Il prend en charge les dossiers de la politique économique, de l’industrie, d’évolution des règles du dialogue social, du développement durable et de la représentativité syndicale.
Dans la phase d’installation, les APC avec quelques centaines d’accords négociés ont mis en évidence des dérives dénoncées par les organisations syndicales notamment au sein du comité d’évaluation des ordonnances qui opère sous l’égide de France Stratégie. Ces dérives se sont par exemple manifestées dans une branche professionnelle par une action concertée d’entreprises, sous l’impulsion d’un syndicat patronal, pour contourner les dispositions de la convention collective. Dans d’autres entreprises, elles se sont faites via un manque de transparence patent : les négociateurs syndicaux n’ont pas été informés qu’ils négociaient un APC et donc des conséquences importantes, y compris sur les contrats de travail individuels de cet accord, que cela impliquait. Bien souvent les informations qui président à la négociation d’un APC sont trop parcellaires et nuisent à un bon dialogue sur la problématique abordée. On dénote également que les deux tiers des accords se font à durée indéterminée ce qui est antinomique d’une négociation permettant à l’entreprise de faire face à une difficulté passagère. En faisant ainsi référence à une durée indéterminée, ces accords répondent à une problématique structurelle par un moins disant social, bien loin de l’idée « d’une performance collective ». Le fait de devoir recourir à un accord majoritaire ou un référendum peut certes être un garde-fou mais le constat de terrain montre que ces négociations se font souvent avec un rapport de forces déséquilibré et en général avec la menace d’un PSE. Ceci explique notamment que rares sont les accords qui comportent des clauses de retour à meilleure fortune récompensant les efforts des salariés une fois le cap difficile franchi. Heureusement, il existe également des exemples vertueux comme la négociation chez un équipementier automobile d’un APC permettant une économie de 10% de ses coûts sur une période donnée, cette économie étant ensuite pérennisée par la négociation d’un accord de gestion de l’emploi et des parcours professionnels faisant notamment appel aux départs naturels de l’entreprise.
Dans le nouveau contexte économique et sanitaire, le dispositif des APC semble néanmoins pertinent. En effet, il s’agit, dans ce contexte particulièrement difficile, de faire émerger des solutions permettant aux entreprises de passer le cap, de surmonter les difficultés pour retrouver une rentabilité et des perspectives favorables grâce au maintien de ses compétences. Il y a donc lieu de promouvoir ce genre de négociation mais dans des conditions sensiblement différentes de celles de la mise en place initiale.
Réformer le dispositif des APC pour redonner confiance et rééquilibrer les rapports de forces est pour la CFDT un passage incontournable si l’on veut faire de cet outil l’objet d’un dialogue social moderne où les salariés, en acceptant des concessions sur une période, sécurisent leur emploi et peuvent ensuite voir s’appliquer des « clauses de retour à meilleure fortune » lorsque le cap difficile est franchi.
Nous préconisions donc plusieurs évolutions législatives :
Un contrôle de ces accords APC par l’administration du travail (DREETS44) portant d’une part sur le processus de négociation pour s’assurer que les négociateurs ont bien été informés que la négociation se faisait dans le cadre d’un APC et d’autre part que l’objet de la négociation rentre dans le champ des APC ainsi que la validité des conditions de signature de l’accord. Enfin nous souhaitons que ces accords soient nécessairement établis pour une durée déterminée.
Selon nous, c’est à ces conditions que les APC peuvent prouver leur utilité pour l’entre prise. Ces négociations, peut-être encore plus que d’autres, doivent se faire en partageant un diagnostic sur l’état de l’entreprise, ses difficultés et ses projets pour convenir d’objectifs permettant d’accroitre sa compétitivité dans toutes ses composantes.
Les outils de gestion des difficultés sont nombreux, dans beaucoup de cas les PSE peuvent être évités pour autant que le dialogue social se place dans un registre de transparence, de confiance et d’anticipation. La situation actuelle, avec les importantes mutations que les entreprises doivent opérer, nécessite que le dialogue social franchisse un cap qualitatif important, c’est à ce « prix » que notre économie peut se transformer en restant prospère.
- 44. Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités
Genèse et résultats de l’accord de compétitivité signé chez Renault en 201345 – Point de vue
Par Christian Pellet, Président de Sextant, cabinet d’expertise et de conseil auprès des représentants du personnel.
Cet accord montre que, même dans un contexte économiquement dégradé, où la défiance entre partenaires sociaux s’est enracinée, il est encore possible de trouver une issue positive pour l’entreprise et ses parties prenantes. À condition de ne pas ménager ses efforts.
De quels efforts parle-t-on ? Renault, alors acculé par de mauvais résultats et la difficile digestion des conséquences de la crise financière de 2009, bousculé par la communication contestataire de ses partenaires sociaux, CFDT en tête, via la publication de livres et de films, a-t-il pour autant été contraint à des compromis scabreux ? Assurément non. Le dialogue social était compromis, certes, mais la mémoire de pratiques responsables restait. À partir du moment où la direction de l’entreprise a fait le choix d’une négociation sérieuse, et a donné des preuves tangibles de son engagement, tout est redevenu possible.
Concrètement, l’entreprise a décidé de mettre toutes les informations sur la table, et de se donner un temps de dialogue et de négociation suffisamment long (٦ mois), nourri par des experts internes, dans un cadre resserré (peu de personnes impliquées), et engagé.
Après ce temps de partage, bien trop souvent négligé en amont des négociations, un accord ambitieux a été trouvé avec trois des quatre organisations syndicales, autour de contreparties significatives.
Les années qui ont suivi ont permis à Renault de redresser rapidement sa situation économique.
L’accord signé n’en est pas bien évidemment la principale cause, mais il a permis de ressouder l’entreprise autour d’objectifs communs, où chacun avait mis du sien. En marquant le fait que, dans un contexte difficile et tendu, l’entreprise réussissait à trouver un chemin avec ses parties prenantes, il redonnait du sens aux choix effectués, jusque-là très contestés, et permettait de générer à nouveau de l’adhésion.
En effectuant un virage dans un dialogue social compromis, il permettait à l’entreprise de renouer avec son histoire, et de se réengager dans une dynamique positive, marquée par un nouvel accord de compétitivité en 2017.
À notre sens, cet accord illustre le retour sur investissement considérable que peut avoir pour l’entreprise le fait d’accepter de prendre le temps, de traiter ses partenaires sociaux en adultes, de partager une information pertinente économiquement, et de dialoguer jusqu’à trouver un accord. Bien des drames et des destructions de valeur pourraient être évités par un peu plus d’intelligence sociale. Le chemin peut paraître long pour ceux qui n’y sont pas familiers, et qui n’ont pas un horizon dépassant le trimestre, mais la récompense est au bout, et elle est grande.
Les fruits du dialogue social se capitalisent, mais se détruisent encore plus vite dès lors que la confiance est mise en cause. C’est pourquoi ce moment de l’histoire sociale de Renault, s’il permet d’identifier certaines des voies du succès, n’a pas pour prétention de décrire un monde idéal46.

Source : Sextant, sur la base de l’accord de 2013 et des entretiens menés chez Renault
- 45. Une étude complète de cet accord a été publiée par Terra Nova dans sa note « Le dialogue social par la preuve : quatre cas d’accords d’entreprise innovants et leurs enseignements », rédigée par Christian Pellet et Vincent Urbejtel, en date du 23 mai 2017. Elle s’est notamment appuyée sur des entretiens menés avec les délégués syndicaux centraux CFE-CGC et CFDT, ainsi que le DRH France, et sur l’analyse de l’accord et d’informations publiques.
- 46. Depuis 2020, Renault a fait d’autres choix, notamment dans le cadre de la crise sanitaire, qui ne susciteraient certainement pas le même consensus.
La politique industrielle, comme réponse à la crise ?
La crise sanitaire a encore renforcé l’intérêt pour l’industrie dans les débats politiques français et européens. La pandémie de Covid-19 a été décrite par beaucoup comme un moment de vérité, un choc qui aurait dramatiquement mis en lumière la désindustrialisation de la France, pourtant entamée depuis une cinquantaine d’années. La réponse gouvernementale française à la crise économique, tout comme le débat public qui l’a entourée, a ainsi réaffirmé le rôle de la politique industrielle comme moteur de croissance et de résilience. Cette lecture des événements, pourtant, n’est pas totalement nouvelle. Au lendemain de la crise de 2008, déjà, nombreux ont été les gouvernements à se pencher sur la question industrielle. En France, un rapport sur la compétitivité de l’industrie française fut commandé à Louis Gallois et remis au Premier ministre en novembre 2012 (Gallois, 2012). Aux États-Unis, le thème de la réindustrialisation a été central dans la campagne d’Obama en 2012 (Bidet-Mayer et Frocrain, 2015). Aux Royaume-Uni, le gouvernement Cameron a, dès son arrivée au pouvoir en 2010, affirmé sa volonté de « rééquilibrer l’économie au profit de l’industrie et des régions »47. Pendant ce temps, la Chine dévoilait son douzième plan quinquennal48 visant à accroître les budgets de recherche et développement (R&D). Ainsi, de nombreux pays partagent cette idée que les politiques industrielles constituent une réponse adaptée à la suite d’une crise économique. La crise économique actuelle ne fait pas exception. En général, les gouvernements répondent par trois types de mesures : i) améliorer l’accès des entreprises au financement ; ii) aider les entreprises à se moderniser ; iii) doper les carnets de commandes via des dispositifs d’incitation à l’achat. En France, la réponse publique à la crise du Covid-19 a ajouté comme priorité un quatrième type de mesures : des mesures dédiées à la relocalisation industrielle.
Le soutien à la capacité de financement des entreprises
Le risque du sous-investissement face à l’endettement des entreprises
La crise a asséché la trésorerie des entreprises industrielles, certaines d’entre elles se trouvant confrontées à des problèmes de financement, voire au dépôt de bilan. Signe de la détérioration de leur santé financière, le montant de leur dette a augmenté de 174,5 milliards entre février et septembre 202049. Cette hausse de l’endettement des entreprises risque de peser durablement sur leur niveau d’investissement car elle pèse sur leur capacité d’emprunt. Or, une chute de l’investissement entraînerait une croissance anémique, et les capacités de production réduites impacteraient à leur tour sur l’emploi et la consommation, réduisant d’autant plus l’investissement, etc. Selon la dernière enquête trimestrielle de l’Insee auprès des chefs d’entreprise, les dépenses d’investissement ont baissé de 13 % en 2020 dans l’industrie manufacturière (voir figure 3.1). Elles pourraient connaître un fort rebond en 2021, les chefs d’entreprise anticipant une hausse de 10 % en 2021 qui compenserait en grande partie la réduction enregistrée l’année précédente50. Néanmoins, ces chiffres masquent des disparités importantes entre les secteurs. Si la reprise des investissements est très dynamique dans le secteur agroalimentaire (9 %) et spectaculaire dans celui des biens d’équipement (25 %), les secteurs aéronautique et automobile devraient quasiment stabiliser leurs dépenses, pourtant en chute de 23 % en 2020. Ainsi, il importe de garantir aux entreprises de ces deux secteurs un accès aux ressources financières nécessaires pour poursuivre et même intensifier leurs investissements. Dans le cas contraire, elles risqueraient de centrer leur stratégie sur le seul désendettement, au détriment de leur activité. Une étude du Trésor (Hadjibeyli et al., 2021) montre, à partir d’une modélisation économétrique, que l’endettement supplémentaire découlant de la pandémie de Covid-19, pourrait réduire l’investissement des entreprises à moyen terme d’environ 2 %. Les auteurs précisent toutefois que ce chiffre ne tient pas compte des prêts participatifs et des obligations instaurés dans le cadre de France Relance, lesquels sont nécessaires pour soutenir l’investissement en phase de reprise.
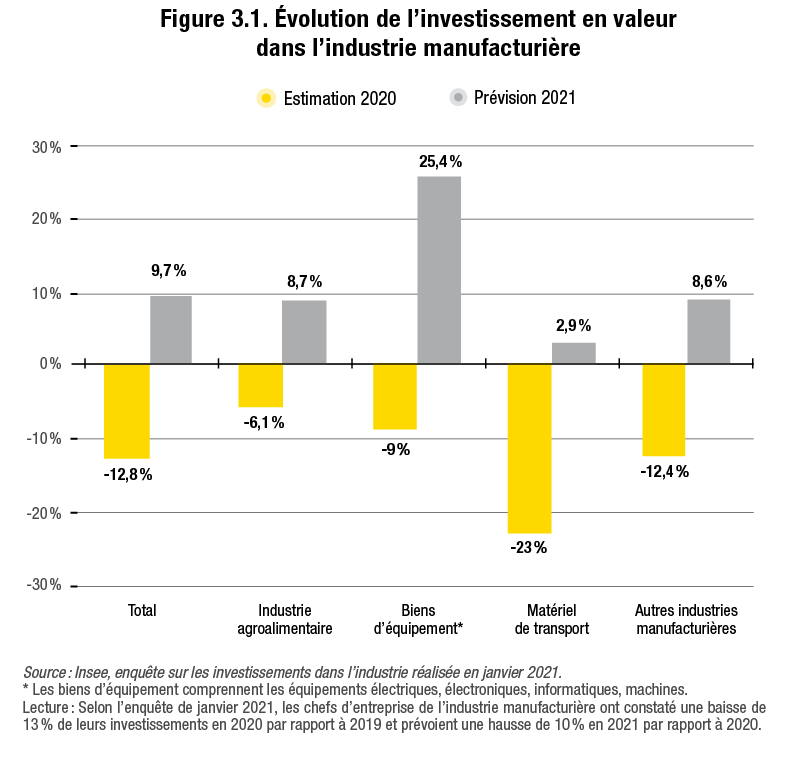
Le nécessaire soutien de l’État en quasi-fonds propres pour renforcer l’investissement des petites et moyennes entreprises
En période de crise économique, les entreprises de taille petite, moyenne ou intermédiaire, sont confrontées, plus que les autres, à une dégradation de leurs résultats et de leur trésorerie alors qu’elles n’ont qu’un accès limité aux marchés financiers et obligataires (OCDE, 2017). La crise actuelle ne fait qu’exacerber les difficultés dans ce domaine et contraint la capacité d’investissement de ces entreprises, car un bilan affaibli limite d’autant plus les accès à de nouvelles sources de financement. Outre les mesures d’urgence destinées à soulager la trésorerie des entreprises et à éviter les faillites, les pouvoirs publics ont donc mis en place un ensemble d’outils donnant accès à certaines entreprises à de nouvelles ressources financières pour leur permettre de poursuivre leur activité et préserver leur compétitivité. Le 4 mars 2021, Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, a présenté les dispositifs de soutien de l’État à l’octroi de prêts participatifs et d’obligations, en présence de nombreux acteurs institutionnels et privés (METI51, CPME52, France Industrie, Bpifrance, Région de France, France Invest, etc.). Le soutien de l’État prend d’abord la forme d’une garantie aux investisseurs qui financent les prêts participatifs ou les obligations. L’État prend en effet à sa charge jusqu’à 30 % des pertes en capital éventuellement subies par les investisseurs, pour rendre les outils attractifs. Du point de vue des entreprises, ces dispositifs présentent l’avantage de pouvoir être mobilisés sur le long terme, sur huit ans, et de commencer à être remboursés à partir de la cinquième année pour les prêts participatifs, et après huit ans pour les obligations. Par ailleurs, ces prêts ne seront remboursés qu’après l’acquittement des autres engagements53, à l’exception des participations en capital. Enfin, ils ne confèrent aucun droit de vote aux investisseurs, conservant en cela la structure de gouvernance de l’entreprise. Du fait de ces caractéristiques, les prêts participatifs et les obligations peuvent être considérés comme des quasifonds propres qui renforcent directement le bilan des entreprises bénéficiaires. Contrairement aux PGE, ils n’aggravent pas le poids de la dette dans le bilan des entreprises, qui peuvent alors accéder plus aisément à de nouvelles sources de financement pour investir.
Selon le gouvernement, la garantie offerte par l’État devrait permettre de mobiliser 20 milliards d’euros de financement privé, longs et au remboursement différé. De nombreux acteurs ont été fédérés autour de ce projet, au premier rang desquels figurent les compagnies d’assurance, qui devront mobiliser cette somme par le biais des assurances-vie, des fonds d’épargne salariale et des fonds d’épargne retraite. Sur les 20 milliards distribués, 14 milliards le seront sous la forme de prêts participatifs et 6 milliards sous la forme d’obligations. Plus restrictifs que les PGE, les prêts participatifs devraient concerner environ 10 000 entreprises. S’il n’est pas encore possible d’évaluer l’impact des prêts participatifs mis en œuvre dans le cadre de France Relance sur la structure financière des entreprises et leur capacité à investir, un dispositif similaire, lancé par Oseo en 2009, a déjà fait l’objet d’une étude (voir encadré 2).
Encadré 2 : Le contrat de développement participatif (CDP) d’Oseo lancé en 2009
Dans le cadre du plan de relance de l’économie en 2008, Oseo, devenu Bpifrance, avait été en charge de mobiliser 1 milliard d’euros sur deux ans pour renforcer les fonds propres et encourager l’investissement des PME et des ETI. C’est à cette fin qu’avait été lancé, fin 2009, le contrat de développement participatif (CDP) qui s’adressait aux entreprises de plus de trois ans et de moins de 5 000 salariés, présentant un besoin de financement pour réaliser des projets de développement ou d’innovation. Les entreprises bénéficiaient d’un crédit sans garantie ni caution personnelle, d’une durée de sept ans et avec un différé de remboursement de deux ans.
Deux ans après la mise en œuvre des CDP, Oseo a mené une évaluation du dispositif. Entre décembre 2009 et décembre 2011, 1 076 CDP ont été accordés, pour une enveloppe totale de 1,1 milliard d’euros54. Selon l’enquête menée par Oseo en 2012, les entreprises bénéficiaires rencontraient plus de difficultés financières que la moyenne des entreprises comparables, suggérant que le dispositif répondait bien à une défaillance de marché du financement. Par ailleurs, le CDP a permis, pour environ la moitié des bénéficiaires, de doubler la valeur de leur outil de production. Il apparaît également que les PME des secteurs industriels et du transport, en forte croissance en France et à l’étranger, représentent 40 % des bénéficiaires du CDP. Enfin, le dispositif a généré un effet de levier important puisqu’un euro d’aide mobilisé a entraîné 41 euros de financement en provenance des banques et des investisseurs.
Source : « Bilan 2011, Perspectives 2012 », Oseo, 2012.
L’actionnariat public, un outil de préservation du tissu productif et des compétences des secteurs les plus sinistrés
Dans la boîte à outils de Bercy pour soutenir les entreprises, ont été créés deux fonds d’investissement sectoriels ayant vocation à intervenir directement en fonds propres chez les sous-traitants des secteurs aéronautique et automobile. Ces derniers sont particulièrement vulnérables compte tenu de leur dépendance aux constructeurs et de leur taille plus réduite. Créé en juillet 2020, le fonds d’investissement dédié à la filière aéronautique, baptisé Ace Aéro Partenaires, est doté d’un montant de 630 millions d’euros. L’État y injecte 230 millions d’euros, dont 50 millions via Bpifrance, tandis que les grands constructeurs y contribuent ensemble à hauteur de la même somme : 116 millions pour Airbus, 58 millions pour Safran, 13 millions pour Dassault et 13 millions pour Thales. Ces 400 millions de fonds propres sont complétés par un apport de 230 millions de la société de gestion Tikehau, chargée de gérer la totalité du fonds aéronautique. Dans le secteur automobile, l’État contribue à hauteur de 400 millions de fonds propres et les deux constructeurs français PSA et Renault abondent chacun 100 millions d’euros, soit un fonds sectoriel doté de 600 millions d’euros géré par Bpifrance. Les contributeurs deviennent ainsi actionnaires minoritaires des entreprises bénéficiaires et mettent à leur disposition de nouvelles capacités d’investissement. Ce type de dispositif vise à préserver les savoir-faire et les compétences du tissu industriel en évitant les vagues de plans sociaux et les faillites. L’apport en capitaux propres contribue à la consolidation et au développement d’entreprises jugées stratégiques ou ayant un fort potentiel d’innovation. Ce type de fonds sectoriel avait déjà été mis en œuvre lors de la précédente crise économique. Créé en 2009, le FMEA (Fonds de modernisation des équipementiers automobiles) avait alors pour mission d’accompagner et de soutenir les projets d’investissement des fournisseurs de rang 1 et 2 dans un contexte particulièrement difficile pour l’ensemble des acteurs de l’industrie automobile, auquel se combinaient des problèmes structurels de surcapacités de la production. À date, environ 600 millions d’euros ont été investis dans une trentaine d’entreprises55. Parmi les réussites attribuées au FMEA figurent les opérations de restructuration industrielle et financière de certaines entreprises dont l’arrêt aurait été préjudiciable pour la filière automobile. Selon le rapport Gallois (2012), le FMEA est également un outil favorisant les rapprochements d’entreprises. En effet, l’apport en capitaux propres permet d’acquérir plus facilement les actifs d’une autre société en difficulté et faire ainsi émerger des équipementiers d’une taille suffisante pour répondre aux futurs enjeux de l’industrie automobile et acquérir une dimension européenne, voire mondiale (voir encadré 3). Le FMEA joue donc un rôle d’intermédiaire qui accompagne les entreprises dans leurs projets industriels, en les aiguillant sur les enjeux futurs et les stratégies à poursuivre pour pérenniser leurs activités.
Encadré 3 : Un exemple de succès du FMEA : le rapprochement industriel du groupe Plastivaloire et de l’entreprise Bourbon
En 2010, le FMEA injecte 11 millions d’euros pour aider le groupe Plastivaloire (PVL), une entreprise spécialisée dans les pièces en plastique, à racheter l’entreprise Bourbon, un fabricant de pièces et de composants en plastique lourdement endetté. L’investissement du FMEA a pour objectif de former un groupe leader en pièces de plastique pour intérieur de voiture, capable de mieux concurrencer les puissantes PME allemandes et de mieux résister aux crises. En 2010, PVL réalisait 220 millions d’euros de chiffre d’affaires, avec pour clients principaux Renault, PSA et Toyota (60 % de l’activité). Lors du rachat de Bourbon, PVL double de taille avec un chiffre d’affaires porté à 400 millions d’euros.
Depuis cette acquisition, plusieurs étapes ont été franchies :
- En 2013, le groupe a investi 7 millions d’euros dans un centre d’essais à Langeais, destiné à la mise au point de nouveaux types de moules à injection.
- Le groupe acquiert, en 2015, 100 % du capital d’un concurrent allemand de rang 1 auprès d’Audi, Mercedes et BMW et engage plusieurs investissements dans diverses usines du groupe pour un montant de 3,5 millions d’euros.
- En 2018, le groupe rachète un concurrent américain et a désormais pour clients
General Motors, Ford, Chrysler et Tesla. La même année, il investit 3 millions d’euros
sur son site de Langeais pour son nouveau centre technique à destination des constructeurs automobiles.Entre 2009 et 2019, le groupe PVL a ainsi multiplié son chiffre d’affaires par plus de quatre, passant de 164 millions d’euros, en 2009, à 730 millions d’euros, en 2019. Au premier semestre 2019, il comptait 32 usines et près de 6 000 salariés.
Source : d’après l’Agefi, 2010, et L’Usine nouvelle, 2013, 2016, 2018.
Aider les entreprises face aux nouveaux défis
Il ne fait pas de doute que la modernisation de l’outil productif participe à sa résilience en temps de crise économique. Ce n’est donc pas parce que la période est tourmentée qu’il faut renoncer à investir et à innover ; c’est au contraire parce qu’elle l’est qu’il faut poursuivre et même accélérer la modernisation du tissu industriel. Le gouvernement français, on l’a écrit plus haut, en a fait la pierre angulaire de son plan de relance. Il mise notamment sur deux axes : la numérisation des entreprises industrielles et le soutien à l’innovation. Le premier axe renvoie à toutes les technologies numériques et d’automatisation qui contribuent à des modes d’organisation plus flexibles et plus fiables, en permettant par exemple le pilotage de sites de production à distance. Le second se situe à un niveau macroéconomique et porte plus généralement sur les grandes stratégies impulsées par les pouvoirs publics pour préparer l’industrie de demain.
La numérisation du tissu productif permet de mieux résister à la crise
La crise économique que nous traversons est venue démontrer toute l’utilité des technologies numériques, si besoin était. Les pouvoirs publics se donnent ainsi comme objectif de développer une politique de numérisation ciblant en priorité les entreprises industrielles les plus contraintes financièrement et souvent confrontées à un déficit d’information et de compétences dans ces domaines. Les politiques publiques en faveur de la numérisation sont d’autant plus une nécessité que les PME et TPE françaises accusent un retard important dans l’adoption des technologies numériques par rapport aux grandes entreprises, selon une récente étude du Trésor (Faquet et Malardé, 2020). En effet, leur degré de numérisation est inférieur à celui des grandes entreprises aussi bien sur des outils numériques anciens, comme les logiciels de gestion ou les factures électroniques, que sur les technologies plus récentes et spécialisées, comme la robotique, l’imprimante 3D ou le big data (voir figure 3.2). Une étude récente de La Fabrique de l’industrie montre également que l’investissement en logiciels des entreprises françaises est très concentré, à tel point que les grandes entreprises et les ETI représentent 80 % de l’investissement immatériel du secteur manufacturier (Guillou et Mini, 2019).
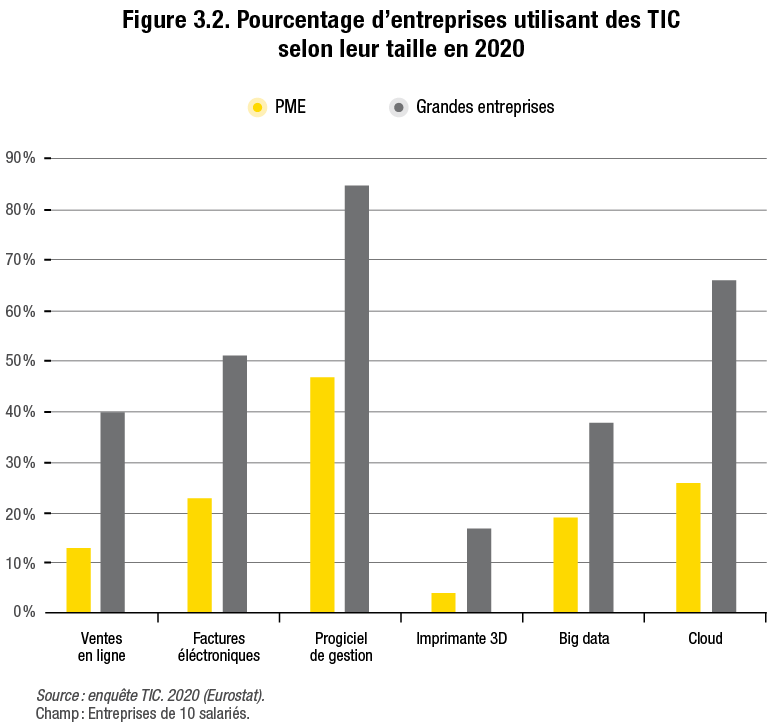 56
56
En revanche, l’industrie française est dans la moyenne des pays de l’Union européenne en matière de numérisation de l’outil productif (voir figure 3.3). Les entreprises industrielles françaises sont même en avance sur leurs homologues allemandes en matière de logiciels de gestion ou de technologies émergentes comme les big data. Mentionnons également que leur degré de numérisation est proche, aussi bien dans le domaine de la vente en ligne que dans celui du traitement automatisé des factures. L’industrie française apparaît toutefois en retrait, par rapport à l’industrie allemande et européenne, en matière de cloud et d’impression 3D. De même, la France présente un faible taux de robotisation avec 177 robots pour 10 000 salariés dans l’industrie manufacturière en 2019, contre 346 en Allemagne57. Mais, selon Guillou et al. (2018), cet écart entre la France et l’Allemagne s’explique en grande partie par un effet de composition : les secteurs les plus exposés à l’automatisation (industrie automobile et fabrication d’équipements électroniques et électriques) sont moins représentés en France qu’en Allemagne mais leur niveau d’équipement en robots est comparable. Par ailleurs, les pays qui connaissent le vieillissement démographique le plus rapide sont aussi ceux qui ont les taux de robotisation les plus élevés (Acemoglu et Restrepo, 2018). En effet, une moindre disponibilité de maind’œuvre crée une incitation forte à recourir aux robots. La France, moins concernée que l’Allemagne par la question du vieillissement de sa population, n’apparaît donc pas aussi sous-robotisée que les chiffres le suggèrent à première vue.
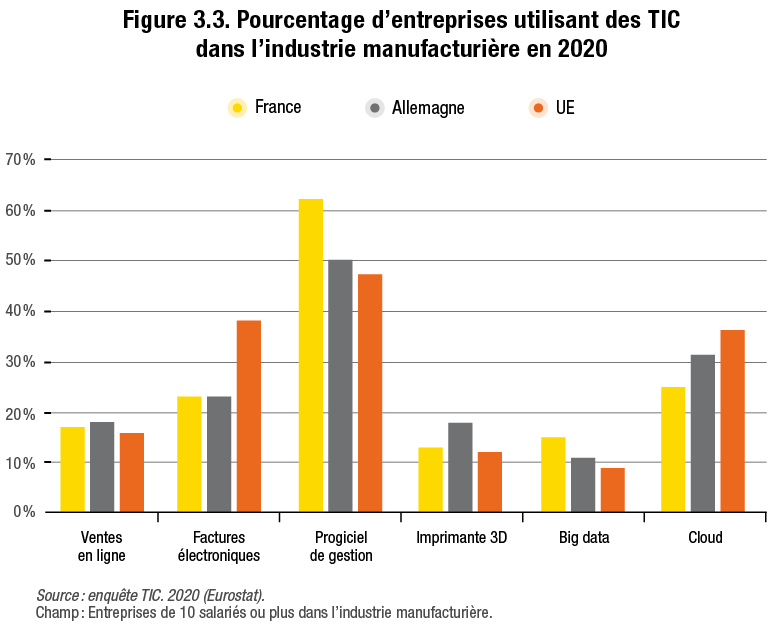
Pour autant, l’industrie française doit poursuivre ses efforts car la numérisation est source d’innovations et de gains de productivité. Selon une récente étude de l’Insee (Firquet, 2020), les technologies numériques stimulent l’innovation, dans l’industrie comme dans les services. De même, à partir d’une enquête originale menée en 2018 par la Banque de France auprès des entreprises de plus de 20 salariés de l’industrie manufacturière, Cette et al. (2020) concluent à un fort impact du recours au digital sur la productivité des entreprises françaises. Toutes choses égales par ailleurs, l’emploi de spécialistes en TIC et l’utilisation de technologies digitales (cloud et big data) augmenteraient de 23 % la productivité du travail et de 17 % la productivité globale des facteurs des entreprises par rapport à celles qui n’y auraient pas recours.
La crise du Covid-19, plus que les crises précédentes, a révélé les bénéfices de la numérisation en permettant au secteur industriel, et aux entreprises en général, de poursuivre une partie de leur activité grâce au télétravail. Une estimation économétrique réalisée par le Trésor (Faquet et Malardé, 2020) montre que les entreprises industrielles ayant abordé la crise avec un niveau d’équipement en ordinateurs portables supérieur de dix points ont tempéré en moyenne leur perte d’activité de deux à quatre points. L’une des limites de cette modélisation est de réduire la numérisation à l’équipement en ordinateurs portables alors que d’autres technologies ont pu contribuer à la résilience de l’industrie. Sans en avoir une preuve formelle, on peut tout de même supposer que les technologies numériques ont permis à certains industriels d’être plus résilients et réactifs que d’autres en permettant, par exemple, de faire fonctionner certaines activités à distance ou d’adapter rapidement les lignes de production en fonction de la demande. Le plan de relance met ainsi l’accent sur la modernisation de l’outil industriel à travers une subvention qui permet aux PME et ETI industrielles de bénéficier d’un appui en trésorerie pour leurs investissements dans les technologies de l’industrie du futur58. L’aide représente au minimum 20 % du coût d’investissement pour les petites entreprises et 10 % pour les moyennes entreprises et les ETI sous certaines conditions. Sous réserve que les entreprises se saisissent du dispositif, le gouvernement a annoncé mobiliser une enveloppe de 280 millions pour le financement de la numérisation des entreprises d’ici 2022. Fort de son succès, le dispositif a ensuite été réabondé par le gouvernement à hauteur de 600 millions d’euros supplémentaires d’ici 2022. Ces aides se substituent au suramortissement fiscal en vigueur en 2019 et 2020. Par ailleurs, l’État français prévoit une nouvelle enveloppe de « Prêts French Fab » opérée par Bpifrance dans le cadre du plan de relance. Ce dispositif, doté de 45 millions d’euros, devrait permettre de mettre en place entre 400 et 500 millions de prêts visant à soutenir les investissements matériels et immatériels des entreprises industrielles. D’un montant compris entre 100 000 euros et 5 millions d’euros, avec un cofinancement bancaire d’un montant au moins équivalent, ce prêt est proposé sur une durée modulable de deux à douze mois.
Outre les aspects financiers, le soutien à la numérisation doit aussi passer par des mesures d’accompagnement et de formation destinées aux dirigeants d’entreprise et aux salariés. Le déficit de compétences et de formation se révèle être un des principaux freins à la numérisation des petites et moyennes entreprises, comme l’atteste une enquête menée par l’Ipsos en 2019 sur la transformation digitale des TPE-PME59 françaises60. Par ailleurs, plus d’une TPE-PME sur deux considère manquer de temps et de budget et attend un accompagnement dans la mise en œuvre d’un projet de digitalisation. Même écho dans une étude menée par le BCG (Boston Consulting Group) et EY (Ernst & Young) pour la Direction générale des entreprises (DGE). Les freins viennent généralement de l’absence de motivation des dirigeants qui ont peu de temps pour s’intéresser à la transformation numérique. Le plan de relance tient compte de ce diagnostic et renforce, à travers la subvention « industrie du futur », les actions de France Num, qui, depuis son lancement en 2018, sensibilise et accompagne les entreprises dans la mise en place de leurs projets de numérisation.
Le programme d’investissements d’avenir (PIA), bras armé d’un État stratège ?
En temps de crise, les actions en soutien à l’industrie passent aussi par des politiques en faveur de l’innovation, entendue ici comme le développement de nouveaux biens, services, procédés ou technologies. Ce soutien à l’innovation traduit l’idée selon laquelle le positionnement de l’industrie sur des segments à haute valeur ajoutée permet de gagner des parts de marché sur la scène internationale et protège de la concurrence des pays à bas coût : plus un produit est complexe, moins nombreux sont les pays capables de le produire. Sur le plan de la compétitivité internationale, l’innovation est en effet un des principaux leviers permettant à l’industrie de se différencier de la concurrence autrement que par la seule recherche de faibles coûts. En temps de crise, un accès moindre au crédit et la perte de débouchés peuvent entraîner une forte contraction des budgets de R&D et d’innovation des entreprises. Il n’est donc pas étonnant que le premier programme d’investissements d’avenir (PIA) ait été conçu en 2010, dans un contexte de crise économique (voir encadré 4).
Encadré 4 : Zoom sur le PIA
Le programme d’investissements d’avenir (PIA) a été conçu comme un dispositif exceptionnel tant du point de vue de sa gouvernance que de celui du contrôle budgétaire. En effet, le CGI s’appuie sur des acteurs publics indépendants des ministères et confie la gestion des dotations du PIA à des opérateurs extérieurs, parmi lesquels l’Agence nationale de la recherche (ANR), l’Agence de services et de paiement (ASP) et Bpifrance. La gestion extrabudgétaire du PIA lui permet de s’affranchir des contraintes d’un budget annuel, quitte à contourner certains principes de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF). Il y a, dans l’esprit et la philosophie du PIA, l’idée selon laquelle les investissements d’avenir « doivent être au seul service des générations futures » et ne surtout pas se laisser écraser par « la tyrannie du court terme » (Rapport Juppé-Rocard). Les crédits disponibles peuvent être utilisés de différentes manières suivant le type de projet : fonds propres, subventions, prêts, fonds de garantie ou avances remboursables.
Depuis sa création, le PIA a fait l’objet de plusieurs vagues successives, correspondant à chaque fois au déploiement de nouveaux crédits (voir figure 3.4). Initialement, le PIA bénéficiait d’une enveloppe de 35 milliards d’euros et n’était pas présenté comme devant être suivi d’autres volets. Pourtant, le PIA 2 lui a succédé en 2014, doté de 12 milliards d’euros, puis le PIA 3, lancé en 2017 et doté de 10 milliards d’euros, portant le montant total consacré aux investissements d’avenir à 57 milliards d’euros. Le quatrième volet du PIA a été créé à l’occasion du plan France Relance, le 3 septembre 2020, pour une durée de cinq ans. Il est doté de 20 milliards d’euros.
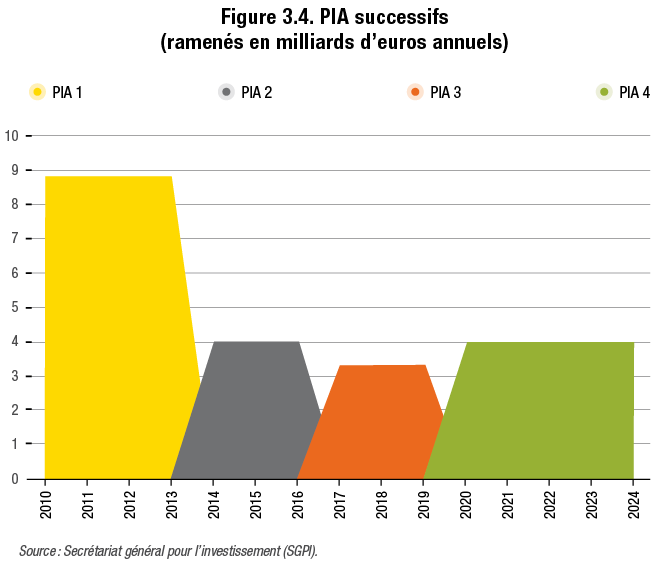
Piloté à l’origine par le Commissariat général à l’investissement (CGI), le PIA est une réponse aux préconisations du rapport « Investir pour l’avenir » (Juppé et Rocard, 2009) de la commission présidée par MM. Juppé et Rocard en 2009, qui visait « la construction d’un nouveau modèle de développement, plus durable », reposant sur l’innovation. Sans faire explicitement référence à la politique industrielle61, le rapport avait pour ambition d’orienter l’action publique vers les activités favorisant la compétitivité de l’économie française à long terme. Selon une étude du Centre d’analyse stratégique publiée en 2011, « le programme d’investissements d’avenir [a marqué] le retour de la politique industrielle en France » (Dhont-Peltrault et Lallement, 2011). L’analyse de ses actions et dotations met en évidence la forte orientation du dispositif vers les enjeux industriels et technologiques. Entre 2010 et 2018, un tiers des actions et des montants décaissés au titre du PIA ont ainsi été dirigés vers le secteur industriel (Comité de surveillance des investissements d’avenir, 2019).
Selon un rapport du Sénat publié en novembre 2020 (Sénat, 2020), le PIA 3 a été particulièrement sollicité au cours de l’année 2020. Près de 1 534 millions d’eu ros auraient en effet été mobilisés par le Secrétariat général pour l’investissement (SGPI)62 afin de faire face aux nouveaux enjeux révélés par la crise sanitaire. Parmi les dispositifs mobilisés, les projets de recherche et développement structurants pour la compétitivité (PSPC) ont occupé une place prépondérante. Les PSPC sont définis comme des projets collaboratifs63 d’inno vation stratégique entre acteurs industriels et académiques, visant notamment des retombées économiques directes sous forme de nouveaux produits, services et technolo gies, et des retombées indirectes en termes de structuration durable des filières. Selon le rapport du Sénat, le SGPI a accéléré le rythme de décaissement du dispositif, en multipliant les projets « par quatre au deuxième trimestre de l’année 2020, pour des sommes allouées supérieures à la moyenne observée au cours des dernières années ». Dans le contexte de la crise sanitaire ont été examinés en priorité les projets présentés par les comités stratégiques de filière (CSF) ainsi que ceux relevant des secteurs les plus affectés par la crise économique64.
Lors de la présentation du plan France Relance, le 3 septembre 2020, le gouvernement a lancé le quatrième PIA doté de 20 milliards d’euros sur cinq ans (dont 11 milliards couverts par France Relance), soit un montant deux fois supérieur à celui des deux PIA précédents et moitié moindre que le premier (voir figure 3.4). Les PIA, conçus à l’origine comme transitoires mais s’étant durablement installés dans le paysage, sont donc manifestement plébiscités en tant qu’outils contracycliques en période de crise. Dans la continuité des précédents, le PIA 4 a pour ambition d’accompagner les prochaines grandes transformations industrielles, lesquelles nécessitent des efforts considérables en matière de R&D. En période de crise économique, ces efforts doivent être intensifiés alors même que les entreprises sont fragilisées par la chute brutale de la demande et le contexte incertain. On constate toutefois que le montant annuel du PIA 4 n’est pas au niveau de celui du PIA 1 (voir figure 3.4). La nouveauté de la dernière version du PIA est de comporter une action « innovation dirigée », visant à accélérer l’innovation dans des secteurs et technologies prioritaires grâce à des « financements exceptionnels » d’un montant de 12,5 milliards d’euros sur les 20 milliards prévus65. Cette logique « dirigée » illustre bien le positionnement de l’État : il définit des priorités d’investissement théoriquement de nature à accompagner les transformations économiques et à renforcer la souveraineté du pays. Quatre premières filières prioritaires ont déjà été identifiées : l’hydrogène décarboné ; la cybersécurité ; le quantique ; l’enseignement et le numérique.
L’existence de tels programmes verticaux de R&D, à forte composante industrielle et bénéficiant d’un soutien public volontariste à hauteur de 1, voire 2 milliards d’euros annuels, n’a rien d’une nouveauté en France : c’est même une « spécialité » de notre pays, vivace depuis les fameux grands programmes gaullo-pompidoliens. Qu’y at-il donc de spécifique cette fois ? D’une part, sans doute, la légitimité réaffirmée de cette approche volontariste et même affaiblie en France ces deux dernières décennies. On pourrait penser que la gouvernance simplifiée des PIA est susceptible d’en renforcer l’efficacité mais rien n’est moins sûr : les grands programmes français ont toujours été menés dans une logique très exécutive, voire planifiée. D’autre part, la pérennisation assumée de ces financements (Sénat, 2020) – alors que le PIA avait été conçu comme une structure temporaire d’exception à côté des ministères, à dotation extrabudgétaire et s’appuyant sur des opérateurs et agences externalisés – interroge sur l’opportunité de rebudgétiser les actions du PIA dans les programmes ministériels. On peut également se demander si les objectifs assignés cette fois ne sont pas plus ambitieux, sur un plan technologique, que le simple abondement en flux continu de filières civiles et militaires habituées depuis longtemps à intégrer les subsides publics (parfois des avances remboursables) dans leur équation financière (voir encadré 5). La réponse à cette question ne pourra venir qu’a posteriori, après avoir mesuré l’engagement effectif des entreprises dans des démarches « disruptives ».
Encadré 5 : Le soutien de l’État pour construire une filière de l’hydrogène en France
L’État prévoit de consacrer 7,2 milliards d’euros d’ici à 2030 à l’hydrogène vert ou bas carbone, dont 2 milliards dans le cadre du plan de relance entre 2020 et 2023. Sur les 2 milliards financés par le plan de relance, 1,4 milliard provient du PIA 4.
L’hydrogène présente de nombreux avantages : c’est une ressource aisément accessible, stockable et transportable en grande quantité, et dont l’utilisation n’émet pas directement de CO2. Toutefois, la manière la plus courante aujourd’hui de produire de l’hydrogène consiste soit à l’extraire d’hydrocarbures, soit à l’obtenir par électrolyse de l’eau : son bilan écologique est donc, dans le meilleur des cas, tributaire de la façon dont on a produit l’électricité nécessaire à son obtention. On parle d’hydrogène vert ou décarboné quand sa production n’émet pas de CO2, c’est-à-dire lorsque l’électricité utilisée est produite de manière renouvelable.
Le recours à l’hydrogène vert peut en théorie constituer un atout décisif pour atteindre l’objectif fixé dans la stratégie nationale bas-carbone pour l’industrie : 53 millions de tonnes émises par an en 2030 contre 80 millions aujourd’hui. Plus précisément, selon l’Afhypac (Association française pour l’hydrogène et les piles à combustible), « l’hydrogène constitue une option pour décarboner les procédés difficiles à électrifier directement ». Il offre également un fort potentiel dans le secteur de la mobilité, les véhicules à hydrogène pouvant parcourir de plus longues distances que les véhicules électriques classiques, tout en ne rejetant que de l’eau. Enfin, l’hydrogène obtenu à partir d’eau se pose en alternative aux énergies fossiles et répond ainsi à des enjeux d’indépendance énergétique.
Pour l’instant toutefois, l’utilisation d’hydrogène en est encore au stade des promesses ou des prototypes. De nombreux obstacles restent à surmonter avant d’envisager son utilisation massive. Le premier est son rendement, qui reste faible. Plus inflammable que le gaz naturel, l’hydrogène présente également des problèmes de sécurité. Du point de vue des constructeurs automobiles, un autre obstacle majeur tient à l’absence d’infrastructures de recharge. Outre ces sujets relatifs à l’hydrogène sous toutes ses formes, la production décarbonée de grandes quantités de ce gaz du futur est évidemment une gageure.
À travers un dispositif comme le PIA, les pouvoirs publics peuvent agir sur les stratégies d’innovation des entreprises, en renforçant et en orientant leurs activités de R&D de façon à encourager le développement de cette filière. La stratégie nationale a ainsi fixé trois priorités :
- faire émerger une filière française de l’électrolyse ;
- déployer une offre de mobilité lourde (camions, bus, trains) fonctionnant à l’hydrogène décarboné ;
- soutenir la recherche et l’innovation et renforcer les compétences sur les futurs usages de l’hydrogène.
Dix ans après sa création, le PIA fait encore partie des outils à disposition pour soutenir l’économie française en période de crise. Mais est-il efficace ? Compte tenu de la multiplicité des objectifs qu’il poursuit, il n’est pas aisé de répondre à cette question. En décembre 2019, une étude a été publiée par le Comité de surveillance des investissements d’avenir (2019) sur l’impact du PIA aussi bien en termes économiques que sociétaux et environnementaux. Sans en apporter une preuve formelle, les auteurs de l’étude considèrent que la décision de déployer le PIA, dans une situation de crise économique, « a suscité un signal positif sur les agents économiques ». Il ressort de l’étude que le PIA a eu un effet significativement positif sur l’investissement privé entre 2010 et 2014, soit dans les années suivant la Grande Récession. Au niveau microéconomique, l’effet d’entraînement du PIA sur l’investissement privé est estimé à 1,1 : pour chaque euro de PIA reçu, une entreprise réalise un investissement de 1,1 euro supplémentaire. D’autres instruments de politique économique ont également contribué à préserver l’effort d’investissement durant les années qui ont suivi la crise de 2008, avec des effets de levier voisins. Bozio et al. (2017) concluent ainsi à un effet positif du crédit d’impôt recherche (CIR) sur les dépenses de R&D des entreprises bénéficiaires. Selon cette étude, un euro de CIR entraîne de 1,1 à 1,5 euro de dépenses en R&D supplémentaires par les entreprises bénéficiaires à un horizon de trois ans. À notre connaissance, seuls les travaux du Comité de surveillance des investissements d’avenir (voir supra) ont évalué l’impact du PIA au niveau macroéconomique. À partir d’une estimation économétrique réalisée sur la base des actions du premier volet du PIA (PIA 1), ils concluent à un impact potentiel sur le PIB de l’ordre de 33 milliards d’euros à l’horizon 2030 et la création ou le maintien d’un million d’emplois environ. Enfin, sur la base d’une analyse qualitative des actions du PIA en faveur de l’industrie, sur la période 2010-2018, le rapport met en évidence la forte contribution du dispositif à la modernisation des filières aéronautique et automobile. Parmi les actions notables, l’action « Recherche dans le domaine aéronautique » a démontré un impact important sur la compétitivité du secteur à moyen terme (voir encadré 6).
Encadré 6 : L’action « Recherche aéronautique » du PIA
Initialement dotée d’une enveloppe totale de 6,7 milliards, l’action « Recherche dans le domaine aéronautique » vise à accompagner la filière aéronautique dans la réponse aux défis de la transition environnementale. Elle a également pour objectif de soutenir le développement de nouvelles générations d’aéronefs, en saisissant les opportunités du développement durable et la diminution de l’empreinte environnementale du système de transport.
L’action se structure en deux volets :
- Le volet « Démonstrateurs technologiques aéronautiques » est destiné à soutenir des projets de R&T (Recherche et Technologie) dans le secteur (réduction de la masse et de la traînée aérodynamique des cellules d’aéronefs, amélioration des moteurs et des systèmes de navigation, etc.).
- Le volet « Aéronefs du futur » vise à soutenir des programmes de R&D pour développer de nouveaux produits à fort niveau de rupture technologique (industrialisation des programmes A350, X4 et X6).
Tout ce qui précède montre que le PIA a certes une pertinence et une efficacité avérées, mais elles ne sont pas très différentes de celles de l’action publique « classique » qu’il est venu supplanter. On pourrait dire que l’action publique a changé d’habits mais pas de nature, du moins sur ce volet R&D.
La question est maintenant de savoir si les investissements ont réellement été au service d’enjeux d’avenir, comme le voulaient MM. Juppé et Rocard, et si leur nature extrabudgétaire leur a conféré un supplément d’efficacité. On peut également se demander si cela a provoqué dans l’ensemble un accroissement de l’effort public au service de ces missions (le PIA s’est-il ajouté aux efforts du CNRS, de l’ONERA, du CEA et de Thales) ou n’a-t-il été qu’une étape de plus dans la tuyauterie financière ?
Les relocalisations, au-delà du paravent narratif
La réindustrialisation compte plus que la relocalisation66
La réponse française à la crise du Covid-19 fait la part belle à l’idée de reconquête de notre souveraineté industrielle et de réindustrialisation du pays. Les débats en cours évoquent les relocalisations comme un élément clé de la politique industrielle du « monde d’après ». Dans le cadre du plan France Relance, 1 milliard d’euros sont destinés à subventionner les projets de relocalisation. Parmi les principaux arguments avancés pour justifier la nécessité de relocaliser, la question de la désindustrialisation occupe une place importante. En effet, la part de l’emploi manufacturier dans l’emploi total baisse continûment depuis une cinquantaine d’années : elle est passée de 23 % à 9 % entre 1974 et 2019 (voir figure 3.5). Le recul relatif de l’emploi industriel est concordant avec la baisse du poids de l’industrie manufacturière dans la valeur ajoutée brute. Celle-ci est passée de 23 % à 11 % entre 1974 et 2019. Pour comparaison, elle représente, en 2019, 19,7 % en Allemagne, 16,6 % en Italie, ou encore 12,3 % en Espagne67. Avec le Royaume-Uni, la France est l’une des grandes puissances industrialisées qui a subi la plus forte désindustrialisation au cours de la décennie 2000-2010. Dans une étude publiée en 2010, Lila Demmou évalue les causes de la désindustrialisation en France sur la période 1980-2007 (Demmou, 2010). Elle estime que la perte d’emplois industriels s’explique, à peu près à parité, par trois phénomènes : les gains de productivité dans le secteur, l’externalisation de certaines activités industrielles vers les services et la concurrence internationale. Les deux premiers n’appellent pas du tout le même jugement que le troisième.
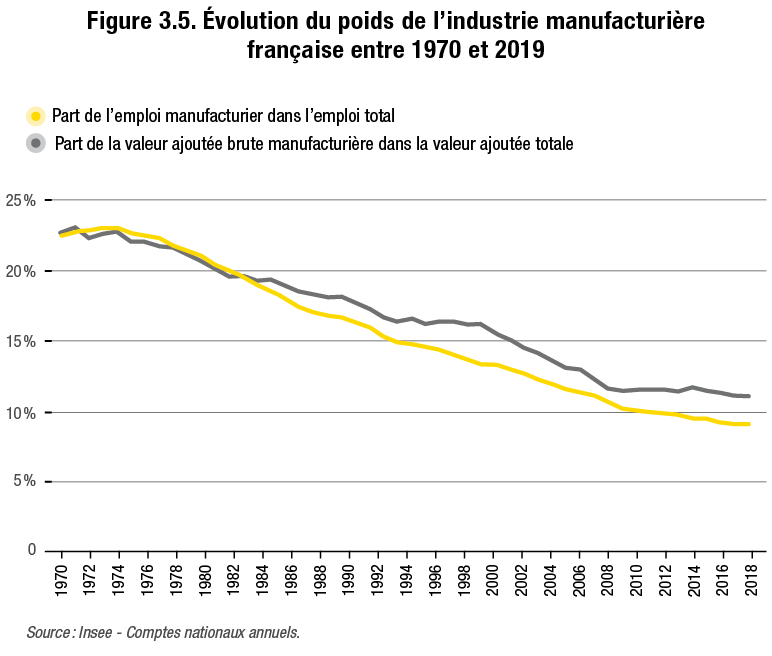
D’une part, la désindustrialisation, entendue au sens du recul relatif de l’emploi industriel, est, dans une certaine mesure, une tendance naturelle commune à toutes les grandes puissances industrialisées. Mais, d’autre part, quand la désindustrialisation rime avec des pertes de parts de marché à l’export ou un déficit commercial structurel des biens manufacturés (26,7 milliards d’euros en 2019) (voir figure 3.6), alors elle est le visage perceptible d’un problème de compétitivité.
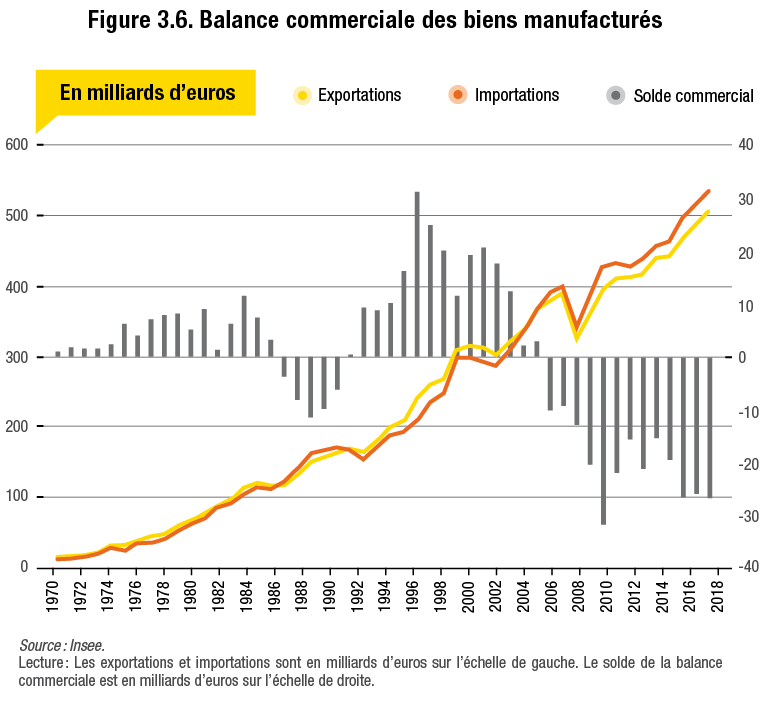
Mais alors peut-on considérer les relocalisations comme un moyen de reconstituer le tissu industriel français ? Peut-être faut-il définir ce qu’on entend par « relocalisation ».
Selon la plupart des économistes, la relocalisation consiste dans le « retour dans le pays d’origine d’unités productives, d’assemblage ou de montage, antérieurement délocalisées sous diverses formes dans les pays à faibles coûts salariaux » (Mouhoud, 2017). Ainsi, les délocalisations destinées à se rapprocher des marchés n’ont pas vocation à relocaliser. Seules les délocalisations qui consistent à fragmenter la production sont relocalisables. De ce point de vue, la relocalisation répond à un seul type de délocalisation, celle qui est réalisée dans une logique de baisse des coûts. Les entreprises qui transfèrent leur activité dans une logique de conquête de marché n’ont en effet pas vocation à revenir sur le territoire d’origine. Selon la Direction générale des entreprises (DGE), le phénomène de relocalisation reste très marginal en France : elle a recensé 98 cas de relocalisations entre mai 2014 et septembre 2018 et n’en a répertorié que 107 entre 2005 et 2013 (DGCIS/Datar/PIPAME, 2013). Une étude pilotée par le ministère du Redressement productif et la Datar (2014) identifie deux schémas de relocalisation. Les « relocalisations de développement » proviennent d’entreprises dont une première phase de lancement et de croissance est réalisée dans un pays à bas coûts avant d’envisager un retour dans le pays de la société mère pour développer des produits de gammes supérieures. C’est le cas, par exemple, de l’entreprise Kusmi Tea qui a fait le choix, en 2005, de recourir à un fournisseur de boîtes métalliques en Chine et à un producteur de sachets de thé au Maroc (voir encadré 7). Les « relocalisations de retour » répondent à une autre logique. Elles sont surtout le fait d’entreprises déçues par des délocalisations qui ont révélé au fil du temps des coûts de production cachés (défauts de fabrication, coûts de transport élevés, etc.).
Encadré 7 : Le retour gagnant de Kusmi Tea
Kusmi Tea est le leader du thé premium en France. Avant son rachat par la société familiale Orientis, en 2003, Kusmi Tea est proche du dépôt de bilan. Son produit était alors entièrement fabriqué en France : l’activité de Kusmi Tea consistait à mélanger, aromatiser et conditionner le thé dans des sachets réalisés en Mayenne et des boîtes en métal fabriquées en région parisienne. La contrepartie de cette fabrication made in France était un coût de revient trop élevé, au regard du prix auquel l’entreprise pouvait vendre ses produits. En 2005, le groupe Orientis décide de restaurer ses marges, d’une part, en augmentant le prix de vente pour positionner la marque sur le haut de gamme et, d’autre part, en délocalisant une partie de l’activité de façon à réduire les coûts de production.
L’entreprise confie la production de sachets à une entreprise marocaine qui fournit des sachets cousus mains à un coût équivalent à 60 % du prix français. Elle recourt également à un fournisseur de boîtes métalliques en Chine qui les propose au tiers du prix français. La baisse significative du coût de revient des boîtes et des sachets de thé a permis à l’entreprise de restaurer ses marges et de financer de nouveaux investissements. Une fois les positions de marché établies et des volumes de production suffisamment élevés pour réaliser des économies d’échelle, Kusmi Tea commence par rapatrier la production de boîtes en 2012 en faisant appel à une PME du Loiret. Cette décision est également motivée par l’augmentation des coûts en Chine, des taux d’imperfection élevés liés au transport et un manque de réactivité des sites de production.
L’entreprise décide ensuite d’investir 2,5 millions d’euros dans des robots japonais capables de produire des sachets de thé, jusqu’alors confectionnés à la main. La robotisation d’une partie de l’activité permet à l’entreprise d’achever sa relocalisation : en 2014, Kusmi Tea internalise la production de sachets de thé dans ses ateliers français.
En 2003, Kusmi Tea enregistrait un chiffre d’affaires de 800 000 euros et employait une dizaine de personnes. Fin 2017, l’entreprise réalisait un chiffre d’affaires de 80 millions d’euros et comptait plus de 500 salariés.
Source : d’après Alternatives économiques, 2018, et Les Échos, 2017.
Derrière l’idée de relocalisation figurent plusieurs objectifs, parmi lesquels la création d’emplois industriels. Si on définit la réindustrialisation comme l’augmentation de la part relative du nombre d’emplois industriels dans l’emploi total, alors la relocalisation n’apparaît pas comme un moyen efficace de reconstituer le tissu industriel français. D’abord, il sera difficile de faire revenir les sites de production dont la main-d’œuvre demeure une part élevée des coûts de production ou dont l’activité est à faible valeur ajoutée. Ensuite, la relocalisation d’activités suppose la reconstitution d’écosystèmes de production sur le territoire d’origine : la relocalisation d’une entreprise a peu d’intérêt si ses fournisseurs ne sont pas à proximité. Enfin, les quelques relocalisations plausibles concernent des activités qui sont automatisables et créent donc peu d’emplois directs. En dépit des subventions proposées par le gouvernement, le retour d’activités autrefois délocalisées ne pourra donc représenter qu’une solution très partielle à la réindustrialisation.
Dans le débat public entourant le plan de relance, il semble plus indiqué de mettre l’accent sur le maintien de l’activité industrielle existante et sur l’implantation de nouvelles activités. Dès lors, il s’agit principalement de renforcer la compétitivité coût et hors coût sur le territoire national. Une étude de Coe-Rexecode (2018) pointe notamment l’impact d’une fiscalité pénalisante sur l’industrie française. D’une part, le secteur industriel est soumis à un taux de prélèvement obligatoire plus élevé que celui qui prévaut dans les secteurs non industriels. En 2016, l’ensemble des prélèvements pesant sur l’industrie manufacturière représentait 27,9 % de la valeur ajoutée brute, contre 24 % pour les autres secteurs. D’autre part, le niveau de taxation de l’industrie française est relativement élevé, par rapport aux autres pays européens. Pour comparaison, l’ensemble des prélèvements obligatoires pesant sur l’industrie manufacturière allemande s’élève à 17,2 % de la valeur ajoutée brute. Selon Coe-Rexecode, cet écart de 10,7 points de la valeur ajoutée brute provient, pour plus de la moitié, des prélèvements issus des impôts de production. La remise du rapport Gallois en 2012 a été un marqueur important de la prise de conscience des décideurs publics, y compris à gauche, du déficit de compétitivité coût de la France à l’issue de la décennie 2000, et par conséquent de la nécessité de renforcer une politique de l’offre. Cependant, la proposition phare du rapport Gallois portait non pas sur la réduction des impôts de production mais sur la réduction des charges sociales pesant sur les salaires intermédiaires. Cette proposition s’est traduite par la création du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) en 2012. Le CICE s’écartait toutefois des recommandations du rapport sur deux points importants : d’une part, il n’était pas uniquement au service de la compétitivité mais aussi – pour ne pas dire surtout – au service de l’emploi ; d’autre part, et pour cette raison, il était prioritairement ciblé sur les bas salaires. Il n’a donc apporté qu’un gain de compétitivité modéré pour bon nombre de secteurs industriels. Il a fallu attendre le plan de relance de 2020 pour que la baisse des impôts de production soit envisagée puis annoncée par le gouvernement, à hauteur de 20 milliards, dont un peu plus de 7 milliards concernant l’industrie. Si l’on compare ce montant au milliard dédié aux relocalisations, on peut supposer que le gouvernement mise lui aussi davantage sur le renforcement du tissu productif que sur les relocalisations pour mettre un frein à la désindustrialisation.
La montée en gamme de l’industrie est un autre enjeu majeur pour la France. En effet, alors que la France compte des activités très haut de gamme, parmi lesquelles l’aéronautique et le luxe, ses exportations demeurent en moyenne plus sensibles aux variations de prix que celles de l’Allemagne, du Royaume-Uni ou encore du Japon (Sautard, Tazi, Thubin, 2014). Dit autrement, la production française se situe à un niveau de gamme intermédiaire et son pouvoir de marché est plus faible. Dans les années 2000, les entreprises françaises ont largement opté pour une délocalisation des sites de production vers des pays à bas coût, dans un contexte d’accroissement des échanges commerciaux, tandis que l’Allemagne a fait le choix de la montée en gamme de ses produits. Selon le récent rapport de France Stratégie (2020), « les grandes entreprises françaises sont [donc] devenues les championnes de la délocalisation, ce qui leur a permis de maintenir leur compétitivité au niveau mondial, mais au détriment de l’emploi industriel en France ». En 2017, l’emploi des filiales industrielles à l’étranger des groupes français représentait 62 % de l’emploi industriel en France, contre 52 % au Royaume-Uni, 38 % en Allemagne, 26 % en Italie et 10 % en Espagne. Cette analyse est corroborée par une récente étude du Trésor (de Warren, 2020) qui montre que le positionnement moyenne gamme des entreprises françaises explique en partie leurs stratégies d’internationalisation. Depuis les années 2000, celles-ci ont privilégié les investissements à l’étranger plutôt que les exportations, contribuant au recul de la valeur ajoutée industrielle produite en France et à la dégradation de la balance commerciale. L’exemple du secteur automobile illustre bien ce phénomène. Le positionnement de l’industrie française sur des segments à haute valeur ajoutée devrait améliorer la pérennité des activités sur le territoire et leur développement68. Complétant la recherche d’une compétitivité coût, l’action publique doit également renforcer la compétitivité hors coût de l’industrie. Outre les politiques en faveur de l’innovation et de la numérisation mentionnées précédemment, il s’agit d’encourager la formation des travailleurs aux nouvelles technologies ainsi qu’aux nouvelles organisations du travail. À ce titre, le programme Territoires d’industrie lancé en 2018 permet à 148 territoires de bénéficier d’une aide de l’État et des collectivités territoriales pour recruter, innover, attirer des compétences et simplifier les démarches administratives. Sur le milliard d’euros dédiés aux relocalisations dans le cadre de France Relance, 400 millions sont destinés à ce programme d’ici à 2022, afin de financer des projets industriels (création et extension de sites, modernisation, nouveaux équipements, etc.). On perçoit là encore que la priorité est donnée au renforcement des bases industrielles existantes plutôt qu’aux relocalisations sur le territoire.
Les relocalisations participent à la résilience de l’industrie française
La pandémie de Covid-19 a relancé le débat sur la vulnérabilité à laquelle s’exposent les entreprises, et par extension les pays, en cas de forte dépendance vis-à-vis de l’étranger pour certains approvisionnements. Le constat a été dressé quand sont apparus des risques de pénurie sur des produits dits stratégiques, comme les masques, les réactifs pour les tests PCR ou les respirateurs. À travers le phénomène de dépendance, c’est l’excès de fragmentation internationale des processus de production qui s’est trouvé remis en question. La France, comme l’ensemble des grands pays développés, est très insérée dans les chaînes de valeur mondiales. Cette insertion permet aux entreprises de bénéficier des avantages comparatifs des pays partenaires pour certains segments de leur production. Schématiquement, les entreprises se concentrent sur des activités à haute valeur ajoutée (R&D, conception, production en juste-à-temps, etc.) sur le territoire national tandis qu’elles externalisent, au besoin à l’étranger, les autres stades du processus de production. Ce phénomène se traduit par des gains de compétitivité pour les entreprises et des gains de pouvoir d’achat pour les consommateurs. La fragmentation des processus de production a naturellement accru notre dépendance vis-à-vis de l’étranger sur les biens manufacturés. En 2015, le contenu importé des biens manufacturés consommés par les ménages français s’élève à 64 %, contre 19 % pour la consommation finale (Insee, 2019). La décomposition selon l’origine des importations permet d’affiner ce résultat et de déterminer les pays vis-à-vis desquels la dépendance est la plus grande. Le contenu importé des biens manufacturés consommés par les ménages français provient tout d’abord d’Allemagne à 14,6 %, puis de Chine (12,6 %) et des États-Unis (7,4 %) (voir figure 3.7). S’agissant des entreprises industrielles, la dépendance peut se mesurer comme la part des intrants étrangers contenue dans la production. Selon une note récente du Trésor sur la vulnérabilité des approvisionnements français et européens (Bonneau et Nakaa, 2020), cette part est passée de 29 % à 39 % au cours des vingt dernières années69. Si la part des intrants d’origine européenne est bien plus importante pour l’ensemble des secteurs industriels français, la dépendance à la Chine est bien réelle. Selon une étude de l’IPP (Gerschel et al., 2020), elle se matérialise à la fois par les importations chinoises de biens intermédiaires et par la valeur ajoutée chinoise contenue dans des intrants issus d’autres pays.
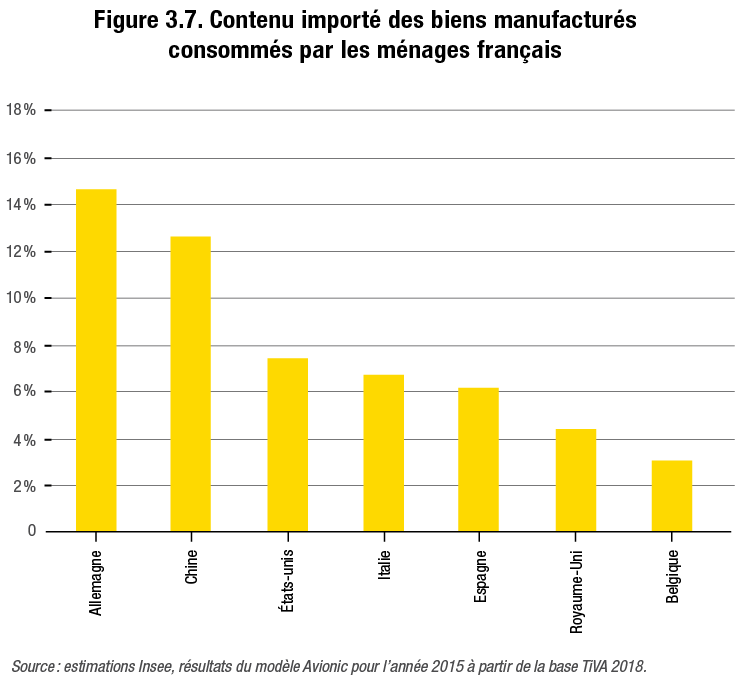
La réponse à notre « dépendance » à l’égard de l’étranger pour produire des biens indispensables passe par la notion de « souveraineté industrielle ». Pour un pays, celle-ci suppose de pouvoir satisfaire certains besoins essentiels sans dépendre de la bienveillance ou de la volonté d’un autre État. De ce point de vue, la fragmentation des chaînes de valeur peut créer des situations de dépendance. La pénurie actuelle de semi-conducteurs en offre une bonne illustration. Elle montre que la dépendance à l’étranger peut avoir des conséquences économiques désastreuses lorsque la production industrielle est concentrée dans un petit nombre d’entreprises et de pays. À partir d’un examen des flux commerciaux internationaux, Jean et Vicard (2020) montrent qu’en 2018 « près de 6 % des importations françaises concernaient des produits pour lesquels un seul pays représentait plus de 50 % des exportations ». Dans deux tiers des cas, le fournisseur prédominant était la Chine.
Pour définir une stratégie de résilience adaptée, encore faut-il identifier les biens pouvant être source de vulnérabilité sur un territoire donné. Selon la méthodologie employée, les résultats peuvent être très différents d’une étude à l’autre. PwC (2020) a identifié, pour le Conseil national des achats (CNA), 58 catégories de produits aujourd’hui importés qui auraient un potentiel prioritaire de relocalisation70. Ils appartiennent à quatre secteurs d’activité qui regroupent la santé-pharmaceutique, l’agroalimentaire, l’électronique et les industries de process et d’assemblage. L’étude montre que ces secteurs représentent 115 milliards d’euros d’importations, soit près de 21 % des importations françaises en 2018. Une étude du Trésor (Bonneau et Nakaa, 2020) adopte une autre méthodologie consistant à examiner les importations extra-UE d’environ 5 000 catégories de produits pour six pays (France, Allemagne, Italie, Espagne, Pays-Bas, Pologne) et à y identifier des éléments constitutifs de vulnérabilité. Mais encore faut-il définir ce qu’est un bien vulnérable. Deux critères ont été pris en compte : la concentration des importations depuis un nombre réduit de pays fournisseurs hors Union européenne et l’existence d’alternatives pour se fournir auprès d’autres pays. L’analyse des vulnérabilités dans les importations françaises extra-UE met en évidence 121 produits concentrés en 2018. Parmi eux figurent notamment des produits chimiques et pharmaceutiques, des produits métallurgiques dont certaines terres rares et des biens d’équipement (machines-outils, accumulateurs, etc.). La Chine est le principal fournisseur du quart de ces produits. Toutefois, les auteurs de l’étude concluent que, sur ces 121 produits, seulement 12 sont « vulnérables » du fait d’un faible potentiel de diversification. Néanmoins, une limite de l’étude, soulignée par les auteurs, réside dans la non-prise en compte des dépendances indirectes via les fournisseurs de rang 2 ou plus. En effet, les données mobilisées n’offrent pas un niveau de détail suffisamment fin pour détecter si un bien importé de l’Union européenne contient des intrants extra-européens. Les vulnérabilités d’approvisionnement peuvent donc être minorées, du fait des vulnérabilités indirectes. En adoptant une approche similaire, une récente note du CAE (Jaravel et Méjean, 2021) s’affranchit de ce biais d’agrégation en analysant les données des douanes à un niveau très fin, sur environ 10 000 produits. Pour identifier les intrants potentiellement vulnérables, ils retiennent trois critères : i) une production majoritairement extra-UE, ii) un faible nombre de producteurs et iii) la concentration sur une seule entreprise française de 90 % des exportations, considérée comme une « vulnérabilité renforcée ». Les auteurs identifient 644 intrants répondant aux deux premiers critères, soit 4 % des importations françaises pour lesquelles l’approvisionnement est majoritairement hors Union européenne et concentré dans un faible nombre de pays fournisseurs. Parmi ces intrants, 122 produits présentent un risque de vulnérabilité renforcée car une seule entreprise française concentre au moins 90 % des approvisionnements au niveau national. L’ensemble de ces résultats, cohérents entre eux malgré l’application de méthodes différentes, suggèrent que les risques pesant sur les approvisionnements proviennent avant tout de l’organisation très concentrée des chaînes de valeur mondiales, mais ils ne remettent pas en cause les bénéfices de la mondialisation. En conséquence, une stratégie publique de « souveraineté industrielle » n’a de sens que par une approche sur mesure, pour ne pas dire chirurgicale. Pour les produits dont le potentiel de diversification est faible, une politique industrielle en faveur des relocalisations a du sens, à condition toutefois – comme le souligne le CAE que les capacités productives sur le territoire puissent se situer à la frontière technologique, comme dans le nucléaire ou les secteurs automobile et aéronautique. Lorsque le retard technologique est trop important, de telles politiques seraient vaines, le leadership technologique n’étant alors pas envisageable pour les entreprises françaises ou européennes. Pour le dire autrement, les politiques en faveur des relocalisations doivent être combinées à d’autres stratégies publiques de résilience, notamment la recherche d’une plus grande diversification des fournisseurs et des sources (par exemple, via une sensibilisation des acteurs aux risques pandémiques ou aux pénuries) et la constitution de stocks stratégiques.
S’il n’est pas aisé de déterminer les périmètres géographique et industriel au sein desquels la souveraineté doit s’apprécier, la politique industrielle ne peut de toute façon se restreindre aux seuls arbitrages économiques, la sécurité des approvisionnements étant indispensable à l’autonomie stratégique d’un État. C’est pourquoi, sur 1 milliard d’euros dédié aux relocalisations dans le cadre de France Relance – déduction faite des 400 millions dédiés aux Territoires d’industrie –, 600 millions visent à sécuriser les approvisionnements et à relocaliser les activités stratégiques en ciblant les secteurs de la santé, de l’agroalimentaire, des télécommunications, de l’électronique, des intrants industriels critiques, de l’automobile et de l’aéronautique71. Au niveau européen, des premières initiatives ont éga lement été prises pour favoriser l’autonomie stratégique dans certains secteurs clés. Le 18 février 2021, la Commission présentait sa nouvelle stratégie commerciale qui affiche clairement un objectif « d’autonomie stratégique ouverte ». Loin de remettre en cause l’ouverture aux échanges, la nouvelle stratégie proposée par la Commission affiche une plus grande fermeté vis-à-vis de ses partenaires extérieurs et propose de développer de nouveaux outils visant à mieux protéger les entreprises européennes contre les pratiques déloyales de pays tiers72 (subventions étatiques, fermeture des marchés publics, contrôle des investissements directs à l’étranger, etc.).
La relance par la demande : le cas du secteur automobile
L’impact du secteur automobile sur le reste de l’économie
Si l’on en croit le dernier rapport de France Stratégie sur les politiques industrielles (2020), la France serait « championne d’Europe de la relance de la demande depuis 25 ans » dans le secteur automobile. En période de retournement, l’automobile fait en effet partie des secteurs les plus soutenus par les pouvoirs publics en raison de ses spécificités. D’abord, l’activité automobile est très corrélée à celle de l’économie : en période de crise, la consommation privée se détourne de ce type de biens durables, ce qui a un impact considérable sur la demande de véhicules. Ensuite, le secteur automobile se caractérise par une forte volatilité de sa production : durant les épisodes récessifs, la baisse de l’activité est plus forte dans le secteur que dans l’ensemble de l’économie en moyenne. Enfin, il entretient des liens forts avec d’autres pans de l’économie, via le poids de ses consommations intermédiaires (Dahmani et al., 2014). D’une part, la fabrication de véhicules intègre de nombreuses technologies issues d’autres branches (batteries électriques, équipements de télécommunication, etc.) et, d’autre part, elle s’appuie sur des services dédiés, parmi lesquels les services après-vente, les services de location et les infrastructures de recharge de batteries. Par conséquent, un choc économique dans le secteur automobile se traduit par un effet d’entraînement important sur le reste de l’économie. Pour évaluer l’effet multiplicateur d’un choc sur l’activité automobile, l’Insee (2012) a calculé à la fois l’effet direct du choc sur la branche et l’effet indirect sur les autres branches, via les consommations intermédiaires73. Selon cette analyse, la hausse d’un point de la valeur ajoutée dans la branche automobile se traduit par une hausse quatre fois plus importante dans l’ensemble de l’économie (voir figure 3.8). Cet important effet d’entraînement du secteur automobile sur le reste de l’économie, via le poids des consommations intermédiaires, justifie que les pouvoirs publics lui consacrent des politiques de relance spécifiques.
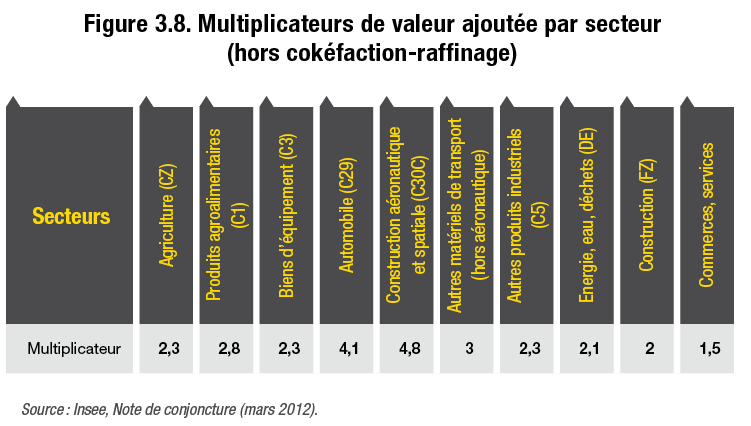
Pour faire face à un choc économique touchant le secteur automobile, la prime à la casse est de loin l’outil de relance par la demande le plus privilégié en France. Surnommée la « balladurette », la première prime à la casse, mise en place entre février 1994 et juin 1995, consiste en une aide de 5 000 francs pour l’achat d’une voiture neuve contre la mise au rebut d’un véhicule de plus de dix ans. Entre octobre 1995 et octobre 1996, lui succède la « jupette », une prime de 5 000 francs à 7 000 francs pour l’achat d’une voiture neuve, contre la mise au rebut d’une voiture de plus de huit ans et de moins de 3,5 tonnes. Il faudra attendre la crise de 2008 pour voir réapparaître cet outil. Le secteur automobile est alors confronté à une chute brutale de la demande d’automobiles couplée à un problème – antérieur à la crise – de surcapacités productives. Entre 2008 et 2012, les immatriculations de voitures particulières neuves sur le marché français ont chuté de 9 % (voir figure 3.9). Ainsi, dès décembre 2008, une aide de 1 000 euros est mise en place pour l’achat d’un véhicule neuf émettant moins de 160 grammes de CO2 par kilomètre, contre la mise au rebut d’un véhicule de plus de dix ans. Afin de lisser les effets de contrecoup inhérents à ce dispositif, le programme est prolongé en 2010, mais l’aide est réduite à 700 euros pour les véhicules commandés sur le premier semestre 2010, puis à 500 euros pour les véhicules commandés sur le second semestre. À la suite de la crise de 2008, les pouvoirs publics ont continué de recourir à ce type de dispositif pour répondre à des enjeux écologiques, notamment en accompagnant la stratégie d’électrification du parc automobile français74. Mais leur caractère contracyclique a été réactivé à l’occasion de la crise économique liée à la pandémie de Covid-19. En 2020, les immatriculations de voitures particulières neuves ont chuté de 25 % (voir figure 3.9). À partir d’une analyse sectorielle sur l’impact du premier confinement, l’OFCE (2020) montre que le secteur des matériels de transport est le troisième secteur dans lequel l’activité s’est le plus contractée : au 30 mars, la valeur ajoutée y a baissé de 70 %, contre 32 % pour l’ensemble de l’économie. Ainsi, le gouvernement a prévu pour l’ensemble des ménages affichant un revenu fiscal inférieur à 18 000 euros nets une aide à la conversion, à hauteur de 3 000 euros pour un véhicule thermique ou hybride et de 5 000 euros pour un véhicule électrique. Cette aide est toutefois limitée à 200 000 achats, l’initiative visant davantage à écouler les stocks d’invendus. En marge de ce dispositif destiné à pallier les difficultés conjoncturelles, les pouvoirs publics soutiennent l’achat de véhicules électrifiés : le bonus pour l’achat d’un véhicule électrique est porté à 7 000 euros pour les particuliers et 5 000 euros pour les entreprises. Une aide à l’achat d’un véhicule hybride rechargeable est également mise en place, pour un montant de 2 000 euros. Ces dispositifs répondent donc à un double objectif de relance économique et de transition écologique vers des véhicules moins polluants.
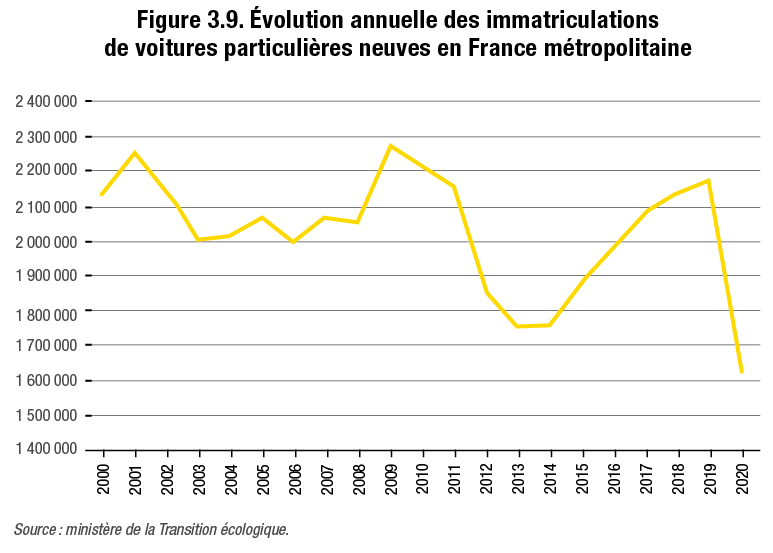
Les mesures de prime à la casse favorisent les ventes de véhicules à court terme mais moins les usines françaises
Les dispositifs de prime à la casse et leur impact sur l’économie font encore l’objet de nombreux débats. Il est aujourd’hui admis que ce type de mesures stimulent les ventes automobiles à court terme, notamment en période de crise économique. Elles sont toutefois suivies d’un contrecoup sur les immatriculations à plus long terme, l’arrêt du dispositif provoquant une baisse d’activité dans le secteur (Adda et Cooper, 2000 ; Müller et Heimeshoff, 2013). En effet, le caractère temporaire de ces programmes suscite essentiellement le renouvellement anticipé du parc automobile, tandis que leur arrêt endigue les ventes en raison de ce même renouvellement. Mais si ces mesures contracycliques permettent de limiter la chute des ventes, elles ne se traduisent pas mécaniquement par un soutien à l’emploi et à l’activité des usines françaises. Depuis le milieu des années 2000, les constructeurs automobiles français ont intensifié la délocalisation d’une partie de leur production à l’étranger (voir figure 3.10), notamment dans les pays d’Europe centrale et orientale (PECO), puis au Maghreb et en Turquie. Ce mouvement de délocalisation a particulièrement concerné la production de petits véhicules peu émetteurs de CO2, lesquels bénéficient en premier lieu des bonus-malus écologiques et des achats subventionnés par la prime à la casse. Selon Bernard Jullien, économiste et spécialiste du secteur automobile, subventionner l’achat de véhicules, « c’est certes bon pour les comptes de PSA ou Renault mais pour les sites de production français l’effet est nul ». S’il est légitime de s’interroger sur la pertinence d’une politique nationale qui subventionne la fabrication de voitures à l’étranger, les arguments en faveur d’une telle mesure restent néanmoins nombreux. D’une part, les mesures de soutien à la demande automobile permettent d’enrayer les tensions sur la trésorerie des constructeurs et, par ricochet, de bénéficier aux entreprises en amont et en aval de la filière75. D’autre part, des dispositifs très semblables sont mis en place dans les autres principaux pays européens, notamment en période de crise. L’absence d’une telle mesure en France pourrait créer des distorsions de concurrence défavorables aux constructeurs français. Durant la crise de 2008, la simultanéité des mesures au niveau européen a permis de soutenir le marché automobile européen de façon relativement uniforme76. Enfin, les aides répondent également à des enjeux écologiques en incitant les ménages à acquérir des véhicules moins consommateurs d’énergies carbonées. Mais ce dernier point est sujet à débat en période de crise économique. Du point de vue de la filière automobile, conditionner le dispositif de prime à la casse aux émissions de CO2 nuirait à son objectif de relance. Du point de vue des ONG environnementales (Greenpeace, Réseau Action Climat et la Fondation Nicolas Hulot), le maintien des primes à la casse pour l’achat de véhicules thermiques est un « non-sens climatique et social »77. Or, réserver exclusivement les primes à l’acquisition des seuls véhicules électriques ou hybrides risquerait d’obérer la capacité de relance des constructeurs. Ces derniers détiennent en effet majoritairement des stocks de voitures thermiques.
La multiplicité des objectifs assignés à ce type de dispositif comporte toujours un risque d’inefficacité. Pourtant, au cas d’espèce, une étude publiée en 2016 montre que l’effet stabilisateur de la prime à la casse sur les ventes, dans le contexte de la crise de 2008, a été plus important dans les pays ayant opté pour un dispositif en partie conditionné aux émissions de CO2 (France, Italie, Portugal et Espagne) que dans les pays n’ayant pas fait ce choix (Allemagne, Pays-Bas et Royaume-Uni)78.
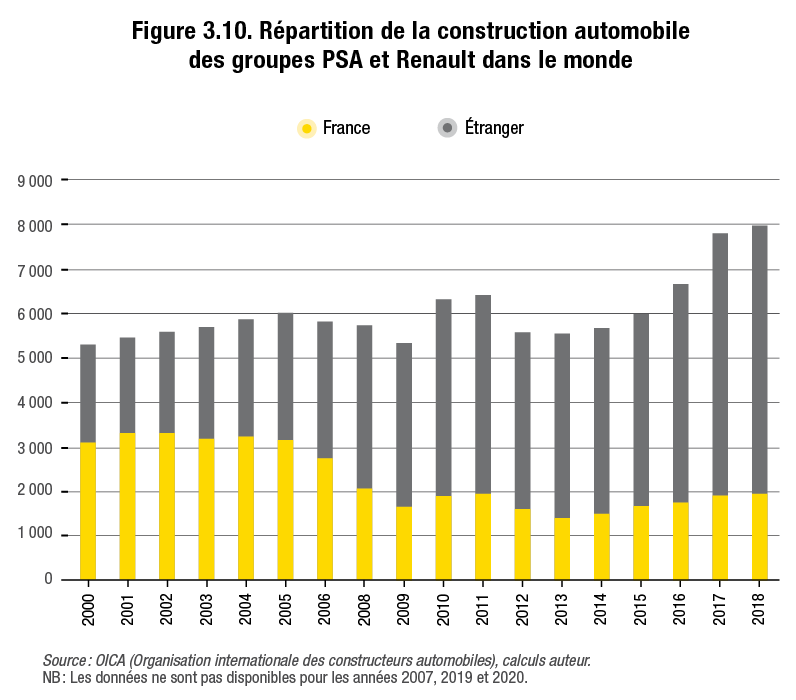
- 47. Department for Business, Innovation & Skills (2010).
- 48. Le plan quinquennal est un outil de planification économique. Le premier plan quinquennal a été lancé en 1953.
- 49. Source : Banque de France.
- 50. Ces chiffres doivent être pris avec précaution car ils sont fréquemment révisés par l’Insee en cours d’année.
- 51. Mouvement des entreprises de taille intermédiaire.
- 52. Confédération des petites et moyennes entreprises.
- 53. La dette est dite subordonnée.
- 54. L’enveloppe de 1 milliard d’euros confiée à Oseo avait été portée à 2 milliards en mars 2011.
- 55. https://www.usinenouvelle.com/article/comment-va-fonctionner-le-fonds-d-aide-aux-equipementiers-automobiles-de-600-millions-d-euros.N970871
- 56. https://www.usinenouvelle.com/article/comment-va-fonctionner-le-fonds-d-aide-aux-equipementiers-automobiles-de-600-millions-d-euros.N970871
- 57. Source : Fédération internationale de robotique (FIR).
- 58. La subvention « industrie du futur » s’applique aux investissements relevant des catégories suivantes : équipements robotiques et cobotiques ; équipements de fabrication additive ; logiciels utilisés pour des opérations de conception, de fabrication, de trans-
formation ou de maintenance ; machines intégrées destinées au calcul intensif ; capteurs physiques collectant des données sur le site de production de l’entreprise, sa chaîne de production ou sur son système transitique ; machines de production à commande programmable ou numérique ; équipements de réalité augmentée et de réalité virtuelle utilisés pour des opérations de conception, de fabrication ou de transformation ; logiciels ou équipements dont l’usage recourt, en tout ou partie, à de l’intelligence artificielle. - 59. Entreprises employant entre 1 et 249 salariés.
- 60. « La transformation numérique : une opportunité de croissance pour les TPE-PME françaises », Ipsos France.
- 61. Dès le départ, le PIA était orienté vers quatre thèmes : modernisation de l’enseignement supérieur ; soutien au renouveau de l’industrie par l’innovation ; transition énergétique ; diffusion du numérique et équipement en haut débit.
- 62. Le SGPI a succédé au CGI début 2018.
- 63. Les projets doivent regrouper au moins deux entreprises et un acteur public de recherche ou un organisme public de formation.
- 64. « Les dispositifs à destination des entreprises industrielles », ministère chargé de l’Industrie, octobre 2020.
- 65. Les 7,5 milliards de financement restants sont dédiés au volet « innovation structurelle » qui vise à poursuivre les efforts en faveur des « écosystèmes de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation ».
- 66. Cette section s’appuie en partie sur une précédente publication de La Fabrique de l’industrie : Bellit S., Granier C. et Mini C., « De la souveraineté industrielle aux relocalisations : de quoi parle-t-on ? », Document de travail, 2020.
- 67. Source : Eurostat.
- 68. Dans le cas des IAA, le positionnement sur le haut de gamme peut toutefois se révéler une impasse coûteuse. Selon une étude de La Fabrique de l’industrie (Zarka et Laroche, 2015), fabriquer efficacement des produits de milieu de gamme peut être très lucratif.
- 69. Calculs des auteurs à partir des données de la base MRIO (Multi-Regional Input Output).
- 70. PwC détermine les produits ayant un potentiel prioritaire de relocalisation à partir de 7 critères : 1) ils font partie des activités critiques ou stratégiques, 2) ils ont une valeur élevée des importations extra-UE, 3) une part importante de la demande nationale couverte par les importations hors UE et 4) les importations hors UE, 5) une évolution accrue de la part des importations extra-UE dans la demande, 6) une balance commerciale déficitaire et 7) ils ont une demande nationale et étrangère élevée.
- 71. https://investinfrance.fr/wp-content/uploads/2017/08/2021-02-Fiche-France-Relance-BFInvest.pdf
- 72. https://www.lesechos.fr/monde/europe/commerce-bruxelles-defend-une-approche-plus-ferme-et-plus-ecologique-1291595
- 73. « Construction aéronautique et construction automobile, deux secteurs qui ont un effet d’entraînement marqué sur le reste de l’économie », Note de conjoncture, p. 99, mars 2012. Le multiplicateur de valeur ajoutée est estimé à partir des tableaux entrées-sorties fournis par les comptes nationaux. Il est d’autant plus élevé que le processus de production utilise une part importante de consommations intermédiaires et que celles-ci sont riches en valeur ajoutée et pauvres en importations.
- 74. Les premiers bonus-malus écologiques ont été créés en décembre 2007, dans le cadre du Grenelle de l’environnement. S’ils avaient pour objectif principal d’accélérer le verdissement du parc automobile français, ils ont également favorisé les constructeurs nationaux, ces derniers produisant des véhicules moins émetteurs de CO2 que leurs homologues européens (Fréhaut, 2012).
- 75. Il faut toutefois préciser que la valeur ajoutée produite en France dans le secteur automobile risque de se réduire à l’avenir, compte tenu de la dépendance à l’étranger sur la production de véhicules électriques.
- 76. Voir l’étude de la Banque centrale européenne : « The effects of vehicule scrapping schemes across euro area countries », octobre 2009.
- 77. https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/automobile-le-casse-tete-dune-relance-verte-1205799
- 78. Selon cette étude de Grigolon et al. (2016), en l’absence d’un dispositif de prime à la casse, les ventes auraient été 30,5 % moins élevées dans les pays avec une prime à la casse ciblée, contre 29,0 % dans les pays avec une prime à la casse non ciblée, À l’échelle des pays, une hausse de ١ % du montant de la prime aurait augmenté les ventes de 3,8 % en Allemagne, 2,9 % aux Pays-Bas et 1,3 % au Royaume-Uni. Cette même hausse aurait augmenté les ventes de 9,1 % en France et de 5,3 % en Italie.
Les opportunités dans les crises – Point de vue
Par Joseph Puzo, PDG de l’entreprise AXON’ CABLE.
La crise en idéogramme chinois :
Le mot wei ji, qui veut dire « crise » en chinois, reflète brillamment une sagesse antique, puisqu’il est représenté par 2 idéogrammes, l’un signifiant « danger » et l’autre « opportunité ».
Les 4 crises que notre entreprise AXON’ CABLE a traversées de 1980 à 2020, environ une crise par décennie, ont été des aiguillons pour nous forcer à améliorer notre organisation et à rendre notre entreprise plus résiliente.
La récession du début des années 1980
Fin 1980, jeune dirigeant embauché dans une PME de 100 salariés, fabriquant du câble électronique standard, j’ai dû immédiatement faire face à la crise économique de 81 à 84, et sa forte inflation, communément appelée « la récession du début des années 1980 ». Elle fut brutale et sévère dans l’industrie du câble, suite aux années florissantes précédentes. Les câbliers bradaient leurs produits.
Ma PME ne pourrait pas survivre longtemps en cassant les prix. J’ai voulu échapper à cette concurrence féroce par la technologie, en montant en gamme. J’ai créé un embryon de Service R&D. Le concurrent qui faisait les câbles électroniques les plus techniques était alors la société américaine W. L. GORE. Elle commercialisait des coaxiaux souples pour les hyperfréquences. L’isolant entre le conducteur central et le blindage était en Téflon PTFE poreux, le fameux GORETEX. Avec l’aide de l’École de Chimie de Montpelier, nous réussîmes en 18 mois seulement à inventer et breveté un procédé différent pour réaliser un isolant en PTFE poreux, que nous nommâmes CELLOFLON. Et c’est ce CELLOFLON, qui nous permettra à partir de 1990 d’obtenir des commandes en câblage spatial.
Cette récession avait affecté les différents pays industriels sur des périodes légèrement décalées. Si mon entreprise avait eu des filiales à l’étranger, elles n’auraient pas toutes été touchées en même temps. Cela m’a incité à créer ٤ filiales-exports, en 1990, dans les pays les plus industriels d’alors : les USA, le Japon, l’Allemagne, la Grande-Bretagne.
La crise Covid de 2020 :
Début février 2020, AXON’ exposait au salon aérospatial de Singapour. Le Covid commençait à se répandre dans Singapour. Une prise de température, avec thermomètre sans contact, était exigée pour être autorisé à entrer au salon, tout comme dans les restaurants de la ville. Et les salutations se faisaient sans contact physique. Cela nous donna la méthode à suivre quand la crise débuta en mars en France. Nous importâmes des thermomètres sans contact par notre filiale commerciale de Singapour et des masques par notre filiale en Chine.
À partir de mars 2020, les commandes ralentirent fortement, notamment en aéronautique.
Nos concurrents américains utilisèrent 4 méthodes, déjà mises en place lors de la crise de 2009 :
1. Arrêt de la R&D, car cela restait le plus facile à couper.
2. Arrêt des expositions dans les salons professionnels, mais cette fois parce que tous les salons étaient annulés.
3. Suppression des visites commerciales en présentiel chez les clients, mais cette fois parce que les clients refusaient les visites, voire certains clients étaient totalement à l’arrêt.
4. Licenciement immédiat d’un maximum de salariés, comme le permet la législation américaine. Parfois du chômage partiel dans certains pays, dont la France.
Nous prîmes 4 mesures à contrepied de nos concurrents, en décidant d’accélérer pour être prêts avant tout le monde en vue de la future sortie de crise :
1. Accélération de notre RDI (Recherche & Développement & Industrialisation). Nous avons terminé rapidement, début octobre 2020, la construction d’une nouvelle usine, AXO.PLUS, de 4 500 m² à Montmirail pour y fabriquer des câbles de « plus » grande longueur. Un câble plus long facilite l’automatisation de l’étape suivante d’assemblage du câble en cordon. Nous avons accéléré la R&D pour terminer trois nouvelles lignes de production. Pour coordonner notre RDI, nous avons utilisé l’application Webex pour faire nos réunions en visioconférence avec nos chefs de services en France. En outre toutes les semaines, le mercredi de 12H à 13h, en heure française, nous faisions, et nous faisons encore en juin 2021, un échange avec nos 22 dirigeants de filiales dans le monde, de la Chine aux USA.
2. Proposition de « e-séminaires » techniques à nos clients en remplacement des salons. Chaque e-séminaire est réservé au personnel d’un seul client à la fois, pour préserver la confidentialité des projets du client. Avec l’application Webex, le e-seminaire commence par une vidéo sur un de nos nouveaux produits, puis un débat en ligne sur l’intérêt dans le domaine du client.
3. Contacts personnalisés fréquents avec nos clients : en les appelant souvent, en leur envoyant par courriel des « AxoNews », une feuille présentant une nouveauté technique. Pour nos commerciaux dans nos filiales du monde entier, nous envoyons des « AxoClues », une feuille donnant l’argumentaire pour convaincre face aux produits concurrents. Et quelques fois des « AxoBuzz », une feuille technique humoristique.
4. Aucun licenciement, pas même de chômage partiel pour nos salariés. Certes 30 % de nos salariés sont restés au domicile lors du premier confinement en France de mi-mars à mi-mai 2021, soit en télétravail, soit en garde d’enfant, soit en tant que personne à risque. Mais nous nous sommes vite rendu compte que cela baissait la productivité et surtout la créativité, même avec l’alternance trois jours en distanciel pour deux en présentiel, et même avec le rapport quotidien pour les journées en distanciel. Le Covid a fait ressortir que la pause-café conviviale en entreprise est aussi un moment informel d’échange d’idées et d’inventivité. Nous avons proposé lors du second confinement à tous nos salariés de rester en présentiel, même pour les personnes à risque, sous réserve de l’accord de leur médecin. Nos usines sont en zones rurales, sans transport en commun. Les salariés utilisent leur propre voiture : ils échappent donc à la promiscuité et aux risques de contamination des métros ou des bus collectifs. Nous avons aussi accueilli deux fois plus de stagiaires que les autres années, car les étudiants ont eu beaucoup de mal à trouver des stages. Bien sûr nous avons été très stricts sur les mesures-barrières, mais à notre propre étonnement ces mesures ont été systématiquement respectées sans avoir à faire de rappel à l’ordre.
Que s’est-il passé en 2020 pour AXON’ : le chiffre d’affaires consolidé a baissé de 1 % par rapport à 2019, alors que nous avions prévu une croissance de 1 % en janvier 2020. Le résultat net a été un bénéfice de 2 % alors que nous escomptions un 5 %. Notre implantation internationale nous a été utile. Les ventes en Chine ont été en progrès et ont même connu une forte accélération en ce début 2021. Le secteur automobile, qui représentait 25 % de nos ventes avait baissé fortement de mars à septembre 2020, puis est remonté. Le secteur aéronautique, qui représentait 30 % de nos ventes en 2019, a baissé quasiment de moitié et n’est toujours pas remonté. Par contre le Spatial et la Défense se sont fortement développés dans le monde entier. La diversité géographique et sectorielle de nos marchés nous a donc servi, même si notre 30 % en aéronautique en 2019 s’est révélé être une part trop importante de notre chiffre d’affaires total. Il nous faudra à l’avenir amplifier encore la diversité de note portefeuille de clients.
Comment s’est passé 2020 pour nos concurrents ? En général beaucoup moins bien que pour nous. Certains ont eu des baisses de chiffre d’affaires de 30 % et donc ont enregistré de fortes pertes. Et plusieurs concurrents sont à vendre. Doit-on en acquérir ? Cela aurait-il un impact négatif sur la diversité de notre portefeuille de clients ? C’est notre questionnement du moment.
AXON’ CABLE est aujourd’hui une « multinationale de poche » avec ses 22 filiales dans le monde et ses 2 500 salariés, dont 1 000 en France.
Pour assurer la réindustrialisation automobile de la France, il faut obtenir des deux constructeurs qu’ils changent de doctrine – Point de vue
Par Bernard Jullien, maitre de conférences en économie à l’Université de Bordeaux et conseiller scientifique de la chaire de management des réseaux du Groupe Essca. Avec Yannick Lung, il a publié en 2011 l’ouvrage « Industrie automobile – La croisée des chemins » (La Documentation française).
Les vingt années écoulées ont été, pour l’industrie automobile française ou, plus exactement, pour le site industriel français dans l’automobile, vingt années de déclin. Ce déclin est beaucoup moins en effet celui des constructeurs français en Europe et dans le monde que celui de leur production en France. Il est marqué par une évolution du commerce extérieur automobile français qui était exportateur au début des années 2000, est devenu importateur en 2008 pour ne plus jamais cesser de l’être ensuite. Contrairement à ce qui peut s’observer dans d’autres industries manufacturières plus « globalisées », cette évolution n’a pas correspondu à une montée en puissance d’importations venues de l’autre bout du monde mais à une réorganisation de l’outil industriel des constructeurs en Europe – si l’on donne à ladite Europe la définition extensive que lui donnent les constructeurs français qui y incluent Turquie et Maroc – : profitant de l’élargissement au début des années 2000 et des accords commerciaux conférant à la Turquie et au Maroc des statuts « d’associés » permettant de les traiter comme s’ils appartenaient à l’Union, les constructeurs français ont massivement délocalisé le cœur de leurs fabrications qui concerne les petits véhicules.
Il en est résulté que les véhicules de marques françaises achetés par les Français ont été de plus en plus volontiers importés d’une part et que les exportations depuis la France se sont réduites d’autre part. Les organisations industrielles des constructeurs comme des équipementiers sont, dans l’automobile, des organisations « régionales » parce que les véhicules voyagent difficilement d’un bout à l’autre de la planète : lorsque les constructeurs délocalisent leurs productions états-uniennes c’est au profit du Mexique ; lorsque Fiat déserte l’Italie c’est au profit de la Pologne ; lorsque PSA et Renault désertent le site France, c’est au profit de l’Espagne, de la République Tchèque, de la Slovaquie, de la Slovénie, de la Turquie et du Maroc. Ainsi le problème de la désindustrialisation automobile de la France est beaucoup moins un problème de trajectoire de la France dans la globalisation que de capacité de celle-ci à s’inscrire dans la dynamique d’intégration européenne et/ou de veiller à la préservation de ses intérêts dans ce processus.
De ce point de vue, la comparaison avec l’Allemagne est intéressante car ce que l’on observe pour Renault ou PSA est peu perceptible pour Volkswagen. L’intégration européenne a été gérée de facto par les constructeurs français comme une opportunité de mettre en concurrence leurs sites domestiques avec leurs autres usines européennes. Elle a été gérée par Volkswagen comme une opportunité d’expansion en Europe qui est passée principalement par des acquisitions qui ont permis de compléter le portefeuille de marques et d’étoffer l’outil industriel : l’acquisition de SEAT en 1986 a initié ce mode de gestion du dossier ; celle de SKODA l’a dupliqué en 1992. De la même manière, ce que les Français font dans les années 2000 lors de l’élargissement est dans la droite ligne de ce qu’avait été leur gestion de l’intégration des pays ibériques à l’Union dans les années 70 et 80 : pour régler la « question sociale » et leurs problèmes de compétitivité, ils mettent en concurrence leurs sites français et organisent l’expansion de leurs productions européennes hors de France ; plus qu’à répondre à des demandes locales en croissance, leurs nouvelles usines ont cette vocation.
Dans le cas de l’Espagne, le bilan est plutôt positif car l’expansion du marché et les parts de marché qu’acquièrent les marques françaises rendent le « deal » presque équilibré du point de vue du commerce extérieur. La contrepartie sociale et industrielle n’est toutefois pas négligeable : les salariés et les élus locaux voient s’affaiblir leur pouvoir de négociation face au management des constructeurs qui peut, à chaque lancement de nouveau modèle, exhiber ses choix alternatifs et faire baisser les enchères ; le management dispose pour gagner en compétitivité de cette solution de facilité qu’est la mise en concurrence des sites et cela l’incite moins que d’autres à investir dans les équipements et la formation pour préserver la compétitivité de ses sites historiques « à hauts salaires ». Lors de l’intégration des PECO, cette différence deviendra plus problématique encore car si Renault réalise avec Dacia un mouvement comparable à ce que Volkswagen a pu faire avec Skoda, les PECO n’offrent pas à la construction automobile européenne comme l’Espagne et le Portugal l’avaient fait une opportunité de croissance. Si tel est le cas c’est parce que le principe de libre circulation s’applique aussi aux véhicules d’occasion et qu’il en résultera que l’équipement en véhicules des ménages est-européens sera assuré sans qu’ils n’achètent de véhicules neufs. La conséquence sera que les nouveaux sites des PECO seront des sites de pure délocalisation : à l’expansion de leur production correspondra assez exactement la baisse des productions italiennes, françaises ou belges. Dans l’automobile, l’Europe échouera à faire émerger ses émergents et organisera son espace comme un espace de pure mise en concurrence.
Cette dynamique mortifère est celle dont le site France a pâti depuis plus de 20 ans dans l’automobile. Elle a concerné d’abord les plus petits et les moins chers des véhicules qui correspondent à ce que l’on appelle le segment A, celui des Twingo, C1, 108 (Saxo et 106 autrefois). Petit à petit le phénomène s’étend au segment du dessus, le B qui est le segment roi en France comme en Europe et celui pour lequel les marques françaises ont la plus grande légitimité. Ainsi, avec une très grande constance, les deux constructeurs ont défendu et mis en œuvre une même doctrine : les segments A et B, quels que soient les modèles, doivent quitter la France.
À l’appui de cette doctrine, on trouve un argumentaire qui défend que le segment A est à la fois le plus concurrentiel -et donc porteur des plus faibles marges- et beaucoup plus sensible que d’autres aux coûts de main-d’œuvre et aux coûts des composants rendant la délocalisation incontournable. Des études confidentielles avaient été produites pour la DGE par les constructeurs lors de la crise de 2009 et chiffraient le différentiel de PRF (prix de revient de fabrication) dans une fourchette de 700 à 1200 euros qui correspondait à un montant supérieur à la marge espéré sur ces véhicules et justifiait donc la désertion. Le fait que Toyota persiste à produire sa Yaris à Onnaing, la profitabilité de l’ancien 2008 assemblé à Mulhouse, les performances des sites espagnols sur ce segment malgré leurs coûts salariaux très supérieurs à ceux slovaques ou – a fortiori – marocains conduisent à interroger ces logiques des fichiers Excel. Les performances dégradées des sites français lorsque l’on les compare pour ces segments à leurs homologues espagnols, slovaques ou turcs renvoient aussi – et surtout – au fait qu’ils sont en proie à la décroissance et au doute depuis des années. Selon une logique qui veut que lorsque l’on veut que son chien meure on dise qu’il a la rage, ces sites réputés sous-performants font l’objet de peu d’investissements, ils embauchent peu, leurs pyramides des âges sont mauvaises, le tissu fournisseur environnant n’est pas sûr de survivre et n’investit pas non plus et, de loin en loin, la sous-performance supposée devient sous-performance réelle. À l’inverse lorsque, comme c’est le cas pour Toyota à Onnaing ou pour Volkswagen à Wolfsburg, il n’est pas question de se passer d’un site alors, malgré les hauts salaires, on s’emploie à le rendre performant : plutôt que de disperser le risque et de faire passer la patate chaude de l’insuffisance de compétitivité d’une usine à l’autre en mettant la pression sur les salariés, les fournisseurs et, éventuellement, les autorités locales, on tente de faire en sorte que le « cluster » se renforce. C’est ce qu’ont perdu les sites français spécialisés dans la production de petits véhicules, victimes de la « doctrine » pré-citée.
CONCLUSION – L’heure de la reconquête industrielle a-t-elle sonné ?
 L’apparition de la pandémie de Covid-19 a remis à l’ordre du jour les différents modes d’intervention des pouvoirs publics en période de crise économique. L’action publique nécessite d’abord de frapper fort et vite en instaurant des mesures d’urgence destinées à sauver l’économie. Elle consiste ensuite à élaborer un plan de relance pour accompagner et accélérer la reprise. Par son caractère exceptionnel, la crise du Covid-19 a montré de façon particulièrement éclairante l’intérêt de combiner ces deux types de mesures : les mesures de sauvegarde dans une économie à l’arrêt (stop) puis le plan de relance (go). À cet égard, les pouvoirs publics semblent avoir tiré les leçons de la crise précédente. Tandis que les gouvernements européens avaient privilégié, au sortir de la crise de 2008, des mesures d’austérité pour limiter leur dette, ils consacrent aujourd’hui des efforts budgétaires colossaux pour faire face à la crise du Covid-19, au prix d’un endettement massif auprès de la BCE. L’Histoire récente nous a en effet appris que la mise en œuvre prématurée de politiques d’austérité pouvait produire les effets inverses de ceux qui étaient escomptés.
L’apparition de la pandémie de Covid-19 a remis à l’ordre du jour les différents modes d’intervention des pouvoirs publics en période de crise économique. L’action publique nécessite d’abord de frapper fort et vite en instaurant des mesures d’urgence destinées à sauver l’économie. Elle consiste ensuite à élaborer un plan de relance pour accompagner et accélérer la reprise. Par son caractère exceptionnel, la crise du Covid-19 a montré de façon particulièrement éclairante l’intérêt de combiner ces deux types de mesures : les mesures de sauvegarde dans une économie à l’arrêt (stop) puis le plan de relance (go). À cet égard, les pouvoirs publics semblent avoir tiré les leçons de la crise précédente. Tandis que les gouvernements européens avaient privilégié, au sortir de la crise de 2008, des mesures d’austérité pour limiter leur dette, ils consacrent aujourd’hui des efforts budgétaires colossaux pour faire face à la crise du Covid-19, au prix d’un endettement massif auprès de la BCE. L’Histoire récente nous a en effet appris que la mise en œuvre prématurée de politiques d’austérité pouvait produire les effets inverses de ceux qui étaient escomptés.
Le plan de relance français est en partie fondé sur une stratégie de long terme, comme en témoignent les propos du président Emmanuel Macron : « La véritable ambition de France Relance n’est pas tant dans l’importance des moyens mobilisés pour soutenir l’activité à court terme que dans la philosophie de transformation qui sous-tend le plan. » Cette dualité d’objectifs, à la fois conjoncturels et structurels, a fait l’objet de critiques de la part d’économistes, lesquels considèrent qu’un plan de relance doit prioritairement agir sur le court terme. Sans trancher ce débat, le poids représenté par les mesures de long terme traduit, en premier lieu, une inflexion de la politique industrielle française.
La crise sanitaire a eu une résonnance particulière en France : elle a été perçue comme un révélateur de ses faiblesses, pointant sa dépendance aux approvisionnements étrangers et son incapacité à fournir à la population du matériel médical et de protection. Ainsi, l’industrie a été remise au cœur du débat, avec l’idée que la réindustrialisation est non seulement un élément clé de notre compétitivité mais aussi de notre souveraineté, affaiblie par cinquante années de désindustrialisation. L’affirmation d’une préoccupation croissante pour l’activité de production et pour la souveraineté économique renouvelle l’intérêt pour des mesures publiques en faveur de l’industrie. Dans le plan de relance français, le secteur industriel se taille la part du lion : sur les 100 milliards d’euros de France Relance, plus d’un tiers sont destinés à l’industrie. Dans la boîte à outils des mesures dédiées à l’industrie figurent en bonne place les politiques en faveur de l’innovation, les mesures de soutien au financement des entreprises, et les dispositifs d’incitation à l’achat, comme les primes à la casse. Mais cette crise a fait émerger un autre type de mesures avec un objectif bien défini : (re)localiser l’industrie sur le territoire français.
S’il est trop tôt pour apprécier les effets de cette politique, on peut d’ores et déjà établir que la relocalisation de sites de production ne se décrète pas. De nombreuses études ont montré que le retour d’entreprises industrielles ayant autrefois délocalisé était un phénomène rare et peu générateur d’emplois directs. Le gouvernement a donc tout intérêt à se focaliser sur des politiques industrielles plus horizontales visant à créer un environnement favorable au développement ou au maintien de nouvelles activités. À cet égard, la baisse des impôts de production, le soutien à l’innovation et la formation aux métiers industriels constituent des leviers fondamentaux. Pour autant, la France ne doit pas faire l’économie d’une politique volontariste de reconquête de sa souveraineté industrielle. Une stratégie ayant pour objectif la relocalisation des activités stratégiques et de certains maillons de chaînes de valeur jugés critiques peut constituer une réponse pertinente aux constats dressés en 2020. Notre capacité à disposer de certains produits clés permet en effet de faire face plus efficacement aux périodes de crise, et ce indépendamment de contraintes extérieures. Toutefois, la relocalisation de produits à l’échelle nationale ou européenne est hors de portée lorsque le retard technologique accumulé face aux concurrents est trop important. C’est pourquoi la stratégie de résilience n’a de sens autrement qu’en combinant les relocalisations à d’autres politiques, notamment la recherche d’une plus grande diversification des fournisseurs et des sources et la constitution de stocks stratégiques. En outre, la reconquête industrielle passera nécessairement par une politique volontariste, à l’échelle européenne, visant à répondre aux défis des transitions écologique et numérique.
Bibliographie
Acemoglu D., Restrepo P. (2018), « The race between man and machine: Implications of technology for growth, factor shares, and employment » , American Economic Review, 108 (6) : 1488-1542.
Adda J., Cooper R.W. (2000) , « Balladurette and jupette: a discrete analysis of scrapping subsidies » , Cepremap working paper, n° 9711.
Bach H.-U., Spitznagel E. (2009), « Kurzarbeit: Betriebe zahlen mit – und haben was davon » , IAB-Kurzbericht 17/2009, 1-8.
Balleer A., Gehrke B., Lechthaler W., Merkl C. (2016), « Does short-time work save jobs? A business cycle analysis », European Economic Review , vol. 84, 99-122.
Banerjee R.N., Hofmann B. (2020), « Corporate zombies: Anatomy and life cycle », BIS Working paper, n° 882, septembre.
Bellit S., Granier C., Mini C. (2020), « De la souveraineté industrielle aux relocalisations : de quoi parle-t-on ? », Document de travail, La Fabrique de l’industrie.
Bidet-Mayer T., Frocrain P. (2015), « L’industrie américaine : simple rebond ou renaissance ? » , Paris, Presses des Mines.
Blanchard O., Leigh D. (2013), « Growth forecast errors and fiscal multipliers », American Economic Review, vol. 103, n° 3, 117-120.
Bonneau C., Nakaa M. (2020), « Vulnérabilité des approvisionnements français et européens », Trésor- Éco, n° 274, décembre.
Bosch G. (2010), « Stunden und nicht Beschäftigte entlassen – Kurzarbeit verlängern » , IAQ-Standpunkte 2/2010.
Bozio A., Cottet S., Py L. (2017), « Impact de la réforme de 2008 du CIR sur la R&D et l’innovation », rapport pour France Stratégie.
Cahuc P., Kramarz F., Nevoux S. (2018), « When short-time work works », IZA Discussion Papers, n° 11673, IZA Institute of Labor Economics.
Cavat H. (2020), « Les accords de performance collective. Enseignements d’une étude empirique », Revue de droit du travail, n° 3, 165-177.
Cette G., Nevoux S., Py L. (2020), « The impact of ICTs and digitalization on productivity and labor share: evidence from French firms » , Banque de France, Working Paper Series n° 785, décembre.
Coe-Rexecode (2018), « Poids et structure des prélèvements obligatoires sur les entreprises industrielles en France et en Allemagne », Document de travail n° 68, mai.
Comité de surveillance des investissements d’avenir (2019), « Le programme d’investissements d’avenir, un outil à préserver, une ambition à refonder », novembre.
Conseil d’analyse économique (2012), « Les mutations du marché du travail allemand », Rapport n°102, novembre.
Dahmani S., Gazaniol A., Rioust de Largentaye T. (2014), « Quel avenir pour l’industrie auto- mobile française ? », Trésor- Éco, n° 138, octobre.
David C., Faquet R., Rachiq C. (2020), « Contribution de la destruction créatrice aux gains de la productivité en France depuis 20 ans », Trésor-Éco , n° 273, décembre.
Demmou, L. (2010), « La désindustrialisation en France », Trésor, Documents de travail de la DG Trésor, juin.
De Warren G. (2020), « Les stratégies internationales des entreprises françaises », Trésor-Éco , n° 267, septembre.
DGCIS/DATAR/PIPAME (2013), « Relocalisations d’activités industrielles en France », décembre.
Dhont-Peltrault E., Lallement R. (2011), « “Investissement d’avenir” et politique industrielle en Europe : quel ciblage et quelle sélection des projets innovants ? », La note d’analyse Économie-Finances, n° 236, Centre d’analyse stratégique, septembre.
Duc C., Souquet C. (2020), « L’impact de la crise sanitaire sur l’organisation et l’activité des sociétés », Insee Première , n° 1830, décembre.
Faquet R., Malardé V. (2020), « Numérisation des entreprises françaises », Trésor- Éco , n° 271, novembre.
Firquet S. (2020), « Le numérique stimule l’innovation dans le secteur tertiaire », Insee Première , n° 1811, août.
France Stratégie (2019), « Les procédures de défaillances à l’épreuve des entreprises zombies », octobre.
France Stratégie (2020), « Évaluation des ordonnances du 22 septembre 2017 relatives au dialogue social et aux relations de travail », Rapport intermédiaire du comité d’ évaluation, juillet.
France Stratégie (2020), « Les politiques industrielles en France. Évolutions et comparaisons internationales », Rapport, novembre.
Fréhaut P. (2012) « Chômage partiel, activité partielle, Kurzarbeit : quelles différences entre les dispositifs publics français et allemand ? », Trésor-Éco , n° 107, novembre.
Gallois L. (2012), « Pacte pour la compétitivité de l ’industrie française », Rapport au Premier ministre, novembre.
Gerschel E., Martinez A., Méjean I. (2020), « Propagation des chocs dans les chaînes de valeur internationales : le cas du coronavirus », Institut des politiques publiques, n° 53.
Grigolon L., Leheyda N., Verboven F. (2016), « Scrapping subsidies during the financial crisis. Evidence from Europe » , International Journal of Industrial Organization , Elsevier, vol. 44 (C), 41-59.
Guillou S., Lallement R., Mini C. (2018), « L’investissement des entreprises françaises est-il efficace ? », Paris, Presses des Mines.
Guillou S., Mini C. (2019), « À la recherche de l’immatériel : comprendre l’investissement de l’industrie française », Paris, Presses des Mines.
Hadjibeyli B., Roulleau G., Bauer A. (2021), « L’impact de la pandémie de Covid-19 sur les entreprises françaises », Trésor-Éco , n° 282, avril.
Hijzen, A., Venn D. (2011), « The Role of Short-Time Work Schemes during the 2008-09 Recession », Documents de travail de l ’OCDE sur les questions sociales, l’emploi et les migrations, n° 115, Éditions OCDE, Paris.
Insee (2012), « La fièvre tombe, le rétablissement sera lent », Note de conjoncture, mars.
Insee (2019), « Le “made in France” : 81 % de la consommation totale des ménages, mais 36 % seulement de celle des biens manufacturés », Insee Première , n° 1756, juin.
Jaravel X., Méjean I. (2021), « Quelle stratégie de résilience dans la mondialisation ? », Les notes du conseil d’analyse économique, n° 64, avril.
Jean S., Vicard V. (2020), « Relocaliser, réindustrialiser : dans quels buts ? », La Lettre du CEPII, n° 410, septembre.
Juppé A., Rocard M. (2009), « Investir pour l’avenir : priorités stratégiques d’investissement et emprunt national », remis au président de la République Nicolas Sarkozy.
Kramarz F., Senftleben C., Spitz-Oener A., Zwiener H. (2012), « Les mutations du marché du travail allemand », CAE, Rapport n° 102.
Martin P., Pisani-Ferry J., Ragot X. (2020), « Une stratégie économique face à la crise », Les notes du conseil d’analyse économique, n° 57, juillet.
Martin P. et Trannoy A. (2020), « Les impôts sur (ou contre) la production », Les notes du conseil d’analyse économique, n° 53, juin.
Mouhoud E.M. (2017), Mondialisation et délocalisation des entreprises , La Découverte.
Müller A., Heimeshoff U. (2013), « Evaluating the causal effects of cash-for-clunkers programs in selected countries: success or failure? », Conference Paper.
OCDE (2010), « Perspectives de l’emploi de l’OCDE 2010. Sortir de la crise de l ’emploi », Éditions OCDE, Paris.
OCDE (2017), « Evaluating publicly supported credit guarantee programmes for SMEs » , www.oecd.org/finance/Evaluating-Publicly-Supported-Credit-Guarantee-Programmes-for-SMEs.pdf
OFCE (2020), « Évaluation de l’impact économique de la pandémie de Covid-19 et des mesures de confinement sur l’ économie mondiale en avril 2020 », Policy Brief , n° 69, juin.
Oseo (2012), « Bilan 2011, Perspectives 2012 », Dossier de presse.
PwC Strategy, CNA (2020), « Relocalisation des achats stratégiques. Restitution du partenariat PwC-CNA », juillet.
Sautard R., Tazi A., Thubin C. (2014), « Quel positionnement “hors-prix” de la France parmi les économies avancées ? », Trésor-Éco, n° 122, janvier .
Sénat (2020), « Les moyens des politiques publiques et les dispositions spéciales (seconde partie de la loi de finances) », Rapport général du Sénat, n° 138, tome 3, annexe 17, novembre.
Tall A. (2020), « Dialogue social et performance : une étude sur données d’entreprises françaises », Dares, Document d’études, n° 240, septembre.
Zapf I. (2011), « Les comptes épargne-temps, instruments de flexibilité », Regards sur l’ économie allemande , n° 101, 25-31.
Les membres du conseil d’orientation de La Fabrique
La Fabrique s’est entourée d’un conseil d’orientation, garant de la qualité de ses productions et de l’équilibre des points de vue exprimés. Les membres du conseil y participent à titre personnel et n’engagent pas les entreprises ou institutions auxquelles ils appartiennent. Leur participation n’im- plique pas adhésion à l’ensemble des messages, résultats ou conclusions portés par La Fabrique de l’industrie.
À la date du 1 er juin 2021, il est composé de :
Paul ALLIBERT, directeur général de l’Institut de l’entreprise,
Jean ARNOULD, ancien président de l’UIMM Moselle, ancien PDG de la société Thyssenkrupp Presta France,
Gabriel ARTERO, président de la Fédération de la métallurgie CFE-CGC,
Vincent AUSSILLOUX, chef du département économie-finances de France Stratégie,
Laurent BATAILLE, PDG de Poclain Hydraulics Industrie,
Michel BERRY, fondateur et directeur de l’école de Paris du management,
Laurent BIGORGNE, directeur de l’Institut Montaigne,
Serge BRU, représentant de la CFTC au bureau du Conseil national de l’industrie,
Pierre-André de CHALENDAR, président du groupe Saint-Gobain, co-président de La Fabrique de l’industrie,
Benjamin CORIAT, Professeur Université Sorbonne Paris Nord (Paris 13),
Joël DECAILLON, vice-président de Bridge (Bâtir le renouveau industriel sur la démocratie et le génie écologique),
Stéphane DISTINGUIN, fondateur et président de Fabernovel, président du pôle de compétitivité Cap Digital,
Elizabeth DUCOTTET, PDG de Thuasne,
Xavier DUPORTET, cofondateur et CEO de Eligo Biosciences,
Pierre DUQUESNE, ambassadeur, chargé de la coordination du soutien international au Liban,
Philippe ESCANDE, éditorialiste économique au quotidien Le Monde,
Olivier FAVEREAU, professeur émérite en sciences économiques à l’université Paris X,
Denis FERRAND, directeur général de Rexecode,
Jean-Pierre FINE, Secrétaire général de l’UIMM
Jean-Luc GAFFARD, directeur du département de recherche sur l’innovation et la concurrence à l’OFCE,
Louis GALLOIS, ancien président du conseil de surveillance de PSA Groupe, co-président de La Fabrique de l’industrie,
Pascal GATEAUD, ancien rédacteur en chef de l’Usine Nouvelle
Pierre-Noël GIRAUD, professeur d’économie à l’université de Paris-Dauphine et à Mines ParisTech,
Frédéric GONAND, professeur associé de sciences économiques à l’université Paris-Dauphine,
Éric KELLER, secrétaire fédéral de la fédération FO Métaux,
Élisabeth KLEIN, dirigeante de CFT Industrie,
Dorothée KOHLER, directeur général de KOHLER C&C,
Gilles KOLÉDA, directeur scientifique d’Érasme-Seuréco,
Marie-José KOTLICKI, membre du Conseil économique, social et environnemental, ancienne secrétaire générale chez UGICT-CGT,
Éric LABAYE, président de l’École polytechnique,
Jean-Yves LAMBERT, président de Elbi France,
Emmanuel LECHYPRE, éditorialiste à BFM TV et BFM Business,
Fanny LÉTIER, co-fondatrice de GENEO Capital Entrepreneur,
Olivier LLUANSI, associé à Strategy& PWC,
Antonio MOLINA, président du groupe Mäder,
Philippe MUTRICY, directeur de l’évaluation, des études et de la prospective de Bpifrance,
Christian PEUGEOT, président de l’Organisation Internationale des Constructeurs Automobiles,
Florence POIVEY, présidente de la fondation du CNAM,
Philippe PORTIER, secrétaire national de la CFDT,
Grégoire POSTEL-VINAY, directeur de la stratégie, Direction générale des entreprises, ministère de l’Économie,
Didier POURQUERY, fondateur de la version française de The Conversation et ancien directeur de la rédaction,
Joseph PUZO, président d’AXON’CABLE SAS,
Xavier RAGOT, président de l’OFCE,
Frédéric SAINT-GEOURS, vice-président du conseil d’administration de la SNCF,
Ulrike STEINHORST, présidente de Nuria Conseil,
Pierre VELTZ, ancien PDG de l’établissement public de Paris-saclay,
Dominique VERNAY, vice-président de l’Académie des technologies,
Jean-Marc VITTORI, éditorialiste au quotidien Les Echos.
Dernières parutions
dans la collection Les Notes de La Fabrique
Accélérateurs de croissance pour PME : build-up et alliances ,
Paris, Presse des Mines, 2018.
Organisation et compétences dans l’usine du futur. Vers un design du travail ? , Paris, Presse des Mines, 2019.
La France est-elle exposée au risque protectionniste ? , Paris, Presse des Mines, 2019.
L’étonnante disparité des territoires industriels. Comprendre la performance et le déclin, Paris, Presse des Mines, 2019.
À la recherche de l’immatériel : comprendre l’investissement de l’industrie française , Paris, Presse des Mines, 2019.
Au-delà de l’entreprise libérée. Enquête sur l’autonomie et ses contraintes , Paris, Presse des Mines, 2020.
Quand le carbone coûtera cher , Paris, Presse des Mines, 2020.
Ces territoires qui cherchent à se réindustrialiser, Paris, Presse des Mines, 2021.
Le travail à distance dessine-t-il le futur du travail ? , Paris, Presse des Mines, 2021.
Sonia Bellit, À la recherche de la résilience industrielle – Les pouvoirs publics face à la crise, Paris, Presses des Mines, 2021.
ISBN : 978-2-35671-683-5
ISSN : 2495-1706
© Presses des Mines – Transvalor, 2021
60, boulevard Saint-Michel – 75272 Paris Cedex 06 – France presses@mines-paristech.fr
www.pressesdesmines.com
© La Fabrique de l’industrie
81, boulevard Saint-Michel – 75005 Paris – France info@la-fabrique.fr
www.la-fabrique.fr

