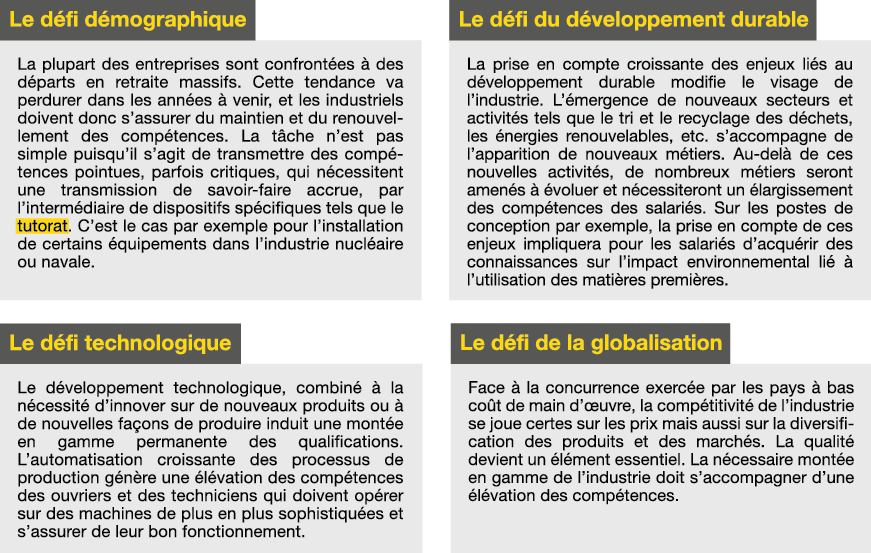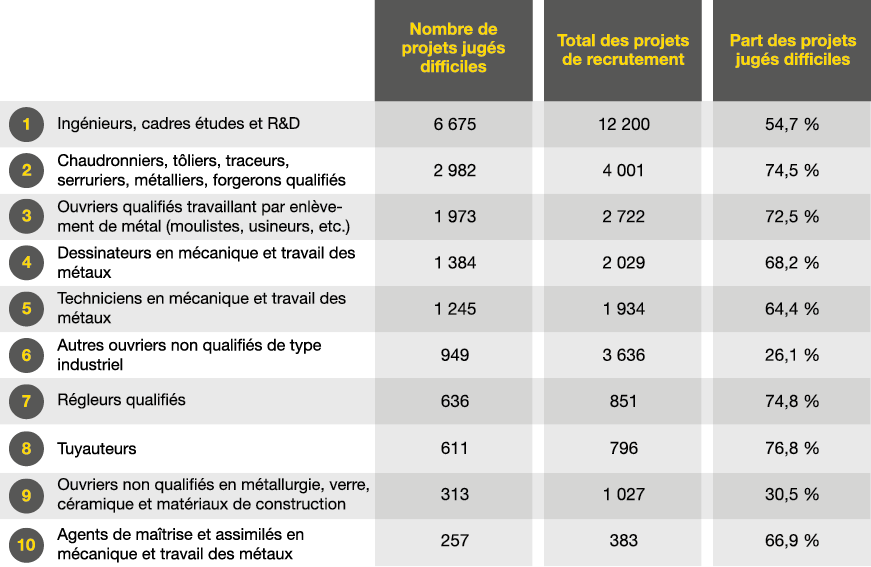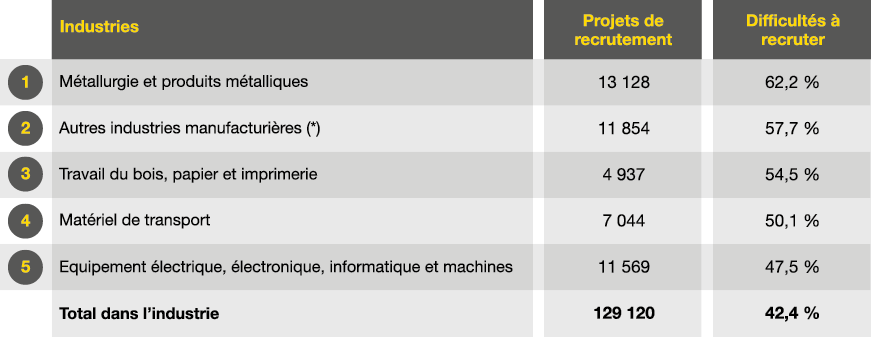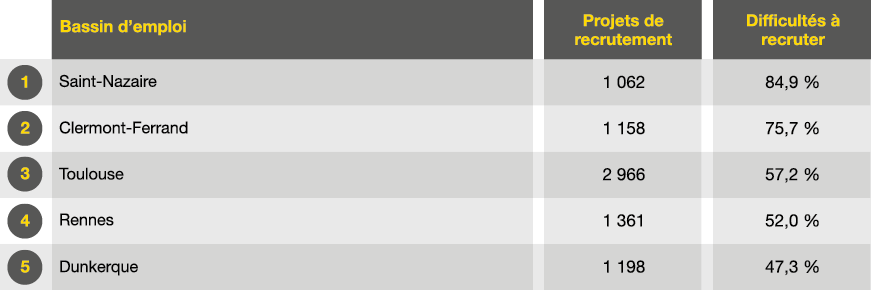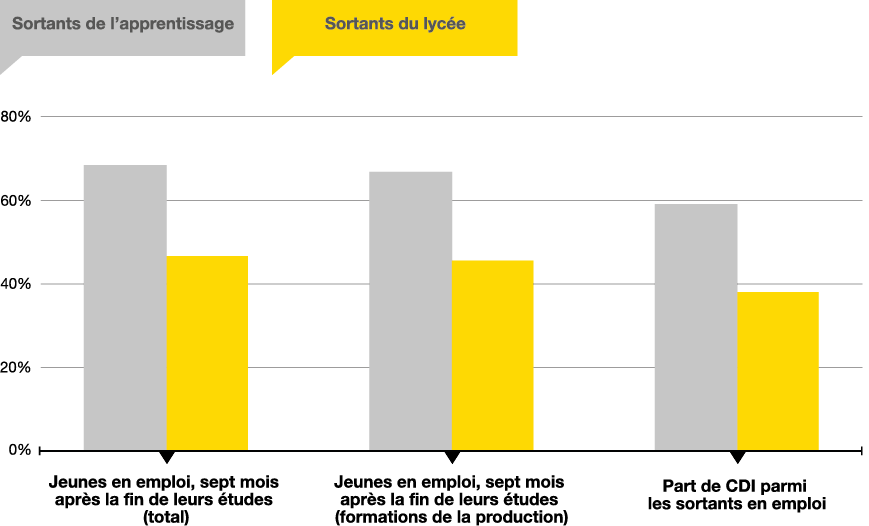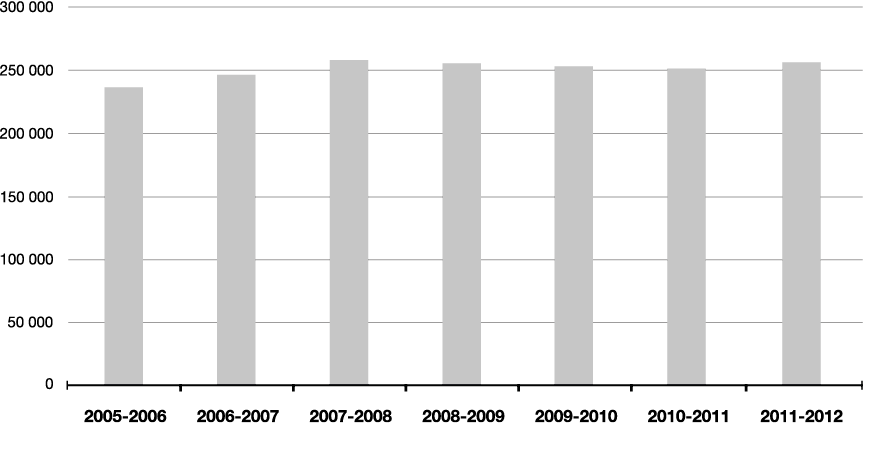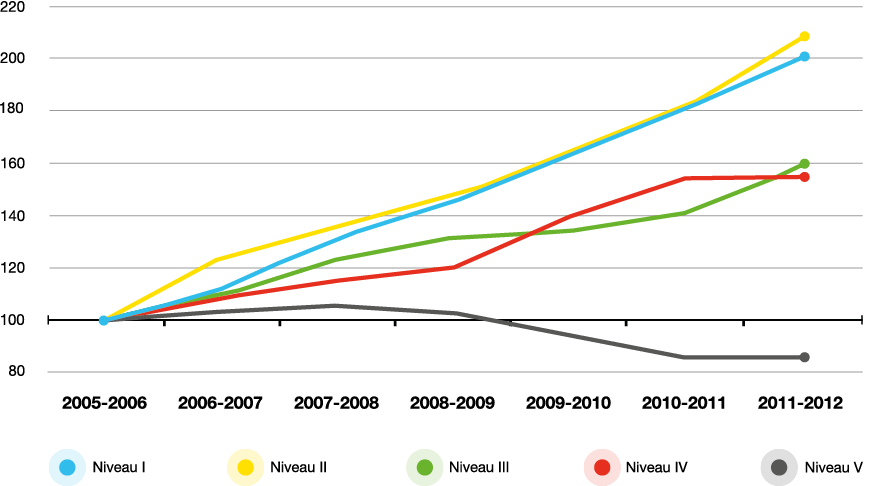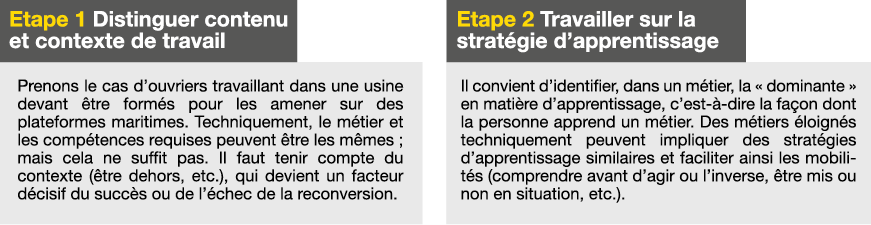Formation professionnelle et industrie : le regard des acteurs de terrain

Robert Doisneau, L’addition (1941) / © Robert Doisneau/Rapho
REMERCIEMENTS
Cette note de La Fabrique de l’industrie constitue la synthèse d’un large travail de consultation auprès des parties prenantes du système de formation. Nous remercions ici l’ensemble des personnes (acteurs de la formation, salariés, jeunes en formation, responsables d’entreprises industrielles, etc.) ayant participé à enrichir ce document par leurs témoignages.
Nous tenons également à remercier les différents experts auditionnés, qui nous ont permis d’approfondir nos réflexions, tout particulièrement André Gauron (Lasaire), Dominique Gillier (CFDT), Yves Lichtenberger (Université Paris-Est), Francis Mer (Safran) et Paul Santelmann (AFPA), pour le temps précieux qu’ils nous ont consacré.
Enfin, nous remercions chaleureusement les responsables de l’Aforp et du CFI pour leur accueil et pour leur disponibilité.
PRÉFACE
En France, de nombreuses entreprises se plaignent de ne pas trouver de candidats ayant les compétences qu’elles recherchent, alors qu’un nombre dramatiquement élevé de jeunes sortent du système éducatif français sans diplôme ni qualification. Les rapports se multiplient sur les dysfonctionnements de notre système de formation professionnelle et appellent à clarifier sa gouvernance et son financement.
La tâche est immense. Les filières professionnelles offertes par les lycées sont souvent considérées par les parents et les enseignants comme un second choix réservé aux élèves en difficulté. De leur côté, les contrats d’apprentissage ou de professionnalisation connaissent un recul inquiétant. Enfin, l’accès à la formation continue est de plus en plus difficile pour les moins qualifiés.
Or la formation, initiale et continue, est une des clés de la nécessaire montée en gamme et en efficacité de l’industrie française. De nombreux salariés doivent s’adapter à des modes de production requérant autonomie et maîtrise des technologies avancées.
Plutôt que de compiler les nombreuses études existantes, La Fabrique a choisi de solliciter les témoignages des acteurs du système : ceux qui organisent, dispensent et suivent les formations, ceux qui ont besoin de collaborateurs bien formés. Ils parlent de la coordination difficile entre des institutions qui se connaissent et se comprennent mal, de l’image négative de l’industrie et de ses métiers, du manque de formation tout au long de la vie pour les salariés.
De brefs aperçus sur la Suisse et la Norvège montrent combien l’on peut progresser en associant l’ensemble des parties prenantes au pilotage du système de formation. La loi du 5 mars 2014, inspirée de l’accord national interprofessionnel de 2013, a réaffirmé le rôle central des Régions dans la gouvernance du système de formation. Elles devront coordonner les acteurs à l’échelle territoriale et remettre les enjeux de formation au cœur des problématiques de développement économique.
Comme la recherche et l’innovation, la formation des salariés ne doit plus être perçue comme une charge mais comme un investissement. Pour les entreprises, les territoires et les personnes, cela participe à la construction d’une capacité collective au cœur de leur compétitivité. Cet investissement est essentiel à la croissance des entreprises, à l’épanouissement personnel des individus et à la cohésion de la société.
Louis Gallois
RÉSUMÉ EXECUTIF
La formation professionnelle constitue un enjeu primordial pour la compétitivité d’une économie. De nombreux rapports et études se sont attachés à mettre en évidence les dysfonctionnements du système de formation français, plus encore dans le contexte de réforme engagée depuis 2013 et adoptée le 5 mars 2014.
En complément de ces travaux et afin de participer de manière originale et constructive à ce débat, La Fabrique de l’industrie a décidé de donner la parole aux acteurs de terrain. Une consultation ouverte a été lancée sur le site internet de La Fabrique entre les mois de septembre et de décembre 2013. Celle-ci a permis de faire remonter une cinquantaine de contributions émanant de l’ensemble des parties prenantes : jeunes, salariés, industriels, acteurs de la formation, experts… Ces témoignages ont été complétés par de nombreuses auditions. Ils ont mis en lumière des dispositifs originaux, destinés à pallier les faiblesses du système.
Avec cette méthode, on peut porter un regard nouveau sur le système de formation. Au-delà des blocages déjà bien identifiés, on constate une volonté forte de la plupart des acteurs d’œuvrer en faveur d’un rapprochement de « mondes » qui s’opposent ou simplement s’ignorent.
La formation professionnelle : un levier de compétitivité
La formation professionnelle constitue un enjeu central pour la compétitivité des entreprises industrielles. La globalisation des échanges, la diffusion de nouvelles technologies ou encore la prise en compte des questions environnementales entraînent une obsolescence des compétences de plus en plus rapide et exigent une adaptation de l’organisation du travail. Cela requiert une polyvalence plus importante de la part de l’ensemble du collectif de travail : la compétitivité industrielle repose aujourd’hui sur tous les salariés, quel que soit leur niveau de qualification.
Dans ce contexte, le système éducatif doit apporter aux jeunes une formation initiale solide, leur permettant de s’adapter tout au long de leur vie. Le rôle de la formation continue est également primordial pour permettre aux salariés en place de maintenir et développer leurs compétences.
Le système de formation actuel ne parvient toutefois pas à répondre à ces exigences. Selon la Banque de France (2011), le manque de personnel qualifié constitue le premier frein au développement des entreprises. Le nombre de jeunes en décrochage scolaire se maintient, année après année, à des niveaux très élevés et alimente un chômage de masse, tandis que les entreprises peinent à trouver des candidats dans de nombreux métiers en tension, Par ailleurs, l’accès à la formation continue reste largement inégalitaire : selon le Céreq, sur la période 2008-2010, seuls 36 % des ouvriers ont bénéficié d’une formation continue, contre 60 % des cadres et professions intermédiaires.
L’exemple de l’Allemagne, développé par Jean-Daniel Weisz dans la note, montre comment nos voisins ont lié les enjeux de compétitivité et de formation, intégrée par exemple au programme sur l’usine du futur Industrie 4.0.
Vous retrouverez également dans cette partie :
- la contribution de Sabine Bessière, chef du département « Métiers et qualifications » de la DARES, sur l’évolution des métiers industriels pendant les trente dernières années,
- l’interview de Marie Carrère-Gée, présidente du Conseil d’orientation pour l’emploi, qui propose un éclairage sur les méthodes de comptabilisation des difficultés de recrutement,
- l’interview de Françoise Diard, responsable de l’Observatoire de la métallurgie, qui présente les travaux de cet observatoire paritaire,
- le regard de Jean Wemaëre, président de la Fédération de la formation professionnelle, sur le thème « La formation professionnelle, un enjeu majeur de compétitivité »,
- une fiche récapitulative sur les difficultés de recrutement dans l’industrie.
Rapprocher le monde de l’école de celui de l’entreprise
Les difficultés de recrutement auxquelles sont confrontées les entreprises industrielles s’expliquent avant tout par le déficit d’attractivité dont souffre le secteur, auprès des jeunes, de leurs parents, des enseignants ou des personnels de l’orientation. La conséquence directe est une désaffection inquiétante pour les formations industrielles : selon les chiffres de l’Éducation nationale, le nombre d’élèves en lycées professionnels inscrits dans une spécialité menant à un métier de l’industrie a baissé de 5,2 % entre 2005 et 2012.
Les métiers industriels sont supposés très prescrits, laissant peu de place à l’initiative. Leurs dénominations traditionnelles – « chaudronnier », « tourneur-fraiseur », etc. – renvoient à une image désuète de l’industrie. Cela conduit la majorité des jeunes à se détourner des formations menant à l’industrie et à privilégier l’enseignement général et théorique. Cette tendance est renforcée par le fait que les formations professionnelles restent très cloisonnées et laissent peu de champ à une éventuelle réorientation.
Ces constats invitent au rapprochement entre les mondes de l’école et de l’entreprise. De nombreux dispositifs sont mis en place par les différents acteurs de la formation et du monde économique pour permettre aux jeunes d’effectuer des choix plus éclairés. Le décloisonnement de la voie professionnelle apparaît également comme un objectif prioritaire.
Vous retrouverez également dans cette partie :
- le regard d’Aziz Jellab, chercheur à l’université Lille III, sur le profil des enseignants en lycée professionnel,
- un encadré thématique intitulé « Qu’est-ce qu’une bonne visite d’usine ? », la présentation de cinq dispositifs visant à rapprocher l’école et l’entreprise.
Œuvrer au développement de l’apprentissage
L’apprentissage constitue un autre moyen de rapprocher école et entreprises. Il est régulièrement affiché comme une priorité gouvernementale : dès 1993, le gouvernement d’Édouard Balladur avait fixé pour objectif le doublement des effectifs d’apprentis dans les cinq ans. Le seuil des 500 000, visé à l’époque, n’est encore pas atteint aujourd’hui. Les signatures de contrats d’apprentissage sont même en recul de 8,1 % en 2013. De nombreux freins, financiers et non financiers, obèrent le développement de ce dispositif.
S’ils plébiscitent ce mode de formation, de nombreux industriels considèrent que l’embauche d’un apprenti représente un investissement pour une entreprise. Par ailleurs, l’apprentissage demeure socialement peu valorisé en France, contrairement à des pays comme la Suisse ou l’Allemagne. Pour les jeunes et leurs familles, il reste associé aux bas niveaux de qualification, auxquels il a longtemps été réservé, et à de faibles opportunités d’évolution, bien qu’il permette aujourd’hui de poursuivre ses études jusque dans l’enseignement supérieur.
L’apprentissage permet une bonne insertion professionnelle. En février 2012, 68,8 % des apprentis étaient en emploi sept mois après la fin de leurs études, contre 47,8 % des élèves de lycée professionnel. Parmi les apprentis en emploi, 58,6 % étaient en CDI, contre 36,9 % chez les lycéens (statistiques du ministère de l’Éducation nationale).
Voie d’insertion professionnelle efficace, l’apprentissage constitue également un moyen de lutte contre le décrochage scolaire. La plupart des centres de formation d’apprentis développent des méthodes pédagogiques alternatives à la voie purement scolaire. Elles visent à mieux articuler enseignements théoriques et pratiques, afin de redonner du sens à la formation. Un travail particulier est également mené pour redonner confiance à des élèves, souvent confrontés à l’échec scolaire au cours de leur cursus. Fréquemment présentés comme concurrents, car tous deux accessibles à partir de la fin du collège, le lycée professionnel et l’apprentissage sont complémentaires car ils visent des objectifs pédagogiques différents.
Vous retrouverez également dans cette partie :
- la présentation de deux centres de formation d’apprentis, l’Aforp et le CFI, complétés par de nombreux témoignages (apprentis, formateurs, responsables de centres, etc.),
- une étude de cas sur le système dual suisse, enrichie de témoignages d’acteurs de terrain.
Investir dans la formation tout au long de la vie
L’accompagnement des mutations industrielles, et l’adaptation des compétences qu’elles exigent, ne peuvent pas uniquement reposer sur la formation initiale. Il faut du temps pour mettre en place un parcours de formation initiale adapté à de nouveaux métiers, puis du temps pour former les premiers bénéficiaires. Or, les entreprises ne peuvent attendre aussi longtemps les compétences recherchées. La formation continue offre plus de souplesse.
Cependant, on donne en France une très grande importance à la formation initiale et au diplôme, au détriment de la formation continue. L’expérience de la Norvège est à ce titre intéressante ; ce pays a réformé son système de formation au cours des années 1990, en considérant que la formation initiale ne constituait que la première étape d’un processus de formation tout au long de la vie. Cette approche globale permet aux salariés de s’adapter aux transformations de l’appareil productif.
Le sous-développement de l’appareil français de formation continue se fait surtout ressentir pour les moins qualifiés. Des initiatives se développent avec difficulté, comme les passerelles-métiers qui permettent à des salariés de secteurs en difficultés de rejoindre des branches plus dynamiques – par exemple entre le secteur de l’automobile et celui de l’aéronautique. La formation des personnes éloignées de l’emploi peut également constituer un investissement intéressant pour les entreprises industrielles qui rencontrent des difficultés de recrutement. Certains dispositifs comme les groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ) permettent de surmonter les réticences de certaines entreprises vis-à-vis de ce public.
La nouvelle loi relative à la formation professionnelle, votée le 5 mars 2014, est présentée par le Gouvernement comme un nouvel « élan » donné au système. Elle acte la mise en place du compte personnel de formation ainsi que la réforme des modalités de financement, avec la suppression de l’obligation fiscale. Elle réaffirme également le rôle des Régions dans la gouvernance de l’appareil de formation et dans la coordination des parties prenantes. Occupant désormais une place centrale dans le pilotage du système, ces dernières devront articuler plus étroitement les politiques de développement économique et de formation, en lien avec les besoins des entreprises de leur territoire.
Vous retrouverez également dans cette partie :
- la contribution d’Abdel Aïssou, directeur général du groupe Randstad France, sur les passerelles-métiers mises en place entre les secteurs de l’automobile et de l’aéronautique,
- la contribution d’Alain Rousset, président de l’Association des régions de France, sur la question de la place des Régions dans la gouvernance du système de formation,
- trois témoignages présentant les dispositifs innovants mis en place en Bourgogne, en Franche-Comté et en Lorraine dans le champ de la formation.
Quelques pistes
Ce document a pour ambition de restituer de manière organisée les propos des acteurs de terrain. Ses auteurs ne prétendent pas avoir la légitimité des nombreux experts qui prescrivent des évolutions souhaitables du système. Certaines pistes se dégagent toutefois des témoignages recueillis.
Sur le déficit d’attractivité de l’industrie
- Alors que l’opposition traditionnelle entre industrie et services est largement obsolète, les métiers liés à la production sont mal connus du public et notamment des prescripteurs (conseillers d’orientation, enseignants…). Des initiatives permettent « d’ouvrir » les usines et de montrer la réalité des métiers mais restent encore trop confidentielles. Leur impact pourrait être renforcé par la mise en réseau des acteurs et la mise en commun des dispositifs. Il semble primordial de rapprocher les mondes de l’école et de l’entreprise, notamment en organisant et en généralisant les stages de professeurs en entreprise.
- L’image d’un travail laissant peu de marges d’initiative et de possibilités de progression est exagérée. Mais les entreprises pourraient davantage faciliter les trajectoires professionnelles évolutives et encourager la formation tout au long de la vie. L’amélioration de la gestion des ressources humaines est une clé de l’attractivité des métiers de l’industrie. L’enrichissement des tâches et une réflexion sur la qualité du travail y contribuent également.
Sur la valorisation des filières industrielles
- Les actions précédentes devraient contribuer à ce que les filières professionnelles soient mieux valorisées, comme dans les pays d’Europe du Nord, pour ne plus être un second choix réservé aux élèves en difficulté. Cette valorisation de l’enseignement professionnel passe aussi par la mise en place de passerelles avec l’enseignement général, afin que les filières professionnelles ne représentent plus des « voies de garage ».
- L’apprentissage permet à des élèves mal à l’aise avec le système scolaire de découvrir des pédagogies différentes. Il faut encourager les entreprises à accueillir des apprentis (y compris en maintenant les incitations financières qui ne semblent pas superflues), mieux faire connaître cette option auprès des jeunes, veiller aux possibilités d’évolution proposées à ceux qui ont fait ce « pari du métier et de l’entreprise ».
Sur la formation tout au long de la vie
- Une meilleure offre de formation continue et une reconnaissance plus grande des acquis de l’expérience contribueraient à rendre attractive l’orientation initiale vers des métiers de production.
- L’accès à la formation continue reste encore largement inégalitaire. L’effort de formation est dirigé vers les salariés les plus qualifiés. Ceci est à relier avec une certaine mentalité, qui consiste à croire que l’industrie serait uniquement portée par les ingénieurs et les cadres. Or aujourd’hui, l’organisation du travail industriel requiert plus d’autonomie et de prise d’initiative à tous les niveaux de qualification. Ce n’est pas seulement une question de justice sociale : si les industriels français veulent rester compétitifs, ils doivent assurer une formation de qualité à leurs salariés, tout au long de leur vie.
- À ce sujet, les politiques de baisses de charges sur les seuls bas salaires peuvent se révéler contre-productives car elles favorisent les emplois les moins qualifiés. Plus qu’un soutien au coût du travail, l’action politique doit viser l’amélioration de la dimension « hors-coût » de la compétitivité par l’élévation des compétences. Les industriels doivent également prendre conscience que l’effort de formation doit bénéficier à tous les salariés.
- La formation est trop souvent considérée comme une dépense pour l’entreprise alors qu’il s’agit au contraire d’un investissement, qui renforce sa capacité à faire face à l’avenir. Comme pour la R&D, les règles comptables devraient permettre de considérer la formation des salariés comme un investissement dans le « capital humain », comme un actif immatériel de l’entreprise. Seul l’amortissement annuel de cet actif immatériel serait comptabilisé comme une charge d’exploitation. L’entreprise qui négligerait l’entretien de son capital de compétences afficherait ainsi un résultat comptable qui traduirait cet appauvrissement.
Sur la coordination et la responsabilité des acteurs
- Les entreprises ont longtemps été déresponsabilisées en matière de formation des individus : versement de l’obligation fiscale pour la formation continue, délégation de la formation initiale à l’Éducation nationale sans grande coordination, etc. Les dernières réformes semblent aller dans le sens d’une plus grande implication des entreprises dans le système de formation mais ces efforts doivent être poursuivis.
- Les Régions ont un rôle essentiel à jouer. Leur place centrale dans le système de formation a été réaffirmée par la réforme du 5 mars 2014. Elles doivent mieux coordonner leurs actions de développement économique et de formation, en lien avec le monde éducatif et les entreprises. En fédérant les acteurs de leur territoire, elles peuvent adapter au mieux l’offre de formation aux besoins des entreprises et aux aspirations des étudiants. Il y a urgence, car sans les compétences nécessaires pour l’alimenter, le développement des entreprises industrielles est compromis.
INTRODUCTION
Malgré le niveau dramatiquement élevé du chômage, les industriels peinent à recruter. Les chiffres qui illustrent ce paradoxe sont connus : entre 300 000 et 500 000 emplois n’ont pas été pourvus en France en 2011, souvent faute de candidats qualifiés. En parallèle, 150 000 jeunes sortent chaque année de notre système éducatif sans diplôme. Ce « faux-départ » n’est pas seulement pénalisant aujourd’hui pour leur insertion sur le marché de l’emploi : ce sera aussi, demain, un frein considérable à leurs perspectives d’évolution. Les entreprises, de leur côté, manquent de compétences et de qualifications indispensables pour faire face aux mutations économiques et technologiques et à la concurrence de nombreuses régions du monde.
Le renforcement de la formation professionnelle, initiale et continue, apparaît à ce titre déterminant pour soutenir la compétitivité industrielle à travers l’amélioration et le renouvellement des qualifications.
Des études et rapports nombreux se sont penchés sur la question des insuffisances et des dysfonctionnements du système de formation professionnelle, plus encore dans le contexte de la réforme engagée depuis 2013 qui s’est traduit le 5 mars 2014 par l’adoption d’une nouvelle loi sur la formation professionnelle.
En complément de cette littérature abondante, et afin d’aborder plus particulièrement l’impact de la formation professionnelle sur la compétitivité des industriels, La Fabrique de l’industrie a souhaité participer de manière constructive et originale à ce débat. Elle a choisi de lancer une consultation ouverte à l’ensemble des parties prenantes (entreprises industrielles, jeunes, salariés, acteurs de la formation, etc.) sur son site internet via une plateforme dédiée. Elle a par ailleurs réalisé près de trente auditions d’experts.
Ces nombreux témoignages d’acteurs permettent d’identifier les facteurs de blocage du système de formation et les leviers d’action pour y remédier.
Du côté des industriels interrogés, la première raison avancée pour expliquer leurs difficultés de recrutement est que le système éducatif ne forme pas les profils recherchés, notamment pour les savoir-faire techniques. Ils invoquent aussi la faible mobilité de la main d’œuvre et surtout le manque d’attractivité de l’industrie et des formations qui y conduisent. On manque de chaudronniers, d’ajusteurs et de personnel de maintenance, et le contenu des formations n’évolue pas au rythme de la transformation des métiers de l’industrie. Les industriels peinent à anticiper leurs besoins, et l’appareil éducatif s’y ajuste avec difficulté. D’autres contributeurs au débat soulignent, quant à eux, que l’appareil de formation aux métiers de l’industrie est bien développé en formation initiale mais très peu en formation continue, et que l’articulation entre ces deux composantes est déficiente. Enfin, ils sont nombreux à remarquer que, face à la pénurie de candidats, les personnes éloignées de l’emploi – chômeurs de longue durée, jeunes sans qualification, etc. – pourraient représenter un gisement de main d’œuvre intéressant, mais que celui-ci reste encore trop peu exploité car leur formation implique un investissement lourd. Au final, le système peine à former les individus tout au long de la vie et donc à les adapter aux défis de compétitivité auxquels les industriels sont soumis.
Le diagnostic, établi de longue date, n’incite pas à l’optimisme. Pourtant, de nombreux acteurs ont mis en place des pratiques intéressantes qui méritent d’être encouragées et développées. Si une « réforme systémique » est par essence ambitieuse, la mise en lumière d’arrangements locaux peut avantageusement diffuser des exemples et débloquer des situations concrètes. Mieux : on observe que c’est en discutant à plusieurs autour de « bonnes pratiques » (terme certes galvaudé) qu’émergent de nouvelles idées, de nouvelle façons de comprendre les problèmes et leurs solutions, quand l’analyse globale peine à dépasser le stade du diagnostic, assez démobilisateur.
Le présent document fait certes écho à des constats qui font déjà largement consensus. Toutefois, la diversité des points de vue exprimés permet d’apporter un nouveau regard sur les problèmes auxquels font face spécifiquement les industriels et sur les moyens concrets d’y remédier. L’ensemble des contributions reçues fait notamment apparaître une volonté forte de la part des acteurs saisis individuellement d’œuvrer en faveur d’un rapprochement de « mondes » qui, pris globalement, s’opposent ou simplement s’ignorent.
Le présent document s’articule comme suit. Un volet introductif vise à fournir des éléments de cadrage à la réflexion. Il s’agit de déterminer en quoi la formation professionnelle est primordiale pour la compétitivité des entreprises industrielles. Il revient également sur les difficultés de recrutement exprimées par les entreprises.
Cette partie est suivie de trois volets mettant en exergue les contributions recueillies.
Dans le premier volet, nous revenons sur les thématiques liées aux problèmes d’attractivité et de déficit d’image de l’industrie. Comment changer la perception des jeunes et de leurs prescripteurs ?
Le second volet s’attache à la question du développement de l’apprentissage. À partir des visites de deux centres de formation d’apprentis (CFA) – l’Aforp et le CFI, La Fabrique de l’industrie fait part des témoignages recueillis auprès des acteurs de terrain. Elle met également en avant l’exemple du système dual suisse, souvent cité pour son efficacité.
Le troisième et dernier volet plaide en faveur d’une meilleure articulation des systèmes de formation initiale et continue : une formation tout au long de la vie pour accompagner les mutations industrielles. Les différents contributeurs reviennent sur la loi du 5 mars 2014, présentée par le Gouvernement comme « un nouvel élan » en matière de formation professionnelle.
Témoignage de Gabriel Colletis, professeur à l’université de Toulouse 1 – Un déterminant essentiel de la compétitivité hors-prix : la qualité de la formation
Le « rapport Gallois », à juste titre, a souligné l’importance et l’urgence d’un redressement de la compétitivité de l’industrie française.
Curieusement, la portée de ce rapport a été réduite par certains à un simple plaidoyer en faveur d’une diminution des coûts salariaux, préalable considéré comme indispensable mais parfois aussi autosuffisant d’un redressement des marges.
Si la maîtrise des coûts et des prix, la reconstitution des marges constituent des objectifs intermédiaires incontestables, ils ne peuvent à eux seuls résumer le caractère global de la bataille pour une meilleure compétitivité de l’industrie française.
Le travail réalisé par Thibaut Bidet-Mayer et Louisa Toubal déplace le projecteur sur un déterminant essentiel de la compétitivité hors-prix : la qualité de la formation de ceux qui travaillent, de l’ouvrier au cadre. Les deux auteurs donnent la parole aux acteurs de la formation professionnelle. Il en ressort un ensemble de constats mais aussi de propositions visant à dépasser les différentes oppositions qui paralysent aujourd’hui les nécessaires évolutions du dispositif de formation professionnelle.
Un changement de représentation de ce que devrait être la formation professionnelle nous paraît indispensable afin que les oppositions identifiées par les auteurs soient dépassées ou transcendées. Plutôt qu’une suite de séquences marquée par le poids du diplôme initial d’entrée dans la vie professionnelle, la formation professionnelle devrait être désormais considérée comme un processus tout au long de la vie. Non un droit ou un avantage dont bénéficieraient principalement les cadres, la formation professionnelle devrait être appréhendée comme une opportunité pour tous permettant de garantir la nécessaire mobilité professionnelle dans un univers en permanente mutation. Loin d’être une obligation dont l’entreprise peut éventuellement s’acquitter par un paiement, la formation professionnelle devrait être considérée comme un investissement.
Pour que ce changement de représentation s’opère, il est indispensable que soit écarté le risque d’une industrie « low cost » où seule la maîtrise des coûts importerait face à des clients dont le principal critère de choix serait le prix. Une organisation cognitive du travail, fondée sur la complémentarité des compétences, doit se substituer à la division technique ou taylorienne du travail…ce qui impose que le travail soit considéré autrement qu’un coût qu’il convient de réduire.
Enfin, la dimension territoriale de l’activité industrielle doit être pleinement reconnue comme le corollaire paradoxal de la mondialisation. La formation professionnelle doit ainsi s’insérer dans la construction de systèmes localisés de compétences dont la mission est de contribuer à ancrer des entreprises dont le nomadisme est une caractéristique intrinsèque.
VOLET INTRODUCTIF – Un impératif pour la compétitivité : adapter la formation professionnelle aux besoins des industriels
La formation professionnelle constitue un enjeu majeur pour la compétitivité d’une économie. L’automatisation
des chaînes de production, la diffusion des TIC, les défis du développement durable et de la globalisation…
sont autant de facteurs qui influent sur les besoins en compétences des industriels. Ils imposent une adaptation et une mobilité de la main d’œuvre toujours plus importantes, qui ne peuvent être assurées que par un fonctionnement efficace du système de formation.
Il importe de développer des outils permettant d’anticiper ces futurs besoins et de construire les dispositifs de
formation adéquats. Si ces exercices de prospective se révèlent difficiles, ils n’en sont pas moins indispensables car ils constituent un outil central pour répondre aux difficultés de recrutement qui handicapent aujourd’hui de nombreuses entreprises industrielles.
Le manque de personnel qualifié est un frein à la compétitivité des industriels
Le manque de personnel qualifié est, selon la Banque de France, le premier frein à l’augmentation des capacités de production pour 64 % des entreprises2. Pour André Gauron, collaborateur au Laboratoire social d’actions, d’innovations, de réflexions et d’échanges (Lasaire)3, « les difficultés de recrutement constituent un facteur de désindustrialisation, soit parce que les entreprises industrielles ne peuvent pas répondre à des commandes et finissent par perdre des marchés, soit parce qu’elles décident de se délocaliser dans des pays où elles savent trouver cette main d’œuvre qualifiée. »
Selon McKinsey4, à l’horizon 2020, « l’inadéquation des compétences* » pourrait empêcher la création de 2,3 millions de postes qualifiés et détruire 2,2 millions d’emplois non qualifiés. « La France est marquée par une demande très forte de main d’œuvre disposant d’un niveau d’études égal ou supérieur au Bac, tandis que ses actifs peu diplômés se heurtent à une sévère pénurie d’emplois. » Le manque de candidats qualifiés concerne l’industrie en premier lieu, car il y est renforcé par le déficit d’attractivité dont souffre le secteur.
Jean-Luc Cenat, conseiller du président de l’Association française pour le développement de l’enseignement technique (Afdet), considère que l’objectif prioritaire à atteindre afin de répondre plus efficacement aux besoins en compétences des industriels est de lutter contre le décrochage scolaire. Il estime en effet que « la sortie prématurée des jeunes du système éducatif pose un réel problème en termes de compétitivité », et rappelle qu’ « environ 150 000 jeunes sortent chaque année de l’école sans diplôme, soit un sur six. » L’ampleur de ce phénomène engendre un manque à gagner important pour la société et pour la compétitivité industrielle. Il alimente un chômage de masse, que l’on pourrait qualifier de « paradoxal » car il fait coexister une importante population de personnes sans qualification avec de nombreux « métiers en tension » sur lesquels les entreprises peinent à recruter.
Un récent rapport du ministère de l’Éducation nationale5 avance plusieurs arguments pour expliquer ce phénomène de décrochage scolaire. D’une part, « les programmes prennent moins (ou plus) en compte l’environnement auquel l’élève pourrait se rattacher, pour mieux comprendre l’utilité de maîtriser un concept. Le caractère abstrait des notions abordées rend plus complexe le travail de l’enseignant pour mettre en place des séquences qui pourraient ramener l’élève à des objets familiers afin qu’il s’en approprie les contenus plus aisément. » D’autre part, le rapport pointe le problème des « orientations subies », dont les sources « sont à puiser dans la méconnaissance des élèves sur les contenus et les attendus des métiers qu’ils ambitionnent. »
Ces constats invitent donc à développer et à valoriser des dispositifs de formation tels que l’apprentissage ou la voie professionnelle initiale, qui proposent des approches pédagogiques alternatives mettant plus directement en lien les savoirs théoriques et leurs applications concrètes. Plus globalement, ils plaident pour un rapprochement entre le monde de l’école et celui de l’entreprise pour aider les jeunes à faire des choix d’orientation plus éclairés.
Dans son rapport publié à l’occasion de son installation, le Conseil national éducation-économie (CNEE)6 affirme que « le redressement productif passe par l’investissement éducatif, c’est-à-dire par un engagement national en faveur de la qualité des formations initiales. L’insertion professionnelle repose d’abord sur une éducation et une formation adaptées. Dans une économie marquée par l’accélération du progrès technique, les jeunes ont besoin d’une formation initiale solide avec en particulier une forte capacité à apprendre pour s’adapter tout au long de leur vie, car ils seront confrontés à une obsolescence de plus en plus rapide de leurs compétences. Compte tenu du rôle déterminant de l’innovation, nous devons amener le plus grand nombre d’élèves dans l’enseignement supérieur […] car les qualifications de nos jeunes doivent être des avantages concurrentiels pour notre pays et pour créer de l’emploi qualifié en France. » Or, seulement un quart des jeunes atteignent ou dépassent le niveau de la licence.
Au-delà de la seule formation initiale, Emmanuelle Wargon, déléguée générale à l’emploi et à la formation professionnelle, réaffirme l’importance de la formation continue des salariés, qui constitue « un facteur connu d’augmentation de la productivité du travail. Elle permet en effet aux salariés de s’adapter plus rapidement aux innovations techniques et organisationnelles et les conduit à gagner en efficacité dans l’exercice de leur travail. » En cela, elle constitue un outil indispensable pour accompagner la nécessaire montée en gamme de l’industrie française par l’élévation des compétences.
Dominique Gillier, secrétaire général de la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT (FGMM-CFDT), rappelle ainsi que l’ « on devrait s’intéresser davantage aux finalités de la formation professionnelle. Pour le salarié, elle représente une qualification qui lui permet d’accéder à un emploi et de sécuriser un parcours professionnel. Pour l’entreprise, elle constitue une capacité de création de richesse et de compétitivité par la qualité du travail humain et sa force d’innovation technique, managériale et organisationnelle… »
Il insiste toutefois sur l’importance « d’un couplage dynamique entre les compétences individuelles et collectives et l’organisation du travail, pour les faire évoluer intelligemment, aux bénéfices conjoints de la
compétitivité, de la création de richesse, de l’emploi et de l’intérêt du travail, y compris évidemment par
sa juste rémunération et des perspectives de carrière. »
- 2. Banque de France, 2012.
- 3. André Gauron est membre du conseil d’orientation de La Fabrique de l’industrie.
- 4. McKinsey, 2012.
- 5. Armand A., Bisson-Vaivre C., Lhermet, P., 2013.
- 6. Le CNEE est chargé d’animer une réflexion prospective sur l’articulation entre le système éducatif et les besoins du monde économique, ainsi qu’un dialogue permanent entre leurs représentants sur la relation entre l’éducation, l’économie et l’emploi.
Témoignage de Jean Wemaëre, président de la Fédération de la formation professionnelle (FFP)
Les objectifs assignés à la formation professionnelle continue sont pluriels. Le Code du Travail dispose ainsi qu’elle a « pour objet de favoriser l’insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans l’emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l’accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle, de contribuer au développement économique et culturel, à la sécurisation des parcours professionnels et à leur promotion sociale » (art L. 6311-1).
En réalité, elle a des effets bénéfiques sur la compétitivité et la croissance à plus d’un titre.
À l’échelle de l’individu, la formation professionnelle engendre une meilleure adéquation au poste de travail et augmente la productivité de l’actif qui bénéficie de l’action de formation. En permettant d’évaluer et potentiellement de certifier les compétences des individus, la formation sécurise les parcours professionnels et favorise les mobilités en limitant les périodes de transition.
À l’échelle de l’entreprise, elle permet une gestion maitrisée et évolutive des ressources humaines et accompagne la montée en compétences des talents. En outre, elle contribue à un environnement de travail plus efficace, notamment par les formations transverses. Le développement d’une culture de l’apprentissage tout au long de la vie permet aux entreprises d’intégrer les rapides évolutions technologiques et organisationnelles. Enfin, elle leur confère de réels atouts immatériels.
À l’échelle du pays enfin, la formation professionnelle est au cœur de la stratégie du développement de la marque France et de la compétitivité hors-coût de notre pays. Elle permet de pallier l’accélération de l’obsolescence des compétences, qui constitue un défi majeur pour nos sociétés à l’ère de l’économie de la connaissance. C’est un enjeu capital dans la concurrence internationale que de disposer d’actifs mobiles et capables de se saisir rapidement de la nouveauté pour en retirer un avantage concurrentiel. La formation sera de plus en plus la clef de la croissance : il ne faudra pas travailler plus, mais travailler mieux. Ainsi, selon une étude de l’OCDE, les formations qui accompagnent les actifs tout au long de leur vie professionnelle atteindront à l’horizon 2060 jusqu’à 10 % du temps de travail.
La FFP est engagée à valoriser l’investissement en capital humain
L’investissement en capital humain n’est pas assez valorisé en France. Deux raisons majeures peuvent l’expliquer. D’abord, il est difficile d’éclairer les liens entre performance économique et investissement en capital immatériel : les données sont très largement issues de la recherche anglo-saxonne et manquent encore très largement en France. Par ailleurs, par son histoire, la formation professionnelle en France a très largement été cantonnée au domaine du social. Par conséquent, elle a été trop souvent perçue comme une variable d’ajustement de l’économie alors qu’elle est un levier majeur de compétitivité et de croissance. Il est vraisemblable que le système de formation professionnelle issu de la loi Delors de 1971 ait renforcé cette appréhension de la formation en limitant toute incitation pour l’entreprise à développer une réelle vision stratégique de formation. Il faut donc saluer la suppression, par la loi du 5 mars 2014, de l’obligation fiscale de financement, qui déresponsabilisait les employeurs et engendrait des coûts de gestion inutiles.
Depuis sa création, la FFP cherche à faire définitivement entrer la formation professionnelle dans le champ économique. Comme le notait le rapport Lévy-Jouyet, « au capital matériel a succédé, dans les critères essentiels de dynamisme économique, le capital immatériel ou, pour le dire autrement, le capital des talents, de la connaissance, du savoir. En fait, la vraie richesse d’un pays, ce sont ses hommes et ses femmes. »
Un prérequis pour cela consiste d’abord à améliorer la lisibilité et la qualité de l’offre de formation. C’est dans ce sens que la FFP a soutenu en 1994 la création de l’Office professionnel de qualification des organismes de formation (OPQF), qui a pu délivrer à 900 organismes une qualification ISQ-OPQF. Et c’est également dans cette optique qu’elle dirige les travaux de normalisation tant au niveau international (ISO) que national (AFNOR).
Par ailleurs, la FFP est au cœur des réflexions menées autour d’une meilleure valorisation des impacts économiques et sociétaux des investissements des entreprises en formation professionnelle. Ainsi, elle s’est vue confier l’animation d’un groupe de travail multipartite réuni entre mars et novembre 2012 qui avait donné lieu à un colloque à Bercy le 18 février 2013 en présence d’Arnaud Montebourg, ministre du Redressement productif et de Thierry Repentin, ministre délégué chargé de la Formation professionnelle et de l’Apprentissage. Lors de ce colloque avait été présenté un guide de reporting à destination des entreprises, visant à mieux appréhender la responsabilité sociétale et environnementale du responsable formation. Parmi ces indicateurs que la FFP continue à diffuser dans nos territoires, trois sont dits « de base » au sens où ils devraient être appliqués par toute entreprise :
- Le nombre moyen d’heures de formation par an et par salarié, et par catégorie,
- Le taux d’accès à la formation par catégorie,
- Les programmes de développement des compétences et de formation tout au long de la vie destinés à assurer l’employabilité des salariés et à les aider à gérer leur fin de carrière.
Dans la continuité, la FFP, avec un mandat de la DGCIS et de la DGEFP, anime un nouveau comité de pilotage chargé de mettre en œuvre le plan d’actions « Capital humain et formation professionnelle, investissements pour la compétitivité ». Lancé le 15 janvier 2014, il fait l’objet de cinq groupes de travail réunissant notamment pouvoirs publics, DRH et responsables formation, OPCA, Régions, CCI et partenaires sociaux. Ils visent à 1° diffuser et consolider les indicateurs contenus dans le guide de reporting mentionné ci-dessus ; 2° étudier la possibilité d’amortir tout ou partie des dépenses des entreprises affectées au capital humain ; 3° faire de l’investissement en formation professionnelle un facteur d’accès au crédit pour les PME ; 4° outiller les acheteurs de formation professionnelle afin qu’ils puissent s’assurer de la qualité des prestations ; 5° soutenir les projets innovants en formation professionnelle.
Des défis nombreux qui ont un impact sur l’évolution des besoins en compétences et en qualifications des entreprises
L’industrie française fait face à un environnement en constante évolution. Confrontée sur les dernières décennies à l’ouverture des échanges internationaux et à l’émergence des technologies de l’information et de la communication, l’industrie ne produit plus aujourd’hui comme elle le faisait pendant les Trente glorieuses. Les entreprises ont dû adapter leur structure (externalisation, recentrage sur leur cœur de métier, etc.) et leur organisation du travail pour prendre en compte ces bouleversements. Alors que l’organisation du travail dans l’industrie se faisait auparavant suivant une logique très verticale, hiérarchique, avec une séparation entre les tâches de conception et d’exécution, celle-ci est progressivement devenue plus horizontale. Cette transversalité des tâches plus grande requiert une polyvalence plus importante.
Ces évolutions induisent de facto des besoins nouveaux en compétences et supposent donc une adaptation de l’offre de formation professionnelle initiale et continue. Cette capacité du système de formation à réagir aux changements a un impact sur la compétitivité du tissu industriel dans son ensemble.
Graphique 1. Les besoins en compétences au regard des défis à relever par les industriels
Source : réalisé sur la base d’un entretien avec Françoise Diard, le 4 février 2014
Ces évolutions sont le signe, selon Gabriel Colletis, que l’industrie est en train de passer d’une division « taylorienne » du travail à une division « cognitive »7. À l’inverse de l’organisation taylorienne ou fordiste où la qualité d’un ouvrier se réduisait à sa seule « force de travail » sur une chaîne de montage, le « travailleur cognitif » tel qu’il est désigné doit aujourd’hui développer des compétences lui permettant de résoudre des problèmes de manière autonome, de travailler en collaboration, en réseau, etc.
Françoise Diard, responsable de l’Observatoire des métiers de la métallurgie, note que « l’industrie a
aujourd’hui besoin à la fois de personnes avec des bases technologiques bien maitrisées mais aussi capables d’avoir une ouverture pour échanger avec les directions d’achats, commerciales etc. Typiquement par exemple, dans l’aéronautique, le profil de chargé d’affaires n’existait pas il y a 15 ans. Aujourd’hui, ce poste nécessite des compétences dans différents domaines comme réaliser des analyses techniques poussées, faire des devis financiers, négocier des contrats, disposer d’une culture internationale forte. »
Alors que la production dans les secteurs difficilement automatisables (jouets, cuir et textiles, etc.) a été très largement délocalisée, la généralisation de la présence de machines de plus en plus complexes a diminué les besoins en ouvriers non qualifiés. Dans les usines très automatisées, on a toujours besoin d’hommes et de femmes pour détecter une situation imprévue et y réagir. Ils ont un rôle de surveillance et de pilotage de machines sophistiquées. Pour reprendre l’exemple du secteur aéronautique, selon l’Observatoire de la métallurgie et le GIFAS, « du fait des exigences de qualité, de la complexité croissante des machines et de la nécessaire optimisation de l’organisation de la production, les critères de recrutement sont plus élevés, tant en termes d’expérience qu’en niveau de diplôme. Sur la programmation, l’évolution des machines (généralisation de la commande numérique, fraiseuses désormais multiaxes…) nécessite des profils plus pointus et donc des profils plus élevés (BTS, Licence pro, voire pour certains des ingénieurs issus des IUT) »8. Les données du Céreq montrent ainsi que, sur les quinze dernières années, la part des salariés sans diplôme est passée de 37,9 % à 23,7 %, tandis que celles des niveaux IV et III ont progressé de respectivement 6,6 et 5,7 points. Les besoins en formation professionnelle sont également importants pour adapter les compétences des salariés aux problématiques liées aux nouvelles énergies et à l’environnement comme l’illustre le développement du véhicule du futur (cf. Encadré 1).
Mais pour Françoise Diard, « si d’un point de vue quantitatif l’industrie a besoin de techniciens et d’ingénieurs, elle ne peut se priver de personnes qualifiées qui n’ont pas nécessairement un niveau Bac ou BTS mais qui ont des compétences avérées. À titre d’exemple, la branche de la métallurgie a de plus en plus de difficultés à recruter des usineurs. Les formations initiales de niveau V n’existent presque plus et ne seront pas recréées par l’Éducation nationale. Ce niveau permettait de développer une culture technique forte (connaissances des machines, des matériaux) qui fait souvent défaut aujourd’hui. »
La compétitivité industrielle se joue donc aujourd’hui à tous les niveaux de qualification. La mise à jour et le développement des compétences des ouvriers et des techniciens sont aussi importants que pour les ingénieurs et il est primordial de garantir une égalité d’accès à la formation continue pour ces différentes catégories de salariés. Le système reste néanmoins largement inégalitaire : sur la période 2008-2010, seuls 36 % des ouvriers ont bénéficié d’une formation continue, contre 60 % des cadres et professions intermédiaires9.
Encadré 1. L’automobile, nouvelles technologies, nouvelles compétences Formation professionnelle et industrie. Le regard des acteurs de terrain
Le développement du véhicule du futur reposera sur trois domaines technologiques qui nécessiteront des compétences nouvelles, souvent à forte valeur ajoutée.
L’économie des matières premières : l’écoconception des véhicules ne pourra se faire sans l’aide d’ingénieurs spécialisés dans l’environnement. La révolution des « matériaux composites » (mousses, plastiques, fibre de carbone…) fera appel à des compétences dans la chimie de spécialité et chimie du végétal (biosourcée). Enfin, des nouvelles compétences se développeront dans la filière recyclage.
Les motorisations électrifiées : Il y aura un fort besoin de compétences sur la chimie des batteries, pour limiter le retard pris par rapport aux asiatiques (Japon et Corée), mais aussi en électronique et en électrochimique, pour faire face au challenge technologique de la prochaine décennie : le Battery Management System (BMS)10.
L’électronique et l’informatique embarquées : L’informatique et l’électronique deviennent incontournables dans l’automobile de demain, notamment par la synergie qu’elles offrent avec les véhicules électrifiés (hybrides et électriques). La valeur et la compétence se déplacent du « hard » vers le « soft » et notamment vers le traitement des données de mobilité.
Ces nouvelles compétences se développeront surtout aux niveaux Bac+3 et Bac+5 et dans une moindre mesure au niveau Bac+2. Elles nécessiteront soit une adaptation des formations existantes, soit la création de nouveaux cursus. Il sera également important pour les entreprises de développer leur offre de formation continue afin de former leur main d’œuvre à ces technologies nouvelles.
Source : Observatoire de la métallurgie
Enfin, en portant le regard un peu plus loin, on peut également se demander comment le système éducatif et de formation pourra préparer « l’industrie de demain ». L’industrie connaît en effet des bouleversements sans précédent, avec la diffusion des technologies liées au numérique, l’intégration croissante des méthodes lean (tant dans le champ de la production que dans ceux de l’ingénierie, de la conception, de la logistique, du commerce, du management, etc.), le développement des imprimantes 3D, de la « cobotique » (c’est-à-dire de la robotique collaborative), et l’apparition d’usines connectées, ce que les Allemands ont décrit comme étant la quatrième révolution industrielle : l’industrie 4.0. Cette mutation vise à concevoir des sites de production intelligents et autonomes grâce à l’utilisation d’internet et des réseaux communicants avancés. Parce que la conception et la conduite de l’usine 4.0 seront différentes de ce que l’on connaît aujourd’hui, il faudra y préparer l’entreprise et le personnel.
L’Allemagne a pris de l’avance et a déjà lancé de multiples programmes, menés en concertation avec les syndicats professionnels, les entreprises et le Gouvernement. L’expérience outre-Rhin peut être riche d’enseignements pour la France. Selon Jean-Daniel Weisz, les Allemands « ont très tôt reconnu que la mise en œuvre opérationnelle d’Industrie 4.0 aurait des impacts majeurs tant sur le contenu du travail que sur l’organisation de l’entreprise, les qualifications demandées et leur évolution au fil du temps. Le monde ultra-connecté de l’industrie 4.0 questionne bien évidemment le système de formation professionnelle initiale et continue, reconnu comme un des avantages compétitifs de l’industrie allemande et comme un pilier de sa capacité d’adaptation. »
- 7. Colletis G., Paulré B., 2008.
- 8. Observatoire de la métallurgie, GIFAS, 2012.
- 9. Céreq, 2013, « Portraits statistiques de branche ».
- 10. Le BMS (système de contrôle de batterie d’accumulateurs) est un système électronique de contrôle de l’état des différents éléments d’une batterie d’accumulateurs au lithium.
Trois questions à Jean-Daniel Weisz, consultant associé chez Kohler Consulting & Coaching11 – Industrie 4.0, quels enjeux pour la formation professionnelle ?
1. Qu’est-ce que l’industrie 4.0 implique en termes de changement organisationnel dans l’entreprise ?
Il est encore difficile de se représenter à quoi ressemblera l’usine du futur. Le rapport final du groupe de travail Industrie 4.012, distingue deux grandes tendances ayant un impact important sur les tâches et les compétences :
- une insertion du processus de production classique très segmenté dans une organisation différente, enrichie en termes de fonctions de décision, de coordination, de contrôle et de services attachés,
- un besoin d’organisation des interactions entre les machines réelles et virtuelles, du pilotage des installations et de la gestion de la production.
L’industrie automobile est aujourd’hui la plus avancée dans ce processus de transformation. Un sous-traitant comme la société Festo, par exemple, imagine déjà des collaborateurs déambulant dans l’usine avec des appareils mobiles constamment abreuvés en informations individualisées, permettant notamment de surveiller
en temps réel la consommation en énergie d’une machine et leur permettant d’intervenir immédiatement en cas d’irrégularité13. Mais cette transformation ne pourra être que progressive.
2. Quel impact sur les salariés et les compétences attendues ?
Il est encore difficile de savoir quel sera l’effet de cette révolution sur le volume d’emploi. Pour Constanze Kurz, membre du directoire d’IG Metall en charge du sujet Industrie 4.0, une chose est sûre : « il restera des hommes dans les halles de production, quel que soit leur degré d’automatisation et même si elles sont gérées de manière décentralisée14. » L’être humain dispose en effet d’une capacité que la machine n’a pas : la créativité.
Le travailleur 4.0 devra résoudre des problèmes de disponibilité, de sécurité et de qualité de l’information dans une usine 4.0 dont les installations virtuelles et réelles seront d’une grande complication. Cette capacité de résolution de problèmes demandera d’abord une montée en gamme des qualifications, plus de connaissances et de qualifications dans des domaines comme l’ingénierie des systèmes et l’infrastructure IT, les logiciels et la sécurité des données et des flux.
Mais au-delà du « plus de connaissances », l’enjeu principal de la formation dans le cadre d’Industrie 4.0 réside dans le développement de profils interdisciplinaires voire hybrides. Dans l’usine connectée, les compétences s’étendront aussi à d’autres fonctions aux interstices entre la production et les services clients ou la logistique et le marketing, voire le contrôle de gestion. L’usine connectée impliquera des hiérarchies plus plates et une montée en puissance du travail collaboratif où la qualité relationnelle entre les collaborateurs 4.0 deviendra cruciale. L’autre enjeu majeur d’Industrie 4.0 sera ainsi le développement de compétences favorisant autant la qualité des interactions humaines que la capacité à décider vite et bien en prenant en compte une représentation globale du système sur lequel le collaborateur 4.0 intervient.
L’évolution de la formation professionnelle tant initiale que continue peut se lire à l’aune de ces deux enjeux : interdisciplinarité et compétences interactionnelles.
3. Quels besoins en termes de formation professionnelle initiale et continue ?
Le rapport final du groupe de travail Industrie 4.0 remet en question une formation standardisée : « il s’agit d’ouvrir les frontières entre les sciences naturelles et les sciences de l’ingénieur, d’adresser de manière plus offensive l’acquisition de compétences transdisciplinaires comme le management ou la gestion de projet. Les maîtres des horloges dans cette évolution de la formation académique des collaborateurs 4.0 sont les entreprises et leurs clients15. »
Selon le VDI (association de l’industrie allemande), il ne sera pas nécessaire de mettre en place de nouvelles filières de formation pour les ingénieurs : « une formation solide, par exemple en électrotechnique ou en construction mécanique suffira aussi à l’avenir comme base pour se maintenir dans l’usine de la ‘quatrième génération industrielle’. Mais en plus de l’interdisciplinarité, les entreprises devront muscler le ‘training on the job’ ». À titre d’exemple, la société Wittenstein, fabricant d’éléments mécatroniques, construit un campus industriel destiné à former aux sciences de l’ingénieur et de l’informatique.
La formation permanente sera aussi essentielle pour maintenir les compétences fondamentales et les capacités d’adaptation tout au long de la vie professionnelle. L’enjeu pour la formation professionnelle réside donc dans la capacité à intensifier et démultiplier les dispositifs existants, notamment dans un contexte national de pénurie d’ingénieurs qualifiés et dans la possibilité de les faire évoluer.
Les entreprises auront besoin d’un cadre et de repères pour s’impliquer davantage dans la formation professionnelle, d’où leur demande de standards destinés aussi à développer des processus d’évaluation de ces nouvelles compétences en entreprise, des « standards pour la reconnaissance de la formation non-formelle et informelle. »
Enfin, l’acquisition et le développement des compétences comportementales nécessaires au collaborateur 4.0 induiront probablement une demande de formation et d’accompagnement individuel, de développement personnel, une sorte de coaching 4.0, que des formations standardisées ne pourront dispenser.
Conséquence inévitable de ces évolutions, des dispositifs d’accompagnement seront à mettre en place pour aider ceux qui, insuffisamment qualifiés ou incapables de développer les compétences interactionnelles requises, pâtiront de l’effet d’éviction que ces changements induiront.
Le réseau des instituts de recherche est bien sûr mobilisé, notamment pour identifier les évolutions attendues en termes d’organisation du travail16. De son côté, le groupe de travail Industrie 4.0 a identifié plusieurs mesures en faveur de la formation professionnelle initiale et continue. Parmi celles-ci, on peut notamment citer le développement de réseaux de bonnes pratiques, la recherche de nouvelles solutions, l’expérimentation de modèles pour l’acquisition de connaissances et de compétences « proches du poste de travail », le développement de techniques d’apprentissage digitales et le développement de contenus de formation spécifiques à Industrie 4.0. Enfin, une plateforme de e-learning, l’Academy Cube, a été lancée début 2013 à l’initiative d’institutions publiques et d’entreprises pour répondre au besoin de nouvelles qualifications et de contenus liés à Industrie 4.0.
- 11. Retrouvez l’intégralité de cette contribution sur www.la-fabrique.fr
- 12. Forschungsunion Wirtschaft und Wissenschaft, Acatech, 2013.
- 13. Die Fabrik der Zukunft, Human Resources Manager : http://www.humanresourcesmanager.de/ressorts/artikel/die-fabrik-der-zukunft
- 14. Interview de Constanze Kurz (IG Metall) dans le journal Ampere, magazine de l’industrie électrique, janvier 2013, p. 32.
- 15. Forschungsunion Wirtschaft und Wissenschaft, Acatech, 2013.
- 16. Voir à ce sujet le rapport de l’Institut Fraunhofer : Produktionsarbeit der Zukunft – Industrie 4.0, Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO.
La difficulté des entreprises à anticiper leurs besoins en formation
Dans un environnement concurrentiel, où les changements sont permanents, les entreprises et en particulier les PMI éprouvent le plus souvent des difficultés à anticiper leurs besoins en compétences et par conséquent en formation. L’enquête sur les métiers d’avenir menée par OpinionWay pour CCI France17 est à ce titre éloquente. Fortement influencés par la conjoncture morose, les industriels préfèrent se recentrer sur la production et le client, plutôt que de miser sur des compétences leur permettant de se développer et de conquérir de nouveaux marchés. L’anticipation des mutations et des nouveaux besoins en compétences qui en découlent est un exercice difficile pour lequel un accompagnement des entreprises, en particulier les plus petites, reste nécessaire.
Depuis la fin des années 1990, des exercices de prospective sur les métiers et les qualifications sont régulièrement menés par le Commissariat général à la stratégie et à la prospective (CGSP) conjointement avec la Direction de l’animation, de la recherche, des études et des statistiques (DARES).18
Mais, comme l’indique le Conseil d’orientation pour l’emploi (COE)19, ces travaux nationaux doivent être complétés par des analyses sectorielles et régionales approfondies afin de refléter de la manière la plus juste les besoins réels des entreprises en termes de compétences et par conséquent de formation. Le rôle des branches professionnelles est, à ce titre, essentiel. Depuis l’accord national interprofessionnel (ANI) de 2003 relatif à l’accès des salariés à la formation tout au long de la vie, les branches professionnelles ont l’obligation de créer un observatoire des métiers et des qualifications – le Céreq20 en recensait 126 en 2011. Ils ont pour mission d’anticiper les besoins en compétences des entreprises et des salariés et de contribuer à la définition des politiques de formation par les partenaires sociaux. Reste que, selon le Céreq, seulement un observatoire sur deux réalise des travaux prospectifs permettant d’anticiper les besoins en compétences futurs. Par ailleurs, une étude réalisée par Sémaphores pour le CGSP en 2013 souligne que « les travaux des observatoires paritaires sur les métiers et qualifications sont peu connus et peu appropriés par les entreprises. »
L’ANI de décembre 2013, dix ans plus tard, a renforcé le rôle des branches professionnelles en leur confiant des « missions d’appui ». Elles sont invitées à se doter d’un Observatoire paritaire prospectif des métiers des qualifications et des compétences (OPMQC) afin « d’anticiper les évolutions qualitatives et quantitatives de l’emploi de la branche ; d’identifier les métiers et compétences clés nécessaires au développement des entreprises de la branche et les métiers à forte évolution potentielle […] et de mener tous travaux d’analyse et d’étude nécessaires à la mise en œuvre d’une GPEC. »
- 17. OpinionWay, 2013.
- 18. CGSP, DARES, 2012.
- 19. COE, 2013.
- 20. Céreq, 2012.
Quatre questions à Françoise Diard, responsable de l’Observatoire paritaire prospectif et analytique de la métallurgie – La métallurgie, un observatoire paritaire
1. Quel est l’impact de l’ANI du 14 décembre 2013 sur le rôle et les missions de votre observatoire ?
Créé suite à l’accord national interprofessionnel (ANI) du 5 décembre 2003 et à l’accord de branche de la métallurgie du 20 avril 2004, notre observatoire a vu son rôle progressivement évoluer. Il a pour mission d’éclairer les partenaires sociaux, les entreprises et les acteurs concernés sur l’évolution des métiers et des qualifications de l’industrie métallurgique, les pratiques et tendances constatées en matière de recrutement et de mobilité, les évolutions de l’emploi et les besoins en compétences. Suite à l’accord de 2013, nous avons par exemple travaillé sur l’accessibilité de l’information à destination de nos publics cibles à savoir les jeunes, les salariés, les chômeurs et bien évidemment les industriels. Nos travaux accessibles sur notre site web sont aussi régulièrement présentés par les UIMM territoriales, les partenaires sociaux…
Notre observatoire a la particularité d’être paritaire depuis sa création. Toutes les communications qui sont sur notre site résultent d’un dialogue partagé entre les organisations patronales et syndicales. Depuis 2005, nous réalisons également des études prospectives afin de dessiner le paysage des compétences à moyen terme. Enfin, il se distingue des autres observatoires par un positionnement très fort en région lié au maillage territorial de l’UIMM. Cette assise régionale nous permet de collecter des données, des informations pour conduire des études et des analyses prospectives à l’échelle locale. Les outils ainsi développés sont précieux pour amorcer des réflexions sur les plans régionaux Emploi-Formation au service de la branche et anticiper les besoins en formation initiale et formation continue. Il faut rappeler que l’ANI de 2013 renforce le rôle des observatoires en lien avec les Régions.
2. Selon le Céreq, environ un observatoire sur deux seulement réalise des analyses prospectives pour soutenir et accompagner les entreprises. À quoi cela est-il dû, selon vous ?
Tous les observatoires ne peuvent en réaliser : ils n’en ont pas tous les moyens humains ou financiers. Cela suppose en effet de mobiliser des ressources pour réaliser des études, construire des bases de données (statistiques et métiers), il faut aussi pouvoir s’entourer d’experts qui disposent d’un savoir-faire pour construire des scenarii économiques. Il faut en effet prendre en compte que la statistique publique n’est pas toujours disponible.
3. Comment réalisez-vous vos travaux prospectifs ?
Nous avons tout d’abord identifié quatre grands défis auxquels fait face l’industrie : le défi démographique, le défi technologique, la globalisation de l’économie et le défi environnemental. Ces derniers ont un impact sur l’évolution actuelle et future des besoins en compétences et en qualifications et in fine sur l’offre de formation.
Puis, notre travail a consisté à identifier chaque secteur (machine équipement, automobile, naval, etc.) de la métallurgie afin de dégager pour chacun d’entre eux de grandes tendances en matière de besoins en compétences à l’horizon 2020.
Enfin, les fédérations économiques (Gifas, PFA, Gican….), notre réseau et les partenaires sociaux avec qui nous réalisons ces études diffusent ces travaux auprès des entreprises concernées.
4. Quelles sont les grandes tendances qui se dégagent de vos travaux prospectifs ?
De manière générale, on observe deux tendances : l’industrie perd des emplois, mais cela ne signifie pas que les différents secteurs de la métallurgie ne continueront pas à recruter. Les besoins en recrutement seront au contraire élevés : ils sont estimés entre 115 000 et 128 000 par an d’ici 2020. Tous les secteurs de la métallurgie sont concernés par le renouvellement des compétences même si le volume des besoins n’est pas le même pour tous.
Toute la difficulté est d’expliquer ces deux mouvements au grand public. Par exemple dans le secteur automobile, si la filière « amont » a perdu un quart de ses effectifs sur la période 2000-2010 et continuera à perdre des emplois à court terme, elle poursuivra en parallèle des recrutements. En effet, il y a (et il y aura) des emplois à pourvoir notamment pour accompagner les mutations technologiques que connaît ce secteur (véhicule du futur). Pour autant, l’industrie automobile peut pâtir d’une mauvaise image auprès des jeunes du fait de la médiatisation des plans sociaux, ces derniers préfèrent alors se tourner vers d’autres secteurs.
Cartographie des difficultés de recrutement dans l’industrie – ETAT DES LIEUX
Les difficultés de recrutement concernent tout particulièrement les ouvriers qualifiés et le personnel d’encadrement
Les résultats de la dernière enquête de Pôle emploi sur les besoins en main d’œuvre21 révèlent que les industriels connaissent des difficultés importantes pour recruter des profils qualifiés. Les difficultés d’embauche des ouvriers qualifiés sont en effet particulièrement importantes : 54,1 % des projets de recrutement étaient jugés difficiles en 2013, contre 40,3 % pour les ouvriers non qualifiés.
On constate ainsi qu’en dépit d’un chômage élevé et d’une conjoncture peu favorable, les tensions ressenties par les entreprises pour recruter certains profils sont très importantes. Environ huit projets de recrutement sur dix sont ainsi jugés difficiles pour les tuyauteurs, sept projets sur dix pour les chaudronniers, tôliers, traceurs, serruriers, métalliers ou encore forgerons. Ces métiers ne représentent pas forcément les plus gros volumes de recrutements mais leur pénurie peut empêcher le développement de l’entreprise ou demander un temps trop long de recrutement.
De nombreux postes d’encadrements font également défaut aux industriels. On note en effet que près d’un projet de recrutement d’ingénieurs et cadres sur deux est considéré comme délicat par les employeurs.
Tableau 1. Classement des dix métiers industriels où le recrutement est jugé difficile
Source : Pôle emploi, Enquête Besoins en Main-d’œuvre (2013)
Les difficultés de recrutement varient en fonction des secteurs et des bassins d’emplois
Majoritairement concentrées sur des profils qualifiés, les difficultés de recrutement concernent également plus particulièrement certains secteurs ou zones géographiques.
Avec 62,2 % de projets jugés difficiles, la branche métallurgie est celle qui enregistre les plus grosses difficultés. Ce sont ainsi des secteurs aussi variés que l’automobile, l’aéronautique, le spatial, le naval, le ferroviaire, les équipements mécaniques, les transformations des métaux, etc. qui sont touchés par ce problème.
Tableau 2. Classement des branche d’activité les plus touchées par les difficultés de recrutement
(*) Le secteur « Autres industries manufacturières » regroupe les 27 postes du niveau CM (Autres industries manufacturières – réparation et installation de machines et d’équipements) de la nomenclature NAF agrégée A38
Source : Pôle emploi, Enquête BMO, 2013
Les difficultés de recrutement ne se font pas ressentir de la même manière selon les bassins d’emplois, pour plusieurs raisons. Elles peuvent par exemple être fortes dans les territoires avec une concentration élevée d’activités de pointe. C’est le cas de Toulouse avec l’industrie aéronautique ou encore de Saint-Nazaire avec l’industrie navale. D’autres territoires souffrent plus globalement de problèmes d’attractivité : c’est par exemple le cas du bassin de Dunkerque, dont le fort recul de l’emploi industriel détériore l’attractivité, pénalisant au passage les activités dynamiques qui présentent de leur côté des besoins en recrutement significatifs.
Les difficultés de recrutement peuvent également se trouver renforcées par la conjugaison de ces facteurs. Le bassin d’emplois de Clermont-Ferrand, par exemple, souffre à la fois de l’image d’une région enclavée et de la forte concentration de ses besoins sur des emplois qualifiés, liée à la présence, outre celle historique du groupe Michelin, de nombreuses grandes entreprises de la métallurgie (Aubert & Duval), de l’aéronautique (AIA), de l’industrie pharmaceutique (Merck) ou encore de l’industrie agroalimentaire (Limagrain, Danone).
Tableau 3. Difficultés de recrutement par bassin d’emploi
Source : Pôle emploi, Enquête BMO, 2013
- 21. Pôle emploi, 2013.
Un éclairage sur la méthode statistique relative à la comptabilisation des difficultés de recrutement – ETAT DES LIEUX
Entretien avec Marie-Claire Carrère-Gée, présidente du Conseil d’orientation pour l’emploi (COE).
1. Les statistiques ayant trait aux difficultés de recrutement font aujourd’hui l’objet de nombreux débats compte tenu de la diversité des terminologies (emplois non pourvus, emplois vacants, etc.) et des sources (Pôle emploi, DARES).
Pourriez-vous préciser les précautions à retenir lorsque l’on essaie de quantifier les difficultés de recrutement ?
La notion d’« emplois vacants », utilisée par la Commission européenne, ne donne aucune indication de la difficulté à pourvoir un poste car elle désigne l’ensemble des emplois à pourvoir à un moment donné sur le marché du travail. Il vaut mieux parler d’emplois durablement non pourvus. Cependant, aucun indicateur statistique ne permet de les quantifier précisément.
Qui plus est, les statistiques disponibles portent sur des champs différents. Les données de Pôle emploi ne portent que sur les offres déposées à Pôle emploi : en 2012, 116 000 offres ont été abandonnées faute de candidats et 215 000 offres ont été satisfaites en trois mois ou plus (chiffre qui pourrait être extrapolé à 570 000 sur l’ensemble du marché du travail). Pour avoir des données globales, il faut se tourner vers des sources déclaratives. La principale est l’enquête Besoins de main-d’œuvre (BMO), selon laquelle les employeurs anticipaient 40 % de recrutements difficiles en 2013. Le Medef a construit sa propre enquête dont il ressort qu’au premier trimestre 2013, plus de 6 % des projets de recrutement ont été abandonnés pour des raisons autres que conjoncturelles. Il s’agit ici de sources déclaratives, avec les limites méthodologiques propres à ce type d’enquêtes. BMO est, en outre, une enquête d’anticipation ; les écarts peuvent être importants entre les projets et les embauches effectivement réalisées.
Au total, si chaque source prise isolément ne fournit pas une indication précise de l’ampleur des difficultés de recrutement, le rapprochement de ces différentes sources a permis au COE d’évaluer à environ 400 000 le nombre de tentatives de recrutement abandonnées chaque année faute de candidats.
2. Peut-on quantifier les besoins en compétences des entreprises industrielles ?
Selon les travaux menés par le Commissariat général à la stratégie et à la prospective et la DARES, pour la période 2010-2020, les projections de créations nettes d’emplois restent relativement faibles dans l’ensemble de l’industrie, par rapport à d’autres secteurs, notamment du tertiaire. Cela n’empêche pas d’avoir un nombre significatif de « postes à pourvoir » mais ils seront essentiellement alimentés par les départs en fin de carrière.
En outre, les postes à pourvoir ne correspondent pas forcément aux besoins en compétences, puisqu’il faut aussi prendre en compte les mobilités entre métiers, qui sont plus ou moins faciles selon le degré de spécialisation technique. Toutefois, ces projections sur les « postes à pourvoir » donnent une bonne indication sur le risque de difficultés de recrutement à venir, notamment là où des difficultés existent déjà et où le nombre de postes à pourvoir va augmenter.
À plus court terme, l’enquête BMO permet d’avoir une photographie des métiers pour lesquels les employeurs anticipent, à un moment donné, les difficultés de recrutement les plus importantes pour l’année à venir. En volume de recrutements jugés difficiles, les métiers de l’industrie ne sont pas les plus concernés. En revanche, quand on regarde les métiers pour lesquels la proportion de recrutements jugés difficiles est la plus élevée, les métiers de l’industrie sont très présents.
Outre BMO, d’autres indicateurs peuvent être mobilisées : la part des offres déposées à Pôle emploi puis retirées faute de candidat, par métier ; l’indicateur de tension entre offre et demande de travail élaboré par la DARES, surtout intéressant pour observer l’évolution des tensions par familles de métiers ; les travaux réalisés par les branches professionnelles ou par les filières.
Là encore, le rapprochement des différentes sources permet de mettre en évidence un certain nombre de métiers de l’industrie où les difficultés de recrutement sont importantes, par exemple des métiers d’ouvriers qualifiés dans la métallurgie (chaudronniers, tôliers, forgerons, moulistes, usineurs, etc.) ou dans les industries graphiques, mais aussi des techniciens et agents de maîtrise des industries mécaniques, de l’électricité et de l’électronique.
3. Parmi les difficultés de recrutement, quelles sont celles qui sont directement liées au manque de qualifications des candidats ?
Est-ce un phénomène plus particulièrement prononcé dans l’industrie ?
Si le manque de qualification des candidats est souvent mis en avant par les employeurs, les causes des difficultés de recrutement sont multiples et se combinent le plus souvent entres elles. D’autres facteurs comme le déficit d’attractivité de certains métiers, le manque de mobilité des candidats, certaines pratiques de recrutement trop exigeantes ou encore une insuffisante mixité des métiers interviennent également, dans des proportions variées selon les métiers. Par exemple, l’industrie souffre encore d’un déficit d’image alors même que les conditions de travail ont beaucoup évolué. De même, la persistance d’une faible mixité des métiers contribue à limiter le vivier de candidats potentiels.
Il n’en demeure pas moins que l’adaptation de l’offre de formation aux besoins de l’économie est un enjeu particulièrement important dans l’industrie, qui exige souvent des compétences techniques spécifiques, en particulier chez les ouvriers qualifiés.
En outre, peuvent s’ajouter des problématiques spécifiques, comme par exemple la difficile organisation de la transmission des compétences dans des industries où les produits ont des cycles de vie longs (nucléaire, navale, etc.) ou qui demandent des compétences dites « critiques », qui ne peuvent s’acquérir qu’avec l’expérience et pour lesquels un enseignement strictement théorique ne suffit pas.
L’évolution des métiers industriels depuis trente ans en France – ETAT DES LIEUX
Témoignage de Sabine Bessière, chef du département « Métiers et Qualifications » de la DARES.
La hausse globale de l’emploi sur les trente dernières années en France résulte d’évolutions très contrastées selon les métiers, mesurés à partir de la nomenclature des familles professionnelles : l’essor des métiers du tertiaire s’est accompagné d’une relative stabilité des métiers du bâtiment, d’une forte baisse des métiers de l’agriculture et d’un repli des métiers industriels.
Depuis le début des années 1980, les effectifs des métiers industriels ont en effet diminué continûment, à l’exception de la fin des années 1990, et plus fortement pendant la crise récente.
En moyenne entre 2010 et 2012, 3,2 millions de personnes exerçaient ces métiers, ce qui représentait 12 % des emplois, contre 18 % au début des années 1980. En près de trente ans, les métiers industriels ont enregistré une perte globale de près de 800 000 emplois (soit une chute de 20 %).
La baisse de l’emploi a été particulièrement prononcée dans les domaines des matériaux souples, bois, industries graphiques (-465 000 emplois, soit une réduction de 60 % entre les années 1982-1984 et 2010-2012), ainsi que dans la mécanique et le travail des métaux (-442 000 emplois, soit -35 % sur la même période). La concurrence des pays à bas coûts salariaux, les innovations technologiques et l’automatisation des procédés, qui ont permis des gains de productivité importants, expliquent notamment ces évolutions. La diminution des emplois a été un peu moins marquée dans les métiers de l’électricité-électronique (-93 000, soit -29 %) et dans ceux des industries de process (-109 000, soit -12 %). À l’inverse, les métiers de la maintenance (+164 000, soit +25 %) ont progressé et le domaine professionnel des ingénieurs et cadres de l’industrie s’est très fortement développé (+148 000, soit +141 %).
Ces évolutions de l’emploi industriel se sont en effet accompagnées d’une importante hausse du niveau de qualification. La part des professions les plus qualifiées s’est accrue continûment sur les trente dernières années, passant pour les cadres de 3 à 8 % des métiers industriels et d’un quart à un tiers pour les techniciens et agents de maîtrise. Dans le même temps, la proportion d’ouvriers peu qualifiés s’est réduite de moitié, malgré un rebond à la fin des années 1990 sous l’effet de mesures d’allègement de cotisations sociales sur les bas salaires notamment. La part des ouvriers qualifiés n’a que légèrement baissé mais c’est au sein de leurs effectifs que la baisse de l’emploi a été la plus sensible au cours de la crise récente. Au final, si l’industrie a perdu des emplois aux niveaux de qualification les plus bas, elle en a également créé aux niveaux les plus hauts.
Au cours des trente dernières années, 287 000 emplois correspondants à des métiers industriels ont été créés dans le secteur tertiaire. 42 % des métiers industriels sont désormais exercés au sein d’établissements non industriels, contre un quart au début des années 1980. Les établissements de l’industrie ont, quant à eux, perdu près d’1,6 million d’emplois, dont 1,1 million d’emplois dans des métiers industriels.
À l’horizon 2020222, les ingénieurs et cadres techniques de l’industrie devraient bénéficier de perspectives d’emploi favorables, portées par le développement de nouvelles technologies, des efforts en matière de recherche-développement et la bonne tenue de secteurs à fort contenu technologique. Dans d’autres métiers ouvriers de la mécanique, de l’électricité, du textile, des industries graphiques), l’emploi devrait continuer à se replier, à un rythme toutefois inférieur aux tendances observées dans les années 2000, tandis que les professions intermédiaires devraient bénéficier d’une dynamique d’emploi plus favorable que celle des ouvriers.
- 22. Ces éléments sont tirés de travaux sur la prospective des métiers et qualifications à l’horizon 2020, réalisés en 2012 par le CAS et la DARES, qui feront prochainement l’objet d’une actualisation tenant compte des dernières évolutions du contexte macroéconomique.
VOLET 1 – Rendre l’industrie et ses métiers attractifs auprès des jeunes et de leurs prescripteurs
De très nombreuses contributions au débat et experts interrogés ont abordé la question de l’attractivité de l’industrie, de ses métiers et des formations qui y mènent. Celle-ci apparaît en effet comme une cause majeure des difficultés de recrutement des industriels. Il s’agit d’un constat connu, mais sa persistance interroge, alors que de nombreux efforts sont menés pour montrer que l’industrie a largement évolué au cours des dernières décennies.
Pourquoi cette désaffection de l’industrie de la part des jeunes et du grand public persiste-t-elle donc ?
Quelles sont les responsabilités des différents acteurs (Éducation nationale, industriels, personnels de l’orientation, parents, etc.) ?
Il est régulièrement fait état de la méfiance réciproque entre le monde de l’éducation et celui de l’entreprise.
Il faut néanmoins souligner une évolution positive de part et d’autre en la matière depuis une dizaine d’années.
De nombreuses pratiques intéressantes sont également mises en œuvre par l’ensemble des acteurs ; celles-ci méritent d’être encouragées et développées.
Des formations sous statut scolaire qui peinent à attirer les jeunes
A. L’image de l’industrie et de ses métiers pèse sur l’attractivité du secteur
Un consensus se dégage des contributions reçues : les difficultés de recrutement rencontrées par les industriels s’expliquent avant tout par un problème d’attractivité du secteur. En conséquence, les filières de
formation professionnelle et technologique souffrent d’une désaffection. Selon la Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP), les effectifs des lycées professionnels s’inscrivent en recul depuis de nombreuses années (-9,2 % entre 2005 et 2012), y compris dans les spécialités industrielles (-5,2 % sur la même période). En 2012 en France, 13,5 % des élèves du secondaire suivaient une filière professionnelle dans une spécialité industrielle. Moins de 5 % d’entre eux étaient en apprentissage contre plus des deux tiers en Suisse, en Autriche, en Allemagne.23
D’après Philippe Akli, responsable du CIO de Caen, « une grande partie du problème, du point de vue de l’adolescent, est son système de représentations. L’image de l’industrie qui domine est une image qui tient plus de Zola que de la réalité. Elle renvoie au stéréotype de cette ‘belle époque’ du XIXe qui flotte dans
le cerveau dès que l’on parle d’industrie, à savoir, un hangar crénelé avec une grande cheminée… ».
Les témoignages convergent par ailleurs pour mettre en exergue le rôle des médias dans la dégradation de l’image de l’industrie, à mesure qu’ils relaient massivement les délocalisations, les fermetures d’entreprises, les rachats par des étrangers, les mouvements sociaux, etc. Ainsi, selon une enquête de l’Ifop pour l’institut Lilly24 réalisée en novembre 2013, les préjugés liés à l’industrie restent tenaces chez les jeunes : on retrouve parmi les qualificatifs que lui associent les 18-25 ans les mots « travail à la chaîne » (85 %), « pénibilité » (81 %), « saleté » (55 %), etc. Seulement 48 % des jeunes interrogés se voient ainsi travailler dans l’industrie contre 72 % dans le secteur des services.
Ce sont les collégiens de 15 ans qui ont l’image la plus négative de l’industrie. D’après un sondage de l’Association française pour le développement de l’enseignement et de la formation technique (Afdet) et LeCanaldesMetiers.tv25 publié en janvier 2013, ils sont plus de 40 % à associer les termes « ouvrier » et « employé » aux métiers industriels. En conséquence, ils sont seulement 14 % à envisager de s’orienter vers une formation conduisant à un métier industriel, et 11 % à vouloir exercer un métier industriel.
B. Un système d’orientation peu favorable à l’enseignement professionnel
L’industrie et les formations menant à des métiers industriels souffrent d’un déficit de promotion important de la part des acteurs de l’orientation, qu’il s’agisse des conseillers d’orientation-psychologues (COP) de l’Éducation nationale, du corps enseignant, des conseillers emploi des missions locales mais aussi et surtout des familles.
Selon Pascal Huard, responsable d’animation et de projets à la maison familiale et rurale de Gironde,
« les institutions, tout comme les parents, ont tendance à sacraliser l’enseignement général et théorique au détriment des formations professionnelles ». Lionel Pinard, proviseur au lycée des métiers Galilée à Gennevilliers, relève également qu’« en grande majorité, les élèves de collège qui n’ont pas les compétences pour accéder à une filière générale vont choisir une formation qualifiante en fonction d’une demande sociale. Ils sont ainsi nombreux à s’orienter vers un Bac pro commerce ou administration parce que pour eux, c’est encore le fantasme du ‘col blanc’. Aujourd’hui, nous avons au sein de notre lycée une formation en plasturgie, après laquelle les élèves sont assurés de trouver un emploi. Pourtant, cette section ne se remplit pas. »
Les orientations vers ces filières professionnelles sont par ailleurs souvent subies. Les formations aux métiers les plus spécialisés ne sont proposées que dans quelques établissements, quand les formations générales sont offertes sur tout le territoire. Une solution évoquée est l’augmentation du nombre d’internats de lycées professionnels. Mais, selon M. Pinard, « le parcours des jeunes de premier niveau de qualification (CAP, Bac pro) se déroule avant tout au niveau local : ils sont très peu mobiles. » À cela il faut ajouter selon Pascal Huard que « l’enseignement professionnel prend souvent en charge les enfants dont les résultats et parfois l’attitude sont considérés comme incompatibles avec les exigences du lycée général et technologique. »
Au final, tout cela participe à la dévalorisation de ces filières.
En outre, des représentations erronées des métiers industriels (conditions de travail, niveau de rémunération, etc.) sont encore aujourd’hui véhiculées par une partie des acteurs de l’orientation. Selon Michel Tibier, directeur général d’Entreprendre ensemble, « il s’agit surtout d’une méconnaissance. Il faut bien avouer qu’il est difficile de faire la promotion d’un secteur que l’on ne connaît pas, et ce d’autant plus qu’il a beaucoup évolué et continue d’évoluer. »
La méconnaissance de l’industrie et plus globalement de l’entreprise influe sur les orientations et la perception des filières professionnelles. Comment un jeune qui sort de troisième ou de seconde peut-il choisir une voie professionnelle précise, qui déterminera sa carrière, s’il n’a pas été informé pendant sa scolarité de ce qu’est le monde de l’entreprise ? Aujourd’hui, peu d’entre eux savent par exemple que l’évolution de l’organisation du travail a eu pour effet une diversification et une sophistication des tâches dans de nombreuses industries (machines très perfectionnées, logiciels adaptés, etc.) et que le secteur propose souvent des salaires d’embauche plutôt attractifs.
Un vrai travail de sensibilisation au monde de l’entreprise reste donc à faire auprès de ces acteurs, mais également auprès des professeurs de collège et de lycée. Un sondage mené par OpinionWay en novembre 2013 indique en effet que pour 62 % des enseignants du second degré (toutes matières et statuts confondus : certifiés, agrégés, etc.), l’entreprise est considérée comme un « lieu d’exploitation. »26 Les enseignants en lycée professionnel sont unanimes : ce sondage ne reflète pas leur perception. Ils rappellent que les lycées professionnels ont profondément évolué dans leurs rapports avec l’entreprise : les formations et les diplômes sont conçus en commissions paritaires (Éducation nationale et employeurs), les représentants du monde économique sont, depuis longtemps, associés à la rénovation régulière des programmes et sont présents dans les jurys de certains diplômes. En outre, la généralisation de l’alternance via des stages d’une durée de 22 semaines pour un élève préparant un baccalauréat professionnel, 16 semaines pour un élève de CAP, implique également que l’entreprise joue un rôle majeur dans l’évaluation de la formation pratique, en vue de la délivrance du diplôme.
- 23. DEPP, 2013.
- 24. Ifop, 2013.
- 25. AFDET, LeCanaldesMetiers.tv, 2013.
- 26. OpinionWay, 2013.
Changer la perception des prescripteurs et des jeunes sur les formations professionnelles
A. Valoriser le travail et les métiers industriels
Pour Brigitte Bastard, responsable du CACEMI27 et ex-professeur de lycée professionnel, il convient de mettre fin à l’opposition entre le « travail manuel » et le « travail intellectuel » afin d’agir sur les représentations des acteurs de l’orientation scolaire. « Il y a, dans cette représentation persistante que le travail manuel engage seulement la main et non l’esprit, une des sources importantes de la dévalorisation dont souffre le travail industriel. La façon dont on va saisir et manier l’outil, qu’il soit préhensible matériellement (comme le marteau ou la gouge, ou la machine-outil) ou applicable méthodologiquement (comme la conduite de projet ou l’animation de réunion) est d’abord un acte intellectuel au cours duquel une analyse de la situation est réalisée, un diagnostic est posé, un choix de solutions est opéré. » Il faut donc « valoriser le fait que tout travail est d’abord, de façon incontournable, un travail intellectuel. »
Dans la même logique, de nombreux témoignages relèvent que, fréquemment, les titres des diplômes tout comme les dénominations traditionnelles des métiers ne mettent également pas assez en valeur leur diversité et leur richesse. Yves Lichtenberger, chercheur au Laboratoire techniques, territoires et sociétés (LATTS) note à ce titre que « les emplois industriels apparaissent comme correspondants à des modes de travail très prescrits laissant peu de place à l’initiative (…). » Monique Fournier-Laurent, bénévole à la mission locale de la vallée de l’Oise et membre du GR2128, ajoute que « les jeunes sont influencés par la ‘génération du tertiaire’ qui sous-estime l’industrie et par conséquent les formations scientifiques et techniques. Non ou mal informés, ils s’orientent, avec leurs seuls préjugés, vers le secteur des services. »
Alain Roumilhac, président de ManpowerGroup France, estime qu’il faut aujourd’hui montrer « combien l’industrie a changé, combien tous les métiers qui la composent sont ‘montés en gamme’, se sont numérisés et sont aujourd’hui étroitement imbriqués avec tous les services qui la font vivre. » Il faut notamment en finir avec les « dénominations aussi désuètes que ‘chaudronnier’, ‘tourneur-fraiseur’, ‘usineur’ ou ’tuyauteur’ (…)
C’est quoi, un chaudronnier, aujourd’hui ? C’est notamment quelqu’un qui modélise des pièces en 3D sur ordinateur… Un tourneur industriel ? C’est un technicien de haute précision qui façonne des pièces de métal nécessaires à la construction mécanique, à l’aide d’un tour à commande numérique en général. Un fraiseur industriel ? C’est un spécialiste des opérations d’usinage de pièces, qui utilise lui aussi de plus en plus souvent une machine à commande numérique. (…) Il est temps que le chaudronnier devienne un ‘modélisateur métallurgique’ et le tourneur un ‘façonneur expert FAO29’ si nous voulons développer et attirer les jeunes talents nécessaires au redressement productif français. »
B. Décloisonner les formations professionnelles et offrir de réelles perspectives d’évolution
Les formations professionnelles sont vécues comme encore « trop cloisonnées », rendant très difficile les réorientations et les évolutions vers d’autres diplômes. La formation initiale est jugée « trop déterminante ». De ce fait, selon Yves Lichtenberger, « le véritable choix se pose entre poursuite d’étude pour accéder à un emploi plus valorisé, et renoncement à une carrière. Comment s’étonner dans ces conditions que des jeunes et leurs familles s’accrochent à tout prix à des formations générales même sans appétit ni chance d’y réussir. »
Une des voies d’amélioration serait de mettre fin à une forme d’irréversibilité du choix d’orientation qui joue sur l’attractivité de ces formations. Jean-Pierre Collignon, inspecteur général de l’Éducation nationale, indique que « la rénovation de la voie professionnelle et la réforme du lycée d’enseignement général et technologique ont conjointement affiché un objectif de développer des ‘parcours de formation personnalisés et individualisés’ permettant des passages entre la voie générale et technologique et la voie professionnelle mais également entre les différents niveaux de diplômes professionnels et entre le statut scolaire et celui d’apprenti. »
Il ajoute que « cette approche sous forme de parcours utilisant des passerelles, permet d’envisager un continuum de la formation professionnelle du niveau V à la licence professionnelle et de ‘gommer’ la frontière entre formation secondaire et formation supérieure. » Il admet cependant que « les passerelles continuent à fonctionner essentiellement à sens unique, de la voie générale vers la voie professionnelle. (…) Il y a encore actuellement une certaine frilosité à sortir des sentiers battus alors qu’il n’existe que peu de freins réglementaires. »
Par ailleurs, Yves Lichtenberger relève que, dans les entreprises, « les postes sont réputés figés et trop souvent pourvus par des recrutements externes, à niveau de formation initiale correspondant, tuant donc les possibilités d’évolutions internes. » Les insuffisances actuelles de l’offre de formation tout au long de la vie30 poussent les enseignants à encourager les élèves à acquérir dès leur formation initiale un maximum de compétences générales, qui faciliteront la poursuite de leurs études. Le choix de commencer par développer des habiletés pratiques permettant d’exercer rapidement un métier qualifié est en effet risqué si l’on a peu de possibilités de poursuivre ultérieurement sa formation.
- 27. Centre spécialisé de formation dans le domaine des matériaux industriels au Conservatoire national des arts et métiers.
- 28. Le groupe de réflexion sur le XXIe siècle (GR21) est un collectif de citoyens bénévoles dont l’action vise à l’insertion sociale des jeunes, notamment par la lutte contre l’échec scolaire.
- 29. FAO : fabrication assistée par ordinateur.
- 30. Ce point sera approfondi dans le Volet 3.
Rapprocher l’école de l’entreprise
A. Adapter le contenu des formations et la pédagogie aux besoins des industriels
Selon un sondage réalisé par OpinionWay31, 57 % des entreprises considèrent que le système éducatif n’est pas apte à former les profils recherchés. Outre le foisonnement des titres de diplômes qui nuit à la lisibilité de l’offre globale de formation, c’est également le contenu des enseignements qui est remis en cause par de nombreux industriels. Selon Olivier Fahy, PDG de la PMI Berkem, (extraction végétale), « le système d’enseignement français manque cruellement de pragmatisme et d’exemples dans le concret. » George Jobard, président de l’ETI Clextral (spécialisée dans l’extrusion bivis) ajoute de son côté que « les connaissances et compétences souvent trop généralistes, pas assez spécialisées » des jeunes diplômés « limitent directement leur employabilité à l’embauche ».
Paul Santelmann, directeur de la veille pédagogique de l’AFPA, relève toutefois que « les demandes des entreprises sont parfois paradoxales puisque, si elles critiquent le manque de spécialisation sur un métier précis, elles sont aussi soucieuses de disposer d’une main d’œuvre qualifiée ayant de bonnes connaissances générales permettant d’évoluer et de s’adapter aux mutations de leur environnement. Le recrutement ne se fait d’ailleurs pas sur la spécialité de leur diplôme mais sur leur niveau. » Selon Lionel Pinard, « on ne doit pas spécialiser l’enseignement professionnel à une entreprise. Nous formons les élèves pour qu’ils soient capables d’identifier des dysfonctionnements sur un processus de fabrication et d’y remédier et moins pour qu’ils sachent piloter une machine particulière. Notre objectif est de leur donner un cadre, c’est ensuite à eux de s’adapter. Au départ, il est tout à fait normal que l’élève ne soit pas opérationnel dès le lendemain de son embauche, c’est le principe de l’inexpérience professionnelle. » De nombreux proviseurs de lycées professionnels s’inquiètent en outre de la faible implication de certains industriels dans la gouvernance de leurs établissements, alors que des places leurs sont attribuées dans les conseils d’administration. Ils souhaitent également que les entreprises s’engagent davantage en tant que partenaires des formations en alternance.
André Gauron s’interroge, quant à lui, sur le rôle des représentants des industriels dans le processus d’élaboration des référentiels de formation. « Une place importante leur est réservée au sein des commissions professionnelles consultatives (CPC), chargées de donner un avis sur les besoins en formation, leur contenu et sur les certifications32. Cependant, compte tenu de la lourdeur des travaux, les organisations professionnelles, patronales ou syndicales, délèguent des permanents plutôt que des industriels et des salariés. Tout l’enjeu repose dès lors sur la capacité de ces derniers à être en prise avec les réalités du terrain pour définir des
formations initiales adéquates. »
Sur la question de la méthode pédagogique développée, il n’en demeure pas moins qu’en voulant enseigner avant tout par la formalisation et le concept, au détriment de la pratique ou de l’expérimentation encadrée par un tuteur, on réduit sensiblement le nombre de ceux qui sont capables de s’approprier l’enseignement et on décourage les autres.
Pour surmonter ces difficultés, certains enseignants mettent en œuvre des pédagogies qui encouragent l’exploration et l’initiative, valorisent la découverte, proposent des travaux collectifs, permettent à l’élève de prendre conscience de ses aptitudes (et pas uniquement de ses faiblesses), renforcent l’estime de soi et lui donnent confiance. Un rapport de l’Académie des technologies33 note ainsi que des méthodes pédagogiques sensibilisant les élèves au travail en mode projet peuvent permettre de leur faire « découvrir l’importance de la rigueur et de la coopération » et de les « éveiller à la conception de procédures efficaces économisant temps et ressources (lean) ». La valorisation de toutes les formes de compétence et d’habileté facilite l’entrée rapide de l’élève dans le monde du travail et lui donne suffisamment confiance en lui pour saisir ultérieurement la possibilité d’acquérir d’autres connaissances et compétences.
On note que ces innovations pédagogiques sont davantage mises en œuvre dans l’enseignement professionnel que dans les formations générales34, mais elles doivent encore se développer. Aziz Jellab, sociologue et chercheur à l’université Lille III, rappelle ainsi que « face à des élèves qui restent réticents à l’enseignement théorique, les enseignants en lycée professionnel doivent repenser leurs pratiques, incarner les concepts abstraits dans le concret, trouver des ruses pédagogiques pour intéresser leurs élèves. »35
B. Développer la formation des enseignants et des personnels d’orientation sur les métiers industriels et l’environnement économique des entreprises
La formation des enseignants et des personnels d’orientation est souvent citée comme un facteur à l’origine de la méconnaissance de l’industrie et plus globalement de l’entreprise.
Les professeurs de lycées professionnels (PLP) ont pour mission de former les élèves à l’acquisition de savoirs et de compétences en lien avec le monde des entreprises. Or, les plus jeunes d’entre eux n’ont pas toujours été amenés à être en contact rapproché avec le milieu professionnel au cours de leur propre formation.
Selon Aziz Jellab, « s’il existe encore des professeurs de lycées professionnels recrutés parmi d’anciens professionnels de l’industrie – anciens ingénieurs et surtout anciens techniciens (il n’y a d’ailleurs pratiquement plus d’anciens ouvriers parmi les nouvelles générations) – la majorité des enseignants de lycées professionnels sont issus de l’enseignement supérieur et n’ont, au mieux, connu l’entreprise qu’à travers des stages (c’est le cas pour ceux qui ont préparé un DUT ou un BTS). Ils effectuent toutefois des visites de stage en vue d’assurer le suivi de leurs élèves lors des périodes de formation en milieu professionnel (PFMP). »
La formation des futurs professeurs de lycée professionnel constitue un enjeu important : avec la mastérisation, le processus de recrutement et de formation des enseignants veille non seulement à ce qu’ils acquièrent des compétences disciplinaires et professionnelles pour enseigner, mais aussi à ce que leur savoir-faire donne toute leur place aux apprentissages que les élèves doivent effectuer au contact des milieux professionnels. À cet égard, plusieurs experts interrogés estiment que, « bien que les CPC constituent un terrain privilégié pour une synergie entre professionnels des entreprises et l’institution scolaire, une plus forte incitation des enseignants à ‘se mettre à jour’ des besoins économiques et des attentes des employeurs est à mettre en œuvre. »
Du coté des conseillers d’orientation, Jean-Pierre Bellier, inspecteur général de l’Éducation nationale, rappelle que « le système d’orientation s’est construit de façon concomitante à l’émergence de la psychologie du travail. D’une certaine façon, elle a longtemps été déconnectée de la sphère productive : le rôle des orienteurs se limitait à délivrer des certificats garantissant qu’un jeune était apte à entrer dans la vie active. Aujourd’hui, le rôle du conseiller d’orientation-psychologue (COP) est d’informer et de conseiller les lycéens et leurs familles sur toutes les questions relatives à l’orientation, aux enseignements, aux professions. Le recrutement des COP a récemment évolué afin notamment de mieux répondre aux attentes du monde professionnel. À titre d’exemple, outre le diplôme en psychologie requis pour se présenter au concours, les candidats doivent réussir une épreuve d’économie appliquée qui a pour objet de détecter ceux d’entre eux en capacité de s’approprier et de transmettre une culture économique aux jeunes qu’ils vont rencontrer dans le cadre de leur activité professionnelle. »
C. Faciliter le dialogue entre le monde de l’entreprise et celui de l’école
Jean Arthuis, sénateur de la Mayenne, rappelle qu’il est « impératif de faciliter le dialogue entre le monde de l’entreprise et celui de l’école qui, bien souvent, affichent des postures de méfiance liées à une méconnaissance réciproque. » Comme lui, de nombreux contributeurs au débat mettent en avant la nécessité pour les industriels d’ouvrir davantage leurs portes. Monique Fournier-Laurent souligne ainsi que « ce sont les professionnels des entreprises qui sont les plus crédibles et les mieux armés pour parler des métiers et des entreprises, et pour donner aux jeunes l’envie de s’y intéresser. Au-delà de la visite d’usine, les professionnels peuvent également se rendre directement dans les classes afin de présenter leur métier aux élèves. C’est l’objet du dispositif ‘Conteur de métier’ mis en place par le GR21. Ces séances d’échange permettent d’éveiller la curiosité des jeunes sur le monde professionnel, de donner du sens au travail scolaire et d’offrir des repères pour l’orientation. » Reste que ces visites d’usines et ces présentations de métiers doivent être bien préparées en amont pour ne pas être contre-productives. Rappelons également qu’en ce qui concerne les visites d’usines, certaines entreprises peuvent se heurter à des obstacles réglementaires, comme l’interdiction pour les élèves de moins de 16 et parfois même de moins de 18 ans d’accéder aux ateliers.
- 31. Op. cit.
- 32. Ces commissions sont placées auprès du ministère de l’Éducation nationale.
- 33. Académie des technologies, 2014.
- 34. Coste S., 2010.
- 35. Interview du 14 mars 2011 dans la lettre de l’Éducation, Le Monde, n°696.
Témoignage d’Aziz Jellab, sociologue, shercheur à l’université Lille III
Le profil des professeurs de lycées professionnels
Les professeurs de lycée professionnel (PLP) constituent sans doute la catégorie la plus hétérogène au sein du corps enseignant, tant sur le plan de leur parcours que sur celui de la diversité des domaines couverts par leur enseignement. Ils sont davantage issus de milieux populaires que les autres enseignants du secondaire : 27,7 % d’entre eux proviennent d’un milieu ouvrier, contre 19,8 % pour les seconds. Il est fort probable que cette situation évolue dans les années à venir : l’élévation du niveau de recrutement au sein des Écoles supérieures du professorat et de l’éducation (ESPE) a de fortes chances de conduire à ce que les PLP soient davantage issus des milieux favorisés. En dépit de ces changements à venir, l’exercice du métier d’enseignant au sein des lycées profesionnels restera façonné par la spécificité de cet ordre d’enseignement qui reste moins valorisé que les autres filières du secondaire, même s’il est en passe de connaître une meilleure image avec la généralisation, en 2009, du baccalauréat professionnel en trois ans.
Certains PLP ont fait l’expérience d’une « entrée contrariée » dans le métier puisqu’ils se sont repliés sur le concours d’enseignant en lycée professionnel à défaut d’avoir réussi le CAPES ou le CAPET. Cela rapproche les enseignants de leurs élèves et marque en quelque sorte une rupture avec les enseignants des anciennes générations : alors que ces derniers partageaient avec leur public une proximité culturelle, où la socialisation professionnelle s’appuyait sur des valeurs ouvrières parce qu’eux-mêmes étaient d’anciens ouvriers ou techniciens de l’industrie, les PLP actuels vivent avec leurs élèves une proximité de condition, celle d’exercer et de vivre dans une institution en quête de reconnaissance. Ainsi, le défi à relever par ces enseignants – issus pour la majorité d’entre eux, de l’université ou de l’enseignement supérieur – est d’assurer la réussite de leurs élèves en mobilisant moins des références symboliques – la classe ouvrière, les valeurs collectives, la culture de classe – que des appuis plus pragmatiques, tels que l’utilité des études, la capacité à se projeter comme futur salarié accédant à la consommation et à une forme d’autonomie.
Évolution du nombre de PLP (y compris les stagiaires) en lycées et collèges publics
Source : DEPP, 2012
45 601 PLP exercent dans les filières d’enseignement professionnel. En enseignement général, les effectifs les plus importants concernent les lettres (10 086), les mathématiques (5 121), l’éducation physique et sportive
(2 710) et les métiers des arts appliqués (1 776). Dans l’enseignement technologique et professionnel des métiers tertiaires, les effectifs les plus importants concernent l’économie et gestion (7 291), le paramédical et social, les soins personnels (1 414) et dans une moindre mesure l’hôtellerie (631). S’agissant des métiers de la production, ce sont les effectifs du génie mécanique qui prédominent (3 793), suivis du génie industriel (2 786), du génie électrique (2 471) et du génie civil (1 561).
On note chez une partie des enseignants – même parmi ceux des filières et spécialités industrielles – une certaine méconnaissance de la vie en entreprise, des évolutions organisationnelles et managériales dans un univers économique en forte compétition. Cette méconnaissance ne tient pas tant à leur réticence vis-à-vis des milieux professionnels qu’à leur trajectoire scolaire.
Le développement de la formation continue pourrait assurer aux enseignants une meilleure connaissance des milieux professionnels mais aussi une meilleure articulation entre les compétences validées par les élèves et les stages que ces derniers effectuent en entreprise (22 semaines pour un élève préparant un baccalauréat professionnel, 16 semaines pour un élève de CAP). L’enjeu d’une connaissance plus précise des entreprises est d’autant plus crucial qu’à l’heure de la promotion de la formation tout au long de la vie, une part importante du parcours des élèves de lycée professionnel s’effectuera en milieu professionnel. En effet, les bacheliers professionnels sont de plus en plus nombreux à préparer un BTS. De ce fait, les entreprises ont tout à gagner à proposer aux enseignants un accueil plus volontariste, de manière à ce qu’un relai soit assuré auprès des élèves et de leurs parents.
Il ne s’agit pas de sacrifier la culture scolaire aux seuls besoins et attentes des entreprises, mais d’en faire tout autant un outil de formation intellectuelle que d’adaptation efficace aux changements techniques et industriels. (…) Les récentes observations que nous avons pu effectuer soulignent combien le lycée professionnel assure pour une majorité d’élèves une émancipation sociale, d’autant plus effective que les savoirs acquis et les compétences construites sont étayés sur une socialisation professionnelle qui les autorise à se penser comme étant capables de réussir scolairement et socialement36.
- 36. Jellab A., 2014.
Encadré 2. Qu’est-ce qu’une bonne visite d’usine ?
Publication :
Regarder et montrer l’industrie : la visite d’usine comme point de contact, mars 2013
Les visites d’usines représentent une occasion unique de faire tomber les préjugés qui peuvent exister à l’encontre de l’industrie. La Fabrique de l’industrie a donc confié un travail exploratoire sur les façons d’améliorer les visites d’usine à des jeunes élèves de l’École nationale supérieure de création industrielle (ENSCI-Les Ateliers). Grâce à l’appui de l’UIMM et de l’Aforp, le groupe d’apprentis-designers a pu visiter les sites franciliens d’Eurocopter, de Frantz Electrolyse, de Poclain Hydraulics et de l’Aforp. À partir de ces rencontres, ils ont formulé des propositions pour « repenser » la visite d’usine, à l’instar de travaux déjà menés par l’ENSCI sur la visite de musées. Il en est résulté un cahier d’expérimentation, publié et présenté par La Fabrique de l’industrie à l’occasion de la Semaine de l’industrie 2013.
Témoignages d’acteurs :
Annie Burnouf, professeur en seconde au lycée Aristide Briand d’Évreux
« L’échec d’une visite d’usine tient à très peu de choses. Nous avons par exemple été très déçus par une visite d’une PMI du secteur aéronautique. Cette dernière s’était inscrite sur le site du ministère pour ouvrir ses portes lors de la Semaine de l’industrie mais, en dépit de cette démarche proactive, nous avons tout de suite senti que la visite tombait à un mauvais moment. Nous avons été très mal accueillis (pas de mot d’accueil, pas d’interlocuteur défini). Or, l’accueil est décisif pour les élèves ; cela conditionne quasiment toute la visite. De plus, nous avons visité les ateliers guidés par un responsable dont la voix était couverte par le bruit des machines. Le groupe étant constitué de deux classes, autant dire que très peu d’élèves ont pu entendre ce qui se disait.
Une bonne visite d’usine, selon moi, se résume en trois temps. D’abord, l’accueil est assuré par le chef d’entreprise, par exemple, et comprend une description du parcours de la visite. Ensuite, la classe est séparée en deux groupes : le premier visite les bureaux, l‘autre les ateliers. Cela facilite les échanges avec les salariés. Dans un troisième temps, on revient dans une salle où nous est présentée une synthèse de la visite. Elle permet de poser des questions sur l’entreprise, sa stratégie, ses objectifs, etc. Enfin, de retour au lycée, les élèves préparent un dossier sur ce qu’ils ont retenu de l’entreprise et de ses métiers. »
Marc Van Der Heijde, responsable sécurité-environnement, et Robert Charreyron,
DRH chez Clextral
Une bonne visite d’usine s’organise, selon nous, en suivant ces cinq points.
1. Une organisation interne en amont : il s’agit de définir qui prend en charge le groupe. Ce doit être une personne motivée et « volontaire » avec un minimum de culture générale technico-process.
Il faut également informer la hiérarchie et les responsables des zones visitées. L’objectif est de montrer au groupe que la visite est préparée et attendue.
2. Donner un cadre de la visite avant de démarrer : objectifs de ces portes ouvertes mais aussi consignes de sécurité et de confidentialité concernant en particulier les photos.
3. Impliquer le personnel travaillant qui est vu lors de la visite : lorsque l’on rencontre un salarié, il faut le présenter et l’interroger. Par exemple : « Voici Bruno qui est dessinateur CAO… Bruno, peux-tu nous expliquer s’il-te-plait en deux mots ce que tu fais actuellement ? »
4. Donner une image du monde du travail d’aujourd’hui en veillant à trouver dans le discours un équilibre pour montrer concrètement la vie en entreprise : il y a du bruit, ça sent l’huile de coupe, etc. mais l’entreprise porte aussi des valeurs : fierté des fruits de son travail, climat de travail agréable, effort de propreté, sécurité, etc. Le guide doit dire la vérité, rester modeste et non pas
affirmer « nous sommes les meilleurs ». En résumé, tenir un discours qui permet d’établir une relation
de confiance/transparence. Tout ceci est primordial car l’image de la société véhiculée en dépend.
5. Susciter l’envie de poser des questions pour rendre la visite encore plus intéressante
La richesse des initiatives visant à rendre l’industrie plus attractive
Les discours négatifs et redondants sur l’image de l’industrie et ses métiers ainsi que sur le manque d’interaction entre l’école et l’entreprise masquent de nombreuses initiatives visant à rendre l’industrie plus attractive. De nombreux acteurs s’investissent en effet dans la mise en place de dispositifs à destination des jeunes, des prescripteurs, des industriels eux-mêmes.
Il nous semble important de diffuser ces « bonnes pratiques » et les expérimentations réussies. En gagnant en visibilité, elles peuvent créer des effets d’entraînement sur le terrain et relativiser un discours pessimiste, peu moteur pour l’ensemble des acteurs.
Sommaire des fiches
Fondation Croissance responsable : proposer des stages en entreprise de trois jours notamment aux enseignants de collèges et lycées
Classe en entreprise : un concept innovant pour faire découvrir aux jeunes les métiers de l’industrie
Pro Pulsion Tour : sensibiliser des lycéens et collégiens aux réalités de l’industrie et de ses métiers
Le PIODMEP : intégrer la découverte des métiers aux enseignements de collège et de lycée
Le lycée des métiers Galilée de Gennevilliers : une approche pédagogique innovante qui porte ce pôle d’excellence
Fondation Croissance responsable
Proposer des stages en entreprise de trois jours notamment aux enseignants de collèges et lycées
Entretien avec Christian Poyau, président de la Fondation Croissance responsable et PDG de Micropole.
1. Pourriez-vous présenter en quelques mots la Fondation Croissance responsable ainsi que ses missions ?
Placée sous l’égide de l’Institut de France, la Fondation Croissance responsable, créée en 2010 par d’anciens présidents de l’association Croissance Plus, rassemble des dirigeants d’entreprises de toutes tailles, des représentants de l’entrepreneuriat social, du monde syndical, de l’université, du journalisme et de la recherche économique. Apolitique, la Fondation a pour objectif de faire de la pédagogie auprès du grand public sur l’économie de marché et en particulier d’œuvrer au rapprochement entre le monde de l’éducation et celui de l’entreprise.
Notre action se décline en deux volets. D’une part, nous organisons chaque année des évènements donnant lieu à la production de publications et d’outils pédagogiques sur des thématiques économiques et sociales (l’ascenseur social, la mondialisation, la finance responsable, etc.), en partenariat avec des lycées et BTS. D’autre part, nous proposons des stages en entreprise de trois jours aux enseignants de collège et lycée ainsi qu’aux conseillers d’orientation, afin de renforcer le dialogue permanent nécessaire entre ces deux mondes. Ce programme intitulé « Prof en entreprise » est mis en œuvre par la Fondation depuis avril 2012, en partenariat avec les académies d’Île-de-France et le ministère de l’Éducation nationale.
2. La méconnaissance du monde économique de la part des enseignants est régulièrement critiquée. Comment les stages de professeurs en entreprise peuvent-ils aider à surmonter cet obstacle ?
Peu d’enseignants ont en effet l’opportunité d’être accueillis dans une entreprise, que ce soit lors de leurs études ou dans la suite de leur carrière. Il leur est donc difficile de parler de ce qu’ils ne connaissent pas. Comment expliquer à ses élèves l’organisation d’une entreprise, les métiers que l’on peut y trouver, les compétences demandées, etc. ?
C’est la raison pour laquelle la Fondation a mis en place ces stages de découverte de trois jours. Cette expérience concrète favorise le dialogue et l’échange, afin de faire tomber les appréhensions et les idées fausses existant de part et d’autre. C’est également une opportunité pour les enseignants de mieux comprendre le fonctionnement interne d’une entreprise, de voir la palette des différents métiers représentés, d’échanger sur les parcours professionnels de chacun, d’appréhender les compétences requises au-delà des diplômes, d’observer le savoir-être nécessaire à la vie en entreprise… Ils se créent enfin un réseau utile, pouvant déboucher sur des initiatives multiples : intervention du chef d’entreprise ou d’un collaborateur en classe, aide à un élève de troisième pour trouver un stage, visite de l’entreprise par la classe, etc.
Ces trois journées d’immersion en entreprise doivent permettre à l’enseignant de se sentir plus en confiance pour guider et accompagner les élèves dans leur choix d’orientation et leurs ambitions professionnelles, ce qui favorisera de facto une meilleure insertion de ces derniers sur le marché de l’emploi.
Nous proposons deux sessions de stage par an, au printemps et à l’automne. En un peu plus d’un an d’existence, le dispositif « Prof en entreprise » a déjà permis à près de 200 enseignants des trois académies d’Île-de-France de faire un stage. Les enseignants concernés sont en général les professeurs de troisième, toutes matières confondues, et particulièrement ceux qui ont en charge l’option DP3 (découverte professionnelle 3h, en classe de troisième) en plus de leur matière principale. Ce sont également des professeurs de seconde générale ou technologique, qui ont maintenant un temps dédié à l’accompagnement personnalisé de l’élève, notamment pour l’aider à construire son projet professionnel. Et ce sont enfin les conseillers d’orientation.
Le stage se déroule sur quatre jours, non consécutifs : une matinée de sensibilisation au monde économique et à l’entreprise, en début de session et en groupe, puis trois jours d’immersion en entreprise pour chaque enseignant (consécutifs ou étalés sur plusieurs semaines) et, en fin de session, une demi-journée en groupe de retour d’expérience.
3. Quels sont les facteurs de succès et les principales difficultés que vous rencontrez à la mise en œuvre de ces actions ?
Quelles sont les réticences de part et d’autre ?
Les difficultés sont tout d’abord d’ordre pratique : il s’agit de stages individuels, la gestion au quotidien est donc un peu lourde. D’autant que, pour favoriser la réciprocité et les échanges ultérieurs entre la classe ou l’établissement de l’enseignant et l’entreprise, la proximité géographique est un atout. Or, nous avons par exemple dans les Hauts-de-Seine beaucoup d’entreprises mais plutôt moins de candidats que dans le Val-de-Marne, le Val d’Oise ou la Seine-et-Marne. Pour l’entreprise, la principale difficulté est de libérer du temps et de la disponibilité de nombreux collaborateurs, à des niveaux différents, pour répondre aux attentes de l’enseignant, organiser son accueil et faire coïncider des agendas déjà chargés.
Nous rencontrons aussi des difficultés plus structurelles. Ce stage est considéré à juste titre par les académies comme une période de formation continue, qui peut donc être effectuée sur les jours de cours. Pour limiter l’absentéisme, les dates de stage sont fixées de gré à gré avec l’entreprise et les trois jours d’immersion ne sont pas forcément consécutifs. Néanmoins, certains chefs d’établissement demeurent réticents et ne considèrent pas encore la formation continue comme un investissement nécessaire. Est-ce aussi la raison pour laquelle les Parisiens, très sollicités, sont moins intéressés ? Nous constatons en tout cas que nous avons beaucoup moins de candidats venant de la capitale.
Il faut encore certainement diffuser l’information sur ces stages, encore très récents, et sur l’importance pour les enseignants et les entreprises d’y participer. Beaucoup d’entreprises s’étonnent d’ailleurs que l’Éducation nationale n’en soit pas à l’origine et qu’un passage en entreprise ne soit pas prévu dans le cursus du futur enseignant.
Cela lèverait sans doute certains blocages, même si les esprits ont beaucoup mûri. Dans le même ordre d’idée, il serait important que la relation école-entreprise soit une priorité d’action dans toutes les académies. Là où c’est le cas, les candidats volontaires sont plus nombreux.
Classe en entreprise – BONNES PRATIQUES
Un concept innovant pour faire découvrir aux jeunes les métiers de l’industrie
Le dispositif « Classe en entreprise » a été lancé par la Fédération des industries électriques, électroniques et de communication (Fieec) en 2009. Avec le soutien de l’UIMM, il a été déployé au niveau national à l’occasion de la première édition de la Semaine de l’industrie, en 2011. Partant du constat que l’industrie n’attirait plus les jeunes en raison de son image dégradée, le dispositif a pour objectif de transplanter une classe de quatrième ou de troisième pendant trois jours au sein d’une entreprise industrielle, afin de faire découvrir aux élèves ses métiers et son fonctionnement.
Les professeurs se déplacent donc dans l’entreprise ; une salle de réunion est mise à leur disposition pour héberger la classe le temps des heures de cours, afin qu’elle ne prenne pas de retard sur le programme scolaire. L’emploi du temps est toutefois aménagé de manière à réserver plusieurs créneaux, d’une heure chacun, à la découverte des métiers. L’investissement de l’entreprise reste mesuré car il n’y a pas de préparation nécessaire en amont, chaque salarié présentant son métier en « conditions réelles ».
Les élèves, répartis en petits groupes et accompagnés d’un salarié, parcourent les différents services de l’entreprise et vont à la rencontre des professionnels (ouvriers, commerciaux…). Les jeunes observent d’abord en silence un salarié au travail. Ils discutent ensuite avec leur accompagnateur de ce qu’ils ont vu et essaient de deviner son métier. Dans un dernier temps, ils peuvent échanger avec le salarié.
Ces trois jours de découverte se concluent par la présentation à tous les participants – salariés et professeurs – d’un exposé préparé par les élèves. À travers ce travail, ils peuvent faire part de la nouvelle image qu’ils ont désormais de l’entreprise et de ses métiers, ainsi que de leurs impressions personnelles. Un professeur témoigne : « les élèves voient que, derrière le mot ‘entreprise’, il y a des hommes et des femmes et ça, ça va leur rester. » Pour Pierre Gattaz, président du Medef et de l’ETI Radiall, « les élèves peuvent voir des gens qui se tutoient entre ingénieurs et ouvriers et qui travaillent ensemble sur des projets pour Boeing ou pour l’exportation vers la Chine. » Camille Geargeoura, assistant pédagogique dans un collège ayant participé à l’opération, insiste sur le fait que « les élèves sont dans le concret ; cela les inspire et les rend ambitieux. Ils voient des possibilités d’avenir dont ils n’avaient même pas idée. » La visite a aussi un intérêt pour les enseignants car elle leur permet d’avoir un contact avec le monde de l’entreprise.
Le Pro Pulsion Tour, Sensibiliser des lycéens et collégiens aux réalités de l’industrie et de ses métiers – BONNES PRATIQUES
Témoignage de Christine Gallot, directeur de la communication de l’UIMM.
Initié en octobre 2011 par l’UIMM en partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale, le Pro Pulsion Tour a pour objectif de sensibiliser le public aux réalités de l’industrie et de ses métiers. Cette expérience ludique et pédagogique a pour ambition de donner envie, aux jeunes en particulier, de s’y intéresser. Deux caravanes, spécialement aménagées avec des contenus interactifs, permettent de sensibiliser les jeunes et leurs enseignants à la réalité de l’industrie et aux perspectives offertes par ce secteur, à travers des exemples concrets.
Le Pro Pulsion Tour s’articule autour de deux animations. La première est la découverte d’une Cité industrielle sur des écrans tactiles. Celle-ci prend la forme d’un univers virtuel présentant les principaux enjeux de l’industrie au quotidien : l’éco-conception, la mobilité, l’énergie, les communications, etc. La seconde est un jeu, « Drive for Success », permettant de découvrir en s’amusant les métiers des industries technologiques. Le but du jeu est de concevoir un véhicule, en faisant appel à des professionnels, puis de le piloter sur différents circuits. Plus le joueur gagne de points, plus les possibilités de course et de personnalisation du véhicule augmentent.
À cette occasion, les élèves, provenant de collèges et de lycées, peuvent échanger et poser leurs questions à des professionnels présents sur place.
Depuis le début de l’opération en 2011, la tournée a visité 134 villes et bassins d’emplois de France et près de 180 établissements scolaires. Plus de 29 000 élèves ont participé à l’expérience, accompagnés de près de 1 000 enseignants. 70 % de ceux qui connaissent le dispositif et 86 % de ceux qui y ont participé personnellement recommanderaient à leur entourage de se tourner vers les métiers de l’industrie.37
Plus qu’une opération ponctuelle, le Pro Pulsion Tour s’inscrit dans une campagne de communication destinée à faire évoluer l’image de l’industrie, menée par l’UIMM et son réseau de chambres syndicales sous la bannière : « Les industries technologiques : l’avenir, on y travaille. »
Plus d’informations sur www.les-industries-technologiques.fr
- 37. Évaluation des actions du programme de communication réalisée par OpinionWay en avril 2013.
Le parcours individuel d’information, d’orientation et de découverte du monde économique et professionnel (PIODMEP)
Intégrer la découverte des métiers aux enseignements de collège et de lycée
Le parcours individuel d’information, d’orientation et de découverte du monde économique et professionnel (PIODMEP) est un dispositif mis en place par le ministère de l’Éducation nationale depuis la rentrée 2013. Il succède au parcours de découverte des métiers et des formations (PDMF) qui avait été introduit dans les programmes officiels à partir de 2009. Il s’appuie sur un cahier des charges académique mais son pilotage associe de nombreux représentants du monde économique tels que des fédérations professionnelles partenaires, des représentants de grandes entreprises ou les chambres consulaires.
Son objectif est de permettre aux élèves d’élaborer progressivement leur projet professionnel grâce à l’acquisition de connaissances sur les métiers ainsi que les formations. Jean-Pierre Collignon souligne que « les dispositifs d’orientation se focalisent, aujourd’hui encore, sur quelques mois seulement en classe de troisième. Dans ces conditions il est très difficile pour un élève de faire un choix réfléchi. » Pour cette raison, le PIODMEP s’adresse à tous les élèves dès la classe de cinquième et jusqu’à la terminale, toutes filières confondues.
Au collège, il consiste à faire découvrir aux jeunes une palette de métiers et de formations afin de « développer leur compétence à s’orienter ».38 Il cherche également à donner du sens aux apprentissages en mettant en
évidence les applications qu’ils pourraient avoir dans le monde professionnel : les cours de
trigonométrie peuvent par exemple servir à mesurer la taille d’un bâtiment et cette séance peut être dédiée à la découverte du métier de géomètre. Le PIODMEP s’appuie notamment sur des dispositifs déjà existants tels que les modules de découverte professionnelle (DP3 et DP6).
Le collège Saint-Maur de Pau s’est par exemple lancé dans l’expérimentation de ce dernier dispositif depuis la rentrée 2011.
L’équipe enseignante lui reconnaît un réel intérêt, car il « aide les élèves à s’inscrire dans un climat propice aux apprentissages et à concevoir de manière plus concrète le monde professionnel. Ils commencent ainsi à se déterminer et à définir leur projet personnel. Reconnus à travers leurs capacités et leurs potentialités, évalués positivement, ils voient alors s’offrir à eux de nouvelles perspectives d’avenir. » Concrètement, la démarche consiste à mettre en place un emploi du temps aménagé : « les élèves suivent les enseignements classiques et élaborent en parallèle leur projet personnel. Celui-ci se construit par des approches complémentaires : interventions de professionnels extérieurs, connaissance de soi, recherche documentaire, rédaction de lettre de motivation et CV. Ces travaux théoriques s’articulent ensuite avec trois périodes de stage en entreprise, qui permettent aux élèves de confronter le projet qu’ils ont défini à la réalité des métiers et de l’entreprise. »
Au lycée, le PIODMEP vise à préparer la transition post-Bac – c’est-à-dire la poursuite d’études ou l’insertion professionnelle – par le biais notamment d’entretiens d’orientation personnalisés. Dorénavant, chaque élève de première aura également la possibilité de passer une journée dans un établissement de formation afin de découvrir les parcours qui y sont proposés.
De nombreux dispositifs sont donc proposés par l’Éducation nationale pour rapprocher l’école de l’entreprise et permettre aux jeunes de faire des choix d’orientation plus éclairés. Mais comme le souligne l’équipe éducative du collège Saint-Maur de Pau, « il faut assurer la promotion de tels projets innovants et favoriser leur inscription dans la durée. »
- 38. Rectorat/SAIO – Onisep.
Le lycée des métiers Galilée de Gennevilliers – BONNES PRATIQUES
Un pôle d’excellence, porteur d’une démarche pédagogique innovante
Entretien avec Lionel Pinard, proviseur du lycée Galilée.
1. Quelle est la particularité de votre établissement, labellisé « lycée des métiers » ?
Notre établissement est un lycée polyvalent qui accueille 930 élèves répartis en pré-Bac et post-Bac. Outre les baccalauréats S et ES, le lycée Galilée prépare les élèves aux baccalauréats technologiques (STL et STI2D) et dispose d’une voie professionnelle (CAP Plasturgie et composites et Bac pro Plasturgie). La carte des formations du post-Bac se compose d’un BTS Biotechnologies, d’un BTS Chimie, d’un BTS Europlastic et d’une classe préparatoire aux grandes écoles post-BTS Biotechnologies (ATS BIO).
Depuis septembre 2012, il est labellisé « lycée des métiers de la chimie et de la plasturgie ». Ce label reconnaît la cohérence de l’offre de formation, la prise en compte des attentes des élèves et un partenariat actif, tant avec le milieu économique (pour s’adapter aux besoins des employeurs) qu’avec les collectivités territoriales et en premier lieu la Région. Il constitue un indicateur d’excellence pour les voies technologique et professionnelle.
Par ailleurs, le lycée a été classé, en avril 2008, pôle d’excellence, sur proposition du recteur de l’académie de Versailles et de l’inspecteur d’académie des Hauts-de-Seine. Le fait d’être pôle d’excellence est un réel atout : cela permet par exemple au lycée de disposer de professeurs mis à disposition pour un an, qui ne sont donc pas en poste fixe, ce qui est une source d’économies importante.
Le lycée a donc de nombreux attraits mais cela nous contraint de refuser chaque année des inscriptions. Nous avons des filières technologiques qui sont porteuses, par exemple en biotechnologies, dans le domaine de la STI environnement durable, etc. Il faut aussi préciser que le lycée est implanté à Gennevilliers, où nous avons 75 % de catégories socioprofessionnelles largement défavorisées et 90 % de population d’origine étrangère. Ainsi, quel que soit leur Bac, le lycée est pour les élèves un vecteur d’intégration sociale.
2. Quels liens entretenez-vous avec les entreprises de votre territoire ?
Les entreprises participent à l’élaboration des programmes, elles accueillent des stagiaires dans le cadre des formations en alternance. Le tuteur de l’entreprise prend part à l’évaluation du stagiaire dans son contrôle continu. Elles prennent également part à des débats-conférences avec des élèves des filières STI et des sections de BTS.
Par ailleurs, nous mettons nos équipements à la disposition des entreprises de la région parisienne. Nous avons en effet la chance de disposer de laboratoires d’études ou d’analyses de faisabilité ou de tests à la pointe.
Outre la location de matériel ou d’installations, certaines sociétés souhaitent améliorer leurs processus de qualité ou de sécurité. Dans cette perspective, elles font appel à nous pour leur dispenser des formations. Notre labellisation nous conduit également à participer à la validation des acquis de l’expérience et donc à être en contact régulier avec des salariés.
3. On entend souvent dire que de nombreuses orientations dans les voies technologique et professionnelle sont subies. Comment surmonter ce phénomène ?
Les jeunes qui s’orientent dans la voie professionnelle n’ont souvent pas les compétences pour accéder à une filière générale. Après le collège, leurs choix d’orientation se font majoritairement en fonction de ce que font leurs amis. Il est également indéniable qu’une certaine « demande sociale » les amène à s’orienter davantage vers des Bac pro commerce ou administration plutôt que vers les filières industrielles. Ces dernières sont touchées par une réelle désaffection des jeunes. Nous peinons à remplir nos sections en plasturgie alors que, pour nos jeunes en CAP, nous avons huit propositions d’emploi pour cinq élèves, avec un salaire de 1 800 euros à la clef, dans des entreprises situées à moins de vingt minutes de Gennevilliers en transport.
Nous essayons d’enrayer cette désaffection en réalisant de nombreuses portes ouvertes et en communiquant très fortement auprès des élèves de collège. Nous mettons en avant nos machines et nos laboratoires de pointe, l’alternance et nos méthodes pédagogiques innovantes.
Dans notre établissement, à partir de la seconde, pour que les élèves s’orientent correctement vers un Bac technologique ou un Bac général, nous faisons en sorte que l’élève s’auto-évalue et s’auto-oriente. Cela signifie que toutes les évaluations ont une structure commune : un premier sujet est commun à tous les élèves et nous laissons le choix du second sujet aux élèves en fonction du type de Bac qu’ils souhaitent préparer. L’objectif est de leur montrer que les compétences attendues ne sont pas les mêmes en fonction de la filière choisie.
En opérant de la sorte, notre objectif est d’emmener nos élèves vers un Bac qu’ils auront choisi en fonction de leurs compétences et de leur sensibilité. Il faut rappeler que nous accueillons des élèves très fragiles à leur entrée en seconde, avec souvent un retard pris au collège. Jusqu’à présent, nous avons réussi à avoir un taux de redoublement conforme à ce que l’académie attend de nous, c’est-à-dire 15 % de redoublements avant orientation. Près d’un tiers de nos élèves s’oriente vers la voie générale et le reste vers celle technologique. Au final, nous obtenons 95 % de réussite pour le Bac technologique, 96 % en scientifique, et 100 % en ES.
Par ailleurs, dès la classe de seconde, les élèves qui se prédestinent à des filières industrielles (génie civil, génie énergétique) effectuent des visites en entreprise dans ces domaines de formation.
4. Avez-vous une approche pédagogique particulière ?
Nous avons la chance d’avoir des textes officiels qui nous permettent de faire des expérimentations pédagogiques. Au lycée Galilée, nous avons décidé d’adapter le rythme scolaire, en partant du principe que les élèves avaient trop de disciplines. Nous avons pour cela supprimé le deuxième enseignement d’exploration qui créait des classes de niveau et nous avons conservé notre seconde « d’indéterminés ». Nous nous sommes également aperçus que nos élèves n’avaient pas l’habitude de travailler le soir. Nous avons donc décidé de ne pas leur donner plus de trois disciplines par jour, ce qui implique que les jeunes n’ont pas plus de quarante-cinq minutes de travail à la maison.
Au niveau de l’emploi du temps, les journées commencent à chaque fois par un cours de deux heures en classe complète pour favoriser une phase de transmission du savoir, d’intégration du savoir et de vérification d’intégration du savoir. Le reste de la journée, les élèves ne sont qu’en demi-groupes. Et le soir à partir de 16 heures, ils ont une heure d’étude obligatoire en fonction des trois disciplines qu’ils ont eues dans la journée. Les professeurs décident de leur affectation en fonction de ce qu’ils n’ont pas compris.
Tout est prévu pour encadrer au maximum les élèves et mettre en place des accompagnements personnalisés. Le classement de notre lycée en pôle d’excellence est un véritable atout pour soutenir cette démarche. Il nous permet de bénéficier de moyens supplémentaires en termes de disponibilité des enseignants.
Nous avons ainsi mis deux professeurs principaux par classe de seconde ; chacun d’entre eux dispose d’une demi-journée libre dans l’emploi du temps, avec un cahier des charges précis à suivre en termes de sorties culturelles, de travail individuel sur l’orientation, de suivis d’élèves, etc.
À côté de cela, l’élève sait que, tous les mercredis après-midi et tous les samedis matin, il peut venir au lycée où il trouvera toujours des professeurs à sa disposition. Nous avons créé des lieux d’open space pour que les élèves puissent venir poser une question ponctuelle. Nous souhaitons avoir un lycée ouvert et que les élèves ne travaillent pas chez eux mais au lycée.
VOLET 2 -Donner des moyens concrets au développement de l’apprentissage
Le développement de l’apprentissage est devenu au fil des décennies une priorité portée par la quasi-totalité des gouvernements successifs. Malgré cela, les effectifs de ce dispositif de formation peinent à atteindre l’objectif de 500 000 fixé par les pouvoirs publics depuis de nombreuses années. Pire, on observe sur ces derniers mois une baisse inquiétante du nombre de signatures de contrats d’apprentissage.
Dans ce volet, nous cherchons à mieux comprendre les caractéristiques de ces formations et les raisons de leurs variations. Est-ce qu’il ne s’agit que de répondre à des besoins spécifiques à court terme des entreprises ou l’apprentissage présente-il d’autres types d’avantages ? Comment l’apprentissage se positionne-t-il par rapport aux lycées professionnels ? Quels sont les freins à son développement ? La Fabrique de l’industrie s’appuie sur les témoignages d’acteurs de terrain recueillis à l’occasion de la visite de deux centres d’apprentissage : l’Aforp et le CFI.
État des lieux de l’apprentissage en France
A. Lycée professionnel ou apprentissage : une complémentarité plus qu’une concurrence
L’enseignement professionnel en lycée et l’apprentissage39 sont deux filières de formation différentes, toutes deux accessibles aux élèves à l’issue du collège. Elles se retrouvent donc en quelque sorte en concurrence, à plus forte raison dans un contexte général où les formations menant à des métiers industriels peinent à attirer des candidats40. Cette concurrence est également renforcée par le fait que l’apprentissage occupe une place particulière au sein du système éducatif français : les deux systèmes n’étant pas gérés par les mêmes acteurs, chacun peut chercher à attirer le plus de candidats possible.
À l’inverse des lycées professionnels, l’apprentissage ne dépend en effet pas uniquement du ministère de l’Éducation nationale mais également de celui du Travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Un récent rapport de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS)41 indique que, en conséquence, « nombre de responsables ministériels considèrent [l’apprentissage] davantage comme un élément constitutif de la politique de l’emploi que de la politique éducative. » La gouvernance de la politique d’apprentissage regroupe en outre de nombreux acteurs extérieurs au monde de l’école tels que les branches professionnelles, les chambres consulaires, les entreprises, les conseils régionaux, etc.
La tendance actuelle est toutefois à l’intégration progressive de l’apprentissage au sein de l’Éducation nationale, notamment grâce au développement de la mixité des parcours et des publics. Les deux systèmes ne doivent pas être considérés comme concurrents mais plutôt comme complémentaires. Il ne s’agit pas d’uniformiser les approches pédagogiques qui, comme l’explique Sabine Coste, chercheuse à l’ENS-Lyon, « visent des objectifs différents en termes d’acquisition de savoir-faire et de compétences ».
Le lycée professionnel a pour objectif d’inculquer aux élèves des connaissances moins spécifiques, et donc plus « transférables », que l’apprentissage. Lionel Pinard, proviseur du lycée des métiers de Gennevilliers, relève que « ces capacités plus générales leurs permettent de valoriser leur formation à travers différents emplois et autorisent une mobilité plus forte. » Sabine Coste note par ailleurs que « le lycée professionnel peut représenter une solution plus sécurisante pour un élève, car il faut ‘oser’ se lancer en apprentissage, se confronter au monde du travail. »
L’apprentissage, pour sa part, a comme principal intérêt de permettre aux jeunes d’acquérir des compétences très proches des besoins d’un secteur ou d’une entreprise – les apprentis ont d’ailleurs le statut de salarié de l’entreprise. L’ancrage dans le monde du travail offert par les périodes d’alternance facilite ensuite leur insertion professionnelle42. Celle-ci est en effet bien meilleure, quantitativement et qualitativement, que celle des lycéens. En février 2012, ils étaient 68,8 % à être en emploi sept mois après la fin de leurs études, contre 47,8 % pour les élèves de lycée. De même, parmi les apprentis en emploi, 58,6 % étaient en CDI, contre 36,9 % chez les lycéens (cf. Graphique 2).
Graphique 2. Insertion professionnelle des jeunes, selon le type de formation
Source : DARES, 2013
Tout en soulignant l’intérêt des périodes d’alternance en entreprise, Jean-Luc Cenat, conseiller du président de l’Afdet relève toutefois que « la formation dispensée par le milieu professionnel n’est pas toujours satisfaisante, qu’elle soit sous statut scolaire ou non. Ce n’est pas parce qu’un jeune aura passé la moitié de l’année en entreprise que cette expérience lui sera forcément bénéfique. Il faut s’assurer que les missions qui lui sont confiées lui permettent de mettre en application ce qu’il a appris à l’école et que la qualité de l’accompagnement est à la hauteur. »
B. L’apprentissage se développe… mais insuffisamment dans l’industrie
Compte tenu de ses effets sur le chômage des jeunes, le développement de l’apprentissage constitue depuis de nombreuses années un enjeu prioritaire pour les pouvoirs publics. Au cours de la Conférence sociale qui s’est tenue les 20 et 21 juin 2013, le président de la République a fixé un objectif de 500 000 apprentis à atteindre d’ici la fin du quinquennat.
Les mesures encadrant le dispositif ont été profondément remaniées au cours des trois dernières décennies : amélioration du statut de l’apprenti, aides aux employeurs, transfert de nombreuses compétences aux
Régions, etc. Elles ont donné lieu à une forte croissance des effectifs d’apprentis depuis les années 1990. Mais cette croissance s’est accompagnée d’évolutions structurelles importantes qui n’ont ni profité à l’industrie, ni aux plus bas niveaux de qualification, qui sont pourtant les plus fragiles face au chômage.
Le développement de l’apprentissage est donc sujet à des tensions importantes. D’un côté, il doit répondre à la hausse des qualifications attendue par le monde économique. L’apprentissage a pour cela été étendu à l’enseignement supérieur à partir du début des années 1990, si bien que la progression des effectifs observée depuis est imputable à 68 % au développement des formations post-Bac (niveaux III, II et I) (cf. Graphique 3). Cette extension du système à l’enseignement supérieur représente par ailleurs une opportunité pour rapprocher l’université de l’entreprise et faciliter ainsi l’insertion professionnelle des étudiants. L’« universitarisation » de l’apprentissage s’accompagne d’une diffusion de l’alternance aux spécialités du secteur des services, en particulier pour les niveaux de diplômes les plus élevés (licence, master). Les formations du secteur tertiaire ont connu un développement dynamique, en progressant de 18,5 ٪ sur la période 2005-2012. Dans le même temps, les effectifs d’apprentis dans l’industrie sont restés relativement stables sur ces dernières années, autour du seuil des 250 000.
Graphique 3. Évolution des effectifs d’apprentis selon le niveau de diplôme
Source : DEPP, enquêtes 51 et SIFA
Graphique 4. Évolution du nombre d’apprentis dans l’industrie
Source : MEN-MESR DEPP / SIFA
Or, d’un autre côté, l’apprentissage est souvent vu comme une voie de qualification pour les publics n’ayant pas réussi dans la voie scolaire. Dans ce cadre, la logique éducative voudrait que l’apprentissage se développe sur les premiers niveaux de qualification (V et IV) car c’est sur ces diplômes qu’il peut jouer pleinement son rôle dans la lutte contre le décrochage scolaire. De plus, de nombreux secteurs (métallurgie, sidérurgie, automobile, etc.) recherchent des apprentis de niveau V car, sur certains métiers traditionnels et techniques, le CAP est considéré comme une qualification très opérationnelle. Or, le nombre de formations de niveau V préparées en apprentissage a reculé de 22 % depuis 1982.
Graphique 5. Évolution des effectifs d’apprentis dans l’industrie, selon le niveau de diplôme
Source : MEN-MESR DEPP / SIFA
Par ailleurs, malgré la progression des effectifs, concentrée sur les filières de formation les plus élevées, l’apprentissage souffre aujourd’hui encore d’un déficit d’attractivité important car peu de gens savent qu’il permet aujourd’hui de poursuivre ses études jusque dans l’enseignement supérieur.
Le nombre de signatures de contrats d’apprentissage a enregistré une baisse sensible sur l’année 2013 (-8,1 %), ce qui démontre que le système reste fragile. Sa consolidation passe par sa valorisation auprès des jeunes, de leurs familles et de leurs enseignants. Elle suppose par ailleurs de le rendre attractif auprès des entreprises : 88 % d’entre elles n’ont pas atteint le quota d’alternants auquel elles étaient soumises en 2012. Dans ce cadre, de nombreux observateurs ont dénoncé la quasi-suppression de la prime d’apprentissage comme une mesure fragilisant encore davantage le système.
- 39. La formation par apprentissage permet également de préparer des diplômes de l’enseignement supérieur (cf. infra).
- 40. Cette concurrence s’explique également par le fait que les formations en alternance se développent depuis quelques années dans les lycées professionnels.
- 41. Desforges C. & al, 2014.
- 42. Sollogoub M., Ulrich V., 1999.
Les acteurs de terrain nous parlent de l’apprentissage
La Fabrique de l’industrie a choisi de se rendre sur le terrain afin de recueillir le point de vue des acteurs de l’apprentissage. Leurs témoignages confirment les différents constats dressés plus haut.
A. Un système en prise avec les besoins des industriels
Les auditions de nombreux industriels ayant eu recours à l’apprentissage ont permis de faire remonter les nombreux avantages du système. Selon Hervé Leroy, directeur opérationnel de Bernard Controls (fabricant de servomoteurs électriques), « l’accueil d’un apprenti permet de le former à des savoir-faire pointus, directement en lien avec les besoins spécifiques de l’entreprise. » Pierre Monfort, directeur de la formation du constructeur naval DCNS, précise que « le recours à l’alternance est très utile pour former des jeunes sur des métiers en tension (soudeurs, chaudronniers, charpentiers, électriciens…) du fait des départs à la retraite. Il est indispensable au transfert de compétences. » Les industriels soulignent aussi le fait que l’apprentissage permet « d’imprégner les jeunes de la culture de l’entreprise ». Si l’entreprise conserve l’apprenti à l’issue de son contrat, elle s’économise certains coûts liés au recrutement (prestations de cabinets, incertitudes sur les compétences réelles des candidats extérieurs…).
On note toutefois que les industriels restent exigeants dans leurs attentes et sur le choix de leurs apprentis. Karim Terki, manager pédagogique au Centre des formations industrielles (CFI), constate que, dans certains secteurs comme l’énergie, les entreprises embauchent progressivement des BTS à des postes d’opérateurs, jusqu’à présent plutôt destinés à des titulaires de Bac pro, car « elles recherchent des compétences en management d’équipe, en français, une ouverture vers les langues pour décrypter les documents techniques, la maîtrise des outils informatiques (dessin et logiciels de simulation), des aptitudes commerciales, etc. Cette hausse des compétences exigées pousse les jeunes à poursuivre leurs études, à se spécialiser dans différents domaines. »
Face à cette évolution de la demande des industriels, des centres de formation d’apprentis (CFA) ont choisi de revoir l’organisation des enseignements de manière à adapter les formations à la méthode de travail en entreprise. L’Aforp a ainsi développé sa pédagogie dans une logique de projet, c’est-à-dire sur un mode plus transversal, de travail en équipe, nécessitant de mobiliser à la fois des compétences générales et techniques. Ce choix vise à se rapprocher le plus possible de la manière de travailler que les jeunes retrouveront ensuite en entreprise et dans l’industrie en particulier, où le travail se conçoit de plus en plus sur le mode de la collaboration, du réseau et où ils devront faire preuve d’autonomie et d’esprit d’initiative. Karim Terki évoque à ce titre la « difficulté de recruter des formateurs capables à la fois de transmettre des savoirs mais également dotés d’une véritable expérience professionnelle qu’ils pourront valoriser face aux élèves. »
B. Des méthodes pédagogiques innovantes pour lutter contre le décrochage scolaire
Une récente étude du think tank Terra Nova43 a estimé le coût pour la collectivité du décrochage scolaire à environ 24 milliards d’euros, en prenant en compte les moindres recettes fiscales liées aux salaires plus faibles des personnes sans diplôme, les allocations sociales plus importantes induites par un risque accru d’inactivité ou de chômage, etc. À cette estimation, il faut par ailleurs ajouter le manque-à-gagner découlant de la pénurie de main d’œuvre à laquelle font face les industriels sur certains métiers, qui pourrait être réduite si, chaque année, 150 000 jeunes ne sortaient pas du système éducatif sans le moindre diplôme.
L’apprentissage constitue pour ces élèves décrocheurs une alternative à la voie scolaire. Henri de Navacelle, directeur de l’Aforp, constate en effet que « les jeunes qui arrivent à l’Aforp n’ont aucune estime d’eux-mêmes, aucune confiance en eux ni en leur capacité à évoluer. » Pour cette raison, les CFA apportent un soin tout particulier à redonner du sens aux formations. Les élèves y découvrent une pédagogie différente, où les savoirs généraux sont mis au service de l’enseignement technique et ont une utilité concrète plus facile à appréhender : le français permet la rédaction de comptes-rendus, les mathématiques permettent des calculs appliqués, etc. Les salles de cours jouxtent les ateliers afin de recréer ce lien entre savoirs théoriques et applications pratiques. De son côté, l’Aforp met en œuvre une méthode pédagogique qui cherche à se démarquer d’une logique d’acquisition de savoirs au profit du développement de compétences. Elle cherche à développer une « culture de la certification » qui se traduit par l’obligation, pour tous les apprentis en Bac et en BTS, en plus de la validation des diplômes, de passer le TOEIC, une certification informatique (PCIE) et une autre relative à la sécurité (secouriste du travail ou habilitation électrique). En 2013, cette obligation a encore été élargie au français (certification Voltaire) et à l’entrepreneuriat (permis de conduire de l’entrepreneur européen). Cette démarche vise à renforcer la confiance en soi des jeunes ; elle est également un bon moyen pour l’apprenti de se situer dans sa formation et dans ses acquis. L’Aforp privilégie enfin l’ouverture à l’international. Des séjours des apprentis en BTS sont organisés en Angleterre, en Irlande et en Allemagne, pendant lesquels ils doivent répondre à un cahier des charges précis sur une problématique technique. Les Bac pro se rendent pour leur part pendant deux semaines en Finlande, en Allemagne ou en Belgique pour découvrir de nouvelles méthodes de travail et se confronter à d’autres cultures.
Au CFI, dans le cadre du dispositif d’initiation aux métiers de l’alternance (Dima), sorte de classe préparatoire à l’apprentissage, les jeunes font l’objet d’un « travail de remise en confiance » spécifique, prenant la forme de cours individualisés où « l’apprenant s’auto-évalue et devient acteur de sa formation. » L’équipe pédagogique travaille en collaboration avec le Centre d’innovation et de recherche en pédagogie de Paris (CCIRPP) pour formaliser sa politique éducative. L’école s’inspire par ailleurs des pratiques de pédagogie coopérative issues des travaux de Célestin Freinet dans l’enseignement supérieur. Une réflexion a été menée en étroite collaboration avec Nicolas Go, enseignant-chercheur en sciences de l’éducation à l’université Rennes 2, pour transposer cette démarche au Dima. Il s’agit de repenser complètement le rapport entre le formateur et les apprentis, basé non plus sur une simple collaboration, mais sur une coopération supposant le partage bien compris de valeurs communes.
Un autre moyen de motiver les jeunes durant leur formation est de les faire travailler sur du matériel de pointe et sur des projets stimulants. Ainsi, Anaïs et Christophe, apprentis en BTS « Fluides, énergies, environnements »44 au CFI, se réjouissent-ils de « suivre des cours en phase avec l’actualité, en travaillant notamment sur la pile à combustible ou encore sur la pompe à chaleur ». Le CFI veille à la qualité de ses plateaux techniques. Outre les dons en nature des entreprises, certaines machines sont achetées par le CFI. Dans le cadre de leur projet pédagogique, les jeunes sont amenés à travailler sur ces dernières afin de mieux intégrer les évolutions de leurs futurs métiers.
Aussi bien l’Aforp que le CFI encouragent leurs apprentis à participer à des concours nécessitant une haute expertise technique (comme les Olympiades des métiers), aux ApprentiScènes ou encore à des compétitions sportives. Les élèves du CFI participent par exemple au 4L Trophy, un raid aventure qui consiste à acheminer des fournitures scolaires aux enfants les plus démunis du Maroc. Outre la mobilisation de connaissances et de savoir-faire, ces projets renforcent la confiance des jeunes apprentis qui réalisent, une fois le projet terminé, ce dont ils sont capables. L’Aforp a également mis en place de nombreux projets pluridisciplinaires, pluri-niveaux de long terme : « Les chaudronniers inspirés », « BeeAforp », participation au « Shell éco-marathon », etc.
Encadré 3. Un exemple de projet mené par les apprentis de l’Aforp : « Les chaudronniers inspirés »
Ce projet a mobilisé pendant plusieurs mois les apprentis chaudronniers sur la conception et la création de jeux de taquin géants, entièrement réalisés en métal. Ce travail a été encadré par une artiste plasticienne. Leurs œuvres ont ensuite été exposées dans une galerie d’art parisienne. En plus de l’intérêt pédagogique de ce projet qui demande de mobiliser des compétences en dessin, en conception, en fabrication assistée par ordinateur, etc., la création d’œuvres d’art permet d’inscrire les apprentis dans un projet de long terme aboutissant à un résultat concret qui donne du sens à leur travail.
C. De nombreux freins au développement de l’apprentissage en France
Malgré son efficacité en termes d’insertion, l’apprentissage pâtit encore de l’image dégradée des métiers industriels, chez les jeunes, leurs familles et chez les prescripteurs. Saliha Tighilt, chargée de sourcing à l’Aforp, a pour mission de créer un réseau de contacts auprès des centres d’information et d’orientation (CIO), des missions locales, des collèges, des lycées, des universités, des Pôle emploi, etc. Elle constate que, aux yeux des professionnels de l’orientation, « l’industrie ne recrute pas, elle est synonyme de déclin, elle est très stigmatisée. » Pour François Lacoste, responsable de la communication de l’Aforp, « les délocalisations et les plans sociaux font régulièrement la Une de la presse mais l’on sait moins que l’industrie recrute chaque année environ 100 000 personnes en France. »
Or, pour Tristan Gillouard, directeur du CFI, le rôle des prescripteurs est primordial pour faire connaître l’apprentissage et faire découvrir les métiers industriels aux jeunes. Si certaines filières comme l’énergie sont associées à des métiers porteurs et des perspectives de carrières valorisantes (250 candidatures pour seulement 52 places disponibles au BTS du CFI), d’autres formations sont affectées par une mauvaise image. La maintenance, par exemple, est associée « aux mains dans le cambouis ». Au travers de l’apprentissage, les jeunes découvrent pourtant qu’il s’agit davantage d’optimiser des installations, de gérer des contrats, d’assurer une bonne relation client et que les conditions d’exercice de la maintenance sont tout à fait valorisantes.
La méconnaissance du système d’apprentissage tient sans doute à la place tenue par l’Éducation nationale dans le dispositif d’orientation. Pour Tristan Gillouard, « il n’est pas forcément évident pour un centre de formation en apprentissage d’entrer dans des collèges ou lycées pour y sensibiliser les jeunes à ce type de formation. Il y a une certaine préemption des jeunes pour alimenter des formations de l’Éducation nationale. À tel point que, quand ces derniers énoncent des souhaits d’orientations en fin de troisième, les formations en apprentissage ne sont pas répertoriées dans le dispositif AFFELNET (AFFectation des Élèves par le Net). L’Éducation nationale propose plus spontanément les formations dispensées en lycées professionnels. » En conséquence, les apprentis rencontrés affirment « en avoir entendu parler par hasard et non pas dans le cadre de leur orientation ». Pour Tristan Gillouard, « le service public de l’orientation gagnerait à actualiser ses représentations de la formation initiale et des formations professionnelles, au besoin en étant formellement déconnecté de l’Éducation nationale. »
Contrairement à l’Allemagne ou à la Suisse, le système d’apprentissage n’est donc pas socialement intégré en France. La plupart des jeunes apprentis interrogés plébiscitent pourtant leur formation. Pour Anaïs et Christophe, l’apprentissage leur a permis de « découvrir des métiers plus riches que ce qu’ils imaginaient et d’apprendre concrètement un métier ». L’acquisition de savoir-faire n’est pas le seul atout de ces formations. Pour Benoît, apprenti en BTS maintenance des véhicules au CFI, cette formation lui a permis de « grandir », d’avoir « un vrai métier rémunéré » avec des « horaires à respecter », des « responsabilités ».
Encadré 4. Le témoignage de Margaux, apprentie en Bac pro « Technicien(ne) en chaudronnerie industrielle » à l’Aforp
Vous êtes aujourd’hui en première année de Bac pro « Technicien(ne) en chaudronnerie industrielle ».
Pouvez-vous nous décrire votre parcours ?
Je pense que j’ai un parcours assez atypique par rapport aux autres apprentis de ma section. J’ai toujours eu une passion pour les métiers manuels mais, malgré ça, j’ai d’abord poursuivi des études dans la voie générale. Beaucoup de personnes m’avaient en effet déconseillé de me lancer en Bac pro après le collège en me disant : « c’est pour les nuls. »
Après avoir décroché un Bac L, je me suis donc lancée dans un BTS « Communication visuelle ». Mais après les deux ans de cette formation, je me suis rendue compte que cela ne correspondait pas vraiment à ce que je voulais faire de ma vie professionnelle : je n’étais pas assez dans le concret.
C’est la raison pour laquelle j’ai décidé de me réorienter dans une voie qui me plaisait vraiment : le travail des métaux. Je ne connaissais rien à ce domaine mais, grâce à des recherches sur internet, j’ai découvert la chaudronnerie et les formations qui existaient près de chez moi.
Depuis la rentrée, je suis en Bac pro « Technicien(ne) en chaudronnerie industrielle ». Ce que j’aime et que je voudrais développer dans ce métier, c’est le côté artistique, le design d’objets. Plus tard, une fois que j’aurai acquis des bases solides en chaudronnerie, j’aimerais pouvoir ouvrir mon propre atelier.
Pourquoi avoir choisi l’apprentissage ? Quels sont pour vous les avantages de ce type de formation ?
Après avoir passé toute ma scolarité dans l’enseignement général, j’avais très envie d’apprendre un métier. Avec l’apprentissage, on passe la moitié de l’année en entreprise, ce qui permet de se former et d’acquérir une expérience professionnelle intéressante. Ce que j’apprécie également, c’est que l’enseignement des matières générales est appliqué. Les formateurs essaient de faire des cours en rapport avec la chaudronnerie. Par exemple, je n’ai jamais aimé les maths à l’école mais maintenant que je vois concrètement à quoi cela peut me servir dans mon métier, c’est plus facile. Et puis, il faut le dire, l’apprentissage me permettra également de gagner ma vie, d’être indépendante, et c’est très important quand on est jeune.
Rencontrez-vous également des difficultés ?
Oui. Pour l’instant, je n’ai pas encore trouvé d’entreprise qui veuille bien m’accueillir. Je démarche les entreprises depuis neuf mois mais je n’ai pour l’instant essuyé que des refus. Je pense que c’est plus difficile pour moi parce que je suis une fille et que la chaudronnerie reste un univers très masculin. Je suis d’ailleurs la seule fille de ma section. Je trouve cela assez dommage : en alternance, on a beaucoup à apprendre en entreprise. C’est un manque-à-gagner pour moi, pour l’instant. En attendant de décrocher un contrat avec une entreprise, je fais des stages. Sur les dernières périodes d’alternance, j’ai par exemple fait un stage de quatre semaines chez Guillaume Piéchaud, un artiste sculpteur qui travaille les métaux.
Quoi qu’il en soit, je reste très motivée. Il n’y a pas beaucoup de personnes qui se lancent en Bac pro chaudronnerie par choix mais, moi, c’est le cas !
Quoique les entreprises plébiscitent l’apprentissage45, Hervé Leroy, directeur opérationnel de Bernard Controls, relève que « prendre un apprenti est un réel investissement pour l’entreprise ». Les industriels peuvent également se montrer réticents « à laisser des jeunes manipuler des machines coûteuses ». Henri de Navacelle confirme que « le coût d’un apprenti reste important et que les entreprises n’ont pas toutes les moyens de former les jeunes, d’autant moins que la prime d’apprentissage a été quasiment supprimée. »
Il ajoute à cela de nombreux obstacles réglementaires. « L’accès aux ateliers et à certaines machines est en effet interdit aux jeunes de moins de 16 et parfois même de 18 ans. L’encadrement d’un jeune doit être assuré par une personne ayant au minimum le même niveau de diplôme. Et, pour finir, le contrat d’apprentissage est calé sur l’année scolaire et répond donc à un besoin de long terme qu’il n’est pas toujours facile d’anticiper. »
Henri de Navacelle rappelle également que les fonds issus de la taxe d’apprentissage ne sont pas totalement dirigés vers le financement de l’apprentissage. Ils bénéficient également aux grandes écoles, aux universités, etc. « À chaque niveau du dispositif, il y a des éléments qui obèrent son développement. » Didier Godement,
responsable du site d’Orly du CFI, le déplore d’autant plus qu’il juge l’apprentissage « indispensable pour conserver des savoir-faire en France. Nous formons à des emplois qui ne sont pas délocalisables, qui enrichissent le tissu économique et social local et régional. L’apprentissage a aussi besoin de moyens pour se développer (enrichir les plateaux techniques, assurer la maintenance des installations…). »
- 43. Obin J-P. & al., 2014.
- 44. Retrouvez d’autres témoignages sur : www.youtube.com/watch?v=ceGSvxbteis
- 45. Un sondage de l’Ifop pour Agefa-PME publié en juin 2013 révèle que 89 % des PME y ayant eu recours seraient prêtes à le recommander auprès d’autres chefs d’entreprises.
Le « modèle dual » suisse de formation professionnelle – BENCHMARK
« La disponibilité d’une main d’œuvre qualifiée est un facteur décisif pour la compétitivité du pays.
Un rôle déterminant revient à la formation professionnelle. Grâce à cette ressource, la Suisse fait partie des économies les plus compétitives au monde. »
Martin Fischer, directeur de la communication, Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI)
Des formations qui offrent de réelles perspectives d’évolution
Le système suisse de formation professionnelle est principalement proposé dans un format dual, combinant des études à temps partiel dans une école professionnelle et des apprentissages en entreprise. Choisie par près des deux tiers des jeunes Suisses à l’issue de la scolarité obligatoire (15 ans), la formation professionnelle initiale en entreprise représente le mode de formation le plus courant dans le pays. Elle peut ensuite être prolongée dans le cadre de la formation professionnelle supérieure.
Les jeunes ont le choix entre environ 250 spécialités de formation, en lien avec les besoins du marché. L’enseignement pratique offre aux apprentis une employabilité forte46 dès la fin de leur cursus. Les trois quarts des jeunes rejoignent directement le marché du travail au terme de la formation professionnelle initiale.
Le système suisse propose également de nombreuses passerelles pour rejoindre des filières de plus haut niveau. Un quart des titularisés de la formation professionnelle initiale poursuivent ainsi leurs études dans l’enseignement supérieur47. La « maturité professionnelle », équivalent suisse du Bac pro, certifie un niveau de connaissances générales et ouvre l’accès aux études supérieures. Selon Martin Fischer, directeur de la communication au SEFRI, « la formation professionnelle et la formation académique ne sont pas en concurrence mais se complètent de manière optimale. »
Enfin, la mobilité des apprentis est importante sur le marché du travail. Seuls 35,5 % des diplômés de la formation professionnelle initiale s’engageaient dans une profession directement liée à leurs qualifications professionnelles en 200748. Les opportunités d’évolutions sont réelles ; de nombreux dirigeants de grandes entreprises suisses sont d’ailleurs connus pour avoir débuté leur carrière par l’apprentissage. Alors que, en France, le diplôme détermine en grande partie la carrière d’un individu, près des deux tiers des jeunes Suisses considèrent que les études ne constituent pas le meilleur atout pour la progression professionnelle. Grégoire Evéquoz, directeur général de l’Office pour l’orientation et la formation professionnelle à Genève, confirme qu’« aucun diplôme de base ne constitue une clé pour arriver au sommet. C’est uniquement la formation continue qui permet d’y arriver. »49 Cela explique que 75 % des jeunes Suisses considèrent que l’apprentissage permet de garder toutes les options ouvertes en termes d’évolution de carrière50.
Un système « piloté par le marché »
Contrairement aux autres domaines de l’éducation qui relèvent essentiellement de la responsabilité cantonale, la formation professionnelle est gérée à l’échelon fédéral par trois partenaires : la Confédération, les cantons et les partenaires sociaux – les « organisations du monde du travail » ou ORTRA.
Au sein de cette gouvernance tripartite, les ORTRA élaborent le contenu des programmes, les qualifications ainsi que les examens. Ils jouent donc un rôle prépondérant dans la définition de l’offre de formation professionnelle. Ce rôle est d’autant plus important qu’il existe en Suisse un véritable « marché des places d’apprentissage », au sein duquel ce sont les entreprises qui fixent le nombre de places ouvertes en fonction de leurs besoins. Concrètement, une plateforme de mise en relation a été créée afin que les élèves souhaitant démarrer une formation duale puissent démarcher directement les entreprises qui recherchent des apprentis. Une fois leur contrat de travail signé, les organismes de formation sont ensuite chargés de proposer les enseignements adaptés aux besoins des entreprises.
En cas d’inadéquation entre l’offre et la demande, le SEFRI intervient par exemple pour financer la création de réseaux d’entreprises formatrices, pour aider les élèves dont le niveau est plus faible à trouver une place d’apprentissage (case management) ou pour encourager les entreprises à proposer des places d’apprentissage.
Martin Fischer insiste sur le fait que « le bon fonctionnement du système de formation professionnelle nécessite un engagement fort de la part de l’État et de l’économie, ainsi qu’une grande réactivité face aux nouveaux défis sociétaux, démographiques et économiques.
Sans cet engagement et cette souplesse de la part des entreprises, on manquera de places d’apprentissage et la formation professionnelle, privée de son lien avec la pratique, ne pourra plus produire ses effets durables. Pour sa part, l’État doit veiller à l’attrait de la formation professionnelle en prévoyant par exemple des possibilités de qualification taillées sur mesure. »
Des conditions propices au développement de la formation duale
Les premières filières de formation duales sont apparues en Suisse dès la fin du XIXe siècle, sous l’impulsion des corporations. À l’époque, cet enseignement combinant théorie et pratique était déjà orienté vers le maintien d’une main d’œuvre hautement qualifiée, capable de répondre aux exigences de qualité imposées aux produits suisses.
Cette proximité historique entre école et entreprise explique aujourd’hui encore la bonne adaptation de l’offre de formation aux besoins des industriels. De même, la spécialisation de l’industrie suisse dans des secteurs de niche tels que l’ingénierie de précision, qui nécessitent des savoir-faire pointus, s’accorde particulièrement bien avec la formation en apprentissage.
L’importance dans le tissu industriel suisse des PME familiales, ancrées dans le territoire, favorise également l’investissement dans la formation professionnelle, en raison de leur souci permanent de développer et transmettre leurs savoir-faire.
Vers une remise en cause du système ?
Des inquiétudes commencent à se faire sentir en Suisse quant à la possibilité de perpétuer ce modèle de formation professionnelle. D’un côté, le système éducatif suisse suit une tendance à l’« universitarisation » des formations. Cela est lié à la concurrence croissante entre le système de formation professionnelle et les universités, exacerbée par une évolution démographique défavorable. Elle s’explique également par la place croissante que tiennent les enseignements théoriques au détriment de la pratique au sein des formations professionnelles. D’un autre côté, alors que les grandes entreprises industrielles ont joué un rôle pionnier dans le développement de l’apprentissage à la fin du XIXe siècle, la place grandissante des groupes multinationaux ne s’identifiant pas à la tradition suisse en matière de formation constitue une menace pour le système dual51.
- 46. Une étude menée par l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT, 2011) auprès de 159 entreprises multinationales implantées en Suisse indique que ces dernières citent spontanément « l’orientation pratique de la formation duale » comme principal point fort du système de formation suisse.
- 47. Office fédéral de la statistique, 2012.
- 48. OCDE, 2009.
- 49. Confédération suisse, 2012.
- 50. Crédit Suisse, 2013.
- 51. Müller B., Schweri J., (2008) in OCDE, 2009.
Des experts en Suisse témoignent
Témoignage de Grégoire Evéquoz, directeur général de l’Office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue de Genève.
Le système suisse de la formation professionnelle
Le système suisse est très « adéquationniste » : les jeunes sont formés conformément aux besoins des entreprises. Cela explique en grande partie pourquoi la Suisse connaît un des plus faibles taux de chômage des jeunes au monde (3 %). À travers ce système, les jeunes obtiennent un diplôme fédéral qui va être le même pour tous les métiers (plus de 239 professions au total). Au terme de leur formation de trois ou quatre ans, ils peuvent poursuivre leurs études dans le cadre des hautes écoles spécialisées, qui délivrent des bachelors et des masters, ou dans le cadre de formations professionnelles supérieures.
La Suisse est aujourd’hui en tête de tous les classements internationaux sur la compétitivité des entreprises et sur l’innovation. Le système de formation, en prise avec les besoins de l’économie, n’est pas le seul facteur explicatif de ce succès, mais il en fait partie.
Ce système connaît toutefois des limites. Il repose sur un équilibre entre l’offre de places de formation et la demande des jeunes. Or, certaines régions du pays connaissent actuellement une crise démographique, avec pour conséquence directe que des places de formation risquent de n’être pas occupées. Dans d’autres régions, c’est l’inverse : il y a des risques de manquer de places. Par ailleurs la formation professionnelle devient de plus en plus exigeante et les entreprises recherchent des jeunes avec de très bons profils, ce qu’elles ne trouvent pas toujours. On constate d’ailleurs que les jeunes entrent en formation professionnelle toujours plus tardivement : l’âge moyen d’entrée en apprentissage est de 18 ans actuellement.
Le système suisse de la formation n’est pas forcément transposable tel quel en France, ni dans un autre pays d’ailleurs. Il repose sur deux éléments culturels très spécifiques. D’abord, la valeur donnée au travail lui-même comme facteur d’acquisition et de valorisation de compétences. Il n’y a pas de meilleure image de marque pour une grande banque ou pour une entreprise florissante que de dire que son patron est issu de l’apprentissage. Ensuite la tradition très forte du partenariat avec les milieux professionnels.
Les programmes de formation, l’enseignement de la pratique, le passage des examens sont autant d’éléments qui sont donnés par les milieux professionnels eux-mêmes. La Suisse est dans ce domaine le pays qui a été le plus loin dans la pratique de la concertation et du partenariat entre État et partenaires sociaux.
Comme indiqué plus haut, la Suisse a un très faible taux de chômage, inférieur à 5 %. Ce faible taux est paradoxal, car il rend la situation des demandeurs d’emploi d’autant plus difficile. Que ce soit pour les jeunes ou pour les adultes, la clé de la réinsertion passe de plus en plus par des programmes de qualification et de requalification, qui ont pour caractéristique d’être gérés en commun par les instances s’occupant de la formation et celles responsables du suivi des chômeurs et des mesures du marché du travail.
Entretien avec Samanta Al-Yammouni, assistante en communication à la Chambre franco-suisse de commerce et d’industrie.
1. Quelle place tient aujourd’hui la formation professionnelle au sein du système éducatif en Suisse ?
La formation professionnelle initiale touche deux tiers des jeunes suisses. En 2013, près de 80 000 personnes ont choisi cette voie après l’école obligatoire. Ils sont, au total, 236 600 apprentis à suivre une formation professionnelle initiale.
De grands noms comme Sergio Ermotti et Monika Walser, respectivement à la tête de la banque UBS et Freitag (producteur culte de sacs et accessoires) ont été diplômés de cette filière.
Le nombre de contrats d’apprentissage dans le secteur industriel est resté stable ces vingt dernières années. Cependant, la part qu’ils représentent dans l’ensemble des contrats a nettement baissé, au profit du secteur tertiaire.
2. Quels sont les avantages du système dual pour les entreprises industrielles et plus globalement pour la compétitivité du pays ?
Le système dual, qui représente environ 80 % des entrées en formation professionnelle, donne la possibilité aux jeunes d’être formés à la fois en école professionnelle et en entreprise. Ainsi, les apprentis acquièrent des connaissances théoriques et pratiques liées à la profession qu’ils envisagent. C’est au secteur privé de définir le contenu de la formation et des qualifications requises en vue de l’obtention du certificat. Par conséquent, les 250 formations proposées tiennent compte des besoins du marché du travail. C’est cette orientation vers le marché qui fait d’ailleurs la force de cette filière. Le système dual favorise l’employabilité des jeunes et comporte bien d’autres avantages : étant orienté vers la pratique, il permet à des élèves moins scolaires de développer d’autres compétences.
Il permet également aux entreprises d’embaucher des jeunes tout en économisant sur les coûts liés à l’insertion dans le monde du travail. De plus, cette formation est meilleure marché pour l’économie et les pouvoirs publics qu’une formation académique.
La formation duale permet d’assurer la disponibilité d’une main d’œuvre qualifiée et de lutter contre la pénurie de spécialistes que l’on observe dans la plupart des pays avoisinants.
3. Quels sont les éventuels freins à son développement ?
Transposer le système dual suisse en France demanderait une collaboration étroite entre l’État et le secteur privé. En effet, les deux parties se doivent de soutenir, notamment financièrement, la formation professionnelle. Il s’agit aussi de mettre en œuvre des programmes en adéquation avec les besoins du marché. La France propose déjà une formation professionnelle qui allie formation en atelier (au lycée ou au CFA) et en entreprise. La voie existe, elle mériterait sans doute d’être valorisée tant dans les entreprises que dans les centres de formations et surtout auprès du public et des jeunes en particulier.
4. Un tel système vous semble-t-il transposable à la France ?
Ce système étant fortement dépendant de l’économie, l’offre de places d’apprentissage peut être affectée en période de récession.
Les entreprises, devant réduire leurs coûts, peuvent être amenées à réduire leur investissement en matière de formation professionnelle.
De plus, l’attrait grandissant pour la maturité gymnasiale fait que le nombre de jeunes se dirigeant vers une formation professionnelle diminue. Enfin, les titres de la formation professionnelle suisse ont besoin d’une meilleure reconnaissance internationale afin de permettre aux jeunes diplômés de poursuivre leur carrière à l’étranger.
VOLET 3 – Investir dans la formation tout au long de la vie pour soutenir la compétitivité industrielle
Complétant la formation initiale, la formation continue est indispensable au maintien et au développement des compétences et des qualifications des salariés. Ces deux systèmes doivent être réfléchis de manière interdépendante et coordonnée, afin de promouvoir une formation tout au long de la vie, seule capable de répondre au défi de compétitivité des entreprises.
Face au manque de candidats qualifiés, les industriels doivent davantage investir dans la formation des salariés en place, voire élargir leurs recrutements aux personnes éloignées de l’emploi qui représentent un gisement inexploité. Dans un monde où les mutations s’accélèrent, il faut également mieux anticiper et accompagner les transitions professionnelles.
De nombreuses réformes se sont succédées, depuis la mise en place du système de formation continue en 1971, mais elles n’ont pas réussi à rééquilibrer le système qui reste dominé par l’importance de la formation initiale.
La nouvelle loi votée le 5 mars 2014 constitue un nouveau pas en avant, et est présentée par le Gouvernement comme « une réforme au long cours qui refonde la formation professionnelle peut-être pour quarante ans à nouveau. »
Rééquilibrer les dispositifs de formation initiale et continue pour répondre aux besoins des industriels
A. Les faiblesses de l’appareil éducatif sont compensées par l’implication des entreprises
L’appareil éducatif est souvent présenté comme ayant du mal à s’adapter aux besoins des entreprises comme à leur évolution rapide. Les mutations technologiques impliquent par exemple une certaine réactivité pour transmettre des connaissances sur des techniques nouvelles. En effet, le temps de construction de la formation ajouté à celui de la formation elle-même ne correspond pas à l’urgence de l’entreprise industrielle. Pour Dominique Dubois, PDG de Multiplast (construction navale en matériaux composites), « certaines technologies sont si avancées que l’industrie aéronautique met du temps à se les approprier.
La formation, en revanche, n’évolue pas au même rythme. […] Les enseignants ont été formés il y a plus de vingt ans, sur des composites qui ne sont plus utilisés. D’où l’important décalage qui existe entre l’enseignement et les besoins des entreprises. »
Le système éducatif ne peut à lui seul répondre à ce défi. Les lycées professionnels ne peuvent pas, par exemple, constamment s’équiper de matériels modernes et onéreux et former immédiatement les enseignants à ces changements rapides. Pour Frédéric Coirier, PDG de Cheminées Poujoulat, la disparition du tissu industriel a induit celle des savoir-faire et conduit de nombreux industriels à envisager des solutions alternatives. Pour un métier spécifique comme celui de la maintenance de cheminées industrielles, qui allie des savoir-faire de maçonnerie et de peinture au fait d’être capable de grimper à des hauteurs de trois cents mètres à la corde, « il n’est pas envisageable de créer des filières dans des lycées professionnels avec un tissu d’entreprises aussi diffus. Certains lycées ont certes mis en place des options permettant aux élèves de se rapprocher de nos métiers mais l’essentiel de la formation de nos salariés se fait par intégration et apprentissage. »
Certains industriels vont ainsi jusqu’à créer un centre de formation en interne. Ce sont souvent les salariés de la structure qui y dispensent les formations techniques et généralistes. C’est le cas de Trescal (métrologie) avec son « Trescal Institute », des campus de Thalès ou de Veolia ou encore du lycée Airbus à Toulouse. Les PMI, elles, n’ont pas toutes les moyens de créer un centre de formation, opération pour laquelle les contraintes administratives sont d’ailleurs assez lourdes. Certaines créent leur propre diplôme : Sacred (transformateur et équipementier automobile) a par exemple choisi de développer son propre CAP de caoutchoutier. Cette formation de trois ans, dispensée en interne, repose sur la valorisation de l’expérience. Elle peut accueillir des jeunes gens n’ayant pas le niveau pour envisager un CAP traditionnel. À l’issue de la formation, ils reçoivent un diplôme qui n’a pas de valeur au plan national mais qui est reconnu en Alsace et qui peut être validé par l’Institut national de formation et d’enseignement professionnel du caoutchouc (IFOCA). Cette expérience a permis à l’IFOCA de faire évoluer son offre de formation au plan national.
Les industriels peuvent également trouver un appui auprès des branches pour répondre à leurs besoins en compétences. Ces dernières s’investissent en effet de manière grandissante dans le développement de certificats de qualification professionnelle (CQP). Pour ne citer que cet exemple, la branche professionnelle de la plasturgie en Rhône-Alpes, Allizé-Plasturgie, a piloté en 2012 une opération visant à faire passer trois CQP de la plasturgie à une dizaine de jeunes afin qu’ils occupent les postes vacants des entreprises du bassin de Loriol.
Il est parfois difficile de mettre en place ces certifications, fabriquées sur mesure par les professionnels, et qui doivent être reliés à la fois à un référentiel de formation existant, aux besoins des entreprises et à la convention collective. Par ailleurs, ils ne sont pas reconnus en dehors de la branche. Afin de remédier à ce problème, des CQP inter-branches (CQPI) peuvent être élaborés conjointement par plusieurs branches lorsque celles-ci considèrent que la qualification concernée recouvre des activités professionnelles dont les capacités et les compétences requises sont identiques ou proches. Un accord a par exemple été signé en juin 2013 entre l’industrie chimique et l’industrie pharmaceutique pour reconnaitre l’équivalence partielle ou totale d’un certain nombre de leurs CQP respectifs52.
De nombreux témoignages montrent que les réussites reposent souvent sur une collaboration confiante entre plusieurs acteurs du territoire, notamment des entreprises qui acceptent de mutualiser leurs préoccupations et recherchent une coopération avec l’Éducation nationale, les collectivités territoriales et les organisations consulaires. Ivan Dupraz, directeur des ressources humaines du site de Sanofi de Vertolaye, indique à titre d’exemple que « face aux problèmes d’attractivité de l’Auvergne, Sanofi et les PMI du territoire ont créé une association afin de mutualiser leurs besoins en compétences, en partenariat avec la Région, le rectorat, la préfecture, le Pôle emploi, la Direccte, la CCI, etc. Notre objectif était de mettre en place des actions concrètes pour pallier les problèmes de recrutement des industriels du territoire. Cela s’est traduit par la création de formations continues, le lancement de filières professionnelles répondant aux attentes des entreprises, la prise en compte des besoins d’hébergements, de transport, etc. »
Toutefois, ces collaborations ne sont pas toujours évidentes, les différents acteurs pouvant avoir d’autres types de priorités ou de contraintes. Des difficultés peuvent apparaître concernant la définition des cartes de formations initiales. Certains industriels regrettent en effet que des formations subsistent alors qu’elles n’offrent pas ou plus de débouchés aux jeunes. En parallèle, ils notent que de nombreuses formations recherchées ont disparu. Elizabeth Ducottet, présidente de l’ETI Thuasne (textile médical) témoigne que « l’Éducation nationale a définitivement fermé des parcours de formations technologiques indispensables aux textiles techniques dans le bassin stéphanois (tricoteurs, gareurs…), alors que plusieurs confrères de ce métier sur le même territoire auraient pu justifier le maintien de ces formations, quitte à les adapter. » Lionel Pinard indique pour sa part que « la carte des formations doit répondre à un besoin industriel local, mais elle doit également prendre en compte la contrainte de la mobilité des élèves. Le temps de transport chez les jeunes est un facteur de décrochage important : on constate que si un élève en Bac pro part sur un lieu de formation qui demande plus de trente minutes de transport par jour, il décroche. »
La prise en compte de ces différentes contraintes suppose donc un travail de concertation entre les parties prenantes. André Gauron et Yves Lichtenberger rappellent néanmoins que « la loi qui a transféré dès 1983 la pleine compétence aux Régions en matière de formation professionnelle comportait un codicille accordant la décision finale aux recteurs. Du coup, ceux-ci n’ont souvent pas même jugé utile d’engager le débat et bien des cartes de formation ont été plus guidées par les effectifs de professeurs disponibles que par les besoins des entreprises du territoire. »
Par ailleurs, il faut rappeler qu’il n’est pas facile de mettre les contenus de la formation en adéquation avec les demandes des industriels. Comme l’ont noté de nombreuses études53, le processus d’appariement n’est pas « statique ». Un industriel n’est pas capable de définir précisément ses besoins de compétences et de vérifier que le candidat les possède bien. Le « bon » candidat doit avoir acquis un certain nombre de savoirs et de savoir-être implicites, adhérer au projet de l’entreprise, savoir faire face aux besoins actuels de son poste de travail tout en pouvant s’adapter aux évolutions futures de celui-ci, que souvent son employeur ignore encore.
B. Renforcer le lien entre formation initiale et continue dans une logique de continuum
Par rapport à ses voisins d’Europe du Nord, la France se singularise par une césure plus nette entre le système éducatif et le marché du travail. Le système de formation professionnelle est notamment jugé particulièrement cloisonné avec, d’un côté, une formation diplômante qui dépend de l’État et, de l’autre, une formation professionnelle continue à vocation qualifiante qui dépend des partenaires sociaux et des branches. Le modèle français se caractérise ainsi par une diversité des acteurs, des outils et des dispositifs qui débouche sur un manque d’articulation entre formations initiale et continue et, surtout, qui rend difficile le concept d’une formation tout au long de la vie.
Rappelons que la loi Delors du 16 juillet 1971, qui instaure le système de formation continue, l’a d’abord définie comme une formation organisée postérieurement à la formation initiale. Dans un contexte de plein-emploi, il s’agissait de rechercher, selon le Céreq, « un palliatif aux inégalités sociales que renforçait un système scolaire très sélectif, et d’accorder en quelque sorte une ‘seconde chance’ aux individus mis trop tôt à l’écart des formations initiales. »54 Le système fut, à l’époque, également conçu pour adapter en continu les compétences des salariés aux évolutions des postes et des situations de travail, dans un contexte de production de biens de masse.
Pour Paul Santelmann, « le système français s’est construit en accordant un rôle majeur à l’Éducation nationale et une grande importance aux diplômes et moins aux connaissances produites et apportées par l’entreprise qui sont pourtant complémentaires des enseignements de la formation initiale. »
Le manque d’articulation entre les deux dispositifs repose, selon le directeur de la veille pédagogique de l’Afpa, sur une vision dichotomique de l’école et du monde du travail, où la sphère du savoir ne peut que se distinguer de la sphère du faire. « Notre système actuel est encore imprégné de cette vision qui suppose que la formation initiale des jeunes est au cœur de l’investissement éducatif en France : ‘c’est lorsque l’on est jeune que l’on apprend l’essentiel’. L’une des erreurs est ainsi de croire que l’Éducation nationale est capable de préparer les jeunes à tous les métiers. Un certain nombre de métiers nécessitent pourtant une expérience de travail. » En ce sens, la validation des acquis de l’expérience (VAE), créée en 2002, est une démarche utile car elle ouvre les possibilités d’acquisition de diplômes à ceux qui ont une pratique professionnelle reconnue. Elle reste néanmoins très peu utilisée aujourd’hui.
Encadré 5. La VAE : une voie d’accès aux diplômes au cours de la vie professionnelle
La VAE est un dispositif permettant à toute personne qui le souhaite de faire reconnaître son expérience professionnelle d’au moins trois ans et d’obtenir une certification, c’est-à-dire un diplôme ou un titre à finalité professionnelle. Elle permet de valoriser les acquis d’un salarié, dans la perspective d’une recherche d’un nouvel emploi, d’accession à de nouvelles fonctions, d’une promotion interne ou bien afin de faciliter un projet de formation en réduisant sa durée.
La mise en place de ce dispositif traduit une volonté des pouvoirs publics de consolider la formation des citoyens les plus fragilisés. Il s’agit d’améliorer l’accès à la certification du plus grand nombre, notamment des individus éloignés de l’emploi et privés de diplômes. La VAE est ainsi concentrée aujourd’hui sur les plus bas niveaux de qualification : 52 % des candidats présentés à la VAE en 2012 préparaient un diplôme de niveau V et 17,5 % un diplôme de niveau IV. Mike Manfroi, salarié de l’entreprise Behr (équipementier automobile), témoigne : « j’avais raté mon Bac et je suis entré dans la vie active. La VAE m’a permis de revenir sur cet échec. Le Bac professionnel que j’ai obtenu me permet d’envisager plus sereinement l’avenir. Si, un jour, je dois chercher un emploi dans une autre entreprise, je serai mieux armé avec ce diplôme. La VAE m’a permis de passer ce diplôme que je n’aurais jamais pu obtenir autrement. J’envisage d’ailleurs prochainement de faire un dossier pour un BTS. »
Le dispositif reste néanmoins complexe et donc trop peu utilisé. Moins de 30 000 certifications ont été validées en 2012, loin de l’objectif de 60 000 par an fixé initialement par les pouvoirs publics. Un rapport d’évaluation révélait dès 2008 que « la VAE fait face à de multiples problèmes qui occasionnent des déperditions de candidats tout au long de la procédure » : manque d’information notamment auprès des publics prioritairement visés, multiplicité des acteurs intervenant dans le processus de validation, difficultés dans l’organisation des jurys (qui regroupent pendant deux à trois jours des formateurs, des industriels, des représentants ministériels, etc.), accompagnement trop faible des candidats, etc.
En outre, des difficultés peuvent apparaître lorsqu’il s’agit de valider une expérience opérationnelle, les compétences « validables » se rapportant en effet aux référentiels de la formation initiale, antérieure donc à l’exercice d’un métier.
Par ailleurs, les différents rapports et travaux55 sur la formation professionnelle font consensus : pendant trop longtemps, la formation continue a davantage été conçue comme une formation initiale dispensée aux adultes (acquisition de savoirs de base, remise à niveau, etc.) que dans une logique de continuum permettant à tous les salariés de progresser dans leur vie professionnelle grâce à l’enrichissement de leurs compétences.
Le modèle français, bâti sur la loi de 1971, est notamment imprégné d’une conception « tayloriste » du travail. En dépit de nombreuses réformes pour tenir compte des mutations économiques et de leurs implications sur l’organisation et le contenu du travail, le système de formation continue peine aujourd’hui à répondre aux besoins accrus d’adaptabilité et de mobilité qui caractérisent notre temps. Son articulation insuffisante avec la formation initiale ne fait que renforcer cette difficulté. Comment en effet « assurer un haut niveau général de compétences, une forte capacité d’initiative individuelle et d’apprentissage de nouveaux savoirs »56 si les individus ne peuvent se former tout au long de la vie ?
Encadré 6. Le système de formation professionnelle français est marqué historiquement par une forte césure entre la formation initiale et continue
Les systèmes de formation initiale et continue ne se sont pas construits d’une manière cohérente à un moment donné. Ils ont été constitués par éléments séparés en fonction des époques, des courants de pensées, des pressions économiques, etc. La formation continue s’est ainsi construite de manière autonome par rapport à la formation initiale, ce qui explique le décalage observé aujourd’hui entre la sphère éducative et celle de la production.
Ainsi, dans la période d’après-guerre, par crainte de manquer de main d’œuvre, le monde industriel a exercé une forte pression sur l’appareil éducatif pour que les jeunes puissent intégrer le plus rapidement possible le système de production. Au niveau de la conception des diplômes professionnels, cela s’est traduit par la création de nombreuses filières courtes très spécialisées. Ceci se justifiait pour deux raisons. D’une part les métiers étaient très spécialisés ; d’autre part, les industries étaient à cette époque en forte concurrence les unes par rapport aux autres, d’où la volonté que la main d’œuvre ne soit pas trop mobile. Le choix à cette période a été de privilégier la quantité à la formation de jeunes qualifiés.
On note également que le syndicalisme enseignant en 1947 s’est détaché du syndicalisme ouvrier. Les syndicats d’enseignants avaient ainsi peu d’interactions avec les syndicats de salariés.
Dans les années 1960, la responsabilité de la formation professionnelle initiale a progressivement été confiée au ministère de l’Éducation nationale. Les lycées d’enseignement technique et professionnel se sont substitués aux écoles d’entreprises, qui formaient jusque-là leurs propres salariés. Ce choix, fondé sur le projet de donner aux jeunes ouvriers et techniciens une formation générale plus large que celles qu’ils recevaient dans les écoles d’entreprises, a compliqué les interactions entre l’univers éducatif et celui de l’entreprise. Il a notamment éloigné le monde patronal de ses responsabilités dans le domaine de la formation.
Suite aux mouvements de grève de mai 1968, les accords de Grenelle prévoyaient une négociation sur la formation professionnelle. Elle s’est ouverte en 1969, avec des objectifs multiples : répondre au besoin en main d’œuvre qualifiée des entreprises, répondre aux aspirations individuelles de promotion liées à la croissance et à la société de consommation, et corriger les inégalités du système scolaire. Ces négociations ont abouti à l’accord national interprofessionnel (ANI) du 9 juillet 1970. La loi Delors du 16 juillet 1971 en a généralisé les principes : la formation professionnelle continue a explicitement pour objet « de permettre l’adaptation des travailleurs au changement des techniques et des conditions de travail, de favoriser leur promotion sociale par l’accès aux différents niveaux de culture et de qualification professionnelle, et leur contribution au développement culturel, économique et social ». Un marché de la formation professionnelle, encadré et intermédié par les partenaires sociaux a été mis en place, en rupture avec le monde de la formation initiale, perçu comme trop rigide et trop théorique.
Cette loi, conçue dans une période de croissance, a été mise en œuvre dans une période de crise. Dans les années 1980, l’enseignement technique et professionnel a notamment été affecté par la conjoncture économique et les mutations sociales. Les politiques de formation sont devenues surdéterminées par la problématique du chômage, la promotion sociale étant progressivement laissée de côté. C’est de ces années que date le revirement du système en faveur de l’allongement des études des jeunes. Un objectif de 80 % d’une classe d’âge au niveau du baccalauréat est fixé, l’Éducation nationale crée le baccalauréat professionnel (1985) afin de revaloriser cet enseignement et réduit en parallèle le nombre de CAP. Pour autant, l’idée de spécialisation dès la sortie de la troisième demeure. Les jeunes orientés vers l’enseignement professionnel sont souvent en échec dans les filières générales ; les formations dispensées dans le système d’enseignement professionnel sont volontairement peu complexes.
On considère à cette époque que la population salariée en place, entrée dans l’industrie avec un faible niveau de qualification et de diplôme sur des postes très spécialisés, est inapte à accompagner les transformations du système de production industrielle (nouvelles organisations du travail liées notamment à l’apparition de nouvelles technologies et à l’internationalisation des marchés). Le système est porté par les grands groupes – les champions nationaux – qui confortent une représentation du monde industriel très dépendante des ingénieurs et des techniciens et, dans une moindre mesure, de la qualification ouvrière. L’amélioration du niveau de formation professionnelle initiale des nouveaux embauchés rend la formation continue moins nécessaire. L’entrée « par le haut » des jeunes diplômés va empêcher la promotion des salariés en place.
Parallèlement, l’alternance et l’apprentissage apparaissent comme une solution pour favoriser la qualification et l’insertion des jeunes dont le taux de chômage augmente fortement. Du coté des industriels, ces dispositifs sont plébiscités pour adapter les compétences aux nouvelles formes d’organisation de travail et à leurs besoins à court terme. Mais le flux de jeunes formés reste insuffisant pour répondre au nombre de postes à pourvoir.
Le dispositif de la formation professionnelle continue n’a cessé d’être renforcé et consolidé depuis 1971. De nombreux rapports en ont souligné les effets bénéfiques tout comme les limites. La formation continue n’a notamment pas réussi à se poser comme un complément ou une alternative crédible à la formation initiale, puisque les savoir-faire qu’elle permet d’acquérir ne disposent pas d’une reconnaissance équivalente à ceux de la formation initiale.
Sans revenir sur les nombreuses critiques adressées au système, on note que :
- la formation professionnelle continue ne permet pas l’accès à une seconde chance et renforce donc les inégalités : le dispositif français est marqué par l’importance du diplôme comme mode d’identification des qualifications, voire des compétences, et le poids de la formation initiale dans la trajectoire professionnelle des individus reste déterminant.
- la formation professionnelle continue n’a pas permis de renforcer les possibilités de promotion : la plupart des formations sont courtes, non qualifiantes et non diplômantes, et visent essentiellement à maintenir ou à adapter les qualifications.
Source : réalisé sur la base d’un entretien avec Paul Santelmann, le 7 février 2014
- 52. Protocole d’accord organisant les passerelles entre les CQP de l’industrie pharmaceutique et les CQP des industries chimiques, 20 juin 2013.
- 53. Seibel C., 2001 ; Mériaux O. & al. 2013.
- 54. Céreq Bref, 1991.
- 55. Urieta Y., 2011.
- 56. Gauron A., 2000.
La formation tout au long de la vie en Norvège – BENCHMARK
Le système éducatif norvégien est régulièrement mis en avant pour sa capacité à s’adapter aux besoins des entreprises. Pour autant, considérant que la formation initiale n’était pas à même de répondre à elle seule aux défis posés par les mutations rapides de l’environnement économique, la Norvège a mené à la fin des années 1990 un programme de réforme visant à construire un appareil de formation tout au long de la vie.
Un système de formation initiale associant les industriels pour mieux répondre à leurs besoins
On observe en Norvège une imbrication étroite entre le monde économique et la sphère éducative. Cette forte proximité s’explique par plusieurs facteurs. D’une part, dans un pays conjuguant une faible taille du marché du travail (2,7 millions d’actifs) et un taux de chômage très bas (3,5 %)57, tout désajustement entre l’offre et la demande de travail a des conséquences importantes en termes de difficultés de recrutement. D’autre part, la main d’œuvre est faiblement mobile du fait des caractéristiques géographiques de la Norvège. À cela s’ajoutent les spécificités du tissu industriel norvégien, composé majoritairement de petites entreprises souvent éloignées les unes des autres.
Pour toutes ces raisons, les acteurs économiques ont été fortement impliqués dans la construction et le développement du système éducatif norvégien. L’enseignement professionnel tel qu’il existe aujourd’hui est apparu dans les années 1890, au moment de la création des premières écoles professionnelles, en partie à l’initiative d’industriels qui demandaient la mise en place d’un système de formation professionnelle.
Le système éducatif norvégien s’appuie ainsi sur l’enseignement professionnel et sur l’alternance pour répondre, au niveau local, aux besoins spécifiques des entreprises industrielles. Après deux années de tronc commun dans l’enseignement secondaire, obligatoires pour tous les élèves, plus de la moitié d’entre eux choisissent de suivre une formation à visée professionnelle. Si l’apprentissage y est moins développé que dans des pays tels que l’Allemagne, l’Autriche ou la Suisse, près de 20 % des jeunes optent chaque année pour ce type de formation.
Les possibilités de réorientation après une formation professionnelle sont nombreuses. Toutes les filières mènent à l’enseignement supérieur, à condition que l’élève ait accompli une formation comprenant trente-cinq heures par semaine d’enseignement général. Celles-ci peuvent être rattrapées sans refaire une année complète en cas d’échec.
Malgré cela, les inégalités du système éducatif norvégien persistent. Un récent rapport d’évaluation de l’OCDE pointe le fait que, malgré les efforts des pouvoirs publics pour rapprocher l’enseignement théorique et l’enseignement professionnel, ce dernier a toujours tendance à être emprunté par les étudiants aux capacités scolaires les plus faibles. Par ailleurs, le taux d’élèves quittant le système éducatif prématurément est très élevé en Norvège (14,8 %, contre 11,6 % en France en 2012).
La construction progressive d’un appareil de formation tout au long de la vie
La Norvège a procédé à une révision complète de son système de formation à la fin des années 1990. Selon la philosophie de ces réformes, la formation initiale ne représente que la première étape d’un processus continu de formation tout au long de la vie, dont les étapes ultérieures n’ont pas obligatoirement pour cadre le système éducatif formel.
L’un des objectifs est de garantir l’adaptation de la main d’œuvre aux besoins des entreprises, dans un environnement où le rythme des mutations économiques, technologiques ou organisationnelles s’accélère. Les connaissances acquises initialement doivent ainsi non seulement préparer les jeunes à leur entrée dans la vie active mais aussi leur donner les bases et les connaissances nécessaires pour qu’ils puissent apprendre tout au long de leur vie.
Une première réforme, adoptée en 1994, a ainsi porté sur la structure du système éducatif et le contenu des formations. L’idée était de faire une place plus large à l’enseignement théorique dans les filières professionnelles et, en contrepartie, d’axer la formation sur l’emploi dans toutes les disciplines. Cette logique a été poursuivie en 2006 avec l’adoption du programme de réforme baptisé « Promouvoir les connaissances ». Concrètement, ces mesures ont conduit à une intégration plus forte entre les filières de formation professionnelle et d’enseignement général.
Un autre pan de la Reform 94 a consisté à faire passer le système éducatif d’une logique de savoirs à une logique de compétences – notion plus large intégrant à la fois les capacités intellectuelles, la créativité et les aptitudes manuelles et sociales – afin d’assurer une meilleure continuité entre la formation initiale et la formation continue.
La Réforme de la compétence a ensuite été adoptée en 1998, marquant l’entrée en vigueur de dispositifs tels que le congé de formation, l’évaluation et la reconnaissance des antécédents de formation non formels des adultes, la suppression de dissuasions fiscales en matière de formation, etc.
À partir de 2001, l’accès à l’enseignement supérieur est devenu un droit pour tous les adultes de plus de 25 ans justifiant d’une expérience professionnelle suffisante. La totalité de l’offre d’enseignement est aujourd’hui ouverte à tous les groupes d’âge. La formation professionnelle initiale et la formation continue s’inscrivent dans le même système, les mêmes textes, les mêmes programmes.
Une démarche de coordination facilitée par une culture du dialogue social
Le système de formation professionnelle est aujourd’hui organisé par l’État, sous l’égide du ministère de l’Éducation et de la recherche (UFD). Les partenaires sociaux y jouent un rôle actif. Ils sont par exemple directement impliqués dans l’élaboration du contenu des formations, des programmes et des examens de formation professionnelle.
Ils sont représentés dans de nombreuses instances telles que, par exemple, le Directorat pour l’éducation et la formation professionnelle. Ce dernier, qui assiste les pouvoirs publics, a notamment pour mission de définir la liste des métiers qui peuvent être préparés par l’apprentissage.
L’influence des partenaires sociaux a également été importante dans la préparation et la mise en œuvre des récentes réformes, notamment par le biais de leur représentation officielle dans les instances nationales de conseil, mais aussi grâce à leur coopération informelle avec les structures administratives et politiques aux niveaux national et régional. Anne-Lise Høstmark Tarrou rappelle que « le modèle de gestion tripartite est bien développé en Norvège, dans tous les secteurs et à tous les niveaux de la société. L’implication des partenaires sociaux et leur collaboration avec les autorités de tutelles est ainsi facilitée. »
- 57. Statistics Norway, 2013.
Accompagner les mutations industrielles par des formations adaptées
A. Soutenir la montée en gamme de l’industrie par l’élévation des compétences et des qualifications des salariés en place
Le rapport pour la croissance, la compétitivité et l’emploi le rappelait encore en novembre 201258 : « l’industrie française doit sortir d’une spécialisation internationale insuffisamment différenciée qui la prend dans la tenaille des industries ‘haut de gamme’ d’un côté et des industries à ‘bas coûts’ de l’autre. Elle ne pourra le faire qu’en montant en gamme. » Cette nécessaire montée en gamme, qui accompagne les transformations de l’appareil productif, impose également une élévation du niveau de compétences du personnel, à tous les niveaux de qualification.
Or, de l’avis de nombreux contributeurs au débat, le faible développement de l’appareil de formation continue se fait particulièrement ressentir pour les plus bas niveaux de qualification. Selon Paul Santelmann « notre système a longtemps été dominé par une représentation qui consistait à croire que l’industrie ne pouvait être portée que par des ingénieurs, des cadres de haut niveau. Il faut dire aussi que la formation continue est un investissement qui coûte cher sur ces profils. Une formation de soudeur est plus lourde qu’une formation de cadre qui ne nécessite pas de matériel. » Il remarque aussi que « le contenu actuel des BTS et des DUT reste hors de portée d’un certain nombre de salariés, entrés dans l’industrie avec un faible niveau de diplôme et qui souhaitent évoluer vers des qualifications intermédiaires. » Il ajoute qu’il y a aujourd’hui « des centaines de milliers de trentenaires et de quadragénaires qui ont obtenu un Bac professionnel ou un BTS industriel dans les années 1990 et qui n’ont guère vu leurs compétences optimisées ni diversifiées. C’est cette population qui devrait être au cœur d’une politique de montée en compétences, irriguée par les innovations technologiques en œuvre. »
À titre d’exemple, des besoins en qualifications et compétences vont se renforcer en matière de diagnostic opérationnel, d’expertise technique, de maintenance, de traitement de matériaux, etc. « En lien avec les enjeux environnementaux ces compétences se diffuseront d’autant plus facilement qu’elles seront portées par les professionnels en place plutôt que par le seul apport de nouvelles générations. »
Certains industriels ont pris conscience de ce phénomène et s’investissent dans la montée en compétences de leurs salariés. L’organisation professionnelle Allizé-plasturgie, par exemple, a mis en place le dispositif ADC+ (Action de développement des compétences) en 2013, afin de faire monter en compétences, via des CQP, les salariés des entreprises du bassin tout en assurant leur remplacement. Pour ce faire, une équipe de dix intérimaires a été formée pour prendre la place des salariés en formation. Poclain Hydraulics (transmissions hydrostatiques) a pour sa part mis en place un programme baptisé « Skill in », qui, en complément de l’évaluation réalisée avec les managers lors des entretiens annuels, donne la possibilité à ses salariés « d’accroître de façon continue leurs compétences et leur employabilité. » Laurent Bataille, PDG du groupe, explique : « ce programme consiste à choisir une première série de postes clé pour le groupe (applications, méthodes, maintenance, acheteurs) et de définir pour chacun de ces métiers un référentiel de compétences que nos collaborateurs doivent posséder. L’évaluation des compétences est réalisée au travers d’un questionnaire permettant d’évaluer l’écart entre les compétences personnelles de chaque salarié, ce référentiel et le niveau de maîtrise attendu pour chacune des compétences. En fonction des résultats obtenus, les collaborateurs se voient alors proposer des formations à la carte. »
Emmanuelle Wargon, déléguée générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP), reconnaît toutefois que « les gains de productivité que l’on peut attendre de la formation sont d’autant plus significatifs que les salariés ont un niveau de formation élevé et qu’ils occupent des postes à responsabilité, qui leur permettent de réinvestir les acquis de la formation. En outre, ces derniers ont des capacités d’apprentissage particulièrement adaptées au cadre formel des stages, qui constituent le modèle pédagogique le plus répandu en France. De ce fait, il est rationnel pour les entreprises de concentrer l’effort de formation sur les personnes les plus diplômées ou celles occupant les postes les plus qualifiés. » Mais, précise-t-elle, « la compétitivité d’une entreprise ne se réduit pas à la somme des compétences individuelles ; elle résulte aussi de la construction d’une compétence collective, qui produit pour toute l’économie des externalités positives. »
Face à ces risques de concentration de l’effort de formation des salaries vers ceux qui sont déjà le plus formés, Emmanuelle Wargon relève que « la première réponse de l’État a été de rompre au milieu des années 1980 avec l’approche malthusienne du système de formation initiale en élevant substantiellement le niveau de sortie du système scolaire. Cependant, les sorties sans diplôme continuent à alimenter chaque année un nombre important d’actifs qui ont et auront des difficultés d’accès, non seulement à l’emploi en raison de la sélectivité du marché du travail mais aussi à la formation continue. »
Selon André Gauron, « il faudrait aussi que l’État et les économistes tiennent un discours différent de celui qui domine aujourd’hui, qui vise à subventionner les emplois peu qualifiés à travers les exonérations de charges sociales sur les bas salaires. Cette politique est suicidaire : non seulement elle livre un signal négatif aux entreprises en les incitant à multiplier les emplois peu qualifiés mais, plus grave, elle crée également un différentiel croissant de coût pour les techniciens, ingénieurs et cadres avec nos pays voisins. Les entreprises sont de ce fait incitées à installer leurs centres de recherche-développement en Allemagne ou en Grande-Bretagne et à garder en France des emplois moins qualifiés. Il ne suffit pas de subventionner des entreprises pour créer des emplois, il est aussi nécessaire de s’interroger sur leur qualité et donc leur viabilité. »
B. Faciliter les reconversions grâce aux « passerelles métiers »
De nombreux contributeurs au débat l’assure : « nous faisons face à une accélération des transformations de l’appareil de production qui se traduit par l’effondrement de certains secteurs et l’émergence de nouvelles activités. La reconversion des demandeurs d’emploi et des salariés devient essentielle. » Les « passerelles métiers » représentent donc un enjeu important pour les entreprises industrielles, permettant à des salariés d’un secteur d’acquérir les compétences nécessaires pour exercer dans un autre secteur.
Les acteurs de l’intérim peuvent être fortement impliqués dans la mise en place de telles passerelles ; ils ont en effet une bonne connaissance des besoins des entreprises et voient des intérimaires exercer un même métier dans des entreprises différentes. Randstad, spécialiste du travail temporaire, de l’outplacement et de la formation, forme ainsi des professionnels de l’automobile aux métiers de l’aéronautique.
Témoignage d’Abdel Aïssou, directeur général du groupe Randstad France
Des « passerelles métiers » entre des professionnels de l’aéronautique et de l’automobile
Alors que la crise a chahuté l’industrie automobile en Europe et en France, l’industrie aéronautique vole de record en record. Tirés par la forte croissance mondiale du trafic aérien, les carnets de commande des grandes entreprises du secteur sont au beau fixe. Avec, à la clé, du travail garanti pour les cinq à dix prochaines années. Or, face à l’accélération des rythmes de production, certaines entreprises du secteur peinent à suivre la cadence, en raison notamment de difficultés de recrutement qui se traduisent, selon les années, par 3 000 à 6 000 postes non pourvus.
Face à ce constat, Randstad conduit depuis le printemps 2012 un programme inédit : former aux métiers de l’aéronautique des professionnels de l’automobile souhaitant se reconvertir. Le fonctionnement de cette passerelle repose sur un socle de compétences techniques similaires et sur une ingénierie de formation forte.
Randstad a dans un premier temps identifié une dizaine de qualifications pour lesquelles une reconversion était envisageable. Près de 500 techniciens de l’automobile ont ensuite été contactés. Ils ont passé, dans les agences du groupe, des tests métiers et sécurité. Une fois les tests validés, les formations ont pu débuter. Randstad en avait préalablement défini le contenu pédagogique en appui avec des acteurs tels que l’AFPI, l’AFMAé ou l’AFPA.
Au terme de ces formations longues – six à dix semaines en moyenne, les salariés engagés dans la passerelle ont tous décroché un premier contrat de mission, de trois ou six mois. Avec la possibilité réelle de voir le contrat transformé en CDI.
Pourtant, au final, seul un petit nombre de personnes a basculé de l’automobile vers l’aéronautique. En cause, des freins géographiques, financiers et peut-être culturels, qui ont rendu complexe une telle reconversion.
Néanmoins la démarche demeure pertinente. Randstad a ainsi étendu la passerelle à d’autres secteurs que l’automobile, l’ouvrant notamment à des techniciens issus de l’agroalimentaire, de la mécanique et de la maintenance.
L’ambition, partagée avec la passerelle, est la même : placer la formation professionnelle au cœur du processus d’accès à l’emploi pour en faire un pari gagnant.
Selon Françoise Diard, les « passerelles métiers présentent plusieurs avantages : elles permettent par exemple, lors d’un plan de sauvegarde de l’emploi, de garder les compétences dans la branche, dans un bassin d’emploi. De plus, l’entreprise bénéficiaire gagne du temps pour trouver une main d’œuvre rapidement opérationnelle, puisque ces passerelles s’appuient sur des métiers au socle de compétences techniques similaire. » Elle relève toutefois que, « si de nombreux efforts ont été menés récemment pour encourager ces passerelles, il faut encore aller plus loin en initiant ce que l’on pourrait appeler des ‘mobilités prévisionnelles’, qui anticiperaient les mutations sectorielles. Cela suppose de travailler de façon approfondie avec les acteurs de l’emploi au niveau d’un bassin ou d’un territoire (Régions, Dirrecte, etc), mais la coordination des acteurs peut prendre du temps. »
Elle ajoute que « ces passerelles métiers nécessitent naturellement d’adapter les salariés à une nouvelle culture, ce qui est plus ou moins difficile selon les secteurs. » Selon Paul Santelmann, « certains métiers prédisposent à la polyvalence et d’autres à l’hyperspécialisation. Ces paramètres sont à prendre en compte pour rompre la tradition de cloisonnement entre les métiers et les secteurs. Une réelle réflexion est à conduire sur la façon dont les savoirs peuvent se transférer sur d’autres champs d’activité. » Selon lui, deux étapes sont nécessaires : distinguer le contenu du contexte de travail et travailler sur la stratégie d’apprentissage
(cf. Graphique 6).
Graphique 6. La mise en place des « passerelles métiers » en deux étapes
Source : Entretien avec Paul Santelmann du 7 février 2014
C. Répondre au défi des métiers en tension par la formation des personnes éloignées de l’emploi
Jean-Claude Thoenig, professeur émérite à l’université Paris-Dauphine, rappelle que « les chômeurs de longue durée ne parviennent pas à intégrer le monde du travail faute de qualification reconnue. Ils peuvent certes détenir le savoir-être nécessaire pour occuper les postes proposés par les entreprises mais ces dernières
ne souhaitent pas courir le risque de recruter des personnes sans qualification. » La formation de ces dernières
aux métiers industriels représente en effet un investissement lourd pour une entreprise. Elle peut toutefois retrouver une pleine justification économique face à la pénurie de candidats, notamment sur les métiers dits « en tension », où le flux de jeunes formés n’est pas suffisant. Les personnes éloignées de l’emploi constituent alors un gisement de main d’œuvre.
Pour cela, la grande majorité des experts et des acteurs jugent impératif de sortir d’un monde « normé », qui valorise les candidats uniquement en fonction de leur diplôme initial. Selon André Gauron, « la recherche des chômeurs de longue durée ayant les bons profils (attitudes, connaissances de base…) est une tâche qui doit revenir à des interlocuteurs formés et pertinents. Il existe un grand nombre de structures et d’institutions publiques qui pourraient réallouer du personnel à cette mission. »
Parmi les bonnes pratiques existantes, on peut souligner le rôle des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ). Thierry Chevallereau, directeur du GEIQ Industrie Poitou-Charentes, explique que ces structures « rassemblent des entreprises qui, pour résoudre leurs problèmes de recrutement, embauchent des personnes éloignées de l’emploi afin de les qualifier et de les amener vers un emploi durable. En plus du parcours de formation en alternance proposé, les personnes bénéficient d’un accompagnement social et professionnel. » Denis Boissard, directeur de projets de l’UIMM, signale que, « depuis 2009, la branche métallurgie, via son fonds Agir pour l’insertion dans l’industrie (A2i), a contribué à la création de sept GEIQ industriels59 et au développement de cinq autres60 ». Le fonctionnement des GEIQ repose sur un certain nombre de conditions : l’appui d’une branche professionnelle, la création et le maintien d’un réseau de partenaires (service public de l’emploi, Direccte, organismes de formation…), un contexte économique local offrant un nombre suffisant d’entreprises donc de besoins en compétences, et de candidats ou encore des mesures financières de la part de l’État et des collectivités territoriales afin de proposer un prix attractif (le temps de travail des salariés du GEIQ est facturée aux entreprises).
Denis Boissard rappelle que, « plus globalement, le fonds A2i soutient financièrement 116 actions territoriales permettant à des jeunes en échec scolaire, des chômeurs de longue durée, des allocataires du RSA, des personnes handicapées, des détenus proches de leur sortie de prison, etc. d’accéder à une formation qualifiante et à un emploi dans les entreprises de la métallurgie. Ces actions, portées sur le terrain par le réseau territorial de l’UIMM, réalisées en partenariat avec des structures d’insertion par l’activité économique, bénéficient à un public potentiel de 13 000 personnes. »
Par ailleurs, la préparation opérationnelle à l’emploi (POE) individuelle permet à une entreprise de bénéficier d’une aide financière pour former un demandeur d’emploi, préalablement à son embauche, en vue de lui faire acquérir les compétences nécessaires à la tenue du poste à pourvoir. Elle est un bon moyen de faire face à la pénurie de main d’œuvre. Françoise Diard cite par exemple le cas du métier – en tension – de contrôleur non destructif : « il y a aujourd’hui une exigence forte dans les entreprises pour contrôler les pièces sans détruire la matière, car les pièces coûtent cher. Face à une pénurie de main d’œuvre, le Groupe des industries métallurgiques (GIM) en Île-de-France a monté des POE qui impliquent une ingénierie de pédagogie et de formation importante. Le niveau de compétences attendu suppose de bien évaluer en amont les personnes qui vont entrer dans ces parcours ; la réussite du POE en dépend. Un partenariat avec Pôle emploi amène des candidatures présélectionnées. La branche, quant à elle, indique à partir des besoins des entreprises
le nombre de postes à pourvoir. »
Témoignage de Martin Richer, consultant en responsabilité sociale des entreprises et coordonnateur du pôle « Affaires sociales » de Terra Nova
La formation professionnelle, un levier de la RSE
En entrant résolument dans l’économie de la connaissance, l’industrie française développe ses investissements immatériels. La formation professionnelle continue est la principale forme d’investissement dans le « capital humain ». Mais contrairement aux machines et équipements, qui restent dans l’entreprise jusqu’à amortissement ou déclassement, ce capital de compétences est mobile : les salariés actuellement en poste connaîtront en moyenne 6 à 7 employeurs différents au cours de leur carrière. C’est pourquoi la formation professionnelle doit être analysée sous l’angle de son empreinte sociale : en formant ses salariés, une entreprise travaille à sa propre compétitivité, mais aussi à celle des salariés formés, ce que l’on désigne d’un terme barbare qui mérite une analyse critique, l’employabilité61. C’est en cela que la formation constitue un aspect majeur de la responsabilité sociale des entreprises (RSE).
L’approche de la RSE, qui s’intéresse aux impacts sociaux et environnementaux de l’entreprise sur son écosystème et ses parties prenantes, nous invite à porter un regard plus qualitatif sur la politique de formation menée par les organisations privées et publiques. Au-delà des indicateurs quantitatifs globaux (dépense en formation, taux d’accès), cinq critères prennent de l’importance.
- La répartition par qualifications. Certaines entreprises se contentent de livrer bataille sur le segment du marché du travail le plus en déséquilibre et forment en priorité leurs « hauts potentiels », qu’elles appellent aussi leurs « talents ». Ce faisant, elles perpétuent le « vice originel » de notre système de formation, qui profite le plus à ceux qui sont déjà les mieux dotés et laisse sur le bord de la route les salariés les moins qualifiés. Mais lorsque les mutations technologiques et industrielles s’accélèrent, ce sont ces derniers qui en payent le prix… et deviennent une charge pour la société (indemnisation chômage et coûts sociaux). D’autres entreprises, au contraire, ont compris que la compétitivité d’une entreprise ne peut dépendre seulement de quelques individus mais au contraire, mobilise des processus collectifs.
- La nature des formations. Certaines entreprises se contentent de former leurs salariés dans l’objectif d’être toujours plus efficaces, plus productifs dans leur poste. Ce faisant, elles « fixent » leurs collaborateurs dans leur emploi, sans se préoccuper de les doter des savoir-faire de base leur permettant d’évoluer, de progresser de postuler à un poste plus qualifié. D’autres entreprises, au contraire, encouragent leurs salariés à acquérir des compétences transversales et transférables car elles savent que les mutations sont permanentes et s’accélèrent : mieux vaut privilégier l’agilité et l’adaptabilité. Ces organisations apprenantes permettent aux salariés de progresser au sein de leur entreprise et de « rebondir » plus rapidement s’ils sont amenés à la quitter.
- L’évolutivité des formations proposées. Certaines entreprises ont mis en place des processus de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) permettant une mise en question périodique de leur stratégie, une traduction (quantitative et qualitative) de cette dernière en termes d’emplois et sur cette base, une re-conception de leur plan de formation. Cela permet par exemple, d’anticiper une diminution des besoins de travail dans certains métiers et de former les salariés concernés pour leur permettre de prendre d’autres tâches. La formation devient ainsi la pierre angulaire de la sécurisation des parcours professionnels. D’autres entreprises, au contraire, ne se préoccupent guère de l’alignement de leurs actions de formation (résultant de demandes au coup par coup et à courte vue) avec l’évolution de leur environnement concurrentiel et de leur stratégie.
- L’accompagnement des salariés. Certaines entreprises ont compris que laisser les salariés « seuls face à leur employabilité » et à la complexité des dispositifs de formation, revient à accepter que seuls les plus qualifiés réussissent. Elles mobilisent leur direction des ressources humaines et surtout leur management de proximité pour soutenir les collaborateurs dans la construction de leur parcours professionnel et la mobilisation des dispositifs adéquats (formation bien sûr, mais aussi situations apprenantes, valorisation des acquis, tutorat, coaching, etc.). Elles s’assurent que la question de la formation est abordée lors des entretiens professionnels avec tous les salariés, et non seulement avec les cadres et techniciens…
- La connexion au dialogue social. Certaines entreprises mobilisent le dialogue social de façon à ce que leurs initiatives de formation soient mieux portées et diffusées dans l’entreprise. Elles négocient loyalement les orientations, voire le contenu, de leur plan de formation avec leurs organisations syndicales ; elles consultent leur comité d’entreprise (ce qui est obligatoire) mais surtout tiennent compte de leurs remarques (ce qui n’est pas obligatoire mais se révèle souvent utile) ; elles donnent à la commission formation des moyens de fonctionner.
En termes de RSE la problématique est simple : sur ces cinq critères, les entreprises sont actuellement traitées de la même manière, qu’elles mettent en œuvre les bonnes pratiques ou au contraire « gèrent a minima ». Ainsi, par exemple, Marie Salognon, chercheuse associée à EconomiX, a montré que « la formation professionnelle dispensée lors du dernier emploi permet un raccourcissement de la durée de chômage »62. Il faut donc créer des incitations à agir de manière socialement responsable, c’est-à-dire en tenant compte des impacts sur la société. Je citerai deux orientations possibles sur lesquelles travaille Terra Nova.
- La modularisation des cotisations chômage acquittées par l’employeur. Cette idée de « conditionner les cotisations d’assurance-chômage sur la qualité de la politique de formation » a été émise initialement par deux économistes, Mathilde Lemoine et Étienne Wasmer, dans leur rapport pour le CAE, « Les mobilités des salariés », publié en mai 2010. Elle se fonde sur le constat qu’une politique de formation de qualité (qui profite à la vaste majorité des salariés, qui privilégie les compétences transversales, etc.) place les salariés qui quittent l’entreprise en capacité plus favorable pour retrouver rapidement un emploi de qualité.
- La mise en visibilité de la politique de formation par la notation sociale. Cette notation permet de valoriser les employeurs qui investissent dans une formation socialement responsable, d’améliorer ainsi leur réputation et leur attractivité. Elle guide les choix des candidats dans les processus de recrutement et s’inscrit dans la politique RSE des entreprises. Cette notation peut s’appuyer entre autres sur des indicateurs proposés par le groupe de travail évoqué par Jean Wemaëre, président de la Fédération de la formation professionnelle63.
Depuis la première loi qui a posé les fondations de la formation professionnelle continue (loi Delors de 1971), les ambitions fortes ont progressivement laissé place à une fuite éperdue dans la construction de dispositifs sophistiqués (pourquoi le CPF réussirait-il, là où son prédécesseur, le DIF, a échoué ?) qui ignorent la capacité des acteurs sociaux à s’en emparer. Conséquence : les réformes se succèdent (au rythme d’une tous les trois ans cette dernière décennie) mais la réforme piétine. Il faut maintenant inverser la logique en renforçant les acteurs pour reprendre la voie des transformations sociales impulsées par le terrain, celle de la RSE.
- 58. Gallois L., 2012.
- 59. Dunkerque, Brest, Nantes, Chalon-sur-Saône, Poitiers, Pau, Tarbes.
- 60. Sedan, Strasbourg, Besançon, Auxerre, Bagnols-sur-Cèze.
- 61. Voir : Martin Richer, « RSE et emploi : construire les compétences, développer l’employabilité », Management & RSE, 8 novembre 2013
- 62. Étude du CAS, « L’exclusion professionnelle, quelle implication des entreprises ? »
- 63. Voir l’encadré page 26
VOLET 3 – Investir dans la formation tout au long de la vie pour soutenir la compétitivité industrielle
Le regard des acteurs sur les avancées portées par la loi du 5 mars 2014
A. Rendre efficaces les dépenses de formation : le passage de l’obligation de payer à l’obligation de former
Faisant suite à l’accord national interprofessionnel (ANI) du 14 décembre 2013, la loi du 5 mars 2014 supprime l’obligation légale de formation instituée par la loi Delors de 1971. Cette dépense de formation à la charge des entreprises était exprimée en pourcentage de la masse salariale. Selon Dominique Gillier, secrétaire générale de la CFDT-FGMM, « cette obligation a pu occasionner des gaspillages : saupoudrage de dépenses de formation sans véritable objectif de compétences, formation « récompense » sans objectif professionnel, tolérance de prix élevés d’organismes dispensateurs « amis » ou moindre attention au rapport qualité-prix avec parfois surcharge de luxe des coûts, etc. »
Pour Emmanuelle Wargon, « en supprimant l’obligation fiscale, on redonne des marges de manœuvre aux entreprises pour décider des formations les plus utiles à leur développement. En contrepartie, l’obligation de l’employeur de maintenir les compétences et de développer l’employabilité de ses salariés est réaffirmée. Le texte renforce l’implication de l’ensemble du collectif de travail dans la politique de formation de l’entreprise, via la consultation des instances représentatives du personnel et l’inscription dans la négociation d’entreprise. »
André Gauron souligne que « le basculement de l’obligation de payer vers l’obligation de former a longtemps été freiné par la crainte, exprimée avec force lors de la négociation de l’ANI, de voir les organismes de collecte privés d’une partie de leurs ressources. Ce risque est réel mais le maintien d’une taxe destinée à financer la mutualisation devrait en réduire l’impact sur la formation elle-même. Devant cette difficulté, une autre voie avait été choisie par Martine Aubry, alors ministre du Travail. Elle avait, en 2002, introduit dans sa loi de modernisation sociale l’obligation d’une adaptation au poste de travail comme élément constitutif du contrat de travail. Celle-ci a conduit des entreprises à privilégier les formations courtes, au détriment des formations plus longues visant au développement des compétences. »
Henri de Navacelle affirme que « la suppression de l’obligation légale soulève également la question de l’attractivité de la formation pour les entreprises. Pour ces dernières, les dépenses de formation ne sont plus considérées comme une taxe mais comme un réel investissement. L’État n’a pourtant pas prévu de dispositif de soutien tels qu’une règle d’amortissement qui serait applicable à ces dépenses, au même titre que les autres investissements matériels ou immatériels. »
Dominique Gillier relève que « le risque de voir diminuer les moyens de la formation, s’il est réel, doit être relativisé. Des entreprises sous forte contrainte économique peuvent certes opérer un arbitrage défavorable à la formation. Mais on ne peut sérieusement imaginer qu’une entreprise ne forme pas ses salariés si elle en a réellement besoin. » Par ailleurs, il rappelle trois éléments. Premièrement, la plupart des entreprises, notamment toutes les grandes, consacrent à leur plan de formation des moyens largement supérieurs à l’obligation légale minimale. Deuxièmement, l’obligation subsiste intégralement pour les entreprises de moins de dix salariés (0,4 % de la masse salariale) et partiellement pour celles comprenant entre 10 et 49 salariés (0,2 % au lieu de 0,7 %). Troisièmement et enfin, les formations correspondant à des obligations de l’employeur (sécurité par exemple) ou aux habilitations nécessaires des salariés demeureront.
B. Le compte personnel de formation : un droit à la qualification créant un continuum entre la formation initiale et la formation continue
Emmanuelle Wargon précise que, avec le compte personnel de formation (CPF) « la loi reconnaît à chaque salarié un droit à la capitalisation et à la mobilisation d’heures de formation, jusqu’à 150 heures, financées par une contribution spécifique de l’entreprise. Ces heures ont vocation à être abondées par l’employeur, par accord d’entreprise ou de branche, et ne peuvent être utilisées que pour des formations qualifiantes ou certifiantes (en dehors de la remise à niveau pour les savoirs de base). À travers ce compte personnel de formation, est enfin reconnue la possibilité pour toute personne de s’inscrire dans un parcours de formation qualifiante, utile pour elle et pour l’ensemble de l’économie. »
Selon Dominique Gillier, le compte personnel de formation doit être un instrument supplémentaire de la qualification : « les droits acquis au titre du CPF sont obligatoirement réservés au financement de formations qualifiantes, identifiées par les partenaires sociaux comme répondant à des besoins de l’économie et sécurisant le parcours des salariés (art. 12 de l’ANI). » Mais tout dépendra de l’investissement et de la sélectivité des financeurs et des usagers du CPF (concentration sur des projets qualifiants ou saupoudrage sur des formations d’adaptation), de l’intérêt que lui trouveront les entreprises et les salariés et de l’adaptation de l’offre. Concrètement, cela se vérifiera au travers :
des objectifs prioritaires donnés à la formation par les entreprises et les autres prescripteurs (Pôle emploi notamment), mais aussi par les salariés eux-mêmes, en termes de projet professionnel ;
- des moyens supplémentaires apportés au CPF (abondements des entreprises, des branches et des collectivités publiques, temps des salariés) ;
- de l’efficacité pédagogique et économique des organismes dispensateurs de formation : rapport qualité-coût, réalisation de gains de productivité n’affectant pas la qualité (formation ouverte et à distance par exemple), évaluation des acquis de la formation ;
- de l’évolution accélérée et généralisée des certifications professionnelles.
Les certifications professionnelles sont des outils essentiels pour les salariés et les entreprises qui ont besoin de repères fiables, partagés, attestant de la réalité des compétences. Leur définition incombe aux branches ; c’est le cœur de leur légitimité. Mais c’est aussi une mission de l’Éducation nationale, qui doit donc se saisir de cet accord en favorisant la coopération avec les entreprises et en valorisant, dans l’orientation des jeunes, les filières de formation professionnelle.
Pour André Gauron, « le compte personnel de formation est l’un des grands enjeux de l’accord. Mais cela implique de la part des entreprises, notamment des PMI, de lier la formation à une stratégie de montée en gamme et donc d’innovation.
La portabilité du compte personnel de formation constitue un indéniable progrès par rapport au droit individuel à la formation (DIF). Il risque cependant de souffrir des mêmes défauts : un droit ouvre une opportunité mais son existence ne suffit pas pour que les salariés s’en saisissent64. La formation n’est pas seulement l’affaire de l’individu. Elle doit participer d’une démarche collective de l’entreprise. Pour s’investir dans une formation, les salariés, notamment les moins qualifiés, ont besoin de s’inscrire dans une perspective d’évolution de carrière. C’est la force du système dual allemand, qui lie formation, qualification et évolution professionnelle dans le cadre de conventions collectives de branche. Ce lien n’existe plus en France depuis longtemps, faute de véritable négociation sur les qualifications – dans la métallurgie, la dernière remonte aux années 1970.
Créer un lien entre formation et évolution des compétences suppose que l’entreprise se projette à un horizon de trois ou cinq ans mais aussi qu’elle modifie en profondeur sa gestion des compétences et privilégie la formation interne à la ‘cueillette’ externe ».
C. Le nouveau rôle des Régions
Les Régions occupent une place centrale dans la régulation formation-emploi. Depuis 1982, elles disposent de la compétence de droit commun en matière de formation professionnelle et d’apprentissage. Après plusieurs mouvements de transfert de compétences, la loi du 5 mars 2014 leur confère un pouvoir renforcé en matière de formation professionnelle comme de développement économique.
- 64. Gauron A., 2014.
Témoignage d’Alain Rousset, président de l’Association des régions de France (ARF) et du Conseil régional d’Aquitaine
Des stratégies régionales de formation au plus près des besoins des entreprises
En leur confiant une compétence pleine et entière sur le champ de la formation professionnelle, de l’apprentissage et de l’orientation, l’État a reconnu la capacité des Régions à articuler plus étroitement les politiques de développement économique et d’innovation avec les politiques de formation professionnelle.
Ainsi, ces politiques tiendront mieux compte de la diversité des histoires régionales et du dynamisme des acteurs des territoires. Les Régions connaissent les entreprises de leurs territoires, quels que soient leur taille et leur secteur d’activité. Elles les aident à s’inscrire dans des stratégies de filières, de collaboration entre grands groupes et PME. Elles les accompagnent dans leurs projets de développement et d’innovation mais aussi de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, afin qu’elles puissent recruter demain les salariés bien formés dont elles auront besoin.
Dès lors, des stratégies se mettent en place pour réorienter, par la formation, des salariés souvent peu qualifiés et peu mobiles vers des métiers plus porteurs. Un bel exemple est donné par l’entreprise de ballerines Repetto qui, avec l’aide du Conseil régional d’Aquitaine, a créé sa propre école de pré-recrutement dans un lycée professionnel en Dordogne, sur les métiers du cuir et du luxe.
La Région a financé les équipements du centre de formation, les parcours de pré-qualification des demandeurs d’emplois et les formations de professionnalisation des salariés. Cette réalisation est exemplaire à plus d’un titre : elle a permis de préserver des savoirs faire très pointus, de reconvertir sur ces métiers des demandeurs d’emplois issus de secteurs professionnels parfois très éloignés (boulangerie par exemple), de garantir à l’entreprise qu’elle sera en mesure de faire face à ses besoins de recrutement et donc de développement dans les années futures.
Le continuum entre l’élaboration de la carte des formations, l’orientation, l’accompagnement vers l’emploi et le développement économique est indispensable à la réussite des entreprises sur les territoires.
À la suite de la définition des 34 plans industriels et des 7 défis pour l’avenir, dont la transition énergétique ou la silver economy, les Régions doivent réinterroger leur offre de formation et la rendre encore plus réactive et pointue par rapport aux besoins actuels et futurs exprimés par les branches professionnelles et les entreprises.
La nouvelle gouvernance quadripartite (État/Région/partenaires sociaux employeurs et salariés) qui va se mettre en place suite à la loi du 5 mars 2014 va faciliter les diagnostics partagés et la mise en commun des stratégies quel que soit le statut des personnes. Tous les spécialistes considèrent que les allers-retours entre situation d’emploi et situation de chômage seront plus fréquents à l’avenir. C’est pourquoi il faut mener une réflexion collective sur les grands enjeux de demain et leurs impacts en matière de formation, y compris en prenant en compte des pédagogies innovantes et des formations plus modularisées.
À l’aube de la crise en 2008-2009, de nombreuses Régions avaient mis en place des dispositifs « former plutôt que chômer », d’abord dans le secteur automobile puis plus largement. Le succès de ces démarches, tout comme la démarche quadripartite qui a présidé à la concrétisation du compte personnel de formation, sont de bonne augure pour cette nouvelle gouvernance régionale qui va se mettre en place dans les prochains mois.
Pour être réellement efficace, il faudra aller plus loin dans le volet 2 de la loi de décentralisation et confier aux Régions l’accompagnement vers l’emploi, tant le service public de l’emploi est actuellement défaillant pour répondre aux besoins des entreprises. La région Aquitaine est candidate à l’expérimentation sur ce point.
La loi investit notamment les conseils régionaux d’une mission de service public : le comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle, tripartite, doit assurer la coordination entre les politiques d’orientation, de formation professionnelle et d’emploi et la cohérence des programmes de formation dans la région.
Selon Dominique Gillier, « les partenaires sociaux assurent, dans le cadre du comité paritaire interprofessionnel régional pour l’emploi et la formation, le déploiement des politiques paritaires définies par les accords nationaux interprofessionnels, en coordination avec les autres acteurs régionaux. Les deux instances devront s’articuler efficacement ; cela ne pourra se faire sans un dialogue social voire une délégation aux partenaires sociaux d’une partie du service public, notamment en matière d’orientation. Les branches professionnelles sur le territoire connaissent en effet les besoins en compétences des salariés et des entreprises.
De son côté, André Gauron souligne que le succès de cette nouvelle gouvernance « dépendra de la capacité des institutions régionales à travailler avec les entreprises et les partenaires sociaux, à savoir les accompagner autant que les mobiliser. La Région devra être à l’écoute des acteurs et se penser comme un facilitateur plus que comme un ordonnateur. » Il existe en effet aujourd’hui de nombreux freins aux coopérations : comme le rappelle Philippe Schwartz, directeur général adjoint au Conseil régional de Lorraine, « chaque acteur doit s’affranchir de ‘ses’ dispositifs, de ‘ses’ publics, de ‘ses’ indicateurs… pour pouvoir instaurer une véritable dynamique de collaboration. »
Paul Santelman observe quant à lui que le pilotage régional a un effet pervers sur l’offre de formation : « pour obtenir des financements du Conseil régional, les organismes doivent former des personnes issues du territoire, l’objectif étant de répondre aux besoins d’emploi locaux. Indépendants les uns des autres, ils ouvrent des formations là où il y a beaucoup d’emplois, donc dans les mêmes types de métiers. Ils n’investissent plus sur des formations où il y a peu d’emplois et qui coûtent cher (par exemple la fonderie, le soudage qui nécessitent des investissements en termes de matériaux, de ressources), ni sur des métiers d’avenir qui ne sont pas encore très nombreux. »
Témoignage de Jacques Barthélémy, avocat conseil en droit social, et Gilbert Cette, professeur associé à l’université de la Méditerranée
La loi du 5 mars 2014 sur la formation professionnelle : une réforme qui en appelle d’autres…
La formation professionnelle est une obligation nationale65. Mais le système français de formation des adultes souffre de défauts l’empêchant d’être un levier essentiel de la compétitivité. Ce système est à la fois complexe, inique et inefficace, mais aussi inintelligible, au mépris d’une exigence constitutionnelle. Il ne permet pas, en particulier pour les moins qualifiés qui en auraient le plus besoin, l’accès à des formations susceptibles de déboucher sur de véritables renforcements de qualification ou de reconversions professionnelles.
Les faiblesses du système de formation professionnelle ont été dénoncées dans de nombreux travaux et rapports. Les partenaires sociaux ont à plusieurs reprises proposé de timides voies de réforme. C’est par exemple le cas des accords nationaux interprofessionnels (ANI) de 2003 et 2009. Mais les réformes inspirées de ces ANI restent largement insuffisantes pour élever significativement l’efficacité de la formation professionnelle. L’ANI du 11 janvier 2013 s’est à nouveau intéressé à la question, proposant par exemple la création d’un compte individuel de formation universel, individuel et transférable, ce qui doit être salué.
Ces propositions ont été transposées dans le Code du Travail par la loi du 14 juin 2013.
L’accord national interprofessionnel (ANI) du 14 décembre 2013 sur la formation professionnelle, transposé dans le Code du Travail par la loi du 5 mars 2014, va dans la bonne direction car divers changements vont améliorer notre système. Évoquons-en quatre. L’organisation d’un entretien de compétence tous les deux ans et d’un bilan tous les six ans entre l’employeur et l’employé concernant la formation et le développement de la qualification des salariés constitue une première ébauche d’un droit de l’employabilité. L’ANI du 14 décembre donne une forte consistance au compte personnel de formation, créé par le précédent ANI du 11 janvier, ce qui permettra la transférabilité des droits individuels à la formation. Le plus grand fléchage prévu des ressources des OPCA devrait renforcer la transparence dans la gestion de ces organismes. L’augmentation des droits à formation des chômeurs est une avancée à souligner.
Pour autant, ces changements demeurent insuffisants et en appellent d’autres. Citons en deux, parmi d’autres. Le premier : l’élaboration d’un droit de l’employabilité qui gagnera à être qualifié de droit fondamental de l’Homme. Il aboutirait par exemple à ce que les dotations de droits au compte personnel de formation ne soient pas uniformes mais dépendent des besoins individuels en termes de formation ainsi que des aspirations à une mobilité professionnelle effective. Le second : il est indispensable que la formation professionnelle ne contribue plus au financement des partenaires sociaux, ce qui mérite explications.
Les ressources de la formation professionnelle contribuent au financement des organisations représentatives patronales et syndicales de salariés, comme cela a été montré et détaillé dans le rapport Perruchot (2011)66. Cette contribution se réalise de trois façons, dont seule la première a été remise en cause par la loi du 5 mars 2014 :
- les partenaires sociaux sont autorisés à récupérer 1,5 % des fonds prélevés auprès des entreprises. Avec une collecte de près de 7 milliards d’euros, ils disposent ainsi de plus de 100 millions d’euros par an, à leur totale discrétion ;
- pour gérer les OPCA, les partenaires sociaux font généralement appel à des personnes issues de leurs rangs. Ils rémunèrent ainsi un grand nombre des permanents ou semi-permanents de leurs organisations, de salariés ou d’employeurs. Les frais de gestion des OPCA sont excessifs. Limités à 9,9 % de la collecte par un arrêté du 4 janvier 1996 (dont 4,9 % pour la gestion administrative et financière et 5 % pour les frais de collecte et d’information), ils représentent près de 700 millions d’euros, ce qui est énorme.
- Surtout, il faut inclure « les sommes reversées dans le cadre de la collecte des fonds de formation professionnelle, suspectées non sans raison d’alimenter des structures de formation pouvant dépendre d’organisations syndicales ou représentatives. » En effet, les partenaires sociaux « participent à la gestion des OPCA (ou d’organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage), dont la mission est de financer des stages de formation, d’autre part les mêmes organisations sont souvent amenées à créer dans leur mouvance des centres de formation. » Ainsi, le nombre des prestataires de formation approche actuellement 60 000, et certains se caractérisent autant sinon plus par leur proximité avec les partenaires sociaux que par leur performances.
La loi du 5 mars 2014 fait disparaitre le « préciput », le remplaçant par un léger prélèvement proportionnel sur la masse salariale de toutes les entreprises. Une réforme encore à venir devrait s’efforcer d’éradiquer les deux autres canaux de financement des partenaires sociaux par la formation professionnelle. En premier lieu, elle devra obliger à une gestion des OPCA moins onéreuse et totalement dédiée à la formation professionnelle. En second lieu, elle devra introduire une certification des prestataires de formation confiée à des agences indépendantes et reposant sur des évaluations d’impact des formations, aujourd’hui inexistantes.
La réforme souhaitable de la formation professionnelle doit être accompagnée de celle du financement des partenaires sociaux et du dialogue social. Il faut ici aller plus loin que les propositions de transparence inscrites dans la loi du 20 aout 2010 (article 10) inspirée, rappelons-le, par la position commune du 9 avril 2008 signée par la CGT et la CFDT. La contribution de la formation professionnelle au financement des organisations représentatives patronales et syndicales de salariés réduit l’efficacité du système, car elle éloigne ses finalités de sa fonction. Elle est aussi un frein à toute véritable réforme à l’initiative des partenaires sociaux.
La démarche de réforme de la formation professionnelle doit également éviter d’aborder le sujet sous l’angle des tuyauteries de financement. Une autre approche est nécessaire à partir d’une réflexion sur les moyens de donner corps à la mise en œuvre effective de l’obligation inscrite dans l’article L. 6321-1 du Code du Travail67, catalyseur d’un droit à l’employabilité dont la formation est le moyen privilégié mais pas le seul.
- 65. L’article L. 6111-1 du Code du Travail énonce ainsi : « La formation professionnelle tout au long de la vie constitue une obligation nationale.
Elle vise à permettre à chaque personne, indépendamment de son statut, d’acquérir et d’actualiser des connaissances et des compétences favorisant son évolution professionnelle, ainsi que de progresser d’au moins un niveau de qualification au cours de sa vie professionnelle. Une stratégie nationale coordonnée est définie et mise en œuvre par l’État, les Régions et les partenaires sociaux. » - 66. N. Perruchot (2011) : « Le financement des syndicats », rapport au Premier ministre, novembre, enregistré sous le n° 4186 le 18 janvier 2012 à l’Assemblée nationale. Les citations qui suivent sont issues de ce rapport.
- 67. L’article L. 6321-1 du Code du Travail énonce : « L’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations. »
Les CAPéCO, ou comment « générer un réflexe formation dans tous les projets économiques » – ACTIONS EN REGIONS
Entretien avec Marie-Claire Quiers, directrice des « Mutations économiques et continuités professionnelles » au Conseil régional de Bourgogne.
1. En quoi les CAPéCO constituent-ils une démarche originale pour mobiliser les acteurs du territoire sur les questions de formation ?
La Région Bourgogne propose depuis 2009 des Contrats d’appui à la performance économique et à l’évolution des compétences (CAPéCO), signés entre l’État, la Région et les branches professionnelles. L’originalité des CAPéCO se trouve dans le fait qu’ils formalisent dans un contrat unique les points ayant trait au développement économique, traités dans les contrats de progrès68, et ceux concernant l’emploi et la formation professionnelle, abordés dans les contrats d’objectifs69. En rapprochant dans un même contrat les aspects « compétitivité » et « compétences », la Région souhaite susciter un « réflexe formation » dans tous les projets économiques et dans la stratégie qu’elle développe. Le capital humain est un levier primordial de développement économique, la formation est donc un élément majeur. Les CAPéCO permettent ainsi d’avoir une approche transverse des entreprises d’une filière (innovation, export, RSE, compétences, formation…) et d’accompagner leur stratégie de développement.
2. Concrètement, comment ces contrats sont-ils mis en place ?
Le CAPéCO se décline par secteur ou filière et définit des démarches collectives pour accompagner les entreprises. La mise en place d’un CAPéCO se déroule en trois phases.
La première, structurante, consiste à réaliser un diagnostic économique-emploi-formation régional sur une filière : typologie des entreprises, taille, concurrence, marchés visés, qualité de la main d’œuvre et offre de formation.
La deuxième définit la stratégie de positionnement et de développement de la filière régionale, par exemple par rapport à la concurrence. Enfin, la dernière phase conduit à l’élaboration d’un plan d’action et en précise les modalités de mise en œuvre avec le soutien des pouvoirs publics
Pour assurer la mise en œuvre de ce plan d’action et agir au plus près des entreprises, la Région et l’État soutiennent les représentants de la filière en leur accordant des crédits d’animation.
À ce jour, quatre CAPéCO ont été signés avec la plasturgie, la pierre, la métallurgie et l’agroalimentaire. D’autres suivront avec le bois ou encore le BTP.
3. Quels sont les facteurs qui ont permis de garantir le succès de ces démarches en Bourgogne ?
La coordination des parties prenantes est facilitée par une culture historique de partenariat et de dialogue dans la région. La Région travaille de manière concertée avec les représentants des milieux socio-économiques et l’État depuis de longues années notamment dans le cadre des contrats d’objectifs.
4. Quels sont les principaux freins que vous rencontrez ?
L’une des difficultés est de rassembler les spécialistes du développement économique et ceux de la formation. Ils n’ont pas la même approche, le même langage ni les mêmes objectifs. Le fort investissement des partenaires et la création d’espaces de dialogue aident à surmonter ce handicap.
Par ailleurs, les actions menées dans le champ du développement économique et dans celui de la formation ne répondent pas aux toujours aux mêmes temporalités. Les premières doivent apporter des solutions à court ou moyen terme tandis que les secondes s’inscrivent souvent dans des logiques de plus long terme notamment lorsqu’il s’agit de travailler à la structuration de l’appareil de formation initiale.
5. Peut-on transposer cette démarche aux autres régions ?
Un des prérequis pour transposer la démarche tient à la qualité de la concertation avec les acteurs socioéconomiques et à la dynamique développée avec les filières. La mise en place d’une démarche globale à la fois dans les champs du développement économique et de la formation peut sembler plus difficile si le secteur ou la filière concernée n’a pas de contractualisation antérieure en matière de développement économique.
6. Avez-vous mis en place d’autres démarches de coordination des acteurs dans le champ de la formation ?
Oui, le plan pour les continuités professionnelles (PCP) mis en place en région Bourgogne s’appuie sur la même logique participative que les CAPéCO. La sécurisation des parcours professionnels étant une des priorités des élus régionaux inscrite dans leur plan de mandat, la Région a mené un travail de concertation pendant un an et demi avec les partenaires sociaux (syndicats salariés, syndicats employeurs signataires de l’ANI) ainsi qu’avec l’État pour construire un plan d’action visant à améliorer les continuités professionnelles des salariés.
Ce plan a permis d’engager un « dialogue social de projet » avec les partenaires sociaux, en dehors de la logique de branches et de contrats d’objectifs. Concrètement, un diagnostic a été mené afin de recenser les dispositifs et outils existant sur le territoire en faveur de la formation et de l’orientation des salariés. Le constat a été unanime : il n’y a pas besoin de créer de nouveaux dispositifs mais plutôt d’accroître la lisibilité de l’existant, d’améliorer l’articulation d’outils qui sont souvent concurrents et de renforcer pour les salariés l’information et l’orientation.
Des groupes de travail ont été mis en place en associant l’ensemble des acteurs économiques (organisations professionnelles, paritaires, consulaires) et ont permis de formuler des propositions qui ont été ensuite discutées entre la Région, l’État et les partenaires sociaux.
Deux actions importantes ont découlé du plan pour les continuités :
- La mise en place d’un comité de financeurs qui réunit les partenaires sociaux, l’État, les OPCA et le Pôle emploi afin de voir comment mieux articuler les dispositifs existants pour répondre à des problématiques identifiées : par exemple sur la formation des jeunes en emplois d’avenir, le tutorat, la formation des intérimaires, etc.
- Ce plan a aussi mené à la création d’un conseil en évolution professionnelle qui permet à tout salarié de bénéficier, en dehors du cadre de l’entreprise, d’entretiens confidentiels pour réfléchir à son parcours professionnel.
La particularité de cette prestation est qu’elle a été construite dans le cadre de groupes de travail composés en majorité de syndicats de salariés. Ce service a d’ailleurs été repris par la loi sur la formation professionnelle.
- 68. Signé pour une période minimale de trois ans entre l’État, le Conseil régional et une filière professionnelle ou un secteur, le contrat de progrès définit une stratégie de développement économique à moyen terme, anticipant les mutations affectant leur compétitivité et l’emploi.
- 69. Les contrats d’objectifs, conclus entre l’État, le Conseil régional et une branche professionnelle, définissent des orientations en matière d’apprentissage et de formation professionnelle, par secteur d’activité. Ils permettent à ces trois partenaires de coordonner leurs efforts et décrivent des orientations concrètes : observation des emplois, formation des demandeurs d’emplois et des salariés, promotion des métiers, tutorat, VAE, gestion prévisionnelle des emplois… Ils ont une validité de cinq ans.
La Région Lorraine : de la gestion des formations à la co-construction des compétences
Entretien avec Philippe Schwartz, directeur général adjoint au Conseil régional de Lorraine.
1. Comment se construit l’offre de formation sur votre territoire ?
Depuis 2010, la Lorraine a inscrit dans son Contrat de plan régional de développement des formations professionnelles (CPRDFP)70 une logique de pôles de compétences, où l’offre de formation initiale et continue est construite en fonction des besoins du marché à court, moyen et long terme.
La Région a ainsi fait le choix de piloter son offre de formation à partir des projets concrets des entreprises. Plusieurs raisons expliquent cette stratégie : en partant des projets porteurs des entreprises, la Région peut obtenir des indications sur les évolutions des besoins en compétences et en qualifications, elle peut les mettre en perspective avec l’offre de formation d’ores et déjà existante sur le territoire. Il est, en effet, difficile d’anticiper les besoins en compétences des entreprises sur le long terme à un niveau macroéconomique. Et peu de branches sont organisées à l’échelle régionale pour produire des travaux prospectifs
De plus, le rapprochement autour des entreprises pour co-construire une offre de formation bénéficie autant aux salariés qu’aux demandeurs d’emplois du territoire. On constate en effet des différences de profil entre les opérateurs retenus pour assurer les formations intra-entreprises et celles destinées aux demandeurs. Le risque est grand, alors, de déboucher sur un appareil de formation à deux vitesses : un secteur « haut de gamme » assurant du sur-mesure au sein des entreprises et un autre pour les demandeurs d’emploi, soumis aux contraintes des marchés publics et (dé)structurées par celles-ci, avec le risque de « standardisation » de la formation.
Ce raisonnement en termes de pôles de compétences implique pour la Région un véritable changement dans la façon de travailler avec les différents acteurs. Ce changement se traduit également, au niveau régional, par des consultations permanentes (branches professionnelles, représentants interprofessionnels, OPCA, organismes consulaires, etc.) et, sur les territoires par l’animation de CCTEPF (comité de coordination territoriale emploi formation professionnelle) associant acteurs du développement économique sur les territoires aux opérateurs emploi, formation, insertion, afin de partager une vision commune des priorités et des projets à conduire ensemble.
La Région peut alors engager la construction de parcours de formation tout au long de la vie. L’offre de formation continue évolue ainsi pour compléter celle de formation initiale existante.
À titre d’exemple, sur les orientations stratégiques de la Région pour 2014-2017 et le plan d’action 2014, un des objectifs en formation continue est de permettre aux actifs de monter en gamme à travers des blocs de compétences sur des niveaux IV et III, pour venir compléter les parcours de formation initiale sur les niveaux V.
2. Pouvez-vous nous donner un exemple concret de projet illustrant la démarche de construction des évolutions de l’offre de formation en Lorraine ?
Le cas de Safran & Albany est symbolique en la matière. Chargé de construire et piloter un plan de développement des compétences, avec une nouvelle offre de formation co-élaborée en partenariat avec l’entreprise, le Conseil régional n’est plus uniquement un financeur, il devient ainsi co-constructeur de compétences.
Concrètement, Safran & Albany s’est implanté en Lorraine dans le cadre du plan Revitalisation Défense. Ce groupe prévoit de créer 450 emplois à Commercy dans les cinq ans qui viennent, dans le secteur des aérocomposites. Après une analyse des besoins de l’entreprise, en lien avec les chefs de projet, les responsables des ressources humaines et Pôle emploi, il est apparu au Conseil régional que l’offre de formation existante ne permettrait pas de tous les satisfaire. Aussi a-t-il été décidé de créer un centre de compétences dédié aux métiers de l’aéro-composite.
Implanté dans le lycée professionnel de Commercy, ce centre proposera une offre de formation continue pour les demandeurs d’emploi et pour les salariés du groupe. Il sera également chargé de tisser des liens avec l’ensemble des lycées et CFA de la région, pour compléter la qualification de certains jeunes en vue de leur intégration chez Safran & Albany. Certains sous-traitants ont également fait savoir qu’ils souhaitaient pouvoir bénéficier de ce centre, qui devient ainsi un véritable levier de compétitivité et de développement économique, tout en constituant un outil de développement social et d’accès à l’emploi. Il sécurise aussi l’avenir du lycée professionnel, en enrichissant son potentiel de développement : cette initiative sur la formation continue rejaillit donc sur la formation initiale, au bénéfice des jeunes Lorrains. Le secteur des matériaux composites, dans l’aéronautique mais aussi dans d’autres secteurs industriels dont l’automobile, fortement présente en Lorraine, laisse apparaitre un très fort potentiel de développement.
Ce projet a été rendu possible par une véritable collaboration entre le Conseil régional, les collectivités territoriales (le projet ayant été intégré au contrat de développement économique du bassin de Commercy), le rectorat, la Direccte, les acteurs publics et privés de la formation et Safran & Albany. Le Conseil régional finance les travaux au sein du lycée professionnel et l’achat régulier de formation continue dans les quatre ans à venir. L’équipement industriel pédagogique sera quant à lui mis à disposition par Safran & Albany, ce qui assurera une formation professionnelle directement en situation réelle de travail. Le cahier des charges des formations comme la configuration du centre sont co-élaborés avec Safran & Albany, impliquant aussi les représentants du rectorat et du lycée professionnel.
3. Quels sont, selon vous, les principaux freins à la coordination entre acteurs pour définir une offre de formation pertinente sur le territoire ?
Concilier les logiques concurrentielles entre les différents acteurs pour gagner des marchés, dans un contexte où la contrainte de rechercher une optimisation budgétaire est toujours plus pregnante. Il s’agit pour la Région de trouver un juste équilibre qui permette de travailler avec les différentes parties prenantes à la construction d’une offre de formation cohérente sur le territoire en examinant les besoins réels du marché et l’offre déjà existante. Cela impose donc de faire évoluer les modalités de collaboration entre le Conseil régional et les opérateurs de la formation, initiale comme continue, pour assurer un travail le plus en amont possible sur la traduction des mutations socio-économiques en matière de compétences et de qualifications. L’ingénierie de formation venant y répondre doit venir après, dans un souci d’optimisation des moyens financiers et techniques.
Concernant l’ouverture de nouvelles sections de formation professionnelle initiale, par exemple, nous avons déterminé un cadre stratégique avec les acteurs socio-économiques validé par le CESE Lorraine. Ce cadre précise les besoins en compétences et en qualifications au regard des priorités affirmées dans le Pacte Lorraine, qui définit la stratégie de développement économique et innovation sur les trois ans à venir. Nous avons ensuite analysé les propositions d’ouvertures de sections des lycées professionnels et des CFA et attribué les formations à la lumière de ce cadre stratégique. La sélection a également cherché à garantir une cohérence avec l’offre existante notamment en termes d’implantations territoriales, afin d’assurer une accessibilité de cette offre de formation initiale et éviter tout risque d’hyper-concentration et/ou marginalisation.
Outre la concurrence entre acteurs, on se heurte également à un frein culturel. Les acteurs de la formation et les représentants du monde économique doivent se doter d’un langage commun, d’une vision partagée. La mise en commun des méthodes, des outils, des indicateurs reste nécessaire, pour parvenir à décloisonner l’économique et l’innovation avec l’emploi et la formation.
4. Quels sont les changements à prévoir pour que la Région puisse passer d’une logique de financement à celle de co-construction de compétences ?
Co-construire signifie « construire ensemble à partir d’un objectif partagé et dans un projet commun », ce qui est différent d’entretenir d’excellentes relations de coopération… On peut coopérer en restant chacun dans sa culture et sur ses prérogatives, juxtaposant le mieux possible ses modalités d’intervention, ses moyens et ses indicateurs. La co-construction impose un travail sur le management des activités et la conduite de projets stratégiques, des changements de culture professionnelle, des processus de décision, de l’organisation du travail, du contenu des emplois et des compétences, au sein des collectivités territoriales comme de l’ensemble des acteurs du système emploi-formation.
Le Conseil régional a engagé un travail en profondeur sur le champ de la formation professionnelle pour faire évoluer son organisation, améliorer ses pratiques, développer de nouvelles compétences, des manières différentes d’organiser le travail, de manager, etc. Cela passe par exemple par la simplification du processus de décision interne, afin de le rendre compatible avec la réactivité attendue par le marché.
Il faut impulser cette dynamique auprès de chaque partenaire de la Région (Pôle emploi, Dirrecte, etc.) pour pouvoir travailler ensemble et adopter une vision partagée du management territorial. Dans cet esprit, nous travaillons depuis fin 2012 dans le cadre d’une convention tripartite État-Région-Pôle emploi. Celle-ci nous a permis d’une part de mettre en œuvre un processus d’achat de formations parfaitement complémentaires mais aussi de travailler ensemble en fonction des projets des entreprises et des besoins prioritaires des territoires. Nous recherchons ainsi à concrétiser une logique de projet commun articulant différentes modalités d’interventions, ce qui est totalement différent, mais aussi beaucoup plus exigeant voire parfois déstabilisant que de gérer des dispositifs juxtaposés.
Exemple parlant, le Pacte Lorraine insiste sur l’importance stratégique de la « vallée européenne des matériaux, de l’énergie et des procédés ». Nous avons donc co-construit un projet emploi-formation sur trois axes complémentaires :
- un campus des métiers et des qualifications sur les métiers de l’énergie et de la maintenance, qui organise une offre de formation initiale et continue en lien avec les acteurs économiques et les instituts de recherche.
- un pôle de compétences Énergie Maintenance qui identifie les besoins sur ces secteurs : un Edec Énergie est copiloté avec l’État et le Gim’Est, en lien avec le projet Grand Carénage d’EDF à Cattenom. Les travaux de ce pôle de compétences permettront de rétroagir sur l’offre de formation du campus des métiers.
- des actions opérationnelles en formation continue, en collaboration avec Pôle emploi et des entreprises recruteuses.
Ces trois axes complémentaires sont co-construits et copilotés avec le rectorat, la Direccte, l’UIMM, les représentants des entreprises comme EDF… Le suivi de ces travaux est en outre assuré par le Comité lorrain tripartite, composé des organisations syndicales régionales signataires, de l’État et du Conseil régional de Lorraine. Positionné sur l’articulation entre développement économique, innovation et emploi-formation, il suit les projets du Pacte Lorraine sur l’emploi et la formation.
Il peut apparaître comme une préfiguration du futur bureau du Crefop…
Autre sujet, la mise en place d’un conseiller en évolution professionnelle, prévue par la nouvelle loi, appelle un travail très intéressant. Si un cahier des charges national précise le contenu de son activité, il sera nécessaire que les acteurs régionaux définissent un référentiel d’activités et de compétences ainsi qu’un processus de labellisation et de validation, afin de bien positionner cette nouvelle activité au sein du système existant. Cela permettra aussi de tenir compte des spécificités territoriales dans le déploiement de cette nouvelle initiative.
- 70. La loi du 24 novembre 2009 a institué un Contrat de plan régional de développement des formations professionnelles (CPRDFP), qui doit être élaboré au sein du Comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle (CCREFP). Ce contrat doit prendre effet l’année suivant les élections régionales. Il rassemble dans un document unique la stratégie régionale de formation professionnelle des jeunes et des adultes et les engagements financiers des signataires pour atteindre les objectifs fixés. Il peut être décliné par bassin d’emploi et détermine les objectifs communs aux acteurs du territoire régional, notamment en termes de filières de formation professionnelle, sur la base d’une analyse des besoins en emplois et compétences par bassin. Pour préparer ce contrat de plan, le CCREFP procède à une concertation avec les collectivités territoriales, Pôle emploi et des représentants des organismes de formation. Les parties représentées au CCREFP (État, Région, organisations professionnelles, consulaires et syndicales) se trouvent engagées par ce contrat et sont chargées d’en assurer le suivi et l’évaluation.
La Région Franche-Comté : coordonner les acteurs en faveur de la valorisation des métiers de l’industrie – EN RÉGIONS
Entretien avec Marie-Guite Dufay, présidente du Conseil régional de Franche-Comté.
1. Quelle est la particularité de votre territoire ?
La Franche-Comté constitue la première région industrielle de France : les salariés de l’industrie représentent 23 % de l’emploi total, contre 15 % au niveau national. En dépit d’un taux de chômage avoisinant aujourd’hui les 10 %, de nombreux secteurs peinent à recruter en raison d’un déficit d’attractivité persistant.
Afin de remédier à cette situation, la Région s’implique fortement pour maintenir et soutenir les filières industrielles et participe activement à la conception et à la mise en œuvre d’une offre de formation, répondant aux besoins des acteurs. À ce titre, la Région a tenu à associer les partenaires de manière très étroite, notamment pour l’élaboration de son contrat de plan régional de développement des formations professionnelles (CPRDFP) et pour la conception de dispositifs innovants de promotion des formations industrielles ou de sécurisation des parcours professionnels.
Par ailleurs, constatant que l’éloignement géographique faisait obstacle à l’entrée en formation, certains publics disposant d’une faible mobilité, les partenaires francs-comtois ont veillé à optimiser la proximité avec les offres proposées.
2. Les entreprises industrielles franc-comtoises éprouvent des difficultés à recruter. Comment expliquer ces difficultés et quel impact ont-elles sur l’activité industrielle ?
Les métiers de l’industrie en Franche-Comté souffrent, comme dans le reste de la France, d’une image dégradée auprès des jeunes, de leurs familles, des demandeurs d’emplois et parfois encore des conseillers d’orientation, des enseignants, malgré de nombreuses actions entreprises pour mieux les faire connaitre. Près de 14,5 % des places en voie scolaire et 20 % en apprentissage sont restées vacantes en 2013 et globalement, les effectifs des formations industrielles ont baissé durant les dernières années.
Dans les entreprises, un certain nombre de postes restent non pourvus et de nombreux métiers sont en tension. Dans le secteur des microtechniques par exemple, cela concerne les ouvriers qualifiés, les techniciens, les agents de maîtrise, les ingénieurs, les cadres, de façon encore plus marquée qu’au niveau national, pour les entreprises de la métallurgie. Dans celui de la micromécanique et de la sous-traitance automobile, des difficultés sont également recensées pour recruter des techniciens et des agents de maîtrise. Il existe donc un risque de perte de compétences, tant en moyens humains qu’en matière de formation, et de fermeture potentielle de sites, si cette situation devait perdurer et par ailleurs, ces difficultés freinent le développement des entreprises vers de nouveaux marchés.
3. Quelles sont les actions de formation mises en place par la Région pour lutter contre cette désaffection de l’emploi dans l’industrie ?
Le renforcement de l’attractivité des métiers de l’industrie, ainsi que l’intégration des demandeurs d’emploi et des jeunes dans le tissu industriel régional sont inscrits dans les priorités de la Région, notamment dans le CPRDFP et dans le futur Contrat de projet 2014-2020.
Ces objectifs prolongent les dispositifs innovants mis en place en Franche-Comté ces dernières années avec l’aide de l’État et des partenaires sociaux, pour soutenir l’emploi dans l’industrie par des mesures de formation, notamment à travers :
- l’acte I du protocole d’accord en faveur de la sécurisation des parcours professionnels, mis en place en 2009, pour accompagner les entreprises dans l’attente de la reprise de la croissance.
Celui-ci proposait des formations pour les salariés, en vue d’une montée en compétence dans des périodes de baisse d’activité. Ce dispositif, pour lequel la Région a investi 2,5 millions d’euros, a permis la réalisation de près de 13 000 actions de formation et le maintien des salariés dans les entreprises en difficulté. La Région a bénéficié d’un « Territoria d’Or » de l’Observatoire national de l’innovation publique pour cette action. - l’acte II, signé en 2011, a permis d’accompagner la signature de 1 200 contrats de professionnalisation à durée indéterminée pour un montant d’environ 3 millions d’euros, et à cofinancer 1 000 parcours de formation qualifiant pour des salariés intérimaires, destinés à leur permettre d’accéder à des emplois permanents ou à augmenter leur niveau de polyvalence. Un prix spécial du jury « Territoria » a été obtenu sur ce dispositif, qui a également retenu l’attention de la Commission nationale des services du ministère du Redressement productif.
4. En quoi la coordination des acteurs en faveur de la revalorisation des métiers de l’industrie est-elle importante ? Quelle est la contribution de la Région ?
Les acteurs francs-comtois ont pris conscience depuis plusieurs années de la nécessité d’intervenir en faveur de leur industrie. En complément de la définition de l’offre de formation qui fait l’objet d’une concertation étroite, les collectivités, les branches professionnelles, les chambres consulaires, les établissements de formation et de l’enseignement supérieur, les acteurs de la culture scientifique, technique et industrielle (CSTI) ont ainsi développé un certain nombre d’actions de promotion, de découverte, et de sensibilisation aux métiers de l’industrie. Il s’agit, par exemple, de vidéos, d’expositions, de visites d’entreprises, de concours, …
Il s’agit aujourd’hui, d’envisager une action de plus grande ampleur, mieux coordonnée, se déroulant de manière permanente, visant à constituer une réelle dynamique régionale des interventions en faveur de la valorisation des métiers de l’industrie. Cette démarche, baptisée « Tous In’dustrie », vise à mieux faire connaître les métiers et les produits de l’industrie régionale, en faisant notamment le lien entre les productions franc-comtoises et les objets à forte valeur technologique connus du grand public.
Des composants francs-comtois sont par exemple embarqués dans la fusée Ariane, tout comme des capteurs présents dans les téléphones portables sont issus de notre région.
Il est essentiel de montrer que l’industrie franc-comtoise a un avenir. La Franche-Comté bénéficie en effet d’une forte tradition industrielle.
L’industrie a su se renouveler dans de nombreux domaines : de l’horlogerie au biomédical, du travail du métal au véhicule du futur…
Le lien entre l’histoire, les industries d’aujourd’hui et les laboratoires de recherche doit davantage être mis en évidence.
L’objectif de répondre à l’appel à projets du Programme d’investissements d’avenir portant sur la CSTI est d’aborder la valorisation des métiers de l’industrie en Franche-Comté sous une forme globale et transversale, avec une mise en réseau des différents acteurs (partage d’outils, centralisation d’informations, communication sur les opérations innovantes…). Cette approche devrait permettre à la Franche-Comté d’apporter une réponse adaptée et innovante aux besoins de l’industrie du territoire.
CONCLUSION
Les difficultés de recrutement dans l’industrie perdurent malgré de nombreuses tentatives pour adapter les formations et rendre l’industrie plus attractive. La récente réforme de la formation professionnelle a, entre autres, acté le renforcement du rôle des Régions en matière de politiques d’emploi et de formation. Sur le terrain, de nombreuses initiatives sont en cours. Elles ont l’avantage d’être adaptées aux différents contextes locaux mais leur foisonnement peut nuire à leur lisibilité. La coordination des acteurs locaux et une bonne articulation avec l’échelon national restent néanmoins nécessaires pour mieux adapter l’offre de formation aux débouchés.
Quatre « champs d’opposition » émergent des contributions reçues lors du débat lancé par La Fabrique de l’industrie et des auditions complémentaires menées auprès d’experts du sujet. Ces oppositions ne peuvent être surmontées que par l’échange et le dialogue, par un rapprochement des parties prenantes prêtes à dépasser le stade des postures.
Premièrement, on note le contraste entre les métiers de l’industrie et les métiers du secteur des services, les premiers ne bénéficiant pas du même niveau d’attractivité que les seconds. Cela résulte notamment d’une faible connaissance de l’industrie et de ses métiers. Il est donc important de renforcer l’ouverture du monde industriel aux jeunes et à leurs prescripteurs, notamment les enseignants et les personnels de l’orientation.
Préconisations pour renforcer la connaissance des métiers de l’industrie
- De nombreuses initiatives visant à « ouvrir » les usines et à faire découvrir la réalité des métiers industriels existent déjà. Il faut toutefois veiller à la mise en commun des dispositifs par une plus grande collaboration des acteurs afin d’améliorer leur efficacité.
- Le rapprochement de l’école et de l’entreprise, via la généralisation des stages de professeurs en entreprise par exemple, permettrait de resserrer les liens entre deux mondes qui affichent trop souvent des postures de méfiance réciproque.
Une deuxième opposition se manifeste, entre les filières professionnelles et les filières générales menant à l’enseignement supérieur. Il apparaît nécessaire de décloisonner ces formations en créant des passerelles et en offrant de réelles perspectives d’évolution à tous les jeunes.
Préconisations pour désenclaver les filières professionnelles et leurs diplômés
- Le manque d’attractivité de l’enseignement professionnel tient à son trop fort cloisonnement au sein du système éducatif. Les possibilités de réorientation devraient être multipliées par la mise en place de passerelles entre les filières professionnelles et les filières générales et technologiques.
- Si l’image d’un travail industriel laissant peu de place à l’initiative et offrant peu d’opportunités de progression de carrière est exagérée, il n’en reste pas moins que certaines entreprises doivent s’attacher à faciliter les trajectoires professionnelles de leurs salariés et approfondir leur réflexion sur la qualité du travail afin de renforcer l’attractivité de leurs métiers auprès des jeunes.
Troisièmement, l’opposition entre l’apprentissage et l’enseignement en lycée professionnel est encore une réalité. Ces filières, quoique menant aux mêmes diplômes, reposent sur des méthodes pédagogiques différentes. La première est largement organisée hors des établissements de l’Éducation nationale. Encore trop souvent perçues comme concurrentes, ces filières sont pourtant complémentaires. Le rôle des Régions est ici primordial pour adapter au mieux l’offre de formation aux besoins des entreprises de leur territoire.
Préconisation : développer l’apprentissage
- Le développement de l’apprentissage apparaît comme une priorité. De nombreux freins doivent être surmontés pour y parvenir. Son image dégradée, car associé aux bas niveaux de qualification, ou son coût important pour les entreprises, particulièrement en période difficile, pèsent notamment sur son attractivité.
Enfin, l’opposition entre la formation professionnelle continue et la formation initiale constitue un quatrième verrou à débloquer. Elles ne relèvent pas de la même gouvernance, des mêmes dispositifs, des mêmes outils ni des mêmes financements. La formation continue devrait davantage reposer sur des capacités d’ingénierie permettant de construire des réponses « à la demande » que sur des catalogues de formations. Une meilleure articulation entre ces deux composantes est primordiale pour parvenir à une réelle formation tout au long de la vie. Cela supposera de revenir sur la prégnance de la formation initiale et du diplôme en France, car les compétences et les qualifications se construisent bien dès la formation initiale, mais également tout au long de la vie professionnelle.
Préconisations pour développer la formation tout au long de la vie
- La formation des salariés tout au long de la vie doit devenir une réalité, quel que soit leur niveau de qualification. Les inégalités d’accès à la formation persistantes empêchent la montée en compétence de l’ensemble du collectif de travail. Les politiques de baisses de charges ciblées sur les seuls bas salaires sont contre-productives car elles subventionnent des emplois peu qualifiés. L’action publique devrait au contraire soutenir des actions permettant à l’ensemble des salariés de développer leurs compétences.
- Pour que la formation continue des salariés joue pleinement son effet, celle-ci ne doit pas être considérée par les entreprises comme une dépense mais comme un investissement dans leur capital humain. Les règles comptables devraient être adaptées afin de comptabiliser l’effort de formation comme un actif immatériel de l’entreprise.
Surmonter ces points d’opposition ne pourra se faire que par une collaboration étroite et un dialogue apaisé entre les différents acteurs. Seul ce travail commun permettra de relever les défis actuels et futurs qui se posent aux industriels.
Préconisations pour une meilleure coordination des acteurs
- Le fonctionnement efficace du système de formation ne peut être assuré qu’à condition que les acteurs s’y impliquent. Les réformes menées afin de responsabiliser les différentes parties prenantes, et notamment les entreprises, vont dans le bon sens mais les efforts doivent être poursuivis.
- Les Régions jouent désormais un rôle central dans la gouvernance du système de formation. Elles sont les garantes de la bonne adéquation de l’offre de formation aux besoins des entreprises. En cela, elles doivent s’adapter afin de mieux coordonner leur politique de développement économique et de formation.
Témoignage d’Alain d’Iribarne, directeur de recherche au CNRS
Prendre en compte les fondamentaux pour réformer la formation professionnelle
Pour quelqu’un qui suit depuis près de cinquante ans les efforts que fait la France pour adapter sa formation professionnelle aux besoins, d’abord en qualifications puis en compétences, de ses entreprises et plus largement de son économie en vue de conforter leur compétitivité conjointe, ce dernier rapport en date consacré à « la formation professionnelle à travers le regard des acteurs de terrain » est particulièrement intéressant par les éclairages factuels qu’il apporte, montrant ainsi toute la richesse de ce qui peut être fait comme expérimentations sur notre territoire71. Mais, il est en même temps désespérant tant, à la suite d’un nombre difficilement calculable de rapports antérieurs, sont redondants ses diagnostics et ses appels à des actions visant à des nouvelles réformes structurelles des formations initiales aussi bien que continue ainsi qu’à des évolutions dans les représentations du travail industriel dans notre société, avec le but louable d’amener à nos entreprises industrielles cette main d’œuvre qualifiée – singulièrement ouvrière –, qui commence à leur faire cruellement défaut72.
En fait, la principale question que pose ce rapport est celle d’arriver à comprendre pourquoi toutes ces richesses pratiques qui parviennent à résoudre l’essentiel des problèmes tant en ce qui concerne le contenu des formations en relation avec les besoins de compétences des entreprises que la capacité à attirer des jeunes vers des métiers « industriels », ne parviennent pas, en dépit des multiples réformes tant législatives que réglementaires ou institutionnelles qui se succèdent dans le temps, à modifier sur le fond les assises structurelles du système. En effet, tout ce passe comme si celui-ci fonctionne comme un système physique stable, c’est-à-dire revenant après oscillation autour de sa position d’équilibre une fois les impulsions données. Et c’est bien cette stabilité dynamique des macro-normes qui régissent le fonctionnement du système qui interpelle le plus, celui-ci connaissant, pour donner une vision moins statique, des lois de transformations mécaniques et non pas organiques73.
Toutefois, le rassurant, si l’on peut dire, est que le système équivalant allemand vers lequel nous louchons avec constance connait lui aussi des problèmes d’adaptation, à la grande différence près que sa construction sociétale est telle, dans l’état actuel des choses, qu’elle n’exige pas de capacité d’adaptation autres que mécaniques. C’est donc bien la façon dont les dynamiques de nos constructions sociétales nationales historiquement construites sur longues périodes sont capables de faire écho à des dynamiques paradigmatiques productives beaucoup plus mobiles et inscrites dans des espaces concurrentiels élargis et approfondis, qui est en cause. Et c’est donc bien la mise en place de leviers multiples à actions convergentes systémiques et non indépendantes qui doit l’emporter, sachant que ces leviers sont individuellement bien connus et à nouveau bien répertoriés dans le rapport, mais que c’est de la capacité politique des acteurs centraux concernés – les pouvoirs publics, les « patrons employeurs » et les syndicats d’employeurs et de salariés –, à créer la cohérence effective des mesures en œuvre, que dépendra la validité des préconisations du rapport, c’est-à-dire la capacité à modifier les assises du système.
En effet, confrontés à une construction sociétale française qui associe à l’architecture générale de l’appareil éducatif et au contenu des formations, autant une logique de noblesse de rang social et de métiers qu’une logique de contenu de compétences adaptées à des besoins professionnels, les acteurs précités, quelles que soient les réformes entreprises dans la construction institutionnelle des filières, n’ont pas été capable à ce jour de briser la formidable colonne de distillation des jeunes entrant à leur plus jeune âge dans l’appareil scolaire : ceux-ci en sortent à flots réguliers, de plateaux à plateaux, depuis les plus de 10% d’une cohorte sans formation aucune jusqu’au quelque 80% qui arrivent au Bac, sachant que ces derniers sont eux même retriés dans le supérieur au gré de la sélectivité et des noblesses sociales des filières74. Car cette architecture est congruente avec l’usage social de l’éducation formation en fonction des ambitions des parents et de leurs capitaux autant sociaux que financiers75. Et ce serait enfoncer des portes ouvertes que de rappeler que les formations professionnelles fonctionnent massivement dans les établissements scolaires comme des filières de relégation et donc comme des filières repoussoirs. Il en irait de même de rappeler l’existence d’un sous- fractionnement de ces filières, allant des disciplines scientifico-technologiques abstraites aux disciplines pratico-concrètes.
Face à cette stabilité sociétale, les politiques qui se veulent conjointement garants de l’idéal républicain dans sa version jacobine s’inscrivant dans le droit fil de la tradition régalo-impériale, sont d’une certaine façon, au nom de l’égalité des citoyens et des territoires, d’accord pour lutter contre les forces régionalistes girondines ardentes défenseur d’une décentralisation réelle qui prônent une liberté d’action des acteurs locaux. Par contre, ils se déchirent allègrement entre la « droite » et la « gauche », autour de la place à accorder de façon dominante à un collège unique renforcé par des classes indifférenciées76. Cette vision domine chez la seconde au nom de la consubstantielle égalité républicaine que nous venons d’évoquer et dont la préservation constitue en quelque sorte un devoir sacré pour les élus de la Nation. À l’opposé, chez la première, l’évocation d’un réalisme basé sur l’évidence des différences cognitives et des centres d’intérêts des enfants, justifie une différenciation précoce des filières éducatives et une orientation des enfants peu attirés par les études longues à fondements abstraits vers des études à pédagogies concrètes autorisant des belles réussites scolaires sur ces bases, préférables à des échecs sur les autres. Ainsi, contrairement aux croyances de leurs adversaires, une adaptation précoce des filières tant dans leurs contenus que dans leurs pédagogies, aux appétences des enfants serait un gage de la réduction des inégalités scolaires et, compte tenu des tris sociaux opérés dans les conditions d’accès aux filières, des sources de réduction d’inégalités dans la population. En les écoutant, il n’y aurait donc que des gagnants. Ceci acquis, si on veut bien regarder de près la succession de réformes qui ont accompagné tant les successions de ministres que les alternances politiques, c’est dans ce jeu de raquette que se sont constamment trouvées prises, en relation avec l’architecture générale de l’appareil éducatif, le positionnement et le contenu des filières relevant tant de l’apprentissage que des formations professionnelles ou des formations technologiques77. L’important, ici, est qu’en absence de consensus, la stabilité de ce jeu idéologique n’a guère contribué à augmenter tant la lisibilité que l’attractivité sociale de ces filières, bien au contraire.
Peut-être plus fondamentalement encore pour notre propos, dans ce jeu d’acteurs autours des formations ouvrières professionnelles, la mise en relation étroite entre activités formatives et activités professionnelles jugée si performante quand on regarde outre-Rhin, s’est trouvée victime d’un consensus national visant à faire sortir la formation professionnelle des griffes du « grand capital » qui était accusé de formater idéologiquement à ses besoins ceux qui en bénéficiaient, pour la remettre dans les mains du secteur public plus orienté vers une éducation citoyenne. C’est ainsi que les centres d’apprentissage des grandes entreprises industrielles françaises, implantés sur les lieux de travail, étroitement liés aux ateliers et incluant dans les compétences professionnelles des normes de travail, ont peu à peu été liquidés au profit des CFA, tandis que dans le même temps, l’Éducation nationale liquidait ces filières d’excellences professionnelles qu’étaient par exemple les Écoles nationale professionnelles78. Ainsi, depuis l’après-guerre et sur des bases également idéologiques, un grand mouvement de fond a concouru à éloigner les diverses composantes du système des formations professionnelles des activités concrètes liées aux pratiques de travail, alors que dans le même temps, conscient des effets pervers d’un tel éloignement, on cherchait à créer des ponts nouveaux entre l’École de la République et les milieux professionnels comme l’atteste la création des Commissions paritaires consultatives – les fameuses CPC –, destinées à piloter les contenus des formations en relation avec les « besoins des entreprises », ou l’invention les formations en alternance ainsi que des « ingénieurs des métiers », ersatz du système dual allemand.
Toujours dans le même temps, on assiste du côté des employeurs à des mouvements non moins contradictoires associés, d’une part, au délitement du pacte social français éminemment paternaliste qui, à travers un emploi à vie, liait dans la longue durée la vie du salarié à celle de l’établissement de son entreprise et, d’autre part, à la découverte du secret de la performance des usines japonaises79. Cette découverte conduisit à l’invention de « l’OS bachelier» et du « technicien d’atelier » doté d’un diplôme de niveau Bac+2, l’ensemble s’inscrivant dans un passage d’une logique de gestion basée sur les postes de travail et une adéquation des qualifications ouvrières à ces postes, à une logique de gestion des compétences et par les compétences, basée non plus sur les postes de travail plus ou moins déstructurés, mais sur les personnes auxquelles il était demandé de disposer non plus de savoirs, mais de savoirs en actes : ces fameux « savoir-être » et « savoir-faire » jugés comme étant les seuls productifs – donc susceptibles d’être rémunérés –, parce qu’effectivement mobilisés pour produire dans une organisation collective de plus en plus étroite80. Là encore, comme pour l’appareil de formation, les déstructurations de l’existant n’ont pas conduit à des restructurations faisant suffisamment système pour produire aussi bien des normes professionnelles de travail que des repères clairs dans la hiérarchie des positions professionnelles et, en corollaire, des positions sociales. On ne peut donc pas s’étonner de ce que l’attractivité sociale de l’ensemble formations professionnelles/emplois industriels soit particulièrement faible, surtout si, en plus, on prend en compte sa place dans la société.
Il faut voir, en effet, que toujours dans le même temps, la « classe ouvrière » qui constituait le réservoir traditionnel de la population ouvrière, s’est réduite comme peau de chagrin sous l’action conjuguée des restructurations massives conduisant à des fermetures d’usines dans l’ensemble du territoire et de la tertiairisation de l’économie créant un déplacement des activités professionnelles vers les « cols blancs », supports de promotions sociales tant prisées. La recherche de candidats volontaires pour entrer dans des filières de formations professionnelles « ouvrières » et de techniciens d’ateliers ne renvoie donc plus pour les spécialistes de l’orientation professionnelle à une lutte contre l’évasion vers les activités de col blanc des enfants de milieux ouvriers, mais à une lutte pour attirer vers des filières débouchant sur des activités de col bleu, des enfants d’employés voir des catégories sociales intermédiaires. Et ce ne sont pas les tentatives d’anoblissement de la formation professionnelle en créant les Bacs pro dans des lycées techniques et un prolongement des carrières ouvrières vers celles de techniciens d’ateliers, qui viendront compenser la faible lisibilité du système d’un point de vue social et accroitra l’attractivité des formations professionnelles destinées à alimenter les « carrières ouvrières »81.
Dans cette dynamique de l’échafaudage systémique que nous évoquons, reste à situer la formation professionnelle continue dont le rapport pointe à juste titre la grande importance. On peut dire que tout à fait logiquement, celle-ci connait d’égales errances dans ses réformes successives incapables de lui fournir une assise satisfaisante au sein du système précité, aussi bien en matière d’alternance que de « formation tout au long de la vie »82. En matière de formation par alternance, tant avec les contrats d’apprentissage qu’avec les contrats de professionnalisation qui ont été étendus à tous les niveaux de formation – à l’exception des doctorats – et dont tout le monde loue l’efficacité aussi bien « formative » qu’en matière d’insertion professionnelle, on reste encore très loin du compte par rapport au système dual allemand83, en particulier parce que les entreprises rechignent à prendre leur part formative en acceptant de signer des contrats.
Il existe donc un déficit chronique d’offre par rapport aux demandes déjà existantes alors qu’on en prône l’extension84. Quant à la formation continue à la française telle qu’elle a été conçue et s’est développée, elle constitue elle aussi un ersatz du fameux « long life learning » des pays scandinaves dont le modèle a été véhiculé à travers l’Europe par l’OCDE et la Commission européenne85. On notera en effet qu’à son origine se trouve à nouveau une action volontariste de l’État qui vise à obliger les entreprises à corriger leurs lacunes dans ce domaine en les taxant sur le modèle de ce qui était fait pour l’apprentissage. À la suite de la loi de 1971, cette formation continue « à l’initiative des entreprises » n’a donc pas été vécue par ces dernières comme un investissement en capital humain permettant d’entretenir et de développer des compétences tout au long de la vie productive de leurs salariés confrontés à des changements plus ou moins importants, mais a été perçue comme une charge nouvelle difficile à éviter. Elles ont donc tendu à en faire un usage singulier, par exemple celui d’une récompense pour des salariés jugés méritants, ou comme un avantage pour ceux dont le statut était le plus élevé.
Et que dire à propos des actifs sans emploi, c’est-à-dire des chômeurs ? Si on suit la dynamique du législateur, on voit qu’il tend à déplacer le centre de gravité du dispositif de formation continue, de la promotion sociale vers une éducation permanente orientée en premier lieu vers la lutte contre le chômage des jeunes et, plus récemment, vers un droit à la professionnalisation avec la VAE, les CIF et la « sécurisation des parcours professionnels ». Apparaissent dans le même temps les rhétoriques de « l’employabilité » et de la « flexi-sécurité », destinées à convaincre salariés et employeurs que face à un marché du travail fortement segmenté et largement déprimé, il allait des intérêts individuels et collectifs de favoriser cette professionnalisation salariale tout au long de la vie active de façon à assurer à tout le monde une « employabilité permanente ». Au regard de ces bonnes intentions constamment affichées, la réalité des situations observées permet de mieux comprendre le peu d’efficacité global, structurel, des quelques 32 milliards d’euros consacrés par la France à la formation professionnelle continue86.
Que dire pour finir, sur ce rapport et ses préconisations, si ce n’est que tout à fait logiquement il consacre des développements importants aux actions menées au niveau des conseils régionaux avec les trois exemples de la Bourgogne, de la Lorraine et de la Franche-Comté. Ce choix résulte du transfert fait par l’État central vers les Régions de la responsabilité du pilotage de la formation professionnelle en relation avec les « besoins de l’économie ». Mais, à nos yeux, il a une signification beaucoup plus profonde puisqu’il traduirait un retour, sous l’égide des pouvoirs publics, à des co-constructions d’offres de compétences dans une perspective de développements économiques et sociaux des territoires, lieux de remise en cohérence des logiques de production de richesses et de modes de vie.
Ce mouvement n’est pas nouveau puisqu’il s’inscrit dans la découverte par la DATAR des performances des « districts industriels » nord italiens traduit en France par les systèmes de productions localisés (SPL), Il s’inscrit également dans l’accent mis sur la nécessité de faire émerger des territoires innovants avec les technopôles, les pôles de compétitivités et autres « clusters » qui tous, sous des formes diverses, ont comme caractéristique d’être construits sur des coopérations entre acteurs singuliers – mais complémentaires –, au service d’un intérêt commun. Compte tenu de ce que l’on sait des grandes traditions françaises tant en matière d’égalitarisme républicain que nous avons largement évoquées que de quant à soit élitistes dans les relations tant interpersonnelles qu’interinstitutionnelles, on peut mesurer le chemin à parcourir pour que des normes coopératives faisant système s’imposent dans un fonctionnement collectif décentralisé dominant, au plus près des acteurs qui produisent. Mais, compte tenu des nombreux exemples particulièrement innovants que nous connaissons, nous savons que cette voie de réalisation de co-constructions de compétences n’a rien d’utopique. On sait, en tous les cas, qu’elle constitue un enjeu majeur politique et social pour la compétitivité économique de nos entreprises et de nos territoires87.
- 71. L’auteur de ces lignes a commencé sa carrière de chercheur en 1965 à l’Institut d’étude de l’emploi à Toulouse. Il est entré au Céreq en 1970 comme chef de département, au moment de sa création à la suite des recommandations de « l’intergroupe formation-qualification du 5ème Plan dont il avait été un des rapporteurs et l’a quitté en 1980 pour prendre la direction du LEST (Laboratoire d’économie et de sociologie du travail) à Aix-en-Provence où il est resté jusqu’en 2005
- 72. On citera pour exemple, parmi les derniers, le rapport Larcher sur « la formation professionnelle ; clé pour l’emploi et la compétitivité » commandé début 2012 par le président de la République qui considérait que la formation des chômeurs devrait être prioritaire (www.elysee.fr).
- 73. On rappellera que contrairement aux régulations mécaniques qui correspondent à des modifications s’inscrivant dans une stabilité des règles de fonctionnement et donc ne changent guère, sur le fond, les modes de fonctionnement du système, les régulations organiques s’inscrivent dans des recompositions de ce système de règles ce qui conduit à une modification généralement profonde des propriétés de fonctionnement du système. Avec elles, on sort donc de ce qu’on peut appeler une dynamique reproductive.
- 74. C’est tout simplement cela que disent les résultats des enquêtes PISA quand on compare dans le temps, pour la France et les autres pays, les résultats scolaires des enfants en termes des notions maîtrisées. Ce qui est présenté comme une dégradation relative de la situation française est due à un effet de moyenne qui masque une remarquable stabilité des performances des « bons élèves des bonnes classes » au regard d’une dégringolade des performances des « mauvais élèves des mauvaises classes »
- 75. Alain d’Iribarne, Philippe d’Iribarne, « Le système éducatif français comme expression d’une culture politique », Revue européenne Formation Professionnelle, N°17, pp 27-39.
- 76. « Mise en place et réformes. Le collège unique de 1975 aux années 2000 ». Dossiers.
- 77. Voir « Chronologie de l’enseignement technique ».
- 78. Françoise Meylan, « De l’École nationale professionnelle au baccalauréat de technicien, ou l’évolution d’une filière de l’enseignement technique », Revue Formation-Emploi, pp 29-46.
- 79. Contrairement à ce qui souvent dit, ce n’est pas le Japon qui est le pays de « l’emploi à vie », mais la France. Dans notre pacte social de référence, on entrait jeune « à la base » en correspondance avec son niveau de sorti de l’appareil scolaire – manœuvre pour un jeune ouvrier – et on apprenait son métier sur le tas sous l’égide de compagnons expérimentés aux services desquels on était affecté. En prenant de l’âge, on progressait en expérience et en efficacité productive, puis, les forces déclinant avec l’âge, on été employé dans des « petits boulots » utiles. Face à cette efficacité productive croissante puis décroissante, les rémunérations progressaient en fonction de la « carrière » et à l’ancienneté de sorte qu’était instaurée une solidarité de fait, entre les trois temps de l’activité professionnelle, les actifs dans la pleine force de l’âge productif dégageant un « surplus » qui contribuait aux rétributions des jeunes entrants et des anciens vieillissants. C’est ce pacte social qui a été rompu dans le courant des années 1980, les entreprises ne prenant plus de jeunes que dès lors que leur travail produisait un taux de retour immédiat entrainant une forte préférence à l’embauche pour les jeunes ayant de « l’expérience professionnelle » et une exclusion du marché du travail, les jeunes sans expérience. De-même les « ouvriers vieillissants » ont été précocement sortis du marché du travail à l’aide de mises en pré-retraites supportées par des dispositifs du FNE .
- 80.Alain d’Iribarne, « Trente ans de Céreq. Des qualifications aux compétences : chronique d’un oubli accepté ? », Revue Formation-Emploi, N° 76, 2001, pp 71-97.
- 81. La création des Bac pro en 1985 par Jean-Pierre Chevènement (ministre de « gauche ») et leur réforme en 2009 par Xavier Darcos (ministre de « droite ») est particulièrement emblématique du jeu « sociétal » que nous avons précédemment évoqué, avec ses effets pervers sur l’alimentation des formations professionnelles industrielles de base. En effet, l’ambition au départ est d’anoblir la formation professionnelle en créant un nouveau Bac en quelque sorte hybride puisque la filière, tout en ayant la symbolique de l’enseignement long donnant accès à l’enseignement supérieur, garde sa spécificité avec une formation en quatre ans au lieu de trois, les élèves passant par l’acquisition d’un BEP en deux ans. Mais, quelque vingt ans plus tard et au nom de l’égale dignité des trois voies – générales, technologiques et professionnelles –, le cursus des Bac pro est harmonisé avec les autres, se faisant en trois ans et avec une suppression du passage par le BEP. Que pensez-vous qu’il arriva au-delà des succès obtenus? En vertu du postula français qui veut que plus on a un diplôme élevé et plus on a des chances d’accéder plus vite à des meilleurs emplois et à des meilleurs carrières, les élèves des Bac pro se sont mis à poursuivre des études supérieures en nombre croissant (30% en 2013). Mais, pour qu’ils soient admis en STS, ce qui était le prolongement logique, il a fallu leur réserver un certain nombre de places car ils n’étaient pas compétitifs dans ces filières à sélection, face aux Bacs techniques et généraux, ce qui les a conduit à s’inscrire dans les filières universitaires en libre accès avec des taux d’échec quasi totaux en raison de leur non adaptation à leurs formes d’enseignements. Dans le même temps, la densification et la tendance à l’intellectualisation des études, couplées à l’absence de passage par une formation professionnelles intermédiaire, a eu comme effet d’accroître le décrochage des moins adaptés à ces évolutions et, en corollaire, d’accroitre leur arrivée sur le marché du travail sans formation professionnelle. CQFD. (Voir Le Monde, « Le Bac pro devient un passeport pour le supérieur », 12 juin 2014, p 10)
- 82. Chronologie. La formation professionnelle continue (1971-2009). www.vie-publique.fr/politiques-publiques/formation-professionnelle-continue/chronologie/
- 83. Voir, Marc Maurice, François Sellier, Jean-Jacques Silvestre, « Politique d’éducation et organisation industrielle en France et en Allemagne », Paris, PUF, 1982
- 84. Voir à ce propos le supplément du Monde du 12 juin 2014, « Universités & Grandes Écoles » consacré à l’alternance, qui rappelle que le nombre de signatures de contrats de stages a lourdement chuté en 2013, au plus bas depuis 2005, avec 273 000 contrats d’apprentissage et 117 000 contrats de professionnalisation.
- 85. Alain d’Iribarne, « Une lecture des paradigmes du Livre Blanc sur l’éducation et la formation : éléments pour un débat. » Revue européenne Formation Professionnelle, N° 8/9 pp 23-31. (Il s’agit du livre blanc « Enseigner et apprendre. Vers une société cognitive » Office des publications officielles des Communautés européennes. Luxembourg, 1995.)
- 86. Dont les bénéficiaires sont à titre principal les salariés du secteur privé (13 milliards) et du secteur public (6 milliards), les jeunes dont l’apprentissage (6 milliards) et les demandeurs d’emplois (4 milliards).
- 87. Finalement, peut-être pas si curieusement que cela, nous retrouvons là à quelque chose près, les bases de notre ouvrage publié par le CNRS en 1989 « La compétitivité, défi social enjeu éducatif » avec une préface d’Antoine Riboud, alors PDG de BSN devenu aujourd’hui Danone, et une postface de Yannick Simbron, alors secrétaire général de la FEN.
Bibliographie
Académie des technologies, 2014, « La renaissance de l’industrie – Construire des écosystèmes compétitifs, fondés sur la confiance et favorisant l’innovation », avril.
AFDET, LeCanaldesMetiers.tv, 2013, « En 2013, à 15 ans que sait-on, que pense-t-on des métiers industriels ? », janvier.
Armand A., Bisson-Vaivre C., Lhermet, P., 2013, « Agir contre le décrochage scolaire : alliance éducative et approche pédagogique repensée », Rapport de l’IGEN-IGAENR, juin.
Banque de France, 2012, « Durée d’utilisation des équipements dans l’industrie », Bulletin de la Banque de France, n°187, 1er trimestre.
CEDEFOP, 1999, « Le système de formation professionnelle en Norvège ».
CEDEFOP, 2012, « Spotlight on VET. Norway ».
Céreq Bref, 1991, « Vingt ans de formation professionnelle continue dans les entreprises », Bulletin de recherche, n°66, juin.
Céreq Bref, 2012, « Les observatoires prospectifs des métiers et des qualifications : des outils pour agir », n° 297-2, mars.
CGSP, DARES, 2012, « Les métiers en 2020 : progression et féminisation des emplois les plus qualifiés ; dynamisme des métiers d’aide et de soins aux personnes », mars.
COE, 2013, « Emplois durablement vacants et difficultés de recrutement », septembre.
Colletis G., Paulré B., 2008, « Poursuivre le programme de recherche sur le capitalisme cognitif ».
Confédération suisse, 2012, « D’apprenti à CEO : un parcours encore possible ? », 7 mars.
Coste S., 2010, « Au lycée professionnel ». Cahiers pédagogiques, n° 484, octobre.
Crédit Suisse, 2013, « Baromètre de la jeunesse ».
DEPP, 2013, « Repères et références statistiques sur les enseignements, la formation et la recherche ».
Desforges C. & al, 2014, « Les freins non financiers au développement de l’apprentissage », IGAS.
Gallois L., 2012, « Pacte pour la compétitivité de l’industrie française », Rapport au Premier ministre, 5 novembre.
Gauron A., 2000, « Formation tout au long de la vie », La Documentation française, Paris.
Høstmark Tarrou A-L., 2003, « La formation professionnelle initiale en Norvège. Entre valeurs démocratiques et partenariats économiques », Revue internationale d’éducation de Sèvres, n°57.
Ifop, 2013, « Les jeunes et les métiers de l’industrie », novembre.
Jellab A., 2014, « L’émancipation scolaire. Pour un lycée professionnel de la réussite », Toulouse, Presses universitaires du Mirail.
Forschungsunion Wirtschaft und Wissenschaft, Acatech, 2013, « Umsetzungsempfehlungen für das ZukunftsprojektIndustrie 4.0, Abschlussbericht des Arbeitskreises Industrie 4.0 », avril.
McKinsey, 2012, « L’emploi en France : cinq priorités d’action d’ici 2020 », mars.
Bourdu E., Dubois C., Mériaux O., 2013, « La stratégie du jardinier. Quand les entreprises investissent dans les ressources humaines du territoire », Paris, La Fabrique de l’industrie, avril.
Obin J-P. & al., 2014, « Pour une école commune, du cours préparatoire à la troisième : un pas supplémentaire vers la démocratisation », Terra Nova.
Observatoire de la métallurgie, GIFAS, 2012, « Étude sur les besoins prospectifs en ressources humaines du secteur aéronautique et spatial », juin.
OCDE, 2002, « La formation tout au long de la vie en Norvège ».
OCDE, 2008, « OECD reviews of vocational education and training. Norway », Learning for jobs.
OCDE, 2009, « Évaluation par l’OCDE du système de formation professionnelle », Learning for jobs.
OFFT, 2011, « La formation professionnelle – un facteur en faveur de la place économique et de la compétitivité en Suisse ».
OpinionWay, 2013, « L’entreprise, vue par les enseignants », novembre.
OpinionWay, 2013, « Les nouveaux métiers industriels. Le regard des dirigeants des entreprises industrielles », décembre.
Pôle emploi, 2013, « Enquête Besoins en main d’œuvre », avril.
Seibel C., 2001, « Entre chômage et difficultés de recrutement : se souvenir pour prévoir », La Documentation française, Paris.
Sollogoub M., Ulrich V., 1999, « Les jeunes en apprentissage ou en lycée professionnel. Une mesure quantitative et qualitative de leur insertion sur le marché du travail », Économie et statistique, n° 323, INSEE.
Urieta Y., 2011, « Quarante ans de formation professionnelle : bilan et perspectives », Rapport au CESE, décembre.
Glossaire
Apprentissage : Voie de formation en alternance, c’est-à-dire qui associe une formation en entreprise et des enseignements dispensés dans un centre de formation d’apprentis (CFA). L’apprentissage prépare à l’ensemble des diplômes de l’enseignement technologique et professionnel, et du supérieur.
Certification : Attestation officielle indiquant qu’une personne est en mesure d’exercer une activité professionnelle. Les certifications professionnelles sont recensées au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP). Elles peuvent être de trois ordres : diplômes et titres délivrés par l’État et au nom de l’État ; diplômes et titres délivrés par des organismes en leur nom ; certificats de qualification professionnelle.
Certificat de qualification professionnelle (CQP) : Diplôme mis en place par une branche professionnelle pour répondre à ses besoins spécifiques. Les CQP s’appuient sur les référentiels de compétences de l’Éducation nationale. Ils ne sont toutefois reconnus que par les branches considérées, ou par un regroupement de branche dans le cas des CQP inter-branches (CQPI).
Contenu de formation : Description détaillée des différents sujets traités dans la formation, en fonction d’objectifs pédagogiques et de formation définis. (Source : AFNOR)
Compétences : Ensemble de savoirs (connaissances), savoir-faire (habiletés) et savoir-être (attitudes) mobilisables dans une situation donnée.
Droit individuel à la formation (DIF) : Dispositif permettant aux salariés de bénéficier d’actions de formation continue. Il a été mis en place par la loi du 4 mai 2004 et offre à chaque salarié, qu’il soit titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou non, la possibilité de se former sur une durée de vingt heures par an. Les formations accessibles au titre du DIF doivent s’inscrire dans des démarches de promotion ; d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des connaissances ; d’acquisition d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle ou d’une qualification professionnelle.
Formation continue : Formation destinée aux personnes engagées dans la vie professionnelle (salariés du secteur public ou privé, demandeurs d’emploi, non-salariés, etc.). Les actions de formation continue peuvent avoir pour objectif de répondre à des besoins d’adaptation d’un salarié à son poste de travail, d’entretien ou de perfectionnement professionnel, de qualification, de reconversion ou de promotion.
Formation initiale : Désigne la première formation obtenue par une personne dans le cadre du système éducatif, avant son entrée dans la vie active.
Formation professionnelle : Processus d’apprentissage permettant à un individu d’acquérir les savoirs et les savoir-faire nécessaires à l’exercice d’un métier ou d’une activité professionnelle. On distingue la formation professionnelle initiale (voie professionnelle du lycée, apprentissage, etc.) et la formation professionnelle continue qui s’adresse aux salariés en place et aux demandeurs d’emploi.
Formation tout au long de la vie : Terme se rapportant à l’ensemble des situations et contextes de formation que connaît un individu au cours de sa vie, et qui constituent ainsi un continuum entre la formation initiale et la formation continue. Ce concept est apparu dès les années 1960 mais s’est développé au milieu des années 1990 avec la prise de conscience que, pour permettre l’adaptation des salariés aux évolutions économiques et technologiques, le maintien et le développement des compétences doit se faire tout au long de la vie.
Pôle de compétences : Région caractérisée par la concentration d’activités dans un même domaine technique, conduisant à l’accumulation de savoir-faire pouvant procurer un avantage compétitif important une fois atteinte une masse critique.
Qualification : Ensemble des connaissances, diplômes, expériences professionnelles, etc. d’un individu le rendant apte à exercer une activité professionnelle.
Méthode pédagogique : Ensemble des démarches pédagogiques adoptées par un enseignant pour favoriser l’apprentissage et permettre l’acquisition de savoirs conformes aux objectifs pédagogiques. On distingue généralement trois types de méthodes pédagogiques : les méthodes affirmatives, dans lesquelles le formateur, détenteur du savoir, le transmet aux apprenants qui reçoivent ce savoir sans collaborer à sa construction ; les méthodes interrogatives (ou inductives), qui consistent à faire découvrir à l’apprenant ce que l’on veut enseigner ; les méthodes actives, basées sur le principe que l’on apprend mieux lorsque l’on construit soi-même son propre savoir.
Métier en tension : Métier sur lequel il existe de fortes difficultés de recrutement. Il ne s’agit pas forcément des métiers qui représentent les volumes de recrutement les plus importants, mais la pénurie de candidat peut ralentir le développement d’une entreprise ou engendrer des délais et des coûts de recrutement conséquents. Les métiers en tension sont identifiés grâce à un « indicateur de tension », qui se calcule en rapportant le nombre d’offres aux demandes d’emploi. Lorsque ce ratio est supérieur à 1, cela signifie que le nombre d’offres surpasse celui des demandes d’emploi. Plus celui-ci est élevé, plus la tension est forte et signale les difficultés que rencontrer les entreprises à pourvoir leurs postes.
Niveau de formation : Désigne la position hiérarchique d’un diplôme dans une nomenclature donnée. En France, la nomenclature distingue six niveaux de formation :
- Niveau VI et V bis : sorties en cours de premier cycle de l’enseignement secondaire (sixième à troisième) ou abandons en cours de CAP ou BEP avant l’année terminale.
- Niveau V : sorties après l’année terminale de CAP ou BEP ou sorties de second cycle général et technologique avant l’année terminale (seconde ou première).
- Niveau IV : sorties des classes de terminale de l’enseignement secondaire (avec ou sans le baccalauréat). Abandons des études supérieures sans diplôme.
- Niveau III : sorties avec un diplôme de niveau Bac+2 (DUT, BTS, DEUG, écoles des formations sanitaires ou sociales, etc.).
- Niveau II : sorties avec un diplôme de niveau compris entre Bac+3 et Bac+4 (licence, première année de master).
- Niveau I : sorties avec un diplôme de niveau supérieur à Bac+5 (master, doctorat, diplôme de grande école). (Source INSEE)
Savoir : Ensemble des connaissances théoriques et pratiques.
Savoir-être : Terme communément employé pour désigner la capacité d’un individu à trouver les conduites et comportements appropriés dans des situations professionnelles impliquant échanges et coopération.
Savoir-faire : Habileté d’un individu à mettre en œuvre son expérience et ses connaissances acquises pour l’accomplissement d’une tâche. La combinaison des deux verbes « savoir » et « faire » révèle en effet l’alliance entre la connaissance et l’action.
Tutorat : Dispositif de formation se déroulant en situation de travail et dans lequel la personne en apprentissage est encadrée par un professionnel. L’objectif est de faciliter l’apprentissage progressif d’un métier dans le cadre d’une relation individualisée et formalisée.
Liste des contributeurs et des personnalités auditionnées
Acteurs de la formation
Abdel AÏSSOU, Directeur général du groupe Randstad France
Philippe AKLI, Responsable du centre d’information et d’orientation (CIO) de Caen
Jean-Pierre BELLIER, Inspecteur général de l’Éducation nationale
Annie BURNOUF, Professeure au Lycée Aristide Briand d’Évreux
Thierry CHEVALLEREAU, Directeur du GEIQ Industrie Poitou-Charentes
Jean-Pierre COLLIGNON, Inspecteur général de l’Éducation nationale
Henri DE NAVACELLE, Directeur de l’AFORP
Bernard DESCLAUX, ex-Directeur de centre d’information et d’orientation (CIO)
Équipe enseignante du collège Saint-Maur de Pau
Monique FOURNIER-LAURENT, Bénévole à la mission locale de la vallée de l’Oise, Membre du GR21
Tristan GILLOUARD, Directeur du Centre des formations industrielles (CFI)
Didier GODEMENT, Responsable du site d’Orly du Centre des formations industrielles (CFI)
Pascal HUARD, Responsable d’animation et de projet à la maison familiale et rurale de Gironde
François LACOSTE, Responsable de la communication interne et externe à l’AFORP
Franck LEROY, Directeur départemental de Pôle emploi en Mayenne
Lionel PINARD, Proviseur du lycée des métiers Galilée de Gennevilliers
Responsables du centre d’information et d’orientation (CIO) de Vernon
Alain ROUMILHAC, Président de ManpowerGroup France
Claudine SCHMIDT-LAINE, Recteur de l’Académie de Rouen
Karim TERKI, Manager pédagogique au Centre des formations industrielles (CFI)
Michel TIBIER, Directeur général d’Entreprendre ensemble
Saliha TIGHILT, Chargée de sourcing à l’AFORP
Aline WAGNER, Chef de projet à Inffolor
Acteurs régionaux
Marie-Guite DUFAY, Présidente du Conseil régional de Franche-Comté
Marie-Claire QUIERS, Directrice des « Mutations économiques et continuités professionnelles » au Conseil régional de Bourgogne
Alain ROUSSET, Président de l’Association des régions de France (ARF), Président du Conseil régional d’Aquitaine
Philippe SCHWARTZ, Directeur général adjoint au Conseil régional de Lorraine
Gérard SPERANZA, Directeur général adjoint au Conseil régional de Bourgogne
Experts
Samanta AL-YAMMOUNI, Chargée de communication à la Chambre franco-suisse pour le commerce et l’industrie (CFSCI)
Raphaël ALEXANDRE, Vice-président de la CGPME de la Mayenne
Francis ARCAUTE, Directeur du comité « Métiers et compétences » de la Plateforme de la filière automobile (PFA)
Jean ARTHUIS, Sénateur de la Mayenne, Président du Conseil général de la Mayenne
Jacques BARTHELEMY, Avocat conseil en droit social
Brigitte BASTARD, Responsable du Centre spécialisé de formation dans le domaine des matériaux industriels (CACEMI) du Conservatoire national des arts et métiers (CNAM)
Sabine BESSIERE, Chef du département « Métiers et qualification » de la DARES
Denis BOISSARD, Directeur de projets de l’UIMM
Marc CANAPLE, Responsable du département de droit social de la direction générale des études et de la mission consultative de la CCI Paris Île-de-France
Marie-Claire CARRERE-GEE, Présidente du Conseil d’orientation pour l’emploi (COE)
Jean-Luc CENAT, Conseiller du président de l’AFDET
Gilbert CETTE, Professeur associé à l’université de la Méditerranée, Économiste à la Banque de France
Guillaume CHATROUX, Chargé d’affaires à l’Institut de régulation et d’automation (IRA)
Gabriel COLLETIS, Professeur à l’université Toulouse 1
Sabine COSTE, Chercheuse à l’École normale supérieure de Lyon
Françoise DIARD, Responsable de l’Observatoire de la métallurgie
Olivier DUPUIS, Secrétaire général du Comité national des entreprises d’insertion (CNEI)
Grégoire EVEQUOZ, Directeur général de l’Office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue (OFPC) de Genève
Martin FISCHER, Directeur de la communication du Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI)
Christine GALLOT, Directeur de la communication de l’UIMM
André GAURON, Collaborateur au Laboratoire social d’actions, d’innovations, de réflexions et d’échanges (Lasaire)
Bernard GAZIER, Professeur à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne
Dominique GILLIER, Secrétaire général de la Fédération générale des mines et de la métallurgie de la CFDT (FGMM-CFDT)
Anne-Lise HØSTMARK-TARROU, Professeur émérite à Oslo and Akershus University College
Alain d’IRIBARNE, Directeur de recherche au CNRS
Aziz JELLAB, Chercheur à l’université Lille III
Yves LICHTENBERGER, Chercheur au Laboratoire techniques, territoires et sociétés (LATTS)
Francis MER, Vice-président du groupe Safran
Christian POYAU, Président de la Fondation Croissance responsable, PDG de Micropole
Martin RICHER, Consultant en responsabilité sociale des entreprises, Coordonnateur du pôle « Affaires sociales » de Terra Nova
Claudine ROMANI, Chargée de la mission « Partenariats sociaux » au Céreq
Paul SANTELMANN, Directeur de la veille pédagogique de l’AFPA
Jean-Claude THOENIG, Professeur émérite à l’université Paris-Dauphine
Emmanuelle WARGON, Déléguée générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP)
Jean-Daniel WEISZ, Associé chez Kohler Consulting & Coaching
Jean WEMAËRE, Président de la Fédération de la formation professionnelle (FFP)
Industriels
Laurent BATAILLE, Président-directeur général de Poclain Hydraulics
Pascal CHAPELON, directeur des ressources humaines de Mane
Robert CHARREYRON, Directeur des ressources humaines de Clextral
Frédéric COIRIER, Président-directeur général de Cheminées Poujoulat
Dominique DUBOIS, Président-directeur général de Multiplast
Elizabeth DUCOTTET, Présidente de Thuasne
Ivan DUPRAZ, Directeur des ressources humaines du site de Vertolaye de Sanofi
Olivier FAHY, Président-directeur général de Berkem
Didier FEGLY, Président-directeur général de Sacred, Président d’Elastopole
Georges JOBARD, Président-directeur général de Clextral
Hervé LEROY, Directeur opérationnel de Bernard Controls
Pierre MONFORT, Directeur de la formation de DCNS
Eugénie SAMOUR, Chargée de mission et de l’emploi à Trescal
André ULMANN, Président-directeur général de HRA-Pharma
Marc VAN DER HEIJDE, Responsable sécurité-environnement à Clextral
Thibaut Bidet-Mayer et Louisa Toubal, Formation professionnelle et industrie. Le regard des acteurs de terrain, Paris, Presses des Mines, 2014.
ISBN : 978-2-35671-150-2
© Presses des MINES – TRANSVALOR, 2014
60, boulevard Saint-Michel – 75272 Paris Cedex 06 – France
presses@mines-paristech.fr
www.pressesdesmines.com
© La Fabrique de l’industrie
81, boulevard Saint-Michel -75005 Paris – France
info@la-fabrique.fr
www.la-fabrique.fr