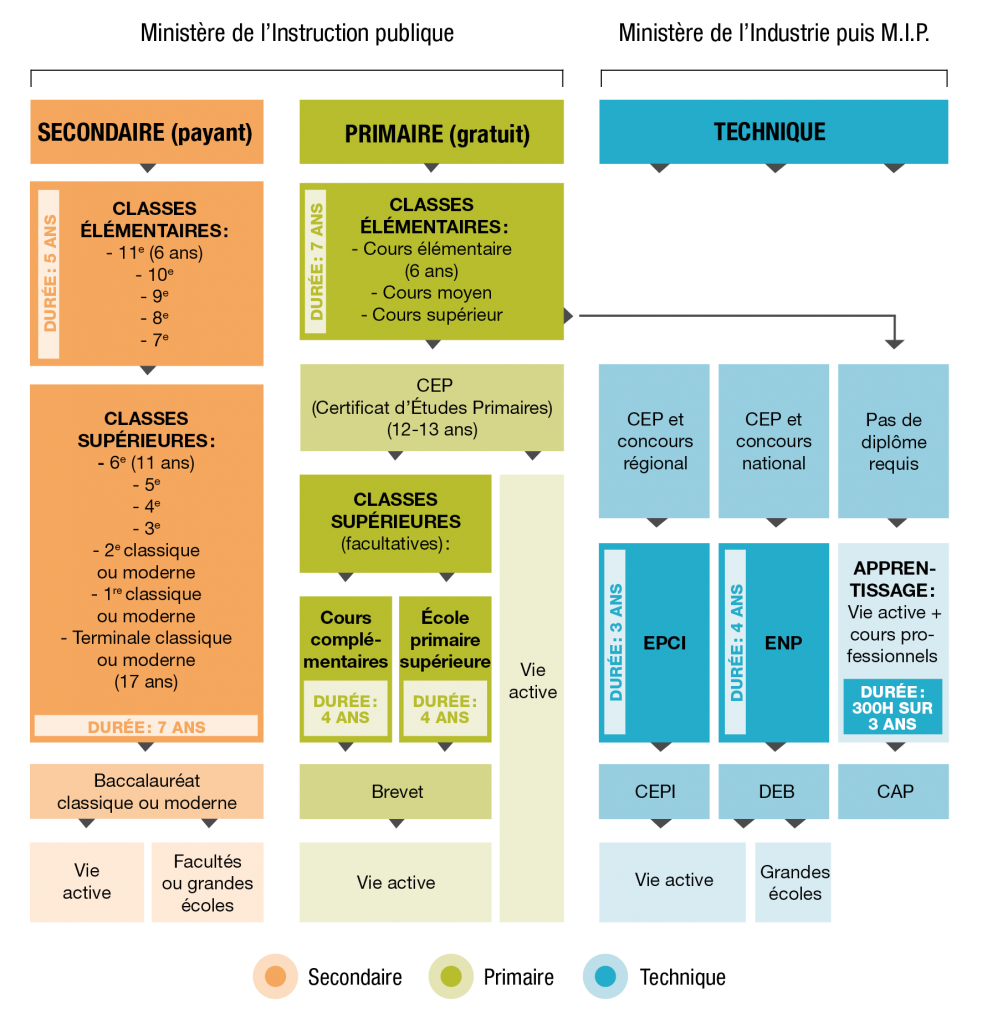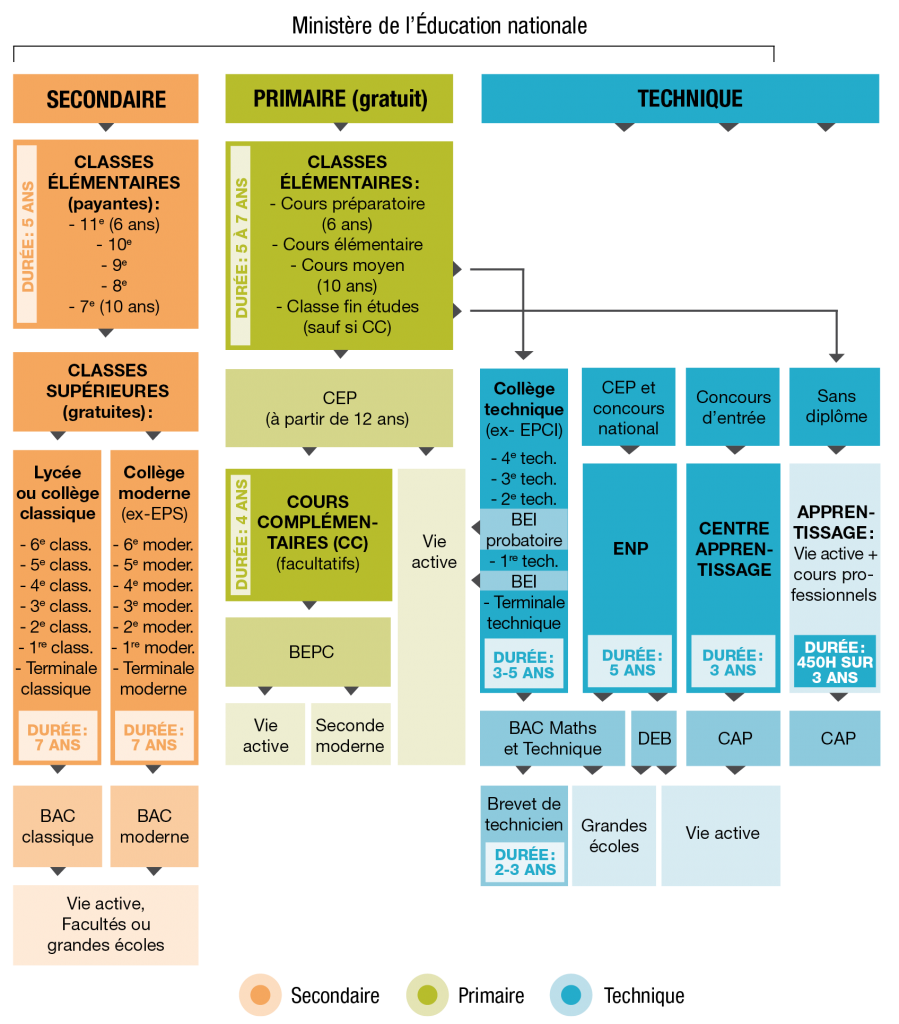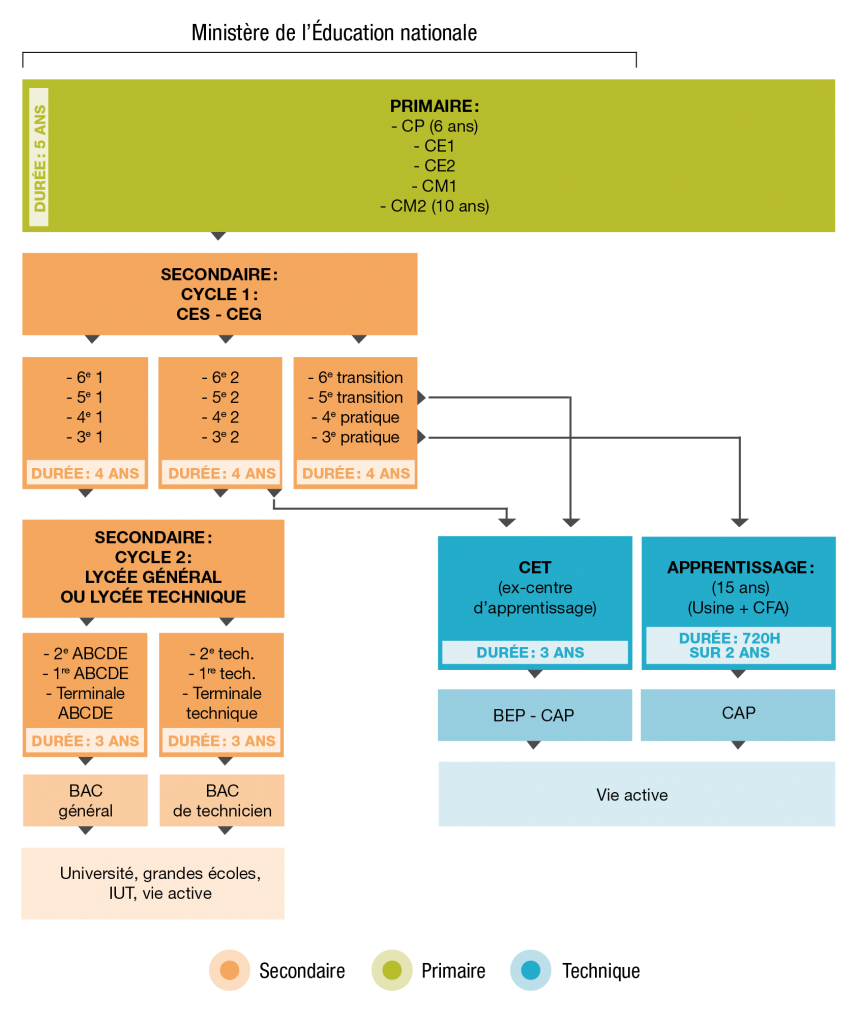Tempête sur les représentations du travail

Photo de couverture : Le Sculpteur Ossip Zadkine Bois d’orme polychromé, 1939-1940 Musée d’art Moderne En dépôt au musée d’Art Moderne de Saint-Étienne © ADAGP Paris 2018
Avant-propos
Bien que la reprise de l’économie soit fragile, beaucoup d’usines fonctionnent à plein régime et n’arrivent pas à embaucher les personnes qualifiées dont elles ont besoin. Soudeurs, chaudronniers, ajusteurs, mécaniciens… : les employeurs déplorent une pénurie de main d’œuvre sur plusieurs métiers industriels, parfois appelés « technologiques ».
Comment en sommes-nous arrivés là, dans un pays frappé par un chômage endémique, alors que, chez nos voisins, les emplois de production et les formations qui y préparent sont bien plus prisés ?
Pour aborder ces questions, La Fabrique de l’industrie et plusieurs entreprises se sont associées pour créer à Mines ParisTech une chaire dédiée à l’étude des transformations de l’industrie et du travail. Cette chaire (FIT), dont le présent ouvrage est la première production, s’intéresse notamment aux nouvelles manières d’organiser le travail dans « l’entreprise du futur ».
Pour comprendre la méfiance des Français à l’égard de l’industrie, des diagnostics ont été posés sur les dysfonctionnements de la formation professionnelle et de l’apprentissage1 et sur ceux du marché du travail. D’autres travaux ont souligné la nécessité d’améliorer la qualité de vie au travail2, ou simplement de mieux faire connaître la réalité des usines3.
Tout cela est pertinent, mais les racines du mal sont plus profondes. Cet ouvrage analyse la manière dont nos représentations sur le travail de production se sont construites au fil de l’histoire intellectuelle, politique et économique de notre pays et du développement de son système éducatif. Laurence Decréau, enseignante de lettres classiques dont de précédents ouvrages portaient sur les vocations4 et sur les cadres désillusionnés qui se reconvertissent à l’artisanat5, était particulièrement qualifiée pour entreprendre cette étude. Le résultat est vertigineux. Au fil des siècles, la France s’est littéralement coupé les mains en associant l’exercice d’un travail utile à un état servile. En qualifiant de « manuels », non ceux qui excellent par leur habileté, mais ceux qui semblent inaptes à un travail intellectuel. En n’incluant aucun rudiment de culture technique dans l’enseignement des humanités. En orientant vers les métiers de production les élèves au parcours scolaire difficile.
Il faut connaître cette histoire si l’on veut comprendre comment réconcilier les Français avec les activités de production et faciliter le développement d’une industrie haut de gamme, pourvoyeuse de richesse économique, d’emplois qualifiés attractifs et de cohésion sociale.
Vincent Charlet – Délégué général de La Fabrique de l’industrie
Thierry Weil – Titulaire de la chaire Futurs de l’industrie et du travail
- 1. Voir notamment Formation professionnelle et industrie : le regard des acteurs de terrain ( note de La Fabrique n°8, Thibaud Bidet-Mayer et Louisa Toubal, Presses des mines, 2014), Osez la voie pro (Presses des mines, 2015), Yves Malier, Reconnecter la formation à l’emploi, Le chômage des jeunes n’est pas une fatalité , Presses des mines, 2017.
- 2. Emilie Bourdu, Marie-Madeleine Péretié, Martin Richer, La qualité de vie au travail, levier de compétitivité , Presses des mines, 2016.
- 3. Dimitri Pleplé, L’indus’trip, un vélo, des usines et des hommes , Presses des mines, 2018.
- 4. Laurence Decréau, Des génies et des saints, les chemins de la vocation , Plon, 2005.
- 5. Laurence Decréau, L’élégance de la clé de douze, Enquête sur ces intellectuels devenus artisans , Lemieux, 2015.
Résumé
« Ouvrier, moi ? Jamais ! » Tel semble être le cri du cœur de nombre de jeunes. Tout leur vaut mieux que travailler « à l’usine », synonyme de chômage, pénibilité, salaire minimum et relégation sociale. Or, ces représentations sont en décalage total avec la réalité.
L’usine d’autrefois tend à céder la place à une hyper-industrie dominée par des machines sophistiquées et des robots pilotés par des logiciels complexes que doivent surveiller les hommes. Pas d’accès possible à ces postes qualifiés sans formation technique approfondie. Ce n’est plus à l’usine que vont désormais les moins qualifiés, elle n’a plus de poste à leur offrir, mais dans les services – centres d’appels, restauration rapide, logistique, distribution, services à la personne – gourmands d’une abondante main d’œuvre interchangeable et souvent précaire.
L’École n’a pas encore entériné cette évolution du monde du travail. Elle appelle les jeunes à briguer la voie générale où, dotés d’un baccalauréat qui s’est progressivement dévalorisé, ils rejoindront l’université. Mais nombre d’entre eux qui en sortiront sans métier voire sans diplôme finiront, frustrés, par rejoindre le nouveau prolétariat des services. Quant à la voie professionnelle, censée préparer à un métier, elle n’attire guère et peine à remplir sa mission. Devenue bien trop générale pour former des spécialistes qualifiés, elle est trop souvent considérée comme une voie de relégation pour élèves aux résultats insuffisants dans les disciplines scolaires abstraites. Résultat : des jeunes sans emploi et des industriels qui peinent à pourvoir les postes…
La crise du travail et de l’éducation est aussi une crise lexicale : manuel vs intellectuel, technique vs culture, voie professionnelle vs voie générale, col bleu vs col blanc… tous ces mots désignaient des catégories qui ont cessé d’être opérantes. La France est aujourd’hui un pays malade de ces représentations binaires.
Cet ouvrage entend revenir sur les origines et la construction de ces représentations. Comment des termes tels que « manuel », « culture » et « orientation » se sont-ils insensi- blement distordus au point de perdre tout lien avec leur signification d’origine ? Rebattus à l’envi, ils sont d’un usage si courant qu’enseignants, parents et élèves les emploient aujourd’hui sans y penser : « manuel » qualifie un élève inapte à suivre la voie générale ; « orientation » masque un processus menant à l’exclusion de ladite voie générale ; quant à « culture », implicitement associé aux humanités, il est opposé à technique.
Quels événements historiques, politiques, intellectuels, ont agrégé à ces mots leurs connotations actuelles ? Est-ce propre à la France ? Avant même de songer à réconcilier les Français avec la technique et l’industrie, il importe de comprendre ce qui les en a éloignés. C’est par les mots, véhicules d’images, qu’évolueront enfin nos représentations, figées depuis près de deux siècles.
Introduction
Trois millions de chômeurs, et les jeunes en première ligne. 120 000 postes non pourvus dans l’industrie, faute de candidats ou de candidatures recevables. Des filières industrielles boudées au lycée professionnel, au profit d’un secteur tertiaire offrant pourtant moins d’opportunités et des salaires moins élevés. Tandis que l’industrie française peine à recruter, les jeunes générations semblent prêtes à tout accepter – chômage, CDD au rabais… – plutôt que de travailler à l’usine.
Dans le même temps, sur les rayons des librairies et les écrans de cinéma, le calvaire des cols blancs fait florès : burn-out, dépressions, suicides, il n’est question que du mal-être des cadres et des employés confinés dans les open spaces. L’Établi de Robert Linhart1, Sortie d’usine de François Bon2, L’Excès-l’usine de Leslie Kaplan3 : balayés, les romans sur la souffrance ouvrière des années 1970 ! La représentation du malheur au travail a migré de l’atelier au bureau. L’usine n’y gagne rien pour autant : naguère fustigée, elle est devenue invisible, évacuée du champ des représentations, sauf rares exceptions mettant en scène ces variantes d’une disparition annoncée que sont fermetures et délocalisations.
On conçoit dès lors que de grands patrons d’industrie peinent à se faire entendre lorsqu’ils tentent de « convaincre nos concitoyens que l’industrie est la plus passionnante des aventures de notre époque »4. Il n’est pire sourd que celui qui ne veut entendre. Louis Gallois en est bien conscient, qui ajoute : « C’est en abordant les problèmes par leurs racines culturelles que nous parviendrons à les traiter. »5 Avant de chercher à réconcilier les Français avec leur industrie, il importe de comprendre ce qui les en a éloignés. Tel est le propos de cette étude.
Films, romans, essais, le matériau ne manquait pas où glaner des indices. Des entretiens avec les divers acteurs concernés – travailleurs de l’industrie, du tertiaire, institutionnels… – offraient en outre la promesse d’un précieux complément. Aussi bien une récente enquête sur la reconversion des « cols blancs » à l’artisanat6 nous avait-elle déjà ouvert quelques pistes. Mais il nous est vite apparu qu’avec une telle méthode, nous resterions inévitablement à la surface du phénomène. Tout au plus serions-nous capable de livrer un constat, d’offrir une photographie plus ou moins juste. Manquerait l’essentiel : la genèse de ces représentations. Il fallait s’immerger dans le passé ; éplucher les analyses livrées par les spécialistes.
L’incontournable enquête bibliographique nous l’a montré : le plus souvent, notre sujet – le déficit d’image des métiers manuels et techniques, plus particulièrement en France – n’est traité qu’à la marge. Des historiens l’abordent, à travers le prisme de leur spécialité : histoire culturelle, histoire de l’éducation, du monde ouvrier, du travail… Des philosophes, aussi, de Platon et Aristote à Diderot, d’Alembert, Hannah Arendt, Nicolas Grimaldi. Des sociologues, enfin : Durkheim, Max Weber, Bourdieu et son école… Mais s’ils le font, et parfois longuement, c’est au sein d’une réflexion plus large dédiée ici à la démocratie, là au travail, ailleurs aux racines du capitalisme ou à la reproduction des élites.
Tropisme d’enseignante7 oblige, c’est par le pan « éducation et formation » que nous avons attaqué l’escalade de notre montagne bibliographique. Histoire de l’éducation et de l’enseignement, Histoire de la formation ouvrière, Histoire de l’enseignement technique… Très vite, un fait nous a frappée : selon les locuteurs, les champs de spécialisation, les époques surtout, trois mots-clés liés à notre sujet changent du tout au tout de coloration, voire de signification : manuel, culture, orientation. Rebattus à l’envi, ils sont d’un usage si courant qu’enseignants, parents et élèves les emploient aujourd’hui sans y penser. Or, cet emploi contredit à la fois leur étymologie et leur sens premier. Deux de ces mots se sont mués en euphémismes : « manuel » qualifie un élève inapte à suivre la voie générale, un nul, en somme ; « orientation » désigne le processus menant à l’exclusion de ladite voie générale. Quant au troisième, « culture », implicitement associé aux humanités, il exclut d’emblée ce qui, étymologiquement, lui est pourtant consubstantiel : la technique.
Comment de telles distorsions lexicales, dont on mesure l’impact sur notre système de formation, ont-elles pu s’opérer ? Ont-elles une origine identifiable, ou se sont-elles effectuées insensiblement ? Quels événements historiques, politiques, intellectuels, ont agrégé à ces mots leurs connotations actuelles, qui nous semblent si naturelles ? Pourquoi en France plus particulièrement ? Ce surprenant glissement sémantique ouvrait tant de questions que l’idée s’est vite imposée d’aborder le problème des « représentations actuelles du travail manuel et techniques en France » à travers le prisme de ces trois mots. Ce choix présentait un double avantage : celui de circonscrire un champ d’investigation à la fois pléthorique et flou, les « représentations » ; et du même coup, en le réduisant, de nous permettre un ample balayage historique sans risque d’éparpillement.
Dans un second temps, il nous sera loisible de réinterroger la crise actuelle du travail et de l’éducation à la lumière de cette mise au point historique et sémantique. Si les catégorisations auxquelles nous sommes accoutumés ont perdu de leur pertinence (manuel vs intellectuel, culture vs technique, voie générale vs voie professionnelle), peut-on voir dans cette crise les prémices du retour en grâce d’un secteur technique trop longtemps et injustement mal-aimé ? À supposer que tel soit bien le cas, cette étude – forcément partielle – a pour seule ambition d’inspirer quelques pistes de réflexion et d’action à tous ceux que désolent les souffrances d’un pays malade de ses représentations.
- 1. Robert Linhart, L’Établi , Minuit, 1978.
- 2. François Bon, Sortie d’usine , Minuit, 1982.
- 3. Leslie Kaplan, L’Excès-l’usine , P.O.L., 1987.
- 4. Pierre Veltz et Thierry Weil (dir), L’Industrie, notre avenir, Eyrolles, 2015, p. 233
- 5. Ibid.
- 6. Laurence Decréau, L’ Élégance de la clé de douze. Enquête sur ces intellectuels devenus artisans , Lemieux éditeur, 2015.
- 7. L’auteure de cette étude est agrégée de lettres classiques. Elle a enseigné dans le secondaire et en grande école d’ingénieurs.
Manuel
« Nous devons nous inquiéter du mépris que l’on porte à un travail manuel exigeant et noble », écrivait récemment le linguiste Alain Bentolila.
1
« La revalorisation du travail manuel est largement en marche », se félicitait quarante ans plus tôt le président Valéry Giscard d’Estaing devant les lauréats du concours du Meilleur Ouvrier de France2.
Ainsi juxtaposées, ces deux citations en apparence contradictoires peuvent certes prêter à sourire. Du moins y lit-on un même double diagnostic : en France, le travail manuel est dévalorisé – manifestement, cela ne date pas d’hier ; cette dévalorisation constitue un problème.
Au-delà du diagnostic, qui ne surprend personne tant on y est accoutumé, nul ne songe curieusement à s’étonner de l’emploi, hier comme aujourd’hui, de l’adjectif « manuel » – comme s’il allait de soi. Avec son antonyme, pour tous évident : « intellectuel ». Ainsi se répartissent les métiers, les uns « intellectuels » et les autres « manuels ». Les intelligences aussi, témoin cette citation empruntée au sociologue François Dubet à propos du collège unique : « Les élèves ayant des compétences et des goûts “ intellectuels” resteront dans une formation les préparant au lycée d’enseignement général, les élèves pourvus d’une “intelligence manuelle” seront orientés précocement vers les techniques et les professions. »3
C’est cette apparente évidence que nous souhaiterions dans un premier temps interroger. Nul besoin d’être latiniste pour rattacher le mot « manuel » à sa racine manus – la main. Ni pour deviner une racine commune entre « intellectuel » et « intelligence » – le verbe latin intellegere . Mais d’où vient que les deux s’opposent dans nos catégories ? Plus surprenant encore, comment peut-on dès lors qualifier de « manuelle » une « intelligence » ? Enfin, à l’ère de l’automatisation, où s’interposent entre l’homme et la matière des machines à commandes numériques, des imprimantes 3D ou des robots, comment expliquer que l’on persiste à qualifier de « manuels » des métiers dont la main n’a de cesse de s’absenter ?
- 1. Le Monde , 26 septembre 2016.
- 2. Le 26 octobre 1979.
- 3. François Dubet, L’École des chances. Qu’est-ce qu’une école juste ? Seuil, 2004.
« Manuel » : un concept fourre-tout et péjoratif
Manuel ? Et l’œil, et le nez, et l’oreille ?
Un travail du corps
Ce fut un des grands succès de librairie de l’année 2010 : un philosophe de formation reconverti dans la réparation de motos, Matthew Crawford, dénonçant la taylorisation du travail des « cols blancs », lançait un vibrant plaidoyer pour l’artisanat1. S’il y décrit par le menu ses bonheurs de mécanicien, on y chercherait en vain un éloge de l’habileté manuelle. Comment gonfler un moteur ? Il est question de « mesure rigoureuse » et d’« inspection visuelle », de « qualités d’attention », de « symptômes invisibles »2… Plus loin, un « claquement des pistons » décelé par l’oreille fait aussitôt jaillir ce diagnostic : « Ah ! Les poussoirs ! »3 Si la main ne reste certes pas inactive – limant, vissant, serrant, coinçant – son rôle se limite à celui d’un outil. L’essentiel se passe ailleurs, dans un va-et-vient permanent entre les cinq sens et le cerveau.
Dans un autre ouvrage consacré à l’artisanat paru la même année, le sociologue Richard Sennett détaille longuement les démêlés d’une souffleuse de verre avec la matière en fusion dont elle s’efforcera, longtemps en vain, de faire un verre ballon parfait4. La main, qui tourne la longue canne servant à « cueiller » le verre fondu, joue évidemment son rôle. Mais on le découvre bien minime, au regard de la posture corporelle, du rythme à attraper, du soufflage, de l’œil surtout, qui doit anticiper les réactions de la bulle de verre. Ce rôle en définitive accessoire de la main, l’auteur de ces lignes en a fait le constat étonné en interviewant cinq cols blancs reconvertis tardivement à l’artisanat5. Interrogés sur leur « habileté manuelle », tous cinq se montrèrent peu diserts – le vitrailliste préférant s’étendre amoureusement sur le « chant du verre » qui chuchote au coupeur qu’il exerce sur sa matière une juste pression.
Le travail dit « manuel », au-delà de la main, engage le corps tout entier. On pourrait développer ainsi à l’infini : c’est l’odorat qui confirmera au paysan que son lisier est bon, à l’ouvrier de la pétrochimie la présence de chlore6… Au-delà de la main, c’est le corps tout entier qui travaille, envoyant au cerveau ses innombrables perceptions que ce dernier synthétise, mémorise, interprète. Un tel travail, résume Baudoin Roger, « s’appuie sur l’ensemble des expériences, savoirs et connaissances accumulés dans une expérience singulière, corporellement vécue. »7
Mais le travail dit « manuel » n’est pas seul concerné. Ne peut-on en dire autant des artistes – peintres, sculpteurs ou musiciens – dont la main est également l’outil ? Ou d’une partie des travailleurs considérés quant à eux comme « intellectuels » – physiciens, chimistes, biologistes, géologues… – qui eux aussi se servent de leurs mains pour sonder la matière ? Assurément – et le sociologue Claude Grignon8 d’en conclure que la nature des moyens physiologiques mis en œuvre pour accomplir un travail ne constitue pas un critère pertinent pour définir la catégorie du « travail manuel ».
Une certitude, toutefois : le corps des managers, des notaires, des comptables, n’est guère sollicité dans l’exercice de leur métier au quotidien. Eux, du moins, sont de vrais « cols blancs ».
Alors, pourquoi « manuel » ?
Pourquoi les travailleurs qualifiés de « manuels » – artisans, ouvriers – voient-ils leur compétence résumée à celle de leur main, alors que leur corps tout entier est engagé dans ce dialogue quotidien avec la matière ? Sans doute parce que, chez l’homme seul, ce dialogue s’opère par le truchement de la main. Depuis l’Antiquité, la main symbolise la supériorité de l’homme sur le reste des animaux : « Anaxagore prétend que c’est parce qu’il a des mains que l’homme est le plus intelligent des animaux. Ce qui est rationnel, plutôt, c’est de dire qu’il a des mains parce qu’il est le plus intelligent. »9
Libérée par la station debout, la main s’est aussitôt employée à fabriquer des outils pour travailler, modeler et dompter la matière. Ce qui fait d’elle, dit l’anthropologue André Leroi-Gourhan, « le symbole de l’évolution de l’homme »10. En termes d’odorat, l’homme ne soutient pas la comparaison avec le chien, et encore moins avec la mouche en termes d’acuité visuelle. Seuls les Primates sont, comme lui, dotés de mains, mais les rares outils qu’ils utilisent sont des plus sommaires.
Porteuse d’outils de plus en plus sophistiqués, la main symbolise cette capacité spécifiquement humaine de plier la matière à ses fins. Dès lors que tel est son métier, le travailleur sera à juste titre qualifié de « manuel » – homo faber, homo habilis… Mais à ce stade, rien de péjoratif encore.
Chirurgien, fondeur-métallurgiste : qui est le plus manuel des deux ?
Posons donc pour principe qu’un travailleur « manuel » est celui qui, dans l’exercice de son métier, sollicite ses sens comme capteurs et ses mains comme outils pour agir sur la matière. Le chirurgien, le dentiste, le kinésithérapeute se rangent tout naturellement dans cette catégorie – de même que les artistes et les scientifiques cités précédemment. À l’inverse, le fondeur-métallurgiste qui, assis dans sa cabine de pilotage, surveille la coulée sur un écran d’ordinateur, interprétant les multiples indicateurs, rectifiant d’un clic, ne saurait en faire partie. Pour le visiteur, la salle des commandes des aciéries de Dunkerque évoque à s’y méprendre celle du CERN11 – en plus petit.
Or, il n’en est rien. Debout, gantés, bistouri ou davier à la main, engoncés dans leur blouse, le chirurgien et le dentiste exercent des métiers qualifiés d’« intellectuels ». Quant au fondeur-métallurgiste, il a beau être assis sur son fauteuil en skaï avec sa chemisette toute propre, la main sur sa souris, ne vous y méprenez pas : c’est bien un « manuel ».
Survivance des temps anciens, arguera-t-on pour ce dernier. Il n’y a pas si longtemps, masqué, ganté, debout près de la coulée, le fondeur, tout le jour durant, manipulait le métal en fusion. L’étiquette lui sera restée par habitude. Peut-être. Mais alors pourquoi, hier encore associé au barbier, le chirurgien, « manuel » pendant des siècles, trône-t-il aujourd’hui parmi les « intellectuels » ?
Jetons un œil à ces critères étranges selon lesquels s’opère la distinction entre les deux catégories.
Trois distinctions non pertinentes
Le sociologue Claude Grignon s’est attelé à un inventaire systématique de ces critères dans son ouvrage L’Ordre des choses12. Il y évacue rapidement, nous l’avons évoqué supra, celui des moyens physiologiques mis en œuvre, qui impliquerait de classer Rodin, l’empereur du burin, Marie Curie, prêtresse de la pechblende, ou le virtuose Arthur Rubinstein parmi les travailleurs manuels. Ce qui n’est pas le cas.
La nature du résultat obtenu, se demande-t-il, conviendrait peut-être mieux? Définissons comme « manuel » celui dont la tâche vise à produire des résultats purement matériels – confectionner un pain, une table, réparer une chaudière – et comme « intellectuel» celui qui exerce une action symbolique – produire un discours, un tableau, une statue, une théorie scientifique… De nouveau, nous nous heurtons à divers contre exemples : le médecin et le dentiste, occupés à réparer notre machinerie corporelle, migreraient chez les manuels, tandis que les coiffeurs et les esthéticiennes, visant un résultat purement esthétique et donc symbolique, caracoleraient chez les intellectuels.
Reste un principe de classification de prime abord plus satisfaisant : l’objet du travail.
L’objet du travail. D’Alembert en son temps, co-auteur avec Diderot de l’Encyclopédie, distinguait deux types de métiers : ceux dont l’objet est extérieur et matériel, réunis sous l’appellation d’« Arts mécaniques » ; ceux dont l’objet est constitué de représentations – relevant des «Arts libéraux». À ce compte, notre chirurgien est bien un manuel.
À l’aube du XXe siècle, le philosophe Alain reprend peu ou prou cette catégorisation, tout en modifiant les mots. Conservant pour critère l’objet, il distingue deux types de travail : l’un s’exerce sur la matière et transforme les choses – le travail « prolétaire » ; l’autre s’applique aux hommes, dont il s’emploie à transformer les sentiments, les représentations, les jugements, les intentions, les décisions – le travail « bourgeois ». « Prolétaires », les métiers de tailleur de pierre, ferronnier, boulanger, agriculteur ; « bourgeois », ceux d’avocat, de juge, de commerçant.
Moins d’un siècle plus tard, la technique est passée par là, qui rend caduques ces belles catégories, fait observer le philosophe Nicolas Grimaldi13. Prolétaires ou bourgeois, les travailleurs n’ont plus guère de contact direct avec l’objet censé les différencier – la matière pour les uns, les hommes pour les autres. La machine et l’ordinateur se dressent désormais entre le « prolétaire » et la matière. Quant au « bourgeois », outre l’ordinateur, il voit s’interposer entre lui et les hommes cette entité abstraite qui se nomme « statistique », avec ses corollaires – marketing, publicité… Sauf pour quelques métiers, le lien direct avec les choses et les hommes a disparu. « Prolétaires » et « bourgeois » ne manipulent plus désormais que des médiations.
Quoi qu’il en soit, note Claude Grignon, cette distinction par l’objet du travail (matière/homme) achoppe de nouveau sur les professions liées à la manipulation du corps humain. Elle ne permet pas d’expliquer que les métiers visant à enjoliver le corps soient catalogués comme « manuels » et ceux à le réparer comme « intellectuels »… Elle ne rend décidément pas compte de nos représentations.
Un reflet de la hiérarchie sociale
Paul Valéry ne manque pas de relever ces contradictions. Dans ses « Propos sur l’intelligence », il évoque la distinction longtemps en usage entre arts « mécaniques » et « libéraux ». Comme leur nom l’indique, les seconds englobaient, rappelle-t-il, « les professions qui conviennent à un homme libre. Un homme libre ne devrait pas vivre du travail de ses mains. La profession libérale s’opposait à la profession manuelle. »14 En vertu de cette logique, les artistes et les chirurgiens étaient donc en ce temps considérés comme de simples ouvriers. « Sono avoratore ! » répond Véronèse au tribunal de l’Inquisition qui l’interroge sur son métier. De nos jours, les catégories ont changé. L’artiste ne se confond plus avec l’artisan, ni le chirurgien avec le barbier. La raison de cette transformation ? « La hiérarchie sociale fondée sur l’estime, sur le degré supposé de noblesse des occupations, s’est déplacée. »
Faisant écho à cette analyse, Claude Grignon conclut son inventaire en identifiant le même critère de distinction entre travail « manuel » et « intellectuel » : « Le degré d’intellectualité socialement reconnu à une profession semble être directement fonction de la position qu’elle occupe dans la hiérarchie sociale. […] On pourrait probablement montrer qu’une profession cesse d’être perçue comme manuelle dès lors que ceux qui l’exercent parviennent à occuper une position sociale plus élevée. »15 La récente promotion dont bénéficient cuisiniers et pâtissiers en est, semble-t-il, une illustration. Naguère simples artisans, les voici aujourd’hui promus « artistes » : le « génie » s’est substitué au « tour de main », les « secrets » aux « recettes » – glissement lexical du champ de la main à celui de l’esprit. Concurrençant les chanteurs sur le petit écran, ils ont accédé au rang de stars. Et si, ni plus ni moins que les chaudronniers, ils se plient aux règles du concours du « Meilleur Ouvrier de France », les lauréats de leur seule catégorie accèdent à la médiatisation. Il reste à comprendre pourquoi.
Et, tout d’abord, à répondre à cette question : d’où vient cette valorisation si française du travail de l’esprit au détriment de celui de la main ?
- 1. Matthew Crawford, Éloge du carburateur. Essai sur le sens et la valeur du travail , La Découverte, 2010.
- 2. Ibid. , p. 108-113.
- 3. Ibid. , p. 114. Citation de Robert Pirsig, Traité du zen et de l’entretien des motocyclettes , Seuil, 1978, p. 37.
- 4. Richard Sennett, Ce que sait la main. Éloge de l’artisanat , Albin Michel, 2010, p. 236.
- 5. Laurence Decréau, L’ Élégance de la clé de douze. Enquête sur ces intellectuels devenus artisans , Lemieux éditeur, 2015.
- 6. Christophe Dejours, La Panne. Repenser le travail et changer la vie , Bayard, 2012.
- 7. Baudoin Roger in L’Industrie, notre avenir , op.cit. , p. 141.
- 8. Claude Grignon, L’Ordre des choses. Les fonctions sociales de l’enseignement technique , Minuit, 1971, p.45.
- 9. Aristote, Les Parties des animaux , 68a.
- 10. André Leroi-Gourhan, « Libération de la main », Problèmes n°32, 1956.
- 11. Organisation européenne pour la recherche nucléaire, le plus grand centre de physique des particules du monde.
- 12. Op.cit. p. 45-46.
- 13. Nicolas Grimaldi, Le Travail, communion et excommunication , Puf, 1998.
- 14. Paul Valéry, « Essais quasi politiques », Œuvres I , Gallimard « Pléiade », 1957, p. 1057.
- 15. Claude Grignon, op.cit. , p. 47.
Depuis quand le travail de l’esprit est-il «noble» et celui de la main «ignoble»?
Platon, ou le ver dans le fruit
« Animal doué de raison », « animal politique », voire « bipède sans plumes » : depuis l’Antiquité, définir la spécificité de l’être humain constitue un des sports favoris des philosophes occidentaux. Si l’essence de sa supériorité ne fait pas consensus, on s’accorde au moins sur un point, jugé fort regrettable : à l’instar de toutes les créatures, l’homme appartient à la nature. Avec les plantes, les animaux, il partage le besoin de se nourrir, de ne pas avoir trop chaud ni trop froid, la maladie aussi – et la mort. Fort heureusement, contrairement à eux, il ne se résume pas à ces trivialités. Car lui seul est doté d’une « âme intellective », par laquelle il s’élève au-dessus de la création.
L’allégorie de la caverne : le réel sensible n’est pas le vrai monde
Par cette âme qui le caractérise, nous dit Platon, l’homme seul, parmi le vivant, peut avoir contact avec le vrai monde, celui des Idées, dont le réel qui nous entoure n’est qu’une copie fallacieuse. Ce réel n’est qu’une caverne1 où l’homme est enchaîné, regardant danser sur ses murs les ombres déformées des Vrais objets qui sont là-bas, dehors : les Idées. S’il trouve le courage de se retourner, de sortir, d’affronter la lumière du soleil qui lui brûlera les yeux, il pourra contempler le Vrai. Nos sens nous trompent, dit Platon, ils nous enchaînent à une fausse réalité. Ce n’est qu’à condition de briser les chaînes, de renoncer aux sens pour nous en remettre à la seule raison que nous accéderons à la Vérité par la connaissance théorique.
Dès le IVe siècle avant Jésus-Christ, Platon pose les bases de la pensée occidentale, qui fait de la Raison (logos) la valeur première et du Philosophe l’homme le plus accompli. Voilà le manuel d’emblée ravalé au rang d’enchaîné, lui qui, se fiant à ses sens, voue à l’observation et à la manipulation des ombres sa misérable vie.
Le mythe de Prométhée : les arts mécaniques sont des arts palliatifs
Selon le mythe de la création de l’homme raconté par Platon, Épiméthée, chargé par Zeus de doter de diverses qualités tous les êtres vivants, eut l’étourderie de tout distribuer sans rien garder pour l’homme, qui resta nu et faible. Pour pallier ce fâcheux oubli, son frère Prométhée déroba le feu à Héphaïstos, les arts à Athéna, et il en fit cadeau aux malheureux humains, leur distribuant à chacun un art particulier. Si cet acte de générosité lui valut un châtiment éternel, les hommes purent ainsi inventer les maisons, les habits, les chaussures, les lits, et cultiver le sol pour en tirer leurs aliments. Mais ces « arts mécaniques » n’étaient pas suffisants : faute de posséder la science politique, les hommes étaient incapables de s’organiser pour affronter les autres animaux. Si, pour se protéger, ils construisaient des villes, aussitôt ils s’entretuaient. Zeus, qui n’était au fond pas si mauvais bougre, s’en inquiéta et décida de leur faire don de cette science qui leur manquait, sous forme de deux qualités : « Justice et Pudeur ». Contrairement aux autres arts, chaque homme en fut doté, et c’est ainsi que naquit la Cité2.
Les « arts mécaniques », nous dit le mythe, ne sont que des arts de survie, propres à pallier l’infériorité physique de l’homme dans la nature – lui qui n’a ni poils ni carapace pour se couvrir, ni sabots pour courir, ni griffes ni crocs pour se défendre ou attaquer.
Travailler de ses mains : un obstacle au plein exercice de la politique
La véritable supériorité de l’homme sur les êtres vivants est donc la science politique. De son exercice, et de tout ce qui peut l’aider à la cultiver – le logos, la philosophie, il tire son honneur, sa dignité. La démocratie athénienne attend de ses citoyens une pleine disponibilité pour les affaires publiques. Cette disponibilité porte le nom de scholè – qui a donné schola, l’école. À l’inverse, l’ascholia désigne toute occupation autre que politique – le « travail ». Les Romains reprendront cette catégorisation, en appelant l’une otium – qui a donné le mot « oisiveté » – et l’autre negotium – devenu en français « négoce ». Il ne fait pas bon « travailler », en Grèce ni à Rome : une telle activité ramène l’homme à sa triste condition de créature « naturelle », contrainte de se colleter avec les éléments – terre, métaux, bois… – pour simplement survivre, et de gagner sa vie pour pouvoir subsister. D’où le mépris dont sont victimes tous ceux qui pratiquent les arts mécaniques, certes bien utiles à la communauté, mais qu’il est préférable de déléguer aux « autres » – à commencer par les esclaves, qui ne manquent pas.
Du démiurge à la bête de somme
L’artisanat n’a pas pour seul défaut de détourner de la vie politique en mangeant tout le temps dont est censé disposer un homme libre. Il constitue en soi une activité étrangère à toute forme de liberté. Selon les Grecs, l’artisan est triplement asservi : à la nature, qui lui dicte ses lois – pour construire une table, il faut se plier à celles du bois et pour forger, à celles du métal ; au « modèle » idéal de table, de chaise, de chaussure, défini une fois pour toutes en fonction de son usage ; au client, qui lui passe commande et qu’il doit satisfaire pour être payé. Aucune initiative dans son ouvrage : de tous côtés, il obéit. Et, sa besogne faite, il est si fatigué qu’il ne lui reste plus la force ni l’envie de se consacrer à la vie publique. Animal laborans, il ne vaut guère mieux qu’une bête de somme. Ainsi en va-t-il dans ce siècle où s’épanouit la démocratie athénienne.
Il fut pourtant un autre temps, rappelle Jean-Pierre Vernant, où l’artisan était nimbé de l’auréole du sacré3. En ce temps-là, trois siècles plus tôt, la Grèce n’avait pas encore inventé la démocratie. Avides de marquer leur supériorité sociale, les nobles qui l’habitaient étaient prêts à dépenser des fortunes pour acquérir les objets les plus beaux, les plus précieux, les plus extraordinaires. Les démiurges – ainsi nommait-on alors ces contemporains d’Homère – itinérants, sillonnaient la Grèce pour vendre très cher leur science et leur audace, se livrant entre eux une lutte sans merci par le truchement de leurs confréries. Loin d’être méprisée, la technique, parée de mystère, valait à ceux qui en détenaient les secrets le prestige de véritables héros. L’avènement de la démocratie avec ses corollaires, l’égalité civique et le refus du luxe ostentatoire, devait être fatal aux démiurges. Réduits à fabriquer des objets purement utilitaires, ils devinrent artisans, banausoi, simples exécutants voués à la routine.
Pour le malheur des « travailleurs manuels », c’est de ces derniers que se souviendra l’histoire, et sur leur triste image que se bâtiront pour des siècles nos représentations. Ancrées dans notre imaginaire depuis le IVe siècle avant Jésus-Christ, ces représentations forgées par Platon nous sont devenues naturelles. Aussi oublions-nous qu’ailleurs, loin, bien loin de la Grèce, d’autres civilisations firent des choix différents. En Chine, rappelle le philosophe François Jullien4, aucun monde « idéal » ne vient s’interposer entre l’homme et la réalité offerte à ses sens. Au culte du savoir, les Chinois ont préféré celui de la « saveur », cette douce immersion dans le monde sensible d’où procède la joie.
Une tentative de rachat : les Lumières
De viles personnes déshonnêtes et sordides
En ce début de XVIIe siècle français, un dénommé Loyseau, juriste de son état, s’attelle à une hiérarchisation minutieuse des diverses catégories de la société5. Ou plus exactement, de ce « tiers état » disparate au sein duquel il distingue avec soin les « gens de lettres » des quatre facultés (théologie, droit, médecine, arts), les financiers, tous ceux qui font métier du droit, et enfin l’ensemble des marchands. Quant aux autres classes de la société française, il est même inutile d’en parler, tant l’évidence s’impose : tout au sommet trône la noblesse d’épée, qui jouit depuis des siècles de l’écrasante supériorité conférée par la naissance et le sang. Et tout en bas, ces « viles personnes » « déshonnêtes et sordides » qui travaillent de leurs mains, exerçant les arts mécaniques.
« Nous appelons communément mécanique ce qui est vil et abject », précise le sieur Loyseau, qui tient à cette mise au point pour faire face aux prétentions de certains d’accéder au rang de « bourgeois » et de siéger ainsi au sein du tiers état. Leur requête, dit-il, ne saurait être recevable que si à leur métier s’ajoute la pratique du commerce, quant à elle honorable. Pour les autres, qui se cantonnent à travailler de leurs mains, il ne saurait en être question. « Les simples métiers… gisent plus en la peine de corps qu’au trafic de la marchandise ni en la subtilité de l’esprit, et ceux-là sont les plus vils, comme dit Cicéron aux Offices.» L’argument est jeté, imparable : Cicéron lui-même l’a dit ! Vingt siècles après Platon, les malheureux artisans n’ont pas progressé d’un iota, se voyant reprocher l’usage de leur corps au détriment de celui de l’esprit.
L’Encyclopédie réhabilite les arts mécaniques
Une révolution
Un siècle et demi plus tard, un écrivain et un mathématicien, Diderot et d’Alembert, l’un et l’autre philosophes, se lancent dans une entreprise qui changera le cours de l’Histoire : L’Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des arts, des sciences et des métiers. Son objectif est double : comme encyclopédie, « exposer autant qu’il est possible l’ordre et l’enchaînement des connaissances humaines » ; comme dictionnaire, « contenir sur chaque science et chaque art, soit libéral, soit mécanique, des principes généraux qui en sont la base, et les détails les plus essentiels qui en font le corps et la substance. »6
« Soit libéral, soit mécanique » : le pavé est lancé. Les vils métiers, pratiqués par les personnes déshonnêtes et sordides, se voient rangés par les deux philosophes sur le même pied que les professions de l’esprit, et les uns comme les autres seront exposés en un même livre selon un simple classement alphabétique. Quelle mouche pique donc d’Alembert et Diderot, pour chambouler ainsi une hiérarchie vieille de vingt et un siècles ?
Une injustice aussi vieille que l’humanité
Ils s’en expliquent dès leur discours préliminaire : il s’agit de réparer une injustice, à savoir « cette supériorité qu’on accorde aux premiers [les arts libéraux] sur les seconds [les arts mécaniques]. » Pour raconter l’histoire de l’humanité, Platon avait emprunté le mythe de Prométhée à la mythologie, pour le remanier à sa convenance. D’Alembert n’emprunte à personne : comme s’il y avait lui-même assisté, il nous relate benoîtement cette histoire depuis ses débuts.
Tout s’explique, nous dit-il, par l’existence d’inégalités entre les hommes. La plus évidente d’entre elles est la supériorité physique dont jouissent quelques-uns, qui leur permet de contraindre les autres par la force. C’est donc celle-ci qui s’exerça en premier, au grand dam des plus faibles. Pour se défendre, ces derniers se sont réunis, palliant par le nombre leur infériorité, et ont créé les lois, qui excluaient l’usage de la force. Mais l’homme est ainsi fait qu’un éternel désir de supériorité l’anime. Le critère de la force physique étant éliminé, les humains en trouvèrent un autre, bien plus pacifique : l’esprit. De ce jour, les qualités de l’esprit furent considérées comme supérieures à celles du corps – avec pour conséquence un mépris unanime pour les métiers manuels. Dès lors, il ne fut plus question d’exercer ces derniers par génie ou par goût – on ne s’y résolut désormais que par nécessité.
Il n’en demeure pas moins vrai, ajoute d’Alembert, que les arts mécaniques sont pour nos sociétés d’une bien plus grande utilité que les arts libéraux. Il importait donc que le plus grand nombre, avec ou sans talent, pût les exercer proprement. Aussi réduisit-on ces arts mécaniques en opérations purement machinales, afin de les rendre accessibles à tous. Ce qui n’empêche que, dans ce domaine comme dans celui de l’esprit, de grands inventeurs, par leurs découvertes, ont permis à l’humanité d’accomplir d’immenses progrès. Mais le mépris dont on accable les arts mécaniques les a condamnés à l’anonymat.
Des arts qui échappent au discours
Pour réparer cette injustice et donner à connaître aux hommes toutes les subtilités de ces « arts mécaniques » auxquels ils doivent tant, Diderot et d’Alembert se sont fixé pour tâche d’en livrer une description exhaustive. C’est ainsi que, devançant nos grands reporters, Diderot s’en fut visiter systématiquement les ateliers des artisans les « plus habiles de Paris et du royaume »7. Ce dont il s’aperçut alors éclaire d’une façon nouvelle la relégation dont sont victimes les métiers de la main. Comme il tentait d’interroger les artisans sur les arcanes de leur art, il se heurta à un obstacle dont il n’avait jusqu’alors nulle idée : l’impuissance du discours et des mots pour rendre compte du fonctionnement des machines et du détail des opérations. À cela, deux raisons. La première tient aux artisans eux-mêmes, dont l’habileté et la connaissance relèvent souvent de l’instinct, et qu’ils se révèlent incapables de verbaliser : « À peine entre mille en trouve-t-on une douzaine en état de s’exprimer avec quelque clarté sur les instruments qu’ils emploient et sur les ouvrages qu’ils fabriquent. »8
Mais il en est une autre, qui ne tient nullement aux individus : Il est des métiers si singuliers et des manœuvres si déliées, qu’à moins de travailler soi-même, de mouvoir une machine de ses propres mains, et de voir l’ouvrage se former sous ses propres yeux, il est difficile d’en parler avec précision. »9
Si difficile que Diderot dut bien souvent se faire lui-même apprenti pour mener à bien son projet. Mieux, renonçant parfois à faire usage des mots, il dut favoriser un autre moyen de décrire ce qu’il découvrait : l’image, et les schémas.
Ce recours à l’image qui caractérise l’Encyclopédie, le philosophe des techniques Gilbert Simondon l’érige en caractéristique de la technique : « le symbolisme adéquat à l’opération technique est le symbolisme visuel, avec son riche jeu de formes et de proportions. »10 Un symbolisme ô combien étranger à notre civilisation imprégnée de platonisme, pour laquelle le discours est supérieur à tout… Le sociologue Richard Sennett y voit d’ailleurs matière à s’interroger sur la prétendue universalité du langage humain : « C’est là une, peut-être la limite humaine fondamentale : le langage n’est pas un “outil spéculaire” adéquat pour les mouvements physiques du corps humain. »11
Avec l’Encyclopédie, les métiers de la main sortent de l’ombre pour se livrer sans secret aux regards de l’humanité. L’entreprise de Diderot et d’Alembert était-elle à même de réhabiliter les « arts mécaniques » ? Elle l’eût peut-être été si, au même moment, la révolution industrielle n’était venue substituer aux ateliers des maîtres et des compagnons la manufacture, ses machines et sa masse d’ouvriers sans qualification. Avec la grande industrie et la mécanisation, la figure de l’artisan va peu à peu céder la place à celle de l’ouvrier prolétaire. Et la Révolution française, avec la loi Le Chapelier de 1791 qui abolit les corporations, n’aura fait que précipiter le mouvement.
- 1. Platon, République , livre VII, 515a-515b.
- 2. Platon, Protagoras , 320-321.
- 3. Jean-Pierre Vernant, Mythe et pensée chez les Grecs. Études de psychologie historique , François Maspéro, 1965 ; La Découverte/Poche, 1996, p. 318.
- 4. François Jullien, L’Invention de l’idéal et le destin de l’Europe , Gallimard, 2017.
- 5. Régine Pernoud, Histoire de la bourgeoisie en France , Seuil, 1962 ; « Points » Seuil 1981, p. 62-63.
- 6. Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers , GF Flammarion, 1986. Discours préliminaire, p. 76.
- 7. Ibid . p. 177.
- 8. Ibid .
- 9. Ibid ., p. 178.
- 10. Gilbert Simondon, Du mode d’existence des objets techniques , Aubier, 1958 ; 2012, p. 139.
- 11. Richard Sennett, op.cit ., p 133.
L’intelligence manuelle : réalité, euphémisme ou mystification ?
Le travailleur manuel pense-t-il ?
La question, posée en ces termes, peut sembler abrupte. C’est pourtant bien de cela qu’il s’agit, dès lors que le mot « manuel », dans nos représentations, s’oppose au mot « intellectuel », et les métiers de la main à ceux de l’esprit.
Non !
La réponse fut longtemps « non », sans qu’on jugeât nécessaire de s’y appesantir. Les Grecs, là encore, ont une lourde part de responsabilité.
Le travail manuel est par essence routinier
Le travailleur manuel n’a nul besoin de réfléchir car il n’invente ni ne décide rien. Soit le « modèle » idéal de chaise (eidos) : il préexiste, de toute éternité, déterminé par l’usage de l’objet et le besoin (chrêsis) auquel il répond – s’asseoir. L’artisan ne l’a pas inventé. De ses prédécesseurs, il a hérité une technique, « technê », ensemble de règles et de savoir-faire qu’il lui suffit d’appliquer pour transformer le bois. Déterminés par la nature, ni les besoins de l’homme ni la matière ne changent : un homme reste un homme avec sa façon immuable de s’asseoir, le bois reste du bois. Nulle initiative n’est requise de la part de l’artisan, et l’art du menuisier ne saurait progresser1.
Le travail manuel est purement empirique
Si l’artisan possède certes une technique, celle-ci ne repose sur aucune connaissance théorique de la matière. Il se contente d’appliquer bêtement un ensemble de règles traditionnelles auxquelles il ne comprend rien. Pour réussir à coup sûr, il a seulement besoin d’un coup d’œil, d’un flair, d’un instinct, qui lui permet d’agir au bon moment (kairos). Ce kairos, seul l’usage de ses sens – vue, odorat, ouïe… – lui permet de l’identifier : faute de connaissance théorique, il est incapable de l’anticiper. C’est pourquoi il lui faut rester rivé à sa tâche, comme un esclave.
Gilbert Simondon nuancera cet argument en distinguant deux rapports à la technique : celui de l’apprenti, initié dès l’enfance à un métier, dont il acquiert les bases par imitation et répétition ; celui du technicien ou de l’ingénieur, adulte quant à lui, qui considère l’objet de façon réfléchie en mobilisant pour l’appréhender toutes les connaissances rationnelles que la science a mises à sa disposition. Au rapport enfantin, « mineur » de l’artisan à l’objet s’oppose donc selon lui le rapport adulte, « majeur » du technicien ou de l’ingénieur2.
Le travail manuel rend inapte à la pensée
En épuisant le corps, il prive le travailleur de la force et du désir de raisonner, d’argumenter. Sa journée achevée, il n’a plus qu’un besoin, une envie : se reposer3. Après son têteà-tête avec la matière, il s’en va aussitôt au lit, d’où une existence confinée, sans sociabilité ni intérêt pour la chose publique.
Ces trois arguments, qui peuvent certes se discuter pour ce qui concerne l’artisanat, retrouvent une nouvelle vigueur avec la taylorisation, dont le principe même est de décomposer l’acte de production en tâches fragmentaires et répétitives. Selon Taylor, « toute forme de travail cérébral devrait être éliminée de l’atelier et recentrée au sein du département conception et planification »4.
Oui !
La triade main-œil-cerveau
Ces dernières années, nous avons déjà mentionné ce phénomène, les plaidoyers en faveur de l’artisanat et du travail de la main fleurissent. On trouve en particulier chez Matthew Crawford et Richard Sennett des analyses subtiles de ce qu’il est convenu d’appeler « intelligence de la main. »
D’abord, une évidence : la connaissance, récente à l’échelle de l’histoire, du fonctionnement du cerveau a mis à mal bien des prétendues certitudes. À commencer par celle du dualisme « corps-esprit » théorisé par Descartes. Non, le corps n’est pas une « machine » dotée d’une « âme » : unité centrale de l’animal, le cerveau reçoit les perceptions de nos sens, les interprète, et en retour transmet des ordres aux membres – par exemple, la main – via le circuit nerveux. Tout geste de la main est dicté par le cerveau. Richard Sennett définit ainsi la « main intelligente » comme une « triade » : « coordination de la main, de l’œil et du cerveau »5.
Le travail manuel repose sur des facultés intellectuelles
Nombre des facultés nécessaires à l’artisan pour faire du bon travail relèvent de l’intellect.
La connaissance des «façons d’être» du matériau utilisé est tout d’abord indispensable. Il existe, par exemple, une multitude de bois, avec des propriétés différentes, que le menuisier se doit de connaître s’il veut pouvoir travailler sa matière. Dans une scène magnifique du film Le Fils, les frères Dardenne montrent le maître menuisier (Olivier Gourmet) testant le savoir de son apprenti dans un immense hangar rempli de planches : à l’œil et au toucher, le jeune homme doit reconnaître les différentes essences. Avec application, il consulte son catalogue, observe, touche, hésite, puis répond. Mais ce n’est là évidemment qu’un premier pas : la pratique seule lui apprendra comment « agir » face à chaque type de bois, quels outils privilégier, à quels usages le destiner.
Cette connaissance va donc de pair avec une mémorisation. Mémorisation non seulement de propriétés, mais aussi de situations dans lesquelles l’artisan, confronté à sa matière, a hésité, été surpris, a obtenu un résultat différent de celui qu’il recherchait – s’est trompé ou a surmonté l’obstacle. Il se constitue, dit Crawford, une « bibliothèque mentale6 » qui lui est nécessaire pour accomplir son travail.
Cette mémorisation est ce qui lui permet d’identifier des récurrences entre diverses situations, divers objets : telle cause produit tel effet ; tel phénomène est toujours l’indice de tel autre ; tel détail sur le bois, l’indice d’une fragilité, tel bruit dans un moteur, le signe que les pistons sont défectueux… On peut ici parler de théorisation, avec la faculté de rattacher le particulier au général, et de raisonnement, avec la mise en œuvre d’une causalité. D’attention, aussi : de l’acuité avec laquelle est observé l’objet dépend la justesse du diagnostic – qu’il s’agisse de réparer l’objet ou de prendre une décision à la suite d’une difficulté rencontrée dans son exécution.
L’empathie n’est pas moins nécessaire, cette faculté de sortir de soi pour se projeter dans l’autre, devenir l’autre – en l’occurrence, ce matériau étranger. Fruit de la connaissance et d’une longue expérience, elle permet à l’artisan de « devenir la chose à laquelle il travaille », d’anticiper, voire de deviner ses réactions – ce que le philosophe Merleau-Ponty nomme « l’être de chose7 ». De cette empathie procède l’imagination, qui permet d’inventer des formes, des moyens, adaptés à la singularité de l’événement rencontré.
C’est pourquoi, sans doute, les Grecs de l’époque homérique usaient du mot « sophia » pour définir de façon générale toute forme de talent, d’aptitude et de compé-tence, qu’il (elle) fût manuel(le) ou intellectuel(le)8. La spécialisation de ce mot pour définir une sagesse purement abstraite ne vint que plus tard, lorsqu’à l’âge classique s’imposa le culte de la Raison qui donna la « philosophie ».
Le travail intellectuel repose sur des pratiques physiques
Achevant de brouiller barrières et catégories, Richard Sennett rappelle dans son livre que « toutes les compétences, même les plus abstraites, sont au départ des pratiques physiques »9. En témoigne le vocabulaire désignant les opérations abstraites. Qu’il s’agisse de comprendre, com-prehendere (prendre ensemble), apprendre, ad-prehendere (prendre vers soi), synthétiser, syn-theînai (mettre ensemble), intelligence, inter-legere (cueillir une chose entre d’autres) : tous ces mots désignent un geste simple de la main, précédé d’une préposition indiquant le mouvement de celle-ci. Sans entrer dans des considérations étymologiques, des mots comme saisir (un objet/le sens de quelque chose), construire (une maison/une argumentation), réfléchir, sont couramment employés dans un sens concret ou abstrait. L’« abstraction » même ne consiste-t-elle pas à séparer, détacher, éloigner une chose d’une autre, abtrahere ?
Au commencement était le geste de la main, nous disent les racines des mots de l’intellect. « Apprendre » est prendre vers soi, s’approprier quelque chose d’extérieur à soi – qu’il s’agisse des propriétés du métal ou de celles des nombres premiers. Et l’on peut être habile couturier comme habile orateur ou médecin… La main et la pensée ont ontologiquement partie liée.
Ainsi peut-on comprendre que l’anthropologue André Leroi-Gourhan s’inquiète de l’avenir de la pensée humaine dans un monde où l’usage de la main est appelé à s’effacer, la machine et l’ordinateur venant s’interposer entre l’humain et la matière : « Ne pas avoir à penser avec ses dix doigts équivaut à manquer d’une partie de sa pensée normalement, philogénétiquement humaine »10, écrivait-il il y a déjà plus d’un demi-siècle.
Y a-t-il deux types d’intelligence : « manuelle » et « intellectuelle » ?
Admettons donc que l’exercice de la pensée ne soit pas réservé aux seules professions de l’esprit. Est-ce à dire que l’intelligence est une, qu’un mathématicien et un menuisier entretiennent le même type de rapport au monde, qu’ils partagent la même façon d’apprendre, de comprendre, d’inventer ? Tel qui excelle dans la menuiserie aurait-il pu s’illustrer aussi bien dans la géométrie analytique ? Tel virtuose du discours aurait-il pu déployer une même habileté dans la construction de maisons ? Curieusement, si chacun trouve aujourd’hui naturel d’édifier un cloisonnement entre esprits « scientifiques » et « littéraires », la distinction entre « intellectuels » et « manuels » déchaîne les passions et fait polémique. Essayons de comprendre pourquoi.
« C’est un manuel », « c’est un intellectuel » : qu’entend-on par-là ?
Un verdict scolaire bien commode
Le territoire privilégié de cette polémique est l’école, ou plutôt le collège, à qui revient la lourde responsabilité d’orienter les élèves. À l’issue de la Troisième, les portes s’ouvrent, diverses : seconde « générale » menant aux carrières scientifiques, littéraires, aux sciences humaines ; seconde technologique ; seconde professionnelle – voire, apprentissage. Que les résultats en mathématiques, en français ou en langues s’avèrent satisfaisants, l’élève sera tout naturellement dirigé vers le lycée d’enseignement général. Qu’ils soient mauvais, et le verdict tombera : cet élève n’est pas fait pour les études, pour l’école – ce qui, au vu de ses résultats, relève plutôt du bon sens. Moins évident semble ce diagnostic qui s’y ajoute presque inévitablement : c’est un « manuel »11. Pour les enseignants du collège, l’équivalence logique entre « pas fait pour les études » et « manuel » va fréquemment de soi.
Le plus souvent, elle relève de l’euphémisme, « manuel » se substituant poliment à « bon à rien ». Nul n’est dupe : aucun des enseignants n’ayant eu l’heur de tester les « aptitudes manuelles » de l’élève, on ne voit guère sur quoi se fonde ce jugement. Mais cette étiquette bien commode a le mérite de libérer l’enseignement général d’un cancre qui a amplement démontré son incapacité (ou son refus) de suivre les cours de français, de maths, de physique et d’anglais qui lui étaient dispensés.
Des capacités intellectuelles absentes… ou conditionnelles
Sociologue et spécialiste des sciences de l’éducation, de surcroît inspecteur général de l’Éducation nationale, Aziz Jellab consacre ses recherches à l’enseignement professionnel. Dans son ouvrage cité supra en référence, il s’efforce de cerner ce que recouvre le terme « manuel » tel que l’emploient non les professeurs de collège, un peu expéditifs, mais les enseignants de lycées professionnels (LP), familiers d’un public de jeunes présumés « manuels ». L’emploi de cet adjectif, note-t-il, alterne avec celui du mot « concret », qui fait manifestement figure de synonyme. Deux catégories distinctes d’élèves, dit-il, sont couramment désignées par cette double terminologie.
Les premiers sont ceux qui « ne disposent pas des outils intellectuels leur permettant d’engager un travail réflexif ou méta-concret ». Une définition, donc, par la négative : le « manuel » est celui à qui manquent un certain nombre d’outils intellectuels.
Les seconds « ont des capacités intellectuelles qui ne peuvent être activées qu’au prix d’une centration préalable et plus ou moins durable sur des savoirs parlants. » Entendez : pour accéder à l’abstraction, certains élèves ont besoin que les savoirs enseignés s’appuient sur un contenu concret – le travail en atelier, ou des exemples empruntés à la vie quotidienne.
En d’autres termes, les élèves dits « manuels » ou « concrets » éprouvent des difficultés avec la réflexion abstraite, la conceptualisation. Les uns en sont incapables (parce qu’on ne leur a pas donné les outils intellectuels ? parce qu’ils manquent des dispositions nécessaires pour les acquérir ?) ; les autres ont besoin de partir du concret pour parvenir au concept. Ce qui est tout à fait différent.
Reste à savoir si ces aptitudes ou inaptitudes relèvent de la nature ou de la culture… Fort pragmatiquement, Azib Jellab s’abstient de poser la question : seul lui importe de conduire vers la réussite et l’épanouissement les jeunes de 16 ou 17 ans dont hérite le LP. Mais tel n’est pas le cas des chercheurs en sciences humaines qui se penchent sur la question.
Manuel vs intellectuel ? Une mystification !
En 1985, le philosophe Bernard Charlot, formateur de professeurs de technologie en collège, et la sociologue Madeleine Figeat publient une monumentale Histoire de la formation des ouvriers de 1789 à 1984. Si la richesse des sources en fait un outil exceptionnel, les auteurs ne font pas mystère de l’objectif qu’ils poursuivaient en se lançant dans cette entreprise : démontrer que le système capitaliste n’a eu de cesse de priver d’instruction une partie de la population afin de se ménager une main d’œuvre abondante et bon marché.
Parmi les manœuvres qu’ils dénoncent, il en est une qui déchaîne tout particulièrement leurs foudres : l’argument récurrent selon lequel certains esprits seraient « concrets » et donc par nature inaptes à l’abstraction. Une authentique mystification, selon eux, qui traduit simplement le désir égoïste des patrons de cantonner à un apprentissage bien concret leurs futurs ouvriers, afin de pouvoir les mettre au plus vite sur des machines en étant assurés de leur immédiate efficacité. Le rêve du patron : former très tôt le jeune à quelques gestes simples, ceux dont il a besoin pour faire son travail, et arguer de cette formation sommaire pour le payer à faible coût. Prétendre que certaines intelligences sont purement concrètes n’est qu’un stratagème cousu de fil blanc, qui permet de retirer vite le jeune de l’école en alléguant son manque de goût pour les études, et de limiter au strict minimum la formation qui lui sera ensuite octroyée. « Puisqu’on enseigne à des intelligences concrètes, ironisent les deux auteurs, il faudra, bien sûr, s’en tenir au concret. »
Il ne faut pas chercher ailleurs, selon eux, la raison pour laquelle, de façon récurrente tout au long du XXe siècle, la direction de l’Enseignement technique a plaidé pour conserver son autonomie : ayant partie liée avec le patronat, elle tenait à garder les mains libres pour organiser à sa guise la formation. Le grand danger qu’elle redoutait : celui de voir l’Éducation nationale mettre son nez dans ses affaires, elle qui se piquait d’augmenter le niveau d’instruction de la classe ouvrière. L’Éducation nationale souhaitait en effet adjoindre aux enseignements purement techniques des enseignements généraux, afin de faire de tous les écoliers de futurs citoyens éclairés. Mieux, elle suggérait régulièrement de reculer le moment de l’orientation, afin de donner à tous les enfants une chance d’accéder à la voie dite « générale ».
Les instructions pédagogiques de 1938 parlent de « goût des études concrètes, de manipulation, de fabrication, de travaux pratiques, de culture adaptée à leur tour d’esprit » : Bernard Charlot et Madeleine Figeat dénoncent là un « dérapage idéologique ». Les heurte tout particulièrement la notion de « tour d’esprit », ou celle de « caractéristiques naturelles », justifiant selon eux une « pédagogie discriminante et discriminatoire, qui tend à justifier idéologiquement l’enfermement de certains élèves dans des ghettos préprofessionnels ou professionnels »12.
On reconnaît ici un écho de la pensée bourdieusienne, par ailleurs brillamment illustrée par Claude Grignon dans son essai sur les Collèges d’Enseignement Technique (CET) mentionné plus haut. Selon les sociologues de cette école, l’enseignement français ayant pour seule fin de reproduire les inégalités sociales, la voie professionnelle n’est pas conçue pour des intelligences manuelles, mais pour cantonner les fils d’ouvriers dans des tâches d’ouvriers.
Si leur rhétorique est cohérente, les preuves issues de l’expérience pédagogique en sont singulièrement absentes.
Manuel vs intellectuel : une évidence à prendre en compte
La voie professionnelle, celle dite du travail manuel, ne serait donc pour les disciples de Bourdieu qu’une voie par défaut, un Enfer pour les damnés de la sélection scolaire : « Vous qui entrez ici, quittez toute espérance. » Curieusement, pourtant, certains n’aspirent qu’à s’y diriger.
Une vocation, pourquoi pas ?
Un livre récemment paru, J’ai un métier !13, rapporte les témoignages de dix jeunes d’aujourd’hui qui ont choisi, délibérément, de s’orienter vers la voie professionnelle, et se préparent aux Olympiades des métiers. L’un, depuis l’âge de six ans, voulait faire de la pâtisserie ; l’autre, par goût et par passion, passait tous ses samedis après-midi dans le salon de coiffure de sa tante depuis la classe de sixième ; un autre encore, bravant ses professeurs, s’est inscrit chez les Compagnons du Devoir pour devenir tourneur-fraiseur malgré son quinze de moyenne générale en Troisième.
« J’aimais vraiment… Comment dire ça ? J’aimais réparer les choses, dit Florent le mécanicien. La logique de la réparation. Quand quelque chose était cassé chez moi, il fallait que je le démonte. »14 Cette passion de la réparation fait écho à celle d’Olivier Beurton, ancien élève d’HEC, aujourd’hui plombier après une quinzaine d’années de direction marketing15, ou encore celle de Matthew Crawford, diplômé de philosophie devenu réparateur de motos.
« Gamin, je me demandais : comment on fait une vis ? raconte Jean-Baptiste, fraiseurtourneur. Une vis, on la regarde, c’est joli, il y en a des millions et des millions, mais comment on peut fabriquer un truc comme ça ? Savoir comment on fabrique une vis, c’est peut-être une passion bizarre, mais ça me fascinait. » 16
« Aimer », « Fasciner », « Passion… » On peut être « manuel » par vocation.
Intelligent signifie-t-il intellectuel ?
En 1883, l’ouvrier compagnon charpentier Castel s’exprime ainsi devant la Commission extra-parlementaire des associations coopératives : « Nous avons résolu, comme coupe de charpente, tout ce que l’imagination peut rêver de plus extraordinaire […]. Nous avons des ouvriers qui ne connaissent pas un mot d’algèbre ni de quoi que ce soit et qui sont plus forts en descriptive – une descriptive impossible, fantastique – que tous les ingénieurs du monde. Les courbes d’un navire, c’est de la plaisanterie ; chez nous on fait tout ce qu’on veut, et ce qu’il y a de plus joli, sans savoir comment. »17 Point n’est besoin de connaissance théorique pour exceller dans un métier manuel, affirme cet artisan, corroborant sur ce point l’analyse de Platon. Olivier, le plombier HEC, s’inscrit en faux, qui se félicite chaque jour de connaître la trigonométrie pour couder ses tuyaux. Quoi qu’il en soit, tous deux démentent Platon en célébrant l’inventivité et l’imagination nécessaires face aux défis que lance la matière au travailleur manuel. Ils sont intelligents – chacun à sa façon.
Concret vs abstrait ? Ou utile vs gratuit ?
C’est la raison qu’invoquent en premier lieu les partisans d’une orientation précoce vers la voie professionnelle : certains enfants s’ennuient à mourir sur les bancs de l’école. « L’enfant, rebuté par une certaine forme d’abstraction, végète en classe et répète : J’en ai assez, je veux travailler »18, argue en 1939 la direction de l’Enseignement technique. Sans être suspectée d’être vendue au patronat, la psychanalyste Françoise Dolto fait écho : « Que peuvent faire de leurs énergies en jachère des garçons et des filles jusqu’à seize ans obligés par la loi à une scolarité pour eux sans intérêt, en marge des échanges qui les valoriseraient ? Comment s’intégrer à une société qui leur fait le reproche ouvertement de n’avoir pas aimé les bancs de l’école, les connaissances livresques, les palabres impersonnelles de leurs maîtres, la discipline passive et les jeux sans risques ? »19
Aziz Jellab en a vu défiler, des élèves de LP. Des bancs de la salle de classe où ils suivent leurs cours de maths, d’histoire, de français, à l’atelier où ils apprennent les gestes du métier, il a pu observer leurs réactions. Et, oui, il le confirme : certains élèves sont rebutés par l’enseignement général. Non tant pour son abstraction que pour son apparente inutilité. Leur leitmotiv : « À quoi ça sert ? » Pour qu’un savoir les intéresse, il ne doit pas leur apparaître comme gratuit. « Je n’ai jamais aimé les maths à l’école mais maintenant que je vois concrètement à quoi cela peut me servir dans mon métier, c’est plus facile », confirme Margaux, apprentie chaudronnière20. Déconnectées de toute finalité pratique, les connaissances qu’on leur fait ingurgiter au collège leur semblent absolument vaines. Entre leur univers, leurs préoccupations et ces enseignements, l’intersection est nulle. Leur attente, leur impatience ? Pouvoir, enfin, « agir sur le monde »21. Par la maîtrise d’un métier, en premier lieu. C’est en cela qu’ils sont « concrets ».
Ils n’en sont pas pour autant moins « intelligents ». Aziz Jellab témoigne au contraire de leur exigence, de leur goût de la difficulté22, que leurs professeurs se doivent de satisfaire sous peine de passer pour démagogues ou méprisants. Mieux : nombre de ces élèves sont susceptibles de prendre plaisir à des disciplines relevant des champs culturels et symboliques23. Mais à une condition : ces enseignements doivent faire la preuve qu’ils leur seront de quelque utilité dans leur vie quotidienne. Qu’ils s’en trouveront mieux armés.
Une question de rapport au monde
Plus qu’une affaire d’intelligence, la distinction entre manuel et intellectuel semble être une question de rapport au monde. Certains ont un besoin profond de se frotter à la rugueuse réalité – en la touchant, en s’y heurtant, en la domptant. D’autres se sentent plus à leur aise en ne l’approchant que par le truchement des symboles.
L’ouvrier charpentier Castel en avait déjà l’intuition, en 1883, qui délivrait quelques conseils sur l’enseignement de la géométrie descriptive : « C’est très curieux, il ne faut pas dire, par exemple : en élevant cette perpendiculaire, en tirant cette oblique, etc.
On dit : Tiens, tu vois ça, et puis ça : en mettant un morceau de bois comme ça et traçant ça comme ça, ça fait deux coupes ou ça fait un arêtier, ou un arbalétier.»24
Aux uns la perpendiculaire, aux autres l’arbalétrier. Aux uns le monde de la Caverne, aux autres celui des Idées. Et Platon, encore et toujours.
- 1. Pour toute cette argumentation, voir Jean-Pierre Vernant, op.cit. , p. 288 sqq.
- 2. Gilbert Simondon, Du mode d’existence… , op. cit. p. 124.
- 3. Nicolas Grimaldi, op.cit ., p. 55 sqq.
- 4. Frederick W. Taylor, Shop Management , Harper and Brothers, 1912, p. 98-99. Cité par Matthew Crawford, op.cit. p. 49.
- 5. Richard Sennett, op. cit. , p. 237.
- 6. Matthew Crawford, op. cit. , p. 33.
- 7. Maurice Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception , Gallimard, 1945 ; rééd. « Tel », 1990, p. 173.
- 8. Matthew Crawford, op. cit. , p. 29.
- 9. Op. cit. , p. 21.
- 10. André Leroi-Gourhan, Le Geste et la parole. II La mémoire et les rythmes , Albin Michel, 1964, p. 62.
- 11. Aziz Jellab, L’Émancipation scolaire. Pour un lycée professionnel de la réussite , Presses universitaires du Mirail, 2014, p. 88.
- 12. Bernard Charlot et Madeleine Figeat, Histoire de la formation des ouvriers. 1789-1984 , Minerve, 1985, p. 285.
- 13. Julien Millanvoye, J’ai un métier ! Globe, L’école des loisirs, 2013.
- 14. Ibid . p 67.
- 15. Laurence Decréau, op. cit.
- 16. Jullien Millanvoye, op. cit. , p. 70.
- 17. Bernard Charlot et Madeleine Figeat, op.cit. , p. 137.
- 18. Revue L’Enseignement technique , n°10, 1939.
- 19. Françoise Dolto, préface au Premier rendez-vous avec un psychanalyste , de Maud Mannoni, Denoël/Gonthier, 1965.
- 20. Osez la voie pro , La Fabrique de l’Industrie, Presses des Mines, 2015, p. 85.
- 21. Aziz Jellab, op. cit. , p. 92.
- 22. Ibid. , p. 136.
- 23. Ibid. , p. 170.
- 24. Bernard Charlot et Madeleine Figeat, op. cit. , p. 136.
La revalorisation du travail manuel : mesure salutaire ou imposture ?
En janvier 1976, le Président de la République Valéry Giscard d’Estaing charge Lionel Stoléru de s’atteler à un chantier que son gouvernement juge prioritaire : la revalorisation du travail manuel en France. Le nouveau Secrétaire d’État à la Condition des travailleurs manuels ne ménage pas sa peine : à la télévision, à la radio, sur les panneaux publicitaires, une large campagne de communication se déploie. Son slogan : « Maintenant, la priorité est aux travailleurs manuels ! » On y voit, par exemple, un architecte tout fier montrer à son petit garçon la maison qu’a construite son papa. C’est toi qui as fait les murs ? demande l’enfant – Non, ce sont les maçons. Et le toit ? – Non, ce sont les charpentiers. Tu étais en blanc comme ces messieurs ? – Non, ce sont les plâtriers. Alors, qu’est-ce que tu as fait, toi, papa ? Mine gênée du père – et voix off : « L’homme, des mains, un cerveau. Maintenant priorité au travail manuel. »1 Il était temps, se dit-on – oubliant un peu vite que cette entreprise n’a rien d’un coup d’essai.
Rien de nouveau sous le soleil
Le thème fait presque figure de marronnier. Jean Zay déjà, sous le Front populaire, puis le gouvernement de Vichy, enfin le plan Langevin-Wallon juste après la Libération, l’ont décliné, chacun à sa façon.
« L’organisation actuelle de notre enseignement entretient dans notre société le préjugé antique d’une hiérarchie entre les tâches et les travailleurs, lit-on dans l’introduction du Plan Langevin-Wallon (1947).
Le travail manuel, l’intelligence pratique sont encore trop souvent considérés comme de médiocre valeur. L’équité exige la reconnaissance de l’égale dignité de toutes les tâches sociales, de la haute valeur matérielle et morale des activités manuelles, de l’intelligence pratique, de la valeur technique. Ce reclassement des valeurs réelles est indispensable dans une société démocratique moderne dont le progrès et la vie même sont subordonnés à l’exacte utilisation des compétences. » 2
L’argument clé, qui n’est pas sans rappeler les Encyclopédistes : l’injuste mépris dont sont victimes les travailleurs manuels. Vichy s’indigne à juste titre : « L’importance de l’effort intellectuel exigé dans les métiers manuels a été méconnue en France et pèse actuellement sur les travaux manuels »3. Et de préciser : « Celui-ci [le travail manuel] développe harmonieusement les qualités physiques et intellectuelles. C’est une école d’ordre, de précision, de volonté, de discipline. » Il est vrai que les qualités brandies par Vichy – ordre, discipline – sentent aujourd’hui le soufre. Mais le plan LangevinWallon, dont l’idéologie n’a certes rien de suspect, conçoit quant à lui les travaux manuels qu’il compte développer dans ses classes nouvelles « à la fois comme discipline d’éducation et comme moyen d’observation continue des aptitudes de l’enfant dans les différents domaines proposés à son activité. »4
Si cette injustice est en soi condamnable, ses conséquences, note Vichy, sont encore plus dommageables : « Ce fossé qui se crée actuellement à l’âge de 11 ans entre primaires et secondaires – opposant irrémédiablement l’habileté manuelle à l’intelligence spéculative – est aujourd’hui générateur d’oppositions sociales que les différences de méthodes éducatives ne font qu’accentuer. »5 Pas de société harmonieuse sans destruction des barrières entre « intellectuels » et « manuels », classes dominantes et classes dominées, bourgeois et prolétaires. Aussi Vichy projette-t-il de rendre obligatoires pour tous, à tous les âges, y compris au lycée, l’éducation manuelle. Cette obligation, « qui permettra aux jeunes de se rendre compte du véritable caractère de ces travaux, constituera l’un des moyens de lutte contre un état d’esprit dont la disparition s’impose sans retard. »6 Certes, le seul fait que ce projet s’inscrive dans le cadre global de la « Révolution nationale » pourrait suffire à le disqualifier. Pour autant, on se tromperait en faisant de la revalorisation du travail manuel une spécificité de Vichy : du Front populaire à la Libération, de « classes d’orientation » expérimentales en « classes nouvelles », on s’y attela régulièrement – en vain…
« Manuels vs intellectuels » ou « patrons vs ouvriers » ? Marx détrône Platon
1976. Sur l’affiche, un beau visage d’homme, maculé de poussière – ou de suie. Sous le casque, deux yeux graves vous fixent. Le col, haut relevé, laisse deviner que l’homme porte une épaisse combinaison de protection. C’est un ouvrier. Au sommet de l’affiche, ces mots, caractères gras sur fond blanc : « Celui qui donne le meilleur de lui-même a droit à une part équitable. Lui aussi. » En bas, la « signature » de la campagne : « Maintenant, priorité aux travailleurs manuels. »
Ce sont ces derniers mots qui vaudront à la campagne de Lionel Stoléru de se faire écharper par une partie de l’opinion. « Travailleur manuel », vraiment ? Et qu’entendon par-là, au juste ? Travailleur non intellectuel. Qui ne travaille pas dans un bureau. Le patron menuisier, l’ébéniste, le plombier, s’intègrent à merveille dans cette catégorie, aussi bien que l’OS qui travaille à la chaîne. Quoi de commun, pourtant, entre leurs métiers respectifs – hormis les mains et l’atelier ? Les premiers, artisans à leur compte, gagnent souvent grassement leur vie – et ils votent plutôt à droite. Victimes de la taylorisation, les seconds s’éreintent sur des machines qui ne leur appartiennent pas pour un salaire proche du minimum légal. La catégorie « manuel-intellectuel » est une mystification, un clivage éculé, dénonce une partie de la gauche. Un tour de passe-passe cynique de la droite libérale pour renverser des décennies de lutte syndicale fondées sur la seule authentique catégorisation : la distinction marxiste entre bourgeois et prolétaires.
Cela posé, disent ses détracteurs, la campagne de Giscard d’Estaing apparaît pour ce qu’elle est véritablement : une manœuvre cynique pour asséner un coup fatal à la lutte des classes, en détachant les ouvriers du PC et des syndicats pour leur faire faire cause commune avec les artisans. Il suffit d’anoblir les représentations du travail manuel, d’augmenter un peu les salaires, et les Français ne verront plus d’inconvénient à s’atteler aux tâches ingrates laissées vacantes par le départ des immigrés que le Gouvernement tente d’encourager par ailleurs. Cessant de rêver aux études longues, les enfants s’en iront garnir d’un cœur joyeux les bancs des CET et les ateliers des usines dans un apprentissage au blason redoré. Le moment est judicieusement choisi, notent Julien Mischi et Sylvain Laurens dans le long article qu’ils consacrent au sujet : justement, le virage récent du PC vers les exclus et les plus miséreux dans sa « Campagne sur la pauvreté » déplaît aux plus qualifiés des ouvriers, qui ne s’y retrouvent pas.
Pour ces auteurs, Marx offre un cadre plus pertinent que Platon et les encyclopédistes afin de comprendre cette France industrielle où le taylorisme s’est imposé.
La fabrique du bon sauvage
Disciple de Bourdieu, Claude Grignon, vers la même époque, jette un éclairage un peu différent sur cette entreprise de « revalorisation du travail manuel ». Fort de sa longue enquête dans les CET, qui fit l’objet d’une thèse publiée en 1971, il place à la base de nos représentations une catégorisation quant à elle fort ancienne : l’opposition entre « nature » et « culture ». Du côté de la nature se range le « concret », le travail direct sur les choses, « au ras de la réalité ». Ceux qui traditionnellement l’exercent font physiquement subir des transformations physiques aux objets. Nul besoin, pour cela, de réflexivité : le corps et les mains y suffisent. Du côté de la « culture » – entendez du langage et de la pensée, apanage de l’être humain –, se trouvent les hommes qui conçoivent l’ensemble de l’ouvrage et le font exécuter : « la domination que l’ingénieur exerce sur l’ouvrier est alors du même ordre que celle que l’homme exerce sur la nature. »7
Quelle est, dans cette perspective, la fonction de la formation délivrée aux futurs travailleurs manuels ? Celle tout d’abord de maintenir cet ordre social : pas question de faire accéder l’ouvrier à la culture des classes privilégiées, sous peine de perdre les précieux exécutants dont on a tant besoin. Mais une forme d’éducation est nécessaire, afin d’éviter que ne se déchaînent les forces barbares de la nature – ivrognerie, débauche, sédition et révolte. Cette éducation, morale autant qu’intellectuelle, consiste à faire du sauvage un « bon sauvage » en lui inculquant juste ce qu’il faut de culture : goût de « la belle ouvrage », vertu contre vice, ardeur à la tâche contre oisiveté…
En exaltant l’amour du métier et le sentiment de l’honneur de la profession, les classes « cultivées » marquent sur deux tableaux : non contentes de museler les forces barbares des « concrets », elles les incitent à ne pas sortir de leur classe.
Tel serait, selon Claude Grignon, l’objectif réel poursuivi par la « revalorisation du travail manuel ». En quoi il ne contredit guère les futurs détracteurs de la campagne lancée cinq ans plus tard par Valéry Giscard d’Estaing.
Manuels, intellectuels : même combat !
« Sous les pavés, la plage », « Il est interdit d’interdire »… Les slogans imagés de Mai 68 sont restés dans toutes les mémoires. Mais l’on se souvient peut-être moins de celui-ci, qui fleurit un temps du côté de Billancourt : « À À bas la séparation travail manuel et intellectuel!» D’une nature bien différente du slogan de Lionel Stoléru, s’il prétend effacer une dichotomie, ce n’est pas en revendiquant une « revalorisation du travail manuel ». C’est au contraire en dénonçant la semblable exclusion dont sont victimes une partie des intellectuels – les étudiants – et les prolétaires: celle que leur fait subir une culture fondée sur la reproduction. De même que le capitalisme réduit les ouvriers à la misère en les condamnant à la chaîne, le mandarinat qui prévaut à l’université frustre la grande majorité des étudiants du bénéfice qu’ils sont en droit d’attendre de leur long cursus. 8
Cette main tendue des étudiants aux ouvriers fera long feu, ces derniers ne se reconnaissant guère dans la lutte des jeunes intellectuels. Mais il en reste les témoignages que les « Établis », ces étudiants embauchés volontaires dans les ateliers des usines, ont livrés de leur expérience – parmi lesquels L’Établi, de Robert Linhart9. En partageant pendant des mois, voire des années, le quotidien des ouvriers à la chaîne, ils n’ont pas seulement vécu de l’intérieur les sensations de leurs compagnons. Ils ont aussi, mettant à profit leur dextérité conceptuelle, analysé ce qui fait la spécificité de la taylorisation : répétitivité et contrainte de temps, d’où procèdent l’abêtissement et la déshumanisation du travailleur.
***
À ce stade de notre étude, nous ne pouvons que livrer ce constat : la dévalorisation du travail manuel ne date pas d’hier ; au fil des millénaires, elle s’est puissamment ancrée dans nos représentations. Avec la taylorisation et l’avènement de la catégorie des ouvriers sans qualification, de nouvelles grilles de lecture sont venues, sinon supplanter celles de la tradition, du moins les modifier. Marx a repoussé dans l’ombre Platon, D’Alembert et Diderot.
Se pose alors une question. Tout comme la France, l’ensemble des pays « occidentaux » ont été nourris de culture classique ; non moins qu’ici, la taylorisation s’y est imposée ; la pensée marxiste y a prospéré pendant les trois quarts du XXe siècle. Comment s’explique alors que dans notre pays, le travail manuel et technique soit infiniment plus déconsidéré que chez nos voisins ? Une réponse possible : la place longtemps accordée aux Humanités dans notre culture nationale, puis dans le système éducatif qui en est le reflet, au détriment de la science et de la technique.
- 1. Julien Mischi et Sylvain Laurens, « Les politiques de revalorisation du travail manuel. 1974-1981 », Agone , n°46, 2011.
- 2. http://escales.enfa.fr/wp-content/uploads/sites/7/2009/03/Plan-Langevin-Wallon.pdf. Page 2
- 3. Cité in Bernard Charlot et Madeleine Figeat, op. cit. , p. 323.
- 4. Ibid. note 188 p. 576.
- 5. Ibid ., p. 323.
- 6. Ibid .
- 7. Claude Grignon, op. cit. , p. 291.
- 8. Michel de Certeau, La Culture au pluriel , UGE, 1974 ; « Points » Seuil, 1993, pp. 160-163.
- 9. Robert Linhart, L’ Établi , Minuit, 1978.
Culture
On l’a encore constaté récemment, à l’occasion de la énième réforme du collège : tout ministre de l’Éducation nationale qui s’avise de toucher au latin déchaîne aussitôt les tempêtes. En 2016, c’est autour du latin que s’est cristallisée la colère soulevée par la réforme du collège, avec ces fameux « EPI »1, qui concernaient pourtant toutes les disciplines, et l’on vit même un mathématicien, Cédric Villani, prendre fait et cause pour ce bon vieil exercice de la version latine. Quelques années plus tôt, le président Nicolas Sarkozy déclenchait un tollé comparable en s’en prenant à un roman du XVIe siècle, La Princesse de Clèves, dont il jugeait la présence déplacée au programme d’un concours d’attachés administratifs : « Je ne sais pas si cela vous est arrivé de demander à la guichetière ce qu’elle pensait de La Princesse de Clèves. Imaginez un peu le spectacle ! »
« Touche pas à mes classiques » pourrait figurer au nombre des devises françaises.
À l’inverse, c’est sans nulle vergogne qu’un ministre de l’Éducation nationale s’avouera incompétent en matière de règle de trois : « Je ne sais pas le faire du tout », avoue tout de go Xavier Darcos à Ariane Massenet au Grand Journal de Canal + en 2008. Nul doute qu’un patron d’industrie diplômé de Polytechnique confesserait avec la même ingénuité son incapacité à réparer un circuit électrique. En France, admettre son ignorance crasse en matière de sciences et a fortiori de technique n’empêche nullement de se dire cultivé, ni de passer pour tel. L’on a beau scruter à la loupe les quelque 1 500 pages de 1 kilo de culture générale (PUF, 2017), qui entend donner « un accès immédiat à la connaissance, depuis la formation de la Terre jusqu’à l’élection du pape François », on n’en trouvera guère plus de cent dédiées à la science et à la Technique. Aussi bien les auteurs de cette somme monumentale sont-ils tous deux littéraires. Tant il est vrai qu’au XXIe siècle encore, le mot « culture » reste étroitement associé aux « humanités ».
D’où nous vient cette spécificité un brin croquignolette à l’heure du numérique, des robots et l’intelligence artificielle ?
- 1. Enseignements pratiques interdisciplinaires.
Le monde à l’envers
Clergé et noblesse : l’âme et les mains
Pendant des siècles, le latin, la lecture, l’écriture, la culture en somme, furent l’apanage des clercs – ces savants et hommes d’église qui constituaient un des trois « états » de la société, avec la noblesse et le peuple. Aux clercs, la prière et la science ; aux princes et seigneurs, la guerre ; au peuple, le travail. Juché tout au sommet, le roi. Ainsi allait la vie, en cette époque appelée Moyen Âge – du moins, pendant sa majeure partie. Nul besoin de culture pour aller guerroyer : bien des seigneurs lisaient à peine, écrivaient encore moins, et les mamelles de leur éducation se résumaient à l’apprentissage des techniques bien physiques du combat et de la chasse – vènerie et fauconnerie1. Le roi lui-même, au XIIe siècle, ne lisait guère, et n’avait pas de livres. Aussi bien, jusqu’au XIIIe siècle, la lecture n’était-elle ni silencieuse ni individuelle : elle se faisait en public, à haute voix. Si les seigneurs étaient la main du royaume, son bras armé, les clercs en étaient l’âme, intercesseurs entre ce monde et Dieu.
Quant au peuple, chacun vaquait à ses occupations, les paysans aux champs sous la protection du seigneur, les autres au sein de leurs corporations, à moins qu’ils ne fussent mendiants, vivant honorablement de la charité. Si rivalité il y avait, c’était entre les princes du royaume, soucieux d’asseoir leur influence sur le roi, et localement entre seigneurs et clergé, également désireux d’affirmer leur contrôle sur les terres et sur l’encadrement des hommes qui y vivaient2.
L’instruction, alors, était peu répandue. Rares étaient ceux qui apprenaient à lire – dans des écoles tenues par le clergé. Plus rares encore ceux qui faisaient de vraies études, à l’université : à moins de vouloir entrer dans les ordres ou devenir médecin, on se souciait peu d’aller dépenser des sommes faramineuses en livres, en parchemins, en cours et examens, pendant quelque 5 à 8 ans d’études. Sur les bancs de l’Université, à la fin du Moyen Âge, les aristocrates se comptent sur les doigts de la main – à peine 3 à 7 %3 dans les Universités du Midi. Pour entrer au service du roi et des princes territoriaux, nul besoin alors de diplômes. Les postes de pouvoir revenaient tout naturellement aux bien nés – aux plus riches aussi – qu’ils fussent ou non instruits.
Vantant les mérites de Paris, en 1420, Guillebert De Mets énumère côte à côte « la belle sauniere, la belle bouchiere », la poétesse Christine de Pizan, un universitaire et un « artificieux ouvrier » : nulle différence marquée entre culture intellectuelle et culture matérielle4. Chacun, à sa façon, contribue à la gloire de la capitale. Jusqu’au XVe siècle, la noblesse peut tranquillement bouder les livres et chasser au faucon : elle continue de trôner au sommet de la société.
Où la bureaucratie naissante se met à changer la donne
« Un roi sans lettre est comme un âne couronné », écrivait au XIIe siècle le philosophe anglais Jean de Salisbury. Quand s’est-on avisé que pour diriger les affaires de France,
que l’on fût à la Cour, au Parlement, ou dans les instances municipales d’une grande ville, il valait mieux n’être pas ignorant ? Curieusement, il semble que le déclic soit venu de l’installation de la Papauté en Avignon, à l’aube du XIVe siècle. À son contact, la France découvre les vertus de la bureaucratisation. Parlement, Chambre des comptes et chancellerie, Cour du Trésor et Cour des Aides… Le pouvoir central s’organise. Pour mener les affaires du royaume, il faut écrire des lettres bien construites, bien argumentées, et connaître le droit. De même pour mener les affaires de province, que l’on soit à Dijon, Poitiers ou Bourges. Les écritures se multipliant, les postes d’officiers, royaux ou princiers, suivent la même courbe ascendante – bénéficiant d’émoluments mirobolants, et bientôt encadrés par un « statut de la fonction publique»5 à la fin du XIVe siècle.
Les universités, de plus en plus, pourvoient à ces besoins. Non que ce soit leur vocation première : les « clercs » – ainsi appelle-ton les professeurs comme les étudiants – constituent une corporation à part, partageant un même « métier », celui de la production et de la diffusion du savoir. Une corporation comme une autre : de même que les artisans se font payer pour fabriquer des objets et les marchands pour vendre des denrées6, les clercs font commerce de leur pensée, moyennant argent trébuchant. Ils ont eux aussi leurs outils – livres, pupitres, plume, lampe…, et leur méthode rigoureusement normée : la scolastique. Comme toute corporation urbaine, celle des clercs a sa juridiction propre, ses rituels, parmi lesquels celui de l’examen – et d’autres, religieux. Rattachée à la Papauté, la corporation des clercs est en effet officiellement ecclésiastique, quoique, de plus en plus nombreux au fil du temps, les laïcs soient admis parmi les étudiants.
Mais dès le XIIIe siècle, les rois s’avisent que la formation délivrée par l’Université fait d’elle une pépinière toute désignée où puiser leurs officiers et leurs fonctionnaires. À défaut de la mettre à leur botte comme ils le voudraient bien – le Pape veille au grain – ils offrent volontiers des charges officielles à ses gradués. Sises dans les grandes villes (les « bourgs »), les universités sont structurées en facultés. Passage obligé pour tout étudiant, la faculté des Arts accueille des jeunes de 14 à 20 ans, pour les préparer à l’enseignement d’une des trois autres facultés, celles-là « supérieures » : théologie, médecine et droit canon. Experts en matière de textes, les clercs de l’université ne savent pas seulement lire et écrire : ils apprennent à penser, discourir, convaincre, critiquer, organiser leurs arguments avec subtilité, grâce à la faculté des Arts qui les mène au baccalauréat et au doctorat. Ajoutez-y quelque cinq ou six ans d’études de droit, et vous avez les cerveaux les mieux faits du monde pour conseiller un roi et mener les affaires du pays, à Paris ou dans les villes de province. Mieux faits, car souvent plus instruits, que ceux de l’aristocratie.
C’est ainsi qu’une nouvelle classe peu à peu émerge : celle des « bourgeois », étymologiquement habitants des bourgs, se distinguant des artisans par leur savoir – ou leur richesse, s’ils sont financiers ou marchands… Ces derniers envoyant volontiers leurs rejetons faire de longues études, auxquelles leurs bourses bien garnies leur donnent aisément accès. Sans qu’on y prenne garde, insensiblement, la bourgeoisie, partout, étend son réseau d’influence, occupant à la Cour et dans les villes des postes clés. Force est alors à Christine de Pizan de revoir le vieux schéma des « trois corps de la policie ». À la triade « clergé, noblesse, peuple » dominée par le roi viennent se substituer désormais sept parties dont la tête est le roi, les épaules les princes, les bras la chevalerie, les flancs le clergé, les reins et le ventre les bourgeois, les cuisses les marchands – le menu peuple (artisans et paysans) se logeant dans les jambes et les pieds.
Qui s’en étonnera ? C’est à travers cette classe nouvelle de lettrés formés par l’université, occupant à la Cour les postes importants mérités par leur savoir et leurs compétences, que se répandit en France l’humanisme, venu d’Italie.
Humanisme et humanités
On les appelle « humanités » – studia humanitatis, « études de ce qui caractérise l’être humain », ou litterae humaniores, « enseignements plus particulièrement humains » – en opposition aux enseignement sacrés, litterae divinae. Apparentées à l’humanisme du XVIe par le nom et l’esprit, elles ont pour pilier le latin. Le latin ? Certes, il n’est pas mentionné dans la définition que donne de l’humanisme Etienne Dolet, un des grands initiateurs du mouvement en France :
« Par les lettres, les hommes sont ramenés à l’étude si longtemps négligée du beau et du vrai. Maintenant l’homme apprend à se connaître ; maintenant il marche à la lumière du grand jour, au lieu de tâtonner misérablement à travers les ténèbres ; maintenant l’homme s’élève vraiment au-dessus de l’animal, par son âme qu’il sait cultiver et son langage qu’il perfectionne. »7
Mais l’ouvrage dont est tirée cette citation s’intitule Commentaires sur le latin… et est écrit en bel et bon latin. Non celui, frelaté, de l’Église, mais le latin tel que le parlait Cicéron.
Car pour la première fois depuis des centaines d’années, les intellectuels de toute l’Europe peuvent découvrir les textes authentiques de ces auteurs anciens auxquels l’Église avait jusqu’alors seule accès, et dont elle ne livrait le contenu que tronqué, mutilé, surchargé de glose pour servir son dogme. Non que les érudits se soient livrés au pillage de la sainte Église, mais deux événements concomitants ont fait pleuvoir les textes latins et grecs. L’un est historique : la chute de Constantinople, en 1453, qui a poussé à l’exil les lettrés de la ville, emportant avec eux des manuscrits auxquels l’Europe n’avait pas accès. L’autre est une invention : celle de l’imprimerie par Gutenberg, en 1454. Pléthore de textes inconnus, imprimeries pour les diffuser, et voilà la révolution en marche.
Quelle révolution ? Celle d’un retour aux sources authentiques, d’un dialogue en direct avec les plus grands esprits de l’Antiquité – dont l’humain seul était l’objet d’étude et non la religion – sans les enfumages et barbouillages de la scolastique. Pour y accéder pleinement, pour en goûter la moelle, il faut devenir expert en latin, en grec – telle est la clé du nouveau monde.
Par une étrange coïncidence, quarante années plus tard, Christophe Colomb découvre l’Amérique ; encore trente ans, et Magellan effectue la première circumnavigation ; sept de plus, et Copernic chasse la Terre du centre de l’univers. Partout, des nouveaux mondes – et le latin pour les raconter.
On conçoit l’exaltation, la griserie de ces humanistes, que Stefan Zweig dépeint avec une tendresse amusée dans sa biographie d’Érasme : « Vient-on de découvrir un nouveau manuscrit de Cicéron ? Voilà le clan des humanistes persuadé que la terre tout entière va tressaillir de joie jusqu’en ses fondements ; le moindre petit pamphlet les met en émoi. »8 Rien de poussiéreux chez ces hommes qui traduisent avec frénésie la Bible, Cicéron et Platon, qui apprennent la technique et se font imprimeurs pour mieux diffuser leurs trésors, s’écrivent, se visitent d’un bout à l’autre de l’Europe, et bravent, campés dans leurs bottes, les foudres de l’Église offensée – jusqu’à finir sur le bûcher, tel Étienne Dolet. Comment être pusillanime, quand vous pensez détenir dans vos mains le seul moyen d’arracher l’homme à l’animalité, de le soustraire à la barbarie : le livre, où sont couchés, intacts, les textes des grands auteurs ?
Litterati et illitterati : quand l’humanisme restructure la société
Une nouvelle noblesse : les esprits cultivés
Étienne Dolet, Guillaume Budé, Jacques Lefèvre… Des noms bien roturiers. Ancien
prévôt des marchands de Paris, Guillaume Budé, considéré comme le meilleur helléniste d’Europe, appartient au cercle prestigieux des notaires et secrétaires du roi. Étienne Dolet fut secrétaire de l’ambassadeur de France à Venise. Quant à Jacques Lefèvre, il dut à la faveur d’un évêque d’être conduit à la cour, après avoir parcouru toute l’Europe, poussé par le démon de la curiosité.
Avec ces hommes va bientôt souffler sur la Cour, puis sur tout le royaume, comme dans les autres pays d’Europe, le vent de l’humanisme, propagé par l’imprimerie. Animé par cette unique certitude : avec son bras armé pacifique, le livre, la culture doit gouverner le monde, car elle est seule à même de dissiper le chaos, la barbarie, en développant ce qui différencie l’homme de l’animal – la raison. Pour les humanistes, écrit Stefan Zweig, « il existe deux couches sociales : en bas, la masse inculte, grossière, passionnée ; en haut, la sphère lumineuse des gens cultivés, compréhensifs, civilisés. »9
« L’antique orgueil de la noblesse a fait place à un autre, l’orgueil académique […] qui ne reconnaissait qu’au seul latiniste, à l’homme sorti des universités, le droit de statuer sur ce qui est juste ou non, moral ou immoral. »10 Dans la bouche des étudiants, le titre de magister, qui désignait au XIIe siècle aussi bien le maître d’école que le maître artisan, cède la place à celui de dominus, « seigneur ». Le roi lui-même entérine cet anoblissement implicite puisqu’en 1533, François Ier accorde la chevalerie aux docteurs de l’Université11. «La possession si recherchée de la science vaut plus que n’importe quel autre trésor, déclare le grammairien Mino da Colle à ses élèves ; elle fait sortir le pauvre de sa poussière, elle rend noble le non-noble et lui confère une réputation illustre, et permet au noble de dépasser les non-nobles en appartenant à une élite. »12
La société se divisera désormais entre litterati et illitterati – ceux qui pratiquent les livres, et ceux qui ne les pratiquent pas. Si la noblesse veut maintenir son éclat pour briller à la Cour, il lui faudra se plier au modèle italien en ajoutant au maniement des armes le goût de la beauté, la maîtrise du latin et du grec, de la poésie et de la musique, et se montrer capable de soutenir des conversations raffinées. À ce petit jeu-là, elle n’est pas sûre de gagner, concurrencée qu’elle est par les plus riches des bourgeois, qui ne comptent pas leurs écus pour jouer les mécènes auprès des artistes et des poètes.
Le peuple exilé de la culture
Quant au peuple, sa culture n’en est plus une : avec l’imprimerie, voilà la parole et le geste, ces media pluriséculaires de la communication, dévalorisés. Terminées, les représentations des Mystères – ces pièces de théâtre populaires si prisées pendant tout le Moyen Âge – à l’Hôtel de Bourgogne. Un arrêt du Parlement y met fin en 1542, crachant son mépris pour « ces gens non lettrés ni entendus en telles affaires, de condition infâme, comme un menuisier, un sergent à verge, un tapissier, un vendeur de poissons (…) gens ignares, artisans mécaniques, ne sachant ni A ni B, qui oncques ne furent instruits et davantage n’ont langue diserte… »13. Dans le nouveau firmament des lettrés, le marteau et le clou, l’outil et la matière, n’ont guère droit de cité. N’étant de vérité que livresque, la « culture » bannit de son champ la pratique pour ne garder que la théorie, et la technique pour ne conserver que la science14. L’on voit ainsi les fêtes médiévales de jadis – charivari, carnaval, processions – auxquelles participaient indistinctement les membres des trois ordres, se muer en spectacles que le peuple d’artisans et de paysans a tout juste droit de regarder, pressé derrière des barrières qui le séparent de l’élite bourgeoise et aristocratique.
Si le « corps de la policie » a les membres bien chahutés, les représentations anciennes n’en sont pas mortes pour autant. Car à présent qu’elle s’est extirpée du peuple par la richesse et le savoir, la bourgeoisie rêve d’accéder au rang le plus haut, celui qui a dominé sans partage pendant quelque mille ans. Devenir noble !
- 1. Michel Sot, Jean-Patrice Boudet, Anita Guerreau-Jalabert, Histoire culturelle de la France. 1. Le Moyen Âge , sous la direction
de Jean-Pierre Rioux et Jean-François Sirinelli, Seuil, 1997 ; « Points », 2005, p. 130. - 2. Ibid. p. 256.
- 3. Ibid . p. 279.
- 4. Ibid. p. 299.
- 5. Michel Sot, Jean-Patrice Boudet, Anita Guerreau-Jalabert, op.cit ., p. 293. L’expression « statut de la fonction publique » est empruntée par les auteurs à Françoise Autrand.
- 6. Pour ce paragraphe et le suivant, voir Jacques Le Goff, Les Intellectuels au Moyen Âge , Seuil, 1957 ; 1985 ; « Points » Seuil, 2000 pour la bibliographie.
- 7. Cité dans Alain Croix et Jean Quéniart, Histoire culturelle de la France. 2. De la Renaissance à l’aube des Lumières , sous la direction de Jean-Pierre Rioux et Jean-François Sirinelli, Seuil, 1997 ; « Points » Seuil, 2005, p. 99.
- 8. Stefan Zweig, Erasme. Grandeur et décadence d’une idée , Grasset, 1935 ; Livre de Poche, 2004, p. 98.
- 9. Op.cit. , p. 94.
- 10. Ibid. p. 95
- 11. Jacques Le Goff, op. cit ., p. 145.
- 12. Ibid. p. 144.
- 13. Régine Pernoud, op. cit ., p. 33.
- 14. Ibid. , p. 145
La moitié de l’Europe convertie au travail par un fils de mineur
La Réforme, fille de l’humanisme
L’humanisme ne connaît pas de frontières : « Le monde entier est notre patrie à tous », proclame Érasme dans sa Querela pacis. Telle est même sa vocation : balayer les barrières factices entre humains pour asseoir la civilisation nouvelle de l’homme cultivé. Remplacer les idiomes par une langue européenne unique, le latin. Aux frontières des nations, aux clivages des classes sociales, substituer la seule distinction entre litterati et illitterati. Grâce à la maîtrise du latin – du grec et de l’hébreu aussi, pour les plus érudits – les esprits, éclairés, pourront goûter directement, sans plus d’intermédiaire, le précieux suc de la sagesse antique. Et accéder librement aux Saintes Écritures, jusqu’alors jalousement gardées par l’Église, qui n’autorise leur accès qu’aux chrétiens entrés dans les ordres.
C’est là, très vite, que le bât se met à blesser. Car pour qui s’avise de mettre le nez dans les textes sacrés, notamment l’Évangile, une évidence se fait jour : il y a loin, bien loin, de la lettre de l’Évangile à ce que l’Église en a fait, et à sa tête, le pape. Quand Jésus prêche la pauvreté, le Vatican affiche sans vergogne une débauche de richesse et de luxe. Mieux : pour remplir ses caisses, il encourage éhontément le trafic d’indulgences, comptant sur la crédulité des ouailles, sur leur peur de l’enfer, pour leur faire acheter quelques bouts de papier censés remettre leurs péchés. Le doux Érasme de Rotterdam, ce prince incontesté des humanistes, ne manque pas de le faire remarquer – à sa façon, prudente – dans son Éloge de la Folie. Et de traduire, dans la foulée, les Évangiles du grec en latin, premier pas vers leur vulgarisation. Avec cette naïve conviction : placée face à ces évidentes contradictions par la foule des chrétiens fervents, l’Église s’amendera, renouant avec sa pureté des premiers temps. C’est là toute la logique de l’humanisme appliquée aux textes sacrés.
Mais c’est aussi la boîte de Pandore qui s’ouvre soudain. Car à ce compte, rien n’interdit de pousser plus loin l’examen du texte. De constater que rien n’y autorise l’Église à jouer les intercesseurs entre l’homme et Dieu, qu’il s’agisse de remettre les péchés ou de racheter des années de purgatoire en monnaie trébuchante. D’observer que rien, jamais, n’y est dit, sur le sacrement de la confession – ni sur le célibat des prêtres, ni sur les saints, ni sur le culte de la Vierge Marie. D’appliquer son esprit critique à l’interprétation des plus grands mystères – par exemple, la Grâce. Ce pas, un jeune moine, obscur fils d’un mineur de la Thuringe, le franchit sans hésitation : Luther, bientôt rejoint par une foule qui peu à peu s’enflamme. La Papauté s’alarme, somme le trublion de renoncer à ses propos impies – en vain. Le schisme est consommé ; la Réforme est née. L’humanisme, dont elle est fille, lui emboîtera-t-il le pas ?
Si la question semble nous mener loin de notre propos, dans une étude consacrée aux représentations du travail manuel en France, la suite montrera que nous touchons au contraire au cœur de notre sujet. Car c’est sur la réponse donnée à la Réforme par les divers pays d’Europe qu’au XXe siècle, le sociologue allemand Max Weber1 fondera la radicale opposition entre deux représentations du travail dans le monde occidental : celle du monde protestant, celle du monde catholique, le premier propice au capitalisme, le second y répugnant viscéralement. Nous résumerons ici sa théorie qui, pour être souvent critiquée par les historiens, n’en constitue pas moins une référence incontournable.
Où le travail devient vocation, et le succès signe de grâce
Bien travailler pour plaire à Dieu
Excommunié par le pape en 1521, Luther, accueilli par son ami l’électeur de Saxe Frédéric III, se lance dans un chantier gigantesque : la traduction de l’Ancien Testament en allemand. En allemand, la langue du peuple, et non pas en latin, langue des humanistes ! Il suffira désormais de savoir lire pour accéder à la bible. Et la version des textes saints que l’on pourra méditer à loisir sera celle de Luther.
Pour illustrer l’importance déterminante d’une traduction dans la construction des représentations, rien n’est plus édifiant que l’exemple d’un tout petit mot : Beruf, choisi par le moine Luther pour traduire deux mots grecs totalement distincts : klêsis, « appel de Dieu », et ponos, « la peine, le travail »2. Beruf, construit sur la même racine que le verbe allemand rufen, « appeler », signifie originellement « vocation ». Luther étant passé par là, il désignera aussi le métier – non seulement en allemand, mais dans toutes les langues des pays où le protestantisme sera prépondérant : beroep en hollandais, calling en anglais, kald en danois, kallelse en suédois. Rien de tel, en revanche, dans les pays catholiques.
Pourquoi ce choix de traduction ? Pour Luther, l’activité quotidienne à laquelle se livre chacun est la façon que Dieu lui a donnée d’accomplir son devoir religieux au cours de son existence. Exercer son métier du mieux qu’on peut, quel qu’il soit – « tous les métiers licites ont absolument même valeur devant Dieu »3, voilà la vie du bon chrétien, et il n’en est pas d’autre :
« L’unique moyen de vivre d’une manière agréable à Dieu n’est pas de dépasser la morale de la vie séculière par la vie monastique, mais exclusivement d’accomplir dans le monde les devoirs correspondant à la place que l’existence assigne à l’individu dans la société , devoirs qui deviennent ainsi sa “vocation”[Beruf]. »4
Toutefois, pour Luther, l’exercice d’un métier n’est pas affaire de choix, chaque homme ayant le devoir de rester dans la position où son Créateur l’a fait naître ; la « vocation » consiste à rester à sa place. Par la suite, l’idée s’affinera, la notion de « talent », de « don » venant s’y ajouter : pour travailler de son mieux à la gloire divine, l’homme doit mettre les « dons » qu’il a reçus de lui à sa naissance au service du métier qui lui permettra le mieux de les faire fructifier. C’est ainsi que, dans le protestantisme, le travail devient une valeur suprême, voire le but d’une existence de bon chrétien.
Le succès professionnel, preuve de la grâce divine
Né vingt-six ans après Luther, en 1509, Calvin, qui rompt avec l’Église romaine à 21 ans, pousse encore plus loin la doctrine de Luther. Ce dernier s’était contenté de contester à l’Église toute légitimité à s’interposer entre l’homme et Dieu, et aux « œuvres » le pouvoir d’acheter le salut. Calvin fait un saut gigantesque avec la notion de Prédestination. Non seulement, dit-il, la grâce divine ne s’achète pas. Mais, de toute éternité, Dieu aurait déjà choisi ceux à qui sa grâce sera accordée. Ceux-là seuls, les rares élus, seront sauvés. Les autres, marqués par le péché originel, sont des âmes perdues dès avant leur naissance ; tous leurs efforts pour mener une vie de bons chrétiens n’y pourront rien changer.
La grande question devient alors : comment savoir si l’on compte au nombre des élus ? Une seule réponse : par la foi. Parvenir à se persuader qu’on est choisi, parvenir à ne pas en douter, c’est détenir le signe qu’on l’est bel et bien. Et comment parvenir à cette certitude inébranlable, cette confiance en soi ? En travaillant sans relâche dans un métier, sans s’accorder de plaisir ni de joie, avec pour seule fin d’accroître sur terre la gloire de Dieu, chacun attelé à « faire la besogne de Celui qui l’a envoyé, aussi longtemps que dure le jour. » Le succès dont sera couronné ce travail constituera le signe, la confirmation, que l’on bénéficie en effet de la grâce de Dieu.
Ainsi l’homme se voit-il non seulement incité à travailler, mais à réussir. Le signe de ce succès étant évidemment la prospérité et l’argent, le bon chrétien s’enrichira autant qu’il le pourra, sans toutefois profiter de ses richesses – là serait le péché. Mener un train de vie modeste, se refuser tous les plaisirs, et n’user de l’argent que pour réussir mieux encore – en le faisant fructifier ou en l’investissant : tel est le mode de vie idéal du bon protestant. Ascétisme, travail, richesse. Libre concurrence, aussi. Car, bientôt répartis en de multiples communautés – baptistes, méthodistes, quiétistes… – les croyants n’auront de cesse d’illustrer la leur par les succès éclatants de ses membres, la réussite de l’un contribuant à la gloire de tous.
Et voilà, selon Max Weber, la preuve – ici très sommairement résumée – que l’éthique protestante était le terreau idéal pour que fleurisse et prospère le capitalisme. La Réforme peu à peu s’imposera en Allemagne, en Angleterre, en Suisse, aux Pays-Bas et dans les pays scandinaves. L’humanisme et son rêve d’une Europe sans frontières unie par la Culture sous le signe de la Raison, aura engendré son contraire : le schisme, la Réforme, les guerres de religion, une Europe coupée en deux. En France, après avoir rougi les eaux de la Seine pendant la nuit de la Saint-Barthélémy, les huguenots seront finalement tolérés grâce à l’édit de Nantes, promulgué en 1598 par un roi protestant ayant abjuré pour accéder au trône de France : Henri IV. Le royaume de France restera catholique.
- 1. Max Weber, L’ Éthique protestante et l’esprit du capitalisme , Plon, 1964 ; Pocket, 2001. L’analyse qui suit est tirée de cet ouvrage.
- 2. Ecclésiastique , XI 20-21.
- 3. Max Weber, op.cit. , p. 92.
- 4. Ibid. , p. 90.
Au royaume de l’honnête homme
La noblesse, Graal du bourgeois1
Il y a des petits riens qui en disent long… En ce XVIIe siècle, en France, un bourgeois du siècle passé qui se promènerait dans son ancienne demeure ne la reconnaîtrait guère. Méconnaissable, le jardin d’antan, où les arbres fruitiers et les rangs de salades voisinaient avec le lilas dans un plaisant fouillis. Une pelouse, quelques ifs bien taillés, des charmilles, le tout bien ordonnancé : rien qui se mange ne doit gâter la vue, c’est une question de bon goût. Un jardin a pour unique fonction d’être beau, en aucun cas utile. Dans la pièce de réception, on chercherait en vain le rouet sur lequel Madame filait naguère, avec son dévidoir. Il a migré vers la cuisine, et seule la servante y pose les doigts. Une personne de la bonne société ne saurait se livrer à une occupation utile, a fortiori manuelle.
Ils ont bien changé, les bourgeois, depuis qu’ils ont quitté le « peuple » pour devenir le « Tiers État », dont sont exclus ceux qui travaillent de leurs mains – les paysans, les artisans. Aussi bien la noblesse, qui les fascine tant, est-elle désormais à leur portée, objet de leurs désirs. Pour intégrer ses rangs, il faut mettre la main au portefeuille, s’acheter une haute charge et devenir officier du roi. Dans un État centralisé, les charges ne manquent pas, qu’il s’agisse d’œuvrer dans la finance ou la justice : l’on n’a que l’embarras du choix. Vous pouvez bien être fils de tanneur, comme le grand-père de Corneille, ou d’épicier, la noblesse vous sera acquise, définitivement, et votre charge ira à l’un de vos enfants. Vous serez certes un « robin », de la noblesse dite « de robe », mais noble néanmoins.
Restera à tenir son rang – en imitant les us et coutumes de l’aristocratie. Première étape, incontournable : s’acheter une terre dont on portera le nom. Manifester aussi tout son mépris pour les occupations vilipendées par la noblesse de sang, qui y voit motif suffisant à « dérogeance » – les activités mercantiles et, naturellement, les « arts mécaniques », quand bien même on serait fils de tapissier ou de riche négociant :
« Ce serait une chose ridicule de soutenir que la profession des arts mécaniques et la noblesse peuvent subsister ensemble ; ce serait dire que la lumière et les ténèbres, la vertu et le vice et tous les contraires du monde peuvent compatir ensemble, car la noblesse étant un ornement de la vertu et de l’honneur, quelle correspondance pourrait-elle avoir avec des métiers où il ne se reconnaît que de vil et d’abject ? » écrit le chevalier de La Roque2. Récemment anobli ou aspirant à l’être, le bourgeois se doit désormais d’agir et de penser en « honnête homme. »
La culture, ciment de l’unité nationale
Si la tempête des guerres de religion a ravagé la France, le calme est revenu depuis l’édit de Nantes3. Mais les esprits n’en restent pas moins marqués par cette époque sanglante qui a vu la France se couper en deux. Avec l’absolutisme, Louis XIV invente le moyen de rassembler la France en incarnant dans sa royale personne, qui représente Dieu sur Terre, l’autorité de l’État. Initiée dès le Moyen Âge, la centralisation, avec son corollaire, la bureaucratisation, atteint son apogée. Reste à trouver le ciment qui fera tenir cette haute pyramide administrative. Ce sera la Culture – lettres, arts et sciences, dont la Cour sera à la fois le creuset et le modèle rayonnant, et le Roi son vivant symbole. Telle que l’a définie naguère l’humanisme, la culture n’a-t-elle pas pour vocation première l’universalité ? Sa définition de l’« homme complet », rebaptisé « honnête homme », transcende à la fois les frontières et les clivages religieux : de quel meilleur ciment peut-on rêver ? Elle seule est à même de réconcilier la France et de la faire rayonner, en l’érigeant en modèle offert aux nations.
Certes, cette culture humaniste ignore les « vilains », ces gens du peuple qui travaillent de leurs mains. Mais le danger de schisme ne vient pas d’eux : il vient plutôt de l’Église, de la noblesse aussi avec ses prétentions, son goût pour les armes et la guerre, sa manie multiséculaire de n’en faire qu’à sa tête. Louis XIV entend la dompter, mieux, la domestiquer. Dans son essai Mensonge romantique et vérité romanesque4, René Girard démonte cette inversion des valeurs féodales réalisée par Louis XIV à la Cour. Rassemblés autour du monarque dans ce microcosme qu’est la Cour, les nobles n’ont plus qu’un moyen pour valoir : s’attirer les faveurs royales. Comment ? En brillant plus que leur voisin – par leur conversation, leur art de trousser un sonnet, d’esquisser joliment un pas de danse, de maîtriser les codes de la galanterie. Mais de ces valeurs nouvelles qui font de la Cour le haut lieu de la vie en société, les nobles n’ont certes pas l’exclusivité. Les « bourgeois » y sont passés maîtres, par l’éducation, et ce sont désormais des Lully, fils de meunier italien, des Molière, fils de marchand parisien, des Mansart, fils de maître charpentier, qui donnent le la – assurant au modèle français son rayonnement international.
Le collège, voie royale de l’ascension sociale
Avec les guerres de religion et les guerres franco-anglaises, les myriades de petites écoles où les clercs du Moyen Âge enseignaient aux enfants d’une même paroisse le catéchisme et quelques rudiments de lecture dans un psautier ont disparu, détruites par les affrontements. S’y côtoyaient alors toutes les classes sociales – un Suger, fils de serfs, ne fit-il pas ses classes à Saint-Denis aux côtés du futur Louis VI5?
La paix revenue, un nouveau système éducatif s’édifie, fondé sur une distinction sociale : aux pauvres des campagnes un enseignement gratuit, dispensé par ceux qu’on nomme plaisamment « Frères ignorantins » car ils ignorent le latin ; aux riches, les « collèges », où les Congrégations dispensent un enseignement fort coûteux dans la droite ligne de l’humanisme – les « humanités ». Deux enseignements aux contenus bien différents, il y va du salut de l’État.
« Ainsi qu’un corps qui aurait des yeux en toutes ses parties serait monstrueux, de même un État le serait-il si tous ses sujets étaient savants ; on y verrait aussi peu d’obéissance que l’orgueil et la présomption seraient ordinaires ; le commerce des lettres bannirait absolument celui de la marchandise et ruinerait l’agriculture », écrit Richelieu dans son Testament politique6.
Dès l’âge de huit ans, au collège, l’on apprend systématiquement le latin au contact des meilleurs auteurs de l’Antiquité7. Non content de maîtriser la langue classique par la grammaire, on y étudie la rhétorique, art de plaire et de persuader ; on y disserte à l’envi sur les conclusions morales à tirer de Cicéron ou Sénèque ; on s’y adonne, enfin, à la philosophie, distinguée en deux pans : la logique – art du raisonnement – et la physique, qui enseigne le fonctionnement du monde. Tout est ici fondé sur l’étude des textes anciens, grecs ou latins, censés contenir la quintessence de la sagesse et du savoir humain. Dans ce creuset se forgent les « honnêtes hommes », à qui sont promises les meilleures charges de l’État. Si la culture humaniste y règne en maîtresse, la science, considérée comme une partie de la philosophie, n’occupe qu’une place mineure. L’on y opère en outre une sévère dichotomie entre ce qui relève de la science fondamentale et de la recherche appliquée. N’ayant d’utilité que pour le monde des métiers, cette dernière n’a pas sa place ici. Le collège n’a pas vocation à préparer à une profession, mais à donner un excellent bagage de « culture générale », seul marqueur de l’élite. Le savoir que l’on y enseigne n’est pas finalisé : il est la condition nécessaire et suffisante pour forger un « honnête homme » – noble ou bourgeois.
La pratique mise au ban
Évidemment, une telle conception de l’éducation ne fait pas l’affaire de tous. Si leurs bourses bien garnies leur donnent les moyens d’offrir un bon collège à leurs rejetons, les riches marchands et les négociants boudent cet enseignement de peu d’utilité à qui veut embrasser une carrière commerciale ou manufacturière. Recourir à un précepteur privé leur semble préférable pour enseigner à leurs enfants les rudiments de théorie dont ils auront besoin – avant de les envoyer faire leurs armes par l’expérience, sur le terrain, dans les boutiques ou sur les comptoirs lointains. Les riches artisans, qui n’y trouvent pas davantage matière à satisfaire leurs besoins, en restent pour leur part à l’apprentissage.
En vérité, toutes les professions se trouvent handicapées par ce culte de l’abstraction et cette révérence des Anciens qui prévalent dans les études. À la faculté de médecine, c’est dans Hippocrate et Galien que les futurs médecins apprennent à soigner leurs contemporains : la pratique y est réduite à la portion congrue, bonne pour ces « artisans » que sont les chirurgiens-barbiers-apothicaires ; quant aux progrès récents de la science, tels que la découverte par Harvey de la circulation du sang en 1627, il faut attendre plusieurs décennies avant que la Faculté ne condescende à les intégrer. Qu’importe ? Le métier s’apprendra plus tard, sur le tas, au gré des relations sociales et familiales – tant il est vrai qu’il faut être fils de médecin pour aspirer à devenir médecin.
Formé au collège jésuite de La Flèche, Descartes incarne à merveille ce mépris de la pratique. Si sa philosophie, « Je pense donc je suis », plaçant au-dessus de tout l’intellect, fait fureur dans tous les cercles cultivés, son peu de goût pour les faits bien concrets lui vaudra d’être souvent démenti par des physiciens – tel l’Anglais Isaac Newton.
Cicéron et la machine à vapeur
Succédant à l’Espagne, la France, sous Louis XIV, devient la première nation d’Europe. C’est par sa culture qu’elle s’est imposée, celle de l’honnête homme, et cette culture seule permet d’accéder à la plus haute fonction qui soit désormais : le service de l’État. Cette suprématie culturelle, la France ne cessera plus, désormais, de la revendiquer comme consubstantielle à son identité. Avec les Lumières et ses philosophes, la voici à nouveau pionnière, répandant sur l’Europe l’éclat d’une pensée nouvelle. Et, avec la Révolution, ce sont les Droits de l’Homme qu’elle offre au monde entier, poussant à son extrême la prétention à l’universalité8.
Pendant ce temps, ailleurs, d’autres pays consacrent leur énergie à de nouveaux enjeux. La Révolution industrielle fait ses premiers pas en Angleterre. Rien de plus opposé à l’esprit français que cet utilitarisme affiché, qui fait feu de tout bois – science, technique, commerce, finance – pour enrichir le pays en créant des machines et en rationalisant les méthodes de production. Si la France s’enorgueillit de ses intellectuels, la monarchie anglaise préfère ériger en exemple les grandes réussites commerciales : « Les Anglais ne s’intéressent pas assez aux choses intellectuelles pour les aborder avec intolérance »9, notera plaisamment l’écrivain George Orwell. Le même état d’esprit se retrouve en Europe du Nord, et bientôt aux États-Unis, où le prestige couronne non le bon goût et la culture de l’« honnête homme », mais la richesse, l’audace et l’inventivité de la grande bourgeoisie d’affaires et d’industrie10. Selon la thèse de Max Weber, résumée plus haut, la culture protestante de ces pays expliquerait en partie cette différence radicale. Qu’importe, dit-il, qu’au XXe siècle, les esprits ne soient plus guère occupés de religion. Les réflexes culturels demeurent, qui dirigent plus volontiers les étudiants catholiques allemands vers les humanités, les protestants vers les techniques et l’industrie.
La France devra pourtant se résigner à prendre en marche le train de la révolution industrielle au XIXe siècle. Même alors, elle ne pourra se résoudre à ouvrir l’Université à la recherche scientifique appliquée, ni à créer des ponts entre l’Alma Mater et le monde de l’industrie. Dans les pays anglo-saxons et germaniques, c’est tout naturellement que l’Université développe un enseignement en symbiose avec les laboratoires des entreprises chimiques, électriques ou métallurgiques, note Jean-Pierre Rioux11. Et en dehors des grands campus, on voit fleurir des myriades d’instituts techniques où se forment les cadres de l’industrie. Nées au tournant du XVIIIe et du XIXe siècle, hors du cadre de l’Université, les quelques Grandes écoles scientifiques françaises – Mines, Ponts, Génie Maritime – vouées à la formation des ingénieurs, incarnent bien cette singularité de notre pays : chez nous, on ne mélange pas le pratique et l’abstrait, ce dernier réservé à l’université.
- 1. Pour ces deux paragraphes, voir Régine Pernoud, Histoire de la bourgeoisie en France. 2. Les temps modernes , Seuil, 1962 et 1981 ; « Points », chapitres 1 et 2.
- 2. Chevalier de La Roque, Traité de la noblesse , 1678, p. 466. Cité par Yves Tinard, L’Exception française , Maxima, 2001.
- 3. Pour l’analyse qui suit, voir Marcel Gauchet, Comprendre le malheur français , Stock, 2016 ; « Folio » Gallimard, p. ٤٢ sqq.
- 4. René Girard, Mensonge romantique et vérité romanesque , Grasset, 1977.
- 5. Régine Pernoud, op. cit ., p. 26.
- 6. Régine Pernoud, op. cit. , p. 27.
- 7. Pour ce paragraphe et le suivant, voir Alain Croix et Jean Quéniart, Histoire culturelle de la France. 2. De la Renaissance à l’aube des Lumières , sous la direction de Jean-Pierre Rioux et Jean-François Sirinelli, Seuil, 1997 ; « Points » 2005, chapitre 9 « Enseigner les savoirs ».
- 8. Pour ce paragraphe, voir Marcel Gauchet, op. cit. , chapitre 2 « La France et son histoire ».
- 9. Emmanuelle Loyer, Une brève histoire culturelle de l’Europe , « Champs » Flammarion, 2017, p. 241.
- 10. Ibid. , p. 215.
- 11. Jean-Pierre Rioux, La Révolution industrielle, 1780-1880 , Seuil, 1971 ; « Points » 1989, p. 117.
Au royaume de l’honnête homme
Une culture élitiste… pour tous !
En 1959, Charles de Gaulle crée un nouveau ministère pour André Malraux : le « ministère des Affaires culturelles ». Jusqu’alors, les « Beaux-Arts » (Arts et Lettres, Musées, Architecture, Archives) étaient placés sous la tutelle du ministère de l’Éducation nationale, et le cinéma sous celle du ministère de l’Industrie. Les voici réunis sous le même vocable de « Culture ». La mission du nouveau ministre, par lui-même définie : « rendre accessibles les œuvres capitales de l’humanité, et d’abord de la France, au plus grand nombre possible de Français, assurer la plus vaste audience à notre patrimoine culturel et favoriser la création des arts et de l’esprit qui l’enrichissent. »1
Première remarque : ne sont ici concernés que les chefs d’œuvre des Arts et des Lettres. De ce point de vue, Malraux se situe clairement dans le prolongement de l’humanisme du XVIe siècle, et non de celui de l’Encyclopédie qui réunit sous la même bannière Arts Libéraux et Mécaniques – le philosophe, le physicien et le menuisier.
Deuxième remarque : Malraux le précise bien, ces chefs d’œuvre doivent désormais être accessibles au plus grand nombre de Français. En quoi il se démarque cette fois totalement des premiers humanistes, et de « l’honnête homme » dont Louis XIV fit l’idéal de la Cour. Rappelons-le en effet, cet humanisme là n’a jamais aspiré à faire bénéficier le peuple de la culture. Affirmant au contraire son élitisme, il postule que l’humanité se subdivise en deux parties : l’élite constituée par les « lettrés » et la masse des autres, auxquels l’enseignement dispensé par les « Frères Ignorantins » suffit bien. On conçoit qu’une telle scission de l’humanité en deux ne soit plus de mise dans notre République – en l’occurrence la Cinquième, qui fait ses premiers pas lorsque Malraux accède à son ministère tout neuf. La « Culture » sera donc pour tous. De même que l’Éducation nationale réunira désormais tous les enfants dans une même école, puis dans un même collège – pour y recevoir, à partir de 1975, une même culture, définie par le «socle commun ».
On voit ici l’ambiguïté fondamentale de la culture ainsi définie : culture pour tous, certes, mais dont le contenu eut longtemps vocation à marquer une différence entre l’élite et les autres. Cette définition du contenu de la culture ne concerne pas seulement Malraux et son ministère. Elle prévaut aujourd’hui partout. Il n’est besoin, pour s’en convaincre, que de jeter un œil aux partenaires du concours du Meilleur Ouvrier de France : le logo du ministère de la Culture y brille par son absence, tandis que ceux du ministère de l’Industrie et du secrétariat au Commerce et à l’artisanat y trônent en bonne place – aux côtés de Badoit, Renault ou Nespresso. Les programmes de Culture générale définis par les Grandes écoles ne sont pas moins éloquents : à l’épreuve de « Culture gé », Sciences Po demande à ses candidats de démontrer leurs connaissances en « philosophie, littérature, sociologie, histoire » ; HEC, pour sa part, s’enorgueillit de « former l’esprit [de ses élèves] à une réflexion autonome et éclairée, par la lecture ample et directe des grands textes et par la pratique de la dissertation. »
Dans la Culture générale, nulle trace de science ou de technique. La science et la technique relèvent de l’expertise ou du métier – elles n’appartiennent pas au « patrimoine culturel ».
Les humanités : plus « humaines » que les autres formes de savoir ?
En 1837, le physicien et astronome François Arago interpelle ainsi le Parlement, à l’occasion d’un débat sur l’enseignement des classiques :
« Ce n’est pas avec de belles paroles qu’on fait du sucre de betteraves ; ce n’est pas avec des alexandrins qu’on extrait le sodium du sel marin. »2
Il s’attire aussitôt du poète Alphonse de Lamartine la verte réplique que voici :
« Si le genre humain était condamné à perdre entièrement un de ces ordres de vérité, ou toutes les vérités mathématiques, ou toutes les vérités morales, je dis qu’il ne devrait pas hésiter à sacrifier les vérités mathématiques ; car si toutes les vérités mathématiques se perdaient, le monde industriel, le monde matériel subirait sans doute un grand dommage, un immense détriment ; mais si l’homme perdait une seule de ces vérités morales dont les études littéraires sont le véhicule, ce serait l’humanité tout entière qui périrait. »3
Dialogue de sourds, qui met en concurrence deux conceptions différentes de l’utilité : morale pour le poète, qui place au sommet de la hiérarchie l’enseignement qui élève l’âme humaine ; matérielle pour le second, qui choisit à dessein des techniques relatives à la nourriture. Vaut-il mieux bien penser ou bien manger ?
Des vérités « morales »
C’est là une première supériorité revendiquée par les « humanités » : leur champ concerne la morale. En étudiant Sénèque, Cicéron et Platon, puis Ronsard, Corneille et Descartes, l’on accède à des vérités sur l’homme, valables de toute éternité, sans lesquelles on ne peut « bien » vivre. Le théorème de Thalès ni l’art d’assembler tenon et mortaise ne feront de vous un homme « complet ». Ils ne contribueront qu’à votre confort – grâce à l’artisanat, ou l’industrie.
Les détracteurs des humanités auront beau jeu d’objecter que pour se pénétrer des belles vérités cicéroniennes, il n’est nul besoin de connaître le latin. On peut apprécier Shakespeare sans parler anglais, Goethe sans connaître l’allemand, pourvu que la traduction soit de qualité. Pour leur clouer le bec, l’on invoque alors, avec quelque raison, la filiation entre latin et français. Comment connaître et aimer notre langue sans y déceler, sous les mots, les racines ? D’autres encore argueront de la valeur intrinsèque de l’exercice de traduction : apprendre à traduire le latin, le grec, est un exercice difficile qui structure l’esprit. Non moins que démontrer un théorème, feront observer certains…
Une culture « désintéressée »
C’est ailleurs que se loge l’autre grande prétendue supériorité des humanités : leur objectif, affirme-t-on, n’a rien d’utilitaire. Elles offrent une culture « désintéressée ». Entendez : enseignées à l’école, elles n’ont pas pour vocation de préparer l’élève à son futur métier. Elles n’aspirent qu’à former l’homme – sa morale, sa faculté de raisonner, d’argumenter, d’analyser, de critiquer ; ne s’attachent à développer chez lui que les facultés nobles – la pensée, l’intellect, le pouvoir d’abstraction4. Pascal n’at-il pas écrit : « Toute notre dignité consiste en la pensée » ? Descartes, par sa méthode, nous apprend la logique, la façon de décomposer chaque problème en une multitude de petits problèmes. Cette méthode acquise, chacun sera en mesure de l’appliquer à l’objet de son choix.
Telle serait l’unique finalité de la culture – et donc de l’école, qui a vocation à la transmettre : grâce à la fréquentation des grands esprits du passé, développer les plus nobles des facultés humaines. Le reste, n’ayant d’utilité que purement pratique – préparer, par exemple, à l’exercice d’un métier – ne mérite pas de figurer parmi les « humanités », ni donc au sein de la culture.
La science et la technique : des « anti-humanités » ?
Utilitaire vs désintéressé
En 1902, lors de la grande querelle autour de la refonte de l’enseignement secondaire, Gustave Lanson, défenseur d’une section moderne sans latin, ne se privera pas de remarquer que « l’éducation des humanistes, celle des jésuites, étaient utilitaires dans les circonstances qui les ont produites. L’instruction secondaire, ajoute-t-il, s’adressait alors à une minorité privilégiée destinée aux carrières purement libérales. »5 Par la fréquentation des auteurs grecs et latins, par l’apprentissage de la rhétorique, les classes privilégiées de l’Ancien Régime apprenaient à briller, à séduire, à convaincre, qualités nécessaires à toute carrière au Parlement ou à la Chancellerie. Au cours de leur apprentissage, les futurs menuisiers apprenaient quant à eux à construire un meuble, à quoi s’emploierait toute leur existence dans leur atelier. L’enseignement des uns est-il moins utilitaire que l’apprentissage des autres ? Poussons un cran plus loin : s’exercer à dessiner et construire une table, voilà qui, pour le coup, eût été crânement désintéressé de la part d’un duc. Louis XVI ne s’adonnait-il pas à l’art mécanique de la serrurerie pour garnir les portes de Versailles ? Ce qui n’empêche qu’on lui tint rigueur de cette marotte, jugée déshonorante pour un roi.
La notion de « désintéressement » ne tient guère. Il n’empêche qu’elle continue d’être brandie aujourd’hui. Et c’est bien en son nom que l’enseignement du français truffe les jeunes têtes de notions linguistiques qui, à défaut de les intéresser au texte littéraire – elles les en dégoûteraient plutôt – auront au moins le mérite de ne jamais leur servir à rien. Pour jouer à fond la carte du désintéressement, mieux vaudrait à tout prendre enseigner le dessin industriel en classe de Terminale L – mais curieusement, nul ne s’avise d’y songer.
Moral ou intellectuel vs matériel
Au moins ne peut-on retirer aux humanités le contact qu’elles permettent avec de grands esprits. Rien de tel, semble-t-il, dans les « Arts mécaniques », aujourd’hui rebaptisés « technique », qui mettent l’homme face à la matière et à des outils – plus souvent face à une machine depuis la révolution industrielle. C’est justement cette vision que conteste le philosophe des techniques Gilbert Simondon6. Certes, dit-il, on s’est accoutumé à réduire l’objet technique à son utilité. Mais c’est là méconnaître son essence. Nul ne peut nier qu’un objet technique ait été conçu pour servir. Or, cette conception est le produit d’une opération mentale, celle de son inventeur. Pour la mener à bien, ce dernier a puisé dans diverses connaissances – connaissance de mécanismes existant déjà, de propriétés physiques ou chimiques de la matière. Grâce à son ingéniosité, son imagination aussi, l’inventeur de l’objet technique a trouvé moyen de surmonter les obstacles qui se présentaient à lui, jugés infranchissables par ses prédécesseurs. Dans le domaine technique, conclut Simondon, la distinction hiérarchique manuel/intellectuel est dépourvue de sens.
La culture technique
Au même titre que le livre ou le tableau, l’objet technique est le fruit d’une création. Certes, il ne démonte pas le mécanisme de la jalousie comme Un Amour de Swann, ne nous aide pas à saisir la beauté des jeux de lumière comme Les Meules de Monet. Mais il nous raconte l’histoire d’un homme qui, sollicitant ses connaissances, son imagination, sa faculté de raisonner, a inventé le moyen d’aider les autres hommes à mieux vivre dans leur milieu. Faute de posséder la culture technique suffisante pour apprécier le processus de cette invention, l’usager passe à côté d’une rencontre avec un esprit de valeur. Pire : il se trouve face à l’objet en situation d’aliénation, incapable qu’il est de comprendre son fonctionnement et donc de l’entretenir, de le réparer.
La culture ? Une technique. La technique ? Une culture
Dans un article de 19657, Simondon se livre à un petit exercice de vocabulaire fort plaisant, et des plus décapants. Le mot « culture », rappelle-t-il, revêt deux significations. Au sens premier, il désigne l’activité qui consiste à faire pousser une plante sur un sol. En d’autres termes, une technique en bonne et due forme qui s’exerce sur un milieu. Dans un second sens, métaphorique cette fois, la « culture » désigne la technique permettant de faire croître non plus une plante, mais un humain – par l’apprentissage, les connaissances.
Paradoxalement, note Simondon, cette technique s’exerce ici non pas sur le milieu, mais sur l’humain lui-même. En toute logique, elle se rapproche donc plutôt de l’élevage, autre technique qui consiste à apporter directement ses soins à des animaux.
Second paradoxe : l’activité qui consiste à modifier le milieu, l’environnement, pour le rendre plus propice à l’homme – travailler le bois pour en faire un bol, le métal pour en faire un couteau – porte quant à elle le nom de « technique ». Alors qu’étymologiquement, le terme «culture» eût été plus adéquat…
En somme, ce qui relève de l’artisanat devrait porter le nom de « culture », et ce qui touche à l’éducation intellectuelle ou morale, celui d’« élevage ». Quoi qu’il en soit, dans un cas comme dans l’autre, il s’agit bel et bien de techniques. Ou de cultures.
Troisième paradoxe : ces deux activités, par lesquelles l’homme agit sur lui-même – soit directement, par la transmission de coutumes, de connaissances ; soit indirectement, en modifiant son milieu pour améliorer sa vie – sont couramment opposées. L’homme technicien ne saurait se confondre avec l’homme cultivé. Mieux : on entend souvent dire que la technique menace la culture. Alors qu’il s’agit en réalité d’une compétition entre deux techniques – ou deux cultures.
Comment expliquer cette opposition ? La technique a ceci de particulier qu’elle a le pouvoir de transformer le milieu à grande échelle, au-delà du seul milieu de ses inventeurs – surtout depuis la sortie de l’ère préindustrielle. Cette transformation du milieu entraîne évidemment à terme une transformation des hommes qui y vivent : le monde d’avant la machine à vapeur, ou l’électricité, n’est pas le même que celui d’après.
La technique est fondamentalement dynamique, elle se place du côté de l’évolution ; la culture s’y oppose au nom de la pérennité des coutumes d’un groupe. Les deux méritent évidemment d’être prises en compte, conclut Simondon, dès lors que l’une comme l’autre concerne l’homme, ses valeurs, ses choix de vie. Mais le dialogue ne peut se faire qu’à condition d’en finir avec le dualisme « culture/technique », et en conjuguant l’apprentissage des deux, depuis le plus jeune âge.
Ce qui, faut-il le préciser, n’est nullement le cas dans notre pays…
À chaque humanisme sa culture
Les humanistes de la Renaissance avaient fixé à leur culture le noble but de libérer l’homme du dogmatisme de l’Église, en lui donnant accès direct aux textes anciens longtemps accessibles aux seuls gens d’Église. Ceux des Lumières, à travers l’Encyclopédie, se proposaient de « libérer l’initiative technique des forces inhibitrices de la société »8, restituant à la technique sa noblesse à travers l’idée de progrès. Si l’on définit l’humanisme comme « la volonté de ramener à un statut de liberté ce qui de l’être humain a été aliéné, pour que rien d’humain ne soit étranger à l’homme », en quoi devrait consister l’humanisme d’aujourd’hui ? demande Simondon. De quelle aliénation souffre l’homme d’aujourd’hui ? De son rapport, sans doute, à la technique, qu’il subit sans plus être maître de sa finalité. Le nouvel humanisme devra donc redonner à l’homme sa place dans un monde industriel qui dépasse sa capacité de le penser. Pour ce faire, incontestablement, la « culture » telle que l’entendait le premier humanisme ne suffit pas. Il convient désormais d’y ajouter la culture technique, l’une et l’autre étant nécessaires pour aborder avec lucidité les problèmes complexes qui caractérisent le monde d’aujourd’hui.
Nous conclurons avec Jean-Pierre Dupuy :
« Une culture se voulant humaniste qui ignore ce que la science et la technique font de l’homme et de la société n’est pas digne du nom de culture. Elle se condamne à broyer du vent. »9
- 1. Marc Fumaroli, L’ État culturel. Essai sur une religion moderne , Editions de Fallois, 1992 ; Livre de Poche, p. 65.
- 2. Théodore Zeldin, Histoire des passions françaises. 2. Orgueil et intelligence , Petite Bibliothèque Payot, 2003, p. 343.
- 3. Ibid.
- 4. Régine Pernoud, op. cit ., p. 29.
- 5. http://www.fabula.org/atelier.php?Gustave_Lanson_et_la_r%26eacute%3Bforme_de_%31%39%30%32
- 6. Pour ce paragraphe, voir Gilbert Simondon, Du mode d’existence des objets techniques , Aubier, 1958 ; 2012, p. 334 sqq.
- 7. Gilbert Simondon, « Culture et Technique »,1965, cité dans Sur la technique , Puf, 2014, pp. 315-329.
- 8. Ibid. , p. 144
- 9. Jean-Pierre Dupuy, « L’inculture comme avenir », in De quoi l’avenir intellectuel sera-t-il fait ? Enquêtes 1980, 2010, Le Débat , Gallimard, 2010, p. 226.
Orientation
2016. Un collège ordinaire. M. et Mme Z. prennent congé du professeur principal. C’est acté : leur fille Cindy, 17 ans, n’ira pas en seconde générale l’an prochain. Le conseil de classes l’a ainsi décidé. Elle est orientée en LP. « Le lycée des gogols », comme l’appelle Cindy – celui des bons à rien. Avec à peine 8 de moyenne, Cindy n’a pas le niveau, disent ses professeurs. Et elle est trop âgée pour redoubler encore une fois. Les études longues ne sont manifestement pas faites pour elle : c’est un e concrète . Mieux vaut qu’elle aille au LP apprendre un métier. M. et Mme Z. sont effondrés. Envoyer Cindy en LP, alors que son copain Djamel, qui a encore moins travaillé, va faire une seconde générale ? Elle va tomber en dépression. Mais ils n’ont pas dit leur dernier mot. Il leur reste un ultime recours : faire appel…
1946. Une école primaire ordinaire. M. et Mme X. prennent congé de l’instituteur. Bien sûr, il leur revient d’en décider, mais le maître est formel : leur fils Gilbert, 11 ans, brillant sujet, a toutes les qualités requises pour entrer en 6 e au lycée de la ville voisine. Les études secondaires sont gratuites à présent, ils n’auront rien à payer ! Gilbert apprendra le latin, il préparera son baccalauréat, toutes les portes lui seront ouvertes, quelle ascension en perspective pour un fils de mécanicien ! M. et Mme X. sont bien embarrassés. Le latin ? Pour quoi faire ? Quant au baccalauréat, c’est si loin – et pour faire quel métier ? Le certificat d’études, au moins, c’est du concret. Après, Gilbert pourra toujours suivre le Cours complémentaire de son école, ou même faire comme son cousin Roger et aller au collège technique. Le latin, le bachot, c’est bon pour les riches…
Qui s’en doute aujourd’hui ? Les « bonnes classes avec latin », le bac, l’université, les études longues, n’ont pas toujours fait rêver les Français. Il fut un temps où, à choisir entre certificat d’études et baccalauréat, l’on optait volontiers pour le premier. Un temps où entrer à l’école professionnelle – EPCI1 ou ENP – faisait d’un fils, d’une fille, la fierté de ses parents. Un temps où le secondaire, en panne d’effectifs, soupçonnait ces diables d’instituteurs de garder jalousement pour eux leurs meilleures recrues au lieu de les envoyer en collège. Un temps – jusqu’en 1959 ! – où une rivalité affichée opposait l’enseignement secondaire et l’enseignement primaire… à l’avantage de ce dernier.
On tiquera peut-être. Rivalité primaire/secondaire ? Quelle absurdité ! L’un n’est-il pas le prolongement de l’autre ? À moins d’avoir plus de 70 ans ou de s’intéresser à l’histoire de l’enseignement, on se souvient rarement qu’il n’en fut pas toujours ainsi. Avant la Ve République, rien n’empêchait qui le voulait, certificat d’études en poche, de poursuivre sa scolarité en primaire jusqu’à l’âge de 15 ou 16 ans.
Ceux même qui s’en souviennent tiqueront, eux aussi. Si, en ce temps, les classes populaires ne poussaient pas leurs ambitions au-delà du certif ou de l’école professionnelle, feront-ils remarquer, c’est simplement la preuve qu’elles avaient intériorisé leur « infériorité », reproduisant docilement les inégalités installées par l’ordre social. Égalité des chances oblige, les enfants d’aujourd’hui, d’où qu’ils viennent, ont accès à tous les parcours – loué soit le collège unique !
Un petit survol historique s’impose…
- 1. Devenue « collège technique » sous Vichy.
Les trois ordres
Les deux écoles : l’école des classes favorisées, l’école du peuple
Lorsqu’en 1882, Jules Ferry institue l’école primaire gratuite et obligatoire jusqu’à 13 ans, et qu’il la confie aux « hussards noirs de la République », cette école n’est pas destinée, on tend à l’oublier, à tous les enfants de France. Une partie des petits Français a déjà son école, dont l’excellence est pour tous évidente : l’enseignement secondaire, qui mène les enfants de la 11e au baccalauréat.
Le secondaire : l’école des classes favorisées
L’enseignement secondaire est payant. Ce simple fait le réserve à la frange la plus aisée de la population, seule à même de financer des études longues et coûteuses. Contrairement à ce que suggère son nom, le secondaire accueille les enfants dès la classe de 11e. Pourquoi, alors, l’appeler « secondaire » ? Parce que son objectif, sa raison d’être même, est de conduire les élèves au baccalauréat, porte d’accès à l’université. Les « petites classes », de la 11e à la 7e, ont pour unique fonction de préparer les enfants à l’entrée en 6e. Là, pour de bon, commencent les choses sérieuses.
Sous la houlette de professeurs hautement qualifiés, licenciés ou agrégés dans une matière qu’ils ont étudiée à l’université, les élèves, pas à pas, progressent vers leur Graal : le baccalauréat…
Le programme ? Il s’agit d’offrir à ces fils et filles de bourgeois la culture qui fonde leur excellence et marque leur prééminence dans la société : les « humanités », déesses tutélaires des beaux discours, qui leur permettront de briller parmi les leurs au prétoire ou à l’Assemblée, et dont la pierre angulaire est le latin. Au fil du progrès scientifique et technique, mathématiques et physique s’y adjoindront, arts mineurs néanmoins utiles à de futurs grands patrons d’industrie. L’enseignement secondaire se dispense dans deux types d’établissements – les lycées, dans les grandes villes ; les collèges, dans les villes moins peuplées.
Le primaire : l’école du peuple
Les enfants du peuple n’ont pas attendu Jules Ferry pour apprendre à lire et écrire. Des écoles gratuites existaient déjà avant 1880, çà et là, dans les villages et les quartiers pauvres des villes ; elles étaient souvent catholiques : dès 1833, Guizot avait enjoint à chaque commune d’entretenir une école, voire d’en créer une, et de dispenser les familles indigentes de la « rétribution paternelle » due pour chaque élève à l’instituteur1. Mais avec Jules Ferry, l’enseignement primaire est tout entier repensé par la République comme un tout cohérent : avec ses instituteurs, ces « hussards noirs » laïcs formés dans les Écoles normales, et son réseau d’écoles pénétrant jusqu’aux plus petits villages. Obligation est faite à tous les enfants de suivre jusqu’à l’âge de 13 ans un programme ambitieux : celui qui les dotera de toutes les connaissances nécessaires pour entrer dans la vie active et exercer de façon éclairée leur métier de citoyens.
Les petites classes du primaire
L’enseignement «primaire » doit son nom aux classes qui constituent son cœur : celles, de 7 à 13 ans, où l’on apprend à lire, à écrire, à compter. On y apprend aussi des rudiments d’histoire, de géographie et des « leçons de choses »… Bref, on s’y constitue le bagage de savoir que gardera toute sa vie l’adulte qu’on deviendra. Un programme ambitieux et lourd, dont les élèves exceptionnellement doués auront fait le tour dès l’âge de 11 ans, les plus lents à 13 ans, et d’autres jamais. Chacun va à son rythme dans ces classes où se trouvent réunis plusieurs niveaux – le groupe du cours élémentaire, celui du cours moyen… Quand un instituteur juge des élèves prêts à réussir, il les présente au certificat d’études. Certains l’obtiennent, d’autres non. Certains ne le passeront jamais. « Certif » en poche, beaucoup entreront dans la vie active – dans l’atelier ou la ferme familiale, en apprentissage chez un patron… Quant aux plus doués, l’instituteur leur proposera de poursuivre leurs études.
Après le certif
Pour faire des études, nul besoin de quitter le primaire, ni même nécessairement l’école où l’on a fait ses classes. Malgré son nom, le primaire offre un enseignement qui peut mener ses bons élèves jusqu’à l’âge de 16 ans et dispensé, toujours, par des instituteurs. On y approfondit le programme des petites classes pour consolider ses acquis. On y reçoit, aussi, des cours pratiques préparant à l’exercice d’un métier : comptabilité, travaux manuels… Les enfants des familles les plus modestes resteront dans leur école, où ils suivront les quatre années de « cours complémentaires » (CC), dispensés par un instituteur – souvent, le directeur de l’école. S’il n’y a pas de CC dans leur établissement, ou si leurs parents sont plus ambitieux, les élèves les plus doués migreront dans l’école primaire supérieure (EPS) de la ville la plus proche. Passés par l’École normale supérieure de Fontenay ou de Saint-Cloud, les maîtres qui y officient, quoique instituteurs, ont reçu une formation plus poussée et n’enseignent chacun que deux ou trois matières. Certaines de ces EPS s’étant spécialisées dans le commerce ou l’enseignement technique, les élèves y acquerront en quatre ans une qualification dans leur futur métier – souvent en atelier, s’ils se destinent à l’artisanat ou l’industrie.
Primaire vs secondaire
On ne choisit pas d’aller dans un enseignement plutôt que dans l’autre. Selon la classe sociale à laquelle on appartient, la chose va de soi. Appartient-on à une classe aisée ? Le secondaire s’impose, préambule à des études de médecine ou de droit ; de lettres, d’histoire ou de géographie si l’on vise le professorat ; ou dans une grande école, si l’on est tenté par l’aventure naissante de l’industrie. Pour les classes populaires, immense majorité de la population, il n’est qu’une école, le primaire, vestibule de la vie active. Tel est d’ailleurs le message délivré par les autorités :
« Nous n’oublions pas que la plupart de nos élèves devront, dès qu’ils nous auront quittés, gagner leur vie par leur travail ; et nous voulons les munir des connaissances pratiques qui, dès demain, leur serviront dans leur métier. Nous n’oublions pas davantage que nous devons former en eux l’homme et le citoyen qu’ils seront demain. »2
Quant aux passerelles entre les deux ordres, elles resteront longtemps inexistantes, le programme des « petites classes » du secondaire et celui du primaire ne coïncidant pas. Lorsqu’ils s’aligneront, par un arrêté de 1926, l’âge minimum du certificat d’études (12 ans) ne correspondant pas à celui de l’entrée en 6e (11 ans), les instituteurs et les parents répugneront pendant longtemps à priver les enfants d’un bon diplôme à portée de main pour un baccalauréat fort lointain et rien moins qu’assuré…
Le troisième larron : l’enseignement technique
L’apprentissage, ancêtre de la formation technique
À moins de faire partie des rares enfants de favorisés suivant automatiquement la voie royale de l’enseignement secondaire, les jeunes Français, longtemps, n’eurent guère de choix que d’être paysans, artisans ou ouvriers. Le plus souvent, en vérité, ils n’avaient pas le choix du tout, chaussant les pantoufles du père – le fils de cordonnier devenait cordonnier, le fils de paysan devenait paysan et le fils d’ouvrier, ouvrier. Nul besoin dans ces conditions de suivre une formation, qui s’acquiert de fait au quotidien au sein de la famille. Pour qui souhaitait apprendre un autre métier que celui du père, il n’était qu’une voie : l’apprentissage, auprès d’un patron artisan. Commencé dès l’enfance, celui-ci s’achevait au bout de cinq ou six ans. Nanti de sa « quittance d’apprentissage », le jeune devenait compagnon. Puis, s’il travaillait bien et s’armait de patience, il pouvait espérer devenir à son tour patron.
Au tournant du XIXe siècle, survint la Révolution industrielle avec ses corollaires : progrès technique et développement de la grande industrie. Nous ne retracerons pas ici cette histoire mille fois détaillée ailleurs. La France, on le sait, fut longtemps à la traîne de l’Angleterre pour maintes raisons. Elle n’était pas la seule – l’Allemagne et les États-Unis ne furent guère plus précoces. Quoi qu’il en soit, cette nouvelle page de l’histoire signait le début de la crise pour l’apprentissage traditionnel. Car pour faire marcher les machines, les techniques ancestrales ne présentent guère d’utilité. La formation sur le tas, en usine, y suffit – avec en outre l’avantage d’être rémunéré, quand l’apprenti artisan, au contraire, doit payer des droits au patron.
Quelle formation pour travailler en usine ?
L’affaire, toutefois, devait vite se corser, quand les machines se perfectionnèrent et requirent des compétences pour être domestiquées. Une nouvelle question se posait : comment former des ouvriers qualifiés ? Et des chefs d’atelier, des contremaîtres pour les encadrer ?
Au fil du temps, diverses écoles professionnelles spécialisées qui dans le métal, qui dans le bois, se sont ouvertes çà et là, à l’initiative de municipalités ou de firmes industrielles. Mais c’est à la fin du XIXe siècle que la formation professionnelle commence à prendre forme. Créées respectivement en 1880 et 1892, les écoles nationales professionnelles (ENP) et les écoles pratiques de commerce et d’industrie (EPCI), rattachées au ministère du Commerce et de l’Industrie, ont pour vocation de répondre aux besoins de main d’œuvre qualifiée. On y entre sur concours, une fois son certificat d’études en poche. L’enseignement dispensé y est à la fois général (français, géographie, mathématiques…), théorique (physique, chimie…) et pratique (en atelier). Au bout de 3 ans pour les EPCI, 4 ans pour les ENP, on en ressort nanti d’un diplôme : le diplôme d’élève breveté (DEB) pour les ENP, le certificat d’études pratiques industrielles (CEPI) pour les EPCI. On a alors 16 ou 17 ans, et devant soi un avenir de contremaître ou de chef d’atelier. Si l’on a de grandes ambitions et le talent qui va avec, on peut aussi intégrer les Arts et Métiers et, pourquoi pas, préparer les grandes écoles et devenir ingénieur3.
Le casse-tête des ouvriers qualifiés
Créées à l’origine pour former des ouvriers qualifiés, les ENP et les EPCI ne s’acquitteront guère de cette tâche : très vite, leur programme ambitieux les destine à la formation de personnel d’encadrement. Mais pour bien encadrer des ouvriers, il faut avoir des ouvriers à encadrer… Et se pose de nouveau le même problème : comment former des ouvriers dotés d’une qualification plus poussée que les simples manœuvres ?
La question ne trouvera sa réponse qu’en 1919, avec la Loi Astier. Son principe : offrir une formation à tous les jeunes de moins de 18 ans qui travaillent en usine. À raison de 100 heures par an minimum, prises sur le temps de travail pendant 3 ans, les « cours professionnels » gratuits et obligatoires ne sont certes pas le Pérou, mais au moins les ouvriers acquerront-ils ainsi la culture technique minimale pour ne pas être désarmés devant leurs machines. Et les plus assidus pourront décrocher un diplôme : le CAP, créé en 1911. L’idée est simple. Encore faut-il qu’elle soit appliquée – et bien appliquée.
L’enseignement technique, grand frère de l’enseignement primaire
Récapitulons.
L’enseignement technique recrute ses éléments parmi les élèves issus de l’enseignement primaire.
Les moins bons élèves, ou ceux dont les familles ont le moins d’ambition ou de moyens, entrent en usine dès 13 ans, avec ou sans certificat d’études, et font leur apprentissage sur le tas. À partir de 1919, ils ont – théoriquement – non seulement le droit, mais l’obligation de recevoir 300 heures de formation.
Graphique 1. Le système éducatif français vers 1919-1920 (scolarité obligatoire jusqu’à 13 ans)
Source : création originale de l’auteur à partir de différentes sources.
Ces graphiques volontairement simplificateurs ont été conçus à des fins pédagogiques et ont une valeur strictement indicative. Ils ne prétendent pas rendre compte de façon exhaustive d’une réalité évolutive et complexe.
Les élèves munis du certif et désireux de poursuivre leurs études peuvent se présenter au concours régional des EPCI ou au concours interrégional des ENP pour suivre un enseignement technique poussé.
S’ils échouent, ou s’ils n’ont pas l’ambition d’aller si loin, ils peuvent intégrer une école primaire supérieure, ou un cran en dessous, le cours complémentaire de leur école. On leur y prodiguera une formation elle aussi axée sur la vie pratique et le métier – mais de moindre niveau.
On le voit : entre l’enseignement primaire et l’enseignement technique, il existe une forte connivence, même s’ils sont rattachés à deux ministères distincts – le primaire à celui de l’Instruction publique, le technique à celui du Commerce et de l’Industrie. L’enseignement technique permet aux meilleurs (ou aux plus aisés…) du primaire d’accéder à des postes d’encadrement.
Le secondaire, naturellement, n’entretient aucun lien avec cette filière technique. Temple de la grande Culture abstraite, théorique et dominée par les humanités, il ne prépare à l’industrie que ses futurs patrons ou cadres dirigeants, qui apprendront leur métier après le baccalauréat, dans une grande école d’ingénieurs. Si rencontre il y a entre anciens élèves du primaire et du secondaire, elle ne pourra se faire que dans une de ces grandes écoles, que quelques brillants sujets issus des classes populaires auront intégrée après l’ENP…
- 1. Voir Pierre Albertini, L’École en France du XIX e siècle à nos jours de la maternelle à l’université , Hachette, 1992 ; 2006, p. 37.
- 2. Instructions officielles du 20 juin 1923. Cité dans : Claude Lelièvre, Histoire des institutions scolaires (depuis 1789) , Nathan Pédagogie, 1990, p. 116.
- 3. Yves Malier, Reconnecter la formation à l’emploi. Le chômage des jeunes n’est pas une fatalité , Presses des Mines, 2017, p. 39.
L’école unique, ou la démocratisation introuvable
Une idée née dans les tranchées : l’école unique
Dans les tranchées de la Grande guerre, les obus et les poux, la boue et la mitraille, insensibles aux classes sociales, firent partager le même enfer aux fils de bourgeois, d’ouvriers et de paysans. De cette fraternisation dans la souffrance, on trouve divers témoignages dans la littérature, des Croix de Bois1 à Au revoir là-haut2 tout récemment. C’est là qu’une idée née quelque vingt ans plus tôt mûrit et prit forme dans le cerveau de jeunes universitaires sous les drapeaux : celle de l’École unique.
L’ambition des « Compagnons de l’université nouvelle » : remplacer l’enseignement de classe, fondé sur la fortune, par un enseignement fondé sur le mérite. Pourquoi le secondaire et ses nobles humanités seraient -ils réservés aux seuls fils de bourgeois, ni plus ni moins doués que les enfants du peuple ? L’école de la République doit permettre aux plus talentueux et aux plus méritants, d’où qu’ils viennent, d’intégrer les rangs de l’élite. Pour ce faire, quelques mesures de bon sens s’imposent : unifier les programmes des classes élémentaires du primaire et du secondaire ; prolonger l’âge de la scolarité obligatoire ; instaurer la gratuité de l’enseignement secondaire.
S’y ajoute une idée nouvelle qui déchaînera longtemps les passions : celle de l’« année d’orientation ». Son principe : observer les aptitudes des élèves, afin de les orienter par la suite dans les voies qui leur correspondront le mieux. Les Compagnons situaient cette année clé en fin de primaire. Le comité qui donnera forme à leur idée au tournant des années 1920 la place en 6e. C’est l’acte de naissance de l’orientation et de l’égalité des chances.
Qu’on ne s’y trompe pas : il ne s’agit nullement de faire accéder au secondaire tous les enfants de France. Seuls ceux qui en auront été jugés capables, sur la base de leur dossier et d’un examen, franchiront la porte du lycée. Que deviendront les autres, les nombreux recalés ? Pour ceux-là aussi, le programme de l’école unique nourrit des ambitions. Élevant à 15 ans l’âge de la scolarité obligatoire, il prévoit de les envoyer tous dans les cours complémentaires du primaire, où ils recevront conjointement un enseignement général et un enseignement professionnel, qui les armeront pour la vie active.
Élever le niveau d’instruction des enfants du peuple, permettre aux plus doués d’entre eux d’accéder aux rangs de l’élite… Comparée au « collège unique » et aux « 80 % d’une génération accédant au baccalauréat », l’ambition des Compagnons semble bien modeste. Elle n’en est pas moins révolutionnaire. Pour la première fois, primaire et secondaire sortent de leur ignorance mutuelle. Ils vont désormais entrer en compétition.
L’école unique rêvée par les Compagnons de l’université nouvelle connaîtra bien des avatars au fil du XXe siècle. Narrer par le menu les innombrables rebondissements de cette course à la démocratisation n’a pas ici grand intérêt. Attachons-nous plutôt à camper les forces en présence, et à identifier clairement les enjeux.
L’école unique… mais quelle école ?
Pendant une trentaine d’années, les trois ordres d’enseignement – primaire, secondaire, technique – se sont ignorés. Dès lors qu’il est question d’école unique, cette ignorance mutuelle ne peut perdurer. Unique, soit… Mais que met-on dans l’enseignement commun ? Qui est habilité à le délivrer ? Jusqu’à quel âge faire durer la partie commune de l’enseignement ? À quel âge orienter les élèves ? Selon quels critères ? Qui décide de cette orientation ? Autant de points de dissension entre les divers acteurs concernés.
Comment chacun des trois ordres perçoit-il sa spécificité ?
Pour les acteurs de l’enseignement secondaire, il va de soi que l’enseignement d’excellence, le meilleur, le plus accompli, le plus désirable qui soit, est… l’enseignement secondaire. Abstraction, théorie, amour désintéressé de la connaissance : il s’agit d’acquérir une culture – la culture –, non de se préparer à la vie active. Emblème de cet enseignement, le latin, qui ne « sert » à rien, est la matière noble par excellence. On s’y attelle dès l’entrée en 6e.
Pour les acteurs de l’enseignement primaire, l’école conçue par Jules Ferry remplit excellemment son rôle : préparer les enfants du peuple à entrer dans la vie active et à devenir des citoyens éclairés. Cet enseignement, éminemment pratique, n’apprend aux élèves que ce dont ils auront besoin et qui va leur servir. C’est vrai des petites classes, encore plus des CC et des EPS, qui ménagent une large ouverture à la préparation aux métiers.
Pour les acteurs de l’enseignement technique, ce dernier est une culture en soi, dotée d’une authentique noblesse. Non content de préparer les jeunes à des métiers, il constitue une forme d’humanisme : « L’enseignement technique est entre le métier et l’homme, entre les exigences professionnelles et les droits imprescriptibles de tout esprit et de tout cœur humain », écrit Hippolyte Luc, directeur de l’Enseignement technique3.
Voilà des opinions rien moins que concordantes. On notera que le secondaire seul se perçoit comme universel : à ses yeux, la culture qu’il enseigne est l’unique, et il n’est de bon enseignement que détaché de toute finalité pratique. Tant que les trois ordres menaient leur vie chacun de son côté, ces divergences ne posaient aucun problème. Mais en 1920, l’Enseignement technique quitte le giron du ministère de l’Industrie pour passer sous tutelle de l’Instruction publique. Et en 1936, le nouveau ministre de l’Éducation nationale4, Jean Zay, acquis aux idées des Compagnons de l’université nouvelle, se pique de les appliquer…
Comment sont perçues les idées nouvelles – égalité des chances, orientation ?
Pour la gauche progressiste, la noblesse et l’excellence de l’enseignement secondaire impliquent, au nom de la justice, que tous les élèves ayant les aptitudes nécessaires puissent en profiter. Ces aptitudes ne se révélant que tardivement chez certains enfants, il est souhaitable de leur donner du temps avant de les orienter, et de ménager des passerelles pour de futures reconversions. Quant aux jeunes exclus de cette filière d’excellence, on prendra soin d’intégrer une part non négligeable d’enseignement général dans leur emploi du temps, toujours au nom de la justice sociale.
Pour les classes favorisées et plus généralement la droite la noblesse et l’excellence de l’enseignement secondaire impliquent que leurs enfants, doués ou pas, doivent y avoir accès sans condition. Pas question que les pédagogues et autres psychologues se mêlent d’orienter les élèves en fonction de leurs « aptitudes ». C’est aux parents qu’il revient de décider des études de leurs enfants.
Pour une partie des enseignants du secondaire (SNES, Syndicat des agrégés), la noblesse et l’excellence de l’enseignement secondaire impliquent qu’on n’y doit surtout rien changer. Pas question de modifier le programme, fût-ce sur une seule année. Tout tronc commun repoussant à plus tard l’entrée dans les humanités classiques est donc exclu.
Les instituteurs du primaire sont prêts à tout considérer tant qu’on n’empiète pas sur leur territoire. L’allongement de la durée de scolarisation leur convient à merveille, dès lors que leurs classes post-Certificat d’études (CC, EPS) ne sont pas menacées. Leur cauchemar : se voir peu à peu cantonnés aux classes élémentaires.
Et le technique, dans tout cela ?
À l’origine, la formation technique était l’affaire du ministère de l’Industrie, et donc des patrons. Et voilà qu’elle est rattachée au ministère de l’Instruction publique, devenant la « Direction de l’Enseignement technique »…
La situation. La « filière technique » est disparate et éclatée : écoles professionnelles diverses – municipales, patronales, EPCI, ENP – pour le plus haut niveau de qualification ; cours professionnels en usine, destinés aux jeunes ouvriers et apprentis… Et elle n’est absolument pas centralisée. Selon les régions, les municipalités, les entreprises, le contenu des formations varie, souvent pour s’adapter aux besoins locaux ; leur qualité aussi.
C’est surtout vrai des cours professionnels, idéalement sanctionnés par un CAP. Quoiqu’obligatoires, ils ne sont que peu suivis. Certains patrons, les jugeant inutiles, se dispensent d’en ouvrir, ou se gardent bien d’inciter leurs jeunes ouvriers à les suivre. Quant à leur contenu, on y trouve de tout, les patrons se contentant souvent de l’ajuster aux besoins de leurs ateliers. Que l’ouvrier aille se faire embaucher ailleurs, et sa formation, bien trop spécialisée, ne lui sert plus à rien…
Le ministère a un rêve : intégrer la filière technique dans le moule de l’Éducation nationale. Ce qui signifie réunir les diverses écoles en une seule filière, la filière technique, bâtie sur le même canevas que l’Enseignement secondaire, afin de ménager des passerelles entre secondaire et technique à tous les niveaux. Qui dit passerelles dit une partie d’enseignements communs… Il s’agit donc de renforcer dans le technique la part d’enseignement théorique et général.
Quant à la formation technique des jeunes ouvriers, ces cours professionnels menant au CAP, le ministère souhaite y mettre bon ordre. D’abord, en obligeant tous les patrons à appliquer la loi. Ensuite, en augmentant le nombre d’heures de cours. Peu à peu se dessinera l’idée de créer des centres d’apprentissage gérés par l’Éducation nationale, qui pourrait à sa guise statuer sur les programmes – en y insérant une bonne part d’enseignement général…
La direction de l’enseignement technique a un rêve : demeurer autonome. La formation technique doit être articulée sur les réalités du monde économique, et pour ce faire maintenir des relations étroites avec les professionnels et les entreprises. Or, l’Éducation nationale ignore tout du monde économique. L’enseignement technique doit donc conserver toute son autonomie par rapport à l’enseignement général : il y va de son salut. C’est ce que fait valoir en 1936 le directeur de l’Enseignement technique, Hippolyte Luc, en accord avec le monde de l’entreprise.
Voici la photographie de la situation telle qu’elle se présentait en 1936, sous le Front populaire, lorsque le ministre de l’Éducation nationale, Jean Zay, proposa son projet de loi. Celui-ci ne fut pas accepté – et la guerre survint. Jusqu’à l’avènement de la Ve République, d’innombrables mesures seront prises. Certaines seront éphémères, aussitôt annulées par le ministère suivant ; d’autres demeureront. Quoi qu’il en soit, les enjeux sont posés, et les arguments des divers protagonistes varieront peu. S’opposent tout à la fois des intérêts et des représentations.
Les intérêts en jeu
Née à la fin de la Grande guerre, l’idée d’une école plus juste, fondée sur l’égalité des chances et l’orientation de chacun suivant ses aptitudes, pouvait difficilement être rejetée. Qui souhaiterait s’embrigader sous le drapeau de l’injustice ? Toutefois, dans chaque camp, on est prompt à dénoncer chez l’autre les motivations purement intéressées qui pointent derrière les nobles argumentations. Intérêts corporatistes, politiques, économiques…
Le patronat est soupçonné (par la gauche marxiste) de n’œuvrer que pour son profit. Invoquant les nécessités économiques, le patronat plaide pour des formations spécialisées ? C’est pour pouvoir embaucher directement des ouvriers prêts à l’emploi. S’il rechigne devant l’introduction d’un enseignement théorique et général dans la formation technique, et donc refuse toute mainmise de l’enseignement secondaire sur la formation technique, c’est pour s’assurer une main d’œuvre docile et bon marché.
Les instituteurs sont soupçonnés (par le secondaire) de n’œuvrer que pour leur corporation. S’ils prétendent être les plus à même d’enseigner dans le tronc commun, sous prétexte qu’ils sont plus proches des classes populaires et connaissent mieux leurs attentes, c’est qu’ils ont peur de se retrouver cantonnés aux seules petites classes.
Les enseignants du secondaire sont soupçonnés (par le primaire) de n’œuvrer que pour leur corporation. Ils veulent maintenir le latin en 6e ? C’est pour ne pas perdre une année de leur précieux enseignement. Ils prétendent que les élèves ont droit dès la 6e à des cours d’excellence, dispensés par des spécialistes? C’est pour mettre la main sur le tronc commun.
Les réformistes sont soupçonnés (par la bourgeoisie) d’être des idéologues. Ils veulent confier aux professeurs le soin d’orienter les élèves ? C’est pour se substituer aux parents et renverser l’ordre de la société.
Les représentations
Quelle est la mission de l’enseignement ? Qu’est-ce que la culture ? Qu’est-ce que l’intelligence ? Dès lors qu’il est question d’école unique et d’orientation, il importe que tous les acteurs parlent le même langage. Or, c’est bien loin d’être le cas, et les représentations qui suivent restent d’actualité près de quatre-vingts ans plus tard.
L’enseignement doit préparer à un métier. Les matières enseignées doivent avoir une finalité pratique. Telle est la vision qu’ont longtemps partagée le primaire et l’enseignement technique. Et pour cause : l’un et l’autre ont eu pour première mission de mener leurs élèves à la vie active.
L’enseignement doit être détaché de toute finalité pratique. C’est ce qui fait son excellence et sa noblesse. Telle est la vision du secondaire. Et pour cause : originellement, il a pour mission de préparer ses élèves à l’Université, laquelle a pour mission de former des chercheurs ou des spécialistes.
Il n’y a qu’une culture : la « grande » culture humaniste. Pour l’enseignement secondaire et les classes dominantes qui ont seules le privilège de le suivre, ce sera longtemps une évidence. Elle s’est ancrée dans la société.
Il y a plusieurs cultures : la culture humaniste, mais aussi la culture scientifique, la culture technique… Selon Jean-Pierre Dupuy, il semble que cette vision soit en France encore étonnamment peu partagée, malgré les efforts pédagogiques de philosophes comme Simondon.
Il n’y a qu’une intelligence : celle qui permet de manipuler des idées et de raisonner. C’est la vision de nombreux intellectuels. Marxistes et bourdieusiens en feront un cheval de bataille : selon eux, distinguer plusieurs formes d’intelligence est un subterfuge politique pour dispenser à certains un enseignement au rabais et les maintenir dans le prolétariat.
Il y a deux types d’intelligence : l’intelligence abstraite, l’intelligence concrète. Les enseignants du technique, notamment, en sont convaincus depuis toujours, et préconisent une pédagogie adaptée (cf. Aziz Jellab5). Une variante oppose « intellectuels » et « manuels ».
Avec de telles divergences, allez-vous en « démocratiser l’enseignement » !
Graphique 2. Le système éducatif français vers 1955 (scolarité obligatoire jusqu’à 14 ans)
Source : création originale de l’auteur à partir de différentes sources.
Ces graphiques volontairement simplificateurs ont été conçus à des fins pédagogiques et ont une valeur strictement indicative. Ils ne prétendent pas rendre compte de façon exhaustive d’une réalité évolutive et complexe.
Orientation ? Vous avez dit orientation ?
Particulièrement emblématiques de ces divergences sont les avatars de l’« enseignement manuel ». En toute logique, dès lors qu’on entend orienter les enfants selon leurs aptitudes, ils convient de se donner les moyens de détecter celles-ci. Soient trois filières : littéraire, scientifique, technique. Sur quels critères orienter les enfants vers la troisième ? En observant leur rapport à la matière, aux divers objets techniques. Or, les rares tentatives d’instaurer un enseignement manuel ont fait long feu.
Les 172 « classes d’orientation » tests créées par Jean Zay, dans lesquelles collaborent les enseignants du primaire, du secondaire et du technique, n’auront pas de suite. L’enseignement manuel introduit par Vichy en primaire comme en secondaire, pas davantage. Quant au plan Langevin-Wallon, qui préconise un tronc commun jusqu’en 5e avec une large part dévolue aux travaux manuels, il ne sera pas adopté. L’orientation se donne les moyens de distinguer les aptitudes littéraires des aptitudes scientifiques. Mais les aptitudes techniques, point.
Les appels récurrents à la revalorisation du travail manuel et des filières techniques ne font que traduire l’impuissance des pouvoirs publics à accorder à ces dernières une place équivalente à celle des filières littéraires et scientifiques. Leur impuissance – ou leur absence de réelle conviction…
La situation en 1959
À l’aube de la Ve République, la démocratisation a progressé. Si les trois ordres restent distincts, les lignes ont bougé.
1926 – Finies, les classes élémentaires à deux vitesses. Les programmes du primaire et du secondaire ont été unifiés et l’enseignement confié aux seuls instituteurs. Mais le secondaire conserve ses classes élémentaires, qui demeurent payantes.
1933 – Fini, le secondaire payant de la 6e à la Terminale. La scolarité y est désormais gratuite.
1936 – L’âge de fin de scolarisation obligatoire est passé à 14 ans. Si l’effet sur le secondaire est nul, puisque celui-ci a pour vocation de mener les élèves jusqu’au baccalauréat, le primaire quant à lui se voit pourvu d’une année supplémentaire obli- gatoire : la classe de fin d’études primaires, consacrée à l’orientation professionnelle de ses élèves.
1941 – Le secondaire a posé son empreinte sur le technique. Les EPCI et diverses écoles professionnelles, tout en lui restant rattachées, ont été secondarisées et rebaptisées « collèges techniques », pour anoblir la filière technique. Seules ont échappé à cette opé- ration les ENP, les plus sélectives et les plus convoitées des écoles techniques. Toutes donnent désormais accès au baccalauréat – le « baccalauréat technique », créé en 1946, là encore par un souci d’anoblissement.
1942 – Le secondaire a croqué un morceau de primaire – lequel, paradoxalement, ne s’en porte que mieux. Les écoles primaires supérieures, enlevées au primaire, ont été intégrées au secondaire et rebaptisées « collèges modernes ». Elles conduisent à un baccalauréat sans latin. Curieusement, cette mesure a eu pour effet imprévu de faire grimper en flèche les effectifs des cours complémentaires, demeurés dans le primaire. Preuve qu’à choisir entre enseignement primaire et secondaire, les familles populaires plébiscitent le premier… Si leur enfant réussit bien, à l’issue du primaire, ils peuvent lui faire prolonger sa scolarité en seconde, jusqu’au baccalauréat, et ne s’en privent pas. La démocratisation est en marche… Et la concurrence entre les deux ordres, primaire et secondaire, plus féroce que jamais.
1949 – L’Éducation nationale possède désormais son apprentissage : les « centres d’apprentissage ». Hérités de Vichy (CFP), les centres d’apprentissage font florès, tant par leurs effectifs que par les embauches à la sortie. On y entre sur concours, après les petites classes du primaire, pour y préparer un CAP. Des écoles spéciales, les ENNA, ont été créées pour former leurs enseignants aux méthodes les plus en pointe, souvent inspirées de l’étranger (psychopédagogie). Si l’Éducation nationale, officiellement, a seule la main sur ces centres, les professions jouent un rôle essentiel dans leurs programmes et leur orientation, à travers les commissions nationales pro- fessionnelles consultatives (CNPC). Un équilibre semble avoir été trouvé…
1959 – L’âge de fin de scolarisation obligatoire est porté à 16 ans.
Mais la démocratisation est loin d’être achevée. Il reste encore un grand pas à franchir : créer le tronc commun rêvé par les Compagnons de l’université nouvelle, tenté sans succès par Jean Zay en 1936, et sur lequel une dizaine de réforme ont achoppé tout au long de la IVe République, faute de consensus entre les diverses parties…
- 1. Roland Dorgelès, Les Croix de bois , Albin Michel, 1919.
- 2. Pierre Lemaître, Au revoir là-haut , Albin Michel, 2013.
- 3. Bernard Charlot et Madeleine Figeat, Histoire de la formation des ouvriers. 1789-1984 , Minerve, 1985, p. 275.
- 4. Le ministère de l’Instruction publique a été rebaptisé ministère de l’Éducation nationale en 1932.
- 5. Aziz Jellab, L’Émancipation scolaire. Pour un lycée professionnel de la réussite , Presses Universitaires du Mirail, 2014.
La longue marche vers le collège unique, ou la démocratisation ratée
Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la grande réforme de l’enseignement se cherche et ne se trouve pas. L’urgence est là, pourtant : avec l’essor fulgurant du progrès technique, la France a besoin de gens bien formés pour développer son industrie, depuis les ingénieurs jusqu’aux ouvriers qualifiés. La main d’œuvre compétente manque cruellement, faute de formation. Les citoyens eux-mêmes sont en demande d’instruction pour leurs enfants, rêvant de promotion sociale pour profiter pleinement de l’élévation du niveau de vie. La Ve République va prendre les choses en main. Tambour battant, l’éducation est réformée de fond en comble.
L’objectif : augmenter le niveau d’instruction générale. Aller chercher tous les talents, partout où ils se cachent. L’orientation doit enfin se donner les moyens d’aiguiller chaque enfant vers la meilleure place à laquelle il puisse accéder. Première mesure prise en 1959 : l’âge de la scolarité obligatoire est porté à 16 ans.
La mainmise du secondaire sur le cycle d’orientation
Pour observer, puis orienter les élèves en fonction de leurs aptitudes, il faut, pendant un temps – un an, deux ans ou davantage… – leur dispenser un enseignement commun permettant à chacun de se révéler. Cet enseignement commun, il faut des enseignants également qualifiés pour le leur dispenser. Quel enseignement ? Quels professeurs ? L’affaire n’est pas simple.
Les données d’un casse-tête
Deux corps d’enseignants sont en concurrence sur la tranche d’âge des plus de onze ans : les instituteurs, polyvalents, dont les cours complémentaires en école font le plein dans les classes populaires ; les professeurs du secondaire, spécialisés, qui ont depuis toujours le monopole de la 6e jusqu’à la terminale dans leurs lycées et leurs collèges. Dès lors que tous les élèves, sans distinction, ont le droit à une phase d’observation, qui les observera ? Et où ?
Le casse-tête du latin. Fleuron de l’enseignement secondaire, il débute en 6e depuis… 1880. Si l’on n’y change rien, pour «observer » les élèves avant de les orienter, il faudrait à tous le leur enseigner, afin qu’ils se trouvent à égalité. Or, les instituteurs n’ont jamais appris le latin. L’autre option – repousser le latin d’une année ou deux – n’est même pas envisageable, les parents et les professeurs des enfants du secondaire crieraient au sacrilège.
Mais le latin n’est qu’un symptôme, une partie du problème. Les autres disciplines sont, elles aussi, concernées. Car les instituteurs, polyvalents, ne sont spécialistes d’aucune matière. Ils n’ont pas étudié à l’université. Les professeurs du secondaire, au contraire, ont consacré plusieurs années d’études supérieures à une discipline (lettres classiques, langue vivante, mathématiques, histoire-géographie). Nombre d’entre eux sont titulaires de l’agrégation. Ces deux corps sont-ils également légitimes à enseigner en cycle d’orientation ? Sinon, lequel des deux y a sa place ?
Tout dépend en définitive de l’enseignement que l’on estime convenir aux élèves dans une perspective de massification. L’enseignement de type primaire – pratique, orienté vers la vie active ? L’enseignement de type secondaire, visant à préparer au baccalauréat, à l’université, et, de ce fait, privilégiant la théorie, l’abstraction et la « grande culture » ? Un enseignement combinant habilement les deux ? En termes de qualité, autant chercher à comparer une pomme et un gâteau. Un professeur de lycée est certes plus savant qu’un instituteur dans sa spécialité. Mais les classes populaires attendent-elles qu’on fasse de leurs enfants des savants ?
Oui, répondent les uns :
« Pour les enseignants du secondaire, convaincus de l’excellence de leur enseignement et de l’universalité de leur culture, la vraie démocratisation consiste à donner aux enfants du peuple ce qu’il y a de meilleur, c’est-à-dire à les intégrer dans le secondaire tel qu’il est. Modifier celui-ci pour les accueillir, ce serait leur donner une culture au rabais, et ils s’y refusent avec une sincère énergie. »1
Non, répondent les praticiens du primaire, accoutumés à accueillir dans leurs classes les enfants du peuple :
« Ce qui convient à la masse de la population, ce que demandent les familles et attendent les élèves, ce n’est pas cette culture prestigieuse mais intimidante, désincarnée et lointaine. C’est un enseignement plus concret, plus proche des préoccupations quotidiennes des élèves, plus attentif à leurs débouchés professionnels. »2
C’est là ce qui s’appelle un conflit de représentations.
L’excellence pour tous
Les cours complémentaires deviennent CEG
La voie des enseignants du secondaire l’emportera. Certes, Paris ne s’est pas fait en un jour et il y eut bien des étapes dans cette « secondarisation » de l’enseignement.
La transformation des « cours complémentaires » en « collèges d’enseignement général » (CEG), entérinée par le décret Berthoin en 1959, est un premier pas, symboliquement très fort : le mot collège désigne en effet traditionnellement un établissement secondaire. Les classes des anciens CC du primaire se nomment dorénavant 6e, 5e, 4e et 3e. Leurs instituteurs y enseignent toujours. Tout comme les professeurs dans les lycées, ils ont pour tâche d’observer pendant deux ans, portés à quatre par la réforme Fouchet en 1963, les élèves issus du CM2 avant de les orienter. Mais dans ces CEG, il n’y a évidemment pas de latin, la matière royale, et l’enseignement dispensé par les instituteurs, différent de celui des professeurs, ouvre peu aux filières « longues » : soit la scolarité s’achève en fin de 3e, soit elle conduit en filière professionnelle ou technique. L’orientation est donc biaisée. Seul le lycée donne accès à toutes les voies.
Le primaire change de fonction
Avec la transformation des cours complémentaires en CEG intégrés au secondaire, l’enseignement « primaire » se trouve désormais cantonné aux petites classes – du CP au cours moyen. Ajoutez à cela l’âge de la scolarisation prolongé à 16 ans : exit le Primaire d’antan, censé doter l’enfant du lourd bagage de connaissances nécessaire pour entrer dans la vie active. Dorénavant, le primaire sera l’antichambre du collège, où, comme on va le voir, le modèle dominant va devenir la préparation au lycée. Ce qui change du tout au tout la finalité du primaire.
L’éviction des instituteurs
Rapidement, les instituteurs des CEG se voient sommés par la réforme Fouchet (1963) de suivre une formation complémentaire, le CAPCEG, pour enseigner en 6e et au-delà. Quelques années plus tard (1969), ils quitteront leur corps pour rejoindre celui des enseignants du secondaire avec le titre de « PEGC », dorénavant spécialisés dans deux disciplines.
Dans le même temps, pour faire face à la montée prodigieuse des effectifs, l’Éducation nationale crée les CES, « collèges d’enseignement secondaire » – à distinguer des collèges d’enseignement général mentionnés supra, qui ne comportent pas de filière classique. De la 6e à la 3e, les classes du premier cycle des lycées migrent dans ces nouveaux établissements qui poussent comme des champignons – jusqu’à un par jour ! On y a grand besoin de professeurs : l’Éducation nationale recrute à tour de bras des certifiés.
Les instituteurs ont donc disparu du secondaire. Le professeur de CES est un PEGC (« professeur d’enseignement général de collège »), plus souvent un certifié ou un agrégé. Or, rien n’a changé dans la formation de ces deux dernières catégories. Dissertations, leçon d’agrégation : bien que le public n’ait plus rien de commun avec celui du lycée d’autrefois, l’excellence académique demeure la condition unique du succès aux concours qui donnent accès à l’enseignement. Aussi les professeurs mettent-ils un point d’honneur à refuser toute concession dans leurs exigences et toute adaptation de leur pédagogie à leur nouveau public : pas question que la massification les fasse déroger à leur mission d’excellence. Partageant leurs bancs avec les fils de bourgeois, les enfants du peuple profiteront de l’enseignement de ces derniers.
Le secondaire a bel et bien gagné. Cantonné aux classes élémentaires (CP-CM2), le primaire prépare au secondaire. Les classes d’observation sont confiées aux professeurs, dans des collèges.
Et les élèves en difficulté ?
Longtemps, pour les très nombreux élèves du primaire qui ne désiraient (ou ne pouvaient) pas prolonger leur scolarité après le certificat d’études, la voie toute tracée fut celle de l’apprentissage – en usine, où ils s’embauchaient dès leurs 14 ans, ou dans les centres d’apprentissage.
À partir de 1959, avec la scolarité obligatoire prolongée jusqu’à 16 ans, plus question de s’embaucher à 14 ans. Or, avec la meilleure volonté du monde, le décret Berthoin n’y peut rien changer : certains élèves, à l’issue du primaire, n’ont pas le niveau nécessaire pour entrer en 6e et suivre le programme du secondaire. Leurs connaissances de base, lacunaires, ont besoin d’être consolidées.
C’est aux instituteurs qu’il revient d’y remédier. Dans un premier temps, ces élèves demeureront à l’école, où ils suivront deux années supplémentaires de primaire. S’ils ont rattrapé leur retard, ils rejoindront leurs camarades sur les bancs du collège. Sinon, ils bifurqueront vers la voie professionnelle (voir infra).
Avec la réforme Fouchet (1963), ces classes de mise à niveau destinées aux « écoliers médiocrement doués »3 migrent, elles aussi, dans les CES. Étendues à 4 ans, elles prennent le nom de « classes de transition » pour la 6e et la 5e, suivies de « classes terminales pratiques » pour la 4e et la 3e. C’est là encore aux instituteurs qu’est confié cet enseignement. Comme leur nom l’indique, les terminales pratiques se caractérisent par « une formation générale de caractère concret »4, préparant à la vie active. Sanctionnée par un diplôme, le DFEO (diplôme de fin d’études obligatoires), la terminale pratique marque pour ces élèves (16 % des enfants scolarisés en premier cycle en 1970) la fin de l’école. L’immense majorité d’entre eux entreront en usine, en tant qu’ouvriers spécialisés, dès l’âge de 16 ans.
Voici donc réunis dans le même établissement des élèves qui ne s’étaient jamais côtoyés : les uns, latinistes le plus souvent, promis à un brillant cursus – le bac, l’université ou les grandes écoles ; les autres, dont chacun sait, à commencer par eux, que faute d’« avoir le niveau », ils sont destinés à presser des boutons en usine. Aux meilleurs de ces élèves, les professeurs. Aux moins bons, les instituteurs.
L’Éducation nationale se réjouit de cette mixité, raison d’être des CES : « Pour la première fois, au-delà de l’école élémentaire, des enfants d’origines diverses et promis à des destinées diverses fréquenteront les mêmes établissements et apprendront à mieux se connaître pendant cette période décisive pour la formation de l’homme. »5 Pourtant, démocratisation commence déjà à rimer avec relégation…
La « secondarisation » de l’enseignement professionnel et technique
C’était le rêve de l’Éducation nationale : réunir sous sa houlette l’ensemble de l’enseignement technique pour l’introduire dans le moule du secondaire. Avec la loi FouchetCapelle (1963), le rêve devient réalité.
L’apprentissage
Les CET
Adieu, les « centres d’apprentissage » : les voici devenus CET – collèges d’enseignement technique. Alternant enseignement en atelier et enseignement général, ils constituent la « voie professionnelle » qui mène au CAP. Au gré des divers ministères, on y entrera dès la fin de 5e, ou seulement après la 3e. Tant il est vrai que bien avant la réforme Haby, la tentation est déjà forte de repousser toute orientation vers la voie pro le plus tard possible. C’est ainsi que le CAP se préparera tantôt en trois ans (1959), tantôt en deux (1963), puis de nouveau trois (1971), puis deux (1975)…
Les CFA
Dans le même temps, en 1961, les cours professionnels en entreprise dispensés aux jeunes ouvriers changent de nom et sont rebaptisés CFA, « centres de formation d’apprentis ». Le nombre d’heures de cours obligatoires a beau être considérablement augmenté (360 heures par an minimum au lieu de 200), en ce début d’années 1960, c’est la formation « made in Éducation nationale », les CET, qui a le vent en poupe. L’apprentissage sur le tas fait l’unanimité contre lui : pour les technocrates, il a vécu, l’ouvrier de demain étant l’ouvrier doté d’une solide formation technique. De leur côté, les enseignants comme les ouvriers dénoncent par la voix de leurs syndicats une survivance honteuse de l’exploitation de la jeunesse par le patronat6. Bref, l’apprentissage en usine semble voué à disparaître. Reste à savoir si le CET saura répondre aux attentes.
La filière technique
Quant à la filière « technique » – les écoles professionnelles de naguère – elle se trouve entièrement unifiée sous l’appellation de « lycées techniques ». Les « collèges techniques » instaurés par Vichy se trouvent ainsi rebaptisés – ô valse des appellations ! Mais si ce changement de nom a pour ces derniers des allures de promotion, il n’en va pas de même pour les ENP, ces prestigieuses écoles nationales professionnelles accessibles par concours, ambition suprême des techniciens. En devenant, elles aussi, des « lycées techniques », elles perdent tout à la fois leur prestige et leur singularité. La subtile hiérarchisation du technique de naguère, qui offrait aux plus méritants des perspectives d’ascension sociale, a disparu7.
Finis, les concours difficiles à l’issue du primaire : on entre désormais en lycée technique après la classe de troisième, passé le cycle d’orientation. Et l’on y prépare son baccalauréat.
Les « trois ordres » autonomes sont bien morts. Le primaire n’est plus désormais que l’antichambre du secondaire. Le technique est en partie secondarisé. Le ministère de l’Éducation nationale peut se féliciter : tout ou presque est en place pour que l’ensemble des enfants de France accèdent désormais aux études, puis à une place dans la société adaptée à leurs aptitudes et à leurs talents. Or, dès avant les années 1970, des signes alarmants surgissent, et l’on découvre des obstacles que l’on n’avait pas prévus.
Graphique 3. Le système éducatif français vers 1970-1971 (scolarité obligatoire jusqu’à 16 ans) (gratuit)
Source : création originale de l’auteur à partir de différentes sources.
Ces graphiques volontairement simplificateurs ont été conçus à des fins pédagogiques et ont une valeur strictement indicative. Ils ne prétendent pas rendre compte de façon exhaustive d’une réalité évolutive et complexe.
Des grains de sable dans la belle mécanique
Des inégalités qu’on ne soupçonnait pas
C’est d’abord un fait stupéfiant, un lièvre colossal que lèvent deux sociologues, Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, dans deux ouvrages parus respectivement en 1964 et 1969, Les Héritiers : les étudiants et la culture, et La Distinction : éléments d’une théorie du système d’enseignement. Des Compagnons de l’université nouvelle à Langevin et Wallon en passant par Jean Zay, les réformateurs de l’école unique en avaient toujours été persuadés : pour permettre l’égalité des chances, il faut et il suffit d’offrir à tous les enfants, d’où qu’ils viennent, l’accès à l’instruction. En leur donnant le temps de révéler leurs talents, on les orienterait vers la voie qui leur convenait.
C’est là, disent Passeron et Bourdieu, omettre un facteur essentiel : les inégalités commencent au berceau. Certains, les héritiers, naissent dans un milieu cultivé, pétri de références et maîtrisant pleinement les subtilités du discours. Les autres, les innombrables autres, non.
Or, l’école unique dont on a à la hâte bâti les fondements dès 1959 repose sur une conviction : la vraie culture, celle dont il convient de faire profiter tous les enfants, est celle qui fut dès l’origine l’apanage du Secondaire, lui-même initialement conçu pour les « héritiers ». Celle qui repose sur les humanités, la théorie et l’abstraction. Les enfants des milieux favorisés, qui en ont sucé le lait dès leur venue au monde, s’y trouvent tout à leur aise. Ceux des classes populaires n’en possèdent pas le premier rudiment. Elle leur est parfaitement étrangère.
Sur les bancs de l’école unique, les enfants sont donc inégaux, les uns détenant un bagage que les autres n’ont pas. Dans la course désormais commune, les seconds démarrent avec un handicap.
Un secondaire inadapté à son nouveau public
Les faits, très vite, corroborent cette analyse. Le cycle d’orientation, censé aiguiller chacun selon ses talents, ne fait que reproduire les inégalités sociales. En collège d’enseignement technique et dans les classes de transition se retrouvent pour l’essentiel les enfants d’ouvriers. Les enfants de bourgeois prospèrent en cycle long, qui a pour vocation de conduire au baccalauréat. Comparée aux scores des années 1950, la proportion d’ouvriers qui décrochent leur bac n’a guère augmenté. Pire : alors qu’elle croissait régulièrement jusqu’en 1959, elle se met à stagner. L’historien de l’éducation Antoine Prost explique aisément cette aberration : avant les grandes réformes Berthoin et Fouchet, les plus brillants élèves des cours complémentaires, BEPC en poche, enhardis par leurs résultats, n’hésitaient pas à tenter leur chance en lycée. Ils rejoignaient en seconde les fils de bourgeois dans une filière moderne sans latin8.
Désormais ne subsiste qu’une pédagogie : celle du secondaire. Or, elle s’avère inadaptée à son nouveau public. Dans les classes de collège, notent les sociologues qui enquêtent sur le terrain, les professeurs se plaignent de chahuts d’un type nouveau – jusque dans les matières jugées essentielles. Et pour cause : en 1972, une enquête de la Cofremca révèle que selon 77 % des professeurs, « les élèves ne voient pas l’utilité de ce qu’on leur enseigne9. » Triste bilan.
Réformer la pédagogie ? Pour les inspecteurs généraux, il n’en est pas question. Massification de l’enseignement ou pas, ils gardent le même cap : ne rien sacrifier des exigences du passé. Quant aux professeurs, dans leur majorité, ils n’ont qu’une obsession : maintenir la place de leurs disciplines respectives dans des programmes hypertrophiés10. En mars 1968, un grand colloque organisé par l’AEERS à Amiens et réunissant 600 personnes tire pourtant le signal d’alarme : les enseignements, conclut-il, sont aujourd’hui totalement inadaptés. Il est urgent d’opérer « une rénovation éducative aussi bien que pédagogique. » Quelques aménagements n’y suffiront pas, ajoutent les participants réunis. Si déchirant que ce soit, le temps est venu de réviser la conception même de l’école. Et en particulier, de « renoncer à une conception exclusivement intellectualiste et encyclopédique de la culture »11.
Le salut par les mathématiques ?
Mais après tout, les choses ne sont peut-être pas si graves… Car depuis les années 1950, une révolution s’opère à bas bruit : les sacro-saintes humanités, longtemps pierre angulaire du secondaire, sont en train de se faire détrôner par une autre matière : les mathématiques. C’est le sens de l’histoire. Occupée à se reconstruire pendant quelques décennies – les Trente Glorieuses –, la France de l’après Seconde Guerre mondiale a bien conscience que son salut ne passera pas par Cicéron, Ovide ni Aristophane. Dans la course au progrès technique, elle doit jouer efficacement sa partie. Et, pour y parvenir, c’est de technologie, de science qu’elle a besoin. D’excellents ingénieurs et de techniciens.
Bien avant la réforme Berthoin, déjà, le baccalauréat scientifique monte en flèche. Peu à peu, la voie royale « latin-grec » se voit supplantée par la filière scientifique. Pour réussir dans la vie, il faut être bon en maths, faire des études de maths.
Or, les mathématiques ont – pense-t-on – cet insigne mérite de ne requérir chez l’élève que des dispositions. Nul besoin de culture, d’aisance dans le discours, de bagage de références pour y réussir. Face aux mathématiques, les héritiers se retrouvent à égalité avec les enfants des classes défavorisées.
Dès lors, le rêve d’une école juste, d’une école unique, demeure possible. Les enfants d’ouvriers, par la grâce des mathématiques, se voient ouvrir une nouvelle voie d’accès aux rangs de l’élite. Plus que jamais, l’égalité des chances demeure d’actualité.
Collège unique et « 80 % d’une génération au bac » : la démocratisation achevée ?
Il est vrai que l’Éducation nationale n’a pas le choix. D’abord, elle s’est trop engagée, psalmodiant depuis des années le refrain de l’école unique. En outre, Mai 68 est passé par là. Les étudiants, non contents d’ériger des barricades, ont fraternisé avec les ouvriers. L’autorité – celle des professeurs, celle des mandarins – est sérieusement écornée. Les idées de gauche ont le vent en poupe chez les intellectuels. Pas question de faire marche arrière. Il faut achever de démocratiser l’école, en abattant les derniers obstacles à l’égalité.
La démocratisation ou la fin des différences
Des inégalités à faire disparaître
Seize ans après le décret Berthoin, malgré bien des réformes, le cycle d’orientation laisse subsister des inégalités. Dès la 6e, les élèves sont répartis en fonction de leur niveau. Si tous suivent un enseignement général, selon leurs résultats en fin de CM2, les uns, les meilleurs, entrent en sixième I – voie dite « longue », où enseignent certifiés et agrégés ; les autres, en sixième II – voie dite « courte », fief des PEGC. Les élèves en grande difficulté entrent quant à eux en 6e de transition, où officient les instituteurs. Théoriquement, le cycle d’orientation et d’observation permet, au fil des années, de rectifier cette répartition, tout élève pouvant bifurquer d’une filière à l’autre en fonction de ses résultats. Mais l’expérience prouve qu’il en va rarement ainsi : chacun reste où il est. S’il y a des passerelles, elles sont le plus souvent à sens unique, les changements de filière sanctionnant un échec bien plus qu’ils ne couronnent une réussite.
Reflet de cette hiérarchie, trois types d’établissements accueillent les élèves : les CES – où sont réunies les trois filières ; les CEG, réservés à la voie II ; les CET, qui, à l’issue de la 5e, accueillent les élèves optant pour la préparation d’un CAP.
Pour faire un collège juste, il importe de supprimer ces ultimes inégalités. C’est à quoi s’emploiera la réforme Haby.
Tous (ou presque) sur les mêmes bancs, ou le collège unique
En 1975, René Haby supprime les filières et réunit tous les élèves du cycle d’orientation sous le même toit : le CES, et dans des classes indifférenciées.
Terminées, les voies I et II : à l’issue de leur CM2, que leurs résultats soient bons ou moins bons, tous les élèves sont répartis sans distinction dans des sixièmes, puis des cinquièmes, que rien ne distingue entre elles – hormis la langue vivante. Plus tard seulement, en quatrième, ils choisiront des options – 2e langue vivante, latin, grec, technologie…
Terminée, la bifurcation après la 5e vers le CET pour préparer un CAP. La voie professionnelle ne s’ouvre plus désormais qu’à l’issue de la 3e. Ceux-là même qui souhaitent vite préparer un métier devront d’abord suivre quatre années d’enseignement général, sur les mêmes bancs que les futurs Polytechniciens ou médecins. À moins que leur niveau ne soit décidément par trop insuffisant… Créées en 1972, les « CPPN » (classes pré-professionnelles de niveau) et les CPA (classes de préparation à l’apprentissage), prévoient à l’issue de la 5e, outre une remise
à niveau des connaissances générales, une découverte des métiers et un début de formation en alternance.
À la fin de la 3e, ce premier cycle d’études secondaire s’achève sur un examen, le BEPC, et chacun peut enfin s’orienter en toute connaissance de cause, à l’âge de 15 ou 16 ans.
Tous (ou presque) au lycée, et le bac pour (presque) tous !
Dès 1975, le collège est donc unifié. S’il va de soi qu’ensuite l’orientation est enfin légitime, elle ne doit en aucun cas rimer avec ségrégation. Quel que soit son choix, tout élève doit se sentir également valorisé.
Chacun a droit d’entrer dans un « lycée », ce prestigieux établissement réservé si longtemps aux seuls fils de bourgeois. En 1975, le CET, collège d’enseignement technique, est donc rebaptisé « lycée d’enseignement professionnel », ou LEP, par la réforme Haby. On n’y passe pas le bac, mais le CAP ou le BEP en deux ans ? Qu’importe. Au moins s’agit-il d’un « lycée ».
Dix ans plus tard, en 1985, le voici rebaptisé « LP », lycée professionnel, par Jean-Pierre Chevènement. Merveille : cette fois, lui aussi a droit à son bac, le baccalauréat professionnel, alias « bac pro » ! On le prépare en trois ans, comme dans n’importe quel lycée – 2e, 1re et terminale professionnelle. Pour faire bonne mesure, le technique a également droit à sa gratification, se voyant renommé « lycée technologique ». Tout est dans le suffixe, « logique », du grec « logos » : la technique s’érige en science, elle prend du galon, flirtant avec la noblesse de l’enseignement général.
Simples astuces lexicales ? Nullement. Car, dans le même temps, Jean-Pierre Chevènement lance son fameux slogan : « 80 % d’une génération au bac ! » C’est le bac pour tous – ou presque tous. Qui sont les 20 % manquants ? Sans doute les apprentis des CFA, et ces élèves de LP qui, résolument fâchés avec les études longues, s’obstinent à préférer un CAP ou un BEP en deux ans à un bac en trois ans.
Il ne sera pas dit que les enseignants du professionnel sont des professeurs au rabais. Longtemps constitué de professionnels issus de l’industrie, ce corps enseignant spécifique suivait une formation pédagogique adaptée à son public très particulier dans des centres spécialisés, les ENNA et les CFPT, supervisés par le CNET. Aux innombrables spécialités enseignées correspondait une diversité égale de diplômes : 10 agrégations de technologie, 15 CAPET pour le technique ; plusieurs dizaines de spécialités pour les PLP (professeurs de lycées professionnels). À partir de 1995, l’Éducation nationale y met bon ordre. Le CNET dissous, c’est dans les IUFM que seront désormais formés ces enseignants, avec les professeurs de lettres et de mathématiques de l’enseignement général. Et leurs myriades de spécialités seront réduites à quelques-unes, bien plus généralistes. « Général » : voilà le maître mot !
À l’instar de leurs confrères de sciences ou de lettres, c’est sur les bancs de l’université et non dans les ateliers de l’usine que ces professeurs sont formés. Aussi n’en savent-ils guère plus qu’eux sur le monde de l’entreprise, pour lequel ils éprouvent d’ailleurs un certain mépris12.
Last but not least : afin de bien signifier l’égale valeur de ces divers lycées – général, technique, professionnel – l’Éducation nationale, dès qu’elle le peut, les rassemble en un même lieu sous la dénomination de « lycées polyvalents ». Tout le monde, décidément, est logé à la même enseigne. La démocratisation est bel et bien achevée.
La démocratisation ou l’exacerbation des différences
Le collège unique, antichambre de l’échec
Pendant des décennies, l’enseignement « de classe », fondamentalement injuste, a mené vers des destins préprogrammés des élèves qui ne se rencontraient jamais. Avec la démocratisation, ils se trouvent à présent réunis. Les mêmes chances leur sont certes données à tous – théoriquement. Mais désormais, ils ne peuvent éviter de se comparer.
Pédagogiquement, l’enseignement secondaire du premier cycle n’a pas changé. Il reste construit selon la même logique qu’autrefois : censé mener au baccalauréat, il répartit les connaissances à acquérir en fonction d’un savant rétroplanning dont le terme est le grand examen final, lui-même conçu pour donner accès à l’université. Pour chaque corporation de professeurs, le bien scolaire se définit spontanément comme « le plus haut niveau possible d’accomplissement dans chaque discipline. » Rien de commun avec l’objectif du primaire d’antan, qui se résumait à offrir une commune culture garantie à tous13.
Voilà donc tous les enfants de France mis au régime unique de l’excellence… académique. Pas de classes de niveau. Chacun doit suivre le rythme. Or, la barre est placée si haut que tous ne peuvent évidemment l’atteindre à la même vitesse – si tant est qu’ils l’atteignent. Et l’échec de s’installer, sans nulle échappatoire possible puisque le collège est unique et les classes indifférenciées.
Dans la grande chasse aux inégalités qui a guidé la réforme de 1975, les seules différences qui subsistent sont celles des options, en 4e, et une autre, de taille : les CPPN (classes pré-professionnelles de niveau) et les CPA (classes préparatoires à l’apprentissage), où sont relégués, de fait, les élèves incapables de suivre avec le gros des troupes. Leur dénomination hybride, qui réunit sous un même sigle l’idée de niveau et celle de profession, est fort éloquente. Dans le collège de l’égalité des chances, « n’avoir pas le niveau » est rigoureusement synonyme d’« entrer dans la voie pro ». La voie professionnelle est officiellement une voie de relégation. Celle où finiront « ceux qui n’arrivent pas à suivre. » On conçoit, dans ces conditions, leur honte et leur effroi : leur seule alternative est de s’accrocher à des études qui ne leur conviennent pas et leur renvoient l’image de leur incapacité, ou de bifurquer vers une voie que tous considèrent comme celle des bons à rien.
Petits accommodements avec l’égalité
Si les chances sont en théorie égales, on trouve toujours moyen, pour peu qu’on connaisse le système, de se ménager une égalité un peu plus favorable. Il y a ces options qui garantissent une bonne classe, ou mieux encore, un bon établissement. Option latin, option allemand 1e langue, option russe, et le tour est joué : on échappe au lycée polyvalent que fréquentent, carte scolaire oblige, les enfants de la cité. Ou du moins l’on est assuré que son rejeton sera dans la meilleure classe de son établissement. Entendez : une classe désertée par les cancres, où les professeurs pourront mener à bien le programme tambour battant, sans être ralentis par les retardataires. Il y a les leçons particulières, aussi… Mille façons légales existent de se ménager plus de « chances » que n’en accorderait la stricte égalité. C’est ainsi que, subrepticement, les inégalités sociales permettent à leurs bénéficiaires de tirer leur épingle de la démocratisation, en se réservant la meilleure éducation…
Un contresens tragique : « 80 % d’une génération au bac »
Né des meilleures intentions, le slogan « 80 % d’une génération au bac », dans un tel contexte, ne pouvait que mener au désastre. L’idée est née, explique Antoine Prost14, d’une lecture que fit Jean-Pierre Chevènement des études du BIPE et de la Mission éducation-entreprises en 1985. Dans cette analyse prospective, les auteurs prédisaient le déclin des emplois industriels de niveau CAP au profit d’emplois techniques plus qualifiés. Il s’agissait d’anticiper très vite, en adaptant la formation professionnelle aux mutations annoncées. D’où la création d’un bac pro. D’où le slogan, aussi, censé inviter jeunes et professeurs à opter pour ce bac professionnel nouvellement créé plutôt que pour un BEP ou un CAP.
Mais les parents des classes populaires et leurs enfants ne l’ont pas entendu ainsi. Se méprenant sur l’intention du ministre, ils y ont vu la promesse d’empocher le seul « vrai » bac à leurs yeux : celui qui existe depuis toujours – le baccalauréat général ou technologique. Le sociologue Stéphane Beaud fait le récit de ce contresens tragique dans son ouvrage 80 % au bac… et après ?15 Il y décrit l’immense espoir, la ruée vers les filières générales et technologiques, le refus décuplé de la filière professionnelle « bonne pour les ânes ». Et l’échec au bout de quelques années, sur les bancs d’une université dont les jeunes n’ont pas les codes, et qui ne mène pas aux métiers.
La voie professionnelle devient la voie de relégation
Le LP où s’en vont les ânes, non content de voir son image s’abîmer, joue aussi sa partie dans la course à l’échec. Car pour atteindre l’objectif du ministre à moyens constants, voire diminués, et ouvrir des classes de bac pro, il n’est qu’une solution : sacrifier les classes de CAP et de BEP. Si l’on conserve malgré tout quelques CAP pour les élèves jugés incapables d’atteindre le bac, le BEP voit son programme aligné sur celui de la 1re pro. Perdant du même coup sa finalité professionnelle.
Quant au contenu des enseignements, désormais délivrés par des professeurs sans lien avec le monde professionnel, il ne fait guère l’unanimité parmi les entreprises qui le jugent souvent décalé par rapport aux emplois.
Graphique 4. Le système éducatif français vers 1985 (scolarité obligatoire jusqu’à 16 ans) (gratuit)
Source : création originale de l’auteur à partir de différentes sources.
Ces graphiques volontairement simplificateurs ont été conçus à des fins pédagogiques et ont une valeur strictement indicative. Ils ne prétendent pas rendre compte de façon exhaustive d’une réalité évolutive et complexe.
Reste l’apprentissage en CFA… Vilipendé au début des années 1960, l’apprentissage « sur le tas », en entreprise, a fait son grand retour au mitan des années 1970. Avec une bonne dose d’opportunisme, l’Éducation nationale, constatant son échec face à nombre d’élèves résolument allergiques à la voie scolaire, s’est avisée de redorer son blason en l’érigeant soudain en « véritable voie de l’enseignement technique ». Mieux encadré grâce au « statut de l’apprenti » défini en 1971, à défaut d’attirer beaucoup de jeunes, il a le mérite de les satisfaire. Mais aujourd’hui encore, divers obstacles l’empêchent de décoller pour de bon. Il ne nous appartient pas ici d’en détailler les raisons, amplement étudiées ailleurs.
Nous arrêterons ici notre rapide survol. Depuis les années 1990, les réformes ont eu beau se succéder, l’image de la voie professionnelle ne s’est guère améliorée. L’étude succincte qui précède, remontant aux origines de l’école républicaine, donne, nous l’espérons, un aperçu de l’engrenage qui a conduit une belle idée à se transformer en échec.
L’école unique était-elle une utopie ? Là n’est pas la question. L’était assurément cette folle ambition d’intégrer dans un moule conçu pour une poignée de favorisés tous les enfants de France, sans s’aviser d’y apporter les aménagements nécessaires. Dieu sait, pourtant, que le signal d’alarme a maintes fois été tiré – notamment en 1968, avec le Congrès de l’AEERS. Dieu sait, aussi, que bien des professeurs ont mis toute leur énergie à essayer d’inventer une pédagogie nouvelle, adaptée à un enseignement de masse. Certains d’entre eux évoquent avec une nostalgie amère le fourmillement d’idées et l’enthousiasme qui accompagnèrent la naissance des CPPN et des CPA – avant que l’ouverture de ces classes, aussi massive que précipitée, ne les contraigne à tout abandonner pour simplement faire face. On peut accuser les réflexes corporatistes – des professeurs d’élite accrochés à leur enseignement d’élite… Mais comment leur jeter la pierre ? Rien, dans leur formation, ne les disposait à changer de méthodes. Reste à savoir pourquoi l’on n’a jamais envisagé d’adapter cette formation à la réalité de leur nouveau public.
Les deux parties précédentes ont détaillé la genèse des diverses représentations dans lesquelles s’enracine cet échec. Le mépris du manuel et de la technique, viscéral dans notre pays, n’est que le produit de la culture humaniste – laquelle servit à la fois de tremplin à une bourgeoisie rêvant d’égaler la noblesse, et de ciment à l’absolutisme du Roi Soleil. Les siècles ont beau passer, les représentations perdurent. Mais la société évolue, et vient un moment où leur décalage avec le quotidien vécu en fait émerger de nouvelles, susceptibles de les détrôner.
Ce moment pourrait bien être venu.
Tempête sur les représentations et les catégories
Ouvrier, moi ? Jamais !
« Ouvrier, moi ? Jamais ! » Tel est le cri du cœur des jeunes beurs des cités interviewés par Stéphane Beaud dans 80 % au bac, et après ? Pas question d’aller comme leur père travailler en usine, c’est sale, dégoûtant, trop dur physiquement16. L’idéal : une vie de petit fonctionnaire, en horaire normal, où on finit à 17 heures, pour pouvoir profiter de la vie, sortir, s’amuser17… Si décidément ils ne peuvent couper à l’orientation en LP, tout vaudra mieux que l’industrie – pour se retrouver au chômage, non merci18 ! Le tertiaire est plus propre, mieux vaut être le dernier des cols blancs avec bureau, papier, stylo, ou casque de téléopérateur, que passer sa vie en col bleu souillé au milieu des machines et des robots.
Le sociologue et inspecteur général de l’Éducation nationale Aziz Jellab le confirme, chiffres à l’appui : dans nos années 2010, chez les jeunes fils des classes populaires, la représentation du travail en usine n’a guère évolué depuis Les Temps modernes. Aux cols bleus des usines, la crasse, la souffrance physique et morale, le chômage, les salaires minima. Aux cols blancs du tertiaire, l’embauche assurée, les horaires confortables, les feuilles de paie mirobolantes et la voiture toute neuve. En 2012, à l’académie de Lille, 3 318 élèves orientés en LP plaçaient en premier choix les métiers du secteur commercial, 2 114, ceux des services à la personne, 999, la gestion administrative. Ils n’étaient que 729 à opter pour la maintenance de véhicules, et 86 à vouloir devenir technicien d’usinage19…
Écran pour tous !
Cependant, les représentations ont parfois un train de retard sur la réalité. Pas plus que leurs parents, les élèves de LP ne semblent avoir conscience que leur image du travail en usine est aujourd’hui largement périmée.
Avec l’avènement des TICE, l’ordinateur s’est invité partout, interposant entre les « cols bleus » et la matière qu’ils travaillent un intermédiaire de plus : l’écran, qui commande aux machines, lesquelles sont seules à toucher le métal, le bois… voire le pain, comme le constate Richard Sennett en retournant dans la boulangerie de Boston qu’il fréquentait vingt-cinq ans plus tôt. Rien de commun entre la petite boutique de jadis, tenue par deux frères grecs alcooliques, et la boulangerie informatisée gérée par un conglomérat géant de l’alimentation :
« Désormais, les boulangers n’ont plus le moindre contact physique avec les matériaux ou les miches de pain ; ils surveillent tout le processus grâce aux icônes qui apparaissent sur leurs écrans et dont la couleur, par exemple, les renseigne sur la température et le temps de cuisson des fours. […] Sur l’un d’eux, il y a des icônes correspondant à plus de variétés de pain qu’on n’en a jamais cuit par le passé : des miches de pain russe, italien ou français, qu’une simple pression du doigt sur l’écran suffit à produire. Le pain n’est plus qu’une image sur l’écran. » 20٠
La concrétude qui caractérisait le travail autrefois « manuel » a fait place à la virtualité. Est-ce à dire qu’il n’y a plus de métier ? Si l’on entend par « métier » la connaissance des arcanes de la boulangerie – pétrissage, cuisson… –, dans ce cas précis, la réponse est évidemment « oui ». En revanche, sans connaissances en informatique, pas d’embauche possible. Ce qui fait dire plaisamment à une des employées : « Boulangerie, cordonnerie, imprimerie, tout ce que vous voulez. J’ai la compétence. »21
Cette nouvelle compétence, transposable à tous les métiers, Vincent de Gaulejac la définit comme un mélange de dextérité et de « culture » permettant au travailleur de s’adapter au renouvellement permanent des machines et des logiciels22. « Cols blancs » et « cols bleus » sont ici logés à la même enseigne : point de salut sans la maîtrise de leur outil commun – l’ordinateur.
Alors que le travail des cols blancs se taylorise sous l’effet des nouvelles technologies, les cols bleus, pour la première fois, se voient invités à faire preuve de qualités jusqu’alors réservées aux seuls cadres : dans la nouvelle organisation du travail, l’opérateur industriel doit désormais démontrer sa capacité « non seulement à opérer manuellement, mais aussi à contribuer à des formes collectives d’organisation (réfléchir, faire de l’auto-contrôle, innover…) »23. Au savoir-faire qui suffisait naguère s’ajoute le « savoir-être ». Qu’il s’agisse de vœu pieux ou de réalité, au moins l’image du travail ouvrier y gagne-t-elle en respectabilité.
« Cols blancs / cols bleus » ; « concret / abstrait » ; « manuel / intellectuel ». Transcendant ces catégorisations binaires, plusieurs indices suggèrent que la nature même du travail pourrait être en passe de se transformer. Nos représentations du travail manuel, héritées de l’Antiquité, sortiront-elles indemnes de la métamorphose du marteau en ordinateur ? On peut se permettre d’en douter…
- 1. Antoine Prost, Éducation, société et politiques. Une histoire de l’enseignement en France, de 1945 à nos jours , Seuil, 1997, p. 96.
- 2. Ibid.
- 3. Instructions du 15 juillet 1963.
- 4. Décret du 14 juin 1962, J.O. du 16 juin 1962.
- 5. B.O. , 20 juin 1963.
- 6. Antoine Prost, Histoire de l’enseignement et de l’éducation , op. cit. p. 639.
- 7. Yves Malier, Reconnecter la formation à l’emploi. Le chômage des jeunes n’est pas une fatalité , Presses des Mines, 2017, p. 40.
- 8. Antoine Prost, Éducation, société et politiques , Seuil, 1997. p. 108.
- 9. Antoine Prost, Histoire de l’enseignement et de l’éducation. IV Depuis 1930 . p 374.
- 10. Ibid. , p. 373.
- 11. Ibid. , p. 336.
- 12. Pour ce paragraphe, voir Yves Malier, op. cit. , pp 63 et sqq.
- 13. Voir François Dubet, L’École des chances. Qu’est-ce qu’une école juste ? « La République des idées », Seuil, 2004.
- 14. Antoine Prost, Éducation, Société et politiques , p. 207.
- 15. Stéphane Beaud, 80 % au bac… et après ? La Découverte, 2002.
- 16. Stéphane Beaud, op. cit. , p. 281.
- 17. Ibid. p. 176.
- 18. Aziz Jellab, op.cit. , p. 81.
- 19. Ibid. , p. 80.
- 20. Richard Sennett, Le Travail sans qualités , Albin Michel, 2000 ; 10/18, 2003, p. 92.
- 21. Ibid. p. 95.
- 22. Vincent de Gaulejac, Travail. Les raisons de la colère , Seuil, 2011.
- 23. Philippe d’Iribarne, « Sens et valeur du travail », in Réinventer le travail , op. cit. , p. 149.
CONCLUSION – Crise lexicale, crise du travail
Nous vivons une étrange époque, où les mots et ce qu’ils désignent ont cessé de coïncider.
« C’est un manuel », dit-on d’un élève dont l’habileté manuelle n’a jamais été testée, le programme du collège unique n’incluant pas d’enseignement manuel. C’est un manuel, car ce n’est pas un intellectuel.
On l’oriente donc vers la voie professionnelle qui, comme son nom l’indique, prépare rapidement à une profession – à ceci près que le chômage ne l’épargne guère. L’élève manuel s’y servira-t-il de ses mains ? C’est peu probable, la majorité des professions concernant le tertiaire. Quant à celles de l’industrie, elles demandent désormais de savoir diriger des robots fort sophistiqués – à quoi l’habileté manuelle est assez peu utile.
Pour décrocher un bon métier, on préfère la voie dite générale, qui ne prépare à aucun métier et n’est pas si générale que ça puisqu’elle n’accueille qu’une minorité des élèves1 : forcément, puisque n’y accèdent que les élèves intellectuels.
Leur job en poche – si tant est qu’ils en décrochent un – l’ancien élève de la voie générale, celui de la voie pro tertiaire, celui de la voie pro industrielle passeront tous les trois le plus clair de leur temps assis devant un ordinateur.
Seul le premier exercera un métier dit intellectuel. Car de par sa formation générale, en cliquant sur sa souris, il produit forcément de la pensée : camembert, tableau Excel… C’est un col blanc.
L’opérateur industriel a beau diriger derrière son écran un robot fort sophistiqué, comme il a reçu une formation professionnelle, il ne produit forcément aucune pensée – seulement des moteurs, des radars, des avions. C’est un col bleu.
Et l’employé tertiaire – caissier, guichetier, employé de centre d’appel, serveur de sandwicherie – quelle est la couleur de son col ? Du prolétaire, il a le bleu ; de l’homme préservé du cambouis, il a le blanc. Mettons, un col Vichy à carreaux bleu et blanc.
Manuel, intellectuel. Professionnel, général. Col bleu, col blanc. Nos représentations du travail fonctionnent sur des catégories binaires héritées d’un autre âge, qui ne coïncident plus avec la réalité.
En ce temps-là, le monde était coupé en deux
L’usine était alors manufacture. Nés des familles les plus pauvres, souvent analphabètes, la majorité des hommes et femmes en âge de travailler n’avaient que leurs deux mains et leur force physique pour gagner leur vie. On les reconnaissait à leur bleu de travail. Au bas de la hiérarchie industrielle, c’étaient les prolétaires, les cols bleus
D’autres avaient le privilège envié d’échapper à la pénibilité du travail physique. Certains travaillaient à l’étage de l’usine, dans les bureaux. D’autres, du modeste gratte-papier au directeur, dans les bureaux de l’administration. D’autres encore, professeurs, médecins, notaires ou avocats, travaillaient dans leur cabinet. Tous étaient des cols blancs, qui avaient l’heur de ne pas s’épuiser ni se salir pour gagner leur vie.
L’École entérinait d’avance cette bipartition. Après un bref passage par l’école primaire où ils apprenaient le minimum nécessaire pour exercer métier et citoyenneté, les plus nombreux des classes populaires s’en allaient encore tout enfants remplir les ateliers. Quant aux « happy few » des classes aisées, destinés par leur rang social aux bancs du Secondaire, fussent-ils cancres consommés, ils s’en allaient étudier les humanités. Ces longues études n’avaient aucunement fonction de les préparer à un métier. Générales, elles leur dispensaient la culture… générale qui leur permettrait d’accéder aux fonctions auxquelles tout naturellement ils étaient destinés : celles de l’élite, celles de l’excellence.
Qu’en reste-t-il aujourd’hui ?
La manufacture a cédé la place à l’hyper-industrie, dominée par l’informatique. L’habileté manuelle et la force physique n’y jouent que peu de rôle, car les machines, se substituant au manœuvre et à l’ouvrier, se chargent désormais de la besogne. Pour travailler dans l’usine d’aujourd’hui, il faut être capable de piloter des robots ultra-sophistiqués régis par des logiciels complexes ; de s’adapter aussi, tout au long de sa vie, à un progrès technique galopant. L’intellect s’est substitué à la main. Pas d’accès possible à ces postes qualifiés sans une formation technique approfondie.
Ce n’est plus à l’usine que vont désormais les moins qualifiés : elle n’a plus de postes pour eux. Les services, en revanche, sont gourmands de cette abondante main d’œuvre interchangeable et précaire, destinée à ânonner au téléphone des réponses pré-écrites à des questions toujours semblables ou assurer à peine plus qu’une pure présence humaine. Le lieu de travail ne caractérise plus ce nouveau prolétariat, qui œuvre tantôt derrière un guichet, tantôt sur un scooter, tantôt dans une cabine, tantôt dans un open space.
L’École n’a pas entériné cette évolution du monde du travail.
La voie générale qui ne prépare directement à aucun métier, demeure la voie convoitée par tous. Naguère réservée à une poignée de privilégiés assurés de trouver une place enviable par reproduction sociale, elle s’est désormais massifiée, conduisant jusqu’à 18 ans des jeunes qu’elle ne forme à rien de particulier. Nantis d’un baccalauréat dévalorisé par le quota des « 80 % », une grande partie d’entre eux, vite engloutis par une sélection avouée ou non, quittera l’université sans compétence distinctive, pour échouer dans le nouveau prolétariat des services.
La voie professionnelle censée préparer à un métier, peine à remplir sa mission : n’étant pas générale, elle ne peut prétendre à l’excellence, et ne recrute donc guère que par anti-sélection. À défaut d’être générale, au moins l’Éducation nationale souhaite-t-elle que cette voie ne soit pas trop spécialisée. Aussi les formations destinées aux métiers tertiaires explosent-elles, quand celles qui préparent à l’industrie, d’une haute exigence technique, souffrent d’un manque de candidats autant que de moyens. Le résultat est paradoxal : les jeunes peinent à trouver un emploi, et les industriels peinent à pourvoir leurs postes…
Reste bien sûr l’apprentissage. Mais sa spécialisation technique, aux antipodes de l’excellence forcément générale, le discrédite dans l’opinion.
Un lexique à rectifier d’urgence
Reflet de nos représentations périmées, cette crise lexicale fait écho à la crise actuelle du travail et de l’éducation en France. Les mots employés couramment pour désigner les voies et les métiers sont en décalage criant avec la nouvelle réalité du travail. L’Éducation nationale, qui forme les jeunes esprits et devrait donc donner le la, détient sans doute une part de responsabilité dans cette situation.
« Général », « manuel »… N’est-il pas temps que ces mots qui ne signifient plus rien, mais dont les connotations fallacieuses conditionnent toujours les choix de vie d’individus et de familles, disparaissent du vocabulaire des enseignants et des parents ? Et « orientation » ? La tartuferie qui consiste à cacher derrière ce paravent commode un mécanisme routinier de relégation définitive en voie pro continuera-t-elle longtemps ? Quant à « professionnel », à en faire l’épithète spécifique d’une voie, on semble sous-entendre que le bon élève, celui de la voie « générale », ne doit surtout pas songer à son futur métier ; qu’il doit étudier pour la gloire, voire pour le plaisir. C’était le cas, sans doute, au XIXe siècle, quand le fils de bourgeois était assuré de trouver une place de choix après avoir gambadé dans les prés des Géorgiques. Mais aujourd’hui, quand la perspective du chômage fait trembler tous les enfants dès le collège, peut-on admettre une telle hypocrisie ? Comme s’ils le ressentaient obscurément, les élèves se vengent à leur façon, en détournant insolemment le sens des mots qui blessent : voilà intello devenu insulte !
C’est par les mots, véhicules d’images, qu’évolueront enfin nos représentations, figées depuis plus de deux siècles.
Glamourisation du technique
Aujourd’hui, combien d’adolescents ont le courage de faire fi de ces catégories rances pour choisir un métier technique ? Il faut être cadre supérieur, avoir fait largement ses preuves face à la société, pour s’offrir le luxe de démissionner à 40 ans et de passer avec fierté un CAP de plombier ou de menuisier. Si ces transfuges ne sont que peu nombreux, leur message ne passe pas inaperçu : Non, clament-ils, l’intelligence ne campe pas exclusivement dans les tableaux Excel, les camemberts, les salles de réunion. Cessez de refouler votre goût pour le « faire », la matière, la technique, le concret. Faites-en un métier ! Choisissez-le ! Offert par des membres de l’élite, des enfants de la voie générale, des enfants de l’excellence, des intellectuels, des cols blancs, un tel exemple frappe l’imagination, comme le démontre l’engouement des médias pour le parcours de ces drôles de cadres. Or, les publicitaires le savent, l’imagination est la mère des représentations. Soudain, voilà que le monde de la technique, de la matière, se glamourise, s’intellectualise. Pendant ce temps, les hackerspaces et les fablab essaiment sur tous les continents. Et l’entreprise libérée chère à Isaac Getz entonne son credo : « C’est celui qui fait qui sait ! L’opérateur sait mieux que le directeur ! »
Éclatement des catégories binaires
La crise des cols blancs (ce mot encore ! mais quel autre conviendrait ?) est peut-être bien la grande chance qui s’offre à l’industrie française – avec pour hérauts les néo-artisans. L’artisanat, nous objectera-t-on, n’a pas grand-chose à voir avec l’industrie. Seul maître à bord de sa petite entreprise, l’artisan-patron œuvre de ses mains ; parmi des centaines de collègues, l’opérateur industriel commande à des robots qui triturent la matière à sa place. Il est vrai. Mais qu’on songe plutôt à ce qui dissuade les jeunes d’aller travailler en usine. Les représentations. Voie pro, voie des ânes, voie de relégation, voie qui-n’est-pas-générale, voie qui-n’est-pas-normale, voie des non-intellectuels. En réhabilitant le « faire », le concret, le technique – le manuel, pour le coup ! – les néo-artisans bardés de diplômes, et avec eux tous les bricolos geeks des hackerspaces, pulvérisent les catégorisations binaires éculées, et font rêver les gens à ce qui hier encore les repoussait. Quant aux rêves d’hier – saint Graal du travail de bureau, attaché case et voiture de fonction ! –, relayé par le cinéma et le roman, le blues de l’open space qu’entonnent « les cols blancs » les a déjà bien écornés. Aussi bien est-ce vers un éclatement des catégories que semble se diriger notre ministre de l’Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, en appelant de ses vœux « un enseignement professionnel qui fasse envie » et en aspirant à « des Harvard du pro ».
Reste que pour y parvenir, les industriels, eux aussi, auront à jouer leur partie. Certes, il est des représentations caduques – usine sale, usine bruyante, travail à la chaîne – qu’il leur faut encore mettre à bas, en donnant largement à voir l’usine d’aujourd’hui. L’exposition « L’Usine extraordinaire » organisée au Grand Palais en novembre 2018, le Salon des métiers industriels de l’entreprise, le tourisme industriel, sont de ce point de vue de belles initiatives. Une série de fiction, romanesque ou télévisée, située en partie à l’usine, aurait sans doute un impact non négligeable sur le grand public – la série L’Instit n’était-elle pas une commande officieuse de François Mitterrand au producteur Pierre Grimblat ?
Mais l’élaboration de plans de communication, si bien pensés soient-ils, ne saurait suffire. Car si la crise du travail peut être une occasion en or pour un nouveau départ, il convient aussi de prendre acte du message qu’elle délivre : aspiration des salariés à davantage d’autonomie, davantage de confiance, de sens, de respect, de bien-être… En témoignant de leur volonté d’accompagner le mouvement, en lançant des initiatives pour faire évoluer leurs organisations, les industriels contribueront à rehausser l’image de l’usine pour attirer les jeunes talents et leur donner envie d’y rester.
- 1. En 2015, les élèves d’une classe d’âge se répartissaient ainsi : 40 % bac général ; 16 % bac technologique ; 40 % enseignement professionnel ; 4 % sortant du système scolaire sans formation. Yves Malier, op. cit. p.45.
Bibliographie
Partie 1 – Manuel
Aristote, Politique ; Les Parties des animaux .
Certeau Michel de, La Culture au pluriel , UGE, 1974 ; « Points » Seuil, 1993.
Charlot Bernard et Figeat Madeleine, Histoire de la formation des ouvriers , Minerve, 1985.
Crawford Matthew, Éloge du carburateur , La Découverte, 2010.
Decréau Laurence, L’Élégance de la clé de douze. Enquêtes sur ces intellectuels devenus artisans , Lemieux éditeur, 2015.
Dejours Christophe et Ogilvie Bertrand, La Panne. Repenser le travail et changer la vie , Bayard Culture, 2012.
Dubet François, L’École des chances. Qu’est-ce qu’une école juste ? Seuil, 2004.
Grignon Claude , L’Ordre des choses. Les fonctions sociales de l’enseignement technique , Paris, Éditions de Minuit, Coll. le Sens Commun, 1971.
Grimaldi Nicolas, Le Travail, communion et excommunication , Puf, 1998.
Hésiode, Les Travaux et les jours .
Jellab Aziz, L’ Émancipation de la réussite scolaire. Pour un lycée professionnel de la réussite , Presses Universitaires du Mirail, 2014.
Jullien François, L’Invention de l’idéal et le destin de l’Europe , Gallimard, 2017
Leroi-Gouhan André, Le Geste et la parole. II. La mémoire et les rythmes , Albin Michel, 1964.
Linhart Robert, L’Établi , Minuit, 1978.
Marx Karl, Le Capital , Puf, 1947.
Merleau-Ponty Maurice, Phénoménologie de la perception , Gallimard, 1945 ; rééd. « Tel », 1990.
Millanvoye Julien, J’ai un métier !, Globe, 2013.
Mischi Julien et Laurens Sylvain, « Les politiques de revalorisation du travail manuel. 1974-1981 », Agone , n°46, 2011.
Osez la voie pro, La Fabrique de l’Industrie, Presses des Mines, 2015.
Pernoud Régine, Histoire de la bourgeoisie en France. 2 Les Temps modernes , Seuil, 1962 ; « Points » Seuil, 1981.
Platon, Protagoras ; La République ; Le Politique ; Le Banquet .
Sennett Richard, Ce que sait la main. La culture de l’artisanat , Albin Michel, 2010.
Simondon Gilbert, Du mode d’existence des objets techniques , Aubier, 1958 ; 2012.
Valéry Paul, « Discours aux chirurgiens », Variété , Études philosophiques, p. 907 ; « Propos sur l’intelligence », Variété , Essais quasi politiques , p. 1040. Œuvres I , Gallimard « Pléiade », 1957.
Vernant Jean-Pierre, Mythe et pensée chez les Grecs , Maspéro, 1965 ; La Découverte, 1996.
Veltz Pierre et Weil Thierry (dir.), L’Industrie, notre avenir , Eyrolles, 2015.
Partie 2 – Culture
D’Alembert, « Discours préliminaire », Encyclopédie I , GF Flammarion, 1986.
Bourdieu Pierre et Passeron Jean-Claude, Les Héritiers. Les étudiants et la culture , Minuit, 1964.
Certeau Michel de, La Culture au pluriel , UGE, 1974 ; « Points » Seuil, 1993.
Dupuy Jean-Pierre, « L’inculture comme avenir », in De quoi l’avenir intellectuel sera-t-il fait ? Enquêtes 1980, 2010, Le Débat , Gallimard, 2010, p. 226.
Fumaroli Marc, L’État culturel. Essai sur une religion moderne , de Fallois, 1992 ; Poche Biblio Essais.
Gauchet Marcel, Comprendre le malheur français , Stock, 2016 ; Folio Gallimard, 2017.
Girard René, Mensonge romantique et vérité romanesque , Grasset, 1977.
Le Goff Jacques, Les Intellectuels au Moyen Âge , Seuil, 1957 ; « Points » 2000.
Le Goff Jacques (dir), L’Homme médiéval , « Points » Seuil, 1989.
Le Roux Nicolas et Wrede Matin, Noblesse oblige. Identités et engagements aristocratiques à l’époque moderne , PUR, 2017.
Loyer Emmanuelle, Une brève histoire culturelle de l’Europe , « Champs » Flammarion, 2017.
Pernoud Régine, Histoire de la bourgeoisie en France. 2 Les Temps modernes , Seuil, 1962 ; « Points » Seuil, 1981.
Rioux Jean-Pierre, La Révolution industrielle – 1780-1880 , Seuil 1971 ; « Points » Seuil 1989.
Rioux Jean-Pierre et Sirinelli Jean-François (dir), Histoire culturelle de la France , Seuil, 1997 ; « Points » 2005 :
1 . Sot Michel, Boudet Jean-Patrice, Guerreau-Jalabert Anita , Le Moyen Âge .
2. Croix Alain, Quéniart Jean, De la Renaissance à l’aube des Lumières .
Simondon Gilbert, Du mode d’existence des objets techniques , Aubier, 1958 ; 2012.
Simondon Gilbert, Sur la technique, Puf, 2014.
Tinard Yves, L’Exception française, pourquoi ? Maxima, 2001.
Weber Max, L’ Éthique protestante et l’esprit du capitalisme , Plon, 1964 ; Pocket, 2001.
Zeldin Theodore, Histoire des passions françaises. 2. Orgueil et intelligence , Éditions Recherches, 1978 ; Payot & Rivages, 2003.
Zweig Stefan, Érasme. Grandeur et décadence d’une idée , Grasset, 1935 ; Livre de Poche, 2004.
Partie 3 – Orientation
Albertini Pierre, L’École en France du XIX e siècle à nos jours, de la maternelle à l’université , Hachette, 1992 ; 2006.
Beaud Stéphane, 80 % au bac… et après ? La Découverte, 2003.
Blanquer Jean-Michel, Construisons ensemble l’école de la confiance , Odile Jacob, 2018.
Charlot Bernard et Figeat Madeleine, Histoire de la formation des ouvriers , Minerve, 1985.
Dubet François, L’École des chances. Qu’est-ce qu’une école juste ? Seuil, 2004.
Ensemble, l’éducation , Semaines sociales de France, Actes de la 91 e session, 2017.
« L’enseignement technique et professionnel, repères dans l’histoire (1830-1960) », Emploi-Formation , numéro spécial (27-28), 1989.
Gaulejac Vincent de, Travail, les raisons de la colère , Seuil, 2011.
Jellab Aziz, L’Émancipation de la réussite scolaire. Pour un lycée professionnel de la réussite , Presses Universitaires du Mirail, 2014.
Lelièvre Claude, Histoire des institutions scolaires (depuis 1789) , Nathan, 1990.
Lembré Stéphane, Histoire de l’enseignement technique , La Découverte, 2016.
Malier Yves, Reconnecter la formation à l’emploi. Le chômage des jeunes n’est pas une fatalité , Presses des Mines, 2017.
Prost Antoine, L’Histoire générale de l’Enseignement et de l’ Éducation en France , Nouvelle Librairie de France, G.-V. Labat Editeur, 1981. Tome 4.
Prost Antoine, Éducation, société et politique. Une histoire de l’enseignement en France de 1945 à nos jours , Seuil, 1992.
Réinventer le travail , Semaines sociales de France 2013, Bayard, 2014.
Sennett Richard, Le Travail sans qualités , Albin Michel, 2000 ; 10/18.
Autres ouvrages consultés pour cette étude
Essais sur le travail
Arendt Hannah, Condition de l’homme moderne , Calmann-Lévy, 1961 ; Pocket, 2011.
Blandin Tiffany, Un monde sans travail ? Seuil – Reporterre, 2017.
Bories Christel, L’Industrie racontée à mes ados… qui s’en fichent , Dunod, 2016.
Favereau Olivier (dir), Penser le travail pour penser l’entreprise , Presses des Mines, 2017.
« Gaston, un philosophe au travail » , Philosophie Magazine (Hors-Série), 2018.
Gorz André, Métamorphoses du travail. Critique de la raison économique , Galilée, 1988 ; Folio Gallimard.
Graeber David, Bullshit Jobs , Les Liens qui libèrent, 2018.
Lallement Michel, L’Âge du faire. Hacking, travail, anarchie , Seuil, 2015.
Linhart Danièle, La Comédie humaine du travail. De la déshumanisation taylorienne à la sur-humanisation managériale , Erès, 2015.
Méda Dominique, Le Travail, une valeur en voie de disparition , 1995 ; 2010, « Champs » Flammarion.
Noiriel Gérard, Les Ouvriers dans la société française, XIX e -XX e , « Points » Seuil, 2002.
Parias Louis-Henri, Histoire générale du travail, tome IV : La civilisation industrielle, de 1914 à nos jours , Nouvelle Librairie de France, 1961.
Pialoux Michel et Corouge Christian, Résister à la chaîne. Dialogue entre un ouvrier de Peugeot et un sociologue , Agone, 2011 .
Rifkin Jeremy, La Fin du travail , La Découverte, 2006.
Stiegler Bernard, L’Emploi est mort, vive le travail ! Fayard/Mille et une nuits, 2015.
Weil Simone, La Condition ouvrière , Gallimard, 1951 ; « Folio », 2002.
Romans sur le travail
Beinstingel Thierry, Retour aux mots sauvages , Fayard, 2010.
Bégaudeau François, En guerre , Verticales, 2018.
Bon François, Sortie d’usine , Minuit, 1982.
Kaplan Leslie, L’Excès-l’usine , P.O.L., 1987.
Kerangal Maylis de, Naissance d’un pont , éditions Verticales, 2010.
Kuperman Nathalie, Nous étions des êtres vivants , Gallimard, 2010.
Marchand François, Plan social , Le Cherche-midi, 2010.
Salvayre Lydie, La Médaille , Seuil, 1993.
Biographie
L’auteur
Agrégée de lettres classiques, Laurence Decréau enseigne dans le secondaire avant de bifurquer vers l’édition. Elle se spécialise dans la vulgarisation scientifique, qu’elle publie ou traduit (Flammarion), puis dirige pendant sept ans le département « Culture, Communication » d’une grande école d’ingénieurs, l’ENSTA ParisTech. Cette expérience achève de la convaincre de l’absurdité des clivages – « scientifique/littéraire », « abstrait/concret », « manuel/intellectuel », et de leur nocivité.
Elle est l’auteur de L’Élégance de la clé de douze. Enquête sur ces intellectuels devenus artisans, Lemieux éditeur, 2015.
Laurence Decréau, Tempête sur les représentations du travail, Paris, Presses des Mines, 2018.
ISBN : 978-2-35671-540-1
ISSN : 2495-1706
© Presses des Mines – Transvalor, 2018
60, boulevard Saint-Michel – 75272 Paris Cedex 06 – France presses@mines-paristech.fr
www.pressesdesmines.com
© La Fabrique de l’industrie
81, boulevard Saint-Michel -75005 Paris – France info@la-fabrique.fr
www.la-fabrique.fr